
Table des matières
Vrai travail
Le Collectif Occasionnel a organisé en Suisse deux expositions qui présentaient les oeuvres de personnes à la fois artistes et travailleureuses du sexe. Cet ouvrage prolonge leur travail en proposant des textes et des entretiens avec des Tds ou des alliéxes. Permettant l’auto-représentation des personnes interrogées, les entretiens mettent en lumière la pluralité des pratique du travail du sexe, mais aussi l’importance de construire des solidarités travailleuses, des outils pour défaire les stigmates et des perspectives de luttes intersectionnelles.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 27/01/26 à 14 h 53.
- Note sur l’écriture inclusive
- Blow jobs are real jobs[1] — Introduction
- Matchs, entretien —
- La stratégie de l’autonomie, tutte des travailleur·euses du sexe des deux côtés de l’Atlantique —
- On est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime, entretien —
- Le placard ou le stigmate, visibilités et enjeux du coming out des TdS —
- Il y a bien quelques souminateurs qui essaient de dépasser les limites, entretien —
- Zusammen sind wir stark: Gemeinschaft und Solidarität in der Sexarbeit — (de)
- L’union fait la force : communauté et solidarité dans le travail du sexe — (fr)
- On ne se rend pas compte à quel point le travail d’archivage est important, entretien —
- Ponte en mis tacones n° 2, exctrato — (es)
- Ponte en mis tacones n° 2, extrait — (fr)
- Tant que tu dis pas je t’aime, ils ne pourront pas porter plainte, entretien —
- Payez nous ! Les enjeux d’une justice économique —
- Je suis un fils de pute et fier de l’être entretien —
- Pouvoir des villes : pour une lutte locale —
- J’ai du mal à savoir si le sexe est un événement ou non —
- Je pense que c’est aussi sacré qu’être bonne sœur, entretien —
- Offrande à oyá —
- Annexes
Note sur l’écriture inclusive
Nous avons choisi d’utiliser une typographie incluant des glyphes inclusifs, mais nous avons choisi de garder certains textes avec les accords utilisés à l’oral pour retranscrire au mieux les paroles des personnes interviewées. Nous avons fait le choix de garder le masculin pour parler des clients, car c’est de cette manière que ce mot est en très grande majorité utilisé par les personnes concernées par le travail du sexe.
Blow jobs are real jobsTraduction littérale : « Les pipes sont un vrai travail. » Nous avons emprunté ce titre à un slogan inscrit sur une banderole du CATS/SWAC, Comité Autonome du Travail du Sexe, basé à Montréal, Canada. — Introduction
Notre collectif, le Collectif Occasionnel est formé par trois personnes, Charlotte, Oélia et Constance. Il existe sous la forme légale d’une association basée à Genève, en Suisse, depuis 2021. Nous avons monté notre collectif par affinités, nous avions tous·tes des liens entre nous avant de nous réunir autour de différentes activités comme l’édition d’un fanzine ou l’organisation d’une résidence en mixité choisie. Ayant tous·tes été étudiant·es dans des écoles d’art, nous sommes proches du milieu artistique, et nous en connaissons quelques codes. Nous sommes travailleur·euses du sexe (TdS), ex-travailleur·euses du sexe ou allié·es.
En 2020, nous avons postulé ensemble pour reprendre la direction artistique d’un espace d’art contemporain à Genève, Forde. Si notre candidature n’a pas été retenue, un de nos projets principaux était une proposition d’exposition sur les liens entre art et travail du sexe. Ce projet avait notamment été déclenché par le suicide de l’artiste Maïa Izzo-Foulquier. Maïa était artiste, travailleuse du sexe et porte-parole du STRASS (le Syndicat du TRAvail Sexuel, basé en France). Elle prenait la parole publiquement sur sa condition d’artiste et de travailleuse du sexe, le partageait dans son travail. Son œuvre, et notamment ses textes, ont fortement influencé les intentions de notre collectif.
Suite à cela, nous avons été encouragé·es par Ramaya Tegegne, membre du comité de Forde et artiste, à proposer notre projet autour de Maïa et du travail du sexe à la nouvelle équipe de Forde.
La préparation de cette exposition a permis de poser les bases de ce que nous souhaitions faire en tant que collectif : porter un discours accessible au grand public, parler de travail du sexe et soutenir financièrement des artistes TdS. Tout cela, au-delà d’un regard glamourisant ou misérabiliste, que nous voulions, en somme, déstigmatisant, au plus proche de la multitude de complexités et de réalités que revêt cette activité. L’exposition proposait aussi un cycle de projections, deux tables rondes, des lectures et a donné lieu à la production de podcasts diffusés ensuite par la librairie La DispersionLa Dispersion est une librairie d’art et de pensée critique basée à Genève., sur radio 40radio 40 est une webradio associative qui a vu le jour pendant le premier confinement, basée à Lausanne, en Suisse. et sur le site de ProCoReProCoRe est le réseau national suisse de soutien aux travailleur·euses du sexe..
Si nous voulions axer le propos de notre collectif sur la question du travail, c’est aussi qu’il se situe pour nous à la croisée de plusieurs autres problématiques politiques liées au féminisme, à l’anti-capitalisme, aux conditions économiques de l’existence, à l’antiracisme et à la lutte des classes. Cette transversalité nous a ainsi permis de penser le TdS au regard de bien d’autres sujets qui concernent les personnes avec qui nous avons travaillé depuis 2021.
Ainsi, nous avons dès le départ pensé notre collectif comme un outil pour proposer un soutien financier à des artistes également TdS, qui n’ont pas nécessairement accès à des soutiens en production artistique. Les artistes invité·es à Argent Facile faisaient pourtant partie de notre réseau plus ou moins proche. Nous avons invité des gens que nous connaissions, certain·es avaient également étudié dans des écoles d’art ou venaient de milieux similaires aux nôtres, majoritairement blanc·hes. Les artistes étaient tous·tes européen·nes donc documenté·es, avaient certaines ressources pour faire de l’art. Dans le cadre de cette première exposition, nous avons donc d’abord montré des réalités assez homogènes quant au travail du sexe.
Notre volonté pour Argent Facile était d’abord de mobiliser des ressources et des savoirs sur le TdS, recouvrant diverses manières de travailler. Elle avait pour but de participer à la visibilisation des thématiques liées au métier, sachant qu’il n’y avait pas eu d’évènements similaires, à notre connaissance, depuis longtemps à Genève ni en Suisse romandeNous avons eu connaissance d’une exposition avec des artistes et TdS qui a eu lieu à Berne dans les années 2000, mais n’avons pas retrouvé davantage de traces.. La programmation avait pour ambition d’être accessible à un public large, pas nécessairement familier du sujet, de façon à ce qu’iels puissent apprécier l’exposition et tous les évènements attenants. Juste après l’exposition, nous avons mené notre premier projet d’édition en collaboration avec la librairie La Dispersion grâce à la publication du livre de La Diabla, Ponte en mis tacones, qui a profité d’une importante visibilité médiatiqueCharlotte Fossard, « Mets-toi dans mes talons”, un récit autobiographique au cœur du travail du sexe..
Notre deuxième exposition, intitulée 200 Roses, a eu lieu en novembre 2023, à l’espace Eeeeh ! à Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse. Pour cette exposition, nous avons fait le choix de l’appel à participation, que nous avons diffusé uniquement auprès des associations de soutien aux TdS en Suisse, en France, en Belgique et au Canada. Cette méthode peut être controversée car elle demande justement aux artistes de fournir un travail gratuit. Il se trouve que nous avons eu la possibilité d’accepter toutes les contributions qui nous ont été proposées et par là, de faire également la connaissance d’artistes en dehors de nos réseaux habituels. La plupart n’avaient pas fait d’école d’art et n’étaient pas non plus intégré·es dans des réseaux d’art contemporain. Cette démarche avait donc pour but de sortir de nos liens affinitaires et d’aller à la rencontre de TdS plus isolé·es, pas nécessairement en lien avec le milieu militant non plus. Nous voulions produire une exposition généreuse et hétéroclite avec des esthétiques différentes. Cependant, cette exposition était aussi moins visible et moins bien financée que la première, notamment pour des raisons administratives cantonales, liées aux politiques locales du financement culturel.
Parler de travail du sexe, c’est bien sûr parler de travail avant tout, ce qui est d’ailleurs l’objet principal de ce livre. Quand le travail du sexe est glamourisé, notamment à travers des productions médiatiques ou parfois, certains discours féministes, il pourrait presque passer pour un travail émancipateur, où l’on gagnerait beaucoup d’argent tout en se faisant beau·elle et en fréquentant de riches clients, respectueux et bienveillants. S’il est vrai que, grâce au TdS, certain·es ont accès à un métier qui leur permet de bien gagner leur vie, d’organiser leur temps comme iels le souhaitent, et que nous nous efforçons à montrer que le TdS n’est pas nécessairement traumatique ou exploitant, il reste un travail. Or, notre collectif se place dans une vision critique de cette valeur du travail. Dans notre démarche, nous souhaitons mettre en avant une notion centrale : montrer en quoi le travail du sexe engendre aussi des problèmes et qu’il n’est pas forcément émancipateur.
Ainsi, si nous souhaitons sortir d’un discours binaire qui voudrait stigmatiser le TdS comme systématiquement subi par les personnes qui le pratiquent, nous ne sommes pas toujours en accord avec celleux qui le porteraient comme un moyen de se soustraire aux rapports capitalistes ou comme une démarche intrinsèquement féministe. Nous remarquons également que ce discours, s’il se veut à la base bienveillant et empouvoirant, n’est souvent pas porté par des personnes concernées directement par le TdS, et qui ne prennent pas en compte certaines réalités du métier.
Lorsque les membres TdS de notre collectif discutent entre collègues, iels en viennent souvent au même constat : ce travail est parfois horrible et dur, voire dangereux, et d’autres fois intéressant et agréable, comme n’importe quel emploi finalement. Nous souhaitons cependant aborder aussi les impacts positifs que peut avoir la pratique du TdS. Ce sont donc les multiples facettes de cette réalité que nous voulons mettre en avant ici.
Tout au long du travail sur ce livre, nous avons souhaité intégrer des entretiens avec des personnes et des collectifs de notre entourage, ou avec qui nous avons déjà travaillé par le passé. Ces entretiens portent des voix situées. Le choix de retrouver des personnes que nous connaissions s’est fait car nous voulions pérenniser des liens que nous avions déjà, et voir aussi quelles évolutions ont eu lieu entre nos premières rencontres et maintenant. Vous aurez donc l’occasion de lire notamment des témoignages d’une travailleuse de rue, d’une employée de chez Marc DorcelMarc Dorcel est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de films pornographiques., d’une dominatrice qui travaille en Colombie, d’une travailleuse en salon à Genève et d’autres témoignages qui nous semblaient nécessaires pour englober une certaine réalité. Nous avons fait le choix éditorial de garder une forme d’oralité, bien que certains propos aient pu être reformulés pour une fluidité de lecture, toujours en accord avec leurs auteur·ices. Nous avons aussi proposé à certain·es d’entre elleux de produire des contributions plus longues, sous forme de carte blanche. Évidemment, nous n’avons aucunement l’ambition de prétendre à une exhaustivité sur ce que serait ce vrai travail.
Ce livre est le résultat de quatre années de travail en collectif, qui nous ont confronté·es aussi à des questionnements, des impasses parfois, des contradictions. Tous les échanges que nous avons eus ces dernières années nous ont permis d’agrandir notre boîte à outils politique, en tant que militant·es mais aussi en tant que travailleur·euses dans le milieu culturel, et nous souhaitons pouvoir les mettre à disposition aujourd’hui.
Nous souhaitons remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidé·es pendant ces quatre années d’activité que ce livre souhaite clore, au moins temporairement : Jehane Zouyene, Marianne Schweizer et Eva-Luna Perez Cruz ainsi que tous·tes les membres de l’association AspasieL’association Aspasie est l’association de soutien aux TdS du canton de Genève. Elle a été créée en 1982, entre autres par Grisélidis Réal. et du Centre Grisélidis RéalLe Centre Grisélidis Réal est un centre d’archives et de documentation sur la prostitution, affilié à l’association Aspasie. ll existe sous sa forme actuelle depuis 2016. ; Stella Kerdraon, Théophylle Dcx, Lazare Lazarus, Fraiz, Vi, le collectif Of Manifesto, Cybèle Lespérance, Teodora Niculescu, Berthe de Laon, qui ont participé à la programmation d’Argent Facile, avec l’aide précieuse de l’équipe de Forde en place à ce moment-là. Nous remercions Olga Rozenblum et Lili Reynaud-Dewar pour l’aide à la diffusion et la préservation de l’œuvre de Maïa Izzo-Foulquier, à qui nous dédions nos pensées. Puis, nous remercions l’espace et le collectif eeeeh ! à Nyon, en particulier Chloé Démétriadès, Neige Sanchez et Jessica Vaucher, les participant·es de 200 Roses : AM Trépanier et le collectif CATS, Ave Fenix, La Diabla, le collectif La Grande Horizontale, Joël Defrance, Judith Aregger, Fanny Doucet, Imara, Zozo, la Law Clinic de l’Université de GenèveLa Law Clinic de l’Université de Genève est un programme du département de droit qui travaille sur les droits des personnes vulnérables. Elle vise notamment à produire des publications accessibles pour les personnes concernées., Leandra K, Piti Pietru, le collectif Les Putains de Rencontres, Roberta Monte, Jacquie Belen et Spangle Durac. Nous remercions également Julie Dubois, Caroline Aubry et Nelson Irsapoullé, membres du comité de l’association Collectif Occasionnel. Pour finir, nous remercions Maurane Zaugg, graphiste, Maud Bosset de l’imprimerie Bahnhofstrasse, ainsi que toute l’équipe des éditions Burn~Août, qui ont rendu la publication de ce livre possible.
Matchs, entretien —
Avec Zozo, nous avons réalisé un entretien, qui est comme une galerie de portraits des travailleur·euses du sexe qu’elle a croisé·es et qui l’ont marquée à différents moments de sa vie.
Collectif Occasionnel. Comment tu décrirais ton rapport aux autres travailleuses du sexe ? Autant dans la communauté, solidarité, que dans la compétition, et les conflits.
Zozo. Quand je rencontre une collègue, c’est la curiosité de la connaître qui me vient, savoir comment elle travaille. Il y a autant de manières de tapiner qu’il y a de tapins. J’ai envie de savoir son rythme, son rapport avec le tapin. Mais c’est délicat. Quand on rencontre une collègue, ça se fait plutôt avec discrétion pour éviter qu’elle puisse te faire un coup bas, avec les infos que t’aurais partagées avec elle. La plupart des gens que j’connais autour de moi, plus ou moins bien, savent. Parce que bon… ça y est, ma famille a lâché l’affaire. Ma réputation est déjà éclatée au sol, je n’ai plus rien à perdre. Du coup, les filles ne peuvent pas me faire de chantage : « Je connais ton nom, je sais où tu travailles. » Pour qu’une rencontre se développe en un réel échange amical, les opportunités sont rares. Ça n’arrive pas souvent et ça prend du temps d’arriver à de la confiance. Pour la plupart des filles avec qui j’ai travaillé au Vénusia, je ne connais que leur blase. On ne connaît pas nos vrais noms, ça n’a pas d’importance. Et puis, comme dans tout milieu de travail, il y a toujours des affinités, il y a des allié·es. Concernant la solidarité : nulle. Il faut d’abord qu’une confiance s’instaure. Ce n’est pas parce qu’on fait le même exercice qu’on est solidaires.
CO. Là, tu parles spécifiquement de ton rapport à tes collègues du VénusiaLe Vénusia est un salon érotique genevois, qui a été en activité de 2003 à 2024..
Z. La seule fois où j’ai rencontré un autre tapin en dehors du Vénusia, c’était mon ex-copine. On rigolait de nos expériences avec nos clis, on était escorts. Il y a eu une autre fois où j’ai rencontré une autre collègue : un groupe avait demandé deux filles, mais il ne s’était rien passé. Juste des jeunes bourges qui s’enjaillaient un samedi soir. Leurs parents n’étaient pas là. Ils vivaient au bord du lac. Comme ils nous avaient filé du cash et qu’il était tard, on avait dû aller en boîte pour casser les gros billets. Comme ça, on pouvait partager. Une fois arrivées, elle avait dit : « Y’a que des pauvres ici ! » C’était la première fois que je rencontrais un autre tapin.
Z. C’est global. Avant de faire le salon, je ne savais pas à quoi m’attendre, je me réjouissais de rencontrer des filles. Ce n’est pas non plus n’importe qui, qui entre au salon. Il y a beaucoup de filles qui postulent, pas beaucoup entrent. À l’intérieur, c’est les codes de la rue, ils ont le mérite d’être clairs. J’avais travaillé que dans des hôtels de luxe donc les codes de salons, je les avais pas. C’est ce qui me plaît beaucoup dans le tchaf, pas besoin de faire de salamalec.
CO. En fait, c’est aussi une vision un peu romantisée d’imaginer que tout le monde se tient main dans la main.
Z. On est toutes dans la même merde, mais est-ce qu’on est là les unes pour les autres ? À chacune ses enjeux. On en vient à cette question de la compétition et des conflits. Les jalousies et les coups bas, ça peut être très violent. Je ne pense pas que ce soit plus violent qu’ailleurs. C’est sûr qu’il y a des enjeux de thunes, de précarité. C’est un taff sur appel et ça plonge les gens dans la compétition, fort. Et puis, tu défends ta place un peu. Il n’y a pas de bizutage, mais une espèce de baptême du feu.
CO. Comment tu décrirais ce qui fait une bonne ambiance et ce qui fait une mauvaise ambiance ? C’est quoi pour toi la recette du bon équilibre ? Et que serait l’ingrédient perturbateur ?
CO. Par exemple, ce sentiment, il arrive à cause de quoi ? Pourquoi une fille commencerait à se sentir comme ça par rapport aux autres ? Qu’est-ce qui déclencherait ça chez une collègue, tu crois ?
Z. Samsha, elle dégage une énergie, waouh, faut pas l’approcher. Elle est grande, brune et cheveux longs. Quand elle est montée, c’est-à-dire qu’elle a fait le maquillage, les cheveux, qu’elle est prête pour la présentation, elle est impressionnante. Sa force est sa beauté. De prime abord, elle a l’air désagréable. Faut pas lui parler pour rien dire. Elle parle pas beaucoup, mais une fois ce mur tombé, elle est à l’écoute. Ça faisait plus de sept ans qu’elle travaillait au salon.
Elle met des heures à se faire les cheveux et le maquillage, il est hors de question qu’elle se mouille les cheveux ou le visage. Un jour, j’ai fait un duo avec elle dans l’jacuzzi (il était pas encore cassé), avec un mec, plus relou, tu meurs. Un blanc plein de fric, qui se croyait beau. J’en pouvais plus, je voulais juste que ça se termine. Elle le branlait, le regardait droit dans les yeux et lui bouffait le cerveau.
Elle fait des milliers de francs en une semaine. Elle peut enchaîner des 17 heures avec le même cli. Une fois qu’elle a pris le poisson, elle ne le lâche pas. C’est un des secrets de travail. Le cli l’a choisie et elle ne va pas le lâcher. Il va rester dans la chambre jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’argent. Je n’ai pas cette patience, le mec sort deux trois conneries, et hop, on va faire passer ça très vite, au mieux trente minutes. Y en a pas une meilleure qu’une autre, mais y en a qui sont fortes.
Z. L’Inconnue, je sais plus dans quel pays c’était, si c’était au Brésil ou à NY, ni si c’était le jour ou la nuit. Quand j’l’ai vue passer dans la rue, le temps s’est suspendu à sa démarche fière et vaillante. Grande, noire, en fringues collées-serrées et courtes, avec quelque chose de vulgaire, mais on aurait dit que rien ni personne ne pouvait l’atteindre. Elle faisait même un peu peur, ça m’a ébloui. Quelque chose de sûr et certain m’disait que c’était une pute. Ça décuplait sa force. Le jugement, les clients et la précarité n’avaient, ce jour-là, aucune prise sur elle.
Z. Lâleh, je l’ai rencontrée à un cours de self-défense en France, dans une assoCabiria est une association de santé communautaire lyonnaise à destination des TdS. pour les tapins. C’était Lâleh qui donnait ce cours adapté aux TdS, elle avait de vraies astuces pour se défendre. Des mouvements pour se sortir de certaines positions ou pour retourner la situation. C’était passionnant. Lâleh était très impliquée dans cette asso. Cette rencontre m’a ouvert de grosses fenêtres sur l’engagement politique que la puterie peut être. C’était comme découvrir un morceau de musique incroyable, pour ce que ça t’ouvre dans la tête. On a tissé une amitié, on a créé ensemble un compte Insta, amessrshttps://instagram.com/amessrs (à mes soeurs), collectif queer francophone de traduction et de diffusion des infomations de la révolution féministe en Iran.
Notre amitié a commencé le jour où j’ai reçu une grosse droite dans la tête de la part d’un client. Je n’savais pas qui appeler. Dans le cadre de cette asso, elle avait un bigo où elle était contactable h24. C’est génial, parce que les assos ne sont généralement pas ouvertes les weekends. C’était 6h du mat’, j’avais réussi à me dépatouiller du bail et je lui ai envoyé un texto. J’avais d’abord essayé une asso d’ici, mais c’était fermé jusqu’à mardi. Ce qui m’est arrivé, c’était dans la nuit du vendredi au samedi. Elle a répondu direct : « Il faut que tu fasses ci, ça, etc. », en mode clair et net. C’est la meilleure personne de terrain que j’ai rencontrée.
Z. J’ai beaucoup appris en la voyant faire. Comment elle loue le BNB, comment elle le pense, où est la porte d’entrée, où est la chambre par rapport à la porte d’entrée, en cas de détresse. Ce qu’elle dit dans l’annonce, le site, comment elle parle aux clis. Elle prend sa voix de secrétaire pour balnav’ ses clis, pour la plupart blancs, certains kiffent l’aspect carré et professionnel.
Z. Elîsaba, c’était dans un autre salon. C’est celle qui travaille le plus de toutes celles que je connais. Elle a un physique qui plaît au plus grand nombre. J’en ai rencontré d’autres, des filles. Rosette, parce qu’elle avait l’air très jeune, on aurait dit une petite fille… Et Lux, grande, fine mais chargée, blonde, beaucoup de maquillage et douce.
Une taille 1m65, 1m70 max, ça travaille beaucoup. Ils aiment que la fille soit plus petite qu’eux. Certains clis ont besoin d’avoir l’impression qu’ils ne sont pas le centième à te passer dessus, alors que d’autres ça les excite. Si elle ne fait pas 10 000 balles en une semaine, elle est pas contente. On rigolait bien. J’étais choquée par sa déter’. Elle fait des h24, dort deux heures, rafraîchit un peu son maquillage, et ça passe à trav’. Elle peut s’en faire dix dans la journée. Moi, au bout de deux, trois clients, ça y est, j’suis au bout d’mon string.
Z. J’ai grandi avec une magnifique photo d’elle, énorme, imprimée sur un tableau accroché au-dessus de son lit. Elle est en nuisette, sur un canapé. Elle travaillait en boîte de nuit, j’la voyais se préparer pour aller taffer et j’m’occupais de ma petite sœur. Brésilienne dans les années 1980 en Suisse, ça m’rendait ouf comment les vieux blancs la regardaient dans la rue. C’était exotisant et sale.
Un jour, au téléphone, j’ai discuté avec elle et elle m’a dit : « Pourquoi tu fais pas ça ? » En vrai, je cherchais un peu son approbation. Depuis toute petite déjà, j’avais envie de faire ça. Je me suis posé la question : « Est-ce que j’en ai vraiment envie, ou est-ce que cette envie a grandi en moi de par le contexte dans lequel j’ai grandi ? » Je me suis demandé si ce n’était pas juste de la fascination. À vrai dire, quand elle m’a dit ça, ça m’a soulagé autant que ça m’a fait mal. Mais j’avais sa bénédiction.
La stratégie de l’autonomie, tutte des travailleur·euses du sexe des deux côtés de l’Atlantique —
Le CATS est un comité de TdS montréalais qui milite pour la décriminalisation du travail du sexe et pour de meilleures conditions de travail dans l’industrie du sexe.
Dans les 50 dernières années, le mouvement des travailleur·euses du sexe s’est concentré sur les revendications de changement de modèle légal. Ainsi, plusieurs groupes ont mis la décriminalisation à l’avant-plan, souvent en priorisant une approche de lobbying auprès des partis politiques ou une approche légale à travers des procès en vertu des droits humains. Ces stratégies ont eu des résultats mitigés.
Le cas néo-zélandais en est un exemple. La Nouvelle-Zélande a longtemps été le seul pays du monde à avoir adopté la décriminalisation en 2003, aux côtés de quelques États australiens, et cette loi adoptée contient des écueils importants. En effet, il est clair que la stratégie du lobbying donne beaucoup de pouvoir aux partis politiques, empêchant le mouvement des TdS d’avoir une emprise sur la législation proposée. Cela a favorisé l’introduction d’une clause excluant les TdS migrant·es, sous prétexte d’adresser les préoccupations en lien avec le trafic humain. À ce sujet, Catherine Healy, membre fondatrice du New Zealand Prostitutes Collective, commentait :
« Pour nous, le processus parlementaire et le fait de voir un projet de loi entrer au Parlement et en ressortir avec trois débats intenses puis, être voté en tant que loi avec beaucoup de soutien était un nouvel environnement. […] C’était une décision très difficile [de retirer ou non notre soutien au projet de loi] que nous n’avions pas l’impression de pouvoir prendre, car nous avions le sentiment que cela échappait à notre contrôle, c’était dans la sphère parlementaire. »Jesse Dekel, « On ne laisse personne derrière : la bataille pour décriminaliser le travail du sexe des migrant·e·s en Nouvelle-Zélande : Une entrevue avec Dame Catherine Healy du New-Zealand Prostitutes Collective », dans CATS Attaque !, 2e édition, 2022.
Au Comité autonome du travail du sexe (CATS), nous tentons de reprendre le contrôle sur nos luttes par un changement de stratégie : prioriser d’abord l’organisation de syndicats autonomes dans les milieux de travail. De cette façon, nous souhaitons créer à la fois un rapport de force avec nos patrons, mais également avec l’État. Car si nous avons une base organisée et que nous revendiquons des droits sur nos milieux de travail, nous aurons éventuellement assez de force pour que l’État soit contraint à se positionner sur la question.
Nous avons envisagé deux moyens concrets afin de mettre en application cette stratégie. Dans un premier temps, nous réalisons des enquêtes militantes en milieu de travail afin de documenter les conditions de travail et les résistances déjà existantes dans les bars de danseuses et les salons de massage. Cet outil ne se limite pas à la collecte d’information : il nous permet d’aller à la rencontre de nos collègues, d’organiser desdiscussion sur nos conditions de travail, d’inventer de nouvelles revendications et de réfléchir à de nouveaux moyens d’action. Ce processus est une première étape vers la création de syndicats autonomes dans nos milieux de travail.
Dans un deuxième temps, nous souhaitons faire adopter des positions en soutien à notre syndicalisation dans les syndicats locaux afin de faire pression sur les centralesLes centrales syndicales sont les faîtières syndicales au Québec. qui ont des positions anti-travail du sexe. En 2014, l’adoption de la loi criminalisant les clients et les tierces partis au Canada avait été saluée par la plupart des centrales. Qu’on décide éventuellement de s’affilier ou non à ceux-ci, il reste qu’un appui des syndicats en faveur de la décriminalisation en est un de taille.
Dans les dernières années, nous avons eu la chance au CATS de partager nos analyses avec des groupes de TdS de différentes tendances situés dans différents pays européens. À l’automne 2023, trois militantes du CATS, dont moi, avons rencontré l’association Aspasie à Genève dans le cadre de l’exposition 200 Roses organisée par le Collectif Occasionnel. Puis, à l’automne 2024, je me suis rendue à Bruxelles pour rencontrer l’Union belge des travailleur·euses du sexe (UTSOPI), à Paris pour rencontrer le Syndicat du travail sexuel (STRASS) avec ma collègue Melina May et finalement, à Berlin pour rencontrer le collectif Sex Work Action Group (SWAG). Cette tournée européenne nous a permis de discuter avec des groupes qui évoluent dans trois modèles légaux différents – le modèle nordique, la légalisation et la décriminalisation – et de voir comment les stratégies au CATS y trouvaient écho.
Le modèle nordique
Le modèle nordique se revendique comme féministe et vise l’élimination de la prostitution. Il pénalise les clients et les tierces parties, c’est-à-dire toutes personnes tirant profit de la prostitution comme les chauffeurs, les patrons, les propriétaires et même parfois, les conjoints et les colocataires. C’est le modèle en vigueur entre autres en France, au Canada, en Suède et en Irlande. Il est préconisé par les féministes anti-prostitution qui privilégient une approche carcérale pour enrayer les violences, plutôt que l’organisation des TdS comme nous le revendiquons. Iels nous considèrent comme des victimes passives à sauver.
En septembre 2024, nous avons organisé un panel de discussion avec le STRASS à Paris pour discuter des lois en vigueur dans nos pays respectifs, de leur application et de la manière de les combattre. En France, la pénalisation des clients a été instaurée en 2016, soit deux ans après qu’une loi similaire ait été adoptée au Canada. Nos contextes légaux sont donc très similaires. Toutefois, des TdS ayant travaillé en France et au Canada nous ont confirmé que les lois s’appliquent de manière beaucoup plus laxiste de notre côté de l’Atlantique. À Montréal, il reste encore des milieux de travail organisés, comme les salons de massage qui ont pignon sur rue, dans lesquels se pratiquent des services complets. Dans ces espaces, il est plus facile d’entrer en contact avec ses collègues, ce qui facilite la mobilisation. De tels établissements ne sont pas tolérés en France, ce qui rend l’organisation plus difficile. Cela peut expliquer pourquoi, bien que le STRASS s’identifie comme un syndicat, les militant·es reconnaissent que l’approche de l’organisation des travailleur·euses a été délaissée depuis longtemps au profit du lobbying politique.
Toutefois, il n’est pas dit que ces espaces de travail demeureront encore longtemps au Canada. En effet, les arrondissements et les villes tendent à passer des règlements pour faire fermer ces établissements ou à ne plus donner de nouvelles licences. Il y en a donc de moins en moins. Il y a donc urgence pour nous de s’organiser au sein de nos milieux de travail, mais il est aussi impératif de réfléchir aux stratégies de luttes pour rallier les travailleur·euses qui sont autonomes ou uberisé·es, dépendant·es des plateformes en ligne pour travailler et plus isolé·es.
Durant ce panel, nous avons également abordé la stratégie des contestations judiciaires des lois sur le travail du sexe. Au Canada, une telle contestation est actuellement menée par l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe. En septembre 2023, le premier palier de cour, la Cour supérieure de justice d’Ontario, a statué que la loi était constitutionnelle. En France, c’est aussi la stratégie tentée par le STRASS qui a mené à des résultats similaires. En 2019, la loi a été déclarée constitutionnelle par le Conseil d’État et en 2024, par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). À la vue des résultats de ces deux contestations, il est légitime de remettre en question cette stratégieJ’élabore davantage cette critique dans : Adore Goldman, « L’autonomie qui se saisit : une question de stratégie ! » dans CATS attaque !, 4e édition, 2024.. D’autant plus que les procès ne favorisent pas la constitution d’une base militante organisée capable de rétorquer aux attaques. Visiblement, décriminaliser le travail du sexe requiert un rapport de pouvoir que le judiciaire ne peut pas nous garantir. Même si un projet de loi en venait à décriminaliser le travail du sexe en France ou au Canada, les TdS auront encore des luttes à mener comme on le verra avec l’exemple de la décriminalisation en Belgique.
Suite à la décision de la CEDH, les grands syndicats français ont publié un communiqué unitaire saluant la prise de position de la Cour. À ce propos, Maud Simonet, sociologue du travail, répondait dans une chronique :
« L’objet du syndicalisme n’est-il pas, pourtant, de représenter et de défendre les intérêts de la classe laborieuse dans toutes ses composantes telle qu’elle existe, ici et maintenant ? Ce ‹ déni de travail › n’apparaît-il pas d’autant plus problématique d’un point de vue syndical que, pour reprendre les termes mêmes du communiqué, ‹ la prostitution › concernerait ‹ surtout les femmes pauvres, isolées, migrantes, sans-papiers, mineures et trans ›Maud Simonet, « Prostitution et syndicats : au nom du féminisme, l’invisibilisation des travailleur·euse·s ? », Maud Simonet, Alternatives Economiques, 2024. ? »
À ce niveau, la stratégie du CATS de faire adopter des positions solidaires des luttes des TdS dans les syndicats locaux, afin qu’ils fassent pression de l’intérieur sur leurs centrales, a résonné chez nos camarades du STRASS. D’ailleurs, une lettre ouverte signée par des dizaines de syndicats et certaines organisations syndicales a été publiée en France le 4 octobre 2024 pour appeler à un changement de position dans les syndicats :
« Tout comme nos syndicats ont fini par reconnaître le droit à la syndicalisation des étudiant·es, des chômeur·ses, des migrant·es sans papiers ; ils doivent à présent reconnaître les travailleur·ses de l’économie informelle, et donc les travailleur·ses du sexe, au sein de la classe des travailleur·euses. »Collectif, « Syndicalistes, donc solidaires des travailleur·euses du sexe ! », 2024.
La légalisation
La légalisation est un modèle légal qui permet la prostitution dans un certain cadre limité par l’État. On pense notamment à l’obligation d’obtenir un permis pour exercer le travail du sexe, à l’établissement de zones où on peut le pratiquer ou à des tests psychologiques et de santé obligatoires. C’est le modèle en vigueur notamment en Allemagne, en Suisse et au Pays-Bas.
La légalisation n’est ni préconisée par les militant·es anti- prostitution, ni par les TdS. Pour les premier·es, il s’agit de prostitution sanctionnée par l’État ce qui va évidemment à l’encontre de ce pour quoi iels militent, l’abolition totale. Pour les second·es, le contrôle social exercé par l’État sur la vie des TdS dans ces pays est une violence et au final, peu d’entre elleux s’y plient. La majorité de l’activité reste donc illégale.
Par exemple, les militant·es du SWAG à Berlin m’ont parlé des examens psychologiques annuels obligatoires à l’obtention d’une licence, une pratique qu’iels qualifiaient d’humiliante. Cette licence permet de travailler dans les bordels accrédités par l’État, mais ne permet pas d’être indépendant·e, puisque les exigences pour faire accréditer son lieu de travail sont sévères. Par exemple, les TdS qui souhaitent travailler en incall doivent avoir des sorties de secours ce qui n’est pas le cas des appartements privés. Les TdS possédant une licence s’exposent donc à des descentes policières à leur domicile, car l’État veut s’assurer qu’iels n’y travaillent pas. Bien sûr, pour plusieurs personnes, dont les travailleur·euses migrant·es, s’enregistrer auprès de l’État n’est même pas une option.
Puisque les féministes carcéralesOn entend par féminisme carcéral l’idée que l’augmentation de la répression et des peines pénales sur les auteur·ices de crimes ou délits sexistes participera à la réduction de ces agressions. n’apprécient pas non plus la légalisation, le modèle nordique est une épée de Damoclès qui pèse sur les TdS travaillant dans ces États. Lors de mon passage en Allemagne, le gouvernement annonçait la possibilité de passer une nouvelle loi pour criminaliser les clients et les tierces parties, ce à quoi le SWAG s’apprêtait à riposter. Iels doivent donc se battre tant contre la légalisation que contre le modèle nordique.
Finalement, j’ai eu l’occasion de discuter avec mes hôtes de syndicalisation des TdS. Le SWAG est un collectif de TdS et d’allié·es qui s’est constitué en 2019. De taille similaire au CATS en nombre de militant·es, il est aussi focusé davantage sur l’action et la mobilisation plutôt que sur le lobbying. En 2020, des militant·es du SWAG ont créé une section locale de TdS dans le Frei Arbeiter·innen-Union (FAU) Berlin, une organisation anarcho-syndicaliste. Iels ont décidé à majorité de dissoudre leur section cinq ans plus tard.
Selon le collectif, le syndicat leur a permis d’accomplir plusieurs actions. Iels ont pu adresser des conflits de travail et ont eu beaucoup de gains face à des patrons problématiques, des clients abusifs ou en termes de droit à l’image. Le syndicat leur a également permis de tenir des activités d’aide mutuelle. La dissolution de la section a plus à voir avec les structures de la FAU selon un communiqué publié par le collectif. Le collectif souhaite continuer les activités du syndicat de façon autonome. Cette expérimentation remet en question la nécessité de s’affilier à une centrale, car profiter des ressources de ces organisations vient nécessairement avec des exigences bureaucratiques. Il s’agit d’une expérience dont nous avons des leçons à tirer en tant que mouvement.
La décriminalisation
La décriminalisation est le modèle légal revendiqué par le mouvement des TdS. Plutôt que d’encadrer le travail du sexe par de nouvelles lois, on utilise le cadre légal déjà en place pour réguler l’industrie, comme les lois du travail. Jusqu’à récemment, seule la Nouvelle-Zélande et certains États australiens avaient décriminalisé le travail du sexe. En 2022, la Belgique est devenue le premier État européen à adopter la décriminalisation. Depuis 2024, les TdS ont le droit de signer un contrat de travail et ont accès aux protections sociales comme le chômage, les congés de maternité, les cotisations de retraite, etc. De plus, on leur a accordé des protections supplémentaires auxquelles les autres travailleur·euses n’ont pas droit, comme la possibilité de rompre leur contrat de travail à tout moment sans préavis et sans perdre leurs indemnités de chômage. Bref, il s’agit indéniablement d’un gain.
Toutefois, selon UTSOPI, la lutte n’est pas finie. Au plan local, les communes tentent toujours d’enrayer le travail du sexe de l’espace urbain, soit en évitant de délivrer des permis pour les établissements où il se pratique ou en imposant l’obtention de licences aux TdS. Un cadre qui ressemble à la légalisation est donc en train de s’instaurer dans certaines localités. Ces politiques s’inscrivent plus largement dans un processus de gentrification. De plus, il est évident que les travailleur·euses sans papiers ne sont pas inclus·es dans la nouvelle loi, puisqu’iels ne peuvent pas travailler légalement en Belgique. La politique de tolérance, qui primait avant la décriminalisation, était arbitraire, mais avait pour avantage d’être appliquée de manière laxiste envers les TdS migrant·es qui travaillaient dans les vitrines des quartiers nord de Bruxelles. UTSOPI espère que la dépénalisation ne mènera pas à une politique de la traque.
Bien sûr, ces enjeux ne devraient pas nous empêcher de revendiquer la décriminalisation, qui est le modèle légal où notre organisation est la plus facile. Mais force est de constater que si nous ne sommes pas organisé·es, nous nous exposons toujours à des reculs. L’auto- organisation dans les milieux de travail a l’avantage de permettre une riposte face aux employeurs, aux différents paliers de gouvernements et la défense de nos collègues, peu importe leur statut d’immigration.
Vers l’auto-organisation de nos milieux de travail
Il serait illusoire de penser que la décriminalisation enrayerait toutes les violences dans l’industrie du sexe. L’exploitation n’est pas le produit de la criminalisation, elle est inhérente à l’expérience du travail en général. La différence dans l’emploi légal est le pouvoir qu’ont gagné les travailleur·euses en s’organisant au fil des années contre les abus patronaux et étatiques.
Bien sûr, la criminalisation met un frein à notre organisation. Il est beaucoup plus difficile de confronter son patron quand cela peut mener à une descente policière et à la perte de son gagne-pain. Mais nous ne saurions nous contenter des protections minimales accordées aux travailleur·euses précaires. Seul·es face à nos employeurs, peu d’entre nous se saisiront de leurs droits.
L’auto-organisation sur nos milieux de travail et la création de syndicats autonomes est la seule façon d’obtenir des conditions de travail dignes de ce nom. Pour cela, il est essentiel de rompre avec les happy hookers et ne plus avoir peur de nommer nos mauvaises conditions de travail. Trop nombreux·ses sont les TdS qui, au nom de la reconnaissance de la profession et de la déstigmatisation, vont vanter les bienfaits de l’activité. En clamant leur épanouissement, ces travailleur·euses mettent de côté celleux pour qui le travail n’a rien de libérateur.
Pour nous, le fait de se positionner comme travailleur·euses revêt un aspect stratégique. Sex work is work – le travail du sexe est un travail – n’est pas un slogan creux que nous brandissons en affirmant que nous sommes heureux·ses à la job. Au contraire, c’est bien parce que nous considérons le travail comme relevant fondamentalement de l’exploitation que nous choisissons ce champ lexical. C’est parce qu’il nous permet de dénoncer les violences les plus sordides et les emmerdements les plus banals. Et c’est surtout parce qu’il nous place, nos collègues et nous, au cœur de notre libération ; pas l’État ni la police !
On est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime, entretien —
Nous avons rencontré Piti Pietru la première fois lors d’une session de séminaire de la Law Clinic à laquelle nous participions aussi, puis nous l’avons invitée à intervenir lors d’une table ronde sur les rapports avec la police dans le TdS pendant l’exposition 200 Roses .
Piti Pietru. Je m’appelle Piti. Je suis travailleuse du sexe à Genève et dans toute la Suisse romande. Mon activité a longtemps été principalement un travail de rue, mais aussi via Internet. Aujourd’hui, même si je continue à travailler dans la rue, mes revenus proviennent majoritairement des sites d’escorting. Le travail a évolué, ce qui a modifié mes habitudes.
CO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta manière de travailler ? Tu disais que tu avais un travail de rue et que maintenant, tu travailles aussi sur Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s’organise dans ta vie ?
Je commence à me préparer vers 18h : repas tôt, douche, maquillage. Le choix des tenues n’est pas anodin : j’adapte les couleurs et les styles en fonction des saisons et de ce qui attire le plus de clients. J’arrive dans la rue vers 22h, car avant, la plupart des hommes sont encore avec leur femme. Mes horaires vont généralement de 22h à 4h, 4h30, voire 5h, selon mes gains. Avec le temps, j’ai changé ma façon de faire : avant, je restais jusqu’au bout, mais maintenant, dès que j’ai atteint mon objectif financier, je rentre. Parfois dès 2h, parfois plus tard, mais rarement après 5h, car il n’y a plus vraiment de clients à ce moment-là.
PP. L’argent, tout simplement. Comme dans n’importe quel métier, il faut s’adapter aux nouvelles réalités. Le monde a changé, et on ne peut plus travailler comme avant. Il y a de moins en moins de clients dans la rue. Je remarque qu’ils sont souvent très jeunes ou très âgés, mais qu’il y a peu de personnes d’âge moyen.
CO. Peux-tu nous parler de ton travail de rue, de ton rapport aux clients et à la ville ? Est-ce que tu pourrais décrire l’endroit où tu travailles, pour donner un imaginaire à celleux qui ne connaissent pas Genève ?
PP. Je travaille sur le boulevard Helvétique, à Genève. C’est un grand boulevard qui relie le quartier de Rive à l’hôpital, avec deux fois deux voies, une piste cyclable et des parkings entre les voies. Je me tiens presque au milieu du boulevard, près d’un petit passage, à côté d’une école d’art. Ce passage nous permet de nous isoler un peu des regards des passant·es.
C’est un lieu stratégique, très fréquenté, proche de la vieille ville. Il y a beaucoup de voitures, de vélos et de piéton·nes. Selon les jours, on croise des gens de passage ou des personnes qui viennent spécifiquement pour nous. On repère vite les clients potentiels : ceux qui ralentissent ou s’arrêtent contrastent avec ceux qui passent rapidement.
Sur le boulevard Helvétique, je me tiens dans la phase montante. Les phares des voitures éclairent régulièrement nos visages, avec une voiture toutes les 30 secondes, moins entre 3h et 4h du matin. Le travail de rue, c’est surtout de l’attente : 99 % du temps, on ne fait rien. Parfois, je passe 7 à 8 heures dehors sans voir un seul client. Mentalement, c’est dur : on est là pour gagner de l’argent, mais il fait froid, on s’ennuie, et on ne fait aucune rentrée.
L’interaction avec les clients, en revanche, est formidable. J’ai grandi dans la rue, vécu en squat, donc ce monde-là m’est familier. Les relations y sont franches, directes, mais humaines. Ce n’est pas du tout comme dans les clichés pornos. Les clients arrivent, disent bonjour, on discute. Ils cherchent plus qu’une simple prestation sexuelle. Ils cherchent du réconfort, de l’écoute, un contact humain que la société ne leur offre pas toujours.
CO. Peut-être que ça t’évite le secrétariat que tu peux avoir quand tu travailles sur Internet. Il y a une forme de spontanéité aussi dans cet échange-là ?
CO. Est-ce que tu accepterais de partager ton expérience avec tes collègues de travail sur le boulevard ?
PP. Il y a une relation un peu complexe avec mes collègues sur le boulevard. Globalement, on s’entend bien. On vient d’horizons différents, avec beaucoup de filles de l’Est et d’Amérique du Sud, ce qui crée un joli melting pot. Même si on ne parle pas toujours la même langue, on arrive à se comprendre. C’est un peu comme dans n’importe quel boulot : on se dit bonjour, on prend parfois un café ensemble, et on se voit même en dehors du travail. C’est une vraie ambiance de collègues avec des objectifs communs.
Cela dit, il y a aussi une certaine rivalité. Si un client choisit d’aller voir une autre personne, il ne viendra pas me voir. Cette dynamique crée des tensions de temps en temps. Les différences culturelles jouent aussi un rôle : les Sud-Américaines ont une attitude plus détendue, alors que les filles de l’Est sont plus strictes avec la loi.
Moi, étant trans, je n’ai pas la même clientèle, ce qui me permet de m’entendre avec tout le monde, même si parfois je me retrouve un peu entre les deux clans. En général, l’ambiance reste sympa, on s’envoie des messages pour Noël et tout. Mais il y a quand même une certaine ambiguïté : quand quelqu’un·e traverse une période difficile, comme un burn-out, iel peut se retrouver assez seul·e. Il y a des associations qui viennent en aide, mais au fond, la question reste : dans n’importe quel boulot, si quelqu’un·e craque, est-ce que ses collègues vont vraiment l’aider ?
CO. Oui, comme dans n’importe quel travail. Tu ne te sens pas responsable de tes collègues comme d’un·e ami·e ou d’un·e membre de ta famille.
On fait aussi attention à ne pas baisser nos tarifs, surtout à la fin du mois. Si on commence à faire ça, c’est un cercle vicieux. J’ai vu en France que certaines filles qui baissent leurs prix sont manipulées par des proxénètes. À Genève, si une nouvelle propose des prix trop bas, on lui fait comprendre que ce n’est pas acceptable. Et si nécessaire, on peut recourir à la force.
PP. Je ne connais pas très bien les Pâquis, mais pour le boulevard, il y a deux histoires qui expliquent notre présence. La plus romantique et jolie, c’est que la prostitution a toujours eu lieu là, notamment autour de la promenade Saint-Antoine. Avant, la rue parallèle s’appelait la rue des Vieilles Filles, et c’était le lieu d’origine de la prostitution à Genève. C’était aussi à l’entrée de la ville, ce qui explique peut-être cette tradition. L’autre histoire c’est que le quartier de Rive, qui était autrefois peu fréquentable et avec des logements pas chers, a attiré beaucoup de filles. Comme la zone plus basse était surveillée, elles montaient un peu plus haut, et c’est ainsi que le boulevard a évolué. Il y a un peu de vérité dans chaque version.
CO. Quelles évolutions as-tu pu observer depuis que tu as commencé à travailler dans la rue, que ce soit en France ou en Suisse, ces dix dernières années ?
PP. Il y a eu plusieurs périodes. En France, à une époque, on avait énormément de clients, parfois 10 à 12 dans une soirée. Si on voulait, on pouvait continuer, mais à 2h du matin, on allait en boîte de nuit. Les prix n’étaient pas beaucoup plus bas par rapport au coût de la vie, et on gagnait beaucoup d’argent. C’était une période relativement facile. Puis, avec les années Mitterrand, la situation a changé. Il y a eu un tournant puritain qui a graduellement réduit cette forme de liberté, ce qui a eu un impact sur la prostitution. À Genève, le changement a été moins marqué, mais il a quand même eu lieu.
La polarisation de la société a vraiment changé les choses, notamment sous Sarkozy avec la loi sur les clients de prostituéesLa pénalisation des clients de prostituées n’a pas été adoptée sous Sarkozy, mais sous Hollande avec la loi du 13 avril 2016. Le gouvernement Sarkozy a toutefois renforcé la répression de la prostitution de rue (LOPPSI 2, 2011)., ce qui a compliqué le travail pour nous. C’est à ce moment-là que j’ai quitté la France, car travailler sans macMaquereau, proxénète. est devenu impossible et les conditions sont devenues très violentes. La société s’est renfermée, et ça a eu des conséquences directes sur notre travail.
Les applications de rencontres comme Tinder ont aussi changé la donne. Avant, pour avoir du sexe rapidement, il fallait forcément passer par un·e TdS, mais maintenant, c’est beaucoup plus facile avec ces applications. Puis, le COVID a encore modifié la situation. Avant, j’avais 80 % de mes clients dans la rue et 20 % en ligne. Après le COVID, c’était l’inverse : 80 % en ligne et 20 % dans la rue.
PP. Oui, moralement, c’est devenu plus difficile. Il faut attendre plus longtemps et faire plus d’efforts pour se démarquer des autres. La compétition est plus rude et il y a moins de camaraderie entre nous. Il y a aussi moins de clients, donc c’est devenu plus dangereux. En plus, on nous identifie souvent à des images issues de sites comme YouPorn, avec des prestations plus compliquées que celles que l’on faisait avant.
PP. Oui, c’est compliqué pour moi. J’ai été dans la rue très jeune et j’ai toujours eu une relation difficile avec l’autorité, donc ma vision des rapports avec la police est très biaisée. Mais je vais essayer de prendre un peu de recul et ne pas dire que « tous sont des cons », même si c’est ce que je pense parfois.
Il y a plusieurs types de police. La BTPILa BTPI est la Brigade de lutte contre la Traite d’êtres humains et la Prostitution Illicite, corps de la police genevoise., qui est chargée de la prostitution, a des rapports presque normaux avec moi. Mais ils me contrôlent souvent, parfois de manière répétée, alors que je suis toujours la même personne. Je pense qu’ils ont des quotas à remplir, qu’ils se montrent.
PP. À Genève, pour travailler en tant que TdS, il faut se faire référencer à la BTPI. On doit se présenter à la police, donner nos empreintes et photos, et être inscrit·e·s dans un fichier spécifique des travailleur·euses du sexe. C’est absurde, parce qu’on est le seul métier à avoir un fichier à part, sans avoir commis de crime. Certains cantons ne le font même pas, c’est juste ridicule. C’est une loi qui change la relation avec la police. Quand ils nous cherchent dans ce fichier, c’est comme s’ils cherchaient des délinquant·es ou des gens qui veulent contourner la loi.
La BTPI contrôle deux choses : si on est bien référencé·es et si on n’a pas de poursuites en cours. Si on a une poursuite, on risque l’arrestation. Les contrôles varient, c’est parfois tous les jours, parfois on passe un mois sans les voir. Globalement, ça se passe bien, avec des échanges simples et cordiaux. Mais je ne suis pas sûre que je les contacterais en cas de gros problème, à cause de mon rapport à l’autorité. Par contre, la police municipale et les autres forces de l’ordre sont plus compliquées. On est des femmes dans la rue et souvent confrontées à des hommes machistes qui exercent une autorité abusive.
Les policiers parfois se postent avec leur gyrophare sans raison apparente, comme pour attraper des scooters. Parfois, ils viennent faire des remarques absurdes, comme une fois où j’avais mon pied sur la bande cyclable, ils m’ont envoyé une amende, que je n’ai jamais payée. Il y a aussi des lois floues concernant la prostitution, comme la distance à respecter avec les écoles ou le fait de racoler sous un abri de bus. Une amie a été amendée pour ça, car elle s’était abritée pendant un orage. L’application de ces lois est souvent confuse et dépend de l’interprétation des policiers.
La police joue souvent à un jeu où ils cherchent à nous coincer, parfois en attendant des heures pour nous attraper dans des endroits insignifiants, comme des petites cours. C’est une pression inutile. Mais quand il y a des vrais problèmes, comme des menaces avec une arme ou des agressions, ils sont absents. Récemment, une de nos collègues a été poussée et menacée avec un revolver, mais la police est arrivée 45 minutes après. La même chose s’est produite avec un homme portant une machette, où la police a mis 45 minutes à arriver. C’est frustrant, car on se demande si ce délai serait accepté si ça se passait dans une bijouterie.
On n’est pas pris·es au sérieux, ni par la population ni par la police, qui abuse souvent de son autorité. Cela vient d’un manque de connaissance de notre travail et d’une vision déformée de notre réalité. On est des femmes, souvent étrangères, et on devient une cible facile. Pourtant, je remarque que la police semble un peu plus consciente qu’avant, bien que ce soit encore difficile. La situation reste compliquée, comme on l’a vu avec l’affaire RoxaneL’affaire Roxane fait référence à un cas de viol et de séquestration commis par un policier genevois, en congé envers une TdS. Cette agression a eu lieu en 2018. La victime aurait été soudoyée par la police pour ne pas porter plainte. L’affaire est encore en cours d’instruction., une connaissance à moi.
CO. Tu as participé à des évènements publics ces derniers temps. Est-ce que tu serais d’accord de nous en parler un peu ?
PP. Je m’engage publiquement pour deux raisons. D’abord, d’un point de vue personnel, c’est important pour moi de ne pas m’isoler, surtout avec le passage du travail de rue à l’Internet. Je veux faire partie de cette société, et je sais que si j’attends que les autres m’y laissent ma place, ça n’arrivera jamais. Mais l’aspect le plus important est de faire connaître le travail du sexe pour que celleux qui viendront après moi soient perçu·es différemment dans la société. Je veux que la jeune génération comprenne la réalité du travail du sexe, démystifier les idées reçues et mettre en lumière la vérité.
J’ai l’âge et l’expérience nécessaires pour ne plus avoir peur de rien. Ma vie est ce qu’elle est, et je n’ai plus rien à perdre. Je profite donc de cette liberté pour m’exprimer. J’ai déjà fait des podcasts comme Le Monde de Piti et Les Jeudis du boulevard avec l’association Aspasie, dans lesquels on discutait, avec Judith [Aregger], de thématiques communes, les démystifiant. Je participe aussi à des travaux académiques avec des jeunes diplômé·es et je donne des interventions sur le travail du sexe à l’université. Par exemple, avec des doctorant·es, on a réalisé une étude sur les relations entre les habitant·es des Pâquis et les travailleur·euses du sexe.
On a aussi mené des entretiens qui ont donné lieu à une pièce de théâtre créée par Nina VallonQuand je passe, performance de Mélanie Fréguin et Nina Vallon, jouée au théâtre du Galpon, 2024., dans laquelle j’ai joué il y a quelque temps. J’espère vraiment que cette pièce vivra encore longtemps. J’essaie de contribuer à ma manière, avec ce que je peux faire. Si personne ne parle, rien ne changera. Ça me fait du bien, et ça fait du bien à la profession. Alors je ne vois pas pourquoi je m’en priverais.
CO. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou un sujet qui te vient à l’esprit ?
PP. Oui, il y a un thème qui est venu en filigrane, ce sont les enjeux de santé liés au travail du sexe. C’est un des travaux que j’ai réalisés avec des chercheur·euses de l’Université de Lausanne. Je pense qu’il y a des pathologies spécifiques aux TdS. Quand on parle de santé, on parle souvent de santé physique, surtout quand il s’agit de prostitution, qui est souvent vue comme un travail à risque. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit le cas. La rue a ses propres codes, et si tu les respectes, ça va. Bien sûr, il y a des risques, comme celui de l’agression, mais ça peut arriver à n’importe qui, à n’importe quel moment. Je pense que le véritable problème, c’est la santé mentale, qui est aujourd’hui la grande oubliée. On fait un travail où on est rejeté·es par la société, et ce rejet crée des traumatismes. C’est un double traumatisme parfois, parce qu’on vit ça en silence. On ne le dit à personne, et ça nous fait vivre une réalité différente de celle que les autres perçoivent.
Je trouve que le milieu LGBT nous comprend mieux, car elleux vivent aussi cette dualité entre ce que les autres perçoivent d’elleux et ce qu’iels sont réellement. C’est compliqué, et un·e psychologue pourrait analyser ça mieux. Mais il y a un vrai problème d’isolement. La société nous rejette, mais nous aussi, on s’éloigne. Par exemple, on passe la journée à attendre un client, ce qui rend difficile le fait d’avoir une vie sociale. Ça nous empêche de participer à des activités comme aller dans un club de sport, car un client peut nous appeler à tout moment. La santé mentale des travailleur·euses du sexe, c’est un sujet négligé, mais qui devrait être pris au sérieux. En plus, les clients nous confient parfois des histoires lourdes. Certains ont été violés, d’autres ont vécu des abus familiaux. C’est difficile à gérer. Et on n’a aucune formation pour cela, donc on prend tout sur nous.
Le placard ou le stigmate, visibilités et enjeux du coming out des TdS —
Lorsque l’on parle de coming outLe coming out (ou la sortie du placard) est l’annonce volontaire à son entourage de son orientation sexuelle ou de son identité genre. On utilise aussi ce terme dans le travail du sexe quand on révèle à son entourage que l’on fait ce métier., concernant les travailleur·euses du sexe, celui-ci peut revêtir plusieurs sens. Nous en avons, au moins, dénombré deux. À savoir, pour commencer, le coming out privé, celui que l’on fait auprès de l’entourage : des ami·es, des proches, des familles, des partenaires. Puis, il y a le coming out public, qui est le fait des personnes qui prennent la parole publiquement en tant que TdS.
On pourrait penser que cette deuxième forme de coming out précède le plus souvent la première, que les personnes qui décident de militer hors de l’anonymat, sont d’abord passées par l’étape de l’annoncer à leurs proches. Mais il existe certainement autant de cas de figures, et de manières de faire à ce sujet, qu’il existe de TdS.
À l’inverse, ne pas être out, du moins auprès de ses proches, est souvent décrit comme un lourd secret à porter. Un secret, dont on redoute qu’il soit un jour percé, pour les raisons évidentes liées au stigmate qui entoure le TdS. Cette quasi-double vie demande une organisation méticuleuse, et signifie devoir mentir la plupart du temps, comme pour justifier la manière dont cet argent a été gagné. On note aussi, que d’autres personnes ont un réel plaisir à vivre en portant ce secret, pour le sentiment d’immense liberté qu’il peut leur apporter.
Pour en revenir au principe de militer à visage découvert ou encore avec son nom, celui-ci est souvent impulsé par la nécessité de personnifier une lutte. C’est un sujet récurrent, qu’ont en commun beaucoup de milieux militants, et le TdS n’échappe pas à ces enjeux. S’agissant ici de fluidifier la communication avec le grand public, de mettre un visage sur certaines revendications ou récits de vie, le milieu militant TdS se voit particulièrement forcé d’afficher certain·es individus, en raison des thématiques qu’il porte, encore très loin de faire consensus. Même si l’on considère que c’est un bénéfice pour la cause en général, militer hors de l’anonymat, signifie également s’exposer à de considérables risques. Harcèlement, insultes, menaces : la haine putophobe peut prendre bien des formes, que les détracteur·ices les plus hostiles diffusent, autant en virtuel qu’en réel.
Tenir une banderole en manifestation, signer des textes, posséder un compte sur un réseau social, performer à visage découvert, parler à une table ronde publique : autant de manières de s’exposer à des représailles.
Une situation de violence et de harcèlement reconnue, est celle à laquelle Maïa Izzo-Foulquier a dû faire face, et qui est reconnue comme une cause de son suicide en 2019. Elle était une artiste pluridisciplinaire, une pute, et une membre du STRASS. Elle était également co-rédactrice du blog Ma lumière rouge, où on peut y lire une de ses dernières publications qui s’intitule Pourquoi je n’écris plus dans ce blogThelma Hell, « Pourquoi je n’écris plus dans ce blog », Ma lumière rouge, Libération, 2019.. Dans cet article, elle parle précisément des conséquences de son outing et du stigmate qu’elle a dû porter.
Mais la putophobie ne se circonscrit évidemment pas au cyberharcèlement. Elle peut tout aussi être intériorisée et se manifester au sein des cercles que l’on pourrait penser progressistes, ou dans lesquels on pourrait au moins prétendre se sentir en confiance. La stigmatisation n’y est alors pas clairement énoncée. Et le fait de considérer systématiquement le TdS comme marginal participe, de fait, à la normalisation de certaines réactions lorsque l’on annonce que l’on est TdS. On s’attend nécessairement à des répercussions sur la façon dont on pourrait désormais être perçu·es, au niveau sexuel, relationnel, etc. Alors qu’il pourrait en réalité en être tout autrement.
La question de la visibilité touche à celle de la starification, un phénomène assez répandu dans le milieu TdS, dès lors que l’on décide de s’afficher à visage découvert. Cette stratification se mesure, en quelque sorte, à la présence sur les réseaux sociaux, aux invitations à des évènements dédiés, mais aussi à combien une personne s’exporte, en tant que TdS, vers d’autres activités, pour y prendre la parole. On pense d’abord au milieu des arts vivants, des arts visuels, de l’édition, etc. Toutes ces interventions sont faites au nom de, le processus d’incarnation individualisée est toutefois inévitable. La principale raison étant tout simplement qu’il manque – numériquement parlant – de personnes qui acceptent de prendre ce rôle, on voit alors toute l’attention portée sur les quelques-un·es qui sont visibles.
On pourrait alors se demander qui sont ces personnes qui peuvent et veulent bien militer, agir, et évoluer vers d’autres sphères. De nouveau, sans vouloir dresser de portrait type ou de grandes généralités, on observe toutefois que la grande majorité des personnes qui s’expriment publiquement et prennent ensuite un espace important, sont celles qui ont des ressources. Comme dans tous les domaines, le TdS n’échappe en aucun cas aux dynamiques de hiérarchisation et de privilèges, et il est certain que la parole publique n’est pas forcément menée par les personnes les plus précarisées de la profession.
Un autre phénomène que l’on observe assez fréquemment est celui de la glamourisation, qui consisterait ici en une capitalisation esthétique sur sa propre pratique du travail du sexe.
Cette question est finalement très proche de celle de la fierté, car on pourrait les appréhender toutes deux comme des stratégies d’empouvoirement, face aux injonctions à la honte ou à la culpabilité et à la négation du libre arbitre.
Dans ce cas, comme dans bien d’autres, on ne peut pas réunir tous·tes les travailleur·euses du sexe sous un seul et même parapluie rouge. La possibilité d’esthétiser ou d’être fier·e de son propre métier est co-dépendante du respect et de la dignité avec lesquels il est également traité socialement. On ne peut donc pas mettre sur le même plan une personne qui exercerait en tant strip-teaseur·euse et une autre en tant que travailleur·euse de rue. Cela a également directement à voir avec l’exposition au danger, avec la reconnaissance de ce métier et des droits qui y sont liés, ou encore avec une certaine implication du corps vis-à-vis des clients. En d’autres termes, plus un métier va être considéré comme dégradant, moins il a de potentiel pour une quelconque capitalisation sociale ou esthétique, et moins il est visible aux yeux d’un plus large public.
Lors de la préparation de l’exposition 200 Roses, nous avons été confronté·es à une certaine limite de l’outing. Au début de la préparation de l’exposition, nous avons été mis·es en lien avec une artiste, anciennement TdS. Comme lors de notre première exposition Argent Facile, toutes les personnes exposées pratiquaient ou avaient pratiqué le travail du sexe, cela faisant partie du principe même de notre programmation. Cela ne nécessitait pas forcément que les personnes qui exposaient soient out, car une forme d’anonymat était possible, mais il allait de soit que leur travail artistique serait de facto associé au travail du sexe. Après quelques échanges téléphoniques, cette personne a finalement refusé de participer à l’exposition, préférant voir un jour ses poèmes et ses peintures publiés ou montrés dans un cadre où il ne serait pas question de contextualiser ensemble cette pratique artistique et son métier de travailleuse du sexe.
Cette situation a été vécue comme une sorte d’impasse, autant par nous que par elle. En voulant créer un espace de visibilisation des travailleur·euses du sexe, nous mettions quelqu’une face à une situation d’exclusion par son refus d’être associée au TdS dans une situation où elle avait l’opportunité de montrer son travail.
Il y a bien quelques souminateurs qui essaient de dépasser les limites, entretien —
Cet entretien a été réalisé avec Fraiz, un·e des artistes que nous avons invité·e à montrer une pièce lors de notre première exposition Argent Facile en 2022. Nous avons échangé autour de ses différentes activités de TdS et artistiques.
Fraiz. Actuellement, je ne fais que de la domination, en virtuel et en réel. Pour le virtuel, je travaille principalement via VTC (Vend Ta Culotte), et un peu via Twitter. Sur VTC, je réalise des vidéos solo ou bien parfois en collaboration avec mes clients réels. Je propose aussi des services spécialisés, principalement via Snap ou Skype, où je donne des ordres à mes clients. En réel, je reçois à domicile et pratique la domination.
F. Le BDSML’acronyme BDSM signifie Bondage Discipline / Domination Sadisme Masochisme et regroupe toutes les pratiques sexuelles tenant de jeux de domination et de soumission. m’intéressait déjà dans ma vie personnelle. Au début, je ne faisais que de l’escorting, mais je me suis rendu compte que j’étais attiré·e par la domination, même si je n’avais que très peu expérimenté cela dans ma vie privée. C’était quelque chose qui me fascinait énormément. En y réfléchissant, je pense que c’était une sorte de déclencheur : l’idée de dominer des hommes cis et de les faire payer pour ça me plaisait beaucoup. J’ai donc commencé à m’informer sur les pratiques, et j’ai constaté que j’avais une aptitude naturelle pour cela. Je me suis lancé·e, et dès le début, ça a bien fonctionné. Ce n’était pas une question de quantité de clients, mais de satisfaction personnelle dans la manière dont je réalisais les choses.
F. Je pense que j’avais envie de pratiquer davantage dans ma vie personnelle, mais je n’avais pas beaucoup d’occasions. Le fait de pouvoir dominer des hommes cis et de leur infliger des choses, tout en exerçant un contrôle sur eux, a joué un rôle de déclencheur. Je n’avais pas envie d’offrir ce plaisir gratuitement à des hommes cis. L’idée de les faire payer pour ça m’a aussi motivé·e. C’est d’ailleurs à ce moment-là que ma misandrie a commencé à se développer, ce qui a renforcé mon envie de dominer les hommes.
CO. Pour toi, qu’est-ce que cela change par rapport à l’escorting classique ? Comme tu as les deux expériences.
F. J’ai beaucoup moins de problèmes avec les clients de domination. Il y a bien quelques souminateurs (contraction de soumis et dominateur) qui essaient de dépasser les limites, mais ça reste mineur comparé à toutes les agressions que j’ai subies en tant qu’escort. Sur le plan de la sécurité, cela change énormément. Même lorsque je me fais reconnaître dans la rue, les clients restent respectueux dans leur approche. Ils viennent me voir, mais ils me vouvoient et se placent d’emblée en tant que soumis. Ce n’est pas du tout comme avec les clients d’escorting, où je me faisais souvent harceler ou attaquer, simplement parce que je ne répondais pas ou qu’ils essayaient de m’aborder de manière agressive. En fait, cette nouvelle activité m’a apporté beaucoup plus de sécurité.
Cela dit, c’est moins facile que l’escorting. Avec l’escorting, je pouvais complètement me détacher, j’exécutais une prestation sexuelle sans trop réfléchir. En revanche, la domination demande beaucoup plus de préparation. Il faut que je m’assure d’avoir le bon matériel, surtout si des éléments comme le latex sont impliqués. Il y a aussi toute une préparation mentale à faire concernant le déroulé de la séance : comment je vais gérer le temps, comment l’histoire va s’articuler, et comment je vais jouer mon personnage. Je suis une personne plutôt chill et sympa, il faut vraiment que j’entre dans le rôle de domDom signifie dominateur·ice. pendant la séance. Je dois aussi être créatif·ve en fonction des fantasmes des clients. Ça demande bien plus de charge mentale que l’escorting et ça m’épuise davantage. Après une séance de domination, je suis épuisé·e, alors qu’après une séance d’escorting, je me sentais plus mécanique et détaché·e.
F. Les souminateurs sont des hommes qui prétendent être soumis, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment. Ils essaient constamment de reprendre le contrôle, ce qui les rend difficiles à gérer. C’est compliqué car ces personnes vont souvent outrepasser les limites. Contrairement à de vrais soumis, qui désirent la soumission et l’acceptent mentalement, les souminateurs ne sont pas réellement soumis, ils cherchent toujours à avoir un certain pouvoir ou à te manipuler.
F. Non, je ne change pas mes tarifs. Je n’ai pas envie d’augmenter mes prix juste parce que la domination demande plus de préparation mentale. J’aime vraiment ce que je fais, même si c’est plus exigeant. Si je devais augmenter mes tarifs, ce serait principalement pour des raisons financières, pas parce que je considère la domination comme plus difficile. Même si elle l’est, je prends beaucoup de plaisir à la pratiquer.
F. Je pratique principalement la photographie, la vidéo et le dessin. En ce moment, la photo et la vidéo sont un peu en retrait car je peine à trouver des personnes pour participer à mes projets à Marseille, ce qui m’oblige à me déplacer pour réaliser mes œuvres et complique un peu les choses. Mon travail artistique est souvent porté par une démarche politique. Je traite de sujets comme le TdS, la queerness, le handicap, et je travaille beaucoup avec des gens pour donner de la visibilité à ces causes. Mon travail artistique comporte aussi une dimension pédagogique. Par exemple, j’ai un projet de série de portraits. Dans cette série, l’idée est de montrer ce que cela signifie d’être trans et travailleur·euse du sexe, en explorant la dualité entre la personne qu’on est en tant que trans et la personne qu’on devient dans le rôle de TdS. Cela permet de mettre en lumière la pluralité des profils. Certaines personnes restent ouvertement trans dans leur rôle de TdS, tandis que d’autres préfèrent garder un cis-passing. Mon objectif est de montrer ces différences et de démontrer que la manière dont on se comporte dans notre quotidien et dans notre travail peut varier énormément.
CO. Est-ce que tu voudrais développer sur les liens entre ton identité de TdS et de personne trans, par exemple, en ce qui concerne des choix comme celui de faire de la domination, notamment en relation avec ta propre sécurité ? Est-ce que cela joue un rôle dans ton approche ?
F. Je n’ai pas encore abordé cet aspect. Mais en effet, ma pratique de la domination est liée à ce que je vis. Je suis ouvertement non-binaire dans mon rôle de dom. Depuis ma mammectomie, je ne peux plus faire d’escorting, car beaucoup de clients préfèrent les femmes avec des seins. Cependant, en tant que dom, ce n’est pas un problème. Certains clients continuent à m’appeler « Maîtresse », même si ce n’est pas quelque chose que je revendique. Sur mes annonces, je me présente comme étant trans. C’est intéressant, car je me fais appeler « Majesté », un terme neutre, ou parfois « Daddy ». La plupart des clients respectent mes pronoms sans problème. Le fait de pouvoir continuer à travailler avec des clients cis-hétéros en tant que dom et personne trans a été un grand avantage par rapport à l’escorting. Je me sens plus libre d’exprimer ce que je suis, parce que les clients me voient davantage comme un esprit que comme un corps. Ils s’intéressent à la pratique, à ce que je vais apporter, plutôt qu’à un simple corps. En escorting, il y a une objectification plus forte, et le fait que je n’ai plus de seins peut être un frein pour certains.
CO. Peut-être que dans ce rôle de domination, il y a déjà une sorte de renversement des genres, un questionnement de la sexualité et de l’orientation. Cela permet à certains de flouter les lignes, non ?
F. Oui, il y a des clients qui demandent de la féminisation ou du peggingLe pegging est une pratique sexuelle de pénétration, réalisée généralement avec un gode-ceinture., sans pour autant se considérer comme gays. Ils s’imaginent se faire pénétrer, ce qui, même s’ils ne se disent pas gay, reste un fantasme un peu flou. Mais il y a aussi un côté très politique dans la domination. Personnellement, je politise beaucoup ma pratique. De nombreux·ses TdS utilisent l’humiliation, parfois en traitant leurs clients de femmes ou de petites putes. Moi, je préfère m’orienter vers l’humiliation liée à la masculinité. C’est une manière de déstabiliser les hommes en les confrontant à leur propre identité de genre. Cette approche attire des clients qui s’intéressent aussi à la dimension politique de la domination. Contrairement à l’escorting, où les préoccupations politiques sont souvent absentes.
F. Oui, certains soumis deviennent plus conscients de leurs privilèges, deviennent plus woke. J’ai même reçu des messages de clients me remerciant, parfois en me faisant des dons, disant qu’ils avaient été brainwashed par ma pratique. C’est gratifiant de voir qu’une certaine forme de militantisme peut naître de ce cadre-là, même si cela ne fonctionne pas avec tous. Pour ceux avec qui ça marche, c’est un vrai plaisir.
En Toute IntimitéPièce présentée dans l’exposition Argent Facile
Il s’agit d’une installation vidéo que j’ai réalisée pour mon diplôme des Beaux-Arts. J’ai utilisé des extraits de films pornos que j’ai déformés visuellement. Ce n’étaient pas des extraits bruts, bien qu’on comprenne que c’était du porno. Par-dessus, j’ai intégré des messages vocaux et des captures d’écran de messages envoyés par des clients d’escorting. Ces messages sont remplis de menaces et d’insultes, et la violence s’intensifie au fur et à mesure. Cette vidéo parle des agressions et des viols que j’ai subis, plusieurs messages contiennent des menaces de mort ou de viol. Quand j’ai présenté cette œuvre à l’école des Beaux-Arts, elle était projetée dans une pièce transformée en chambre avec un lit, et la vidéo était projetée sur le mur avec un son puissant. L’objectif était de rendre l’expérience immersive. Lors d’Argent Facile, on a plutôt choisi de créer un petit salon avec un casque audio, mais le but restait le même : l’immersion. L’idée est de rendre cette vidéo inconfortable pour le·a spectateur·ice, de le·a confronter à la violence et à la réalité du harcèlement que subissent les TdS. Ce n’est pas une dénonciation de la dangerosité du TdS en soi, mais plutôt un sous-texte sur la dangerosité liée aux lois et à l’absence de protections pour les TdS.
Un fanzine accompagnait l’installation, avec des captures d’écran des messages, ainsi que des dick pics que j’avais reçues. Ces images étaient là pour illustrer la violence des agressions quotidiennes. Les messages que j’ai reçus étaient parfois des menaces très violentes, mais aussi des tentatives d’humiliation. Le fanzine ajoutait une dimension encore plus brute à l’œuvre.
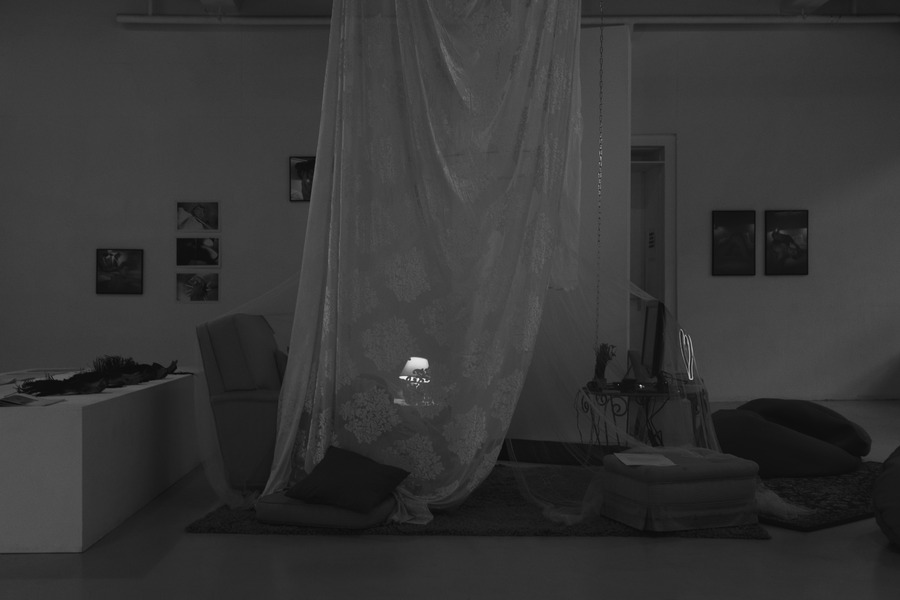

Zusammen sind wir stark: Gemeinschaft und Solidarität in der Sexarbeit — (de)
Das Sexworkers Collective wurde 2021 in der Deutschschweiz von und für Sexarbeiter·innen gegründet. Ihr Ziel als Netzwerk ist es, sich gegenseitig zu unterstützen, eine Gemeinschaft aufzubauen und eine Stimme für die Rechte von Sexarbeiter·innen zu sein.
Der folgende Beitrag ist eine Transkription aus einer Reihe von Interviews mit mehreren Sexarbeiter·innen, denen das SW Collective die gleichen Fragen stellte.
Solidarität, kollektiver Widerstand, Aktivismus und gegen seitige Hilfe sind in der Geschichte der Sexarbeit tief verankert. Im Laufe der Geschichte haben Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, Diskriminierung, Stigmatisierung, Kriminalisierung und Gewalt erfahren.
In vielen Gesellschaften galt die Sexarbeit aufgrund patriarchaler Normen und religiöser Lehren als sündhaft oder unmoralisch, und wurde mit Krankheit und sozialer Störung in Verbindung gebracht. Auch heute müssen Sexarbeitende für ihre Rechte und Anerkennung kämpfen: Sogenannte SWERFs (Sex Worker-Exclusionary Radical Feminists oder Sexarbeitsfeindliche Feminist·innen auf Deutsch) fordern die Kriminalisierung der Kunden von Sexarbeitenden. Diese Umstände machen die Arbeit und das Leben von Sexarbeitenden schwierig, manchmal sogar unerträglich.
Deshalb sind Gemeinschaft und Zusammenhalt ein wichtiger Bestandteil von Selbstschutz, Widerstand und dem Kampf für die Rechte und Anerkennung von Sexarbeitenden. Denn Kriminalisierung, Stigmatisierung und Gewalt bringen Sexarbeiter·innen dazu, sich zusammenzuschließen, füreinander einzustehen und sich zu wehren. Kein Wunder, hängt doch oft unser Überleben davon ab. Als Sexarbeiter·innen kämpfen wir nicht nur für unsere eigenen Arbeits- und Menschenrechte, sondern stehen oft an der Vorfront feministischer, queerer und anti-rassistischer Bewegungen und Protesten.
Wir vom Sexworkers Collective SchweizDas Sexworkers Collective ist ein kleines, 2021 gegründetes Kollektiv von und für Sexarbeitende in der Schweiz. wollen die Solidarität unter Sexarbeitenden in der Schweiz stärken. Deshalb haben wir den Schwerpunkt unserer Arbeit auf den Aufbau eines Netzwerkes gelegt: denn einer unserer Grundwerte ist es, der Isolation, Diskriminierung und Stigmatisierung, die Sexarbeitende erleben, aktiv entgegenzuwirken. Um unsere Gemeinschaft zu stärken, sind wir mit verschiedenen Beratungsstellen für Sexarbeitende vernetzt und organisieren regelmässig Apéros, Brunches und Skillshares für die Community. Wir sind Teil der basisdemokratischen Arbeiter·innen Gewerkschaft Industrial Workers of the WorldIWW ist eine basisdemokratischen Arbeiter·innen Gewerkschaft. Industrial Workers of the World wurde 1905 in den USA gegründet..
selten mit uns. Deswegen wollen wir hier die Stimmen von Sexarbeiter·innen sprechen zu lassen. Auf den folgenden Seiten kommen Sexarbeiter·innen selbst zu Wort. Wir haben sie gefragt, wie Solidarität unter Sexarbeitenden aussieht, warum sie wichtig ist, und was Menschen, die nicht in der Sexarbeit tätig sind tun können, um Stigma abzubauen.
Steckbriefe
Julian Martin
Eva
Pronomen: sie/ihr
Jahrgang: 1988
Begin Sexarbeit: 2018
Bereich der Sexarbeit: Full Service, online Sexarbeit, content creation, Mainstream PornoMainstream-Porno werden kommerziell von etablierten Studios für ein breites Publikum produziert und entsprechen im Gegensatz zu Amateur-/Nischenpornos den konventionellen Standards der Branche in Bezug auf Produktionsqualität, Einwilligung, Altersüberprüfung und Tests der sexuellen Gesundheit.
Hobby: Ausflüge, reisen, alone-time
Bambi
Pronomen: sie/ihr
Jahrgang: 1996
Beginn Sexarbeit: 2021
Bereich der Sexarbeit: Full ServiceFull Service [Komplettservice] ist in der Regel eine Massage mit vollständigem Körperkontakt und kann Oralsex oder Penetration sowie jede Art von sexueller Aktivität umfassen., online Sexarbeit
Hobby: Dance / Performance
Estelle
Kinky Ginger
Pronomen: sie/ihr
Jahrgang: 1976
Beginn Sexarbeit: 2013
Bereich der Sexarbeit: BDSM, Domination
Hobby: Fotografie
R
Interview
Bambi. Ja, mit meinen Freunden bin ich total offen und auch mit meiner Mutter und meiner Schwester. Ich bin gerne ehrlich zu den Leuten, denn ich bin eine stolze Sexarbeiterin und verstecke mich nicht gerne.Früher, als ich in die Schweiz kam, um zu arbeiten, war es schwierig, meiner Mutter zu erklären, warum ich überhaupt kein Geld hatte, als ich Spanien verließ, und dann sah sie, dass ich an verschiedene Orte flog, und es war schwierig zu erklären, woher ich all dieses Geld hatte. Also beschloss ich, es meiner Mutter zu sagen. Ich sage nicht, was ich genau mache, ich sage ihr nur: „Mama, ich bin Sexarbeiterin oder Escort. Ich bin sehr sicher, und die Situation ist in der Schweiz anders als in Spanien“. Für meine Mutter ist das völlig in Ordnung. Sie hat mir nur das typische ‚Pass auf dich auf‘ gesagt. Jedes Mal, wenn ich zu einer Feministinnen- oder Sexarbeiter ·innen-Demonstration gehe, zeige ich meiner Mutter alles und zeige ihr, dass wir für unsere Rechte kämpfen, denn es ist ein Job.
Luna. Mit Freunden bin ich schon geoutet, aber in meiner Familie nicht. Nur mit meiner Mum, sie weiss, dass ich tanze, aber sie weiss nicht, dass ich Escort mache. Ich sage es nur, wenn ich den Menschen vertraue. Sonst habe ich Angst, dass Unbehagen entsteht zwischen uns, oder dass sie mich dann verurteilen oder so.
Maya. Ich bin geoutet, wenn auch nicht von Anbeginn. Nach ein paar Jahren als Sexarbeitende habe ich mich bewusst dafür entschlossen, offen damit umzugehen, zum einen, weil ich mich dessen nicht schäme, zum anderen, weil darüber sprechen meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt in Richtung Entstigmatisierung ist.
Eva. Ich bin bei meinen engsten Freundinnen geoutet. Dies tat ich ganz am Anfang, ohne groß zu überlegen. Im Nachhinein finde ich das noch spannend. Damals war das ganz normal für mich und ich habe gar nicht an Stigma oder sonstiges gedacht. Zu jener Zeit hatte ich im Ausland gelebt und fand es auch ganz normal mich dort medizinischem Personal zu outen oder je nachdem auch im sozialen Umfeld.
Ich bin mir mittlerweile des Stigmas bewusster und möchte mich eher schützen und oute mich selten. Eigentlich finde ich das schade und denke manchmal auch, dass es hypokritisch von mir ist, sich eine stigmafreie Gesellschaft zu wünschen, aber in dieser Hinsicht meinen Beitrag nicht dazu zu leisten. Im Moment finde ich Selbstschutz aber wichtiger.
Estelle. Ich bin zum Teil in meinem Umfeld geoutet. Ich lüge nicht gerne, aber da ich ein Kind im Schulalter habe, will ich sie vor dem Stigma schützen, welches sie erleben würde, wenn unser ganzes Umfeld und die Kinder in der Schule wüssten, dass ich Sexarbeiterin bin. Sich immer wieder zu outen in verschiedenen Kontexten kann sehr anstrengend sein da ich nie weiss, wie Leute reagieren, weswegen ich es manchmal auch sein lasse. Ich denke aber, dass es zur destigmatisierung beiträgt, da ich dann oft gute Gespräche führen kann und dort auch merke, wie wenig Menschen über Sexarbeit wissen. Jemanden vor sich zu haben wo sagt das, dass sie in der Sexarbeit arbeitet, trägt dazu bei, uns zu vermenschlichen.
B. Eindeutig ja. Ich denke, es gibt zwei Arten von Stigmatisierung. Es ist das Stigma von außen. In meinem Umfeld gibt es Leute, die glauben, was in den Medien über die Sexindustrie steht, und die sich große Sorgen um mich machen. Aber ich erfahre auch Stigmatisierung innerhalb der Welt der Sexarbeit, weil ich trans und nicht-binär bin. Natürlich nicht so sehr, aber doch ein bisschen. Auch bei Kunden, weil ich nicht so feminin bin und keine großen Operationen hatte.
L. Ja schon, obwohl ich in dieser Arbeit sehr privilegiert bin, weil ich halt Schweizer Dokumente habe, weiss bin und jung und man mich irgendwo in den ‘Beauty Standards’ einordnen kann… Ich denke, dass ich zu den Menschen gehöre, die am wenigsten Stigma erleben.Es ist mir schon mal passiert, als ich jemanden gedatet habe, und irgendwann habe ich ihm erzählt, dass ich das tue. Dann wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben, obwohl er mich dann halt doch trotzdem voll sexualisiert hat.
M. Beispielsweise ist mir schon passiert, dass Menschen sich gerade noch völlig normal mit mir unterhalten haben, dann erfahren sie, was ich arbeite, und dann beginnen sie langsam und in vereinfachtem Deutsch mit mir zu sprechen. Als ob ich nun auf einen Schlag die Fähigkeit sie zu verstehen verloren habe. Und ich fühle mich durch einseitige Medienberichte, Bücher, Aussagen in Fachbüchern stigmatisiert.
Ev. Spontan fällt mir das Stigma, das wir von unseren Kunden, oft zum Zeitpunkt des Erstkontaktes erfahren, ein. Das sind Sachen wie generelles Misstrauen, oder dass es uns nur ums Geld geht und wir sie abzocken wollen, ohne wirklich etwas zu geben. “Denn Sex macht ja Spass”. Was eben unterschwellig bedeutet, dass es keine echte Arbeit ist.
Zusätzlich zum Stigma von Außenstehenden erlebe ich auch Selbststigma. Sozialisierte Glaubenssätze wie z.B. “Du hast so viel mehr Potenzial” oder “Als Kind hattest du große Berufsträume und hast dir nicht vorgestellt Sexarbeiterin zu werden” prägen mich. Dadurch fühle ich manchmal Scham, obwohl ich grundsätzlich zufrieden bin, diesen Weg für mich gemacht zu haben. Sexarbeit hat mein Leben gerettet !
J. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich eher selbst stigmatisiere, als dass es andere tun. Wenn ich über meinen Job spreche, frage ich mich, ob mein Gegenüber wirklich bereit für die Information ist oder ob ich jemanden vor den Kopf stoße. Das kann in mir ein Schamgefühl auslösen, das eigentlich von mir selbst ausgeht. Gelegentlich spüre ich auch den Druck, mich rechtfertigen zu müssen, selbst wenn gar nicht danach gefragt wurde. Von anderen erlebe ich kaum Stigmatisierung. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich ein privilegierter cis Mann bin. Man unterstellt mir nicht, dass ich meinen Job aus Zwang oder Not mache. Das übliche Narrativ von Ausbeutung wird mir gar nicht aufgedrückt.
Es. Als weisse Schweizerin bin ich viel weniger von Stigma betroffen als andere mehrfachdiskriminierte Menschen. Das Opfer Narrativ erlebe ich zum Beispiel kaum und noch weniger, seit ich als Domina arbeite. Ich bin als Coach angemeldet und nicht als Sexarbeiterin, weswegen ich auch keine Diskriminierung von Behörden erfahre. Aufgrund der Geschichte von Fremdplatzierungen von Kindern von Sexarbeitenden in der Schweiz trage ich eine Angst in mir das dies geschehen könnte, weshalb ich die Sexarbeit bei den Behörden verschweige.
In persönlichen Begegnungen erlebe ich immer wieder Stigma wie auch bei der Jobsuche. Meine Eltern zum Beispiel wissen, dass ich in der Sexarbeit arbeite. Sie würden mich aber nie fragen, wie es läuft und weichen aus, sobald ich irgendwas zu meinem Job sage. Sie wollen nichts hören und das tut manchmal weh. Ein weiteres Beispiel, was mich verletzt hat, war, als eine Freundin meiner Partnerin gefragt hat, ob ich denn dusche nach der Arbeit und bevor ich mich mit ihr treffe.
B. Eindeutig ja.Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die auch in der Sexarbeit arbeiten, und wir unterstützen uns gegenseitig sehr. Vor kurzem habe ich erkannt, dass die Sexarbeiter·innen Community eine sehr starke Gruppe sind, und wir überall und in jedem feministischen und queeren Kampf an vorderster Front mitkämpfen. Wir denken und sorgen füreinander und für die Gemeinschaft.Ich habe auch gute Freunde und Familie, und wir kümmern uns umeinander. Darüber bin ich sehr froh.
L. Unter Tänzerinnen war es immer richtig freundlich und warm und willkommen heißend. Einmal als ich eine schwierige Situation mit meiner Familie und Freunden hatte und mich sehr isoliert fühlte, war der Club wie mein Zuhause. Die Menschen haben mich dort angenommen und waren immer richtig freundlich miteinander, obwohl man oft das Gegenteil hört. In meinem Leben war es so, dass es halt so eine Art Safer Space ist. Ich habe es auch öfters erlebt, dass wir unter Tänzer·innen Klamotten austauschten.
R. Ich fühle mich von Flora DoraFlora Dora ist eine Anlaufstelle mit Sitz in Zürich für Sexarbeiter·innen auf der Straße und Escorts, die vor allem rechtliche, soziale oder medizinische Fragen beantwortet. unterstützt. Es gibt regelmäßig kostenlose Tests und jede Menge Kondome und Gleitmittel, und ich kann alle Fragen stellen. Ich habe Unterstützung von Freund·innen erhalten, z. B. war ein Freund meine Verstärkung, als ich mich nicht so sicher fühlte, zu einem Kunden zu gehen.
Ev. Ich erfahre enorm viel Unterstützung und Verständnis von unserer Sex workers Community. Auch von Beratungsstellen, insbesondere Flora Dora in Zürich habe ich tolle Unterstützung erfahren, was administrative Fragen z.B. in Bezug auf Sozialversicherungen angeht. Es ist auch wirklich schön zu wissen, dass es Organisationen wie ProCoRe gibt, welche sich sehr breit gefächert für unsere Rechte und für die Destigmatisierung einsetzen. Diese Unterstützung für alle Sexarbeiter·innen von Außenstehenden bedeutet mir viel.
J. Es ist hilfreich zu wissen, dass es Orte wie den CheckpointCheckpoint ist ein Gesundheitszentrum für HIV, sexuell übertragbare Infektionen und sexuelle Gesundheit in der Schweiz. gibt, wo ich über alles reden kann, und dass es Anlaufstellen für Sexarbeitende gibt, die ich im Problemfall in Anspruch nehmen könnte.
Es. Ich erfahre vor allem Unterstützung durch meine Sexworker community aber auch Freund·innen sind sehr supportiv, was mega schön ist. Meine Partnerin ist ebenfalls immer da, wenn ich sie brauche. Leider ist es für viele Sexarbeiter·innen schwierig in Partnerschaften, da Whorephabia sehr stark ist.
B. Die Solidarität unter Sexarbeiter·innen gibt mir mehr Kraft und Stärke, um weiterzumachen und für unsere Rechte zu kämpfen. Ich kann mir vorstellen, noch sehr lange als Sexarbeiterin zu arbeiten, und es hilft mir, weiterzumachen und stolz auf das zu sein, was ich tue. Das gibt mir eine Menge Kraft.
R. Es macht mir klar, dass Sexarbeit nichts Schlechtes ist. Wie in anderen Jobs müssen wir uns gegenseitig unterstützen, und in diesem Job sogar noch mehr, weil es einsam sein kann. Es ist großartig, den Sex Workers Gruppenchat zu lesen, weil man sieht, dass wir alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, und alle geben einander Ratschläge. Das gibt mir Kraft und das Gefühl von Gemeinschaft, Hilfe und Unterstützung. Mir gefällt auch, dass es keinen Konkurrenzkampf gibt.Es ist, als ob wir hier zusammen sind. Es ist nicht so, dass es heißt: ‘Ich bin besser als du und ich habe mehr Kunden’. Wir helfen uns immer gegenseitig, das finde ich sehr besonders.
Wir können nur gegen das gesellschaftliche Stigma ankämpfen, wenn wir untereinander kein Stigma leben. Die sogenannte Hurenhierarchie zu bekämpfen ist der erste Schritt. Jeder Mensch, jede sexarbeitende Person ist gleich viel wert. Egal ob jemand als high-class Escort, als Strassenarbeiter·in oder mit online Content oder ähnlichem ihr Geld verdient. Vieles hat eher mit Privilegien als mit sonst etwas zu tun und niemand ist besser oder schlechter als andere.
Es ist toll, wenn es international vernetzende Kampagnen gibt die von ESWAESWA ist die European Sex Workers Rights Alliance. Von Sexarbeiter·innen geführtes Netzwerk, das über 100 Organisationen in 30 Ländern in Europa und Zentralasien vertritt. Ihr Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass alle Stimmen von Sexarbeiter·innen gehört werden und ihre Menschen-, Gesundheits- und Arbeitsrechte anerkannt und geschützt werden. oder anderen Organisationen koordiniert werden. Dadurch sehen wir, wie viele, dass es von uns gibt.
Es. Wenn ich über die Solidarität unter Sexarbeitenden nachdenke, wird es mir warm ums Herz. Ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an, als ich anfing zu arbeiten, Teil der Sexworkers Community war. Ich finde es so schön wie alle zueinander schauen und voneinander lernen. Ich freue mich auch immer wieder zu sehen wie queer unsere Community ist und wie politisch nicht nur wenn es um die Rechte von Sexarbeiter·innen geht. Die Geschichte von Sexarbeiter·innen ist lang und wir haben viele Vorfahren, die für unsere Rechte gekämpft haben. Vor allem Schwarze, People of Color und Transmenschen waren immer an vorderster Front für die Rechte von Sexarbeiter·innen.
B. Zum Beispiel antwortete kürzlich ein Freund: ‘Ah, gut, ich habe auch einen Freund, der Sexarbeiter ist’. Die meinen es gut, aber wenn ich ihnen früher, als ich in einem Café arbeitete, sagte, dass ich als Barista arbeite, antwortete niemand: ‘Ach, ich habe auch einen Freund, der als Barista arbeitet’.
M. Ich denke ein wichtiger Schritt, der wirklich jeder machen kann, ist, die eigene Haltung zu reflektieren. Sich zu hinterfragen, welche Einstellung habe ich persönlich Sexarbeit gegenüber? Warum habe ich diese Einstellung, welche Normen, welche Werte prägen diese? Ist meine Einstellung wertschätzend, oder ist sie verurteilend?
J. Es ist wichtig, immer wieder zu betonen, dass Sexarbeit nicht automatisch mit Menschenhandel verbunden ist. Missbrauch und Ausbeutung gibt es in vielen Branchen, etwa im Bauwesen, doch das wird oft verschleiert. Die Sexarbeit wird stattdessen zum Sündenbock gemacht, weil sie ein „interessanteres“ Thema für die Medien ist.
Es. Informiert euch über Sexarbeit in dem ihr Bücher welche von Sexarbeiter·innen geschrieben wurden lest. Hört auf unsere Stimmen, denn wir sind die Expert·innen wenn es um Sexarbeit geht. Wir müssen auch an der Vorderfront sein, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen, die unsere Arbeit und unser Leben angeht.
Sexarbeit trägt einen grossen Teil zu physischem sowie psychischem Wohlergehen der Gesellschaft bei. Sie verdient Anerkennung, nicht Abwertung. Sexarbeitende zahlen Steuern und Versicherungen und leisten nicht nur so, sondern auch mit ihren Dienstleistungen einen grossen Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn nicht Anerkennung, so verdienen wir mindestens Rechte und Entkriminalisierung
L’union fait la force : communauté et solidarité dans le travail du sexe — (fr)
Le Sexworkers Collective a été fondé en 2021 en Suisse alémanique par et pour des travailleur·euses du sexe. Leur objectif en tant que réseau est de se soutenir mutuellement, de construire une communauté et d’être une voix pour les droits des TdS.
La contribution qui suit est un texte et une transcription d’une série d’entretiens avec plusieurs TdS, à qui le Sexworkers Collective a posé les mêmes questions.
La solidarité, la résistance collective, l’activisme et l’entraide sont profondément ancrés dans l’histoire du TdS. Tout au long de l’histoire, les personnes qui fournissent des services sexuels ont été victimes de discrimination, de stigmatisation, de criminalisation et de violence. Dans de nombreuses sociétés, le travail du sexe était considéré comme pécheur ou immoral en raison des normes patriarcales et des enseignements religieux, et était associé à la maladie et aux troubles sociaux. Aujourd’hui encore, les travailleur·euses du sexe doivent se battre pour leurs droits et leur reconnaissance : les soi-disant SWERF (Sex Worker-Exclusionary Radical Feminists ou féministes hostiles au travail du sexe en français) demandent la criminalisation des clients des TdS. Ces circonstances rendent le travail et la vie des TdS difficiles, parfois même insupportables.
C’est pourquoi la communauté et la cohésion sont des éléments importants pour l’autoprotection, pour la résistance et pour la lutte pour les droits et la reconnaissance des TdS. Car la criminalisation, la stigmatisation et la violence poussent les TdS à s’unir, à se soutenir les un·es les autres et à se défendre. Ce n’est pas étonnant, puisque souvent notre survie en dépend. En tant que TdS, nous ne nous battons pas seulement pour nos propres droits du travail et droits humains, mais nous sommes souvent en première ligne des mouvements et des protestations féministes, queer et antiracistes.
Au sein du Sexworkers Collective SchweizCollectif fondé en 2019 par et pour les travailleur·euses du sexe en Suisse., nous voulons renforcer la solidarité entre les TdS en Suisse. C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur la création d’un réseau : en effet, l’une de nos valeurs fondamentales est de lutter activement contre l’isolement, la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les TdS. Afin de renforcer notre communauté, nous sommes en réseau avec différents services de consultation pour les TdS et organisons régulièrement des apéros, des brunchs et des skillsharesMoments communautaires organisés afin de partager du savoir. pour la communauté. Nous faisons partie du syndicat démocratique de base Industrial Workers of the WorldIWW : Syndicat des travailleur·euses de l’industrie du monde, basé sur la démocratie de base, fondé aux USA en 1905..
On parle souvent des TdS, mais très rarement avec nous. C’est pourquoi nous voulons ici faire entendre la voix des TdS. Dans les pages suivantes, ce sont les TdS elleux- mêmes qui s’expriment. Nous leur avons demandé à quoi ressemble la solidarité entre les TdS, pourquoi elle est importante et ce que les personnes qui ne sont pas actives dans le TdS peuvent faire pour réduire la stigmatisation.
Fiches de présentation
Julian Martin
Eva
Pronoms : elle
Année de naissance : 1988
Début du travail du sexe : 2018
Domaine du travail du sexe : service complet, travail du sexe en ligne, création de contenu, porno mainstreamLe porno mainstream est produit commercialement par des studios établis pour un large public, et respecte les normes conventionnelles de l’industrie en termes de qualité de production, de consentement, de vérification de l’âge et de tests de santé sexuelle, contrairement au porno amateur/de niche.
Hobby : sorties, voyages, temps seule
Bambi
Pronom : elle
Année de naissance : 1996
Début du travail du sexe : 2021
Domaine du travail du sexe : service complet Le full service [service complet] est généralement un massage avec contact physique complet et peut inclure le sexe oral ou la pénétration, ainsi que tout type d’activité sexuelle., travail du sexe en ligne
Hobby : danse, performance
Estelle
Kinky Ginger
Luna
R
Interview
Bambi. Oui, je suis tout à fait ouverte avec mes ami·es, comme avec ma mère et ma sœur. J’aime être honnête avec les gens, car je suis fière d’être TdS et je n’aime pas me cacher. Avant, quand je venais en Suisse pour travailler, c’était difficile d’expliquer à ma mère pourquoi en quittant l’Espagne je n’avais aucun argent, alors qu’ensuite elle voyait que je prenais l’avion vers différents endroits. C’était difficile d’expliquer d’où j’avais tout cet argent. J’ai donc décidé de le dire à ma mère. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais exactement, je lui ai juste dit : « Maman, je suis TdS ou escort. Je suis tout à fait en sécurité, et la situation n’est pas la même en Suisse qu’en Espagne. » Et pour ma mère, cela n’a posé aucun problème. Elle m’a juste dit le classique : « Fais attention à toi. » À chaque fois que je vais à une manifestation féministe ou de TdS, je lui montre tout, je lui montre que nous nous battons pour nos droits, car c’est un travail.
Luna. J’ai déjà fait mon coming out aux ami·es, mais pas à ma famille. Il n’y a que ma mère qui est au courant, mais elle ne sait pas tout. Elle sait que je danse, mais elle ne sait pas que je suis escort. Je ne le dis qu’aux personnes en qui j’ai confiance. Autrement j’ai peur que ça crée un malaise ou qu’iels me jugent ou quelque chose comme ça.
Eva. J’ai fait mon coming out auprès de mes ami·es les plus proches. Je l’ai fait dès le début, sans trop y réfléchir. Avec le recul, je trouve ça plutôt intéressant. À l’époque, c’était tout à fait normal pour moi, je ne pensais pas du tout à la question de la stigmatisation ou à quelque chose de ce genre.
J’ai vécu à l’étranger et là-bas je trouvais tout à fait normal de faire mon coming out auprès du personnel médical ou, selon les cas, à mon entourage. Je suis désormais plus au fait de la stigmatisation et j’ai davantage envie de me protéger et de ne plus trop faire mon coming out. En fait, je trouve ça dommage et je me dis parfois que c’est hypocrite de ma part de vouloir une société sans stigmatisation et de ne pas y apporter ma contribution sur ce point, mais actuellement, je trouve que l’autoprotection est plus importante.
Estelle. J’ai fait mon coming out auprès de certaines personnes de mon entourage. Je n’aime pas mentir, mais comme j’ai une enfant scolarisée, je veux la protéger de la stigmatisation qu’elle subirait si tout notre entourage et les enfants de l’école savaient que je suis TdS. Faire son coming out en permanence dans différents contextes peut être très épuisant. Je ne sais jamais comment les gens vont réagir, et c’est pourquoi je préfère parfois ne pas en parler. Mais je pense que le fait de parler ouvertement de mon métier contribue à le déstigmatiser, car j’arrive souvent à avoir de bonnes conversations et je me rends compte à quel point les gens ne savent pas grand-chose sur le travail du sexe. Le fait d’avoir quelqu’un·e en face de soi qui dit qu’iel l’exerce contribue à nous humaniser.
KG. C’est surtout de la part des autorités que je subis de la stigmatisation. Lorsque j’ai décidé de me consacrer uniquement au TdS, ça n’a pas tout à fait été de mon plein gré. J’ai été licenciée de mon ancien emploi de bureau parce que mon activité avait été exposée au grand jour, suite à la découverte de mon site web par une personne.
B. Oui, sans aucun doute. Je pense qu’il existe deux types de stigmatisation. Il y a d’abord la stigmatisation extérieure. Dans mon entourage, il y a des gens qui croient ce que disent les médias sur l’industrie du sexe et qui s’inquiètent beaucoup pour moi. Mais je subis aussi une stigmatisation interne au sein du milieu du TdS parce que je suis trans et non-binaire. Pas énormément bien sûr, mais quand même un peu. Il arrive même que cela vienne des clients, parce que je ne suis pas très féminine et que je n’ai pas fait de grosses opérations.
L. Oui, même si le fait d’avoir des papiers suisses, d’être blanche, jeune et de pouvoir être classée quelque part parmi les « standards de beauté » me donne beaucoup de privilèges dans ce travail… Je pense que je fais partie des personnes qui sont les moins stigmatisées. Il m’est déjà arrivé de sortir avec quelqu’un et de lui annoncer après notre séparation que j’exerçais ce métier. Il a alors trouvé ça très grave, mais m’a tout de même complètement sexualisée.
M. Il m’est déjà arrivé que des gens aient une conversation tout à fait normale avec moi, puis qu’iels apprennent ce que je fais comme travail et là, iels commencent à me parler lentement et dans un allemand simplifié. Comme si j’avais soudainement perdu la capacité de les comprendre. Et je me sens stigmatisée par les couvertures médiatiques partiales, les livres et les déclarations dans les ouvrages spécialisés.
Ev. Spontanément, je pense à la stigmatisation que nous subissons de la part de nos clients, souvent au moment du premier contact. On sent une forme de méfiance générale comme si nous nous intéressions uniquement à l’argent et que nous voulions les arnaquer sans véritablement leur donner quelque chose en retour, parce que « le sexe, c’est amusant », sous-entendu, « il ne s’agit pas d’un vrai travail ». C’est aussi une stigmatisation très répandue à propos du travail en ligne et de la création de contenu. Les médias font la une en affirmant qu’il s’agit d’un revenu purement passif et que rien n’a besoin d’être fait pour l’obtenir, influençant ainsi l’opinion publique.
En plus de la stigmatisation de la part des personnes extérieures, je vis aussi de l’auto-stigmatisation. Des dogmes socialement ancrés tels que : « Tu as tellement plus de potentiel » ou « Enfant, tu rêvais d’une carrière et n’envisageais pas de devenir TdS », me conditionnent. Pour cette raison j’éprouve parfois de la honte, alors que je suis en principe satisfaite d’avoir choisi cette voie. Le travail du sexe m’a sauvé la vie !
J. J’ai parfois l’impression que c’est surtout moi qui me stigmatise, plus que les autres. Quand je parle de mon travail, je me demande si mon interlocuteur·ice est vraiment prêt·e à entendre ces informations ou si je risque de le ou la heurter. Cela peut déclencher en moi un sentiment de honte qui, en réalité, provient de moi-même. Parfois, je ressens aussi la nécessité de me justifier, même si personne ne me l’a demandé.
Il est rare que je subisse des stigmatisations de la part des autres. Je pense que cela est aussi lié au fait que je suis un homme cisgenre privilégié. On ne me soupçonne pas de faire mon travail contre mon gré ou par pure nécessité. On ne me colle pas le cliché de la victime d’une exploitation sur le dos.
Es. En tant que Suissesse blanche, je suis beaucoup moins stigmatisée que d’autres personnes subissant des discriminations multiples. Je suis rarement confrontée aux récits de la victimisation, et encore moins depuis que je travaille comme domina. Je suis déclarée comme coach et non comme TdS, raison pour laquelle je ne subis également aucune discrimination de la part des autorités. Du fait de l’historique des placements extrafamiliaux d’enfants de TdS en Suisse, j’ai peur que cela puisse se reproduire et c’est pour cela que je passe sous silence le TdS auprès des autorités.
Lors de rencontres inter-individuelles, je suis régulièrement confrontée à la stigmatisation tout comme lorsque je suis dans des périodes de recherche d’emploi. Mes parents par exemple savent que je suis TdS, mais iels ne me demandent jamais comment ça se passe et iels détournent la conversation dès que je parle de mon travail. Iels ne veulent pas en entendre parler et ça me fait parfois de la peine. Un autre exemple de ce qui m’a blessée, c’est quand une amie de ma partenaire m’a demandé si je prenais une douche après le travail et avant de la retrouver.
B. Clairement oui. J’ai beaucoup d’ami·es qui exercent aussi le TdS, et nous nous soutenons beaucoup les un·es les autres. Récemment, j’ai réalisé que la communauté est un groupe très important et que nous sommes en première ligne de toutes les luttes féministes et queer. Nous prenons soin les un·es des autres et de la communauté. J’ai aussi de bon·nes ami·es et une famille et nous veillons les un·es sur les autres. J’en suis très heureuse.
L. Entre danseuses, ça a toujours été vraiment amical, chaleureux et accueillant. Pendant un temps, alors que je vivais une situation difficile avec ma famille et mes ami·es et que je me sentais très isolée, le club était ma deuxième maison. Dans ma vie, c’était une sorte de safer space. Les personnes m’y ont acceptée et elles ont aussi toujours été très gentilles entre elles, même si les rumeurs disent le contraire. Il m’est arrivé plusieurs fois d’échanger des vêtements avec des danseuses. Et comme j’ai un entourage très féministe et bien renseigné sur le sujet, je peux aussi y trouver un soutien émotionnel et parfois même financier. Ça aussi c’est évidemment un grand privilège.
R. Je me sens soutenu par Flora DoraFlora Dora est un centre d’accueil basé à Zürich destiné aux travailleur·euses du sexe de rue et aux escorts, qui répond essentiellement aux questions juridiques, sociales ou médicales.. C’est un endroit où on peut régulièrement et gratuitement se faire tester, où des préservatifs et des lubrifiants sont mis à disposition en grande quantité et où je peux poser toutes les questions que je veux. J’ai également reçu le soutien de mes ami·es, un ami m’a par exemple accompagné quand je ne me sentais pas très à l’aise d’aller voir un client.
Ev. Je reçois énormément de soutien et de compréhension de la part de notre communauté de TdS. J’ai également reçu un grand soutien de la part des centres d’accueil, notamment de Flora Dora à Zürich, pour la partie administrative, les assurances sociales, etc. C’est aussi vraiment agréable de savoir qu’il existe des organisations comme ProCoRe, qui s’engagent de façon générale pour nos droits et pour la déstigmatisation. Ce soutien de la part de personnes extérieures à la communauté des travailleur·euses du sexe compte beaucoup pour moi.
J. C’est rassurant de savoir qu’il existe des endroits comme le CheckpointCheckpoint est un centre de santé pour le VIH, les infections sexuellement transmissibles et la santé sexuelle en Suisse. où je peux parler de tout, et des centres d’accueil pour les travailleur·euses du sexe auxquels je peux m’adresser en cas de problème.
L. Je reçois surtout du soutien de la part de ma communauté de travailleur·euses du sexe, mais mes ami·es sont aussi très solidaires, ce qui est super agréable. Ma partenaire est également toujours là quand j’ai besoin d’elle. Malheureusement, il est difficile pour de nombreuses TdS d’avoir des relations de couple, car la putophobie est très répandue.
R. Ça me fait comprendre que le TdS n’a rien de mauvais. Comme dans d’autres métiers nous devons nous soutenir mutuellement et dans ce métier encore plus, car c’est un travail qui peut être solitaire. C’est formidable de parcourir la conversation du groupe WhatsApp des TdS, car cela montre que nous sommes tous·tes confronté·es aux mêmes problèmes et que nous nous donnons des conseils. Cela me donne de la force et un sentiment de communauté, d’aide et de soutien. J’aime aussi le fait qu’il n’y ait pas d’esprit de compétition. C’est comme si, ici, nous étions ensemble. On ne se dit pas : « Je suis meilleur·e que toi et j’ai plus de clients. » Nous nous aidons toujours mutuellement, je trouve ça très remarquable.
Nous pouvons lutter contre la stigmatisation sociale seulement si nous ne vivons pas de stigmatisation dans nos propres rangs. Combattre la fameuse « hiérarchie des putes » est la première étape. Chaque personne, chaque TdS a la même valeur. Peu importe que quelqu’un·e gagne sa vie en tant qu’escort girl de luxe, travailleur·euse de rue ou avec un contenu en ligne ou autre. Nos conditions sont aussi souvent directement liées à nos privilèges. Personne n’est meilleur·e ou pire que les autres. À mon avis, tous les droits dont nous jouissons aujourd’hui sont le fruit de la solidarité qui existe entre les travailleur·euses du sexe. C’est comme une grande famille à laquelle on se sent appartenir et qui nous offre un point d’ancrage. Où que l’on soit dans le monde. C’est formidable quand il y a des campagnes internationales coordonnées par l’ESWAESWA : European Sex Workers Rights Alliance, est un réseau dirigé par des travailleur·euses du sexe qui représente plus de 100 organisations dans 30 pays d’Europe et d’Asie centrale. Leur objectif est de faire en sorte que toutes les voix des travailleur·euses du sexe soient entendues et que leurs droits humains, sanitaires et professionnels soient reconnus et protégés. ou d’autres organisations. Cela nous permet de voir combien nous sommes.
Es. Quand je pense à la solidarité entre les TdS, ça me réchauffe le cœur. J’ai eu la chance de faire partie de la communauté dès le début de mon activité. Je trouve ça tellement beau que tout le monde se soutient et apprend les un·es des autres. Je me réjouis aussi de voir à quel point notre communauté est queer et politisée, et pas juste lorsqu’il s’agit de nos droits. Notre histoire est longue et nous avons de nombreux·ses ancêtres qui se sont battu·es pour notre reconnaissance. Ce sont surtout les personnes noir·es, racisé·es et transgenres qui ont été en première ligne pour défendre les droits des TdS.
Comment les personnes extérieures au TdS peuvent-iels apporter leur soutien et lutter contre la stigmatisation ?
R. Quand les gens entendent des choses fausses sur nous, iels devraient réagir et ne pas se taire. C’est comme avec la transphobie : « Ne te tais pas quand tu entends ce genre de choses. » Quand nous vivons des expériences désagréables, iels peuvent nous écouter et être là pour nous. Iels peuvent aussi se réjouir quand j’ai un bon client, ou souhaiter que j’aie un sugar daddy.
J. Il est important de bien rappeler que le TdS n’est pas forcément lié à la traite des êtres humains. L’abus et l’exploitation existent dans de nombreux secteurs, comme dans le BTP par exemple, mais cette réalité-là est souvent dissimulée. Le travail du sexe est utilisé comme bouc émissaire, car c’est un sujet plus « intéressant » pour les médias.
Ev. Les TdS sont des personnes tout à fait normales. Quelqu’un·e que tu aimes pourrait être un·e TdS. C’est un travail, un travail de soin. Il contribue grandement au bien-être physique et psychologique de la société. Il mérite d’être reconnu et non d’être dévalorisé. Les TdS paient des impôts et des assurances et participent activement à l’économie et à la société, non seulement par leurs contributions, mais aussi par leurs services. Si ce n’est pas la pleine reconnaissance, nous méritons au moins des droits et la décriminalisation.
On ne se rend pas compte à quel point le travail d’archivage est important, entretien —
Eva-Luna Perez Cruz travaille à l’association Aspasie depuis 2018. Elle exerce maintenant en tant que responsable du pôle terrain de l’association, et s’occupe, parmi beaucoup d’autres choses, de mener les ateliers de français et d’écriture.
Eva-Luna. Je m’appelle Eva-Luna. À la base, je suis photographe et sexologue. J’ai fait des études de photographie au CEPVCentre d’Enseignement Professionnel de Vevey, canton de Vaud, Suisse., à Vevey. Et puis, je me suis lancée dans un projet photo avec des travailleuses du sexe dans les rues à Madrid. J’ai ensuite eu la chance d’auto-éditer mon premier livre qui s’appelle Le Salon J’adore, en 2012. Ensuite, j’ai beaucoup collaboré avec l’association Hetaira, qui est un peu l’équivalent d’Aspasie à Madrid. J’ai donné des cours de français là-bas pendant quelque temps. C’est cette association qui a contacté Aspasie, vu que j’habitais à Genève, en leur disant que je pouvais continuer à offrir de mon temps à des associations qui soutiennent les TdS, parce que pour moi, c’était essentiel. J’ai donc contacté Aspasie, où j’ai d’abord rencontré Marianne Schweizer, qui m’a mise très vite en lien avec Angelina, qui était alors en pleine création du premier syndicat, le STTS, Syndicat des Travailleuses et Travailleurs du Sexe, à Genève.
J’ai vraiment eu un coup de cœur avec Angelina, qui faisait selon moi un travail de rue incroyable. Dans ce syndicat, il ne pouvait y avoir que des TdS. Puis une nouvelle clause a été ajoutée au syndicat pour que je puisse y faire le secrétariat. Ce syndicat a été créé en 2012 et n’a duré que deux ans, car personne n’a voulu reprendre la présidence. C’était un poste très médiatisé qui demandait à être « public ». En 2018, Pénélope Giacardy est arrivée au poste de coordinatrice d’Aspasie et m’a proposé un petit pourcentage pour donner des cours de français. Cet emploi m’a amenée à être maintenant responsable des actions de terrain à Aspasie.
EL. Pour expliquer l’organisation : il y a le pôle soutien et accompagnement, où on fait du suivi juridique et médical. Il y a un pôle valorisation et expertise, qui concerne principalement le CGR, le Centre Grisélidis Réal, avec lequel on met en avant des travaux d’artistes, d’étudiant·es, de travailleur·euses du sexe, des archives, de la documentation sur le TdS. Le pôle dont je m’occupe, c’est tout ce qui est travail de terrain. C’est tout ce qui est « aller vers », dans les lieux où les personnes exercent le travail du sexe, que ce soit en salon, en vitrine, sauna, appartement privé, escorting, dans la rue et sur Internet aussi. Ce pôle regroupe aussi les formations, les séances d’informationLes séances d’information sont des séances obligatoires pour toutes les personnes souhaitant travailler de manière déclarée sur le canton de Genève. et les ateliers communautaires.
CO. On a fait ta connaissance à travers les ateliers d’écriture. Pourrais-tu nous en parler et nous dire comment ils ont été mis en place ? Quelle portée ont-ils maintenant ?
EL. Le premier atelier qui a vraiment fait parler, c’est celui que vous connaissez très bien, avec La Diabla, de Ponte en mis taconesPonte en mis tacones est un récit autobiographique de La Diabla, que le Collectif Occasionnel a co-édité avec la librairie La Dispersion en 2022., qui continue d’ailleurs. Je rêverais de faire des ateliers d’écriture avec un aspect communautaire où il y aurait davantage de partage de connaissances. Ce que j’observe ces derniers temps, c’est que les ateliers d’écriture fonctionnent mieux quand c’est en one to one, quand c’est avec la personne seule. Car il y a beaucoup d’émotions qui en ressortent. Quand je le renomme « atelier d’écriture » et que nous sommes plusieurs, bien souvent les participantes commencent à comparer leurs vécus. Jusqu’à maintenant ça s’est plutôt basé sur des échanges oraux, que je mets à l’écrit. J’ai l’impression que quand c’est un exercice que je donne, par exemple dans les ateliers de français, où je dis : « La semaine prochaine, on parle des clients, qu’est-ce que c’est pour vous les clients ? Qu’est-ce que c’est la relation amoureuse avec un client ? Est-ce que ça existe ? », beaucoup ne le font pas car elles ont de la peine à écrire seules chez elles. Je suis en contact avec deux TdS escorts qui ont fait cet exercice et j’essaie maintenant de publier leur ouvrage.
En fait, les personnes disent des choses hyper touchantes, dont elles ne se rendent pas compte et qu’il faudrait vraiment mettre en avant. Donc je leur propose de mettre moi-même par écrit ce qui se dit. C’est dans ces lieux d’échanges que je ne nomme pas forcément « ateliers d’écriture », mais « ateliers de français », que des choses très belles ressortent.
EL. Les ateliers de français sont pour moi plutôt des moments communautaires. Les personnes qui veulent vraiment apprendre le français, ce n’est pas avec moi ! Celles qui veulent vraiment apprendre, je leur donne des endroits où aller, je leur trouve des chèques de formation, etc. Apprendre le français est une excuse pour passer un moment ensemble, c’est ce qui attire le plus les participant·es, même si on y apprend quelques bases.
Mais ensuite, certaines déchirent leur texte en disant : « C’est nul. » Et moi, je leur dis : « Non, ne déchire pas ! » Parce que ce n’est pas du tout nul. Il y a même des fois où j’ai scanné des écrits (avec leur accord, bien sûr). Récemment, j’ai proposé le sujet de la digitalisation du travail du sexe. Là encore, les textes sont incroyables.
Une des choses qui me touche profondément, c’est que beaucoup d’entre elles ont du mal à écrire, physiquement. Prendre un stylo, écrire une phrase, c’est difficile pour elles, parce qu’elles n’ont pas l’habitude. Et puis, réfléchir et poser ses idées sur papier, c’est un vrai exercice en soi. C’est pour ça qu’avec le temps, j’ai de moins en moins proposé l’écrit : elles finissent par se comparer entre elles, et ça crée une pression sur la qualité de leur écriture. C’est pour ça que je leur propose de faire à l’oral. J’aimerais beaucoup arriver à enregistrer les cours de français.
CO. Oui, parce qu’on se disait, ça doit être sportif pour toi de suivre les conversations, les échanges et puis de les écrire. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les cours en ce moment ?
EL. Ces dernières années, il y a de moins en moins de personnes travaillant aux PâquisLes Pâquis sont un quartier de Genève où sont situés les bureaux d’Aspasie, et où se concentre également le TdS de rue.. C’est plus des personnes qui travaillent dans les appartements privés, seul·es. Il y a beaucoup d’émotions durant les cours de français, des pleurs, des clashs. Il y en a qui se fâchent, il y a des conflits, des gens qui partent mais qui finissent toujours par revenir, parfois la semaine d’après, parfois un an après.
CO. Comment est-ce que tu gères les sollicitations extérieures d’autres associations ou collectifs qui souhaitent faire des choses avec des TdS ? Nous, par exemple !
Ce sont des associations genevoises qui travaillent sur des thématiques qui nous lient. Ce que je leur propose, c’est d’organiser des ateliers spécifiques qui sont en lien avec le TdS. Par exemple avec le Groupe Santé Genève, on va faire un atelier sur la PrEP et la PEPPrEP : traitement préventif pris contre le VIH. PEP : traitement d’urgence pris suite à une potentielle exposition au VIH.. Les participant·es sont prévenu·es du thème et que cette association va participer à l’atelier.
CO. Il y a l’idée que ces ateliers d’écriture restent en quelque sorte préservés des sollicitations extérieures ? Reçois-tu beaucoup de demandes de personnes externes ?
Il y a pas mal d’artistes qui passent par nous pour être mis·es en contact avec des TdS. On leur répond toujours un peu la même chose. Il y a toujours un peu de voyeurisme de leur part. Pour moi, si ce ne sont pas des personnes concernées, ou un projet qui soutient la cause, ou qui aide à visibiliser, c’est non. On fait néanmoins la différence entre les étudiant·es et les autres, dans ce cas-là, c’est plutôt Jehane Zouyene qui les reçoit au CGR. On est aussi là dans un but de formation.
EL. Le temps, on peut toujours le trouver. Il y a aussi peu de personnes qui pensent à financer le temps de travail des TdS. Ce sont des choses qui nous agacent. Parce qu’iels nous disent : « Mais non, mais c’est des photos que les personnes pourront avoir. » Elles n’en ont pas besoin, par contre c’est du temps de travail.
CO. Est-ce que tu peux nous parler des autres ateliers que tu as mis en place dans le cadre d’Aspasie ou même si tu en fais d’autres en dehors d’Aspasie ?
EL. Ces dernières années, j’essaie de créer des ateliers, mais que ce ne soit plus forcément moi qui les anime, mais plutôt des TdS ou des partenaires spécialisé·es. Ce n’est pas une question de temps, mais plutôt l’idée de laisser la place aux personnes concernées. Par exemple, pour l’atelier sur la digitalisation du TdS, c’est MeronMeron est une TdS qui anime régulièrement des ateliers pour aider à la création d’annonces érotiques sur Internet. qui est intervenue. Elle est extraordinaire ! Elle a souvent fait des remplacements à Aspasie. Elle a son propre site internet et de nombreuses ressources, donc maintenant c’est elle qui anime ces ateliers, et on se rend compte qu’il n’y a rien de mieux que l’animation par des pair·es. Ce qui peine encore de notre côté, ce sont les financements, car nous n’avons pas de financements directs pour rémunérer comme il le faudrait.
CO. C’est vraiment intéressant de voir qu’à chaque fois, il s’agit de valoriser des savoir-faire. Il y en a des talents et des connaissances dans ce métier !
EL. Oui, totalement. Moi, ce dont j’ai envie, c’est surtout de donner un élan et puis faire un travail d’archivage. Par exemple, en novembre, on va faire un atelier sur l’autodéfense féminine pour les TdS. Et j’avais organisé ça il y a trois ans avec Fem Do ChiLe Fem Do Chi est une méthode d’autodéfense développée par et pour les femmes et toutes les personnes se reconnaissant dans cette identité.. Des témoignages tellement touchants en ont découlé, notamment autour de la normalisation de la violence. Par exemple, des témoignages qui disaient : « Moi, je me suis fait violer, mais c’était que trois, quatre fois l’année passée. Et puis ça va. » Des choses très puissantes en ressortaient. Mon envie est d’archiver ce qu’il se dit dans les ateliers, en utilisant d’autres noms, d’autres lieux pour maintenir une forme d’anonymat, mais laisser une trace. Par exemple, il y a cette affaire en cours où une TdS a porté plainte suite à des viols et des agressions très violentes d’un client sur elle pendant des années. Cette affaire-là a pu montrer aux autres TdS qu’elles pouvaient aussi porter plainte suite à des agressions. Et j’ai l’impression que quand elles lisent les choses que j’ai pu écrire suite à un témoignage, elles se rendent compte de choses qui ont pu leur arriver par le passé.
CO. Oui, les témoignages d’autres permettent une mise à distance, de prendre du recul sur sa propre situation.
CO. C’est clair que c’est un très bon moyen de valoriser le travail et le savoir-faire de ces personnes.
Même la parole, c’est tellement précieux. Puis les retranscriptions ne donnent pas les phrases exactes, les voix, les intonations. Justement, en faisant cette interview avec vous, je me rends compte que j’aurai peu de matière à vous donner sur tout ce que je vois ou entends. Et c’est tellement dommage.
Ponte en mis tacones n° 2, exctrato — (es)
Conocimos a La Diabla en 2021, antes de la exposición Argent Facile, a través de Eva-Luna Perez Cruz. A raíz de ese encuentro, empezamos a trabajar juntes en colaboración con la librería La Dispersion de Ginebra para la publicación de la primera novela de La Diabla, Ponte en mis tacones. Le pedimos que nos enviara esta nueva contribución, que es un fragmento de su próximo libro.
El trabajo sexual siempre ha estado en constante cambio dependiendo de infinitos factores. No es fácil adaptarse a los cambios que se imponen en nuestras vidas, y menos en este trabajo. En los últimos años, ha habido un cambio radical: la digitalización del trabajo sexual. Hoy en día, es difícil trabajar sin internet, ya sea en la calle, en los salones o como escort independiente. Los clientes prefieren la comodidad de elegir a una chica desde su teléfono, tomarse su tiempo viendo fotos, comparar, fantasear. Muchos también molestan por mensaje, haciendo preguntas interminables que nos hacen perder tiempo… ¡y mucho!
El trabajo sexual se ha digitalizado y, con ello, han surgido nuevas formas de ejercerlo, nuevos conocimientos que adquirir y también nuevos riesgos. Es casi como volver a aprender a trabajar. No basta con abrir un perfil en una plataforma y esperar a que el dinero fluya. Para que funcione realmente, hay que desarrollar muchas habilidades: saber venderse, tener carisma, generar contenido atractivo, manejar las redes sociales, responder mensajes constantemente, negociar precios sin ceder ante clientes abusivos y, sobre todo, tener paciencia.
Mucha gente cree que hacer trabajo sexual virtual es fácil, pero la realidad es otra. Se necesita disciplina, creatividad y perseverancia. Hay días en los que no vendes nada, otros en los que te saturan con mensajes sin que nadie compre realmente. Hay que estar disponible, pero sin agotarse. Saber poner límites sin perder clientes. Aprender a manejar el rechazo sin desmotivarse. Es un trabajo que exige estrategia y mucha resistencia mental.
Además, hay que lidiar con la presión de estar constantemente visible. No es solo subir fotos y videos, sino interactuar con los seguidores que pueden ser potencialmente clientes, responder preguntas, jugar con la ilusión de cercanía sin exponer demasiado la vida personal. Es una línea delgada entre lo íntimo y lo profesional. Muchas veces, los clientes quieren más y más, exigiendo niveles de interacción que pueden llegar a ser agotadores.
Una de las mayores revoluciones ha sido la venta de contenidos eróticos en plataformas como OnlyFans, donde se puede generar un ingreso estable sin necesidad de encuentros físicos con los clientes. Desde que empecé a vender fotos, videos y audios, recibo decenas de solicitudes de contenido muy peculiar, además de la clásica venta de ropa usada. Sin embargo, la venta de contenido erótico o fetichista no es algo nuevo ni exclusivo del trabajo sexual virtual.
Siempre he tenido clientes que, después de una prestación, me preguntaban si podían comprarme bragas usadas, calcetines, toallas de ducha o incluso mis alfombras de cama. Lo que ha cambiado en los últimos años es que esta demanda se ha intensificado. Durante el COVID, la venta de objetos alcanzó su punto más alto; nunca había vendido tanto como en ese periodo. Pero lo sorprendente es que esa tendencia no desapareció con el fin de la pandemia. Hoy en día, sigo vendiendo de todo: prendas íntimas, ropa de deporte sudada, zapatos usados… Todo puede ser fantaseado y erotizado. Es práctico, aunque a veces sorprendente.
Uno de los mayores retos del trabajo sexual virtual es la gestión del dinero. En el trabajo sexual “presencial”, siempre se ha sabido manejar el efectivo. Recibes el pago al momento, decides en qué gastarlo, cómo administrarlo, cómo esconderlo si es necesario. Hay una libertad en el manejo del dinero en efectivo que no existe en el mundo virtual. Obviamente, descarto los casos en donde la persona no ejerce el trabajo sexual de manera autónoma como en situaciones de trata o explotación.
En cambio, con el trabajo sexual digital, el dinero pasa por plataformas, bancos, aplicaciones y métodos de pago electrónicos. Hay comisiones, retrasos en los pagos, conversiones de moneda. Y, sobre todo, hay un riesgo real de que las cuentas sean bloqueadas o cerradas si los bancos sospechan que el dinero proviene de actividades “sensibles”.
En Suiza, donde la fiscalidad es extremadamente estricta, gestionar estos ingresos es aún más complicado. Un simple error puede hacer que una trabajadora sexual termine en problemas con hacienda o con su banco. Muchas veces, el dinero llega en pequeñas cantidades dispersas, lo que hace que sea difícil llevar un control exacto de lo que se gana y lo que se debe declarar. No es raro ver a compañeras que, sin darse cuenta, terminan acumulando ingresos sin declararlos, hasta que llega una notificación de la administración fiscal exigiendo explicaciones.
Para muchas trabajadoras sexuales, especialmente aquellas en situación irregular, esto representa un problema aún mayor. Sin papeles o sin un estatuto legal claro, no pueden abrir una cuenta bancaria a su nombre. Esto significa que tienen que buscar soluciones alternativas: usar cuentas de amigos, recibir pagos a través de aplicaciones, o incluso recurrir a criptomonedas. Pero cada método tiene sus riesgos.
Recibir dinero en cuentas de terceros puede ser peligroso si esa persona decide quedarse con el dinero o si hay problemas legales.
Las aplicaciones de pago como PayPal o Revolut pueden bloquear fondos sin previo aviso si detectan actividad sospechosa. Y aunque las criptomonedas ofrecen anonimato, convertirlas en dinero real sin levantar sospechas es un desafío.
Muchas compañeras optan por no declarar ciertos ingresos, pensando que así evitan problemas. Pero en países como Suiza, donde el control fiscal es riguro so, esto puede traer consecuencias graves. La evasión fiscal no solo implica multas, sino que puede dificultar aún más la posibilidad de regularizarse en el futuro.
La gestión del dinero en el trabajo sexual virtual no solo es un reto legal, sino también personal. Muchas veces, el dinero digital se gasta más rápido. Cuando no tienes billetes en la mano, es fácil perder la noción de cuánto tienes realmente.
Con el dinero en efectivo, es diferente. Lo ves, lo tocas, lo cuentas. Es más fácil entender cuánto ganas y cuánto gastas. Pero con el dinero virtual, el riesgo de gastar impulsivamente es mayor. Las plataformas de pago hacen que parezca fácil, con un simple clic puedes transferir, comprar, suscribirte a algo. Y si no tienes cuidado, puedes terminar sin ahorros y sin darte cuenta de en qué se ha ido el dinero.
Por eso, aprender a administrar los ingresos es fundamental. Hay que separar gastos, ahorrar, planificar inversiones y asegurarse de que el trabajo virtual sea realmente rentable a largo plazo. No basta con ganar mucho si el dinero se va igual de rápido.
A pesar de los desafíos, el trabajo sexual virtual ofrece algo muy valioso: autonomía. Poder generar ingresos sin depender de intermediarios, sin exponerse físicamente a los clientes, sin estar atada a un horario fijo o a un lugar específico, da una sensación de empoderamiento. Es poder decidir cómo y cuándo trabajar, con quién interactuar y qué tipo de contenido vender.
Aprender a manejar esta nueva forma de trabajo es un proceso de adaptación, pero también de crecimiento. Se requiere paciencia, estrategia y mucha inteligencia emocional, pero una vez que se logra dominar, puede ser una herramienta poderosa para la independencia financiera.
El trabajo sexual siempre ha sido un espacio de lucha y resistencia. Adaptarse a lo digital no significa perder autonomía, sino encontrar nuevas maneras de ejercerlo con dignidad y en mejores condiciones. Porque al final, más allá de las dificultades, tener el control sobre nuestra propia forma de trabajar es lo que realmente nos da poder.
Ponte en mis tacones n° 2, extrait — (fr)
Nous avons rencontré La Diabla en 2021, en amont de l’exposition Argent Facile via Eva-Luna Perez Cruz. À l’issue de cette rencontre, nous avons commencé à travailler ensemble en collaboration avec la librairie La Dispersion à Genève sur l’édition du premier roman de La Diabla, Ponte en mis tacones. Nous lui avons proposé de nous envoyer cette nouvelle contribution qui est un extrait de son prochain livre.
Le travail du sexe a toujours été en constante évolution, influencé par une infinité de facteurs. Il n’est jamais facile de s’adapter aux changements qui s’imposent dans nos vies, encore moins dans ce métier. Ces dernières années, un bouleversement radical a eu lieu : la digitalisation du travail du sexe. Aujourd’hui, il est difficile d’exercer le travail du sexe sans Internet, que ce soit dans la rue, dans les salons ou en tant qu’escort indépendante. Les clients préfèrent le confort de choisir une femme depuis leur téléphone, prendre leur temps pour regarder des photos, comparer, fantasmer. Beaucoup en profitent aussi pour harceler par messages, posant des questions interminables qui nous font perdre du temps.
Le travail du sexe s’est digitalisé et avec cela, de nouvelles façons d’exercer ont émergé, impliquant de nouvelles compétences à acquérir, mais aussi de nouveaux risques. C’est presque comme réapprendre à travailler. Il ne suffit pas d’ouvrir un profil sur une plateforme et d’attendre que l’argent coule à flot. Pour que cela fonctionne réellement, il faut développer de nombreuses compétences : savoir se vendre, avoir du charisme, créer du contenu attractif, gérer les réseaux sociaux, répondre aux messages en permanence, négocier les prix sans céder aux clients abusifs et surtout, faire preuve de patience.
Beaucoup de gens pensent que le travail du sexe virtuel est facile, mais la réalité est bien différente. Il faut de la discipline, de la créativité et de la persévérance. Il y a des jours où l’on ne vend rien et d’autres où l’on est submergées de messages sans qu’aucun achat ne se concrétise. Il faut être disponible, mais sans s’épuiser. Savoir poser des limites sans perdre de clients. Apprendre à gérer le rejet sans se démotiver. C’est un travail qui exige stratégie et une grande force mentale.
En plus, il faut gérer la pression d’être constamment visible. Ce n’est pas juste publier des photos et des vidéos, mais aussi interagir avec des abonnés qui peuvent être de potentiels clients, répondre aux questions, jouer avec l’illusion de proximité sans trop dévoiler sa vie personnelle. Il y a une fine frontière entre l’intime et le professionnel. Souvent, les clients en veulent toujours plus, demandant des niveaux d’interaction qui peuvent devenir épuisants.
L’une des plus grandes révolutions a été la vente de contenus érotiques sur des plateformes comme OnlyFans, qui permettent de générer un revenu stable sans avoir à rencontrer physiquement les clients. Depuis que j’ai commencé à vendre des photos, vidéos et audios, je reçois des dizaines de demandes de contenus très particuliers, en plus de la classique vente de vêtements usagés. Toutefois, la vente de contenu érotique ou fétichiste n’est ni nouvelle ni exclusive au travail du sexe virtuel.
J’ai toujours eu des clients qui, après une prestation, me demandaient s’ils pouvaient m’acheter des culottes usagées, des chaussettes, des serviettes de bain ou même mes draps de lit. Ce qui a changé ces dernières années, c’est que cette demande s’est intensifiée. Pendant le COVID, la vente d’objets a atteint son apogée ; je n’ai jamais autant vendu qu’à cette période. Mais le plus surprenant, c’est que cette tendance n’a pas disparu avec la fin de la pandémie. Aujourd’hui encore, je vends de tout : sous-vêtements, vêtements de sport transpirés, chaussures usées… Tout peut être fantasmé et érotisé. C’est pratique, même si parfois surprenant.
L’un des plus grands défis du travail du sexe virtuel est la gestion de l’argent. Dans le travail du sexe présentiel, la gestion du cash a toujours été plus maîtrisée. On reçoit le paiement immédiatement, on décide comment le dépenser, comment l’administrer, comment le cacher si nécessaire. Il y a une liberté dans la gestion de l’argent cash qui n’existe pas dans le monde virtuel. Bien sûr, je ne parle pas des cas où la personne n’exerce pas de manière autonome, comme dans les situations de traite ou d’exploitation.
En revanche, avec le travail du sexe digital, l’argent transite par des plateformes, des banques, des applications et des moyens de paiement électroniques. Il y a des commissions, des retards de paiement, des conversions monétaires. Et surtout, il y a un risque réel que les comptes soient bloqués ou fermés si les banques soupçonnent que l’argent provient d’activités sensibles.
En Suisse, où la fiscalité est extrêmement stricte, gérer ces revenus est encore plus compliqué. Une simple erreur peut amener une travailleuse du sexe à avoir des problèmes avec le fisc ou avec sa banque. Souvent, l’argent arrive en petites sommes dispersées, ce qui rend difficile le suivi précis des gains et des montants à déclarer. Il n’est pas rare de voir des collègues qui, sans s’en rendre compte, accumulent des revenus non déclarés jusqu’à recevoir une notification du fisc leur demandant des explications.
Pour de nombreuses travailleuses du sexe, en particulier celles en situation irrégulière, cela représente un problème encore plus grand. Sans papiers ou sans un statut légal clair, elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire à leur nom. Cela signifie qu’elles doivent trouver des solutions alternatives : utiliser les comptes de proches, recevoir des paiements via des applications, ou même recourir aux cryptomonnaies. Mais chaque méthode comporte des risques.
Recevoir de l’argent sur le compte d’un tiers peut être dangereux si cette personne décide de garder l’argent ou s’il y a des complications légales. Il n’y a pas d’amitiés dans le travail du sexe, je l’ai toujours dit. Il ne faut faire confiance à personne.
Les applications de paiement comme PayPal ou Revolut peuvent bloquer des fonds sans avertissement s’ils détectent une activité suspecte. Et même si les cryptomonnaies offrent de l’anonymat, les convertir en argent réel sans éveiller les soupçons est un défi.
Beaucoup de collègues choisissent de ne pas déclarer certains revenus, pensant ainsi éviter des problèmes. Mais dans des pays comme la Suisse, où le contrôle fiscal est rigoureux, cela peut avoir de graves conséquences. L’évasion fiscale ne signifie pas seulement des amendes ; cela peut également compliquer toute tentative de régularisation future.
La gestion de l’argent dans le travail du sexe virtuel est non seulement un défi légal, mais aussi personnel. Très souvent, l’argent numérique se dépense plus rapidement. Quand on n’a pas de billets en main, il est facile de perdre la notion de ce que l’on possède réellement.
Avec l’argent cash, c’est différent. On le voit, on le touche, on le compte. Il est plus facile de comprendre combien on gagne et combien on dépense. Mais avec l’argent virtuel, le risque de dépenses impulsives est plus élevé. Les plateformes de paiement rendent tout facile : en un simple clic, on peut transférer, acheter, s’abonner à un service. Et si on n’y prend pas garde, on peut se retrouver sans économies, sans même savoir où est passé l’argent.
C’est pourquoi apprendre à gérer ses revenus est fondamental. Il faut séparer les dépenses, épargner, planifier des investissements et s’assurer que le travail virtuel soit réellement rentable à long terme. Gagner beaucoup ne sert à rien si l’argent disparaît aussi vite.
Pouvoir générer des revenus sans intermédiaires, sans s’exposer physiquement aux clients, sans être contrainte par des horaires fixes ou un lieu précis procure une sensation d’empowerment. C’est pouvoir décider comment et quand travailler, avec qui interagir et quel type de contenu vendre.
Apprendre à maîtriser cette nouvelle forme de travail est un processus d’adaptation, mais aussi de croissance. Il faut de la patience, de la stratégie et une grande intelligence émotionnelle. Mais une fois que l’on y parvient, cela peut devenir un outil puissant pour atteindre l’indépendance financière.
Tant que tu dis pas je t’aime, ils ne pourront pas porter plainte, entretien —
La personne interviewée dans cet entretien préfère rester anonyme. Nous avons discuté des enjeux reliés à une de ses précédentes activités professionnelles au sein d’une agence de chatteur·euses pour modèles OnlyFans. Perle, qui est interviewée plus loin dans le livre, était également présente lors de cet entretien.
Collectif Occasionnel. Est-ce que tu peux résumer le travail que tu faisais et comment tu en es venue à le faire ?
M. J’étais chatteuse pour une agence qui gère des modèles OnlyFans. Mon travail consistait à me connecter aux plateformes OnlyFans, MYM, Snapchat, Instagram et à me faire passer pour la·e modèle de l’agence que j’incarnais, pour vendre son contenu. J’ai fait ça pendant trois mois, ça m’est tombé dessus un peu par hasard. J’avais une amie qui faisait ça depuis deux ans qui m’a dit que son agence recrutait des nouvelles chatteur·euses. Elle m’a proposé et j’ai dit oui par nécessité et curiosité. Je travaillais depuis chez moi, trente heures par semaine, à temps plein.
Une journée type commence par se connecter sur le Discord de l’agence pour pointer. Je lis les informations du jour et ensuite je me connecte aux plateformes de la·e modèle. J’ai 80 messages non lus en moyenne par modèle. Les abonnés sont triés par labels : les Timewasters, (ceux qui ne dépensent pas d’argent), les Good Buyers (ceux qui dépensent un peu), les Spenders (ceux qui dépensent beaucoup) et enfin les Big Fishes (ceux qui dépensent de très grosses sommes). On doit prioriser ceux qui dépensent beaucoup. Si ce sont des abonnés récents, en général il faut lancer un script. Un script, c’est un scénario porno de masturbation, avec des photos et des vidéos de la·e modèle qui ont été pré-filmées et des textes pré-écrits. J’avais 20 scénarios à disposition avec différents contextes, de jour, de nuit, dans une pièce en particulier, avec des jouets, différentes pratiques, etc. L’idée est de faire croire aux abonnés qu’il s’agit d’un contenu personnalisé et que c’est en direct. On s’adapte pour rendre le scénario crédible. On a une échelle de tarifs croissants. Le but, c’est de réussir à faire un script complet, c’est-à-dire faire acheter tous les médias à l’abonné jusqu’à la fin du script qui est l’orgasme. Les abonnés plus anciens qui ont déjà dépensé dans plusieurs scripts peuvent payer plus cher pour des contenus « inédits », par exemple l’accès au Snapchat pour faire des sessions live avec la·e modèle. On leur fait croire à un service VIP en construisant une relation affective de confiance avec eux.
Pour reprendre les mots de mon boss, c’est une fois qu’ils sont tombés amoureux qu’ils vont dépenser le plus d’argent. Nous sommes formé·es à des méthodes de manipulation. J’avais des formations vidéos et textuelles qui apprennent le chantage émotionnel, notamment ce qu’ils appellent le female bullshit, un terme qui en réalité ne désigne rien d’autre que du bullshit et du gaslightLe gaslighting est une technique de manipulation mentale abusive qui consiste à faire douter une personne de sa perception de la réalité ou de sa propre santé mentale., qui ne sont pas des compétences spécifiquement féminines. Mais c’est appelé comme ça à cause de l’idée misogyne que les femmes sont vénales et profitent de leurs « atouts » pour extorquer de l’argent aux hommes. La misogynie est présente à plein de niveaux au sein de ces agences.
L’enjeu principal à comprendre dans ce job, c’est que OnlyFans et MYM se situent à la croisée entre la vente de contenu pornographique et la virtual girlfriend. Notamment parce que OnlyFans est une plateforme qui se présente et se promeut comme un réseau social. Sa configuration et son design suggèrent qu’on peut accéder à de véritables relations humaines et à de véritables connexions émotionnelles. Le porno gratuit existant partout, les usagers d’OnlyFans et MYM sont à la recherche de quelque chose en plus. Il y a des méthodes pour la gestion de ces relations affectives parasociales. Mon boss disait que la règle d’or était de ne jamais dire « je t’aime » ou de parler de « couple » même si tu le sous-entends constamment par d’autres registres de langage. Il m’a dit quelque chose qui m’a beaucoup marqué c’était : « Tant que tu dis pas je t’aime, ils ne pourront pas porter plainte. » On entretient un flou qui permet de pousser les abonnés à dépenser sans que jamais ça ne prenne fin. Parfois ils ont conscience que c’est fictif, parfois non.
CO. Est-ce que tu étais en contact avec les personnes qui publient du contenu pour qui tu chattais ? C’est quel type d’échanges ?
M. Oui, via Discord. Chaque modèle avait un espace dédié où les chatteur·euses se coordonnaient pour gérer les plannings, organiser des rendez-vous Snapchat ou vendre des vidéos personnalisées. Par exemple, si un client demandait une vidéo spécifique, je vérifiais avec la·e modèle si iel pouvait la faire. En cas de retard, il fallait souvent inventer des excuses.
M. Les personnes qui se lancent dans ce travail sans connaître d’autres collègues se retrouvent souvent isolées, et il y a peu de solidarité entre les travailleur·euses. La concurrence est inévitable en raison de la structure de rémunération basée sur la commission. Les travailleur·euses expérimenté·es gagnent plus, car iels ont déjà des abonnés réguliers et fidèles, tandis que les débutant·es partent de zéro et n’ont pas encore de virtual sugar daddies récurrents. Pour le même temps de travail, iel gagnent bien moins.
Il n’y a pas de partage des bénéfices, et chacun·e garde ses abonnés les plus dépensiers pour ellui-même. Les informations sur les clients sont partagées pour éviter qu’un·e collègue ne prenne le relais sur un client qu’un·e autre a déjà ciblé. Cela permet de préserver l’investissement personnel de chaque travailleur·euse, car iel mise sur son temps et ses efforts pour maximiser ses gains. Bien qu’il y ait des échanges de conseils sur un Discord, la structure de l’entreprise empêche toute forme de solidarité réelle, car chaque personne est payée individuellement à la commission et non à l’heure. Cela impose d’être individualiste et de rester motivé·e pour réussir.
M. Le rôle du patron et de l’administration était principalement axé sur le coaching pour m’aider à améliorer ma performance. Ils revenaient sur mes erreurs, me signalant ce que j’aurais pu mieux faire dans la gestion des échanges et des ventes. Étant donné que le travail est en statut auto-entrepreneur, dans un environnement où la précarité est présente et où la demande est forte, on est rapidement remplacé·e si l’on quitte. Ils m’encourageaient en me faisant croire que c’était à ma portée de gagner de grosses sommes, à condition de persévérer. Par exemple, parmi les travailleur·euses les plus expérimenté·es, il y avait l’amie qui m’a introduite et une autre fille, qui était la plus performante de toute l’agence. Elle gagnait vraiment beaucoup d’argent, mais c’était après deux ans à temps plein où elle avait pu constituer une liste impressionnante d’abonnés réguliers. Quand tu débutes, il faut vraiment être motivé·e et tenir sur la durée pour espérer obtenir un salaire correct. Pour ma part, en trois mois, je n’ai jamais atteint le SMIC, même si je l’ai frôlé à quelques reprises. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je suis partie, car c’est pas normal à mes yeux de travailler à temps plein et de gagner moins que le SMIC. Même si au bout d’un moment c’est possible de dépasser le SMIC, je ne suis pas d’accord avec cette manière de faire et je me sentais exploitée. Le patron est parfaitement conscient que le modèle de l’auto-entrepreneuriat permet de flirter avec la légalité. Sans contrat, il n’y a aucune sécurité : pas de cotisation pour la retraite, pas d’arrêt maladie, et le risque de perdre son emploi du jour au lendemain est omniprésent. Ce format, censé offrir liberté et flexibilité, engendre en réalité une grande insécurité et précarité. Et ils le savent très bien. Les relations étaient amicales en apparence, mais au fond c’était une dynamique d’exploitation où j’avais très peu de marge de manœuvre.
M. J’ai arrêté ce travail pour trois raisons principales. D’abord parce que le modèle économique qui te rémunère uniquement à la performance est inacceptable pour moi. D’autant plus que c’était du salariat déguisé. Bien qu’on était censé·es être auto-entrepreneur·euses, on avait des horaires imposés et ça contredit le principe de flexibilité que prétend offrir l’auto-entrepreneuriat.
Ensuite, parce qu’à titre personnel, ça me provoquait beaucoup de mal-être. J’étais constamment exposée à de grandes expressions de violence misogyne dans mes interactions avec les abonnés et cette violence se répercutait sur mon état mental. Même si ce n’était pas mon identité qui était en première ligne, j’étais confrontée à cette violence tous les jours à un rythme d’usine. J’étais aussi mal vis-à-vis de ce qu’on proposait dans mon agence en termes de contenu pornographique. Les modèles avaient des profils fictifs complètement optimisés pour le marché normé de la pornographie hétéro. Pour donner un exemple, toutes les modèles de l’agence avaient entre vingt-deux et vingt-neuf ans mais on indiquait sur leurs profils qu’elles avaient dix-huit ou dix-neuf ans, sinon ça marchait moins bien. Quand je faisais connaissance avec les abonnés, je pouvais aussi dire que ma modèle avait une petite sœur de quinze ans, donc mineure mais tout juste la majorité sexuelle. Je trouvais ça affolant à quel point on jouait avec la limite légale des fantasmes pédophiles et plus généralement avec un panel constant de stigmates sexistes. Je suis aussi en désaccord avec le fait que le travail du sexe profite à des hommes, comme le patron de mon agence et à plus grande échelle, à des milliardaires comme Leonid Radvinsky, l’actionnaire principal d’OnlyFans. Lui, comme les patrons de ces plateformes ou des agences qui gèrent les modèles, se rémunèrent en récoltant tous les jours une partie du fruit du travail du sexe de centaines de milliers de travailleur·euses. Par exemple, la plateforme OnlyFans prend 20 % de commission sur chaque média vendu. La gestion lucrative du TdS, même si ce dernier est virtuel, est une forme de proxénétisme. Ce n’est pas juste un service, c’est un système d’exploitation. Le problème dans ces plateformes c’est le capitalisme. Pour rappel, OnlyFans a été fondé en 2016 par Thomas et Tim Stokely, deux hommes d’affaires anglais et le site a vraiment pris de l’ampleur après 2020, car la crise du COVID a plongé énormément de travailleur·euses dans une forme encore plus grande de précarité.
Une troisième raison, plus personnelle, a aussi joué un rôle. Un jour, ma modèle a cessé de communiquer, et le patron de l’agence nous a appris qu’elle faisait une dépression. Ça m’a beaucoup perturbée de continuer à endosser son identité dans ces conditions. Elle a commencé à accumuler des retards dans ses vidéos et j’ai réalisé que j’étais incapable de continuer à travailler sans elle. Cette image qui n’était pas la mienne, que je devais incarner pour satisfaire des fantasmes, me mettait beaucoup plus mal à l’aise en l’absence de communication directe avec celle dont j’utilisais l’image, et je me suis posé beaucoup de questions sur les limites de ce système.
CO. Il pourrait être intéressant de mettre en place des initiatives autogérées, mais le principal obstacle réside dans le monopole exercé par ces agences. Penses-tu que certains hommes réalisent qu’ils ne sont pas en train de communiquer directement avec la·e modèle ?
M. Certains en sont conscients. J’ai déjà été confrontée à des hommes qui me disaient : « Je sais que c’est une agence et que ce n’est pas vraiment toi. » La stratégie à adopter consiste à nier en bloc cette réalité. Si l’abonné insiste de manière excessive, mais qu’il semble prêt à dépenser, je contacte la·e modèle pour lui demander de lui envoyer une vidéo personnalisée en guise de preuve. Certains abonnés connaissent l’existence de ces agences grâce à une médiatisation très récente. Par ailleurs, de plus en plus d’auto-entrepreneurs à l’idéologie masculiniste incitent leur audience masculine sur Youtube et TikTok à se lancer dans le business des agences OnlyFans. En faisant mes recherches, j’ai constaté qu’il y avait encore un vide juridique concernant la question du proxénétisme car le phénomène était trop récent. Dans mon agence, tout·es les modèles étaient majeur·es et blanc·hes, mais il existe des modèles dont l’âge réel, l’origine ou la nationalité sont incertains. Des réseaux sur Telegram existent où des créateurs d’agences échangent des femmes en situation de précarité, y compris des mineur·es ou des femmes sans papiers. La plupart du temps, les modèles intègrent ces agences non pas parce qu’iels sont dépassé·es par leurs abonnés, mais parce qu’iels sont approché·es par des hommes leur promettant des gains « faciles ». Dans mon agence, quand j’y étais encore, notre patron voulait recruter de nouveaux·lles modèles et il nous envoyait des photos de candidat·es potentiel·les pour nous demander notre avis, mais iels n’avaient pas encore de compte. Cela crée également, j’imagine, une relation de dépendance entre l’agence et la·e modèle. Car lorsqu’iels sont introduit·es et intégré·es via les agences, ça doit être difficile de s’en séparer ensuite. Quelques enquêtes, comme un reportage du Parisien« ‹ Il a changé mon RIB › : des modèles érotiques dénoncent la dérive de leur agent MYM », vidéo sur le site du Parisien, 16 juillet 2023., ont mis en lumière la situation de certaines femmes exploitées par ces agences. Bien que mon agence ne m’ait pas semblé problématique de manière alarmante, je suis consciente que je ne sais pas tout sur son fonctionnement, mais que surtout elle ne reflète pas la réalité dans son ensemble. La législation n’a pas encore évolué pour encadrer ces pratiques, et en particulier le trafic d’êtres humains à destination du contenu virtuel.
CO. Les méthodes utilisées dans ce domaine ressemblent exactement à celles observées dans le proxénétisme, notamment avec les escorts. Par exemple, cela inclut les personnes migrantes sans papiers. La stratégie est identique, mais elle est appliquée sur Internet, où les risques sont moindres.
M. En effet, les espaces en ligne pour l’organisation des activités illicites évoluent et sont difficiles à contrôler et le problème s’aggrave avec les milliardaires de la tech qui en accentuent le monopole. C’est très inquiétant que certains CEO aient autant de pouvoir. Un bon exemple est la messagerie Telegram qui est en train de devenir le nouveau Dark Web et qui héberge maintenant, entre autres, les organisations terroristes et les réseaux de pédocriminalité. Son CEO, Pavel Dourov, défend une idéologie libertarienne. Sa vision de la liberté d’expression et des libertés individuelles s’appuie sur le fait de protéger l’anonymat de ses utilisateur·ices à tout prix. Il applique également au monde numérique les principes fondateurs du libéralisme, qui préconisent la liberté individuelle par l’absence de règles et de régulation. Dourov refuse quasi systématiquement de collaborer avec les autorités, ce qui a conduit à son arrestation et à son placement sous contrôle judiciaire en France. Les patrons des agences comme la mienne utilisent Telegram pour s’échanger des conseils et se vendre mutuellement des modèles. Je sais que certain·es modèles possédaient également des profils sur Telegram auxquels je n’avais pas accès. C’était principalement le patron et les chatteur·euses plus expérimenté·es qui les géraient. Et l’une de mes préoccupations était le contrôle que les modèles avaient sur leurs images et leur contenu. Mon entrée dans l’agence a été très rapide, sur la base d’un entretien téléphonique et d’une recommandation d’une autre chatteuse. J’ai eu tout de suite accès à tous les identifiants des réseaux sociaux, ainsi qu’aux espaces de stockage en ligne contenant les images et les vidéos. Je trouvais cette rapidité particulièrement risquée pour la sécurité des modèles. Et bien que je n’y sois restée que trois mois, j’ai été témoin d’un incident durant cette période. Une nouvelle chatteuse est entrée dans l’agence et a volé le contenu d’une modèle, puis créé d’autres comptes pour revendre le contenu ailleurs. La modèle a porté plainte et la chatteuse a été renvoyée, mais ça a révélé un manque de sécurité flagrant. Plus le contenu passe entre des mains différentes, plus il devient difficile de le contrôler. Telegram est une messagerie qui soulève de nombreuses questions éthiques et le fait que ces activités existent également sur cette plateforme me suscite des inquiétudes quant à l’utilisation et à la circulation des images et des informations. Les modèles ne sont sensiblement pas protégé·es comme iels devraient l’être.
Perle. Il y a un youtubeur qui modifie des photographies en changeant les visages tout en conservant les corps. Les photos partagées sur Telegram vont très loin, bien au-delà de ce que l’on pourrait imaginer. Grâce à l’intelligence artificielle, l’exploitation des corps et des visages devient encore plus poussée.
M. La sexualité sur les supports numériques, en particulier avec l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux, soulève de nombreuses questions éthiques et de sécurité. Dans un des reportages que j’avais visionné, une agence avait été dénoncée pour avoir continué à vendre du contenu sans l’accord d’une modèle, qui avait complètement perdu l’accès à ses mots de passe et à ses plateformes. Elle n’avait plus aucun contrôle sur ses images ni sur leur utilisation.
M. Comme je l’ai mentionné, c’était une expérience exceptionnelle. Je suis consciente de ma chance et de mon privilège de disposer encore de temps et d’options pour envisager d’autres moyens de travailler, même si c’est évident qu’au vu de mes conditions matérielles actuelles, elles risquent d’être aussi aliénantes et mal rémunérées. Je n’avais pas les épaules pour faire ce travail et ça m’a soulagé de partir, bien que la question de la précarité me préoccupe toujours. J’ai trouvé intéressant et enrichissant de comprendre de manière plus concrète et approfondie le fonctionnement de ces plateformes, et de pouvoir aller au-delà des idées pré-faites et des préjugés, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Cependant, je pense toujours que le féminisme et le capitalisme ne s’accordent pas bien ensemble. Il est essentiel de rester vigilant·es face aux systèmes d’exploitation qui existent entre les dominé·es et les dominant·es, et de comprendre comment les dominant·es en question peuvent en dissimuler les mécanismes pour leur bénéfice. Cette incursion dans ce modèle précis met en évidence que ce sont en écrasante majorité des femmes en situation de précarité économique qui se retrouvent à exercer ces métiers pénibles et dangereux, physiquement et psychologiquement, tandis que ce sont des hommes, non concernés par les stigmates du sexisme, qui dirigent et qui en tirent le plus grand profit économique. Je suis dérangée par la manière dont ces entreprises dirigées par des hommes, instrumentalisent et capitalisent à leur profit, sur des concepts tels que l’autonomisation féminine par le sexe et les discours féministes qui les accompagnent. Lorsque j’y travaillais encore, j’avais constamment des publicités sponsorisées sur Instagram pour OnlyFans Creator. C’est la partie d’OnlyFans destinée aux potentiel·les créateur·ices de contenu et non aux potentiel·les abonné·es. Les publicités ne mettaient en scène que des femmes et jamais des hommes, ni les clients, ni les patrons. On y voyait des femmes seules assises dans des restaurants, avec une coupe de champagne et un sac à main de luxe. Les slogans disaient : « Gagnez votre indépendance financière, devenez la cheffe d’entreprise de votre vie » et reprenaient tout le registre de langage et l’imaginaire de la Girl BossLe terme Girl Boss désigne une femme qui incarne l’ambition, l’indépendance et la réussite professionnelle, souvent en tant qu’entrepreneuse ou leadeuse dans son domaine. Popularisé par Sophia Amoruso dans son livre #GIRLBOSS, (2014) il met en avant une vision de la femme autonome, qui prend le contrôle de sa carrière et de sa vie. Cependant, ce terme a aussi été critiqué pour sa récupération marketing et son côté individualiste, certaines personnes estimant qu’il repose sur une idée de féminisme capitaliste qui ne remet pas en question les structures de pouvoir existantes.. Je trouve ce marketing particulièrement odieux et mensonger, car en ne représentant que des femmes dans ces images il sous-entend qu’elles en sont à l’origine, alors qu’en réalité il s’agit de deux hommes milliardaires, Thomas et Tim Stokely. C’est profondément pervers la manière dont les hommes exploitent le féminisme à des fins libérales et capitalistes et retournent nos propres outils de survie contre nous.
Payez nous ! Les enjeux d’une justice économique —
En tant que collectif, nous nous sommes intéressé·es aux liens qui existent entre travail du sexe et travail artistique. Tout au long des expositions et évènements que nous avons menés, la question de la circulation de l’argent a été centrale. Lors des entretiens menés en amont de l’exposition Argent Facile en 2022, nous avons exploré ces thèmes en interrogeant les participant·es sur l’impact du travail du sexe sur leur pratique artistique.
Les témoignages recueillis révèlent une prédominance de pratiques artistiques accessibles et peu coûteuses : écriture, performance, dessin, bande dessinée. Pour toutes ces personnes, l’argent issu du travail du sexe est avant tout un moyen de subsistance, mais aussi un levier pour se libérer du temps. Un temps précieux pour créer, militer, voyager, que ne permettrait pas un emploi à plein temps.
Le corps est la force de travail de la pute et de l’artiste. L’artiste et le·a travailleur·euse du sexe doivent négocier leur visibilité, mettre en avant leur travail et gérer elleux-mêmes leur production. Iels sont leurs propres secrétaires, community manager, graphistes, photographes. Pourtant, si de nombreux·ses travailleur·euses du sexe ont une pratique artistique, celle-ci reste rarement reconnue par les institutions, qu’elle soit liée ou non à leur expérience dans le travail du sexe.
Face à une représentation souvent biaisée ou distante du travail du sexe dans le champ artistique et cinématographique, notre collectif cherche à mettre des moyens à disposition et à encourager la production de formes vraisemblables, créées par les personnes concernées. Cependant, nous savons que tout le monde ne part pas du même point. Même au sein d’une école d’art, nous n’avons pas les mêmes moyens d’un·e étudiant·e à l’autre. Certain·es peuvent se consacrer pleinement à leur pratique, tandis que d’autres doivent jongler entre le travail et les études.
Au sein du Collectif Occasionnel, nous avons tout·es étudié dans des écoles d’art et obtenu des diplômes. Nos parcours et nos privilèges respectifs nous ont permis d’acquérir des outils : nous savons où chercher des financements, comment monter des dossiers de subventions, où emprunter du matériel et comment organiser une exposition collectivement.
Conscient·es que ces savoirs restent souvent inaccessibles à de nombreux·ses artistes qui ne sont pas inscrit·es dans un cadre institutionnel ou qui n’ont pas eu l’opportunité de suivre des études d’art, nous avons créé ce collectif. Nous avons la volonté de partager ces ressources et ces connaissances pour favoriser des initiatives artistiques collaboratives et solidaires.
Dans chacune de nos initiatives, la rémunération est un principe fondamental. Nous refusons l’idée que la « visibilité » puisse suffire comme rétribution. Cette exigence est d’autant plus essentielle que nous mettons en avant des personnes souvent marginalisées dans le champ de l’art contemporain et la plupart du temps dans des situations de précarité.
Je suis un fils de pute et fier de l’être entretien —
Igor Schimek est le premier enfant de Grisélidis Réal : écrivaine, artiste et prostituée suisse, militante pour les droits des travailleur·ses du sexe. Nous l’avons rencontré avec Imara, une amie du collectif, pour un entretien, et pour parler notamment de lien de parenté avec une TdS.
IS. Oui. Une catastrophe. Il ne voulait pas d’enfant. Elle a refusé d’avorter. Ça a explosé très vite. À six mois, elle m’a déposé chez mes grands-parents paternels, qui se sont occupé·es de moi. Un an plus tard, iels ont refusé qu’elle me récupère. Iels estimaient son mode de vie trop chaotique et ont alors décidé de m’adopter.
Je ne l’ai retrouvée qu’à quinze ou seize ans. Trop tard pour un lien mère-fils. Mais on est devenu·es de super potes, avec quelques clashs.
Je me considère comme ayant été anarchiste, donc nous étions plutôt sur la même longueur d’onde. Mais vers mes quarante ans, j’en ai eu marre d’être marginal, de vivoter avec des petits boulots et de vouloir changer le monde sans succès. J’ai compris qu’il me fallait un job. La vie illégale, ce n’était pas fait pour moi. Alors, j’ai déménagé ici, dans une région très catholique et conservatrice. C’était le début des années 1990.
C’est un des rares moments de ma vie où j’ai essayé de cacher qui était ma mère. Je voulais devenir éducateur spécialisé ou travailleur social, mais ici, si les gens savaient qui elle était, jamais iels ne m’auraient confié leurs enfants. Au bout de quelques années, j’ai compris que j’avais eu tort.
Elle nous a aimé·es, mes frères, ma sœur et moi, d’un amour immense, sincère. Mais elle manquait de « compétences parentales », comme on dit dans mon métier. Elle ne savait pas trop comment être mère. Parfois, elle paniquait, se disait qu’elle était nulle, qu’elle n’y arrivait pas, qu’elle nous faisait du mal.
Il y a eu deux périodes dans sa vie de prostituée : une première où elle a vraiment détesté faire ça. Puis est venue la révolte des prostituées en 1975En juin 1975, des prostituées occupent l’église Saint-Nizier à Lyon pour dénoncer la répression policière et réclamer des droits. Cette révolte marque une étape majeure dans la lutte des TdS en France.. Là, elle a compris qu’elle pouvait en faire un combat et une fierté.
Elle a été une révélation. Elle m’a transmis des valeurs humaines incroyables comme l’authenticité et le fait que nos actions ne définissent pas notre valeur. En tant que travailleur·euse du sexe, on peut bien sûr être un être humain extraordinaire, avec plus de dignité que la plupart des gens qui rentrent dans le moule sans se poser de questions.
En 2010, je me suis mis à étudier la philosophie. J’anime aujourd’hui des cafés philosophiques dans mon village. Longtemps, Hannah Arendt a été ma philosophe préférée. Son amour de la vérité, sa volonté de dire les choses telles qu’elles sont, même au risque d’être rejetée, me fascinent. Pour moi, Grisélidis était une Hannah Arendt du travail du sexe.
IS. Oui, c’était de la télé pas terrible. C’était faire du fric avec la sentimentalité des gens pour « faire pleurer dans les chaumières ». Mais Aspasie et ProCoRe m’ont poussé à y aller pour les représenter. Ça a été compliqué pour moi. Mais j’ai dit que j’étais très fier de ma mère. J’ai rendu le témoignage le plus sincère possible, le plus authentique. C’était après son décès et après son transfert au cimetière des Rois à GenèveLe cimetière des Rois, ou cimetière de Plainpalais, est un cimetière de la ville de Genève où sont enterré·es, sur 28 000 m2, certains magistrats genevois ainsi que des personnalités ayant contribué à la renommée de la ville.. Parce qu’on a dû enterrer Grisélidis deux fois. Ça, c’est très grisélidien. C’est vraiment quelqu’une qui n’a pas vécu comme tout le monde.
Le jour du deuxième enterrement, devant une petite centaine de personnes, j’ai dit : « Qu’est-ce qu’on dit quand on enterre sa mère pour la deuxième fois ? » Je ne peux pas redire ce que j’ai dit la première fois. Je ne sais pas quoi dire. Tout ça est tellement jouissif une fois qu’on a pris de la distance avec les normes sociales. À partir de ce moment-là, quand je devais me présenter, ça m’est souvent arrivé de commencer par dire : « Je suis un fils de pute et fier de l’être. »
En tant que travailleur social, on m’a demandé de faire des ateliers de prévention dans les écoles et j’ai beaucoup utilisé cette expérience. Plus j’avais affaire à des classes d’élèves « difficiles », ou plutôt discriminé·es, mieux ça marchait, parce qu’on a une forme de ressemblance dans le fait d’être confronté·es à des injustices sociales auxquelles on ne peut rien. Et « fils de pute », c’est l’insulte la plus répandue chez les jeunes, ça les prend tout de suite à revers et iels ne comprennent plus rien.
Le stigmate de la prostitution, en dehors de quelques exceptions, il ne m’a jamais empêché de fonctionner. Je me suis parfois dit que ce serait mieux que les gens ne sachent pas que je suis le fils de cette putain qui est tout le temps à la radio, à la télé, dans le journal mais petit à petit, je me suis dit que c’était plutôt une fierté.
Dans une interview pour les Archives littéraires suissesQuarto : Grisélidis Réal. Revue des Archives littéraires suisses, n° 50, 2022, j’ai dit : « Le problème, ce n’est pas le métier que fait votre père ou votre mère, c’est le traitement que la société en fait. » On peut quand même se demander si ce n’est pas une chance. Ce sont mes traumatismes et la vie que j’ai eue qui m’ont aidé à le percevoir ainsi. Ce sont à la fois des malheurs et des chances.
CO. Ça me fait penser, justement, qu’au Centre Grisélidis Réal à Genève, Jehane [Zouyene] m’a montré un livre pour enfantsJuniper Fitzgerald et Elise Peterson, How mamas love their babies, Hardcover edition, 2018., qui n’est pas spécifiquement sur le travail du sexe, mais sur la manière dont les parents peuvent expliquer ce qu’iels font, sur ce qui pourrait les mettre en péril vis-à-vis du regard des autres et qui pourrait leur faire porter un stigmate. Ce livre explique comment on dit la vérité à des enfants, tout en utilisant des mots qu’iels comprennent et en les mettant en garde de ce qui les attend, puisqu’iels vont aussi porter ces choses-là. Et à un moment, ça parle du fait qu’il y a des mamans qui font le trottoir pour nourrir leurs enfants. Je me demandais comment ça a été pour toi d’apprendre ça.
IS. Pendant des vacances d’été, alors que j’étais encore au collège chez les curés à Saint-Maurice, en filière latin-grec, j’ai retrouvé ma mère après un certain temps. Elle m’a dit à quel point elle était heureuse qu’on se revoie, et je partageais ce sentiment. Pourtant, elle n’osait pas aborder le sujet de la prostitution. À un moment, elle m’a confié qu’elle écrivait un livre, Le Noir est une couleur. Curieux, je lui ai demandé si je pouvais le lire, mais elle a refusé. J’ai tout de suite senti qu’il y avait quelque chose de particulier, cette réticence m’intriguait.
J’en ai alors parlé à mes frères et ma sœur, qui savaient déjà la vérité parce qu’iels avaient passé plus de temps avec elle et l’avaient appris naturellement. Iels m’ont expliqué qu’elle avait peur que je la rejette en découvrant qu’elle s’était prostituée. En entendant ça, je me suis rendu compte que ça ne me posait aucun problème. Je suis donc retourné la voir pour lui dire que je savais, que mes frères et ma sœur m’avaient expliqué, et qu’elle n’avait aucune inquiétude à avoir.
Aurélien vit près de Genève, en France, car son père était français. Grisélidis – qui avait déjà connu le placement de ses enfants sous tutelle – a voulu éviter de revivre cette situation avec son dernier fils. Comme il avait la double nationalité suisse-française, elle a décidé de le confier à une famille à Annemasse, de l’autre côté de la frontière. L’idée était qu’il reste à l’abri des autorités suisses, ce qui lui permettait de le voir librement et de préserver leur relation sans crainte d’intervention officielle.
Cette solution a plutôt bien fonctionné, jusqu’au jour où le père d’Aurélien a voulu le récupérer. Aurélien était encore très jeune, peut-être même pas huit ans, mais il pourrait en parler plus précisément. À partir de là, les choses se sont compliquées, car son père n’aurait probablement pas dû le sortir de cet environnement stable et protecteur où il grandissait bien. Cela a marqué le début d’une période difficile pour lui.
CO. C’est un peu le syndrome du sauveur qu’on retrouve dans ce que tu racontes du père d’Aurélien. C’est une figure dont on a beaucoup discuté avec Imara chez les clients, justement.
IS. C’est typique des gens qui fonctionnent sur des stéréotypes. Le père d’Aurélien a cru bien faire en le reprenant, persuadé que sa nouvelle vie lui offrirait le meilleur. Mais ça ne l’a pas aidé, au contraire. Être enfant d’un·e travailleur·euse du sexe ne pose pas plus de problèmes qu’être enfant de policier·e ou de caissier·e. Tout dépend du parent et de la perception de son métier par la société.
Il y a ce livre de Gail Pheterson, Le prisme de la prostitutionGail Pheterson, Le prisme de la prostitution, L’Harmattan, 2003., essentiel, mais introuvable. Pheterson était une psychosociologue engagée, avec une analyse marxiste pertinente sur le stigmate de la putain. Ça devrait être une lecture obligatoire.
Quand Grisélidis est morte, on a mis un an à trier ses affaires. J’ai refusé qu’on jette tout. Les archives personnelles sont à la Bibliothèque Nationale de Berne, les archives militantes sont chez Aspasie, au centre de documentation dont Grisélidis rêvaitIgor fait référence au Centre Grisélidis Réal..
IS. Grisélidis, c’est quelqu’une avec qui il n’y a pas de demi-mesure. Elle était tellement engagée que ça ne laissait aucune place aux compromis. Je n’ai jamais été en opposition avec ce qu’elle faisait, et à partir du moment où elle a décidé d’être une figure publique pour porter ses valeurs, j’ai trouvé ça juste. Son combat était légitime, il n’y avait rien à critiquer. Mais le stigmate de la prostitution retombait sur les proches, et ce n’était pas toujours facile à assumer. Pendant un temps, dans les années 90, j’ai cherché à m’en éloigner, à me construire autrement. Puis, en obtenant mon diplôme d’éducateur, mon regard sur elle a changé. À partir de là, j’étais fier de porter son combat, à ma manière.
CO. Oui, en tant qu’enfant, ça doit être particulier d’avoir un parent aussi présent, qui occupe tout l’espace, y compris public.
IS. J’ai fait une thérapie, à un moment où je ne composais plus de musique. Ma psy m’a dit : « Quand est-ce que tu vas arrêter de te cacher derrière ta mère ? » Et ça m’a frappé. Avec un parent aussi imposant, on peut s’interdire de réussir, ou se dire qu’on n’y arrivera jamais. Mon grand-père, artiste-peintre, m’avait transmis la valeur de l’art, mais comme quelque chose dont on ne vit pas, pour rester libre. J’ai suivi cette voie : un job stable et la musique à côté.
CO. Mais tu as quand même participé à ce projet autour des poèmes de GrisélidisChair Vive, lecture-musicale, avec les poèmes de Grisélidis Réal, d’après le recueil éponyme des poésies complètes paru chez Seghers, 2022. Avec Aline Chappuis, Margarita Sanchez (voix) et Igor Schimek (guitare et voix), Rinaldo Del Boca (lumières). ?
IS. Oui, une exception ! Grisélidis inspire des gens partout. Un jour, Nancy Huston me contacte car elle veut publier ses poèmes. Je lui envoie ce que j’ai, sans trop m’impliquer, par habitude. Mais Madame Huston fait en sorte que les poésies complètes soient publiées, tout ça prend de l’ampleur, et à Sion, une librairie organise une lecture. Ma compagne, chanteuse, veut participer et me demande de l’accompagner à la guitare. Je dis oui, pour Grisélidis. On joue devant quinze personnes. On le refait ailleurs, dans des festivals. À chaque fois, des gens sont bouleversé·es, en larmes à la fin du spectacle. Alors, on continue. Grisélidis m’entraîne toujours dans des aventures improbables !
IS. Après son décès, on a trié une montagne de papiers. Quatre-vingt, nonante cartons envoyés à la Bibliothèque nationale et à Aspasie. Le reste était des photocopies inutiles qu’on a dû jeter. Grisélidis voulait faire évoluer la conscience collective, donc elle multipliait les copies, pour diffuser ses idées.
Puis est venue la question des archives : convoitées par Genève et Berne en même temps, nous avons mis les deux en concurrence. Finalement, Berne s’est montrée plus engagée, alors on leur a tout confié. Quelques années plus tard, j’apprends que c’est le fonds le plus consulté des Archives littéraires suisses. Pas seulement par les littéraires, mais aussi par des sociologues, anthropologues, même des juristes. Grisélidis continue de faire bouger les lignes.
CO. On a entendu parler du séminaire de droit de l’Université de Genève. Iels ont travaillé avec ProCoRe et Aspasie ces deux dernières années. C’est la Law Clinic, une clinique du droit qui s’intéresse aux impasses juridiques et aux jurisprudences. Iels ont fait un gros travail sur les droits des travailleur·euses du sexe, en explorant les archives de Grisélidis et en impliquant directement des travailleur·euses du sexe.
IS. Il y a beaucoup d’informations dans ces archives. Elles commencent à dater, mais restent utiles. Pour nous, leur gestion a été claire dès le départ. J’ai dit à mes frères et ma sœur que l’on pourrait en tirer de l’argent, mais qu’il vaut mieux servir la mémoire et la cause. Iels étaient d’accord. Par exemple, les peintures de Grisélidis, qui avaient pris de la valeur, on aurait pu les vendre. On a préféré les donner à la Bibliothèque nationale de Berne pour une somme modique. C’est une question de principes.
Je gère tout en accord avec elleux, mais la majeure partie du temps, iels me laissent libre de décider. Si c’est un projet militant, on donne accès aux archives gratuitement. Si c’est un projet avec de l’argent en jeu, on demande un droit d’entrée de cinq-cent euros, déductible des bénéfices. Si les bénéfices sont élevés, on prend un petit pourcentage en droits d’auteur·ice.
IS. Oui, quelques fois en vingt ans. Par exemple, un cinéaste a voulu faire un docu-fiction, mais il nous a semblé malhonnête. On a bloqué ses droits via Gallimard. Une autre fois, on nous a proposé une série TV produite par Jamel Debbouze, avec un gros budget. Après enquête, on a estimé que cela nous ferait perdre le contrôle. On a posé des conditions strictes, iels ont renoncé.
IS. Via Grisélidis, j’ai surtout hérité d’un engagement humaniste, d’une volonté de justice sociale. C’est aussi pour ça que je suis devenu travailleur social. Quand Grisélidis se fixait un objectif, elle ne lâchait pas. Un vrai pitbull. Je voulais être comme ça aussi. Je me suis battu dans ce canton, avec les institutions, la police, pour que les plus précaires soient mieux traité·es.
C’est un héritage symbolique et existentiel. Un autre, plus compliqué, concerne mon rapport à la sexualité. À quinze ou seize ans, Grisélidis nous disait : « Il faut baiser. Sinon, on est des morts-vivants. » J’ai mis longtemps à comprendre que j’avais un rapport déformé à ça. En partie à cause d’abus, et aussi parce qu’elle en remettait une couche. J’ai longtemps instrumentalisé l’autre sans m’en rendre compte. La sexualité heureuse, c’est le respect mutuel et non l’utilisation de l’autre.
Aujourd’hui, à soixante-douze ans, je suis célibataire depuis quatre ans et, pour la première fois, véritablement heureux. J’ai longtemps cru avoir besoin d’une compagne, mais il s’agissait en réalité d’une dépendance affective. J’attendais de l’autre qu’elle comble mes manques, ce qui, de manière inconsciente, a souvent nui à mes relations. J’ai connu de nombreux échecs, mais comme le disait Grisélidis : « J’ai réussi dans l’échec. » Au moins, j’ai cherché. Désormais, si une relation doit naître, ce sera sans co-dépendance, avec la conscience que l’autre n’est pas là pour combler mes vides.
CO. Si ça peut te rassurer, je crois qu’on est toute·s marqué·es par nos parents. Ce n’est pas seulement à cause de Grisélidis ou de son métier.
IS. Dans Liens maternels dans la prostitutionIzzy Feferman, Liens maternels dans la prostitution, Université de Genève, 1991., le premier documentaire consacré à Grisélidis, elle évoque pour la première fois que sa mère les a abusées sexuellement, elle et ses soeurs. Elle décrit que sa mère faisait aligner les trois petites filles, nues, et qu’elle inspectait leurs vagins pour voir si c’était sale, pour voir si c’était rouge, si elles s’étaient touchées. Cette obsession traduisait une peur qui s’exprimait par une surveillance rigide, dont Grisélidis, en tant qu’aînée, a particulièrement souffert.
D’ailleurs, elle avait un musée des grosses bites. Quand elle voyait un membre masculin qui dépassait la norme, elle proposait au mec de faire un dessin. Elle lui faisait mettre sa bite sur la table et puis elle la traçait au crayon. C’est une idée assez géniale. On en a retrouvé une petite pile comme ça. Quand j’ai donné ça à Berne, aux Archives littéraires suisses, j’ai dit : « Il y a des trucs comme ça dans les archives de Grisélidis. »
IS. Forcément, je vais parler de ma manière de dépasser certains schémas et de transformer mes fragilités en force. Un jour, je me suis dit qu’il fallait que je trouve quelque chose pour occuper mon esprit après ma retraite. Je m’étais tellement investi dans mon travail social et la musique que j’avais peur du vide. J’ai vu trop de gens tomber en dépression après avoir arrêté de travailler.
Il y avait chez elle une transmission forte du goût pour la réflexion, pour la pensée critique. Ça, je crois que j’en ai hérité aussi. En approfondissant mes lectures, je suis passé de la philosophie classique à la métaphysique, puis au Taoïsme, puis aux traditions spirituelles orientales : hindouisme, bouddhisme, soufisme… Et en creusant, j’ai vu que Grisélidis s’y intéressait aussi, à sa manière.
IS. Et JehaneJehane Zouyene a réalisé et publié un catalogue des œuvres de Grisélidis Réal, intitulé Grisélidis Réal, peintre, Editions Humus, 2016., qui a beaucoup travaillé sur ses peintures, m’a fait remarquer à quel point Grisélidis représentait des figures symboliques (anges, démons, madones) alors qu’elle se disait profondément anticléricale. Elle avait un rapport compliqué avec la religion, et moi aussi, j’ai pris ça comme héritage. Elle avait bien compris que les violences qu’elle avait subies de la part de sa mère étaient étroitement liées à une morale rigide, détournée, intransigeante, qui servait un système oppressif.
IS. Ma dernière épouse et moi, on est resté·es ensemble vingt ans. Elle voyait bien l’impact que le combat de Grisélidis avait sur moi. Elle me disait que ça me faisait du mal. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C’est peut-être une forme de sacrifice. Un exemple de désaccord que l’on a pu avoir avec Grisélidis, c’est quand l’ONU a sorti une résolution affirmant que la prostitution « est contraire à la dignité humaine ». Elle était furieuse. C’est ce qui l’a poussée à réagir très vivement, notamment dans un débat télévisé où elle a balancé les visites de bordels par l’abbé Pierre en 1990Ciel mon mardi, émission du 15 mai 1990, consultable sur le site de l’INA.. Ce débat circule pas mal en ce moment sur les réseaux.
On s’accordait sur le fait que cette vision était biaisée. Mais moi, en tant que travailleur social, j’avais du mal à concevoir qu’une personne puisse exercer ce métier sans que cela n’affecte, d’une manière ou d’une autre, son estime de soi. Et ça, ça nous faisait débattre sans fin. Elle me disait que je ne pouvais pas comprendre. Et je lui répondais que je ne pouvais pas l’imaginer autrement. Finalement, on a décidé d’arrêter d’en parler. Parce qu’à force, ça finissait par plomber nos discussions.
IS. Après la mort de Grisélidis, je me suis dit : « Elle a tellement gueulé contre les gens qui parlent de ça sans savoir, je pourrais au moins essayer une fois pour comprendre. » J’ai mis des années avant d’oser. Finalement, en Crète, dans un bordel clandestin à Chaniá, une dame m’a expliqué que les tarifs étaient de deux euros la minute, principalement pour des soldats de la base américaine voisine. J’ai payé cinquante euros pour vingt-cinq minutes. J’ai demandé une travailleuse expérimentée. Une Russe d’une trentaine d’années, très gentille, est venue. Mais en pleine séance, je me suis retrouvé projeté dans des souvenirs d’abus vécus enfant. Ce sentiment d’être plongé dans une situation où quelqu’un·e touche ton corps sans que tu comprennes. Impossible de bander. Elle a été patiente, mais au bout de vingt-cinq minutes c’était la fin du temps. Elle m’a fait la bise avant de partir. Ça a été une expérience nécessaire, mais compliquée.
IS. Il y a un documentaire sur Sonia de BruxellesNathalie Delaunoy, Sonia, 2005 où un de ses clients témoigne à visage découvert. Il explique à quel point c’est une expérience forte pour lui, et Sonia ajoute : « Je me sens plus respectée par mes clients que par les hommes que j’ai eus dans ma vie. »
Et puis, tout dépend de l’intention avec laquelle on vit cette expérience. Certains clients viennent une seule fois, d’autres reviennent pour des raisons différentes, selon les périodes de leur vie. Certains sont tétanisés à l’idée de franchir la porte d’un salon, ils ne savent pas comment se comporter.
Pouvoir des villes : pour une lutte locale —
À Montréal (Tiohtià : keLe Canada n’existe qu’en raison du génocide des peuples autochtones. Les nations autochtones ont été et sont encore les protectrices et les gardiennes des terres et des eaux. Le CATS vit et s’organise donc sur des terres volées ; entre autres, le territoire ancestral des Kanien’kehà:ka, à Tiohtià:ke. en Kanien’kehá, une langue autochtone), les vestiges du Red Light sont rares. Avec la gentrification et le nettoyage social du centre-ville, plusieurs lieux de travail de l’industrie du sexe ont été brûlés, bulldozés et remplacés par des tours à condosGrande tour résidentielle., des salles de spectacle et des galeries d’art. C’est notamment le cas du Studio XXX, un cabaret qui proposait différents services comme un peep-show, où l’on pouvait visionner des films érotiques et recevoir des danses contact en cabines privées, situé au coin des artères Saint-Laurent et Sainte-Catherine jusqu’en 2008. Il a été remplacé en 2012 par le 2-22, un complexe culturel et artistique. En 2021, AM Trépanier, artiste- chercheur·euse, débute ses recherches au centre VOX, une galerie d’art faisant partie du 2-22, pour comprendre les tenants et aboutissants de la transformation majeure de cette intersectionPour en connaître plus sur ses recherches : Maxime Durocher et Adore Goldman, « Du Red Light au Quartier des spectacles : Industries culturelles et créatives, travail du sexe et gentrification », dans CATS attaque !, 3e édition, 2023. En collaboration avec le Comité autonome du travail du sexe (CATS), iel a mis sur pied le projet Dans le souffle de c., une exposition-installation qui témoigne de ses recherches. En 2023, le projet voyage à Nyon, en Suisse, dans le cadre de l’exposition 200 Roses organisée par le Collectif Occasionnel.
Si certains lieux ont survécu aux contrecoups de la « revitalisation » de la métropole, comme le très populaire strip club Café Cléopâtre qui s’est opposé à son expropriation devant les tribunauxPour en savoir plus sur la lutte du Café Cléopâtre : « Café Cléopâtre », Wikipédia. (s.d)., nos milieux de travail tendent à disparaître.
Au Canada (A’nó :wara Tsi Kawè :note en Kanien’kehá, signifiant l’île de la tortue), la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation du Code criminel, est appliquée par les forces de l’ordre, les juges et les tribunaux des différentes provinces. Comme en France, elle pénalise les clients et les personnes facilitant la vente de services sexuels. Ce modèle légal est revendiqué par les féministes anti-prostitution et souhaite l’élimination complète de l’activité : les travailleur·euses du sexe sont des victimes qu’il faut sauver.
Bien que la criminalisation du travail du sexe soit de ressort fédéral, plusieurs municipalités et arrondissements tentent d’en contrôler et limiter certains aspects. Dans ce texte, nous souhaitons exposer les pouvoirs qu’ont les villes et leurs effets néfastes sur les conditions de travail des TdS. Nous voulons également proposer quelques pistes d’organisation locale des TdS : une lutte au sein de nos milieux de travail et de nos quartiers nous permettrait une résistance plus directe, décentralisée et spontanée.
Zonage urbain : nos espaces de travail constamment menacés !
Les municipalités font de plus en plus usage des règlements de zonage et d’urbanisme pour cibler et fermer nos milieux de travail. Cette stratégie s’inscrit dans un processus plus large de gentrification. Les municipalités visent à « nettoyer » les villes de la prostitution visible qui dérange. Si ces politiques se font au nom de la sécurité publique, elles ont pour conséquence de précariser les conditions de travail des TdS.
Lors du Rendez-Vous 2007 Montréal Métropole Culturelle, la Ville de Montréal et l’arrondissement Ville-Marie présentaient le Programme particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles, soit les grandes lignes des plans d’aménagement urbain de la Place des Arts. Les changements urbains initiés par ce programme ont comme motivation première le nettoyage social du Quartier des spectacles, historiquement le Red Light District, le berceau du divertissement et du travail du sexe montréalais. Le but étant soi-disant d’embellir un quartier « mort ». Ces tentatives de remplacement remontent aux années 1950, lorsque le maire Jean Drapeau a enclenché diverses campagnes politiques et travaux de rénovations urbaines pour revamperSignifie ici « améliorer » en québécois. le quartierJonathan Cha et Eleonora Diamanti, « En marge du Quartier des spectacles : tensivité et trajectoires opposées du Spectrum et du Café Cléopâtre », dans Harel, Thibert et Lussier, Le Quartier des spectacles et le chantier de l’imaginaire montréalais, Presses de l’Université de Laval, 2015, p.31-34.. L’hypocrisie moraliste de ces discours politiques est flagrante : elle prétend faire de Montréal une ville plus culturelle et vivante alors que le quartier était déjà un pôle culturel, mais clairement, trop dérangeant aux yeux de la municipalité. Confronté·es à la destruction littérale de leur milieu de travail et à une surveillance accrue de la rue, les TdS ont été forcé·es de se relocaliser dans des quartiers où leur présence se ferait moins remarquer par les autorités, mais où la recherche de clients serait plus difficile.
Parmi les tactiques adoptées par les arrondissements et les municipalités, le resserrement de l’octroi des permis d’exploitation a prouvé son efficacité à faire fermer les salons de massageÀ Montréal, les salons de massage ont pignon sur rue, parfois avec des enseignes claires à caractère érotique et d’autres fois, elles se font plus discrètes. Bien que la plupart offrent des services complets (plus qu’une masturbation), la présence des salons est tolérée sur le territoire. et des strip clubs. À Montréal, cette stratégie faisait partie des promesses électorales de l’administration Coderre, dès son arrivée au pouvoir en 2013Isabelle Hachey, « Le maire Coderre veut éradiquer les salons de massage de Montréal », dans La Presse, 2013.. Si cette politique n’a pas abouti, plusieurs arrondissements à Montréal ont, depuis, adopté des règlements pour se débarrasser des salons de massage dans leurs quartiers. Depuis 2017, l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie n’accorde plus de permis d’occupation commerciale aux entreprises soupçonnées de vouloir ouvrir des salons de massage érotique. Suite à cette décision, huit salons de massage ont vu leur permis d’exploitation être révoqué, les forçant à mettre la clé sous la porteMarie Christine Trottier, « Huit permis de salons de massage révoqués dans Rosemont », dans 24 heures, 2017.. Ce resserrement des permis avait été proposé par le maire de Projet Montréal, le parti municipal le plus à gauche du paysage montréalais. Comme quoi, éradiquer nos milieux de travail est un projet qui rallie tout le spectre politique. En septembre 2023, l’arrondissement annonçait vouloir intenter des procédures judiciaires jusqu’à la Cour supérieure afin de faire fermer le dernier salon de massage érotique sur son territoire, Spa Bamboo. Ce salon avait contesté la décision en 2017 et poursuivi ses activitésEmmanuel Delacour, « Un salon de massage dans Rosemont exaspère l’arrondissement », dans Est Média Montréal, 2023.. À Laval, en banlieue montréalaise, depuis 2018, les salons de massage et les bars de danseuses sont interdits sur l’ensemble du territoire, sauf à l’intérieur de la zone industrielle, et ce, pour un maximum de 5 établissements, qui se sont vus interdire l’affichage d’enseignes et de publicités« Laval : les établissements à caractère érotique limités à une zone industrielle », dans Radio-Canada, 2018.. Ce genre de réglementation municipale explique la disparition des clubs à l’échelle du Québec : si on comptait près de 220 établissements il y a quinze ans, aujourd’hui on n’en compte plus qu’une soixantaine sur le territoireJean-Philippe Guilbault, « La dernière danse », dans Radio-Canada 2023..
À Toronto (Tkarón :to en Kanien’kehá), depuis les années 1970, la Division des Licences et des Normes Municipales permet 63 licences de divertissement pour adultes sur son territoire. Les règlements de zonage et le processus pour une demande d’exemption, qui coûte entre 100 000 $ et 250 000 $, rendent presque impossible l’ouverture ou la relocalisation de ces clubsMolly Hayes, « The last dance : Why the Canadian strip club is a dying institution », dans The Globe and Mail ; 2018..
Les villes font donc usage de leur autorité en termes de zonage et de réaménagement urbain pour fermer progressivement nos milieux de travail et nous déplacer des grands centres vers des quartiers industriels, moins bien éclairés et plus isolés. La diminution de nos milieux de travail et leur dérégularisation augmentent également la compétition entre les travailleur·euses et le pouvoir des patrons. Comme l’explique une militante au CATS et danseuse : « Les danses à mon club sont encore à 10 $ parce que comme il y a peu de strip clubs et que les patrons disent oui à tout le monde pour rentrer tout le temps, ça fait qu’il y a full de filles sur le plancher et de la compétition. » La fermeture des salons de massage et des strip clubs ne mettra pas fin à la nécessité pour plusieurs de travailler. Forcé·es de quitter nos milieux de travail, plusieurs se tourneront vers le travail à la maison ou le outcallOutcall signifie que la·e TdS se déplace au client pour le rendez-vous, soit chez lui ou dans un lieu de son choix comme à l’hôtel., nous isolant davantage et nous mettant plus à risque d’être agressé·es.
Avec la gentrification qui fait disparaître nos milieux de travail et, du même coup, hyper-sature les strip clubs et les salons de massage encore debouts ; avec le roulement constant des TdS à force de renvois abusifs et de démissions, il est difficile de s’organiser entre collègues. En 2024, dans le cadre d’une enquête militante locale en salon de massagePour en connaître plus, voir : Adore Goldman, Astrea Léonis, Susie Shower et Melina May, « Enquête militante en salon de massage : collectiviser nos résistances », dans CATS attaque !, 5e édition, 2025., le Comité autonome du travail du sexe et les participant·es ont réfléchi aux moyens de lutter contre ces dynamiques. L’une des propositions qui a émergé est le salaire horaire. Pour contrer la compétitivité, nous pensons que le salaire serait un levier intéressant pour créer de la solidarité entre les travailleur·euses. En effet, iels seraient rémunéré·es également pour leur temps au travail, puis, en extra, pour leur service aux clients, comme il se fait dans le milieu de la restauration en Amérique du Nord par exemple. Cela nous permettrait aussi de sortir du statut flou, entre travailleur·euses indépendant·es et employé·es, dont les patrons font souvent usage pour nous laisser croire que nous sommes libres ; tout en nous surveillant et en imposant des restrictions sur notre horaire et notre apparence physique.
Les licences pour travailler : contrôle et menace à la sécurité
Dans certaines villes et provinces au Canada, comme en Ontario et à Edmonton (Amiskwaciy-Wâskahikan en criLangue autochtone parlée du golfe de Saint-Laurent aux montagnes Rocheuses.), les travailleur·euses dans les milieux légaux doivent obtenir une licence pour prouver leur âge et travailler en salon de massage ou dans les strip clubs. Si les licences servent entre autres à interdire l’accès aux mineur·es à ces milieux, elles sont également un moyen pour contrôler, fragiliser et surveiller les TdS.
En mai 2022, dans un effort pour enrayer l’industrie du sexe, la ville de Newmarket en Ontario adoptait une nouvelle classification des licences pour les travailleur·euses en salon de massage. En vertu du nouveau règlement, les propriétaires sont tenus de prouver que les employé·es offrant des services de massage ont reçu une formation d’une institution accréditée. Le maire de la ville expliquait cette décision : « Je pense que nous voulons tout simplement chasser [l’industrie du sexe] hors de notre ville, très franchement […] je ne pense pas que ce soit cohérent avec les valeurs de notre ville »Traduction libre de « I think we really just want to drive [the sex trade] out of our town, quite frankly, […] I don’t think it’s consistent with the values of our town. » dans Jessica Owen, « Sex work in massage parlours rubs Newmarket councillors wrong way », dans Newmarket Today, 2021.. Une pétition lancée par Butterfly, un organisme qui défend les droits des TdS migrant·es et asiatiques à Toronto, dénonce le règlement qui « perpétu[e] le racisme systémique et les difficultés indues en empêchant les femmes asiatiques non-anglophones et à faible revenu de travailler dans les [établissements de bien-être personnel] »Traduction libre de « perpetuat[e] systemic racism and undue hardship by preventing non-English speaking, low-income, Asian women from working in [Personal Wellness Establishments]. » dans Butterfly, « Town of Newmarket : End racism against Asian massage businesses and workers », 2022.. Suite à cette décision, plusieurs entreprises ont été forcées de fermer du jour au lendemain, laissant plusieurs femmes et familles sans moyen de subsistance.
En Ontario, les danseuses sont également tenues d’obtenir une licence pour travailler légalement. Les TdS avec des casiers judiciaires et les travailleur·euses im / migrant·es sans résidence permanente sont dans l’impossibilité d’accéder à ces licences ; iels sont alors poussé·es dans des situations de travail d’autant plus précaires et criminaliséesLo Stevenson, « Imagining Decriminalization of Sex Work in Canada », dans Appeal. Review of Current Law and Law Reform, vol. 28 (53), 2023.. À Edmonton, les travailleur·euses en salon de massage et en agence sont également dans l’obligation d’obtenir une licence pour travaillerMona Forya, « Letter to the City of Edmonton March 21 », 2023.. Même si cette licence ne contient aucune information personnelle sur papier, ces données sont accessibles aux patrons, menaçant l’intégrité et la sécurité des TdS. Dans une lettre ouverte à la ville, ANSWERS, un organisme qui défend les droits des TdS à Edmonton, dénonçait les effets délétères d’une telle régulation : plusieurs cas ont démontré l’usage des renseignements personnels des TdS par les employeur·ses et / ou les collègues de travail pour ensuite les divulguer à leur famille, leur employeur·se civil·e et leur propriétaireIbid.. Non seulement l’obligation de partager ses informations personnelles à son employeur·se est dangereuse, mais également inutile puisque les TdS reçoivent leurs paies directement de la part de leurs clients.
La stigmatisation vécue par les TdS est aussi ancrée dans l’instauration des licences de travail ; iels sont considéré·es comme un danger pour la santé publique. Les licences sont une manière pour les agent·es municipaux·lles et la police de mieux contrôler les TdS sans concrètement offrir des services de réduction des risques ou des conditions de travail sécuritaires. Ces contextes de légalisation s’inscrivent encore dans une vision anti-TdS où les travailleur·euses sont perçu·es comme nécessitant une surveillance autoritaire accrue en tant que menaces à la santé publique. Dans la majorité des cadres légaux, les TdS travaillant à l’intérieur se plieront aux conditions mises en place par le patron. Cela amoindrit la possibilité de syndicalisation puisque l’autonomie des travailleur·euses est grandement restreinte et la considération quant aux conditions de travail est davantage mise de côtéLo Stevenson, op.cit.. Les besoins concrets des TdS face à leur sécurité générale, la réduction de risques et l’amélioration de leurs conditions de travail sont ignorées.
Pour des milieux de travail sans police, une résistance locale !
Face à la menace constante des villes, nous devons réfléchir aux stratégies à mettre en place pour prendre le contrôle sur nos milieux de travail. Les auteur·ices d’une étude large portant sur les conditions de travail des danseuses au Royaume-Uni concluent leur article en exposant le potentiel que pourrait avoir l’octroi des permis d’entreprises pour spécifier les standards dans les milieux de travail de l’industrie du sexe. Selon Lo Stevenson, « si ces normes étaient négociées avec les TdS organisé·es, reflétant de manière adéquate leurs besoins et leurs préoccupations, un tel régime pourrait non seulement accroître l’autonomie et la solidarité des travailleur·euses du sexe, mais aussi réduire le recours à des litiges coûteux et longs »Ibid..
Faire pression sur les autorités locales pourrait être un moyen d’action intéressant ; par exemple, auprès des conseils municipaux ou des régisseur·euses des licences, pour demander de délivrer des permis d’exploitation à l’image de nos demandes, ou encore pour bloquer les tentatives des villes de fermer nos milieux de travail.
À Montréal, la collaboration entre la police et l’Agence des services frontaliers du Canada rend quasi impossible le recours à la protection institutionnelle pour les TdS migrant·es victimes d’actes criminels et d’abus. Plus encore, le profilage est une tactique notoire utilisée lors des inspections de salons de massage, particulièrement pour piéger les femmes asiatiques et les déporter. En solidarité avec nos collègues migrant·es, constamment ciblé·es par la police,
Même dans un contexte idéal de décriminalisation, les politiques municipales deviendront extrêmement importantes à surveiller, car elles constitueront l’un des principaux cadres réglementaires régissant la vie des TdS. Un bon exemple de l’étendue de ce pouvoir est celui de la Belgique qui, en 2022, est devenu le premier pays européen à décriminaliser le travail du sexe. Mais, au plan local, les communes tentent toujours d’enrayer le travail du sexe de l’espace urbain, en évitant de délivrer des permis aux établissements où il se pratique et en imposant l’obtention de licences aux TdS. Évidemment, les TdS sans papiers sont également exclu·es de la loi, puisqu’iels ne peuvent travailler légalement sur le territoire. Même si nous obtenons des droits, nous devrons toujours les défendre.
C’est pourquoi, face aux forces en place, notre meilleure arme est l’auto-organisation de nos milieux de travail. Nous pensons que c’est en se rencontrant et en discutant de nos conditions de travail ainsi que de nos revendications collectives que nous gagnerons en puissance dans nos rapports avec les patrons et les villes.
J’ai du mal à savoir si le sexe est un événement ou non —
Nous avons interviewé Perle sur son expérience dans la programmation télévisuelle pornographique et institutionnelle, qui nous parle de sa position de femme noire et ancienne TdS.
Collectif Occasionnel. Est-ce que tu peux résumer le job que tu fais à Dorcel ? Comment en es-tu arrivée là ? Et à quoi ressemble une journée typique ?
Perle. Cette année, j’ai commencé une école de production audiovisuelle en alternance. Pour financer mes études, il me fallait absolument une alternance, et j’ai fini par en trouver une chez Marc Dorcel. Ça s’est fait un peu par hasard : je cherchais dans l’audiovisuel, un secteur déjà très bouché, et je suis tombée sur une annonce sur LinkedIn. Je ne savais pas vraiment ce qu’était Marc Dorcel, peut-être que le logo me disait vaguement quelque chose. J’ai postulé sans trop réfléchir. Après coup, j’ai cherché sur Internet et compris que c’était une entreprise liée à l’industrie du porno : chaînes télé, sites de streaming, magasins de jouets pour adultes.
Aujourd’hui, je travaille comme assistante programmation sur le pôle télé. Dorcel gère plusieurs chaînes, comme Playboy TV Europe, Vixen, et bientôt Sky Italia. Mon rôle principal est de créer les grilles de programmation mensuelles. En fonction du catalogue et des nouveautés, je décide, avec ma responsable, quels programmes passent et à quels créneaux.
Je m’occupe aussi de la newsletter, qui annonce les nouveautés des chaînes, et je vais bientôt travailler sur la refonte du site de Playboy TV Europe pour en faire une vitrine destinée aux investisseur·euses. Enfin, je gère les fichiers vidéo : je les classe dans les bons dossiers pour que la régie de diffusion, les monteur·euses et les équipes puissent les utiliser facilement. Tout doit être organisé pour que la grille soit prête et que les diffusions se passent sans problème.
Depuis toute petite, je savais que le sexe existait, bien avant de croire à des choses fantasmées comme le Père Noël (d’ailleurs, je n’y ai jamais cru). J’ai découvert le porno très jeune. Une anecdote : ma mère voulait installer un bloqueur de contenu adulte sur Internet, mais elle n’y arrivait pas. Je lui ai montré comment faire, et elle m’a répondu : « Oui, mais si moi, j’ai envie de regarder mes trucs de cul, je les regarde. »
Le sexe a toujours été présent dans ma perception du monde, mais je n’ai jamais vu le porno comme représentatif de la réalité sexuelle. Ce qui complique encore les choses, c’est que j’ai mis du temps à comprendre que j’étais asexuelle. Ça m’a fait questionner ma relation au sexe : pourquoi je la vivais de manière si différente de mes camarades ? Pourquoi le sexe était déjà, pour moi, un non-évènement alors qu’il semblait si central pour les autres ?
P. Ma perspective sur la sexualité et la pornographie est forcément marquée par le fait que je suis une femme noire, dark skin. Mes ami·es blanc·hes n’ont pas de catégorie à leur nom dans le porno, contrairement à moi, ce qui impose une exotisation qui me précède et teinte inévitablement ma façon d’aborder ces sujets.
Au début, j’étais hyper réservée par rapport au sexe, mais j’ai vite compris que si j’adoptais une certaine attitude, je pouvais plaire, attirer l’attention, recevoir de l’affection. À Paris, il y avait une valorisation de celleux qui parlaient librement de sexe, et j’ai voulu m’inscrire dans cette dynamique, quitte à en faire trop. Pendant un temps, c’était presque un rôle à jouer.
Puis, vers mes vingt-trois, vingt-quatre ans, j’ai pris du recul. J’ai remarqué que je plaisais moins, et ça m’a dérangée, sans vraiment savoir pourquoi. J’ai fini par comprendre que je cherchais à entrer dans des cases qui ne me correspondaient pas. Aujourd’hui, je vois les choses différemment. Mon rapport au sexe est beaucoup plus apaisé et personnel. Voir des corps nus ou des scènes sexuelles n’a jamais été un problème pour moi, mais trouver ma place dans tout ça est une question qui reste ouverte.
CO. Comment ton regard a évolué sur ce milieu-là ? Il y a plein de milieux dans la pornographie, mais celui que tu côtoies, comment est-il devenu pour toi ?
P. Il y a trois ans, je ne pense pas que j’aurais pu bosser dans les conditions dans lesquelles je bosse chez Dorcel. Là-bas, le sexe, c’est vraiment notre travail, on est constamment plongé·e dans des images de cul. Pour ma part, je regarde peu de porno, mais ce que je vois, c’est souvent des choses très niche, plus statiques, plus précises. Je trouve ça fun, mais aussi un peu effrayant, vu la place que cette gymnastique occupe dans notre environnement. Ce n’est pas tant pour la dynamique ou le fantasme, mais plutôt pour observer les corps, voir comment ils réagissent. C’est fascinant d’un point de vue presque clinique, mais ça fait réfléchir sur la manière dont la pornographie façonne notre vision du sexe.
CO. Tu sembles avoir un rapport à la pornographie qui n’est pas dans la consommation au premier degré, mais plutôt avec un recul professionnel et une observation plus distanciée. C’est ça ?
P. On peut peut-être inverser la question. Je ne dirais pas que j’ai un recul « professionnel », mais plutôt un recul personnel. Le sexe n’est pas central pour moi, en tout cas pas comme pour certain·es. Je suis asexuelle ou sur le spectre, et je pense que ça me permet de prendre du recul plus facilement. Ce qui me questionne, c’est plutôt comment mes collègues perçoivent tout ça.
P. En ce qui concerne l’entreprise, je me sens plutôt tranquille. Côté harcèlement, c’est moins pesant qu’ailleurs. Mais c’est vrai qu’on peut parfois entendre des jugements sur les actrices : qu’elles ont refait leurs seins, ou bien qu’une actrice est « moche ». Ça me choque, mais j’arrive à passer outre. Ce qui est aussi fascinant, c’est d’être en backstage et de pouvoir parler avec les actrices, surtout quand elles sont en pleine session de tournage. C’est comme être face à des stars. Elles sont des actrices, au même titre que celles du cinéma. Leur travail est vraiment extrême et intense, mais peu le reconnaissent. D’ailleurs, beaucoup d’actrices finissent par se tourner vers la réalisation. Elles utilisent leur expérience pour créer leurs films et embaucher leurs propres modèles. C’est intéressant à observer. Et même si je ne regarde pas, je suis assez en phase avec l’idée que c’est grâce à des plateformes comme Dorcel ou Playboy que ces actrices sont rémunérées.
Mais dans ce système capitaliste, à qui profite vraiment tout cet argent ? C’est flou pour moi. J’ai eu peu de contact avec des actrices, et puis il y a aussi Dorcel Africa. Je me demande comment ça fonctionne là-bas, en Côte d’Ivoire ou au Cameroun, où des femmes sont pourchassées juste pour vivre leur sexualité, la situation est encore plus complexe.
P. Ce qui me plaît, c’est d’avoir un boulot, déjà. Je ne suis pas en CDI, je suis alternante, donc je suis un peu éloignée de l’idée de « choisir » de travailler dans la pornographie. Je suis fière de ce que je fais, mais je n’en fais pas une fierté personnelle, surtout chez Dorcel. Avant Me TooLe mouvement #MeToo, né en 2017, vise à dénoncer le harcèlement et les violences sexuelles, en particulier dans les milieux professionnels, et a profondément remis en question les rapports de pouvoir et le consentement dans divers secteurs, y compris le porno., je pense que c’était vraiment dégradant. C’est un monde qui m’intéresse, mais je sais que je vois une réalité partielle.
La sexualité et la pornographie sont liées à l’idée de beauté, mais ce n’est pas objectif. Beaucoup se tournent vers le sexe pour combler un vide, mais pourquoi le sexe plutôt que d’autres formes d’intimité ? On peut aimer le sexe sans amour, mais qu’est-ce que cela signifie ? Il faut repenser ce que sont l’amour et le sexe. Chez Dorcel, c’est : peut-on faire l’amour sans être amoureux·se ? Et quel est l’impact du sexe sur le bien-être mental ? C’est presque une performance.
Je constate que l’amour, peu importe sa forme (polyamour ou traditionnel), passe souvent par un acte sexuel. Peu de gens, que ce soit dans une relation amoureuse ou non, ne l’ont pas vécu ainsi. Et pourtant, l’acte sexuel ne se résume pas à la pénétration. Pourquoi la sexualité devient-elle un passage obligé ? Parfois dans le cadre du TdS, certains clients ne vont même pas jusqu’à l’acte, et ça me fait me demander : qu’est-ce qu’ils recherchent vraiment ? Ce n’est pas toujours clair, c’est plus complexe.
P. J’ai du mal à savoir si le sexe est un évènement ou non. Parfois, ça me semble ennuyeux, mais je le vois aussi comme une manière de découvrir l’autre. Mais pourquoi ce besoin constant de répétition ? En grandissant, je pensais que c’était parce que les gens aimaient ça, mais je ne crois pas que la majorité des gens aiment vraiment le sexe. Certain·es oui, mais beaucoup ne semblent pas y trouver de plaisir réel. On regarde du porno, mais ce n’est pas le même pour tout le monde. Il faudrait distinguer ce que les gens cherchent dans le porno, car ce n’est pas une masse uniforme. Malheureusement, beaucoup cherchent des corps idéalisés, sans imperfections.
Je trouve ça triste, mais je comprends pourquoi ça existe. Personnellement, il m’arrive d’être excitée par l’idée d’être avec une personne, mais c’est davantage l’idée de la personne que l’acte en soi qui m’attire. J’ai du mal à en parler, surtout de mon travail chez Dorcel, parce que je ne suis pas vraiment à fond dans ce que je fais. Parfois, je trouve ça répétitif et peu engageant. La dernière fois que j’ai eu une relation sexuelle, c’était plus drôle qu’autre chose : le toucher, la nudité, l’excitation initiale, mais rapidement, je m’ennuie. Je peux atteindre l’orgasme vite, mais je ne vois pas l’intérêt de prolonger.
En ce qui concerne ma vision du sexe, je suis partagée. Parfois, je me sens obligée de croire en des choses opposées, de jouer des rôles différents, car pour ma survie, il faut que je croie à tout et à son contraire. Mais, en même temps, je suis forcée de cacher cette partie de moi qui doute et qui oscille, ce qui est paradoxal et difficile à gérer.
CO. En dehors de ton travail, quelles sont tes activités ? Comment tes pratiques artistiques influencent-elles ta vie et ton travail ?
P. En dehors de mon job, je vis. Je considère ma vie comme une pratique artistique constante : je performe tout le temps, même quand je n’en ai pas l’envie. J’ai une grande envie de réaliser plein de choses, mais je souffre souvent de procrastination. Sur Instagram, je raconte ma vie, mais j’ai du mal à maintenir des projets sur le long terme. C’est un peu comme une tendance à ne pas me forcer, mais je suis consciente des limites de cette attitude quand il faut agir. Je pense que toute production humaine a une dimension artistique. J’ai une vie intense, remplie d’évènements, qu’ils soient positifs ou négatifs, et je m’efforce de transmettre ces expériences à d’autres, qu’iels aient vécu des choses similaires ou non.
Les réseaux sociaux ne sont pas simples pour moi, et mon compte est encore privé. Mais j’aimerais un jour l’ouvrir et recevoir tout ce que les gens ont à offrir, même si cela ressemble à un combat. Je veux être moi-même et cela devient une forme de performance. Pour moi, performer, c’est mettre en avant ses forces pour réaliser quelque chose, mais je cherche à rester naturelle et ne pas forcer les choses pour atteindre un objectif. Mon art, c’est la « nature peinture »« Nature peinture » évoque ici un art spontané et authentique, mêlant naturel et création consciente, reflétant la volonté d’être soi sans forcer., au sens propre comme au sens figuré.
J’ai découvert que la texture des sextoys est vraiment agréable pour celleux qui, comme moi, ont des besoins sensoriels et aiment toucher des choses. Je trouve aussi que ce sont des objets esthétiques, presque comme des pièces d’art. Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont ils sont conçus, leur packaging, et comment ils sont présentés à la vente. Ce n’est pas tant l’objet en soi, mais l’ensemble de l’expérience qui me fascine.
Mon sextoy préféré s’appelle Butter, un grand gode noir conçu pour les personnes qui pratiquent le fist. Ce n’est pas un objet que j’utilise de manière conventionnelle, mais j’apprécie sa conception et son packaging. Il a un motif militaire et un vocabulaire très direct, l’idée c’est d’aller au bout des choses, avec un champ sémantique hyper militaire. Ça parle de remplissage. Il y a une fois le mot « plaisir », mais on parle vraiment d’aller au bout des choses. Sur la boîte, il y a des petites étoiles de blason commando. On sait que la cible c’est pas les meufs. Ce côté visuel, la façon dont il est présenté et son côté décalé m’intéressent vraiment. C’est une manière pour moi de déconstruire ces objets du quotidien, de leur donner une nouvelle signification et de jouer avec les perceptions.
P. Oui, il y a une boîte au travail avec des objets utilisés pour des shootings, certains ne se vendent pas ou ont un défaut de fabrication. Moi, je les prends tous, qu’ils soient fonctionnels ou non. Je trouve que les sextoys sont super chers, donc quand je peux en donner ou les partager, c’est cool, même si c’est difficile pour moi de m’en séparer. J’y tiens vraiment. En ce moment, je traverse une période où je peine à posséder des choses. Là, c’est l’une des premières fois où je me sens vraiment propriétaire de quelque chose que d’autres trouvent intéressant. Ça me permet aussi de parler plus facilement de sexe avec les gens, surtout quand on est chez moi. Les gens adorent parler de sexe, c’est une sorte de fil conducteur, c’est le nerf de la guerre, comme Butter.
Je pense que c’est aussi sacré qu’être bonne sœur, entretien —
Jacquie Belen est l’une des artistes que nous avons invitée en 2023 lors de l’exposition 200 Roses. Elle nous parle ici des spécificités de son activité de TdS à Bogotá en Colombie et de ses différentes pratiques artistiques.
Jacquie Belen. Je suis TdS depuis cinq ans. J’ai commencé en 2019, juste avant la pandémie, en faisant du TdS virtuel « vanille »Le sexe vanille désigne des pratiques sexuelles considérées comme conventionnelles, sans éléments BDSM ou fétichistes. : je ne streamais pas, je produisais uniquement du contenu. À l’époque, c’était un complément à ma vie, car je bénéficiais d’aides et avais d’autres emplois, comme poissonnière ou serveuse au PMU.
J’ai ensuite découvert le BDSM en tant que soumise, guidée par une collègue. En discutant avec d’autres TdS, j’ai voulu essayer le réel. Le virtuel ne me convenait pas : il demandait une régularité et un sérieux que je n’avais pas envie d’investir. J’ai donc progressivement abandonné le virtuel pour me consacrer au réel, cette fois comme dominatrice.
Parallèlement, j’ai continué à exercer des emplois civils très variés. J’alternais entre périodes où je mettais le TdS en pause et d’autres où je reprenais, ça pendant cinq ans. Je suis allée en Colombie et j’ai poursuivi mon activité de dominatrice tout en travaillant dans un call center. J’ai également réessayé le virtuel, notamment le streaming car j’avais peu de clients en réel.
Aujourd’hui, je me prépare à peut-être travailler comme danseuse en club. C’était un rêve avant même de devenir TdS : les showgirls de Las Vegas. Chaque branche du TdS est, selon moi, un travail à part entière, avec ses spécificités. Au bout de cinq ans, on acquiert des compétences transversales : savoir séduire, bouger son corps, comprendre les attentes des autres. Ces savoirs peuvent s’appliquer à toutes les facettes de cette industrie.
CO. Quelle est la situation pour le travail du sexe en Colombie et peux-tu faire des comparaisons avec tes expériences en France ou ailleurs ? As-tu travaillé dans d’autres pays ?
JB. En Colombie, la législation est différente de celle de la France. Ce n’est pas illégal d’être travailleur·euse du sexe ou d’être client. On peut se déclarer auprès de la DIAN (équivalent des finances publiques), dans une catégorie nommée entretenimiento ou divertissement web, qui correspond à l’activité de modèle webcam. Le travail du sexe virtuel y domine largement : la Colombie est le deuxième pays au monde avec le plus de streameur·euses, après la Russie.
L’industrie du streaming est très organisée, avec de nombreux studios, parfois utilisés pour blanchir de l’argent du narcotrafic. Il existe même une école dédiée au travail du sexe virtuel à Medellín. Travailler dans ces studios peut être risqué : les droits des modèles ne sont pas toujours respectés, et je trouve que ça frôle parfois la traite d’êtres humains.
J’ai travaillé dans un studio de webcam comme modèle « satellite », où je n’étais pas physiquement sur place, mais sous la supervision de chefs virtuels. Cette expérience s’est mal terminée : ils m’ont volé une partie de mes revenus, malgré mes tentatives de réclamation. Je leur ai envoyé un mail en disant : « Vous faites du sex trafficking. » Ils m’ont donné une partie de ce qu’ils devaient me payer. L’entreprise était américaine, avec une base en Colombie, et je connaissais la responsable par des relations communes, ce qui m’a poussée à leur faire confiance, à tort.
En France, mon expérience est très différente. Je travaillais principalement en indépendante, dans des bleds paumés, ce qui ne m’a pas permis de voir l’industrie dans son ensemble. Mes collègues étaient principalement des dominatrices ou des escorts indépendantes. Quelques-unes travaillaient en club, mais ça restait assez éloigné de ma propre pratique.
JB. Il y a plusieurs groupes, mais c’est assez fragmenté. À Bogotá, j’ai rencontré un groupe de TdS plus âgé·es (entre cinquante et soixante ans), un syndicat millénaire mais qui a du mal à s’actualiser, notamment sur des sujets comme le travail webcam. J’y avais été introduite par mon cousin, étudiant à Sciences-Po, et la cheffe m’avait proposé de représenter la branche webcam. Mais je ne me sentais pas légitime pour cette responsabilité.
J’ai aussi croisé un syndicat de travailleur·euses plus jeunes, mais il a été marqué par de graves conflits internes, avec des menaces de mort et des compromis douteux avec des studios webcam. Une amie proche qui en faisait partie a dû quitter son poste de présidente après avoir reçu des menaces de mort, y compris envers sa famille, et les représentantes de son ancien syndicat ont tenté de détruire sa réputation. Je garde mes distances avec ce milieu pour la protéger.
Le contexte en Colombie est très différent de celui en France : les assassinats de leade r·euses politiques, sociaux·lles et syndicaux·lles y sont courants. Cette violence engendre corruption, alliances avec des ennemis politiques ou désengagement par peur. Ça rend très difficile l’émergence d’un contre-pouvoir organisé.
CO. Comment as-tu construit ton personnage de dom ? Peux-tu le présenter et expliquer ton processus de création ?
Romea Diabla : c’était mon premier alter ego, à l’origine un nom d’artiste. Avec ce personnage, j’ai construit une image de dominatrice mythologique, presque divine. La déification est un élément central dans la domination : on te met sur un piédestal, et je voulais jouer avec cette idée de créature surnaturelle. Mes inspirations venaient des femmes fatales, d’autres travailleuses du sexe dans l’Histoire, de modèles, d’actrices, mais aussi de personnages non humains au fort impact symbolique.
Nicole Dickman : après plusieurs ruptures avec le travail du sexe, j’ai eu envie de « tuer » Romea, de la laisser derrière moi. C’est à ce moment que j’ai imaginé Nicole Dickman, une avocate érotisée, inspirée par les univers bureaucratiques et judiciaires. Ce personnage reflète une carrière que j’aurais aimé avoir, car j’ai essayé de faire des études de droit sans réussir. Nicole s’inscrit dans une esthétique plus précise, proche des téléfilms des années 1980-1990, avec un aspect très cinématographique. Ça se traduit dans mes vidéos, photos, et dans les sessions que je propose. Je porte souvent des tenues de bureau, que je trouve trop sexy.
Cependant, certains clients m’ont connue en tant que Romea Diabla et préfèrent ce rôle. Par exemple, pour une personne en particulier, je suis toujours la « déesse serpent », ce qui est plus proche de mon premier personnage. Je jongle entre ces deux identités en fonction des attentes ou de mes envies artistiques.
CO. Est-ce que tu pourrais parler de ton travail artistique et des liens entre ton activité artistique et ton travail de TdS, notamment les personnages que tu construis ?
JB. J’ai commencé mon travail artistique aux Beaux-Arts, où j’ai appris les techniques et surtout, l’importance de travailler en collectif. Ce que j’en retiens le plus, c’est cette dimension collaborative : créer des espaces avec d’autres. Ma pratique artistique tourne beaucoup autour de cette idée de collectif, à travers des projets comme la radio, des groupes de musique, ou de la gestion culturelle. Même dans mes travaux plus individuels, comme en arts plastiques ou sonores, je cherche à refléter ces connexions humaines.
Le TdS apparaît dans ma pratique plastique, notamment en peinture, où je représente des collègues, moi-même, ou un imaginaire érotique. Plus récemment, je me suis tournée vers l’audiovisuel, avec cette année la réalisation d’un film porno que j’ai écrit et développé pendant deux ans. Ce film met en scène Nicole Dickman, mon personnage d’avocate. J’ai collaboré avec des personnes du monde du cinéma pour en faire un projet artistique qui va au-delà du simple aspect pornographique ou excitant.
Je pense que mon travail de TdS nourrit ma créativité, tout comme mon travail artistique influence ma vision du TdS. Cela dit, ce n’est pas toujours évident, surtout quand la question financière entre en jeu. Ce film, par exemple, a été réalisé grâce à la volonté et à l’implication de beaucoup de personnes, mais sans budget. Mon rêve serait de pouvoir continuer à faire des films tout en rémunérant correctement les gens avec qui je travaille.
CO. Ta pratique artistique se dirige vers la vidéo. Est-ce que tu mets de côté la peinture ou les activités collectives ? Comment imagines-tu l’évolution de ta pratique artistique et de ton activité ?
JB. Je ne pense pas arrêter la peinture ni les activités collectives, parce que j’aime toujours ça, tout simplement. La peinture reste une pratique agréable pour moi, et j’ai aussi envie d’écrire. J’aimerais reprendre des études pour structurer mes idées et travailler sur des choses que j’ai observées ou ressenties. Mais je ne veux pas que ce soit une approche trop académique, qui enfermerait le TdS dans une identité unique ou figée. J’aimerais que ce soit un projet collectif, même si je ne sais pas encore sous quelle forme.
Je vais sûrement continuer à explorer la vidéo, en collaborant avec d’autres personnes et en réalisant des idées ou des fantasmes qui me tiennent à cœur. Par exemple, j’ai réalisé un documentaire intitulé Portal Las Rosas pour les Porny Days à Zürich, basé sur des goûters de travailleur·euses du sexe qu’on appelle La merienda de putas. On se réunit depuis deux ans avec un groupe fixe de cinq personnes.
Pour ce film, je leur ai proposé qu’on se filme dans un motel, donnant à chacun·e la possibilité de prendre la caméra et le Zoom. Les prises de vue étaient très différentes, mais c’était essentiel pour moi qu’iels puissent contrôler ce qu’iels ont envie de montrer ou non, et qu’iels participent à tout le processus de création. J’ai monté le film, mais je leur ai montré chaque étape pour m’assurer que tout leur convenait, autant visuellement qu’à l’audio.
Ce projet m’a émue. Il a marqué un moment de vie, et j’aimerais refaire des films comme ça, pas uniquement autour du TdS, mais toujours dans cet esprit de transmission et d’intimité. C’est une manière de faire de l’art qui me ressemble : directe, collaborative, et qui évoque des séries ou films que j’aime.
CO. Aujourd’hui, tout le monde a une pratique vidéo, même si elle n’est pas professionnelle. Les gens savent plus ou moins se représenter elleux-mêmes.
JB. Ce qui me fascine – et que j’aimerais explorer dans le cadre des études – c’est l’auto-représentation des TdS. C’est un thème riche, avec des spécificités intéressantes liées aux créatures non humaines. Dans les légendes, que ce soit en Amérique latine, en France ou ailleurs, les TdS sont souvent associé·es à des figures monstrueuses ou démoniaques.
Pièces présentées dans l’exposition 200 roses

La première est une représentation de moi-même en face du motel où je travaillais, accompagnée d’une prière pour l’abondance et l’argent. Je me suis inspirée des peintures votives mexicaines, que j’ai trouvées magnifiques. Comme je ne savais pas où en trouver pour moi, j’en ai créé une.
La deuxième montre deux personnages dans un bureau, habillés en latex et en tenue de secrétaire. C’est une représentation de mon univers de TdS, ce qui m’excite, ce que j’aime et ce à quoi j’aspire. Je n’ai pas forcément autant de latex que le personnage alors je trouvais bien de pouvoir le peindre.

La troisième est une diablesse en shibari, qui était inspirée de Romea Diabla, avant que j’invente Nicole Dickman.
C’est comme un triptyque religieux. J’adore la religion. On en parle dans le film qu’on a fait avec les collègues, de notre fascination pour les sœurs et les couvents. On trouve qu’il n’y a pas de meilleure retraite pour une pute que de devenir bonne sœur.
Je ne suis pas entrée dans ce travail par miracle, mais parce que j’étais dans une phase chaotique de ma sexualité. Ça m’a permis de me la réapproprier : décider avec qui, où, et comment ça se passe. Le fait que ce soit rémunéré me plaisait aussi. C’était une forme d’auto-exploration qui m’a rendue plus libre, comparé à la sexualité vanille et hétérosexuelle qui m’étouffait à l’époque.
Offrande à oyá —
-
Candomblé : Culte pratiqué au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine et au Venezuela. Mélange de catholicisme, de rites indigènes et de croyances africaines.
-
Orixá / Orisha : Divinité ou esprit divin dans la religion yoruba de l’Afrique de l’Ouest. Est aussi une figure centrale dans de nombreuses religions de la diaspora africaine comme le Candomblé, la Santeria et le Vaudou.
-
Santeria : La Santeria est une religion afro-caribéenne, principalement pratiquée à Cuba, qui combine les croyances et les traditions yoruba avec des éléments du catholicisme.
-
Yoruba : Ethnie d’Afrique de l’Ouest et langue tonale appartenant à la famille des langues nigéro-congolaises. La langue yoruba est parlée par le peuple Yoruba, qui vit principalement au Nigeria, mais aussi au Bénin, au Togo et dans d’autres régions d’Afrique de l’Ouest.
Offrande à OyáPièce présentée dans l’exposition 200 Roses
rail : plomb - acide - verre - grisaille, 2018
Banane - Orange - Pêche - Melon - Spondias mombin - Dracaena +
trifasciata Vitrail : plomb - acide - verre - grisaille
J’ai fait ce vitrail sous forme d’offrande à Oyá, ou Iansã dans le candomblé brésilien. Elle est une divinité puissante des traditions religieuses yorubas, l’orixá du vent, de la tempête, des éclairs, de la mort et de la renaissance. Pour la remercier.
La playlist qui l’a accompagnée lors de l’exposition 200 Roses est une bande sonore de cette période de ma vie.

Vagabunda, playlist
Oya, Oyá, ou Iansã (dans le candomblé brésilien) est une divinité afro-américaine originaire des traditions religieuses yorubas. Elle est l’orisha du vent, de la tempête, des éclairs, de la mort et de la renaissance. On retrouve les orishas, ou orixás, dans plusieurs pays africains ainsi que dans de nombreux pays américains, où ils ont été introduits par la traite des Noir·es, qui a frappé les populations yoruba de façon particulièrement lourde. Ils sont vénérés en Afrique, en particulier au Nigeria et au Bénin. Dans les Amériques, on les rencontre surtout dans le candomblé brésilien, sous le nom d’orixás. Ce sont des êtres d’essence divine qui représentent les forces de la nature.
Les orixás brésiliens sont beaucoup moins nombreux que les orishas de la mythologie yoruba, puisqu’il n’en existe guère qu’une douzaine auxquels on rend un culte. Comme dans la santeria, à chaque orixá est associé un·e (voire plusieurs) saint·es catholique·s, ou encore une des manifestations de la Vierge Marie. Cependant, les saint·es associé·es diffèrent fréquemment de celleux de la Santeria, et peuvent même varier d’une région à l’autre du Brésil.
Iansã est associée dans le candomblé à Sainte-Barbe. Dans la mythologie yoruba, le nom d’Oya vient de la rivière du même nom au Nigeria, où son culte est fait, maintenant appelé le fleuve Niger. Iansã, déesse du Niger, est une divinité des eaux comme Oshun et Yemanja, mais est également liée à l’élément air et est l’une des divinités qui contrôlent les vents.
Particularités d’Obba ou Oya dans la Santeria :
Déesse des lacs, symbole de la fidélité conjugale. Deuxième épouse de Chango, profondément amoureuse de l’inconstant, elle soigne sa déprime en errant dans les cimetières. Représentée par Catherine de Sienne, elle est devenue l’intermédiaire avec l’esprit des mort·es.
Chère Mère Iansã, Défends de la jalousie, de la négativité et des demandes. Avec le vent, ton domaine Ma Mère, balaie tous mes doutes et avec le feu sacré de ton amour réchauffe mon coeur. Iansã, reine de Xangô, reine des rayons, que ton épée défende tous mes désirs, ma maison et mon travail. Que ta couronne brille en mon esprit, comme toujours aux rayons du soleil et qu’avec ça je puisse voir les chemins par lesquels je dois passer pour grandir spirituellement. Cherche, Iansã, ton fils / ta fille qui te demande.
Epahei Oya ! Iansã, fille d’Iemanja avec Oxala, Maîtresse des vents et des rayons. L’épée en main défend ses enfants. Protège de la jalousie et des ennemis. Iansã ouvre tes chemins pour ton indépendance. Qui naît dans la tempête, ne tremble pas avec un petit vent.







Annexes
Podcasts
À la suite de l’exposition Argent Facile, en juin 2022, nous avons diffusé une série de six podcasts, sur la webradio radio 40. Ils sont à présent disponibles sur le site de ProCoRe, l’association faîtière Suisse de solidarité avec les TdS et également sur la plateforme d’écoute de la librairie La Dispersionhttps://radio-40.ch/emissions/collectif-occasionnel-argent-facile/, https://ladispersion.ch/podcasts.html (Spotify).
Ensemble d’entretiens réalisés auprès de personnes ayant à la fois une pratique artistique ou créative et une pratique du travail du sexe. Ils ont été menés dans le courant de l’année 2021. Il y est question d’économie, de gestion du temps et de l’argent, mais aussi d’auto-représentation, et de situations provoquées par le COVID. Au total sept entretiens sont proposés à l’écoute.
Enregistrement d’une table ronde qui s’est tenue le 17 février 2022, et qui s’intitulait Luttes et réalités locales. Nous y avions invité des membres de plusieurs organisations de soutien aux TdS françaises et suisses.
Enregistrement d’une table ronde, qui s’est tenue le 27 janvier 2022, et qui s’intitulait Représentations et pédagogies autour du travail du sexe. À cette discussion, ont été invité·es Fraiz, ainsi que Jehane Zouyene et Marianne Schweizer.
Lecture de Lazare Lazarus, qui se présente ainsi : pute et jardinier. Il s’agit d’une lecture de son texte Quand la ville bande, donnée le 23 février 2022, pour ouvrir une soirée de projections de deux documentaires au cinéma le Spoutnik. Ce texte est paru dans la revue Trou Noir n° 11, 2021.
En 2023, nous avons été invité·es par ProCoRe, pour le huitième épisode de leur série Let’s talk about Sex Work, à parler de la représentation du travail du sexe dans l’art, la culture et les médias.https://podcast.de/episode/624320060/8-le-travail-du-sexe-dans-lart-le-recit-de-charlotte-et-constance
Bibligraphie
Lors des expositions Argent Facile et 200 Roses, nous avons édité en collaboration avec la librairie La Dispersion, une série de brochures afin de constituer un infokiosque. Certaines sont disponibles sur le site de La Dispersion.https://ladispersion.brochures.html
-
La révolte des prostituées de Lyon Textes autour de l’occupation de l’église de Saint-Nizier à Lyon en 1975.
-
Travailler, Entretiens avec Bertoulle Beaurebec, Anaïs de Lenclos, Thierry Schaffauser, Morgane Merteuil et Sarah-Marie Maffesoli.
-
Le travail du sexe contre le sexe. Pour une analyse matérialiste du désir, Morgane Merteuil.
Colophon
Relecture par Coralie Guillaubez.
Photographies de eden levi am, Neige Sanchez.
Publié sous licence CC BY-NC-ND.
Version imprimeur
Cette version a été composée par Maurane Zaugg en Amiamie (Mirat-Masson) et HD Microbic (Laura Garcia Mut).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.




















