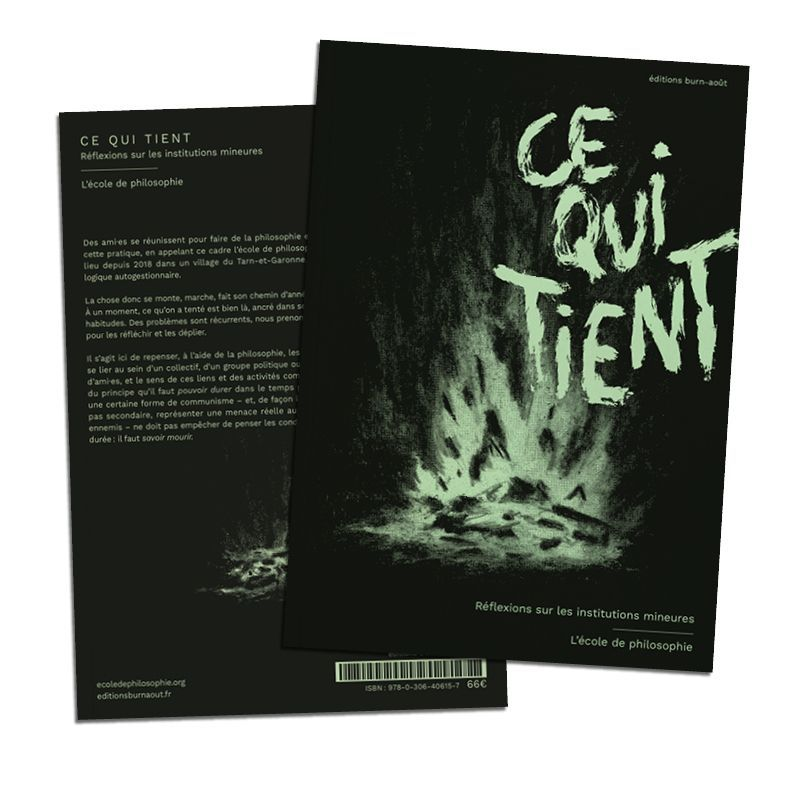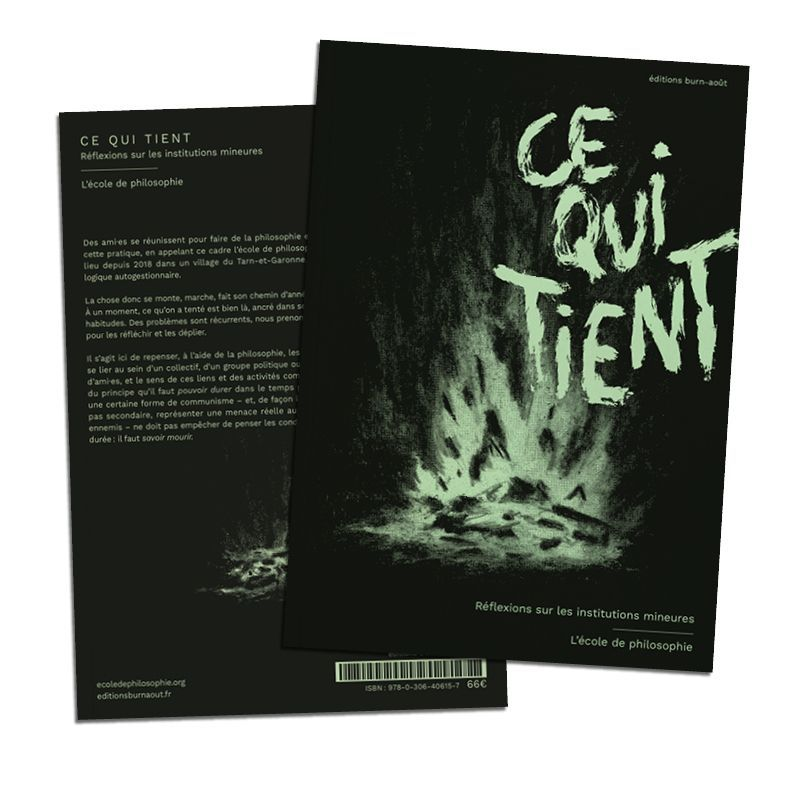
Table des matières
Ce qui tient, réflexions sur les institutions mineures
Ce qui tient est un recueil de textes autour de la notion d’institutions mineures, écrit depuis l’école de philosophie, une école autogérée dans le Tarn-Et-Garonne. Recueil de philosophie politique, ce livre est aussi issu des questions pratiques et existentielles que l’école de philosophie se pose sur elle-même : sa forme comme institution et comme groupe, la pratique de la philosophie comme discours écrasant, et les manières de la pratiquer. Un enjeu s’en dégage : qu’est ce que cela veut dire pour un groupe de durer dans le temps sans se scléroser ?
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 22/01/26 à 10 h 25.
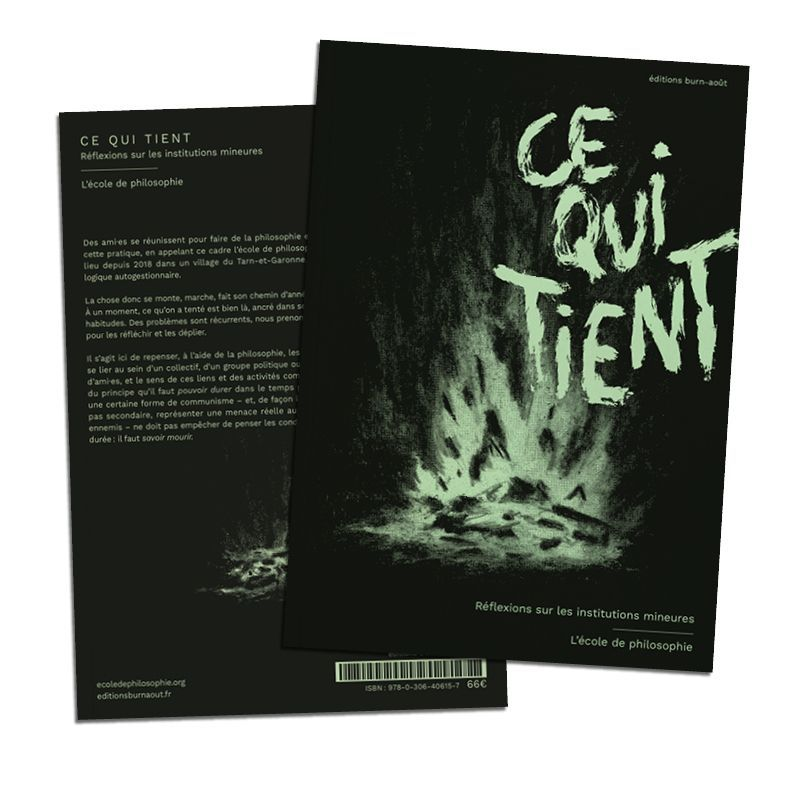
Pour le texte « La naissance de la philosophie d’après Giorgio ColliGiorgio Colli, La Naissance de la Philosophie, trad. Patricia Farazzi, éditions de l’éclat, Paris, 2015. », nous avons fait le choix de ne pas appliquer cette graphie des genres et de laisser la forme masculine. En effet, l’auteur se réfère majoritairement à des philosophes de l’Antiquité, époque pendant laquelle la pratique philosophique est l’apanage des seuls hommes.
Introduction
Le livre qui suit est composé d’un ensemble de thèses, réflexions et recherches issues de la quatrième année (2021-2022) de l’école de philosophie de Verfeil-sur-Seye (Tarn-et-Garonne). Pendant les trois premières années, nous avons gardé la même forme d’organisation. La quatrième a été consacrée à repenser cette forme. Nous voulions le faire en considérant l’école comme un lieu où s’élaborent des manières de vivre, plus qu’un lieu consacré à la transmission d’un savoir. Plutôt que le terme d’école, c’est donc un autre terme qui nous a servi à désigner le type d’espace-temps auquel rapporter cette école de philosophie : « institution mineure ». C’était une trouvaille, qui possédait son évidence et nous permettait de nous mettre en route dans nos recherches. Elle tenait ensemble un spectre large de préoccupations que le sommaire reflètera. Une partie du travail a consisté à creuser et expliciter cette première évidence, et les enjeux qui ont fait que cette formule tombait juste. Institution mineure est la réunion de deux termes, appartenant à des champs distincts. L’institution renvoie au courant de la psychothérapie institutionnelle, dont un des principes pourrait être que l’institution thérapeutique elle-même doit être au travail et en mouvement pour accueillir la singularité du·de la patient·e et permettre qu’une bonne thérapeutique se fasse. Le mineur est ici tiré du travail philosophique de Deleuze et Guattari à partir de travaux en linguistique portant sur les manières d’écrire et de parler qui ne répètent pas la norme dominante, mais la déjouent et la font varier. La coïncidence est heureuse, car en un sens, l’école de philosophie est un lieu où on soigne le langage et où on se soigne par la parole.
Pour organiser cette année, nous invitions à venir avec un exemple historique d’une institution mineure, un·e auteurice ou un livre, et un problème que nous posait la construction d’une école. À partir de là, différents chantiers ont été menésIbid., p. 17-18.. La notion d’institution mineure a donné le fil rouge de cet ouvrage. L’hétérogénéité des textes – essais, notes de lecture, questionnaire – garde une trace de cette proposition initiale dans trois directions différentes. Ce sont autant de problématiques spécifiques qui ont animé le travail : préciser et définir ce concept d’institution mineure et en analyser les conséquences et les effets ; penser avec des exemples concrets et historiques pour confronter le concept ou au contraire permettre de mieux le cerner ; appliquer ces réflexions à notre situation à l’école ou à l’inverse partir d’un problème concret éprouvé à l’école pour aboutir à une élaboration conceptuelle qui transforme ce problème. Ce sont autant de manières d’éclairer une situation et de penser des outils d’intervention qui pourront résonner ailleurs et autrement qu’ à l’école de philosophie.
Depuis cette quatrième année, nous avons poursuivi, de manière différente, l’école de philosophie. Nous avons mis un certain temps à mener à bout cet ouvrage, ce qui impliquait de rencontrer une maison d’édition, donner des formes écrites à des échanges initialement oraux, mettre à l’épreuve des hypothèses, s’en convaincre ou s’en dédire, et continuer en parallèle à s’occuper de ce que l’on nomme l’école de philosophie, c’est-à-dire des temps de rencontres et de formation en philosophie. Le sens que l’on a cherché et mis dans ce terme d’institution mineure s’entendra mieux dans le récit de ces trois années qui nous y ont mené·es, mais aussi par l’éclairage rétrospectif que ce concept donne aux années qui ont suivi jusqu’ à maintenant.
Commencer
À ses débuts, en 2018, l’école de philo était un ensemble de weekends d’étude constituant un engagement à l’année. Cette discipline régulière nous semblait nécessaire à la pratique de la philosophie. À partir d’un thème qui charpentait les corpus et réflexions de l’année, nous discutions, écoutions ou faisions des exposés, des ateliers, des exercices.
Cette forme qui s’est répétée pendant les trois premières années, a rencontré l’engouement, l’enthousiasme, la curiosité d’ami·es plus ou moins proches. Il y eut de très belles fêtes, des rencontres, des discussions tard dans la nuit et tôt le matin, des désaccords. Cette joie n’a pas empêché, et n’empêche toujours pas – et cela n’a rien d’étonnant –, l’omniprésence de dynamiques de pouvoir évidentes qu’il nous reste à déconstruire. L’amitié peut même tendre à les invisibiliser, et par là, désarmer la capacité d’analyse de la domination. Les rapports structurels sont les mêmes partout, et pourtant, les expériences collectives et politiques donnent parfois l’impression qu’ils sont dépassés, ou différents. Sûrement se cachent-ils, comme le diable, dans les détails.
De la même manière, nous étions par ailleurs pris·es dans les schémas éducatifs descendants qui nous avaient formé·es et que nous voulions éviter, alors même que nous cherchions à nous donner les moyens de transmettre une pratique de la pensée.
Nous devions scruter les rapports de genre, de classe et de race dans la pratique et la parole philosophique, la verticalité entre sachant·e et apprenant·e, l’influence des formes universitaires et du cours magistral, le risque du jargon, les manières d’accueillir en dehors d’un milieu social homogène et de présupposés politiques.
Ces problèmes ne pouvaient pas être réglés en une discussion, ils étaient « bons à penser ». La quatrième année de l’école de philosophie, que nous avons appelée « stade du miroir », leur a donc été dédiés. Elle avait pour objectif d’analyser nos pratiques et d’imaginer des formes futures désirables de l’école. C’est ce travail que nous présentons aujourd’hui sous la forme de ce livre.
Instituer
Depuis, l’école de philosophie a perduré. Aujourd’hui, cela fait sept ans qu’elle existe, des centaines de personnes ont été et sont liées par cette expérience. Nous voulons continuer à faire ce que nous aimons – penser ensemble et à côté, penser sans délier la pensée de ses conditions matérielles et politiques – et ne pas craindre comme la peste le fait que les choses qui durent s’instituent, comme si s’instituer voulait dire s’encroûter, se perdre, se vendre, se trahir. Le concept d’institution mineure s’est imposé à nous lors de cette quatrième année puisqu’il liait notre volonté de durer à la réflexion sur les manières de se structurer pour y arriver.
Plus que nos rapports dans l’absolu – et le féminisme nous a appris ça –, le processus compte ; la manière de vivre les évènements ensemble.
Pour réfléchir à ces problèmes, et sachant que nous n’étions pas les premie·res à nous poser ces questions de la forme et de l’intérêt à la micropolitique des groupes, chaque participant·e devait arriver avec un exemple historique d’institution mineure ou d’organisation collective inspirante – l’hôpital de Saint-Alban, les écoles du Black Panther Party, les béguinages ou encore le CIDOC d’Ivan Illich – et un problème au sens philosophique lié au langage, au soin, à la communauté ou à la pédagogie.
Une institution mineure signifie une remise au travail constante des formes, être attentif·ve à ce qui guette les expériences collectives qui durent : sclérose de rapports pourris, places qui se prennent et ne tournent plus, mauvaises habitudes. Il faut que perdure la possibilité de stopper la machine en se demandant ce qu’on fout ensemble, là.
Une institution mineure, nécessite en premier lieu de reconnaître ce qui s’est institué. S’il y a une volonté de durer, alors ça s’instituera et ça s’institue toujours et déjà. Assumer le concept d’institution mineure n’a pas été sans ambiguïté. Pour la plupart, la destitution semblait être un horizon politique plus désirable, l’institution étant décidément du côté de l’autorité.
Pourtant une institution mineure peut être une réponse politique à la domination étatique. L’institution mineure est une manière de faire grandir ce à quoi l’on tient, ces images et ces mots que l’on veut porter dans le monde.
Institution car nous cherchons désespérément à nous doter de forces à la fois symboliquement et matériellement qui soient suffisamment denses pour durer dans le temps et entrer en conflit avec le champ majoritaire.
Mineure parce que nous ne voulons pas répéter les modèles dominants du soin ou de l’enseignement, du partage genré et racialisé de la pensée, parce que nous ne voulons pas nous substituer à ces institutions majeures ou devenir à notre tour majoritaires. Il s’agirait plutôt de se répandre en restant variables selon les saisons, les conditions de vie et les affections. Et ne jamais se prendre pour un mode d’emploi.
Mineure aussi parce que nous voulons continuer à explorer ce concept de minorité dans la pensée. Il y a bien une nécessité à tendre l’oreille à des voix périphériques. Qui lit-on, qui écoute-t-on, quelles voix viennent à nos oreilles et de quelle manière, et quelle parole voulons-nous nous-mêmes porter en appelant ce que l’on fait philosophie.
Partager
Une des tâches de l’école est de transmettre ce qui s’y trame et s’y pense. D’un côté, en se donnant pour ambition de ne pas dissocier la pensée de ses conditions de possibilité et d’apparition, de l’autre, en partageant les recherches qui y sont menées sans reconduire une forme d’élitisme dans les mots et la forme, signe distinctif d’une pratique de la philosophie que nous critiquons.
Si le monde nous échappe de plus en plus, la philosophie nous donne une prise – efficiente ou non, cela reste à vérifier – pour s’en ressaisir. Le besoin de partage est lui aussi pressant, à nos ami·es déjà, et à toustes celleux qui croisent la route de l’école, par hasard ou déterminisme social. Pour cela, nous avons tenté de multiplier les manières d’intervenir : cours ouverts et enregistrements, séminaires ou restitutions publiques, articles dans des revues en ligne et auto-édition de livres.
La production de ce livre a ouvert un moment rétrospectif sur les recherches faites au sein de l’école ; c’est l’occasion, pour celleux qui travaillent à l’éditer et à le publier, de relire les textes des interventions menées pour demander des précisions à celleux qui les ont écrits, de les introduire et de les agencer entre eux. C’est prendre au sérieux les hypothèses faites par celleux qui traversent l’école et en garder une trace pour celleux qui la rejoindront plus tard. Les textes publiés dans ce livre analysent l’école autant qu’ils s’appuient sur des concepts et des expériences historiques, et celleux qui les ont relus analysent les analyses. Drôle de boucle, mais qui prend au sérieux ce que l’on nomme le collectif. Ce que nous apprenons aussi, c’est à travailler ensemble. L’amitié s’en trouve consolidée. Une fois publié, loin de constituer la fin de la pensée, objet fermé sur lui-même, ce livre est bien plutôt le support à partir duquel continuer la discussion.
Nous choisissons aussi de donner à lire différentes formes, entre notes de lecture, thèses, sans les hiérarchiser. Cette variation est due à une mise au travail conceptuelle au sein d’un collectif disparate, de personnes avec des sensibilités multiples, et une familiarité diverse avec l’écriture dite philosophique, des niveaux d’études et des parcours scolaires différents.
Durer
La première partie porte sur le couple parler / se taire. Le langage est ce que nous avons l’impression de partager, c’est aussi, et peut-être une cause de fragilité lorsqu’on commence la philosophie. Si le langage est ce que nous partageons, pourquoi ne puis-je pas comprendre un texte allemand de 1800 à la première lecture et pourquoi d’autres parlent ce langage étrange qui pourtant a les attributs du langage commun. Alors que je sais que je ne peux pas maîtriser un geste du premier coup, j’attendrai de pouvoir comprendre ces mots de manière évidente. Le langage est une institution majeure et normative dans laquelle nous tentons de nous frayer un chemin. Parler c’est accepter de jouer un jeu dont les règles sont structurées par un faux pas vis-à-vis d’une norme, et se taire c’est accepter le silence donc l’absence. À quel jeu jouons-nous lorsque nous parlons le langage de la philosophie ?
« La naissance de la philosophie d’après Giorgio Colli » est une note de lecture en six étapes qui dessine un portrait de la philosophie, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est plus. C’est une réponse ironique et critique à la question « qu’est-ce que la philosophie ? » à partir de son apparition historique en Grèce antique. Cette naissance questionne également la pertinence et les formes d’une pratique actuelle de la philosophie.
Le questionnaire « À quel jeu jouons-nous lorsque nous parlons le langage de la philosophie ? » a été posé aux participant·es de cette année-là pour mener une enquête sur l’enjeu linguistique de la pratique de la philosophie, sur la façon dont la pensée passe par l’accès à une certaine forme de langage et sur les problèmes que cela pose.
« Pierre Bourdieu, langage et pouvoir symbolique (Ce que parler veut dire) » relève aussi de la note de lecture, en abordant les rapports de pouvoirs véhiculés par et dans la langue, a fortiori philosophique. Qu’est-ce que ça fait de dire « a fortiori » par exemple ; ou plus généralement, quelles sont les opérations de pouvoir qui se jouent dans la langue ?
« Règles d’énonciation pour une machine philosophique » propose quelques pistes pour saisir les enjeux de la discussion philosophique collective en vue de la transformer et de rendre la pensée, historiquement masculine et basée sur une silenciation des minorités de genre, praticable par toutes et tous.
La seconde partie porte sur apprendre et ignorer. Dans un petit livre de Marguerite Duras, Ah ! Ernesto, Ernesto ne veut plus aller à l’école. Et pourquoi, lui demandent maîtres et parents. Il répond qu’ à l’école, il apprend des choses qu’il ne sait pas. Qui aime apprendre ce qu’iel ne sait pas ? Qui apprend, Ernesto ou son maître ? Plus largement, qu’apprend-on ? À l’école, apprend-on la discipline du corps ou l’amour de l’algèbre ? Ou apprend-on les bêtises ? Comment apprendre et doit-on savoir pour apprendre ? L’ignorance est-elle une lucidité ou une oeillère ?
Dans une perspective pratique, « Sur la pédagogie institutionnelle » examine des exemples d’écoles anarchistes et libertaires ainsi que des notions comme celles de pédagogie institutionnelle, d’institutionnalisation et d’analyseur.
« Avec Illich » revient brièvement sur la vie du chercheur Ivan Illich, en particulier au travers du Centre Interculturel de Documentation (CIDOC) qu’il a participé à animer au Mexique entre 1961 et 1976. Aux réflexions critiques sur l’école et les institutions répondent des pratiques de recherches novatrices.
Si les signifiants école et philosophie ont donc été questionnés dans les deux premières parties – peut-être, les deux sont-ils à abandonner, la philosophie et l’école étant deux formes hégémoniques – la troisième partie se penche plus spécifiquement sur les notions d’institution et destitution.
Comment construire une institution qui ne cherche pas à concurrencer le champ majoritaire mais qui soit pourtant capable d’entrer en conflit avec lui ? C’est à cette question que le texte « Institutions mineures » cherche à répondre. Il montre à travers diverses expériences qu’il n’y a pas d’usages qui ne se sédimentent en normes au sein d’un groupe, y générant ainsi de puissants rapports de forces. Comment alors construire des formes révolutionnaires qui déjouent l’éternelle opposition entre spontanéité et organisation, entre pureté et efficacité ?
Suit une note de lecture d’un séminaire de Jean Oury, Le Collectif, qui rappelle l’ancrage de cette année dans l’horizon de la psychothérapie institutionnelle. Cette note reprend la notion d’institution telle que Oury la déplie et expose quelques notions clefs – les ambiances, l’hétérogénéité, ou encore cette chose capitale au nom rebutant de fonction diacritique – qu’on peut faire sortir de leur technicité, et passer du champ thérapeutique au champ social, afin de les mettre au travail dans des collectifs comme ceux de l’école de philosophie.
Comment durer, en tant que collectifs contestataires, malgré l’inéluctable processus de récupération et normalisation qui guette toujours ? « Irrécupérables » clôt ce recueil et propose, comme réponse à cette question, d’imaginer des formes collectives capables de se subvertir elles-mêmes : des institutions destituantes.
Se donner des armes
Nous avons trituré cette définition d’institution mineure, et en parallèle, nous avons modifié, tenté, abandonné, remanié des pratiques. Parce que nous voulons durer – avec ce que cela implique d’ajustements et bouleversements continus – et pouvoir, s’il le faut un jour, mourir avant de n’être qu’un amas de mauvaises habitudes. Ce concept d’institution mineure a été une étape de recherche dans l’histoire de cette école de philosophie. C’est l’inverse d’une forme acquise, c’est un processus de questionnement qui n’exclut jamais la notion de problème – qui nous est chère.
Nous avons donc plein de problèmes et nous cherchons des solutions qui ne marchent jamais du premier coup, si tant est qu’elles marchent. À l’issue de cette quatrième année, nous avons – en s’inspirant du modèle de la clinique de psychiatrie institutionnelle de La Borde – aboli ce que l’on nommait le Groupe d’organisation au profit de Clubs divers et variés. Cette idée de dissolution d’un groupe décisionnaire était belle mais elle n’a pas marché dans la pratique : presque toutes les mêmes personnes étaient dans les Clubs, ce qui revenait à multiplier les réunions avec des confusions possibles pour savoir quel club s’occupait de quoi. Logistiquement, c’était trop compliqué. Faire des réunions sans savoir à quel club on a affaire, en ayant l’impression d’avoir créé un monstre horizontal et logistique pour les mêmes quinze personnes a été une expérience drôle et éprouvante. Évidemment, cela paraît être une opération de langage mais elle parle de la tentative de faire de la micropolitique, de dissoudre les rôles qui se prennent. De manière plus sérieuse, on pourrait se demander pourquoi des personnes ont rejoint ce groupe et l’ont quitté, pourquoi les personnes qui le quittent sont souvent celles qui l’ont rejoint en cours.
Parfois, il faut partir du groupe d’organisation pour y revenir, ou en partir pour en partir. Nous avons rétabli ce groupe et ce serait un mensonge publicitaire de dire que rien n’est pareil. Mais nous vivons avec la conscience que le penser comme nécessaire est une facilité ou un choix, pas un fait. Et dans ce groupe, il est parfois difficile de prendre le temps de le suspendre, de se demander ce qu’on fout là, ensemble, en mettant de côté les agacements ou la trop grande familiarité.
Nous avons aussi décidé et acceptons de modifier plus ou moins profondément, presque chaque année la forme de l’école. Entre groupes de recherches, semaines de transmissions, weekends de recherches, ou weekends d’exposés, nous sommes constamment en recherche d’une forme épanouissante. Et pourtant, nous sommes pris·es en étau entre le salariat et les vacances scolaires, la fatigue et les réunions, le temps nécessaire pour travailler et le temps nécessaire à l’organisation logistique qui peut éloigner de la pratique philosophique. Il y a de la fatigue parfois, mais il y a la joie renouvelée de chaque année se laisser la possibilité de tenter des nouvelles choses, la joie de rencontrer des nouvelles personnes qui rencontrent toujours l’école à des moments très variés d’elle-même.
Nous voulons partager cette expérience parce que nous espérons qu’elle parle à d’autres, qu’elle les questionne. Ce partage se fait sous la forme de textes théoriques parce que c’est ce qui nous rassemble : l’élaboration a la forme de sa manière, mais ce n’est pas jamais une évidence. Le concept permet néanmoins de réfléchir ce que l’on fait et de partager ces analyses avec d’autres, c’est pourquoi nous persévérons dans ce langage.
Nous ne voulons pas partager cette pensée uniquement dans le champ de la théorie, nous voulons la partager à la hauteur de ce qu’elle nous importe, d’un communisme existentiel qu’on s’évertue à construire, dans la jonction entre idées et expériences. Nous nous adressons à qui veut, et à celleux qui tentent aussi de construire des expériences collectives, avec ses névroses et ses joies. Nous pourrions produire un discours inaudible pour celleux à qui nous voudrions parler ; référence et philosophie qui mettent à distance. Peut-être est-ce là encore une bâtardise de ce que l’on produit. Sans romantiser l’inconfort, certain·es de nous y tiennent, comme une lutte contre l’autosatisfaction ou l’évidence.
Parler / Se taire
La naissance de la philosophie d’après Giorgio Colli
Qu’est-ce que la philosophie ? Les réponses à la question ont souvent quelque chose d’anhistorique, qui tentent de définir l’essence même du tour d’esprit particulier que serait la philosophie. On reprendra ici la réponse donnée à cette question par Giorgio Colli dans son livre La Naissance de la philosophieIbid., p. 18. parce qu’il opte au contraire pour une approche historique : parler de la philosophie comme on parle d’un moment historique et conceptuel particulier, situé dans le temps et dans l’espace. L’intérêt de revenir à la Grèce antique via l’approche de Colli est aussi de regarder en face le nœud originel entre l’école et la philosophie, ou, plus largement, entre pensée, vérité, politique et éducation. D’où vient la vérité du discours ? Vient-elle de celui ou celle qui l’énonce – les « maîtres de vérité », les figures de pouvoir ou de savoir – ou plutôt de celles et ceux qui reçoivent le discours – le plus grand nombre, le peuple qui consent, qui vote ou qui juge de ce qui est ? La vérité est-elle interne au discours, au signifiant, à l’enchaînement logique et universel de la syntaxe ou plutôt propriété du référent, de ce qui est dit, de la réalité elle-même, de ce qui est ? Selon Colli, la naissance de la philosophie consiste en un basculement d’un couple à l’autre : alors que la sagesse antique attribuait la vérité au couple énonciateur/réalité, la philosophie déplace la vérité du discours vers un couple destinataire/signifiant comme instances sanctionnant la vérité. La sagesse prétend énoncer la vérité en se faisant la porte-voix de l’être lui-même, par le biais de figures aptes à faire parler l’être à travers elles. La philosophie fait au contraire aveu d’impuissance : ne possédant pas la sagesse, elle la recherche en faisant des règles du raisonnement le centre d’une quête de la vérité à laquelle peut participer celui ou celle qui a reçu une éducation adéquate.
0. La philosophie désigne l’amour de la sagesse. Donc ce n’est pas la sagesse, qui justement, est ce qui a été perdu ou que l’on recherche.
0.1. Quand on s’initie à la philosophie, on lit en général cette définition d’une manière très valorisante pour la philosophie. On dit : le sage est celui qui sait tout et a tout expérimenté, a réponse à tout ; alors que le philosophe tend vers la sagesse, la recherche, se pose des questions, ne sait pas. On valorise beaucoup ce doute, cette quête de savoir, cette incertitude et cette humilité.
0.2. Ce n’est pas du tout l’approche de Colli. Selon lui la sagesse est comme un autre moment, une autre expression de la spiritualité grecque antique, que la philosophie va supplanter. On n’a plus la philosophie qui serait première comme recherche d’une sagesse qui serait seconde : la sagesse correspond à un savoir s’exprimant dans un moment historique qui vient avant la philosophie.
0.3. Pour cela, il marche dans les pas de Nietzsche, pour qui la tradition pré-socratique est bien plus riche que tout ce qui vient après Platon. Mais il veut corriger un point majeur dans La Naissance de la tragédie de Nietzsche qui consiste à réhabiliter Apollon en tant que dieu de la sagesse de façon complémentaire à Dionysos.
1. La folie est la source de la sagesse.
À Delphes se manifeste la vocation des Grecs pour la connaissance : le sage n’est pas celui qui est riche d’expériences, celui qui excelle par son habileté technique, par sa dextérité, par ses expédients. […] Le sage est celui qui jette une lumière dans l’obscurité, qui défait les nœuds, qui manifeste l’inconnu, qui précise l’incertain. Pour cette civilisation archaïque, la connaissance du futur de l’homme et du monde appartient à la sagesseIbid..
Si on décompose un peu, ça donne : sagesse = connaissance du futur et du monde = divination. « Divination implique connaissance du futur et manifestation, communication de cette connaissance. Ceci advient à travers la parole du dieu, à travers l’oraclePlaton, Phèdre, cité par Giorgio Colli, ibid., p. 22.. » On retrouve bien le réel (ici, il s’agit du futur) et l’énonciateur (ici, l’oracle) comme sources du discours vrai.
Dans la parole, la sagesse du dieu se manifeste à l’homme, et la forme, l’ordre, le lien par lesquels se présentent les paroles révèlent qu’il ne s’agit pas de paroles humaines, mais bien de paroles divines. D’où le caractère externe de l’oracle : l’ambiguïté, l’obscurité, la forme allusive ardue à déchiffrer, l’incertitudeIbid., p. 51..
L’oracle, et derrière lui le dieu Apollon, a quelque chose de cruel, de destructeur, de méchant. Et il agit de manière différée (via son arc) : jamais ses révélations ne doivent être directes, explicites. Pour Colli, cela témoigne d’une forme de retrait permanent du dieu qui indique, par l’obscurité, son retrait métaphysique.
1.3. Au fond du phénomène de la divination, on trouve la folie. La mania, la folie, est décomposée en quatre genres dans le Phèdre de Platon. La folie mantique, divinatoire qui vient d’Apollon. La folie mystérique ou télestique, qui permet à des guérisseureuses de soigner les fautes anciennes. La folie poétique, don des muses. Et la folie érotique. Colli insiste sur la première, qui est la plus importante et qui vient justement du dieu Apollon et trouve son centre à Delphes. Pour ça, il s’appuie sur Platon :
Les plus grands parmi les biens parviennent jusqu’ à nous par l’intermédiaire de la folie, qui est considérée comme un don divin… en effet la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, alors qu’elles étaient possédées par la folie, ont procuré à la Grèce de grandes et belles choses, aussi bien aux individus qu’ à la communautéAristote, cité par Giorgio Colli, ibid., p. 55..
2. Dans la folie divine, les dieux s’expriment par l’énigme, qui va peu à peu s’humaniser.
2.1. Apollon comme Dionysos ont tous deux un versant hostile et cruel qui va de pair avec un aspect ludique et bienveillant. La figure matérielle de cette ambivalence est le labyrinthe, conçu comme un piège autant qu’un jeu dont on peut sortir. La figure intérieure et discursive de cette ambivalence est l’énigme, dans laquelle le dieu se manifeste tout en se retirant. C’est le cas par exemple de l’énigme du Sphinx qui demande : « Quel être, pourvu d’une seule voix, a d’abord quatre jambes le matin, puis deux jambes à midi, et trois jambes le soir ? »
2.2. « L’énigme est la manifestation dans les paroles de ce qui est divin, caché, d’une intériorité indicible. Par rapport à ce que veut dire celui qui parle, la parole est hétérogène, elle est donc nécessairement obscureIbid., p. 67.. »
2.3. Petit à petit, les énigmes deviennent un jeu de société, un trait d’esprit et perdent leur ascendance religieuse. C’est avec Aristote que l’énigme se détache de ce « pathos originel », puisqu’il la définit comme le fait de « dire des choses réelles en les reliant à des choses impossiblesIbid., p. 73. », à savoir des choses contradictoires. Et pour cela, il faut faire appel à la métaphore.
2.4. On assiste à une humanisation de l’énigme : d’abord le dieu inspire l’oracle qui s’exprime par énigme et le prophète interprète ; puis, le dieu impose une énigme via le Sphinx et l’homme est seul à la résoudre ; enfin, deux hommes luttent pour résoudre une même énigme. On se retrouve avec une lutte humaine pour la connaissance.
3. Le passage de la divination, la folie, l’énigme à la pensée abstraite et discursive se fait par le biais de la dialectique.
3.1. « La dialectique désigne l’art de la discussion, d’une discussion réelle, entre deux personnes vivantesIbid., p. 73-74. », par opposition à une invention littéraire. L’aboutissement de la dialectique serait les Topiques d’Aristote (384-322 av. J.C.), son point culminant Zénon (490-430 av. J.C.) ou Platon (428-348) et son origine Parménide (VIe-milieu du Ve siècle av. J.C.).
Le terrain de la dialectique est l’agonisme, le défi : quelqu’un met un autre au défi de lui répondre. Souvent, l’interrogateur propose une question sous forme d’alternative, le répondant en choisi une, c’est la thèse. Le questionneur le travaille pour démontrer que cette thèse est fausse. Tout l’enjeu repose dans la séquence des réponses qui aboutissent à une contradiction avec la thèse de départ. La force vient de l’aspect interne : on part d’une thèse et on la décortique pour aboutir à une proposition qui la contredit.
3.2. Il y a affinité entre l’énigme s’humanisant et la dialectique par le moyen terme de l’agonisme : dans les deux cas, des personnes s’affrontent sur le terrain de la parole et de l’intellect.
3.3. En fait, l’énigme est à l’origine de la dialectique. Énigme = problema, obstacle, épreuve, défi. Or, problema signifie aussi chez Aristote « formulation d’une recherche », recherche de la question dialectique de départ. « L’énigme est l’intrusion de l’activité hostile du dieu dans la sphère humaine, son défi, de la même manière que la question initiale de l’interrogateur est l’ouverture du défi dialectique, la provocation au combatParménide avait opposé deux « voies » : celle de l’être, selon laquelle l’être est ce qui est, la seule possible à emprunter ; et la voie du non-être ou l’être n’est pas, qui est rejetée comme chaotique et contradictoire.. » Par ailleurs, les deux (énigme et question dialectique) sont formulées de manière contradictoire.
3.4. « Donc, en Grèce, le mysticisme et le rationalisme ne seraient pas deux choses antithétiques, mais devraient plutôt être compris comme deux phases successives d’un phénomène fondamentalExemples de paradoxes de Zénon : Achille et la tortue : il ne parvient jamais à la rattraper ; la dichotomie : un mobile ne peut parcourir la distance d’un point A à un point C en un temps fini car il doit se rendre en B, moitié de AC, mais aussi en B’, moitié de AB, etc., à l’infini ; la flèche toujours au repos qui ne peut donc pas bouger ; etc. Aristote prétendra les réfuter « par les faits » et Colli y voit un aveu de faiblesse du raisonnement.. » La dialectique intervient quand le monde s’adoucit, que les dieux sont moins cruels et violents envers les hommes. Si le monde est devenu bienveillant, la cruauté, elle, n’est pas disparue : la cruauté directe des dieux est médiée, à distance. Elle devient celle de l’interrogateur (dont Socrate est la figure canonique) qui lentement piège son interlocuteur en dissimulant ses intentions.
4. La dialectique révèle la face profondément destructrice de la raison, qui conduit à s’éloigner des dieux.
4.1. L’interrogateur défait n’importe quelle thèse retenue, aucun jugement ne tient, tout peut être réfuté. Or, tout peut être soumis à la dialectique, elle-même soumise au principe de non-contradiction, ce qui rend potentiellement les gens fous. C’est avec Zénon, le disciple de Parménide qui a transgressé sa loi pour suivre la voie du « il n’est pasGiorgio Colli, op. cit., p. 89-90. », que cette logique est poussée à bout : un nihilisme théorétique dans lequel plus rien n’existe, chaque objet est et n’est pas, voire n’est même pas pensable. Il note que ce nihilisme et les paradoxes de Zénon qui vont avec sont difficilement réfutablesIbid., p. 92..
Ici, la référence est Gorgias et ses trois points : « Le premier, qu’il n’y a rien, le second, que même si quelque chose est, ce quelque chose ne peut être connu par l’homme, le troisième, que même s’il est connaissable, on ne peut le communiquer ou l’expliquer aux autres. » Nihilisme explicite, d’après Colli : « Gorgias est le sage qui déclare la fin de l’époque des sages, de ceux qui avaient permis une communication entre les hommes et les dieuxIbid., p. 98.. »
5. Au Ve siècle av. J.C., on passe de la dialectique à la rhétorique, du privé au public, de l’oral à l’écrit.
5.1. À cette époque, on assiste à une centralisation de la culture à Athènes qui pousse à rompre l’isolement de la dialectique : on passe d’un cadre ésotérique à un cadre public ; d’un dialogue à deux à un discours d’une personne vers plusieurs. La rhétorique est née avant mais se greffe sur la dialectique.
5.2. La rhétorique est aussi agonistique : au lieu de défier un interlocuteur, elle défie la masse de ceux qui l’écoutent pour les convaincre, les retourner. « Dans la dialectique on luttait pour la sagesse ; dans la rhétorique, on lutte pour une sagesse tournée vers la puissanceVoir sur ce point Platon, Phèdre, 275d-e. » c’est-à-dire, la persuasion émotionnelle des auditeurs. Le contenu se fait moins abstrait, plus politique et passionnel.
5.3. La dialectique comme la rhétorique sont fondamentalement orales, mais la rhétorique est liée à l’écriture dès le départ pour une raison technique. Les orateurs écrivaient leurs discours et les apprenaient par cœur, le style était très travaillé. Personne ne répondait à l’orateur, il écrivait seul pour s’adresser à une foule. De ce fait, l’écriture acquiert une forme d’autonomie expressive et certaines œuvres de la dialectique sont écrites.
6. La philosophie est une forme littéraire qui combine dialectique, rhétorique et écriture.
6.1. Platon invente le dialogue comme littérature. Une sorte de dialectique et de rhétorique écrite qui « présente dans un cadre narratif les contenus de discussions imaginaires à un public indifférenciéPlaton, Lettre VII, 342-343, cité par Giorgio Colli, op. cit., p. 100. ». Ce nouveau genre littéraire est appelé philosophie. Il fait oublier les conditions pré-littéraires de la pensée, valides seulement à l’oral.
6.2. Paradoxalement, c’est Platon qui permet de mesurer le mieux le bouleversement, la coupure entre sagesse et philosophie. D’abord parce qu’il parle de philosophie, d’amour de la sagesse, ce qui indique qu’il ne la possède pas, ou plus. Les sages ne sont donc pas des précurseurs balbutiant de la philosophie, mais un site originaire qui a été détourné, trahi. Ensuite, il y a le mythe du Phèdre où Platon n’a pas de mots assez durs pour l’écriture, qui trahit la pensée, la réduit à un mutisme, la défait du dialogueGiorgio Colli, ibid., p. 102.. Enfin, il y a le fameux passage de la Lettre VII dans lequel Platon raconte que Denys II, tyran de Syracuse, avait voulu divulguer par écrit la doctrine secrète de Platon. Ce dernier écrit alors : « Aucun homme de bon sens n’osera confier ses pensées philosophiques aux discours, et qui plus est à des discours immobiles, comme c’est le cas de ceux écrits au moyen des lettres » et « c’est précisément pour cela que tout homme sérieux se garde bien d’écrire des choses sérieuses pour ne pas les exposer à la malveillance et à l’incompréhension des hommesIbid., p. 103. », au point de dire que si quelque chose est par écrit, ce ne peut être si sérieux que ça, sauf si l’homme a perdu tout bon sens ! Ce point est à garder en tête à la lecture de ces lignes.
Cela jette, selon Colli, un doute énorme sur toute la philosophie, qui n’a été longtemps qu’un commentaire des œuvres écrites de Platon. Tout cela n’était peut-être pas si sérieux ?
6.3. Socrate n’a rien écrit. Platon est « dominé par le démon littéraire. Il critique l’écriture, l’art, mais son plus fort instinct a été celui du littéraire et du dramaturgeIbid., p. 104.. » Si on ajoute à cela ses ambitions politiques, étrangères au domaine des sages, on trouve le cocktail qui fait émerger la philosophie.
La philosophie jaillit d’une disposition rhétorique liée à un entraînement dialectique, d’une impulsion agonistique incertaine sur la direction à prendre, du premier signe de fracture intérieure dans l’homme de la pensée, dans lesquels s’insinue l’ambition velléitaire à la puissance mondaine, et enfin d’un talent artistique de grand niveau, tumultueux et outrecuidant, qui s’exprime par des voies détournées dans l’invention d’un nouveau genre littéraireMichel Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, p. 23, disponible sur : https://litterature924853235.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/06/ebook-michel-foucault-l-ordre-du-discours.pdf.
6.4. Le but de la philosophie, c’est justement la paideia, l’éducation, la formation intellectuelle et morale des jeunes Athéniens.
Ainsi naît la philosophie, créature trop composite et médiate pour contenir en elle de nouvelles possibilités de vie ascendante. L’écriture, essentielle à cette naissance, les a éteintes. Et le potentiel émotionnel, à la fois dialectique et rhétorique, qui vibre encore chez Platon, est destiné à se dessécher en un court laps de temps, à se sédimenter et à se cristalliser dans l’esprit systématiqueToutes les citations sont extraites de Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Fayard, Paris, 1982..
Il juge qu’au moment où naît la philosophie, il faut l’abandonner, parce que la sagesse dont elle hérite est plus vitale que la philosophie elle-même.
Ce qui m’interroge, c’est qu’avec Platon naît une philosophie où s’intrique à la fois des aspects révolutionnaires, conservateurs et totalitaires. Révolutionnaires car Platon intervient dans un contexte historique spécifique : la démocratie est en crise et il veut révolutionner les valeurs. Il faut changer de régime politique. L’école de philosophie est la voix par laquelle on forme les futurs dirigeants politiques pour aller vers une république juste ; cette dernière doit permettre de trier les citoyens. C’est donc d’abord une école de cadres et non un cadre de pensée spiritualiste. Sa pensée est conservatrice dans le sens où il s’agit de se fonder sur des valeurs qui existent réellement, sont quelque part, ont une objectivité qui ne se laisse pas défaire par le temps. Enfin, parce qu’il prétend fabriquer, modeler la cité et l’humain avec un paradigme artisanal, sa pensée a pu être qualifiée de totalitaire par quelqu’une comme Hannah Arendt, ayant en tête les totalitarismes du XXe siècle.
Que faire de la réflexion de Colli ? Par rapport à la philosophie, plusieurs options s’offrent à nous :
Si l’on accepte le sens que lui donne Colli, comme nouage de rhétorique, de dialectique, de littérature, de recherche de pouvoir et d’éducation, on peut choisir de rejeter l’héritage de la philosophie. Ne pas prétendre « faire de la philosophie » et encore moins une « école de philosophie » qui reproduirait précisément la figure originaire. On peut également choisir de conserver cet héritage et de le poursuivre. Pour ma part, je ne choisirai pas cette voie.
Si l’on accepte toujours la définition de la philosophie par Colli, on peut abandonner le mot « philosophie » pour celui de « sagesse », en laissant de côté les ambitions politiques pour des ambitions plus spirituelles. Le problème est qu’aujourd’hui le mot « sagesse » paraît peu approprié à ce que nous faisons. Cela pousserait également à se défaire du mot « école », lié plus qu’on ne le croyait à la philosophie. Notre aventure pourrait donc être rebaptisée : un centre de recherches ? Ça reste un peu fade.
Une autre option est de garder le mot « philosophie » tout en le chargeant plus que ne le fait Colli, à la manière de Pierre Hadot. La philosophie n’est plus seulement une forme littéraire associée à une ambition politique mais aussi un mode de vie, une façon d’être, des exercices spirituels.
Dans tous les cas, il me semble important de questionner et de se défaire de l’idée que nous sommes une « école de philosophie ». On peut avoir en tête les quelques idées de Colli exposées ici, ou encore, pour conclure, ces préconisations de Foucault qui invite à « remettre en question notre volonté de vérité ; restituer au discours son caractère d’évènement ; lever enfin la souveraineté du signifiantElisavet Moutzan-Martinengou, Autobiographie. Mémoires d’une recluse, trad. Lucile Arnoux-Farnoux Éditions Cambourakis, Paris, 2022. ».
À quel jeu jouons-nous quand nous parlons philosophie ?
Dans le cadre d’un groupe de travail sur le langage et ses périphéries intitulé l’envers du langage, et afin d’incarner dans le présent le travail effectué sur l’ethos chez Bourdieu, un questionnaire a été réalisé pour tenter de mettre des mots sur des attitudes, et des manières de se sentir dans le langage de la philosophie. À chacun·e d’y répondre, sachant qu’il vaut pour tout milieu possédant ses propres règles de langage. Ce questionnaire a donné lieu à des entretiens filmés et des réponses écrites que nous ne retranscrivons pas ici.
Pierre Bourdieu, langage et pouvoir symbolique (ce que parler veut dire)
Nous nous sommes intéressé·es à ce livre de Bourdieu parce qu’il est au croisement de plusieurs problèmes que nous avions formulés.
Le langage philosophique est-il forcément universitaire et hégémonique ? Peut-on faire de la philosophie, ou parler de façon philosophique, autrement qu’avec ce langage universitaire ?
Pourquoi et comment le langage philosophique exerce-t-il une domination symbolique ? Peut-on désamorcer cet effet, ou est-il intrinsèque à la philosophie ?
Ce qui intéresse Bourdieu, ce sont les rapports de pouvoir qui traversent le langage, ce qui demande à considérer les échanges linguistiques contextuellement et pragmatiquement. Il se détache donc de la linguistique générale qui considère que le langage forme un système de signes que l’on peut considérer en tant que tel, comme un tout et en faisant abstraction du contexte. Bourdieu considère qu’on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans des échanges linguistiques si on les réduit à de simples échanges de sens par le moyen de signes, destinés à être déchiffrés au moyen d’un code, que ce code soit une langue ou une culture. On ne peut comprendre ce qui se passe dans les échanges linguistiques qu’en comprenant l’entremêlement entre ce qui est dit, cellui qui le dit, et ce qui permet à cette personne de dire ce qu’iel dit. Ce à quoi procède Bourdieu c’est à l’analyse des relations « entre les propriétés du discours, les propriétés de celui qui les prononce et les propriétés de l’institution qui l’autorise à les prononcer ».
I. L’économie des échanges linguistiques
I.1. Champ et habitus
Dans cette première partie, Bourdieu ne s’intéresse pas spécifiquement au langage philosophique, bien qu’il en vienne à aborder la façon de parler dominante dont certaines caractéristiques ne sont évidemment pas sans lien avec le langage philosophique. Pour prendre les choses simplement, disons que la philosophie peut être considérée comme une pratique parmi d’autres au sein du champ linguistique. Bourdieu appelle champ un monde social doté de ses propres règles. La spécificité est que ces règles sont appropriées par les individus : elles deviennent ainsi des habitudes ancrées dans les corps, ce qui donne aux agent·es de ce champ les moyens de jouer au sein du champ.
Bourdieu appelle habitus cette appropriation des règles d’un champ par un individu. L’habitus désigne le produit d’un apprentissage en tant qu’il est devenu inconscient : une seconde nature, ce qu’on peut appeler une disposition : une aptitude apparemment naturelle, bien que façonnée socialement, à évoluer dans le milieu.
I.2. Une économie des échanges symboliques
L’hypothèse centrale de Bourdieu consiste à considérer que le champ linguistique fonctionne comme un marché. Sur le marché linguistique s’échangent des produits linguistiques socialement caractérisés, dotés d’une certaine valeur sur ce marché. Dans les rapports linguistiques, ce qui s’échange ce n’est pas seulement, et peut-être pas premièrement, des contenus dotés de sens, mais de la reconnaissance. L’échange linguistique entre un·e émetteurice et un·e récepteurice est certes un code à déchiffrer, mais il est aussi et surtout un échange économique destiné à procurer un profit symbolique. Au-delà d’être des signes à comprendre, les discours sont des « signes de richesse destinés à être évalués, appréciés et des signes d’autorité, destinés à être crus et obéisJudith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », trad. Charlotte Nordmann, Éditions Amsterdam, Paris, 2009. ». La communication ne recherche donc pas seulement la maximisation du rendement informatif, mais aussi un profit symbolique, sous la forme de reconnaissance.
D’où la proposition d’une « économie des échanges symboliques ». L’idée d’économie permet de considérer que ces échanges linguistiques sont à perte ou à profit, selon les rapports de pouvoir qui s’y jouent. Les profits et les pertes dépendent de ce qui est dit, et de la façon dont cela est dit, selon le contexte.
I.3. Marché unifié et discours légitime (légitimé) : quel parler s’érige en norme d’un autre
Ce qui circule sur le marché linguistique, ce n’est pas la langue, mais des façons de parler, des discours stylistiquement caractérisés. S’il n’existe pas « la langue », le marché linguistique est néanmoins unifié, au sens où il existe bel et bien un discours considéré comme légitime. Cette langue étant une sorte de discours officiel, distingué, ou universitaire – non sans lien avec le discours philosophique. Ce discours légitime est tout à fait théorique au sens où personne ne parle vraiment « la langue théorique à laquelle toutes les pratiques linguistiques sont objectivement mesurées ». À la façon d’un marché économique qui serait indexé sur l’or, c’est ce « discours légitime » qui constitue l’étalon de valeur du marché linguistique. On attribue une valeur à une pratique linguistique par mesure d’écart à la pratique légitime.
Si cette langue-étalon de valeur est considérée comme « légitime », c’est qu’elle est en fait légitimée par l’État, et notamment par les institutions dotées de force d’imposition et de sanction. Une telle sanction symbolique prend la forme d’un diplôme, par exemple, tel que le délivre une université.
I.4. La domination symbolique
La langue dominante n’exerce pas sa domination par une contrainte consciemment ressentie. C’est le propre de la domination symbolique de se constituer en dehors de la conscience et de la contrainte. Bourdieu prend l’exemple de l’effort de correction des dominé·es pour tendre vers la langue normalisée. Cette forme de violence symbolique amène à être incapable de trouver ses mots – comme si on était soudain dépossédé·e de sa propre langue. Et puis, on se dit que c’est parce qu’on est nul·le : on naturalise la situation en la ramenant à ses propres compétences et en se comparant aux autres indépendamment des champs sociaux.
I.5. Profit de distinction
Pour obtenir, par le biais d’une « sanction symbolique », la reconnaissance recherchée au sein des échanges symboliques, il faut se distinguer. Bourdieu montre que le profit essentiel du marché linguistique, c’est un profit de distinction.
Il est obtenu au sein de chaque échange social à partir de la mobilisation de son capital linguistique, celui-ci permettant de produire des écarts différentiels, « en un mot, de la distinction ».
Le profit de distinction émane de la structure sociale et des relations de domination qui la caractérisent. Pourtant cette dimension disparaît pour se fondre dans les qualités de la personne. Seule l’approche sociologique peut faire comprendre les conditions « dans lesquelles un agent singulier peut se trouver investi et, avec lui sa parole, d’une telle force ».
I.6. À mesure que l’on s’éloigne des marchés officiels
La langue légitime ne s’impose pas de la même façon dans toutes les circonstances. Les profits des échanges linguistiques sont d’autant plus favorables aux détenteurices de la compétence légitime sur les marchés où la langue légitime s’impose. À mesure que l’on s’éloigne des marchés officiels, la « loi de formation des prix » peut devenir plus favorable aux « produits des habitus dominés ». Dans la sphère plus familière, les « dominé·es » peuvent échanger et produire des discours non sanctionnés par les processus de distinction et d’attribution de valeur.
Pourtant, iels demeureront toujours « virtuellement justiciables de la loi officielle », sous le coup de la légitimité linguistique, et « même s’ils passent toute leur vie, à la façon du voleur dont parle Weber, hors de son ressort et que, placés en situation officielle, ils sont voués au silence ou au discours détraqué ».
I.7. Acceptabilité du discours selon les différents marchés
Qu’il s’agisse d’un échange entre ami·es, d’un discours officiel ou d’un exposé de philosophie, chacun·e choisit sa façon de parler selon les lois du marché. Les lois du marché et leur connaissance déterminent toutes les modifications stratégiques du discours, qu’il s’agisse de la correction d’une prononciation ou de production de phrases plus simples syntaxiquement.
Ce que l’on appelle le tact : l’art de prendre acte de la position relative de l’émetteurice et du·de la récepteurice dans la hiérarchie des capitaux.
I.8. Habitus linguistique et hexis corporelle
L’hexis corporelle désigne la façon dont l’habitus informe jusqu’ à notre corps. La philosophie comme pratique de langage apparaît ainsi aussi comme une technique du corps.
L’habitus se traduit par une « stylisation de la vie » visible dans la manière de parler – mais aussi de s’habiller ou de manger. Le refus des « manières » ou des « chichis », c’est-à-dire de la stylisation, dans les classes populaires peut être compris comme le refus d’être dominé·e. Opposées aux postures physiques tendues caricaturales des petit·es-bourgeois·es (« bouche fine », « bouche en cul-de-poule »), les utilisations de la « gueule » sont au contraire associées aux dispositions populaires (et viriles), de même que le « relâchement de la tension articulatoire » avec l’élision de la dernière consonne en fin de phrase. D’un côté, la correction du langage, censurant les propos « gras », les plaisanteries « lourdes » et la domestication du corps, et de l’autre, le corps soumis à ses appétits et le « relâchement de la tension articulatoire ». Ces correspondances entre corps, langage et position sociale sont autant d’habitus, c’est-à-dire de règles incorporées soustraites « pour une part aux prises de la conscience et de la volonté ».
À quoi sert tout ça ? À analyser des discours en contexte, avec les rapports de pouvoir qu’ils impliquent. Deux exemples en ce sens, mobilisés par Bourdieu, nous ont particulièrement parlé. Procédant par l’analyse en contexte des discours avec les rapports de pouvoir qu’ils impliquent, ils exemplifient aussi le geste caractéristique de Bourdieu dans le livre ici présenté.
Premièrement, les « stratégies de condescendance ». Bourdieu prend l’exemple d’un maire béarnais qui prononce une allocution officielle dans le patois béarnais. S’il le peut, c’est bien parce que, maire d’une grande ville, de surcroît professeur agrégé, il possède tous les titres garantissant sa maîtrise de la langue « supérieure ». Qui plus est, il est loué pour ce geste, et s’il est loué pour ce geste, c’est parce qu’il nie symboliquement la hiérarchie. Mais il la nie symboliquement seulement, car il l’incarne ! De même, la personne diplômée en philosophie peut se tenir de façon nonchalante, parler de façon relâchée… C’est le top de la distinction. La stratégie de condescendance consiste à nier le rapport de forces entre les langues, tout en tirant le maximum de profit de ce rapport de forces. Seul·e un·e locuteur·ice reconnu·e dans sa position hiérarchique peut utiliser pareille stratégie, afin que cette reconnaissance et la négation symbolique de sa position lui permettent de cumuler les profits.
Deuxième exemple : Bourdieu décrit l’hyper-correction typique des régions intermédiaires de l’espace social, soit celles et ceux qui veulent en être mais ne le sont pas tout à fait. Cette hyper-correction est due au fait que la distribution de la reconnaissance de la langue légitime est beaucoup plus uniformément partagée que celle de la connaissance de cette langue. L’écart entre l’aspiration à parler la langue légitime et les moyens de satisfaire cette aspiration est maximale dans la petite-bourgeoisie, caractérisée par sa bonne volonté culturelle. Cet écart entre connaissance et reconnaissance est la tragédie de cette classe. Les petit·es-bourgeois·es sont à la fois les plus conscient·es de la vérité objective de leurs produits (telle que définie dans l’hypothèse savante d’un marché unifié) et les plus acharné·es à la refuser. Le plus terrible, c’est que les classes supérieures ne vont pas cesser de continuer à se distinguer à mesure que la petite-bourgeoisie s’approprie ses normes.
II. Analyses de discours
Qu’est-ce qui donne sa valeur à un discours, et plus particulièrement au discours philosophique ? Selon Bourdieu, l’excellence linguistique tient en deux mots : correction et distinction. En réalité, l’une ne va pas sans l’autre : pour opposer l’« ordinaire » au « distingué », la langue légitime doit faire l’objet d’un travail incessant de correction (on peut dire de mise en forme), qui fait naître la mesure d’écart, donc la valeur.
La valeur d’un produit linguistique s’articule selon deux axes : distingué/vulgaire (ou rare/commun), et tendu/relâché (ou soutenu/libre).
Bourdieu s’amuse ici à analyser un type de discours philosophique : celui du commentaire de ponte, prenant pour base un texte d’Étienne Balibar commentant Marx.
· Détente dans la tension Le principe consiste à mettre de la tension là où le commun cède au relâchement, et de la facilité là où le commun trahit l’effort. La détente dans la tension : voilà le principe de tous les traits distinctifs du mode d’expression dominant. Ainsi, « une articulation nonchalante est une des manières les plus universellement attestées de marquer la distinction. » Lacan qui grommelle devant son amphithéâtre plein.
· Distance neutralisante C’est la capacité à « tenir ses distances à l’égard de ses propres propos, donc de ses propres intérêts, et du même coup à l’égard de ceux qui, ne sachant pas tenir cette distance, se laissent emporter par leurs propos, s’abandonnent sans retenue ni censure à la pulsion expressive ou au franc-parler. »
Faire de la philosophie, c’est dire – et c’est une forme de distance neutralisante – : arrêtez les échanges sur le marché linguistique, je vais analyser ce qui s’y passe, ou bien faire bouger certaines significations.
· Rhétorique de la fausse coupure La philosophie et la science empruntent les mots de la langue ordinaire mais ne les utilisent pas comme tels. Elles semblent les révéler en les anoblissant par leur transformation en mots « techniques ». Cette mise en forme aboutit à l’illusion d’une « coupure entre le langage spécialisé et le langage ordinaire » et de l’autonomie de la langue savante. Ainsi, seul·es les initié·es comprendront… Cette mise en forme procède en fait par distinction, chaque mot du discours philosophique marquant la coupure ontologique d’avec le sens ordinaire. Par exemple, Balibar donne d’abord les significations habituelles du mot « préoccupation » avant d’avancer : « En opposition à ces significations préscientifiques et ontiques, le présent travail en use comme d’un terme ontologique (existentiel) qui caractérise l’être d’un être-au-monde possible. » Une telle coupure « tranchée entre le savoir sacré et le savoir profane » garantit au corps de spécialistes le monopole de la langue spéciale. De même que les médecins utilisent des mots compliqués pour désigner des maladies pour lesquelles nous avons des mots simples, les philosophes s’approprient des mots simples pour leur donner une densité conceptuelle cachée. Dans les deux cas, un telle coupure maintient la distance avec les profanes.
Bourdieu s’attache ensuite à caractériser « le discours d’importance ». Il s’appuie, avec une flopée de citations à l’appui, sur un texte d’Étienne Balibar, procédant à un commentaire de Marx. Bourdieu s’attache à prendre le langage non pour ce qu’il dit, mais pour ce qu’il fait.
Il remarque que le discours d’importance est marqué par des signes d’emphase, mais aussi d’humilité (il cite des expressions paradoxales du type : « limités mais importants »). Le discours a pour fonction principale de signifier l’importance de cellui qui le tient. L’enjeu est d’acquérir un double profit, celui de l’identification au·à la prophète et celui de la distinction (lae prophète étant l’auteurice commenté·e, ici Marx). Bourdieu décrit comment Balibar s’évertue à corriger le discours, y compris celui du « prophète », dans le but d’en chasser toute faute théorique (par exemple : « cette généralisation est le lieu d’un grave malentendu »). Il remarque aussi le ton de l’évidence qui accompagne le discours magistral : « il est clair que », « il ne fait pas de doute ».
Voilà de quoi s’amuser à regarder ce que l’on fait en parlant, et parlant philosophiquement. Qui fait tel geste ? Qui adopte quel ton ? Qui, dans son ton, dans ses gestes, suppose quoi ? demande quoi ? Que veulent dire les prises de parole au-delà de leur contenu linguistique ?
Par exemple, que fait quelqu’un·e qui dit « je ne comprends pas » ? Est-ce qu’iel dit : je suis largué·e ? Est-ce qu’iel dit : je comprends que je ne comprends pas quelque chose, comprenant ce que je ne comprends pas ? Ou est-ce qu’iel dit : il y a une contradiction, ce que tu dis est impossible donc incompréhensible ?
Règles d’énonciation pour une machine philosophique
Un jour cependant, comme j’avais un peu de temps, je pris un livre et me mis à lire. Le soir, en rentrant, mon père regarda l’endroit où nous avions l’habitude de suspendre une cage dans laquelle se trouvait un canari et me dit : « Pourquoi, au lieu de donner l’ordre que l’on rentre la cage et qu’on l’accroche à sa place, as-tu laissé ce malheureux oiseau exposé au froid ? » Comme je lui répondais que j’avais oublié, je l’entendis dire à ma mère que les lettres me brouillaient la cervelle et me rendaient négligente. Ces paroles n’étaient ni injurieuses ni méprisantes. Elles étaient insignifiantes, mais moi qui aimais tant apprendre, il m’était insupportable d’entendre que cela puisse avoir des effets pernicieux, de sorte que j’en eus le cœur transpercé. Il me sembla alors que toute imperfection morale ou matérielle que l’on relèverait chez moi, si petite fût-elle, serait toujours attribuée à l’instructionNous n’utilisons pas l’écriture inclusive dans cette partie car les protagonistes en sont seulement des hommes. Ce point fait l’objet d’une réflexion dans la suite du texte.. En d’autres termes, il n’est pas vrai qu’une « position subjective » préexiste à l’énonciation qu’elle occasionne, car certains types d’énonciations démantèlent les « positions subjectives » mêmes par lesquelles elles sont apparemment rendues possiblesPlaton, Gorgias, 497a-497c, trad. Monique Canto-Sperber, Flammarion, Paris, 1987, p. 245-246..
Ce texte vise à fournir quelques matériaux théoriques pour comprendre ce qui se joue dans la pratique collective de la discussion philosophique et pour commencer à élaborer des façons de la transformer qui permettraient peut-être de surmonter quelques blocages récurrents qui s’imposent à nous – la surdétermination sociale des positions discursives, le sentiment d’illégitimité de certain·es, la limitation de la pensée à un usage spécifique du langage, pour n’en citer que quelques-uns.
On s’est donné comme tâche de rendre la pensée praticable à toutes et à tous, c’est-à-dire de rendre la philosophie, sa technicité, ses textes, son pouvoir, appropriables. Pour le faire, on a fait comme d’habitude, comme on a contracté l’habitude de le faire : on a répété les méthodes scolaires, celles qu’on a apprises, celles qui nous ont formaté·es. Il ne s’agit pas de s’en accuser. Pas plus qu’il ne s’agirait de les remettre en cause soudain et naïvement, alors que c’est précisément l’attitude que nous avons cherché à éviter depuis le début. Cela n’aurait aucun sens d’abandonner la rigueur analytique et argumentative, la précision conceptuelle, la puissance synthétique ou l’habileté interprétative. Il s’agit plutôt d’essayer de comprendre pourquoi le partage collectif de ces modes de penser s’avère insuffisant, pourquoi l’espace alternatif qu’on a ouvert semble se refermer sur les mêmes impasses que les champs institutionnels qu’on a fuis, pourquoi une entreprise collective qui a tenté de rendre la philosophie aussi modeste qu’une tâche ménagère et aussi conviviale qu’une partie de foot reconduit ou recrée de la violence symbolique, de l’exclusion et de la frustration, pourquoi enfin tout le monde ne se sert pas des matériaux philosophiques mis à disposition comme d’une boîte à outils.
C’est précisément cette naïveté qu’il s’agit de déconstruire. Il y a sans doute beaucoup de façons de le faire, mais celle qui a été retenue passe par une réflexion sur le langage. Plus précisément sur la philosophie comme langage ou, pour le dire autrement, sur ce qu’il faut pour pouvoir parler comme il faut parler pour pouvoir faire de la philosophie. Pendant des années on a fait l’hypothèse que la philosophie était une pratique ou une technique comme les autres, qu’elle pouvait s’apprendre aussi simplement – non pas facilement – que les autres, sans qu’on en fasse tout un drame, sans que cela nous plonge dans de grands tourments, sans qu’on en sorte avec moins de confiance qu’on en avait en commençant. Il faut croire que cette hypothèse n’est pas bonne. Premièrement parce que la philosophie est une pratique mentale et discursive qui suppose de beaucoup parler, beaucoup lire et beaucoup écrire. Or on sait, même si on ne sait pas bien pourquoi, que quand ça touche au langage, ça ne nous laisse pas tranquilles. Comme si ça touchait à quelque chose de fondamental ou d’essentiel. Deuxièmement parce que le langage ça ne s’apprend pas comme une suite de mots. Ça se vit, ça parle en nous, ça vit à l’intérieur et à l’extérieur de nous. On est pris dedans et il faut donc savoir s’y prendre.
Si apprendre la philosophie c’est apprendre à parler un certain langage, si faire de la philosophie c’est proférer un certain type de discours, alors il faut se demander tout ce qu’implique cet acte de langage ou cette pratique discursive. Non pas pour le critiquer, mais pour arrêter de n’en considérer que la part obvie – et surtout pour le prendre par le bon bout. Se réapproprier la philosophie comme praxis, c’est non seulement s’exercer à sa technique discursive, mais aussi mettre en place les conditions pratiques, matérielles, vitales, pour pouvoir s’adonner à la pensée. En linguistique, le concept qui fait pivot entre le corps et le langage, c’est l’énonciation. Voici donc une nouvelle hypothèse : il faut reconditionner l’énonciation.
Le propos s’organise en cinq points : (1) on commence par interroger la façon dont Platon met en scène ses dialogues pour mettre en évidence l’importance des conditions d’énonciation de la philosophie, (2) pour tenter de comprendre, en suivant Foucault, en quel sens la pensée moderne a occulté ces conditions d’énonciation et a prétendu faire de la philosophie une capacité subjective innée, (3) ce qui amène à déconstruire le sujet pensant en le réinscrivant dans ce que Deleuze et Guattari appellent un « agencement collectif d’énonciation », qui est l’ensemble de ses conditions de possibilité concrètes, (4) on montre alors, en reformulant un argument de Woolf, qu’une des conditions principales de l’émergence du sujet pensant est l’exclusion du féminin au profit du masculin, (5) pour tenter d’envisager comment cette exclusion peut être évitée si l’on modifie dans une perspective féministe les règles de ce que Wittgenstein nommerait le « jeu de langage » de la philosophie. Le fil rouge de cette réflexion est l’idée selon laquelle la philosophie ne doit pas être envisagée seulement à partir de ses énoncés, mais aussi au niveau de son énonciation – niveau auquel se décide ce qu’elle rend possible et ce qu’elle rend impossible.
Dans tout le texte il est question des « femmes » et du « féminin », par opposition aux « hommes » et au « masculin », car c’est à cette binarité que nous nous attachons, mais l’intention n’est pas de naturaliser cette catégorie et l’opération d’exclusion qu’on cherche à repérer participe aussi à la production du sujet sexisé « femme » en tant que telle – au détriment d’autres minorités de genre, dont il faudrait aussi interroger la position dans l’ordre du discours philosophique. Le sexisme n’est cependant pas la seule forme de domination qui s’exerce dans le champ philosophique ou par son intermédiaire, mais il est celle qui nous est la plus familière et sur laquelle notre expérience nous a donné le plus de prise. C’est donc par lui que nous tentons d’ouvrir une brèche dans l’énonciation philosophique.
La mise en scène
La lecture d’un dialogue de Platon procure toujours un sentiment très ambivalent. D’un côté, on s’agace de la théâtralité poussive et des effets de mise en scène artificiels, qui semblent parasiter le propos. De l’autre, on se rend compte que le contenu doctrinal est assez maigre et que l’intérêt philosophique du texte porte bien plutôt sur la forme, c’est-à-dire sur la progression du dialogue. Pourquoi les dialogues platoniciens ressemblent-ils à de longs monologues de Socrate, ponctués par les acquiescements niais de ses interlocuteursRené Descartes, Discours de la méthode, Première partie, Vrin, Paris, 2005, p. 44. – oui Socrate, c’est vrai Socrate, tu as raison Socrate ? N’aurait-on pu éviter toutes ces fioritures pseudo-dramatiques et aller directement au propos ? Si c’est vraiment le dialogue en tant que dialogue qui compte, pourquoi est-il aussi unilatéral ? Depuis vingt-cinq siècles, tout le monde se demande probablement si Socrate ne prend pas le jeune esclave du Ménon pour un demeuré, si Platon ne nous prend pas un peu pour des con·nes et si toute cette histoire de maïeutique – Socrate faisant accoucher ses interlocuteurs d’une vérité qu’ils portent en eux – n’est pas une vaste arnaque !
Comment donc interpréter cette hyper-théâtralité philosophique ? Il faut simplement se rappeler que le texte platonicien constitue l’origine de la philosophie. Là s’invente une forme de pensée et un régime de discours pour la première fois. Il en va donc un peu comme de ces vieux films dans lesquels on a expérimenté pour la première fois tel type de plan, tel montage, tel mouvement de caméra et où tout paraît encore très artificiel et un peu forcé. Quelque chose s’invente, donc, mais quoi donc ? Là où cela se voit le mieux, s’observe dans sa plus grande étrangeté ou sa plus grande rugosité, c’est là où cela résiste. C’est-à-dire quand Socrate se heurte à de fortes réticences et qu’il est obligé de redoubler d’explications, de précautions, de stratégies. Par exemple dans le Gorgias.
La discussion a lieu dans la maison de Calliclès, où le grand sophiste Gorgias vient de faire un discours. Socrate et son ami Chéréphon sont arrivés trop tard pour l’entendre. On va donc poursuivre autrement la discussion, sous la forme d’un examen dialectique, c’est-à-dire d’un dialogue. Comme Gorgias a déjà beaucoup parlé, la discussion s’engage entre Chéréphon et Polos, un autre rhéteur, admirateur de Gorgias. Socrate, comme d’habitude, s’introduit dans la conversation au bout de cinq minutes pour casser les pieds. Il se trouve que Polos ne respecte pas la règle du jeu, il ne répond pas bien aux questions : il fait de la rhétorique au lieu de dialoguer. Il est donc exclu de la discussion, en même temps que Socrate prend insensiblement la place de Chéréphon et se met à interroger Gorgias.
Ce que Platon appelle dialogue ou dialectique (en grec, c’est un verbe à l’infinitif, dialegesthai) se distingue donc du discours rhétoriquement construit. Il s’agit d’un dispositif de question-réponse dans lequel on est tenu de répondre de façon directe et concise aux questions. Ce qui ne laisse la place à aucun développement, à aucune nuance, à aucun doute. C’est tout le contraire d’un discours, dans lequel la parole peut prendre de la place et du temps, s’organiser et se structurer, ou même divaguer et se perdre. Cela demande une attitude linguistique très peu naturelle. Il faut donc constamment rappeler les participants aux règles.
On pourrait croire cependant que certaines réponses exigent de longs discours puisque certaines questions n’admettent pas de réponses simples. À commencer par les questions philosophiques. Il y a donc quelque chose d’agaçant dans l’injonction à répondre directement et brièvement, l’impression d’avoir à donner une forme certaine et définitive à quelque chose qu’on ne sait pas vraiment et qu’on ne dit qu’ à moitié – comme dans les questionnaires de magazines. Pourtant c’est dans cette forme qu’est née la philosophie. Il faut questionner des évidences, encore et encore, faire vaciller les certitudes, demander à l’autre de répéter ce qu’il a déjà dit, lui reposer la même question, à un autre moment, pour voir si la réponse est toujours valable, si elle n’a pas changé, s’il est encore possible d’affirmer ce qu’on pensait être vrai avant. C’est que le dialogue avance, il a son développement et sa cohérence propres. Chaque question n’est pas isolée, elle n’appelle pas une réponse définitive et unique. Ce n’est toutefois pas à celui qui répond de détailler les choses et d’entrer dans des considérations subtiles – on se garde de toute rhétorique – mais c’est le dialogue qui produira éventuellement les variations nécessaires. Car c’est une entreprise collective. Les personnes ne sont pas face à face dans une joute ou un agone, mais progressent ensemble dans un questionnement. À un certain point, le dispositif produit une abolition des positions personnelles, des points de vue et des opinions, pour énoncer des vérités, c’est-à-dire, minimalement, des énoncés que les partenaires du dialogue s’accordent à tenir, compte tenu de ce qui a été dit et élucidé ensemble.
Un peu plus loin dans le dialogue, un autre participant, Calliclès, s’en prend à Socrate, dont il ne supporte plus la façon de faire :
– Calliclès : Je ne sais pas quels tours de sophistes tu es en train de faire, Socrate !
– Socrate : Tu le sais très bien, mais tu fais l’imbécile, Calliclès. Bon, avançons encore un peu. Allons de l’avant !
– Calliclès : Qu’est-ce que tu as ? Pourquoi t’obstines-tu à parler pour rien ?
– Socrate : C’est pour que tu saches combien tu es savant, toi qui me reprends ! Donc n’est-ce pas au même moment que chacun de nous cesse à la fois d’avoir soif et de prendre plaisir à boire ?
– Calliclès : Je ne sais pas ce que tu veux dire.
– Gorgias : Ne fais pas cela, Calliclès ! Réponds plutôt. C’est notre intérêt que tu sers, si nous voulons que cette discussion se poursuive jusqu’ à son terme.
– Calliclès : Mais, Gorgias, Socrate est toujours pareil : il pose et repose des petites questions, qui ne valent pas grand-chose, puis il se met à réfuter.
– Gorgias : Mais qu’est-ce que cela peut te faire ? De toute façon, Calliclès, ce n’est pas à toi d’estimer ce que valent les questions de Socrate. Allons, laisse-le réfuter comme il veut.
– Calliclès : Vas-y, pose tes petites questions, tes questions de rien du tout, puisque Gorgias est de cet avisMichel Foucault, « À propos de la généalogie de l’éthique : un aperçu du travail en cours », dans Dits et écrits, II, Gallimard, Paris, 2017, p. 1449..
Calliclès ne veut plus répondre et accuse Socrate de jouer avec le langage comme un sophiste : de parler pour ne rien dire, de poser des questions sans valeur et sans intérêt pour pouvoir d’autant mieux réfuter ensuite son interlocuteur. Par exemple, demander si c’est au même moment que l’on cesse d’avoir soif et de prendre plaisir à boire ! Prise hors du contexte ou du fil de la discussion, cette question paraît en effet n’avoir aucun sens. C’est précisément la situation dans laquelle Calliclès se retrouve : il ne comprend plus comment la discussion en est arrivée à ce point et où veut en venir Socrate, mais il pressent qu’ à la faveur d’une de ses réponses, il va être réfuté par ce dernier. Cette coupure brusque de la discussion donne à ressentir ce sentiment d’incompréhension et le caractère absurde du dialogue. En réponse, Socrate accuse Calliclès de faire l’idiot, de faire semblant de ne pas comprendre, de faire preuve de mauvaise foi. Pour peu que le courant ne passe plus et que les deux discutants ne s’entendent plus, l’interrogateur devient un sophiste et le répondant un idiot. Le dispositif ne peut marcher que si les participants acceptent et suivent les règles. Il y a une asymétrie entre les positions, en ce que seul l’interrogateur choisit les questions auxquelles le répondant est tenu de simplement répondre.
Peut-on en conclure que le répondant n’a qu’un rôle de figuration, qui consiste, à la limite, à simplement approuver ce que dit l’interrogateur ? C’est ce qui semble, si l’on se représente le dialogue comme un échange linguistique entre des personnes partageant leurs idées, mais le « dialogue » dont il est question ici n’est pas une conversation de ce genre, mais plutôt un dispositif dialectique, c’est-à-dire précisément un jeu de question-réponse dont le but est de tester la consistance des énoncés de départ et dont la règle principale est la distribution asymétrique des positions discursives. L’interrogateur ne dit pas ce qu’il pense, il pousse à la limite ce que le répondant affirme. Pour faire cela, le répondant doit renoncer à la maîtrise de son propre discours, accepter de soumettre ses énoncés au questionnement. L’interrogateur, de son côté, ne peut rien affirmer, mais il doit sans cesse solliciter la réponse du répondant, sous la forme d’une approbation ou d’un refus de ce qu’il soumet à titre de question. Asymétrie donc, mais pour opérer un double abandon des positions de maîtrise du discours.
Par-delà la caricature du dispositif dialogique, ce que montre le Gorgias, c’est que le dialogue peut rater, que son bon déroulement ne va pas de soi, que sa tenue suppose beaucoup de conditions. Il faut donc essayer de comprendre le rôle des conditions et la raison de l’échec.
La discussion philosophique n’adopte pas une stratégie de persuasion. C’est précisément pour cela qu’elle ne se satisfait jamais simplement de paroles. C’est une expérience qui touche aux positions et aux dispositions mêmes de ceux qui y prennent part – bien qu’elle se déroule presque intégralement dans le champ du discours. C’est pour cela aussi sans doute que Platon a écrit des dialogues et non pas des traités. C’est pour cela encore, en tout cas telle est l’hypothèse, qu’il multiplie les effets de mise en scène. Tout dialogue suppose une situation, une scène, un dispositif. Ce n’est pas un simple échange d’idées et de paroles, c’est une procédure collective, une expérience partagée. Peu importe qu’elle ne soit pas partagée à égalité ou de la même façon par tous ceux qui y participent – il est probable qu’ à l’issue d’un dialogue, Socrate garde une longueur d’avance sur son interlocuteur ou que ce dernier ait compris autre chose que ce que Socrate avait en tête exactement – ce qui compte, c’est que tout le monde y soit également impliqué. Il s’agit de bouger selon des lignes communes, même si chacun bouge d’une façon un peu différente. L’attention ne se porte donc jamais uniquement sur ce qui est dit, mais aussi sur l’ensemble des conditions qui permettent que cela soit dit. Si le dialogue n’est pas une conversation de comptoir ou de salon, où l’on viendrait dire ce qu’on a à dire ou ce qu’on a envie de dire, mais où l’on essaie de dégager une entente commune, alors il faut établir une procédure et des règles pour pouvoir dialoguer. Des règles de langage et de discours, en un sens plus général que la logique ou la grammaire. Il s’agit d’instituer les conditions du dialogue, aussi bien matériellement que pratiquement et que discursivement. C’est-à-dire se trouver dans un lieu adéquat, au bon moment et avec les bonnes personnes, qu’elles soient bien disposées, à savoir, qu’elles ne soient pas fatiguées, mais aussi désireuses de parler et d’écouter, surtout de discuter selon le protocole adopté, car la discussion ne peut pas prendre n’importe quelle forme. Philosopher suppose tout cela. C’est pourquoi les dialogues sont toujours aussi des mises en scène – tout à la fois théâtre de la parole, jeu de rôles et méthode du discours. Le langage philosophique élaboré par Platon tient autant à la forme logique de ses énoncés qu’aux conditions pragmatiques de son énonciation.
Le sujet de la pensée
Que la vie pratique constitue une part essentielle de la philosophie dans la pensée antique, Foucault l’a mis en évidence, dans le sillage des travaux de Pierre Hadot. La philosophie constitue avant tout une forme de vie, un mode de subjectivation, un travail de soi sur soi et un rapport à l’autre. L’attention aux conditions d’énonciation dont font preuve les dialogues platoniciens s’inscrit pleinement dans cette perspective existentielle et ascétique. Relire les analyses de Foucault à la lumière de la question du langage permet toutefois de mettre en lumière un aspect de la modernité sur lequel ce dernier n’insiste pas : l’occultation par la philosophie de ses propres conditions d’énonciation.
En effet, le Discours de la méthode de Descartes marque l’apparition dans l’histoire d’un sujet – le cogito – naturellement capable de vérité – « le bon sens est la chose du monde la mieux partagéeVoir Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, Paris, 1995, p. 114-122. » – à qui il incombe seulement de se doter des moyens adéquats d’y parvenir – la méthode. C’est dans l’exercice solitaire et méthodique de la méditation – et non plus dans le jeu réglé du dialogue avec autrui – que le sujet cartésien rencontre la vérité. Cependant, Foucault n’interprète pas l’invention moderne du sujet comme un surgissement historique, mais comme une modification du rapport que le sujet entretient avec sa pensée.
S’il est vrai que la philosophie grecque a fondé une rationalité dans laquelle nous nous reconnaissons, elle soutenait toujours qu’un sujet ne pouvait pas avoir accès à la vérité à moins de réaliser d’abord sur lui un certain travail qui le rendrait susceptible de connaître la vérité. Le lien entre l’accès à la vérité et le travail d’élaboration de soi par soi est essentiel dans la pensée ancienne et dans la pensée esthétique.
Je pense que Descartes a rompu avec cela en disant : « Pour accéder à la vérité, il suffit que je sois n’importe quel sujet capable de voir ce qui est évident. » L’évidence est substituée à l’ascèse au point de jonction entre le rapport à soi et le rapport aux autres, le rapport au monde. Le rapport à soi n’a plus besoin d’être ascétique pour être un rapport avec la vérité. Il suffit que le rapport à soi me révèle la vérité évidente de ce que je vois pour appréhender définitivement cette véritéMichel Foucault, op cit., p. 1449..
La rationalité grecque – la philosophie – ne conçoit pas l’accès à la vérité par la pensée sans un travail sur soi. Il faut se rendre capable de vérité avant de pouvoir prétendre penser, savoir, connaître. Il faut en quelque sorte se subjectiver afin de devenir un sujet pensant ou connaissant. Or cette subjectivation n’est pas théorique, mais éthique et ascétique. Elle passe par une modification de soi pratique et existentielle, par la production en soi de dispositions propres à l’exercice de la réflexion et à l’appréhension ou l’accueil de la vérité. Selon Pierre Hadot, les règles du dialogue philosophique constituent moins une méthode scientifique qu’une ascèse pratiqueRené Descartes, op. cit., p. 58..
À l’opposé de cela, le sujet promu par Descartes est immédiatement, essentiellement capable de vérité. Si la vérité n’est que l’évidence de ce qui se voit bien, alors le sujet n’a pas besoin de se transformer pour y accéder, mais simplement d’être au plus près de lui-même, de ce qui lui apparaît comme absolument évident. Le sujet est directement sa pensée. Il est transparent à la vérité. Il lui suffit de cultiver cette transparence. Comme le dit Foucault, l’évidence se substitue à l’ascèse. Certes, il y a une méthode, mais celle-ci est strictement scientifique. Elle n’appelle aucune mobilisation existentielle, aucun rapport ascétique de soi à soi, aucune transformation subjective. Elle est simplement une procédure logique d’ordonnancement et d’exposition des contenus de pensée. Le sujet est donné et avec lui les conditions de la vérité : la méthode ne sert qu’ à bien appliquer l’esprit à ses propres contenus.
La pensée s’organise dans un système à trois termes : une métaphysique du sujet, une épistémologie de l’évidence et une formalisation de la méthode. Il serait cependant erroné de croire que la dimension éthico-ascétique de cette pensée a complètement disparu. Foucault ne manque pas de le rappeler :
Mais il faut remarquer que cela n’a été possible pour Descartes lui-même qu’au prix d’une démarche qui a été celle des Méditations, au cours de laquelle il a constitué un rapport de soi à soi le qualifiant comme pouvant être sujet de connaissance vraie sous la forme de l’évidence (sous réserve qu’il excluait la possibilité d’être fou). Un accès à la vérité sans condition « ascétique », sans un certain travail de soi sur soi, est une idée qui était plus ou moins exclue par les cultures précédentes. Avec Descartes, l’évidence immédiate est suffisanteRené Descartes, Méditations métaphysiques, Première méditation, PUF, Paris, 1956 (2004), p. 27..
La première est la constitution d’un certain type de rapport à soi qualifiant le sujet comme sujet de connaissance. C’est-à-dire un certain mode de subjectivation. Le Discours de la méthode comporte une dimension autobiographique explicite et avant d’exposer les principes de la méthode, Descartes raconte les étapes de sa vie qui l’y ont mené. Il a quitté le monde de l’étude et des livres pour voyager, découvrir le monde, faire la guerre, avant de se retrouver, vers le milieu de la guerre de Trente Ans, désœuvré et solitaire, dans des conditions matérielles et existentielles propres à la méditation – « enfermé seul dans un poêleVoir Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris, 1972. ». Les Méditations métaphysiques sont parsemées d’indications sur les conditions d’énonciation qui recréent l’ambiance dans laquelle Descartes se livre à ses réflexions – comme autant d’effets de mise en scène de soi. Le philosophe est « assis auprès du feu, vêtu d’une robe de chambre, ayant ce papier entre les mainsRené Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., p. 28. ». Ce ne sont pas des détails, mais presque un ensemble d’instructions pour la méditation philosophique.
La deuxième condition de la pensée est l’exclusion de la folie. Si le sujet peut accéder par lui-même à la certitude et à l’évidence de la vérité, c’est parce qu’il n’est pas fou. Dans l’Histoire de la folie, Foucault met en parallèle le rejet cartésien de la folie avec la grande entreprise d’internement des fou·lles qui a commencé au XVIIe siècle en EuropeEmmanuel Kant, Critique de la raison pure, Analytique transcendantale, livre I, ch. 2, §16, trad. Jules Barni, Gallimard, Paris, 1980, p. 159.. On ne comprend pas la radicalité de l’exclusion de la folie par la raison philosophique sans la mettre en regard de l’exclusion sociale des fou·lles par la pratique de l’internement. Il ne s’agit ici ni d’établir une causalité ni de simplement juxtaposer des évènements, mais de rassembler un certain type de discours philosophique et une certaine pratique administrative et policière dans un même champ de rationalité. Au détour d’une phrase – « Mais quoi ? Ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs exemples » – Descartes fait passer une « ligne de partage » entre la raison et la folieVoir Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Fayard, Paris, 1983 (repris dans Langage et pouvoir symbolique, Seuil, Paris, 2001) et Supra, « Pierre Bourdieu, langage et pouvoir symbolique », p. 33.. Comme l’a montré Foucault, celle-ci vient de plus loin que son texte – des léproseries et des maladreries désaffectées – et se prolonge ailleurs – dans la création de l’Hôpital général à Paris en 1656, dans lequel ont été systématiquement interné·es les mendiant·es, les vagabond·es et les prostitué·es. Ainsi, l’évidence avec laquelle Descartes peut présupposer, sans même vraiment avoir à l’affirmer ni à l’argumenter, que la pensée n’a rien à voir avec la déraison et qu’elle lui est étanche, c’est la pratique généralisée de l’internement qui l’a diffusée.
Foucault ne dit donc pas tout à fait que le sujet moderne ne procède pas d’un travail pratique de subjectivation, mais que cette ascèse n’appartient plus à l’essence de la pensée comme telle. Le sujet cartésien dépend bien des conditions matérielles qui le produisent, ou du moins le rendent possible, mais il s’en détache presque complètement dans l’exercice de la pensée, comme vidé de toute sa teneur éthique et existentielle. On pourrait dire que Descartes n’invente pas tant le sujet pensant, qu’il le coupe virtuellement de ses conditions de subjectivation. C’est-à-dire aussi de ses conditions d’énonciation.
La constitution du sujet moderne pourrait donc être envisagée comme une dissimulation progressive par le sujet lui-même de ses propres conditions de possibilité. L’aboutissement de ce processus, la formation d’un pur sujet de la connaissance, c’est dans le sujet transcendantal de Kant qu’on le trouvera, un siècle plus tard. En effet, les deux conditions recherchées par Descartes se trouvent parfaitement remplies chez Kant : la pensée relève intégralement d’un sujet connaissant et il n’y entre aucun élément éthique. De Descartes, il récupère le « je pense », mais il l’expurge de toute substantialité. « Le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations » – c’est toutVoir Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1995 (1916).. Le « je pense » se réduit à une pure fonction, que Kant qualifie de « transcendantale ». Afin que la multiplicité et la diversité des perceptions sensibles qui composent mon expérience puissent composer une expérience, il faut d’une part qu’elle soit ordonnée et d’autre part qu’elle soit mienne – sans quoi elle serait plus chaotique qu’un tableau de Monet, un texte de Joyce ou un film de Vertov. Or, le principe ultime d’unification et d’ordonnancement de l’expérience est le « je pense ». C’est ce que Kant appelle le « sujet transcendantal ». Pour bien comprendre le pas franchi par Kant, il faut se rappeler que chez Descartes, le « je pense » était l’aboutissement d’une expérience réelle, d’une méditation : il apparaissait comme ce qui résiste à l’épreuve du doute radical, comme ce sur quoi peut se fonder la certitude. Or, là où Descartes parlait encore d’une expérience subjective, Kant pose le sujet en-deçà de toute expérience possible, en en faisant la condition formelle a priori de cette expérience elle-même. Le « je pense » devient le principe abstrait d’unification de l’expérience en un sujet ou une conscience – ce qui en fait une expérience et son expérience. Voilà le rapport au monde rendu possible par un sujet hors-sol et l’objectivité même du réel conditionnée par un fantôme. Peut-être faudrait-il avancer que ce n’est qu’en devenant lui-même la condition de l’expérience que le sujet peut s’en abstraire aussi radicalement. Comme si, en devenant transcendantale, la pensée avait avalé, digéré et intégré ses propres conditions empiriques de possibilité.
Quel est le sens de cette inversion ? Plutôt que de voir dans la Modernité l’aboutissement d’un processus initié dans l’Antiquité – l’émergence de la subjectivité – on pourrait considérer, en suivant Foucault, l’histoire de la pensée comme l’histoire de la façon dont s’organise et se représente l’activité de penser. Cela permettrait de comprendre que la pensée n’est pas coupée de la vie, mais qu’elle acquiert, comme toute activité spécifique, à partir de conditions données, une certaine autonomie et qu’elle déploie un mode de fonctionnement propre en produisant un certain type d’agents et de contenus. La forme de la pensée dépend donc de tout un ensemble de conditions sans pour autant que son être ne s’y réduise complètement. L’objet d’une telle histoire serait donc la praxis de la pensée envisagée à partir des conditions dont elle dépend, des relations qu’elle implique, des opérations qu’elle rend possibles, des modes d’individuation qu’elle engage, des représentations qu’elle charrie, etc. Ce que ferait apparaître une telle histoire de la pensée, c’est que le moment transcendantal de la philosophie ne constitue pas un point d’aboutissement, mais une scansion singulière. C’est le point de déconnexion absolue entre la pensée et ses conditions pratiques – le sujet pensant devenu condition formelle de l’expérience. Comment rendre compte historiquement, matériellement, de cette déconnexion ? Quelles sont les conditions matérielles de possibilité d’un tel régime de subjectivation de la pensée ? Où se situe l’élément éthico-pratique qui lui correspond ?
À bien y regarder, faire une histoire à la Foucault des modes de subjectivation et des régimes discursifs empruntés par la pensée philosophique ne fait que reconduire la démarche transcendantale – c’est-à-dire la recherche des conditions de possibilité. Ce qui intéresse en effet une telle approche est la mise au jour des conditions de la pensée, sous tel ou tel mode singulier. C’est un transcendantal ou un a priori historique qu’on tente donc de mettre en évidence. Cette remarque permet qu’on envisage le sujet transcendantal non pas comme une erreur ou une abstraction idéaliste, qu’il faudrait réduire à ses conditions empiriques d’existence, mais comme une figure historique concrète du rapport entre l’image de la pensée et ses conditions de possibilité. Il s’agirait donc moins de déconstruire le sujet transcendantal que de désubjectiver le transcendantal – pour comprendre ce qui est proprement transcendantal dans le sujet moderne de la pensée, c’est-à-dire ce qui constitue les conditions réelles d’une telle subjectivation absolue.
Esquissons une hypothèse. Si le sujet moderne est capable de penser hors de toutes conditions d’énonciation concrètes, c’est qu’il porte en lui-même l’ensemble de ces conditions. Le je pense n’est plus l’énoncé d’une vérité – « je pense » – mais la condition de toute vérité énonçable possible. Autrement dit, ce qui était un énoncé est devenu une condition d’énonciation. Le sujet ne se subjective plus dans l’expérience linguistique concrète de l’énonciation du « je pense », mais il s’identifie a priori à un je pense qui vaut comme condition de toute expression possible. Or, on peut remarquer que la condition d’énonciation a la forme même de l’énoncé. Qu’est-ce qui permet de distinguer le « je pense » du je pense ? En un sens, rien. Ce qui permet de préciser l’hypothèse : le transcendantal du sujet moderne, c’est la structure linguistique en tant qu’elle est instanciée et intériorisée sous la forme d’une rationalité abstraite. Le sujet transcendantal est un sujet parlant – mais il a oublié ce que parler voulait direÉmile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation », Problèmes de linguistique générale, 2, Gallimard, Paris, p. 80..
Les conditions d’énonciation
Comment le sujet intériorise-t-il le langage ? Par la parole. Sans parole, la langue resterait lettre morte. Ce ne serait qu’un code ou une structure abstraite. La parole, telle que la définit Saussure dans le Cours de linguistique générale, est la mise en œuvre concrète et singulière de la langue par des locuteurs et des locutrices à des fins de communication et d’expressionIbid., p. 83.. C’est toutefois dans l’ordre unitaire de la langue que s’inscrit chaque parole particulière. Autrement dit, on ne trouve dans la parole que de la langue. On ne voit donc pas où dans le langage pourrait se loger la singularité. C’est ce que le concept d’énonciation, élaboré par Benveniste, essaie de faire apparaître.
Celui-ci se définit comme la « mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation », sans toutefois se réduire à la paroleBashō, L’Intégrale des haïkus, 273, trad. Makoto Kemmoku, Dominique Chipot, Points, Paris, 2021, p. 135.. En effet, entre la structure linguistique (langue) et l’énoncé particulier (parole) se trouve l’acte d’énonciation. C’est un acte, une réalité pratique, qui n’est cependant pas extérieure au langage. Car l’énonciation s’indique dans les énoncés de façon formelle, notamment dans ce qu’on appelle en linguistique des déictiques ou des shifters – je, tu, ceci, ici, etc. Pour que la langue devienne parole, il faut que quelqu’un·e la parle. L’énonciation n’est donc pas un accident qui survient de l’extérieur au langage, mais une de ses possibilités les plus intimes et presque sa plus stricte nécessité. Le langage, ça parle et cette possibilité y est inscrite en creux dans ces termes en apparence anodins – je, ici, maintenant.
Les formes appelées traditionnellement « pronoms personnels », « démonstratifs » nous apparaissent maintenant comme une classe d’« individus linguistiques », de formes qui renvoient toujours et seulement à des « individus », qu’il s’agisse de personnes, de moments, de lieux, par opposition aux termes nominaux qui renvoient toujours et seulement à des concepts. Or le statut de ces « individus linguistiques » tient au fait qu’ils naissent d’une énonciation, qu’ils sont produits par cet événement individuel et, si l’on peut dire, « semel-natif ». Ils sont engendrés à nouveau chaque fois qu’une énonciation est proférée, et chaque fois ils désignent à neufRené Descartes, Méditations métaphysiques, op. cit., p. 38..
Les marqueurs énonciatifs ne sont pas des termes comme les autres. Ils n’ont pas vraiment de signification lexicale ou conceptuelle. Le mot « je » n’a pas une signification, au sens où le mot « arbre » en a une : celui-ci renvoie à l’idée générale de l’arbre, alors que celui-là signifie simplement « l’instance d’énonciation de ce discours ». Il ne renvoie pas tant à l’individu qui parle qu’ à la seule instance énonciative. De fait, quand l’actrice dit « je », ce n’est pas elle qui parle, mais son personnage. À la limite « je » veut seulement dire « l’instance qui dit je ». La signification générale du pronom je n’en est pas vraiment une, elle n’est pas sémantique mais métalinguistique, au sens où elle renseigne simplement sur le mode de fonctionnement du mot. Autrement dit, le pronom je renvoie à une fonction ou à un usage.
C’est ce que Benveniste appelle un « individu linguistique ». Un tel individu n’est pas nécessairement une personne, cela peut être aussi un moment ou un lieu. Ce qui est appelé ici individu est avant tout l’effet d’une individuation qui passe par le langage, par l’énonciation. En prenant parole, je existe comme instance d’énonciation de ce discours ici et maintenant. Ces termes, encore une fois, ne renvoient pas à des concepts mais au procès d’individuation qui se réalise dans l’énonciation. À la limite, ils renvoient à un évènement de parole ou à une individuation qui est évènementielle plus que substantielle. Benveniste qualifie de tels individus de « semel-natifs », ce qui signifie qu’ils naissent à chaque fois qu’une énonciation a lieu, à chaque fois nouveaux et pour une seule et unique fois (semel en latin signifie « une seule fois »). Comme dans le fleuve d’Héraclite, dans lequel on ne se baigne jamais deux fois, on ne dit jamais deux fois le même « je ». L’énonciation est donc une forme d’individuation linguistique évènementielle et non pas structurelle. Un peu comme dans un haïku :
De quoi parle ce haïku ? De la première neige. Bashō la regarde-t-il tomber depuis son ermitage ou s’est-il simplement mis à l’abri ? Le bonheur est-il celui de voir la neige tomber ou d’y échapper ou les deux en même temps ? On ne sait pas. Le sujet qui l’énonce ne s’indique dans le poème qu’en disant « je suis ici ». Je ne suis que cette parole qui ici maintenant parle de la neige. Le sujet de l’énonciation – je – se confond presque avec le sujet de l’énoncé – la première neige. Alors la parole peut presque s’évanouir dans un instant cosmique, dans la douceur de la neige qui tombe un 31 janvier 1687. À ceci près que pour pouvoir parler, pour pouvoir le dire, il fallait un ermitage.
L’expérience cartésienne du cogito témoigne aussi, un demi-siècle plus tôt, de cette évanescence de l’individuation dans l’énonciation. Dans les Méditations métaphysiques, Descartes s’aperçoit que la proposition « je suis, j’existe, est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon espritIbid., p. 260. ». Le cogito, l’expérience du « je pense », ne prouve rien – sinon que quand je pense, je pense et que donc je suis cet acte de penser et que l’énoncé « je suis, j’existe » n’est vrai que pour autant et aussi longtemps que je le prononce, à voix haute ou dans ma tête. En latin, dans cogito, il n’y a même pas un « je » qui pense, il n’y a qu’un verbe, un acte, un évènement de pensée. On pourrait dire qu’il s’agit là d’un énoncé performatif, au sens où il ne fait pas référence à quelque chose d’extérieur à lui-même, mais fait exister ce dont il parle en en parlant au moment où il en parle – il faudrait essayer d’entendre « je pense » comme « je promets » ou « je m’excuse ». Le cogito est une performance. Le sujet cartésien n’a pas plus d’épaisseur dans le cogito que le poète qui évoque la neige n’en a dans le haïku. En ce sens, le cogito ne constitue pas l’acte de naissance du sujet, mais l’invention de l’énonciation. Avant que le philosophe trouve d’autres moyens pour donner un peu de substance à cette chose pensante, elle n’est qu’un acte d’énonciation, un individu linguistique, un fantôme qui hante le langage. On se rappellera seulement que pour Descartes, comme pour Bashō, il fallait aussi qu’il y ait un poêle, où se trouver pour pouvoir dire ce que l’on dit.
L’énonciation est donc l’acte par lequel un sujet s’approprie la langue en s’y individuant linguistiquement. De façon paradigmatique, cela consiste à dire « je ». Benveniste va jusqu’ à dire que le langage est « le fondement de la subjectivité » ou « la possibilité de la subjectivitéIbid., p. 260. ». Ce n’est qu’en disant « je » que l’être humain se constitue comme un sujet, c’est-à-dire comme « l’unité psychique qui transcende la totalité des expériences vécues qu’elle assembleCécile Canut, Langue, Anamosa, Paris, 2021, p. 15-16. ». On reconnaîtra là sans peine quelque chose qui ressemble fort au sujet transcendantal kantien. Or, si la subjectivité n’est que « l’émergence dans l’être d’une propriété fondamentale du langage », alors il apparaît que le transcendantal du sujet n’est rien d’autre que le langageVoir Cécile Canut, Provincialiser la langue. Langage et colonialisme, Amsterdam, Paris, 2021..
Il y a toutefois une difficulté : comment un sujet qui ne s’individue que dans ce qu’il dit, pourrait-il se l’approprier ? Quand je dis « je », je ne devient pas moi, car ce moi auquel je renvoie ne s’est construit qu’ à force de dire « je » dans une langue qui n’était pas la mienne, qui ne m’est pas propre, qui est une réalité sociale. On voit mal comment la subjectivation ou l’individuation linguistique pourrait constituer sans reste un acte d’appropriation. Il y a toujours quelque chose qui m’échappe dans la langue que je parle. Il y a donc quelque chose de fondamentalement manqué dans l’énonciation : l’acte par lequel on s’approprie la langue s’avère être une forme d’aliénation au langage. Le sujet parlant est assujetti à la parole. Plus précisément, le sujet ne s’individue dans sa parole que pour autant qu’en parlant il s’aliène à la langue. Car l’évènement de l’individuation dans l’énonciation dépend d’une structure linguistique sociale. Le drame de la parole – de la prise de parole – tient à cette tension irrésolue au sein du langage entre appropriation et aliénation. Parler est l’expérience heureuse ou malheureuse par laquelle on réussit plus ou moins bien – et plus souvent mal que bien – à se faire exister dans le langage.
L’expérience de la parole, ou plutôt la représentation qu’on se fait de cette expérience, est donc celle d’un face-à-face entre le sujet et le langage. Il y aurait d’un côté un sujet capable de parler et de l’autre une langue disponible à l’utilisation. Il suffirait donc de bien s’en servir pour pouvoir y exprimer sa pensée. C’est pourquoi la question de la maîtrise de la langue devient si cruciale. Celui ou celle qui ne maîtrise pas la langue sera dominé·e par celle-ci, sera parlé·e par elle plus qu’il ou elle ne la parle. Comme le montre Cécile Canut, cette question est profondément politique :
C’est ce que j’appelle un ordre-de-la-langue, lequel est d’abord appliqué à l’école avant d’être institué politiquement comme critère de domination. Cette mise en ordre passe par l’exercice de la prescription (ce qu’il faut dire) et de la coercition (ce qu’il ne faut pas dire) et, au-delà, promeut l’idée selon laquelle le langage est de bout en bout recueilli dans le modèle de la langue.
Tout entière administrée par l’institution qui en définit les possibles, la mise en ordre de la langue entraîne sa dissociation d’avec l’acte de parler […]. C’est ce qui fait que si la langue peut magnifier et réjouir, ou produire des œuvres, elle peut également blesser et détruire : elle ne cesse, en tout cas, de contraindre la parole au motif d’en canaliser les excèsGilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980, p. 101..
Ce que la linguistique, depuis Saussure, appelle la langue, en tant que structure sociale ou que code linguistique partagé, est renommée « ordre-de-la-langue », dans la mesure où elle est le résultat d’une mise en ordre de la langue. Elle n’est pas une réalité naturelle, mais précisément sociale, c’est-à-dire politique et institutionnelle. On n’apprend pas à parler comme on apprend à marcher – le parallélisme est trompeur. Pour apprendre à parler, on passe par l’école, la grammaire, les règles, le·a maître·sse, les évaluations, les corrections, les punitions, les récompenses – la prescription et la coercition. C’est donc l’activité de mise en ordre de la langue qui la sépare de l’usage concret et quotidien de la parole, pour l’ériger en norme de tout discours et en instrument de domination – par exemple la langue de la métropole enseignée et imposée dans les coloniesVirginia Woolf, Mrs Dalloway, trad. Marie-Claire Pasquier, Gallimard, Paris, 1994 (2020), p. 61.. Face à l’ordre-de-la-langue, l’énonciation revêt donc un enjeu socio-politique : prendre parole revient à se mesurer à une norme linguistique, à se situer sur une échelle sociale, à s’inclure dans ou à s’exclure de l’ordre dominant. Parler, prendre part à une discussion, essayer de s’exprimer, sont autant d’actes en apparence banals qui peuvent cependant blesser ou détruire.
Le face-à-face entre le sujet et le langage est donc un rapport social. Le drame de la subjectivation linguistique – de l’énonciation – a donc des coordonnées sociales précises. Il ne s’agit pas d’une dialectique abstraite entre le particulier et le général, mais d’un rapport concret entre un individu qui parle et les conditions dans lesquelles il lui est donné de parler. L’individu est une réalité sociale au même titre que la langue. Il faut donc penser l’énonciation – et l’individuation qu’elle opère – comme un processus collectif. C’est ce que tentent de faire Deleuze et Guattari au moyen du concept d’agencement collectif d’énonciation.
Il n’y a pas d’énonciation individuelle, ni même de sujet d’énonciation. […] Le caractère social de l’énonciation n’est intrinsèquement fondé que si l’on arrive à montrer comment l’énonciation renvoie par elle-même à des agencements collectifs. Alors on voit bien qu’il n’y a d’individuation de l’énoncé, et de subjectivation de l’énonciation, que dans la mesure où l’agencement collectif impersonnel l’exige et le détermine. C’est précisément la valeur exemplaire du discours indirect, et surtout du discours indirect « libre » : il n’y a pas de contours distinctifs nets, il n’y a pas d’abord insertion d’énoncés différemment individués, ni emboîtement de sujets d’énonciation divers, mais un agencement collectif qui va déterminer comme sa conséquence les procès relatifs de subjectivation, les assignations d’individualité et leurs distributions mouvantes dans le discoursVoir Melvin J. Friedman, Stream of Consciousness: a Study in Literary Method, Yale University Press, New Haven, 1955 ; Dora Zhang, « Stream of Consciousness », dans Anne E. Fernald (dir.), The Oxford Handbook of Virginia Woolf, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 133-148. Le terme provient de William James (voir The Principles of Psychology, Henry Holt and Company, New York, 1890) et a été utilisé dans le domaine de la critique littéraire par May Sinclair (voir « The Novels of Dorothy Richardson », dans The Egoist, vol. 5, no 4, Londres, 1918, p. 57-59)..
La forme linguistique qui permet de comprendre l’idée d’agencement collectif est le discours indirect libre. Il peut être défini comme un mélange de discours indirect (Descartes dit qu’il pense) et de discours direct (« je pense »), au sens où un discours direct se fond dans un discours indirect sans y être indiqué d’aucune façon. C’est ce qu’on trouve de façon exemplaire au début du roman de Virginia Woolf, Mrs Dalloway.
Mrs Dalloway dit qu’elle se chargerait d’acheter les fleurs. Car Lucy avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leurs gonds ; les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway : toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plageGilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977 (1996), p. 60..
La première phrase est au discours indirect, la dernière phrase au discours direct, mais dans les deux phrases du milieu, la pensée de Clarissa Dalloway fait irruption dans le récit sans aucun filtre et se confond de façon indémêlable avec la voix neutre de la narration, au point qu’on ne sait pas exactement qui parle. À bien y regarder, ce ne sont pas le discours direct et le discours indirect qui déterminent ce qu’est le discours indirect libre, mais bien l’inverse. En effet, l’incise de la dernière phrase (« pensa Clarissa Dalloway ») apparaît comme une tentative de rattraper le cours de la pensée (le stream of consciousness dont parlent les critiques littéraires), mais elle montre que nous étions dans la tête de Clarissa Dalloway avant même de le savoirGilles Deleuze, Félix Guattari, op. cit. p. 133. Sur l’homme comme sujet universel, voir Donna Haraway, « Savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », dans Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, trad. Oristelle Bonis, J. Chambon, Paris, 2009.. Dès les premières phrases, donc, tout est brouillé, les niveaux de discours et les plans d’énonciation. L’écriture de Woolf ne forme pas un emboîtement rigoureux de points de vue, d’instances d’énonciation, de temporalités, etc., mais tout est emporté dans un mouvement de va-et-vient où tout se confond potentiellement. Aussi le discours indirect libre est-il exemplaire de l’agencement collectif d’énonciation comme machine qui précède et opère les distributions, les subjectivations, les individuations linguistiques. De même que dans le texte de Woolf, la narration ne porte pas l’ensemble des voix, des discours, des pensées des personnages en vertu d’une quelconque neutralité, mais se mêle à celles-ci indistinctement dans une écriture polyphonique, de même, l’agencement ne constitue pas une instance de niveau supérieur qui ordonnerait des énonciations individuelles, mais l’emboîtement virtuel de tous ces plans.
Il n’y a donc pas de sujet d’énonciation, car l’énonciation relève toujours d’un processus collectif – c’est cela que signifie « agencement collectif d’énonciation ». Parler ne résulte jamais du rapport entre un sujet et une langue, mais d’un acte de parole qui se produit à partir d’un ensemble de conditions d’énonciation linguistiques et extra-linguistiques.
Il ne s’agit pas tant de dire que ce n’est pas moi qui parle quand je parle, que de comprendre que parler n’est pas une affaire strictement individuelle, mais l’inscription d’un processus d’individuation dans une machine collective et sociale. C’est bien moi qui parle – c’est la dimension de la parole – même si je parle dans le langage de l’autre – c’est la dimension de la langue. Cette représentation reste toutefois fallacieuse dans la mesure où elle présuppose un sujet individuel isolé et une langue abstraitement définie. Or, même l’élève qui apprend la langue en récitant sa leçon de grammaire dépend d’un agencement collectif d’énonciation – le dispositif de l’école, par exemple. Le ou la même élève apprendra à parler autrement dans la cour de récréation, avec d’autres mots et à d’autres fins – dans un agencement de type bande, par exemple. C’est bien le même sujet qui parle dans les deux cas, si l’on veut, mais l’énonciation n’est jamais son seul fait. Il n’y a d’énonciation que collective.
On peut alors établir deux choses à propos du sujet transcendantal moderne. Premièrement, qu’il a intériorisé le langage comme condition de possibilité de sa propre subjectivité. Deuxièmement, que le langage qu’il a intériorisé ne constitue pas une structure abstraite, mais une réalité sociale concrète. Il faut donc tenter de rendre compte, du point de vue de l’agencement collectif d’énonciation, du mode de subjectivation du sujet transcendantal : c’est le sujet qui a intériorisé l’ordre-de-la-langue comme structure a priori et condition de toute parole possible. Ce sujet a bien une existence empirique concrète, c’est, pour le dire vite, avec Deleuze et Guattari, l’« Homme-blanc-mâle-adulte-habitant des villes-parlant une langue standard-européen-hétérosexuel quelconqueVirginia Woolf, Une chambre à soi, trad. Clara Malraux, Éditions Denoël, Paris, 1977 (1992) p. 8. ». Il s’agit là cependant moins d’une forme d’existence précise que d’un type ou d’une norme sociale. « JE est un mot d’ordreIbid., p. 162.. » Se subjectiver dans le langage comme sujet pensant, c’est obéir à cette norme, ou du moins devoir le faire. Or, tout le monde ne le peut pas – par définition.
L’école des femmes savantes
Une prise de parole n’est donc jamais individuelle. Prendre la parole suppose beaucoup plus que la capacité à parler et que la maîtrise de la langue. Cela suppose non seulement de l’assurance, de la confiance, du courage, mais aussi une forme de légitimité, d’autorité ou au moins d’autorisation. Tout le monde ne peut pas parler, tout le monde ne peut pas dire ce qu’il ou elle veut. L’énonciation n’est pas un acte individuel héroïque, mais l’effet d’une construction collective. C’est une possibilité inscrite dans un champ social déterminé, dont l’effectuation a à peu près autant de conditions externes qu’internes et subjectives. L’autre en moi ce n’est pas seulement la langue, mais aussi la parole. De quelles paroles dépend la parole philosophique ?
Invitée en octobre 1928 dans deux collèges de filles de l’université de Cambridge à parler de la question des femmes et du roman, Virginia Woolf énonce la thèse qui a donné le titre de son essai le plus connu : « il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fictionIbid., p. 110-114. ». À la question bête mais récurrente qu’on lui a posée, de savoir pourquoi les femmes n’ont pas écrit de grand chefs-d’œuvre romanesques, du moins pas autant que les hommes, Woolf donne une réponse très simple : parce qu’il leur a manqué les conditions matérielles d’une telle production, parce qu’elles n’ont jamais eu, ou presque, de chambre à soi.
Pourquoi une chambre à soi ? C’est, selon Woolf, la condition minimale de solitude, de calme, d’isolement, d’indépendance, qu’il est nécessaire d’avoir si l’on veut pouvoir écrire un roman – ou tout autre forme d’ouvrage. C’est la possibilité de se couper pendant un temps suffisamment long des tâches ménagères, des devoirs conjugaux, de la vie familiale, de la sphère domestique – pour consacrer son esprit et son énergie à l’écriture, à la production d’un texte ou d’une idée. On s’étonne alors que Jane Austen, qui écrivit aux alentours de 1800, ait pu écrire des chefs-d’œuvre romanesques alors qu’elle n’avait pas de bureau et devait écrire dans le salon commun, en dissimulant son travail à toustes les visiteureuses – cachant son brouillon dès qu’elle entendait grincer les gonds. Dans de telles conditions il n’est pas étonnant qu’elle n’ait pu écrire qu’un certain type de romans, elle qui n’a jamais pu traverser Londres ou déjeuner seule dans un restaurant, elle qui n’a eu comme formation littéraire que l’observation des caractères et l’analyse des émotions – à savoir, de la littérature de salon produite dans un salon. Woolf remarque qu’ à la même époque où les sœurs Brontë – autres figures féminines marquantes de la littérature du XIXe siècle – ont écrit leurs romans, Tolstoï, qui n’a pas vécu dans un prieuré et qui a fréquenté les champs de bataille, écrivait Guerre et paix. On écrit les romans qu’on peut en fonction des vies qu’on mène.
Une chambre à soi – et cinq-cents livres de rente et tout ce que cela signifie en termes d’indépendance matérielle – c’est avant tout un plan d’énonciation, un ensemble de conditions objectives à partir desquelles il est possible pour un sujet – ici, féminin – de prendre parole. « La liberté intellectuelle dépend des choses matériellesIbid., p. 111.. » L’agencement collectif d’énonciation comporte avant tout des conditions matérielles – une chambre à soi pour Woolf, un poêle pour Descartes, un ermitage pour Bashō – mais on aurait tort de l’y réduire. Comme le montre Woolf, les conditions matérielles sont immédiatement aussi des conditions d’énonciation : le salon où écrit Jane Austen se retrouve dans ses romans, de même que le champ de bataille où il a combattu est le décor de ceux de Tolstoï. Non pas par simple imitation de la vie, mais parce que le lieu où l’on prend parole constitue aussi une position dans un champ social et discursif. Le confinement de la parole des femmes à l’espace domestique s’opère aussi au niveau du langage et de la culture.
Ce livre est important, déclare la critique, parce qu’il traite de la guerre. Ce livre est insignifiant parce qu’il traite des sentiments des femmes dans un salon. Une scène sur un champ de bataille est plus importante qu’une scène dans une boutique – partout et d’une façon infiniment plus subtile, la différence des valeurs existe. C’est pourquoi, au début du [.Siecle_Citation]#XIX#e siècle, la structure entière d’un roman était édifiée, lorsqu’il était l’œuvre d’une femme, par un esprit légèrement dévié de la ligne droite et contraint de modifier sa vision propre par déférence envers une autorité extérieure. […] Mais quel que fût l’effet que le découragement et les critiques eurent sur leurs écrits […], critiques et découragement étaient négligeables, comparés aux difficultés auxquelles les femmes devaient faire face […] quand elles en venaient à fixer leurs pensées sur le papier – je veux parler de l’absence de tradition qui pût les soutenir ou de l’existence d’une tradition si courte et si fragmentaire qu’elle était de peu de secours. Car nous, c’est à travers la pensée de nos mères que nous pensons, si nous sommes femmes. […] La première chose, peut-être, qu’une femme trouvait quand elle mettait la main à la plume, c’était que n’existait aucune phrase courante dont elle pût faire usageMichèle Le Dœuff, Cheveux longs, idées courtes. Sexisme, philosophie et culture du viol, Payot & Rivages, Paris, 2025, p. 38. L’article de 1977 (« Cheveux longs, idées courtes », dans Le Doctrinal de sapience, no 3, 1er trimestre, 1977, p. 10-12 et 21-27) se prolonge dans deux ouvrages publiés chacun à dix ans d’intervalle environ : L’étude et le rouet. Des femmes, de la philosophie, etc., Seuil, Paris, 1989 et Le sexe du savoir, Aubier, Paris, 1998..
Le jugement de la critique n’apparaît pas ici comme un élément extérieur de contexte, mais comme la prégnance d’un ensemble de valeurs masculines dans les conditions d’énonciation elles-mêmes, pour un homme comme pour une femme. Les possibilités d’expression sont surdéterminées : il est demandé qu’on parle de la guerre plutôt que des sentiments, il est donc implicitement demandé à une femme qui voudrait écrire qu’elle parle de la guerre quand bien même elle vivrait recluse dans son foyer. L’autorité extérieure – masculine, patriarcale – modifie a priori la vision de l’écrivaine et dévie sa ligne droite. Elle a « modifié ses valeurs par déférence pour l’opinion des autresMichèle Le Dœuff, Cheveux longs, idées courtes. Sexisme, philosophie et culture du viol, op. cit., p. 31-38. ». Tous les romans féminins portent cette « faille ».
Cet a priori innerve non seulement la subjectivité féminine, mais la langue elle-même. Woolf note qu’il n’y a pas, ou presque pas, de tradition linguistique féminine. On demande à une femme, qui pense à travers la pensée de sa mère, qui a été élevée, genrée et subjectivée comme une femme, de parler comme un homme avec le langage des hommes. C’est-à-dire avec leurs mots, leur style, leur allure. La plus grande difficulté à laquelle se heurte l’écriture féminine, c’est donc qu’elle ne peut faire usage d’« aucune phrase courante ». Woolf dira que la différence entre le singe et son modèle est trop grande : l’écart entre l’énonciation et les énoncés est presque insurmontable. Il s’agit ici de parler la parole de l’autre alors que tout ou presque dans l’agencement collectif d’énonciation – expérience vécue, références littéraires, valeurs communes – interdit à la femme d’y accéder.
Virginia Woolf a écrit cela en 1929, à propos du rapport des femmes à la littérature romanesque. On fera remarquer que son constat n’est plus valable aujourd’hui, qu’il existe depuis une solide tradition littéraire féminine, que le propos n’a plus beaucoup de pertinence. On se demandera surtout en quoi cela pourrait éclairer la question du rapport des femmes à la philosophie. Qu’en est-il de ce rapport aujourd’hui ? Michèle Le Dœuff écrivait en 1977 :
Virginia Woolf disait que pour qu’une femme écrive, il lui faut au minimum une chambre à elle et cinq cents livres de rente. Je dirai que, pour qu’une femme philosophe, il faut qu’elle ait une chambre à elle et qu’elle soit placée dans la nécessité de gagner sa vie en philosophant (qu’elle n’ait pas éludé cette possibilité). Il faut aujourd’hui un système de contraintes réelles pour faire contrepoids à un autre système subtil de prohibitions et de découragements. Une femme qui pourrait ne pas s’intégrer aux contraintes universitaires et professionnelles du métier de philosophe aurait de fortes chances d’occuper une place qui est toute prête pour elleSur la minoration de genre par le langage philosophique, voir Luce Irigaray, « Pouvoir du discours, subordination du féminin », dans Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Les Éditions de Minuit, 1977, p. 65-82 ; Gayatri C. Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler ?, trad. Jérôme Vidal, Paris, Amsterdam, 2020 (dans une perspective décoloniale)..
La citation est explicite, la filiation est assumée. La proposition est toutefois légèrement différente : la pratique de la philosophie suppose une indépendance matérielle, sous la forme d’une chambre à soi et non pas d’une rente, mais de la nécessité de gagner un salaire. Pourquoi apporter cette modification à la réponse de Woolf ? Parce que le problème des conditions de possibilité de la philosophie n’est pas seulement matériel, mais aussi symbolique. Cela Woolf l’avait certes remarqué à propos de la littérature, mais une chambre à soi lui semblait une condition à la fois nécessaire et suffisante pour écrire, peut-être parce que cela posait les bases d’une égalité. Pourquoi cela ne suffit-il pas dans le cas de la philosophie ? À bien y regarder, Le Dœuff ne demande rien de plus, mais elle affirme que l’argent doit être gagné – c’est-à-dire que l’activité soit professionnalisée, institutionnalisée, socialisée. Devoir gagner sa vie en philosophant, en effet, c’est se donner les moyens de faire de la philosophie sa forme de vie et donc ne pas se maintenir dans un rapport d’extériorité à la philosophie – c’est-à-dire, pour une femme, dans « une place qui est toute prête pour elle ». Quelle est exactement cette place ?
Le mode singulier du transfert me paraît être d’abord la rançon de la position d’amateur à laquelle ces femmes ont été condamnées. Seul un rapport institutionnel, trouvant place et sens dans un cadre réglé, peut éviter l’hypertrophie du rapport personnel entre maître et disciple. […] À faire de l’histoire mécanique, on pourrait penser que, maintenant que les femmes ont un accès institutionnel à la philosophie, le blocage dans la féminitude transférentielle n’a plus lieu d’être, et que donc il n’existe plus. Tel n’est pas le cas : le risque d’amateurisme et la position particulière qu’il implique, subsistent, la seule différence étant que nos aînées y étaient condamnées et que nous y sommes seulement exposéesPlaton, Phédon, 59e-60b, trad. Léon Robin, Gallimard, Paris, 1950, p. 768..
La position d’amateure risque de maintenir la femme dans une relation transférentielle vis-à-vis d’une figure masculine de savoir. Que l’accès à la philosophie passe par un transfert « érotico-théorique » relève d’un constat banal, c’est la structure même du rapport maître·sse-élève : on éprouve toujours une forme de désir envers la personne qui incarne pour nous le savoir et qui nous y donne accès. Ce transfert est toutefois généralement liquidé, quand l’élève passe en position de maître·sse, le plus souvent par le moyen d’une légitimation institutionnelle (diplôme, concours, etc.). C’est pourquoi la position d’amateur·e est si risquée. Le Dœuff ne considère pas que l’accès institutionnel à la philosophie sans distinction de genre suffise, par sa seule possibilité, à sortir les femmes de cette position – c’est pourquoi il faut le convertir en nécessité. Il faut donc que quelque chose les pousse à s’arracher à la position où elles sont généralement maintenues.
Tout ne se joue cependant pas dans l’institution et celle-ci ne vaut que comme l’indice d’une possibilité de dépassement symbolique du transfert. Or on sait bien qu’une institution peut aussi être sexiste, misogyne, phallocrate. On sait qu’elle peut produire et reproduire du transfert. Il faut donc se demander ce qui dans la philosophie elle-même – jusque dans ses formes institutionnelles – empêche cette conversion et maintient les femmes dans une position de minoritéPlutarque, « Périclès », Les vies parallèles, trad. Anne-Marie Ozanam, Gallimard, Paris, 2001, p. 343..
Ce qui appelle rien moins qu’un détour, ou plutôt un retour à Platon et à ce qui s’est joué dès l’origine dans les dialogues philosophiques. Au dernier jour de sa vie, alors qu’on lui a annoncé qu’il allait devoir boire la ciguë, Socrate entame le dernier entretien avec ses comparses, mais afin d’obtenir un peu de calme pour pouvoir discuter de sujets sérieux, il chasse sa femme en pleurs, qui était venue lui rendre visite dans sa prison.
Or, une fois entrés, nous voilà en présence, non pas seulement de Socrate, qu’on venait de détacher, mais de Xanthippe (tu es au courant, sans doute), qui avait sur elle leur plus jeune enfant et était assise contre son mari. Mais, aussitôt qu’elle nous vit, Xanthippe se mit à prononcer des imprécations et à tenir ces sortes de propos qui sont habituels aux femmes : « Ah ! Socrate, c’est maintenant la dernière fois que tes familiers te parleront et que tu leur parleras ! » Alors Socrate, regardant du côté de Criton : « Qu’on l’emmène à la maison, Criton ! » dit-il. Et, pendant que l’emmenaient quelques-uns des serviteurs de Criton, elle poussait de grands cris en se frappant la têteFrédéric Pagès, Philosopher ou l’art de clouer le bec aux femmes, Mille et une nuits, Paris, 2006, p. 12..
C’est peut-être là, de tous les gestes d’exclusion de Platon, le plus décisif. Plus que les poètes ou les sophistes, il faut chasser les femmes pour pouvoir faire de la philosophie. Quel est le sens de cette exclusion ?
À première vue, le but est clair. Face à la mort, il s’agit d’être digne et sage, on parlera donc de ce que c’est que mourir et de l’immortalité de l’âme plutôt que de se répandre en pleurs. Qu’on fasse sortir les femmes – c’est une affirmation de virilité. Le discours philosophique ne ménage aucune place à la sensiblerie, c’est-à-dire à la sensibilité et aux affects. Cette virilité est constitutive de sa méthode. Pourtant, à bien y regarder, cette lecture n’est pas complètement convaincante. Car le langage philosophique promu par Socrate et Platon n’est précisément pas celui du discours rhétorique, affirmatif, véhément. C’est plutôt une conversation intime, hésitante, aporétique. Socrate et ses interlocuteurs ne rivalisent pas de virilité à coup de grandes assertions et d’idées fortes. Ils dialoguent. Ce n’est alors peut-être pas ce genre de virilité qui est en jeu ici.
De quoi s’agit-il donc ? On suivra l’hypothèse un peu audacieuse que fait Frédéric Pagès dans Philosopher ou l’art de clouer le bec aux femmes : le seul lieu où pouvait se dérouler une conversation de type socratique à Athènes au Ve siècle était une maison close et la seule partenaire susceptible de tenir une telle conversation était une prostituée. En l’occurrence, Socrate est connu pour avoir fréquenté une hétaïre nommée Aspasie, célèbre « pour son intelligence et son sens politiqueCorinne Monnet, « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation », dans Nouvelles Questions Féministes, vol. 19, no 1, 1998, p. 9-34. ».
Le dialogue socratique, ce ton très intime, qui ne part jamais dans l’envolée rhétorique, ni dans l’éloquence d’assemblée, cette conversation à quelques-uns, où se tricotent l’ironie et le sous-entendu, loin de la foule, cette désinvolture de bon aloi qui permet parfois de partir sans même donner la réponse à la question qu’on a mise en débat, relèvent d’une scène philosophique où non seulement une femme a sa place, mais, dans le cas d’Aspasie, la place centraleVirginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit., p. 54..
Qu’Aspasie soit la véritable interlocutrice de Socrate – l’hypothèse n’a pas de fondement historique solide, mais elle a une grande valeur heuristique. Imaginons un instant que ce soit le cas : que cela nous permet-il de comprendre ? On se représente Socrate qui parle et Aspasie qui l’écoute. Elle ne se contente pas de l’écouter, elle le fait parler. C’est probablement elle qui l’a lancé avec une question bien sentie et c’est elle qui le relance à chaque fin de phrase ou de réplique. Elle l’écoute attentivement, comprend ce qu’il dit et a l’intelligence de faire avancer son propos. Elle ne lui coupe pas la parole, elle se contente de hocher la tête pendant qu’il parle, en le regardant fixement, elle acquiesce, elle approuve, ou alors elle s’étonne, mais elle ne contredit jamais, de telle sorte qu’il ne pourrait pas être déstabilisé. Quand il se perd dans son propos, elle le remet sur la voie en l’interrogeant. Ses questions sont pertinentes, efficaces, discrètes. En somme, elle fait de façon intelligente ce que font les interlocuteurs de Socrate ridiculisés par Platon dans les dialogues : elle donne le change.
Or cela n’est pas un point de détail, mais une activité à part entière. Ce que Corinne Monnet appelle, d’un point de vue à la fois linguistique et féministe, un travail interactionnel ou conversationnel. Un tel travail est indispensable au bon déroulement d’une conversation, c’est-à-dire au développement d’un propos. Or, ce travail est en règle générale à la charge des femmes et comme tel il est invisibilisé.
Les femmes fournissent presque la totalité du travail pour qu’un dialogue ait lieu. Obligées de proposer de nombreux sujets auxquels elles doivent ensuite renoncer majoritairement, l’effort des femmes ne se limite pas seulement à se laisser interrompre par les hommes. Elles travaillent au développement du sujet masculin et manifestent une attitude de soutien afin de maintenir l’interaction. Pendant ce temps, les hommes interrompent, imposent leurs sujets, influencent, dominent la conversation. Principalement, ce sont donc les femmes qui produisent les discussions et qui restent pourtant sous le contrôle des hommesGilles Deleuze, Félix Guattari, op. cit., p. 126..
Tel est le rôle des femmes dans le dialogue philosophique – mais telle n’est pas leur place, puisqu’elles n’en ont aucune. Le travail conversationnel est avant tout un travail du sexe – en un sens très large du terme, mais il n’est pas anodin que ce travail ait été initié en philosophie par une hétaïre. Or quel philosophe aurait osé dire que ses pensées les plus brillantes lui avaient été soufflées par une prostituée ? Il a donc fallu effacer le travail féminin à l’origine de la philosophie. De cela aussi, Virginia Woolf en avait eu l’intuition :
Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroirs, elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l’homme deux fois plus grande que nature. […] Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit, son aptitude à la vie s’en trouve diminuéeLudwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. Françoise Dastur, Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud et Élisabeth Rigal, Gallimard, Paris, 2005, §83, p. 73..
C’est un tel miroir que le travail de la conversation tend à l’homme qui parle de philosophie. Combien de femmes faut-il faire taire pour qu’un homme parvienne à formuler une idée ? Voilà la question matérialiste qui fonde la philosophie depuis ses origines. Encore aujourd’hui, il suffit d’observer une discussion intellectuelle en mixité pour se rendre compte que le sujet féminin y joue très souvent le rôle de miroir dont parle Woolf – et dans le miroir, on ne voit donc que le sujet masculin. Le silence féminin fait partie de l’agencement collectif d’énonciation de la philosophie. En ce sens, le silence de la femme est un transcendantal de la parole de l’homme.
Le jeu des règles
Tout le problème est alors de modifier l’agencement collectif d’énonciation. Comment s’y prend-on pour faire cela ? Par quelle voie change-t-on les conditions d’énonciation de notre propre parole ? Quelle est cette opération magique par laquelle une action transforme ses propres conditions de possibilité ? Le problème d’une pragmatique de l’énonciation est, en termes philosophiques, celui d’une reconfiguration empirique du transcendantal.
Refusant la conception selon laquelle une langue consisterait en un ensemble de constantes et d’universaux, par rapport auxquels la parole représenterait la potentialité de variations aléatoires et secondaires, Deleuze et Guattari font la remarque suivante :
On croit parfois que ces variations n’expriment pas le travail ordinaire de la création dans la langue, et restent marginales, réservées aux poètes, aux enfants et aux fous. C’est parce que l’on veut définir la machine abstraite par des constantes, qui ne peuvent dès lors être modifiées que secondairement […]. Mais la machine abstraite de la langue n’est pas universelle ou même générale, elle est singulière ; elle n’est pas actuelle, mais virtuelle-réelle ; elle n’a pas de règles obligatoires ou invariables, mais des règles facultatives qui varient sans cesse avec la variation même, comme dans un jeu où chaque coup porterait sur la règle. D’où la complémentarité des machines abstraites et des agencements d’énonciation, la présence des unes dans les autres. C’est que la machine abstraite est comme le diagramme d’un agencement12 suggestions pratiques destinées aux hommes qui se trouvent dans des espaces féministes..
Ce qui est appelé la « machine abstraite » d’une langue, c’est en quelque sorte son mode de fonctionnement. Ce dernier ne consiste pas en un système de constantes auxquelles seraient soumises les variables de la parole, en un ensemble de règles qui définiraient les usages ou les coups possibles dans l’activité linguistique. Ni la grammaire particulière d’une langue, ni les universaux de la linguistique ne permettent de déterminer le mode de fonctionnement d’un langage. Une langue, ça se parle. Il n’y a pas la langue d’un côté et ses variations accidentelles de l’autre. Il n’y a pas des constantes primaires et des variables secondaires. Un tel modèle abstrait, on l’a vu, est toujours complice ou tributaire d’une opération de pouvoir, d’un ordre-de-la-langue. La variation n’est pas accidentelle, elle est continue, c’est même plutôt elle qui est constante. Elle n’est donc pas l’apanage des poètes·ses, des enfants et des fou·lles. Une langue ne change pas sous l’effet d’accumulation des variations – comme une loi qui devrait s’adapter à des usages qui s’en sont trop écartés – mais elle se définit avant tout par un travail ordinaire de création.
Plutôt que de se figurer une structure universelle de la langue d’une part et des actes individuels de parole d’autre part, on essaiera donc de penser que la machine abstraite est singulière et qu’elle opère au sein d’un agencement d’énonciation collectif. N’importe quel·le locuteur ou locutrice prend la parole dans un contexte historique et social, évènementiel et politique, donné. On n’est jamais seul·e face à la langue. On ne prend pas la parole dans un réservoir linguistique, dans un trésor de la langue, mais on la prend avec ou à d’autres. L’ensemble des possibilités d’expression, ou pour le dire comme Woolf, des phrases courantes dont on peut faire usage – c’est-à-dire aussi bien des mots, des attitudes, des références, etc. – n’est cependant pas déterminé de façon structurelle. Il relève d’une virtualité abstraite, ouverte sur des variations et des mutations possibles, mais singulière et réelle, liée à un état donné de la parole. Autrement dit la machine n’est pas une structure, elle ne cesse jamais de fonctionner, c’est-à-dire de muter.
Si on l’envisage comme un ensemble de règles, il faut préciser que celles-ci ne sont pas obligatoires et invariables, mais facultatives et en état de variation continue. Plus précisément, la machine abstraite définit « un jeu où chaque coup porterait sur la règle ». Quel est ce rapport paradoxal du jeu et de la règle ? Non pas une partition claire entre la généralité des règles et la particularité des coups ou des usages, mais une réversibilité infinie entre les coups et les règles. Le jeu ne se définit donc pas par un ensemble fini de règles, mais par la possibilité infinie que chaque coup rétroagisse sur les règles, redéfinisse ses propres conditions de possibilité. Le langage ne se définit pas par des règles, mais par un jeu entre la règle et l’usage, entre le transcendantal et l’empirique.
Ce n’est rien d’autre, en un sens, que ce que Wittgenstein appelle « jeu de langage » et qu’il décrit avec une très grande économie de concepts en une image saisissante.
L’analogie du langage et du jeu ne nous apporte-t-elle donc pas quelque lumière ? Nous pouvons très bien imaginer des gens qui s’amusent avec un ballon dans un pré. Ils commencent à jouer à différents jeux existants ; il y en a certains qu’ils ne mènent pas à terme, et dans l’intervalle, ils lancent le ballon en l’air au hasard, et pour s’amuser, ils se pourchassent avec le ballon, s’en servent comme d’un projectile, etc.
Il s’agit de comparer le langage à un jeu. Or un jeu ne se définit pas nécessairement par ses règles – au sens où les règles ne déterminent pas par avance et n’épuisent pas toutes les possibilités d’un jeu. Il existe des jeux ou des façons de jouer qui entretiennent un rapport très libre ou très lâche à la règle. Par exemple quand on joue avec un ballon dans un pré. Cela n’a pas de nom, pas de règles prédéfinies, mais cela reste un jeu qui a du sens. Le langage peut être comparé à un tel jeu dans lequel chaque coup peut virtuellement changer la règle. Modifier la règle ne consiste pas nécessairement à établir une grammaire. Celle-ci est immanente à la parole, elle se réécrit sans cesse à mesure que les locuteurs et les locutrices parlent. Elle est une carte plus qu’un code. Les règles du jeu s’inventent et se modifient en cours de route – make up the rules as we go along. Ce qui ne signifie pas seulement qu’elles changent avec le temps, mais aussi qu’elles peuvent être changées – non pas arbitrairement, mais activement. Les règles constituent un outil linguistique d’une grande plasticité. Il existe même un jeu qui consiste à les changer.
C’est à un tel « jeu » que « jouent » les collectifs féministes qui ont su se doter de règles pragmatiques permettant de délimiter des espaces de discussions dans lesquels le sexisme ordinaire de la parole masculine n’aurait plus cours. Ce qui n’enlève rien au sérieux et à la gravité de l’affaire. On aimerait, à partir d’une brochure qui a beaucoup circulé sur internet, en citer quelques-unes, dont le potentiel de transformation des usages linguistiques nous paraît immense, en particulier pour la pratique de la philosophie.
Règle #7 : Si des gens vous traitent de trolls, c’est qu’il y a probablement une bonne raison. Il n’est pas nécessaire d’avoir consciemment l’intention d’être un troll pour agir comme tel. Vous pouvez vous amuser à cœur joie à jouer l’avocat du diable, éteindre ensuite votre ordinateur et ne plus jamais avoir à vivre avec ces enjeux. Nous ne le pouvons pas. Il s’agit de nos réalités et nous n’apprécions généralement pas que des hommes traitent des enjeux qui nous affectent sérieusement comme s’il ne s’agissait que de simples exercices intellectuels.
Règle #8 : N’essayez pas de jouer au Chevalier Servant. Vous pensez que vous pouvez « sauver » le féminisme grâce à votre analyse pénétrante ? Revenez-en. Il est extrêmement peu probable que vous ayez reçu, grâce à l’« intelligence supérieure de votre organe », une brillante révélation qui aurait échappé aux femmes depuis des siècles.[…]
Règle #11 : Ce n’est pas parce que vous vous qualifiez de féministe que vous êtes exempts de ces suggestions. Il est merveilleux que vous connaissiez des théories féministes. Vous voulez vous engager dans cette noble lutte – excellent ! ! Ceci ne vous donne toutefois pas le droit de vous lancer en ignorant ces suggestions parce que vous auriez « compris » et feriez partie de la « bonne gangDans cette perspective, voir Catherine Malabou, Changer de différence. Le féminin et la question philosophique, Galilée, Paris, 2009 ; Vinciane Despret, Isabelle Stengers, Les faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ?, La Découverte, Paris, 2011 ; Judith Butler, « L’“Autre” de la philosophie peut-il prendre la parole ? », Défaire le genre, trad. Maxime Cervulle, Amsterdam, Paris, 2016, p. 320-344. ».
La première chose frappante, c’est que ces règles de discussion ne sont pas grammaticales ou lexicales, mais pragmatiques : elles portent sur les conditions d’énonciation elles-mêmes. Elles encouragent ou proscrivent non pas des mots ou des expressions, mais des attitudes particulières, des façons de se rapporter à la discussion (écouter) ou au contenu de la parole des autres (comprendre les enjeux) ou à la sienne propre (ne pas se tenir à distance de ce que l’on dit). Elles visent à produire une manière de parler qui ne se réduit pas à l’usage d’un certain type de vocabulaire, d’un certain registre de langue ou d’une certaine catégorie d’énoncés ou de références, mais qui engage une disposition ou une attitude particulière, qui met en jeu la relation même entre le sujet parlant et sa parole, entre les locuteurs et les locutrices. Ces règles promeuvent donc un nouveau type d’agencement collectif d’énonciation.
Or – c’est la seconde chose que l’on peut remarquer – la critique féministe ne vise pas simplement à déconstruire l’habitus linguistique du macho ordinaire. En effet, nombre de traits de comportement dénoncés par ces règles appartiennent au jeu de langage de la philosophie elle-même. Garder une distance affective par rapport à ce que l’on dit et s’y rapporter uniquement sur le plan intellectuel, passer au crible de la réflexion et de la théorie les maximes pratiques et les énoncés politiques, supposer que détenir la vérité au point de vue théorique constitue une condition nécessaire et suffisante pour être du bon côté sur le plan pratique – autant d’axiomes plus ou moins implicites qui régissent l’exercice courant de la philosophie. À les lire dans leur forme épurée et abstraite, on ne voit pas nécessairement en quoi ils peuvent poser problème. C’est seulement du point de vue féministe, à partir d’une situation d’énonciation singulière et différente, qu’on perçoit leur dimension sexiste et genrée. Il apparaît alors que la philosophie est une sorte de mansplaining méthodique – ou qu’elle en est la caution idéologiqueFernand Oury, « Institutions : de quoi parlons-nous ? », dans Institutions, no 34, mars 2004 (1980)..
On ne saurait dire a priori comment de telles règles doivent être interprétées philosophiquement ou appliquées au discours philosophique. Elles n’ont pas été spécifiquement pensées pour cela. Il apparaît pourtant qu’elles pourraient fournir les principes suivants :
À première vue, ils paraissent prendre le contre-pied de la philosophie elle-même. On aura tôt fait de les réduire à une apologie de la sensiblerie, de la doxa et de la paresse intellectuelle. Pourtant, un tel dispositif peut produire autre chose que cela. En le prenant au sérieux, en reconnaissant sa pertinence au point de vue féministe, on peut certainement essayer d’y articuler une pensée philosophique consistante. On renoncerait éventuellement à une certaine idée de la vérité, mais au profit d’une intelligence plus fine des exigences éthiques et d’un partage plus large des dispositions affectives. On y perdrait peut-être la production d’énoncés forts, mais on y gagnerait probablement une plus grande force de cohésion dans le mode de circulation des énoncés communs. À la limite, la valeur d’une discussion philosophique tient moins aux énoncés qu’elle formule qu’aux conditions d’énonciation qu’elle établit et son bonheur réside moins dans ce qu’elle produit que dans ce qu’elle effectue immédiatement. Le but d’une telle démarche n’est pas de rejeter en bloc la méthode philosophique, mais de neutraliser certaines attitudes pragmatiques et théoriques pour interroger la pertinence de leur systématicité et de leur légitimation a priori. Il ne va pas de soi qu’il faille en toutes circonstances se livrer au même type d’argumentation pour pouvoir penser. L’attention à une situation, à ses présupposés et à ses enjeux, peut parfois dicter de nouvelles règles à l’exercice philosophique.
Il n’est donc pas question ici d’instruire un procès général de la philosophie. On ne s’intéressera pas à ce qu’elle a pu charrier comme bêtises sexistes pendant des siècles et jusqu’ à aujourd’hui. Ce que nous permet de faire la critique féministe est tout autre : c’est d’envisager concrètement le discours philosophique non plus du point de vue de ses énoncés, mais du point de vue de ses conditions d’énonciation. Car la philosophie ne consiste pas seulement en un ensemble déterminé de procédures de vérité – logiques, épistémologiques, méthodologiques – mais aussi en un style de parole plus général et moins clairement défini, qui passe par des attitudes de pensée plus ou moins explicites, par la naturalisation d’un régime discursif tout à fait artificiel, par un rapport asymétrique plus ou moins consciemment institué entre les hommes et toutes les minorités – les femmes et les fou·lles et les barbares et les sauvages et les incultes et les idiot·es et les enfants et les animaux, etc.
Il n’est pas non plus question de dire ce que devrait être une philosophie féministe ou un féminisme philosophique ou quoi que ce soit de ce genre. De telles élaborations théoriques existent et ont leurs autricesFernand Oury, Aïda Vasquez, Vers une pédagogie institutionnelle, Matrice, Paris, 2001 (Maspero, 1967).. La proposition qui s’énonce ici en est largement tributaire. Beaucoup de choses qui ont été dites ici ont probablement été pensées et énoncées ailleurs, par d’autres, de façon plus claire, plus précise et plus juste. Le propos n’était cependant pas seulement de produire des énoncés sur le genre ou sur la dimension genrée du discours philosophique, mais surtout de frayer des possibilités d’énonciation qui tiennent compte des enjeux sociaux et politiques qui inquiètent la philosophie. Il ne s’agit toutefois pas d’un guide pratique : l’approche demeure théorique. La proposition s’énonce au sein d’une tradition philosophique dont elle interroge certains angles morts, mais qu’elle ne répudie pas intégralement. Peut-être ne s’est-elle pas complètement débarrassée de tout ce qu’elle critique dans cette tradition. À tout prendre, esquisser une théorie de l’énonciation philosophique permettra peut-être qu’ à la faveur d’autres conditions d’énonciation, la théorie s’énonce différemment.
Le jeu de langage de la philosophie a été inventé par Socrate. Platon en a exposé les règles tout en les dissimulant un peu sous une forme théâtrale. Il a été sans cesse repris, réinventé, amendé, pendant des siècles. Sans en faire à proprement parler l’histoire, on a essayé de montrer comment les règles sont devenues de plus en plus implicites, comment les conditions d’énonciation ont été de plus en plus absorbées par les énoncés – jusqu’ à la production d’un sujet transcendantal. Ce fantasme du sujet universel de la pensée fait écran entre la pratique concrète de la philosophie et ses conditions de possibilité et d’énonciation. C’est pourquoi l’enjeu de son abolition n’est pas simplement théorique – cela fait bien longtemps que la philosophie elle-même ne croit plus dans un tel sujet – mais bien pratique. Il ne s’agit pas de promouvoir conceptuellement une alternative à la subjectivité ou à l’universalité, mais de frayer des possibilités concrètes de penser – c’est-à-dire de parler – pour des individus et des collectifs désireux de continuer à le faire, sans reconduire, parfois involontairement ou inconsciemment, ce que la philosophie a aussi pu engendrer de pire.
Que serait une discussion philosophique dont personne ne se sentirait exclu·e ? Le langage technique de la philosophie pourrait-il produire autre chose qu’un sentiment d’illégitimité à parler et à penser chez celles et ceux qui ne le maîtrisent pas ? Le discours philosophique peut-il prendre des formes qui ne soient pas rhétoriques ou agonistiques ? On a essayé de montrer que la réponse à de telles question n’est pas strictement logique et linguistique. Il y a tout à repenser et à reprendre des formes de discussion, de la circulation de la parole, du commerce des regards, de la disposition des corps, de la répartition des tâches, des modes de valorisation de soi et des autres, ainsi que de tout ce qui contribue à agencer collectivement l’énonciation, pour rendre possible une autre pratique de la philosophie. On ne donnera pas ici de solutions ou de conseils. Il s’agissait seulement d’articuler encore une fois et autrement, en fonction de certaines nécessités ou exigences éthiques et politiques, ce jeu de langage et cette forme de vie qu’on appelle « philosophie ».
Apprendre / Ignorer
Sur la pédagogie institutionnelle
Ce texte est le résultat d’une recherche au sein du groupe « Éducation et Politique : autonomie, dogmatisme, autorité et relativisme ». Les questions qui nous ont traversé·es ont été nombreuses : peut-il y avoir un enseignement sans rapports de pouvoir ? Existe-t-il une pédagogie de l’autonomie ? Quelle forme pourrait prendre un apprentissage non aliénant ? Peut-on penser une pédagogie qui serait structurellement anticapitaliste et qui ne serait pas dogmatique ?
J’essaierai de répondre à quelques-unes de ces questions en puisant dans deux courants et expériences pédagogiques : la pédagogie institutionnelle et l’autogestion pédagogique. Il me semble que ces deux courants sont inspirés par les réflexions sur l’éducation du mouvement anarchiste et libertaire, sur lequel nous nous attarderons en introduction, avec pour but d’inspirer la recherche sur les formes futures de l’école de philosophie.
Je pars de deux postulats. Le premier, que l’on peut éduquer quelqu’un·e, c’est-à-dire l’aider à développer ses capacités, à apprendre des savoir-être et des savoir-faire qui lui permettront de s’épanouir. Ce postulat est discutable mais ce ne sera pas l’objet de cet exposé.
Le second principe est qu’il existe des méthodes qui facilitent l’éducation et l’apprentissage. C’est un constat fait depuis mon propre apprentissage au sein du mouvement d’Éducation populaire et dans mon travail avec des enfants. On appelle pédagogie l’ensemble des pratiques et des théories de l’éducation. Ma contradiction de départ est que la pédagogie sous-entend forcément un·e pédagogue, personne tierce ou instance tierce qui pense et agit pour favoriser l’apprentissage. Prenant pour acquis le fait qu’on ne peut se soustraire à sa subjectivité, comment peut-on alors enseigner sans orienter ? Peut-on penser des méthodes qui donnent une place prépondérante à l’enseigné·e, à son cheminement, à ses questionnements ? Est-ce que « pédagogie de l’autonomie » n’est pas un oxymore ? Peut-on apprendre à penser par soi-même grâce à une école ?
Je définirai ici l’autonomie comme étant la capacité à remettre en cause un fonctionnement institué et à se donner ses propres règles.
Divers courants ont tenté de répondre à ces questions de manière théorique mais aussi pratique, en pensant et en construisant des cadres qui donnaient la part belle à l’apprentissage de la liberté et de l’autonomie, à commencer par les écoles anarchistes.
Depuis le milieu du XIXe siècle, les idées anarchistes traversent et influencent les sociétés occidentales. Elles sont particulièrement reprises au sein du mouvement ouvrier, en Espagne, France, Russie, Italie et USA notamment. Dans la plupart des courants anarchistes de l’époque, l’éducation est un thème central car elle est envisagée comme un moyen d’émancipation politique : des êtres éduqués à la liberté et à l’autonomie participeront demain à l’émancipation générale de la société. C’est ainsi que de nombreuses écoles libertaires voient le jour en Europe. Ces tentatives pédagogiques proposent toutes de remettre en cause les méthodes éducatives autoritaires de l’époque et les hiérarchies au sein de l’institution scolaire.
L’École moderne est l’une des plus inspirantes de son temps et des plus connues, du fait de la popularité de son fondateur, Francisco Ferrer. Elle voit le jour en 1901. L’enseignement qui y est délivré est scientifique et positif, la science étant envisagée comme le seul moyen d’atteindre la vérité, en opposition aux dogmes religieux.
L’axiome principal de la pensée de Francisco Ferrer est la liberté de conscience, « connais librement et agis en conformité ». Il pense la société depuis un principe de responsabilité et de liberté individuelle. La lutte contre l’injustice et la recherche d’une nouvelle organisation sociale sont aussi des éléments qui structurent sa pensée et son projet s’inscrit dans la continuité des modèles de société anarcho-syndicalistes, révolutionnaires et internationalistes.
Pour Ferrer, il ne s’agit pas de réformer le système scolaire de l’intérieur mais bien de construire des alternatives qui ouvriront de nouvelles voies par leur réussite. L’École moderne est ainsi bien plus qu’une simple école : en plus de l’enseignement délivré aux enfants, le projet comprend la publication d’un bulletin sur la pédagogie, un projet éditorial de rédaction de manuels scolaires, la réalisation de conférences ouvertes aux familles et aux travailleureuses, la tenue de réunion syndicales et de séances d’information et la création d’une école normale destinée à la formation d’enseignant·es.
Les caractéristiques de l’École moderne sont les suivantes : une école payante au prorata des revenus des familles, mixte, laïque, rationnelle, scientifique et sociale. Les principes pédagogiques sont la co-éducation des sexes, la co-éducation des classes sociales, l’hygiène scolaire, l’autodiscipline, le refus des examens, l’autonomie et la liberté de l’enfant. Ces principes ne sont autres que la mise en application de propositions faites par le comité pour l’enseignement, créé en 1898 à l’initiative de Pierre Kropotkine et dans lequel siègent entre autres élisée Reclus, Louise Michel ou encore Léon Tolstoï et Jean Grave.
Ferrer ne prétend pas inculquer la rébellion contre l’oppression. En revanche il fait le pari que son école rendra les enfants conscient·es de l’injustice et prêt·es à se battre contre elle. Dans son ouvrage principal, L’École moderne, il explique qu’il refuse de former de bon·nes petit·es militant·es anarchistes en chargeant les enfants d’une lutte qui n’est pas encore la leur :
Je le dis franchement, les opprimés et les exploités ont droit à la révolte ; ils doivent réclamer leurs droits jusqu’ à ce qu’ils obtiennent leur pleine part du patrimoine commun. L’École moderne ne doit cependant pas anticiper les désirs et les haines, les affiliations et les rébellions, bien que ces sentiments soient appropriés chez l’adulte. Autrement dit elle ne doit pas tenter de récolter les fruits que la culture n’a pas encore livrés ; non plus qu’elle ne doit implanter un sens des responsabilités avant d’avoir muni la conscience des conditions fondamentales de telles responsabilités. Laissons-la enseigner aux enfants à devenir hommes. Une fois hommes ils pourront se déclarer rebelles devant l’injustice.
Son objectif n’est pas l’endoctrinement à un nouveau dogme, mais le changement social par la conscience et l’éducation. Ce projet révolutionnaire lui coûtera la vie : Francisco Ferrer est fusillé en octobre 1909, à la suite d’un procès sommaire où il est accusé d’être l’instigateur des émeutes de la Semaine tragique qui ont lieu à Barcelone en juillet de la même année. L’École moderne survivra cependant comme un modèle et de nombreuses expériences de pédagogies libertaires se revendiqueront de son héritage.
Plus largement, certains principes pédagogiques énoncés plus haut ont même été intégrés au système scolaire que nous connaissons (la mixité, l’hygiène scolaire, l’école laïque…). Pourtant, malgré des tentatives de modernisation et réformes après réformes, l’école reste toujours cette institution sclérosée qui sert d’instance de normalisation. Une institution disciplinaire qui favorise la reproduction sociale plutôt qu’un lieu d’apprentissage et d’autonomisation.
Dans les années 1960, certain·es ont voulu répondre à ces questions par l’application de nouvelles méthodes d’apprentissage au sein de l’institution scolaire. Ces tentatives s’inscrivent dans un mouvement plus large de critique de l’École et des institutions en général. Comme Ivan Illich le démontre à propos de l’institution médicale et de l’institution scolaire dans Némésis médicale et La société contre l’école, les institutions ont un caractère aliénant voir contre-productif : l’hôpital ne soigne pas mais crée des malades, l’école n’enseigne pas mais détruit la curiosité et l’envie de savoir. Les mouvements de la pédagogie nouvelle puis de la pédagogie institutionnelle et de l’autogestion pédagogique ont essayé de modifier l’état des institutions en y proposant des alternatives.
Contrairement aux initiatives anarchistes qui se fabriquent en dehors du système scolaire étatique (écoles autonomes) ces mouvements s’insèrent dans un cadre éducatif classique avec la volonté de le subvertir de l’intérieur. C’est peut-être parce qu’ à ce moment-là il est compliqué de faire école totalement en dehors de l’institution. Le mot d’ordre de ces mouvements est : « contre l’école-caserne ».
I. L’autogestion pédagogique
L’autogestion pédagogique désigne à la fois une théorie : l’idée d’un système d’éducation dans lequel le rapport prof-élève est en principe aboli, où ce sont les « enseigné·es » qui décident ce que doit être leur formation ; et une technique de groupe et de formation : la classe y fonctionne comme un groupe s’autogérant avec des décisions prises collectivement et concernant l’ensemble des tâches. Les frontières de cette expérience sont celles de la classe et non celles de l’école. Le but est d’apprendre aux enfants à remettre en cause les normes et les institutions.
Georges Lapassade est un des fondateurs et penseurs de ce courant. Il distingue trois conceptions de l’autogestion pédagogique. La tendance autoritaire : les enseignant·es proposent des modèles d’institutions (Makarenko) ; le self-government : une tentative d’autoformation. On retrouvera cette idée chez Célestin et Élise Freinet puis dans les Groupes de Techniques Éducatives (GTE). Cette tendance se situe entre la tendance autoritaire et la tendance libertaire. Enfin l’orientation libertaire : c’est une tendance non instituante dans laquelle les enseignant·es s’abstiennent de toute proposition. C’est le courant que porte plus particulièrement G. Lapassade et son mouvement.
Les deux derniers courants (tendance « autoformation » et tendance « libertaire ») sont très proches et me semblent représenter deux orientations qui sont en tension au sein de l’école de philosophie. Ils tentent de remettre en question la hiérarchie prof-élève, minorent voire suppriment le cours magistral et donnent une place primordiale à l’aspect collectif de l’apprentissage. Ces deux courants portent aussi l’idée qu’il faut créer des institutions à l’intérieur de la classe mais chaque courant le propose et le met en place d’une manière différente.
I.1. Pédagogie institutionnelle et self-government – Fernand Oury, Aïda Vasquez
Le courant de la pédagogie institutionnelle, théorisé en 1967 par Aïda Vasquez et Fernand Oury dans leur ouvrage Vers une pédagogie institutionnelle, emprunte à la pédagogie Freinet ses méthodes actives et y intègre les apports de la psychanalyse et de la sociologie. Fernand Oury est le frère de Jean Oury, fondateur de la Clinique de La Borde. Pédagogie institutionnelle et psychothérapie institutionnelle sont donc intimement liées dès le départ et on y retrouve des concepts communs comme le concept clé d’institution.
Le concept d’institution
Dans la psychothérapie institutionnelle, l’institution est mise en opposition avec le concept d’établissement. L’établissement est par définition répressif et autoritaire : c’est une structure à forme fixe, enfermante et aliénante. Les institutions a contrario ont des formes mouvantes et questionnables. Ce sont des structures subversives gérées par les usager·es comme les ateliers, les clubs, le journal, le bar, la cantine…
Fernand Oury rappelle que ce qui soigne ou ce qui permet d’apprendre, ce n’est pas l’institution en elle-même, mais bien l’institutionnalisation et la désinstitutionnalisation, comprises comme processus de création et de destruction.
La simple règle qui permet à dix gosses d’utiliser le savon sans se quereller est déjà une institution. « Décisions communes » ou « lois de la classe », l’ensemble des règles qui déterminent ce qui se fait et ne se fait pas, en tel lieu, à tel moment en est un autre. Nous appelons institutions ce que nous instituons ensemble en fonction de réalités qui évoluent constamment : définition des lieux et moments pour… (emploi du temps), des fonctions (métiers), des rôles (présidence, secrétariat), des statuts de chacun selon ses possibilités actuelles (niveaux scolaires, comportement). Les rituels, les réunions diverses qui en assurent l’efficacité (maîtres mots, etc.) sont aussi des institutions. Au conseil de coopérative, lieu de parole mais seul lieu de décision, tout peut être régulièrement mis en question. C’est bien le lieu de l’institutionnalisation-désinstitutionnalisation, l’institution instituant : le lieu du pouvoir réel bien que limité à la classeGeorges Lapassade (dir.), L’autogestion pédagogique, Gauthier-Villars, Paris, 1971..
La pédagogie institutionnelle est également l’héritière d’une pédagogie née quelques années plus tôt : la pédagogie Freinet. Développée par Élise et Célestin Freinet, cette pédagogie s’appuie sur des méthodes dites « méthodes actives » qui se basent sur la participation active des individus à leur propre formation. Le principe étant que l’apprentissage, avant d’être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès global de la personne. Pour cela, il faut partir de ses centres d’intérêt et s’efforcer de susciter l’esprit d’exploration et de coopération. La « méthode Freinet » prône une éducation globale, accordant une importance égale aux différents domaines éducatifs : intellectuels et artistiques, mais également physiques, manuels et sociaux. L’apprentissage de la vie sociale est considéré comme essentiel.
La « méthode Freinet » est basée sur l’utilisation d’outils pédagogiques tels que l’écriture d’un journal, sa production via une imprimerie, la correspondance scolaire (intra-école et inter-écoles). Les notions de groupe et d’apprentissage coopératif sont importantes car elles permettent de minorer la place du·de la prof. En effet, la pédagogie institutionnelle pense que la relation duelle (la relation prof-élève) est nocive car elle tient lieu de projection et d’identification et peut provoquer des transferts nocifs. La pédagogie institutionnelle apporte des systèmes de médiations diverses et donne à l’enseigné·e une diversité de points de fixation. L’apprentissage n’y est pas que collectif, il y a plutôt une articulation entre des outils qui permettent de réaliser un projet individuel et un projet collectif. Il y a l’idée que c’est l’échange qui fait avancer.
C’est peut-être là la caractéristique de la pédagogie institutionnelle : tendre à remplacer l’action permanente et l’intervention du maître par un système d’activités, de médiations diverses, d’institutions qui assurent d’une façon continue l’obligation et la réciprocité des échanges, dans et hors du groupeIbid..
I.2. Les Groupes de Techniques Éducatives et le Conseil
La pédagogie institutionnelle ne se pense pas comme un modèle mais comme un ensemble de pratiques mouvantes et en questionnements. Ces questionnements ont lieu au sein de groupes d’analyse de pratiques : le GTE, Groupes de Techniques Éducatives. Les enseignant·es affilié·es au mouvement s’y retrouvent pour discuter et échanger sur leur pratique. Iels écrivent des journaux de leur classe et lors de leur rencontre, chacun·e vient avec une monographie portant en général sur une situation ou un·e élève en particulier, afin de la soumettre au groupe et de l’analyser ensemble.
Un des autres outils centraux de cette méthode est le Conseil. C’est le lieu d’exercice du collectif. L’ambition est que maître·sses et élèves disposent, via ce moment, des capacités de contrôler les formes d’organisation et de la possibilité de les réajuster en fonction des nécessités et des objectifs. Une grande part est laissée aux conflits : ils déstabilisent mais font avancer. « Grâce au conflit il s’agit d’accéder à un nouvel équilibre, provisoire mais supérieur. » (G. Lapassade)
II. L’orientation libertaire - Georges Lapassade, Raymond Fonvieille, René Lourau, Michel Lobrot
Ce courant a pour ambition d’abolir les rapports de pouvoir au sein de l’enseignement. Dès lors, il fait face à plusieurs difficultés : comment faire cela tout en maintenant l’existence d’une institution scolaire et, en préférant à la disparition pure et simple du statut de professeur·e, sa transformation en profondeur.
La disparition du pouvoir est pensée dans la disparition du contenu (disparition relative puisqu’il y a quand même les programmes scolaires). Il y a la volonté de donner le plus de liberté possible à l’intérieur d’un cadre. G. Lapassade distingue deux formes d’institutions : l’institution interne (le cadre de la classe) et l’institution externe (le Rectorat, l’Académie, l’État). On peut s’autogérer à l’intérieur de l’institution interne mais on garde les obligations et les pressions de l’institution externe.
Dans cette méthode, contrairement à celle précédemment expliquée, l’enseignant·e ne propose pas de modèle d’institution, ce sont les enseigné·es qui doivent définir elleux-mêmes le cadre de la formation.
II.1. Mise en pratique
1. Une classe que l’on met en autogestion ne peut être livrée à elle-même brusquement et sans précaution. Il faut rappeler le cadre des institutions externes – qu’on espère un jour modifier, mais qui ne l’est pas actuellement – c’est-à-dire les programmes, les examens, la hiérarchie administrative, les notes, etc. Le groupe en fera ce qu’il voudra, c’est sa responsabilité. D’autre part il faut l’informer de la nature de la méthode qu’on veut employer avec lui et des raisons pour lesquelles on les emploie. Le maximum d’information sur la situation est toujours souhaitable. Enfin, le pédagogue chargé de la classe doit définir ses attitudes et les limites de son intervention. Il attend que la classe s’organise, définisse ses objectifs, sa manière de travailler, ses systèmes de régulation. Cependant il accepte de participer au travail dans la mesure où on lui demande. Le principe de la « demande » est essentiel. Cela veut dire pratiquement qu’il peut faire des exposés, informer, guider, dans la mesure où on lui demande.
2. Le pédagogue peut-il intervenir sans qu’il y ait demande explicite de la part du groupe ? Peut-il par exemple faire des propositions d’organisation ? Cela est dangereux : car le groupe, confronté à des problèmes difficiles, a tendance à s’en remettre à quelqu’un de plus « expérimenté » pour prendre des décisions à sa place. Il est indispensable à notre avis que le pédagogue s’en tienne strictement au principe de la demande c’est-à-dire qu’il n’intervienne pas avant que le groupe se soit entendu pour formuler une demande explicite. Cela crée une angoisse et une certaine panique parmi les individus. Mais celles-ci ne sont pas nécessairement défavorables. Le psychanalyste les accepte et les considère même comme une étape nécessaire.
3. Le groupe passe d’un état informel à une structuration qui s’améliore progressivement. Dans les premiers temps surtout de sa vie, et après encore, mais moins dramatiquement, il se pose des problèmes de fonctionnement, il doit régler des conflits interpersonnels. Le règlement de ces problèmes est pré-supposé à la prise collective de décisions, c’est-à-dire à un niveau où les individus ne se situent pas par rapport à d’autres individus, mais par rapport à la collectivité prise comme telle et au travail de cette collectivité. Le pédagogue ne peut pas vraiment intervenir à ce niveau élémentaire. Il ne peut que faire un travail de facilitation qui consiste à faire des analyses ou encore à proposer des analyses du groupe par lui-même.
4. Les propositions du pédagogue concernant l’organisation, si elles lui sont demandées doivent vraiment être des propositions. Elles doivent consister à proposer des choix, des formules de fonctionnement possibles. Il faut éviter de faire des propositions plus ou moins valorisées ou appuyées émotionnellement qui apparaîtront automatiquement comme des ordres ou des menaces.
5. L’intervention du pédagogue dans le « contenu », c’est-à-dire dans le travail d’enseignement lui-même, doit être discrète, précise, courte le plus possible. Il est utile de donner des instruments de travail (exposé, polycopié, références bibliographiques, matériel, fiches autocorrectives) plutôt que des discours oraux improvisés. Ceux-ci risquent en effet de prendre une place telle qu’ils paralysent le travail du groupe. Il faut une grande expérience de la part du pédagogue pour savoir quand il doit s’arrêter dans ces interventions et comment il doit les faireIbid..
II.2. Analyste et analyseur
Lapassade développe le concept d’analyseur. Il désigne ainsi « tout évènement, tout dispositif susceptible de décomposer une totalité jusque-là globalement saisie. Ainsi le prisme qui décompose la lumière est un analyseurIbid.. » C’est une sorte de contre-pouvoir. L’analyseur questionne la norme de façon plus ou moins consciente et plus ou moins compréhensible/audible (c’est la chose qui bug, la personne qui ne s’intègre pas, etc.). Un analyseur institutionnel fonctionne lorsqu’il provoque la venue de matériaux pour l’analyse. À l’inverse, l’analyste est celle ou celui qui doit prêter attention et détecter les analyseurs. Iel décode leur message et contribue ainsi à « faire parler » le non-dit institutionnel.
Pour Lapassade la question de l’autogestion n’est pas limitée à l’école mais pensée à l’échelle de l’organisation de la société. Il s’en réfère à Marx qui, convaincu par les évènements de la Commune de Paris, pense que l’État moderne doit laisser place à l’autogestionHannah Arendt, « La Crise de l’éducation » (1958), La Crise de la culture, Gallimard, Paris, 1972..
Pour Lapassade le problème est que l’autogestion n’est pas tout le temps comprise dans sa perspective révolutionnaire, celle-ci n’étant pas la participation, la concertation ou la cogestion qui sont en fait des « antidotes » à l’autogestion permettant d’améliorer le processus de production capitaliste. L’autogestion signifie le refus de participation au procès de travail capitaliste et la lutte pour un procès de travail socialiste. Pour lui, la Révolution commence avec l’autogestion car c’est un bouleversement des rapports sociaux.
On ne peut prédire ce que sera l’organisation dans la société socialiste ; on peut simplement indiquer qu’elle sera véritablement collective et que la fonction instituante ne sera plus l’affaire de quelques-uns. La Révolution doit remplacer l’Institution par l’institutionnalisation. L’autogestion c’est avant tout cette libération des forces instituantesSupra,« La naissance de la philosophie d’après Giorgio Colli », p. 21..
III. Les limites de ces pédagogies
Bien qu’inspirantes à plusieurs égards, ces différentes méthodes pédagogiques présentent aussi des limites, la plus évidente étant celle de la place de l’enseignant·e. En effet toutes ces tentatives fonctionnent grâce à un·e adulte qui coordonne l’ensemble de la classe et apporte de temps à autre ses compétences de professeur·e. Comment cela pourrait-il fonctionner dans un collectif d’apprentissage entre adultes ? Faut-il toujours une personne qui en sache plus et qui peut, si on le lui demande, occuper de temps à autre la place du·de la professeur·e ?
Une autre limite peut être pointée : celle de la technicité de ces approches. Ces pédagogies ont tendance à résumer l’éducation à une question de méthodes et de techniques et non à une question de transmission de savoirs comme pourrait le défendre Hannah ArendtVoir Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, Paris, 1979.. Les encadrant·es sont moins des passeureuses de connaissances et d’histoires que des technicien·nes de l’apprentissage. L’approche est néanmoins ambigüe car, si la volonté est que le contenu de formation soit décidé par les apprenant·es elleux-mêmes, les techniques et les technicien·nes ne sont jamais neutres et orientent tout de même l’éducation.
Enfin, ces expériences d’autogestion ont toujours lieu à l’intérieur de cadres qui ne peuvent être totalement bousculés : l’École et la classe. Il y a toujours l’institution externe qui fixe un cadre supérieur sur lequel il n’y a pas de prise : l’Académie, le Rectorat, l’inspecteurice et en dernier lieu l’État.
IV. Des questions pour l’école de philo
Deux visions de l’apprentissage s’opposent dans les expériences d’autogestion pédagogique portées d’un côté par les Groupes de Techniques Éducatives et de l’autre par les classes autogérées présentées par G. Lapassade. Dans le courant de la pédagogie institutionnelle, l’apprentissage est pensé depuis le désir d’apprendre des enfants. Le rôle de l’enseignant·e est de susciter désir et curiosité et de fournir les outils qui permettent aux apprenant·es de mieux se développer. Dans le courant de l’autogestion pédagogique, l’apprentissage est suscité depuis l’expérience de la liberté totale : le contenu doit être entièrement décidé par les apprenant·es et l’enseignant·e ne doit intervenir que si iel est sollicité·e. Cela produit dans un premier temps du vide et de l’angoisse. On a d’un côté une expérience de liberté guidée, de l’autre une expérience de liberté totale. Je pense que cette tension pédagogique est présente au sein de l’école de philo et qu’elle s’exprime de façon bipolaire : une polarité École et une polarité Recherche.
Pour l’instant notre École est une école. Derrière ce signifiant il y a l’idée d’un cadre donné pour apprendre et enseigner des contenus. Mais la philosophie peut-elle être l’objet d’un enseignement ?
On peut distinguer deux définitions de la philosophie : la philosophie comme étant l’histoire et la compréhension des concepts liés à l’être, la place des humain·es dans le monde, la métaphysique ; et la philosophie comme une attitude de questionnement, une manière de penser et de poser des problèmes, de créer des concepts et de comprendre le monde. Si la première peut faire l’objet d’une transmission, que faire de la deuxième ? Peut-on trouver des méthodes non directives qui permettent d’apprendre à penser sans maître·sse ? Comment faire pour trouver ce qui nous intéresse sans être trop influencé·e par « ce que l’on devrait apprendre » ?
L’autogestion pédagogique peut nous permettre de continuer de tenir ensemble nos deux polarités. Tout d’abord en nous questionnant sur la place et le rôle de l’enseignant·e. Jusqu’ à maintenant, des personnes étaient clairement identifiées comme étant des « profs » et d’autres des « élèves ». Ce qui consacre ce statut est la capacité ou non à produire un cours magistral et/ou à diriger des exercices. Nous avons remarqué qu’une différence de pouvoir se créait du fait de ce statut, surtout lorsqu’il était toujours occupé par les mêmes personnes. Plusieurs chemins s’ouvrent à nous pour changer cet aspect : rendre de plus en plus mineure cette place ou bien la rendre plus accessible en faisant en sorte que d’autres puissent s’en saisir.
Faire tourner la place du·de la prof, c’est faire tourner la charge qui lui incombe : celle de faire des cours.
Le cours magistral est un dispositif très impressionnant et académique. Il ne doit pas être la seule manière de présenter à d’autres le fruit d’un travail. Nous pourrions favoriser la participation de chacun·e par le biais d’exposés par exemple. Ce geste se passe dans le langage mais il a des effets dans le réel. L’abandon d’un vocabulaire lié à des rapports de pouvoir inhérents à l’institution de la fac permet de ne pas reproduire, en pensant les détourner, des rapports de domination. De plus, si un exposé n’est pas nommé cours magistral, alors plus de personnes peuvent se sentir de parler en public, sans devoir être un·e « maître·sse ». De ce fait, l’exposé produit une parole moins descendante, le fruit de recherches, peut-être empreintes de plus de doutes et sans la nécessité magistrale d’une thèse singulière et frappante. L’exposé peut prendre des formes diverses, notamment se faire seul·e ou à plusieurs. C’est en faisant qu’on apprend et aussi en restituant aux autres ce que l’on a appris. Cela nous force à mettre au clair notre pensée. Si tout le monde s’essaye à cet exercice, on élargit le transfert à d’autres personnes et on permet à chacun·e de s’exercer et de se rendre capable de produire quelque chose qui sera montré aux autres, peu importe la forme.
Je propose que notre méthode soit celle d’un travail de « recherche » collective qui naisse de désirs communs. C’est d’ailleurs la méthode que nous avons expérimentée cette année par le biais des petits groupes de travail, composés par proximité d’idées et non par pur hasard. Il y a bien évidemment une tension entre singularité et collectif. Existe-t-il des désirs complètement singuliers, non influencés, non traversés par les désirs des autres ? Qu’est-ce qui guide le désir d’apprendre ? N’est-il pas agréable et souhaitable de pouvoir être emporté·e par d’autres désirs que les siens ? Il me semble que le groupe de recherche permet de concilier ces deux approches, le travail personnel étant mêlé avec le travail collectif, lors de présentations, de discussions, de lectures communes, etc.
Avec Illich
0. Cette année
Cette année, en guise de réflexion sur notre aventure intellectuelle et collective, j’ai voulu questionner le nom qu’on lui avait donné : école de philosophie. D’où vient la philosophie, est-il judicieux de persévérer dans cette voie ? Ce travail, esquissé dans un autre texte sur Giorgio Colli et la naissance de la philosophieIvan Illich, « Une société sans école », Œuvres complètes, vol. 1, Fayard, Paris, 2020, p. 299., me pousse à trouver qu’il y a quelques bonnes raisons de délaisser la philosophie, quitte à retrouver des pratiques qu’elle désigne sous d’autres noms. Voilà pour le nom de famille, qu’en est-il du prénom, école ? Ce fut l’autre travail de mon année, à travers la lecture d’Ivan Illich : examiner la notion d’école et sa place dans notre monde. Sans surprise, de même qu’il convient à mon avis de se passer de la philosophie, il faudrait également se débarrasser de l’école. On rétorquera que c’est chose facile à dire mais légèrement utopique à mettre en œuvre. À l’échelle globale, oui ; à l’échelle de notre aventure, non.
1. Illich
Illich est né en 1926 à Vienne, ses parents sont plutôt riches, il grandit entre l’Italie et l’Autriche, finit ses études entre Florence et Rome, en théologie, philosophie, cristallographie, il parle une dizaine de langues. Il finit par devenir prêtre aux États-Unis où il est parti en 1951. Il commence à avoir des soucis avec le Vatican en 1960, qui l’embête sur le fait qu’il prend des positions en faveur des plus pauvres et avec un ton trop subversif.
En 1959, il part seul dans le désert du Sahara pendant 40 jours pour un exil spirituel. Après ça, il fonde ce qui deviendra le CIDOC, le Centre Interculturel de Documentation, qui est un genre d’école de philosophie un peu étrange et sur lequel je reviendrai. Cette aventure dure jusqu’en 1976, après quoi il devient nomade, entre l’Allemagne, la France et les États-Unis, tout en faisant des conférences aux quatre coins du monde. Il est surtout connu pour les livres écrits lorsqu’il était à Cuernavaca, dans les années 1970 : sur la santé, l’école, les transports, bref les institutions importantes de la société industrielle qui se répand alors partout. Mais on coupe parfois son œuvre en deux parties : après son départ du Mexique, il écrit encore de nombreux livres avec des sujets variés, il fait un retour sur la philosophie médiévale, fait des généalogies plus ou moins réussies et adopte un ton encore plus critique.
2. Sur l’école
Un de ses livres phare s’appelle Une société sans école. Deschooling Society en anglais. Sa critique de l’école se joue sur plusieurs axes. Toute une partie de son livre est par exemple consacrée à chiffrer les inégalités produites par l’école, là où un discours un peu facile de gauche tend à faire croire que l’école réduit les inégalités. Il ne prend pas le problème comme les sociologues français Bourdieu et Passeron, qui montrent comment l’école ne fait que reproduire les inégalités sociales via le système d’évaluation et les codes valorisés qui avantagent celleux qui les possèdent déjàSur ce point, voir son fameux ouvrage Némésis Médicale. L’expropriation de la santé, Seuil, Paris, 1975.. Il prend la chose d’un point de vue plus économique et montre que le gros des dépenses éducatives va pour les hautes études et donc les enfants de riches. L’argent public paye les hautes études des plus riches. D’où son idée selon laquelle l’institution scolaire, loin d’être créée en vue de l’égalité, crée en fait de la rareté, des disparités énormes dans les possibilités d’accès au savoir, qui devient un facteur de pouvoir. Un autre effet pervers est la frustration et l’autoflagellation de celles et ceux qui ne réussissent pas selon les codes scolaires. L’école crée une grille de valeur à l’aune de laquelle tout le monde doit se mesurer, qui permet de classer et de faire se sentir bêtes et pauvres des gens sur la base de critères absurdes. Illich n’arrête pas d’enfoncer le clou de la critique de l’école, contre toute l’idéologie « développementiste » qui règne à son époque et selon laquelle il faut développer le tiers-monde, notamment en finançant des écoles.
Un autre point important de sa critique a trait à la manière dont l’école crée les consommateurices futur·es et la dépendance institutionnelle :
Fondamentalement, les établissements scolaires ne dépendent plus d’une idéologie prônée par un gouvernement ou par une organisation économique particulière. Tandis que les autres institutions peuvent se présenter différemment d’un pays à l’autre, l’école a partout une structure semblable et se propose, sans que nous en ayons conscience, des objectifs comparables. Elle façonne un consommateur qui n’accordera bientôt plus de valeur qu’aux services rendus par les institutionsIvan Illich, « Le travail fantôme », Œuvres complètes, vol. 2, Fayard, Paris, 2020, p. 127..
Ce qui hante Illich dans toutes ses enquêtes sur les institutions, c’est l’idée que la vie et son sens soient remis aux mains de professionnel·les. De la même manière, la médecine se révèle être contre-productive et finit par être génératrice de plus de mal que de bien, mais en plus elle imprime dans les corps une nouvelle idée de la vie, de la santé, qui nous rend complètement dépendant·es de l’institution médicale, de la vie à la mortElio Antonio de Nebrija cité par Ivan Illich, ibid., p. 138.. L’institution est, pour Illich, ce qui crée un besoin et, simultanément, se présente comme le seul moyen d’y répondre.
3. Quelques pistes généalogiques
L’essai sur l’école est un « pamphlet » critique assez court. Dans la deuxième partie de sa vie, Illich consacre des travaux plus pointus et aussi plus ésotériques, moins connus, à la question de l’apprentissage et des institutions. Par exemple, dans Le travail fantôme, il consacre un commentaire de texte à la première grammaire espagnole écrite par Elio Antonio de Nebrija. Ou plutôt, à la lettre que Nebrija écrit à la reine Isabelle de Castille en 1492. En même temps que Christophe Colomb va en Amérique, Nebrija (même s’il ne pense pas découvrir ni conquérir quoi que ce soit) travaille à une grammaire pour soumettre les sujet·tes de la reine. La même année, c’est le lancement de l’Inquisition en Espagne. Évidemment, ça rappelle Jules Ferry, quasiment sanctifié en France pour ses lois sur l’école (laïque, obligatoire, gratuite) qui arrivent en même temps que ses discours enflammés sur la colonisation de l’Indochine et de l’Afrique. Et le lien n’est absolument pas contingent : l’argument permanent de Ferry est le « devoir de civilisation » de la France, le fait d’aller apporter les Lumières au monde entier tout en éduquant les citoyen·nes à l’intérieur, quitte à laver la bouche au savon de celles et ceux qui ne veulent pas apprendre le français. La vérité, c’est la mise au pas, le pouvoir politique et le pouvoir économique qui vont avec l’hégémonie symbolique.
L’avantage avec Nebrija, c’est que les choses sont dites frontalement : il ne propose pas sa grammaire à la reine d’Espagne en arguant d’une mission civilisatrice mais affirme très directement qu’il est question d’asseoir au mieux son pouvoir :
Mon Illustre Reine. Chaque fois que je médite sur les témoignages du passé qui ont été conservés par l’écriture, la même conclusion s’impose à moi. Le langage a toujours été le conjoint de l’empire, et il le demeurera à jamais. Ensemble ils prennent naissance, ensemble ils croissent et fleurissent, et ensemble ils déclinentIbid., p. 138-139..
Une langue qui permette d’unifier la multitude des langues pour que tout le monde puisse obéir aux ordres de la Couronne. Mais l’opération va au-delà de ça puisqu’elle vise aussi le contenu du langage :
Présentement, ils gaspillent leur loisir sur des romans et des contes pleins de mensonges. J’ai donc décidé que mon plus urgent devoir était de transformer [reducir] le parler castillan en un instrument [artificio] de telle sorte que tout ce qui s’écrira désormais dans cette langue puisse être d’une seule et même teneurVoir Platon, Hippias majeur..
Il faut donc dompter une langue « vagabonde, indisciplinée ». Cette langue, c’est la langue vernaculaire, sans cesse mouvante (Nebrija dit qu’elle a tellement bougé en cinq siècles qu’on peine à identifier la même langue). Illich se sert d’ailleurs de cette étude pour mettre en avant cette notion de vernaculaire, très importante chez lui, qui désigne tout ce qui est fait chez soi de manière complètement séparée de la sphère marchande. Le domaine du vernaculaire, c’est aussi le domaine de la subsistance, de ce que font les gens pour parler, manger, vivre, se soigner sans l’aide d’institutions et de professionnel·les.
Pour lui, la grammaire de Nebrija est l’un des symboles forts de l’attaque contre la subsistance et le vernaculaire. Il écrit :
Le nouvel État prend aux gens les mots dont ils subsistent, et les transforme en une langue normalisée qu’ils seront dorénavant obligés d’employer, chacun au niveau d’instruction qui lui a été institutionnellement imputé. Désormais, les gens devront s’en remettre à un langage qu’ils reçoivent d’en haut et non plus développer une langue en commun. Ce passage du vernaculaire à une langue maternelle officiellement enseignée est peut-être l’événement le plus important – et pourtant le moins étudié – dans l’avènement d’une société hyperdépendante de biens marchands. Le passage radical du vernaculaire à la langue enseignée présage le passage du sein au biberon, de la subsistance à l’assistance, de la production pour l’usage à la production pour le marché, des espérances divisées entre l’Église et l’État à un monde où l’Église est marginale, la religion privatisée, et où l’État assume les fonctions maternelles auparavant revendiquées uniquement par l’Église. Précédemment, il n’y avait pas de salut hors de l’Église ; à présent, il n’y aura ni lecture, ni écriture – ni même, si possible, de parler – hors de la sphère de l’enseignement. Les gens doivent renaître dans le sein de la souveraine, et être nourris à sa mamelle. Voici qu’émergent pour la première fois le citoyen de l’État moderne et sa langue fournie par l’État – l’un et l’autre sont sans précédents dans l’histoireVoir sur ce point l’excellent livre de William Pietz, Le fétiche : généalogie d’un problème, Éditions Kargo / L’Éclat, Paris, 2005..
4. Le fétichisme, la valeur, la contre-productivité
L’une des questions transversales à l’œuvre d’Illich est celle du fétichisme, même s’il ne l’appelle pas forcément comme ça. L’idée qu’une chose ou une institution en vienne à médier les rapports humains et remplacer un rapport authentique à Dieu, au désir ou au sens de la vie.
Il y aurait toute une histoire du fétichisme à faire, comme thème repris à différentes époques pour désigner la falsification qui opère potentiellement dans toute médiation. Peut-être que ça commence dès Platon, quand il se demande comment définir le Beau. On lui rétorque que le Beau, c’est peut-être de l’orÀ leur actif, entre mille autres choses, il faut mentionner une campagne de stérilisation des amérindiennes en Bolivie qu’ils ont lancée dans les années 60 avant d’être expulsés du pays.. Tout le geste platonicien des débuts consiste alors à montrer que les définitions qu’on lui propose sont en fait des choses belles (éventuellement), mais ne sont pas le Beau en soi. En fait, aucun objet particulier ne peut s’élever comme paradigme du Beau, comme ce qui fait que les autres objets dits beaux sont beaux. D’où l’ambition de Platon : affirmer qu’il y a une idée du Beau. Quel rapport entre cette idée et les objets beaux ? Un rapport de participation. C’est là tout le problème. Qu’est-ce que la participation ? Et au fond, ce problème est un problème ontologique (d’où les choses tirent-elles leur être ?) mais c’est aussi bien un problème linguistique (comment définir les choses ?) et un problème mystique et politique tout à fait contemporain (que veut dire participer à quelque chose ?) qu’on nous rappelle à chaque élection. Les élections sont d’ailleurs un beau symptôme : l’abstention semble indiquer qu’elles sont devenues des fétiches, comme si les vrais problèmes étaient ailleurs, que personne ne croyait plus à cette médiation.
Dans les religions, en particulier monothéistes, ce problème devient une obsession. Dans la Bible avec l’épisode du Veau d’or : Moïse est parti chercher les Tables de la Loi et ses fidèles demandent en attendant un dieu de substitution, ils construisent un veau d’or avec leurs bijoux en or. À son retour, Moïse fracasse les Tables de la Loi et Dieu lui intime de tuer toustes les hérétiques. Dans la théologie chrétienne, le problème des intermédiaires entre le premier principe et le monde sera évidemment un enjeu de taille : il faut à la fois faire en sorte que Dieu ne s’abaisse pas directement à gouverner les affaires humaines (ou que le premier principe reste transcendant), et en même temps que les ministres, anges et autres intermédiaires ne prennent pas sa place tout en effectuant ses ordres.
Ça se poursuit dans l’histoire religieuse avec les différentes querelles entre iconoclastes et iconodoules : les premier·es veulent détruire les images dont le pouvoir de fascination fait oublier le véritable Dieu, tandis que les second·es y voient un aspect crucial dans l’accès à la divinité. Plus tard, les protestant·es veulent faire tomber les hiérarchies ecclésiastiques entre le cœur de chacun·e et Dieu. D’ailleurs, le mot « fétiche » apparaît vraisemblablement dans un contexte religieux : d’une part les catholiques accusent des païen·nes ou des sorcières d’user d’objets « magiques » en leur conférant un pouvoir trop grand ; d’autre part les protestant·es reprochent aux catholiques d’user de croix fétiches« …nous proposons de mener à terme la révolution des Amériques, afin de construire un hémisphère où tous les hommes peuvent espérer un niveau de vie décent dans la dignité et la liberté. Pour atteindre cet objectif, la liberté politique doit accompagner le progrès matériel… Transformons une fois encore le continent américain en un vaste creuset d’efforts et d’idées révolutionnaires, un hommage au pouvoir des énergies créatrices des hommes et des femmes libres, un exemple donné au monde que liberté et progrès marchent de conserve. Réveillons une fois encore notre révolution américaine pour qu’elle guide partout la lutte des peuples — non par la force de l’impérialisme ou la crainte mais par la voie du courage, de la liberté et de l’espoir en l’avenir de l’humanité. » Discours du Président John F. Kennedy, « On the Alliance for Progress », 1961..
Je fais vite, pour en arriver à Marx. Chez lui, le fétichisme de la marchandise désigne la double nature de la marchandise, entre valeur d’échange et d’usage, qui lui permet d’être à la fois singulière et en même temps comparable, via sa valeur d’échange, à toutes les autres. Mais surtout, le fétichisme désigne le fait que derrière des rapports d’achat et de vente de marchandise, il y a en réalité des rapports entre humain·es. La marchandise est le fruit d’un rapport d’exploitation et elle masque ce rapport par son seul aspect physique et son prix.
Chez Illich, enfin, le fétichisme est celui de l’institution : elle procède en élaborant un monopole radical sur une question qui crée un besoin auquel elle seule peut répondre. Mais surtout, elle se dresse entre chacun·e et la production du sens, elle finit par incarner le sens, le savoir, la santé, etc. Sauf qu’Illich ne critique pas juste les institutions en tant que telles. Il essaye toujours de pointer le moment où elles deviennent contre-productives, c’est-à-dire lorsqu’elles vont à l’inverse des buts qu’elles se sont elles-mêmes fixés au départ. Cependant, la contre-productivité n’implique pas la fin des institutions. Pour Illich, il s’agit plutôt d’inventer d’autres formes.
5. Le CIDOC (1961-1976)
Le contexte est très particulier : un ordre papal demande aux évêques des États-Unis et du Canada d’envoyer 10% de leurs prêtres et nonnes disponibles en Amérique latine. Cette demande va de pair avec une vague de soft power américain envers l’Amérique latine : d’un côté le Peace Corps, le Corps de la paix, lancé en 1961 par Kennedy et censé aider, dans le monde entier, les pays dits en voie de développementVoir sur ce point le mémoire consacré au CIDOC par Elisabeth Lemmerer, Examining a Sample of the American-Mexican Scientific Cooperation in the 1960s. A Social Network Analysis of the CIDOC Network, Wien, 2009, citation p. 5, note 4, disponible sur : https://othes.univie.ac.at/6734/1/2009-09-24_0305546.pdf ; de l’autre côté, plus spécialement dirigé vers l’Amérique latine, L’Alliance pour le progrès, toujours issue de l’administration Kennedy pour renforcer la coopération avec l’Amérique du Sud, par peur de la propagation révolutionnaire après Cuba en 1959. Ils mettent en œuvre le renforcement d’un marché commun en liant comme ils savent le faire des aides économiques à des conditions politiquesJean-Michel Djian, Ivan Illich. L’homme qui a libéré l’avenir, Seuil, Paris, 2020, p. 37., tout en prétendant poursuivre la révolution américaine. On note que, dans les années 60, treize pays deviennent des dictatures…
C’est dans ce contexte que les fondateurs du CIDOC veulent créer une espèce de centre interculturel pour adapter les missionnaires à leur destination. Au départ, il y a donc évidemment une énorme suspicion : il s’agit d’entraîner les prêtres et les laïc·ques qui veulent se rendre en Amérique latine ! Sauf que très vite, Illich se dit que rien ne va dans tout ça et que ni le Peace Corps ni l’Église catholique ne devraient aller interférer en Amérique latine. Il déclare alors que le but du CIDOC doit être de « corrompre [des volontaires] tant qu’ils [sont] encore avec nous et de les faire rentrer à la maison de leur propre initiative » (to corrupt [volunteers] while they [are] still with us and ship them home under their own motivation)Ibid., p. 38.. Le centre devient alors une sorte de laboratoire expérimental des alternatives et de la critique de la société industrielle.
J.M. Djian évoque le CIDOC et parle d’un « phalanstère pour cogiter » pour « un moi tiraillé à longueur de temps entre un exercice spirituel exigeant et une envie d’en découdre, les “armes” à la main, contre l’injustice du mondeIbid., p. 52. ». « Il fallait au CIDOC dissuader les missionnaires envoyés par le Pape d’atteindre leurs objectifs […], il y avait là, c’était clair, une véritable intention subversive. » Illich aurait dit à Sergio Méndez Arceo, l’évêque progressiste proche de la théologie de la Libération : « J’aimerais créer ici un centre pour la dé-YankeeficationIbid., p. 53.. » Ou encore : « Je n’accepte de voir ici, à Cuernavaca, que des gens, si possible non diplômés, et qui, par leur prédisposition à s’ouvrir sur les autres, sont déjà convaincus d’être au départ sur un pied d’égalité avec le reste de la population qui vit sur cette terreIvan Illich, « Du lisible au visible », Œuvres complètes, vol. 2, op. cit., p. 561.. »
Aucun diplôme n’était demandé pour intégrer le CIDOC. En revanche, le centre exigeait un véritable engagement intellectuel et contestataire, une participation financière aux frais de fonctionnement (sauf pour les ressortissants latino-américains qui bénéficiaient d’une tarification avantageuse) et une adhésion au règlement intérieur, qui précisait un code de conduite et bannissait les armes. On y spéculait sous sa férule charismatique [celle de Illich], mais aussi dans une communauté qui s’organisait en bandes pour lire, écrire, fumer, boire et dormir. S’aimer et s’encanailler aussi. Écouter l’autre, partager les nourritures terrestres qui s’étalaient en désordre sous la bienveillance de l’autre figure de proue de l’aventure illichienne, Valentine BorremansCes diverses expériences historiques ont fait l’objet de recherches et d’exposés lors de cette année d’étude, dont vous pourrez trouver quelques traces dans cet ouvrage. Ce texte, quant à lui, revient sur l’hôpital de Saint-Alban..
Pour finir quelques mots tirés d’un ouvrage tardif d’Illich qui indiquent, malgré sa critique acerbe de l’école, son rêve persistant de lieux d’études :
Je rêve qu’en dehors du système éducatif qui assume aujourd’hui des fonctions totalement différentes il puisse exister quelque chose comme des maisons de lecture, proches de la yeshiva juive, de la medersa islamique ou du monastère, où ceux qui découvrent en eux-mêmes la passion d’une vie centrée sur la lecture pourraient trouver le conseil nécessaire, le silence et la complicité d’un compagnonnage discipliné, nécessaires à la longue initiation dans l’une ou l’autre des nombreuses « spiritualités » ou styles de célébration du livreFrédéric Lordon, Vivre sans ?, La Fabrique, Paris, 2019..
Instituer / Destituer
Institutions mineures
Le concept d’« institutions mineures », ou minoritaires, est apparu pour caractériser l’objet des recherches de cette année de l’école de philosophie sans que nous l’ayons encore véritablement pensé. Intuitivement, il nous semblait désigner différentes expériences dont nous nous sentions proches – l’hôpital de Saint-Alban, les écoles du Black Panther Party, les béguinages ou encore le CIDOC d’Ivan IllichGilles Deleuze, Félix Guattari, « Postulats de la linguistique », Mille plateaux, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980.. « Minoritaires » parce que ces expériences, non seulement ne répètent pas les modèles dominants du soin ou de l’enseignement, mais n’ont pas vocation à s’y substituer ; « institutions », pourtant, car elles se sont dotées de formes symboliques et matérielles suffisamment denses pour durer dans le temps, s’inscrire dans l’espace et entrer en conflit avec le champ majoritaire.
Le concept faisait écho à ce qui se tente à l’école de philosophie, toutes proportions gardées bien sûr, comme en beaucoup d’autres lieux. Faire d’une pratique qui nous tient à cœur autre chose qu’un hobby ou une profession, c’est-à-dire lui donner une forme qui ne se coule pas dans l’institué et son cortège d’injustices structurelles, tout en la rendant suffisamment collective ou partageable pour qu’elle se confronte au monde réel et à ses rapports de forces.
La tentative en question consiste à se balader en équilibre sur une corde avec, d’un côté, la critique anarchiste du caractère morbide de toute institution – institution mineure, c’est déjà trop, ce qu’il faut faire c’est détruire les institutions – et de l’autre la critique léniniste ou réformiste de l’insuffisance de la marginalité – institution mineure, ce n’est pas assez, ce qu’il faut faire c’est s’emparer des institutions majoritaires. Je voudrais sortir de l’opposition binaire entre un refus anarchique de toute institution et un léninisme incapable d’envisager une autre stratégie que celle de la prise de pouvoir d’État et des institutions dominantes, malgré ses échecs historiques et son impuissance actuelleMarcel Mauss et Paul Fauconnet, « Sociologie », dans Grande Encyclopédie, vol. 30, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Paris, 1901. Voir aussi la préface à la seconde édition des Règles de la méthode sociologique, Émile Durkheim (1919) : « On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité ; la sociologie peut alors être définie : la science des institutions, leur genèse et leur fonctionnement. ». Pour cela, je voudrais proposer une distinction entre des institutions majoritaires à tendance hégémonique, et des institutions minoritaires qui ne visent pas le monopole des manières de soigner, de penser ou de faire.
Ce travail vient aussi et surtout de la découverte de la psychothérapie institutionnelle. Je remercie les personnes du groupe de travail « Soigner l’institution », et toutes celles qui y sont intervenues : ce texte est une manière d’agencer ce qui a été collectivement réfléchi cette année.
Pour aller au-delà de notre intuition initiale et savoir si le concept d’institution mineure tient, je voudrais faire plusieurs choses :
Préciser l’opposition conceptuelle majeur/mineur en allant lire les textes de Deleuze et Guattari. Qu’est-ce que le minoritaire ? Que contient le concept d’institution minoritaire ?
Analyser l’expérience historique de la psychothérapie institutionnelle comme une forme possible d’institution minoritaire, ou d’institution en mouvement.
Replacer cette proposition dans le contexte néolibéral du déclin de l’institution et de l’hégémonie contemporaine de la forme entreprise. Qu’est-ce qui distingue l’institution en mouvement de la fluidité contemporaine des organisations ? Y a-t-il une différence entre un collectif et une entreprise ?
I. Majeur, mineur, Institutions et usages
Le devenir minoritaire comme figure universelle de la conscience s’appelle autonomieVoir l’école solidariste et notamment Léon Bourgeois et Léon Duguit, penseur du service public à travers une doctrine de l’État anti-souverainiste, dans Pierre Dardot et Christian Laval, Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’État en Occident, La Découverte, Paris, 2020, p. 615..
I.1. Qu’est-ce qu’une institution ?
Les institutions, au sens très général de la sociologie classique, ce sont les pratiques stables d’un groupe social donné que l’individu trouve préétablies. Elles sont transmises par l’éducation et garantissent à la fois l’intégration au groupe et régulent ses rapportsMaurice Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », dans Cahier de la nouvelle journée, 4e cahier (La Cité moderne et les transformations du droit), 1925, réédité dans Maurice Hauriou, « Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté », dans Cahier de la nouvelle journée, no 23, 1933, p. 89.. La notion sociologique est très floue : on parle d’institution, en effet, pour des choses aussi différentes que la prohibition de l’inceste, le Tour de France, l’Église, la CAF, Noël, le langage. Tout usage partagé, cependant, n’est pas une institution. Pour cela, il doit se doter de formes objectives.
Au début du XXe siècle, plusieurs théoriciens du droitL’hégémonie est le pouvoir conféré par les cités grecques à l’une d’entre elles pour la direction des affaires communes en raison de son prestige guerrier. Gramsci applique ce concept aux rapports entre classes, et désigne le pouvoir éthico-politique qui assure le consentement des masses à la direction imprimée à la vie sociale par les dominant·es, consentement qui naît du prestige que ces classes retirent de leurs positions dans les rapports de production. Voir Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, La Fabrique, Paris, 2018, note 70, p. 288. constatent l’insuffisance des théories contractualistes traditionnelles à rendre compte du foisonnement de formes collectives – syndicats, mutuelles, associations, coopératives de toutes sortes, mais aussi tout ce qui au plan étatique ne relève pas strictement de la loi, par exemple l’école – qui ont surgi durant le XIXe siècle sur les ruines de l’ancien monde. Ces entités ont une existence propre, irréductible à la somme des droits des individus qui la composent ; quelque chose les y réunit qui ne relève pas d’un contrat passé entre volontés indépendantes. Maurice Hauriou, juriste toulousain, un des pères du droit administratif français, élabore une théorie de l’institution pour penser ce nouveau plan du « social ». Il caractérise l’institution comme :
Une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée un pouvoir s’organise qui lui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures« Majorité implique une constante, d’expression ou de contenu, comme un mètre-étalon par rapport auquel elle s’évalue. Supposons que la constante ou l’étalon soit Homme-blanc-mâle-adulte-habitant des villes-parlant une langue standard-européen-hétérosexuel quelconque (l’Ulysse de Joyce ou d’Ezra Pound). Il est évident que “l’homme” a la majorité, même s’il est moins nombreux que les moustiques, les enfants, les femmes, les Noirs, les paysans, les homosexuels, etc. C’est qu’il apparaît deux fois, une fois dans la constante, une fois dans la variable d’où l’on extrait la constante. » Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit..
Ce qui m’intéresse pour l’instant dans cette définition c’est le terme d’idée (en grec ancien, idée ou forme c’est la même chose). L’institution serait une sorte d’idée incarnée ou de forme objective – Dieu, la science, la nation, ou la défense des ouvrier·es ou la haine de l’alcoolisme –, qui se dote des moyens d’exister matériellement et symboliquement, à travers des bâtiments, des vêtements, des gestes, mais aussi des images, des textes, des moments ritualisés, etc. L’institution est plus dense que de simples usages, même sédimentés : elle existe au-delà des comportements qu’elle régule, elle possède une forme propre. Autrement dit, l’institution se caractérise par une certaine transcendance, qui garantit sa durée, et c’est cette forme particulière de transcendance que les théoriciens du droit nomment idée.
Il y a un autre trait distinctif de l’institution dont ne parlent pas ces théoriciens, qui est sa tendance à l’hégémonieGilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit. ou au monopole. « L’idée d’œuvre » en question est toujours une certaine idée de Dieu ou du travail, en général celle des dominant·es, qui ne semble pouvoir se réaliser qu’en détruisant les usages non conformes. Pour ne prendre qu’un exemple, et pas celui de l’Église catholique, l’Académie royale de médecine est une institution qui recueille et normalise les gestes médicaux jugés valides, par opposition aux usages des rebouteux·ses et autres soignant·es (idem pour l’Académie française et la langue). Pour assurer la stabilisation, la diffusion et la reproduction d’une certaine idée de l’enseignement ou du soin sur le territoire national, on a détruit les langues et les savoirs vernaculaires. Ce qu’on entend couramment par institution (l’école, l’hôpital, etc.) s’est constitué historiquement par absorption, normalisation et répression de divers usages traditionnels.
J’appelle ce type d’institution majoritaire (ou majeure). Y a-t-il des institutions qui ne sont pas porteuses d’une telle tendance à l’hégémonie, qu’on pourrait appeler mineures ou minoritaires ? Évidemment, cette distinction n’est pas intéressante si elle vient seulement nommer un rapport de domination contingent – si les breton·nes avaient conquis Paris, sans doute les écoles Diwan seraient-elles majoritaires. Ce qu’on cherche, ce sont des formes collectives suffisamment solides pour donner vie à une idée, pour donner forme et moyens d’existence à un groupe en garantissant la régularité et la transmission de certaines pratiques, sans en passer par la destruction des autres manières de faire. Pour avancer dans l’énoncé du problème, allons voir ce que Deleuze et Guattari entendent par majeur et mineur.
I.2. Majeur/mineur
Dans Mille plateaux, « Postulats de la linguistique », Deleuze et Guattari développent la distinction majeur/mineur à partir de l’exemple de la langue. Majeur et mineur ne sont pas deux langues, mais deux rapports à la langue. Ils nomment majeur celui qui consiste à extraire des langues parlées un ensemble de constantes, règles de grammaire et vocabulaire établi, par exemple. La langue majeure, ce n’est donc pas la langue de l’Académie française par opposition aux dialectes régionaux : c’est l’opération de normalisation qui consiste à extraire des constantes à partir des variables que sont les usages réels de la langue. Il faut du pouvoir pour effectuer cette opération : elle se fait donc la plupart du temps à partir d’une variable qui correspond aux usages du groupe dominantTout geste partagé, comme toute pratique qui se répète, fabrique de la norme, qu’elle soit formellement exprimée ou informelle. Un usage, parce qu’il est une pratique habituelle, contient de manière immanente sa propre norme. La politique étant le domaine du collectif, ses gestes ont d’emblée le partage pour horizon. La question est alors celle de la forme qu’on donne à ces normes. Peut-être le domaine artistique permet-il de poser des gestes purs de toute norme grâce à son travail de la singularité, mais à moins d’assumer l’esthétisation de la politique, il me semble que ces deux domaines ne se recouvrent pas entièrement. Pour approfondir la discussion sur usage et norme, voir par exemple l’article « Éléments de décivilisation - Partie 2 », lundimatin, 9 avril 2019, disponible sur : lundi.am/Elements-de-decivilisation-Partie-2/, ici le langage bourgeois, qui réprime ou marginalise les autres usages. Inversement, la ou les langues mineures, ce ne sont pas simplement les sous-systèmes, tout aussi constants mais au pouvoir de normalisation inférieur (les langues régionales). C’est un autre usage de la langue, qui consiste à la mettre en variation plutôt qu’ à en extraire des constantes, comme le fait un travail littéraire ou un argot.
Le problème n’est pas celui d’une distinction entre langue majeure et langue mineure, mais celui d’un devenir. La question n’est pas de se reterritorialiser sur un dialecte ou un patois, mais de déterritorialiser la langue majeure. […] C’est pourquoi nous devons distinguer : le majoritaire comme système homogène et constant, les minorités comme sous-systèmes, et le minoritaire comme devenir potentiel et créé, créatif. Le problème n’est jamais d’acquérir la majorité, même en instaurant une nouvelle constante. Il n’y a pas de devenir majoritaire, majorité n’est jamais un devenir. Il n’y a de devenir que minoritaire. […] Bien sûr, les minorités sont des états définissables objectivement, états de langue, d’ethnie, de sexe, avec leurs territorialités de ghetto ; mais elles doivent être considérées aussi comme des germes, des cristaux de devenir, qui ne valent qu’en déclenchant des mouvements incontrôlables et des déterritorialisations de la moyenne ou de la majoritéLa contre-culture des balls a été popularisée par le film documentaire Paris is Burning, sorti en 1991. Le film est sujet à des controverses quant au regard de sa réalisatrice, blanche, et de la rémunération des personnes filmées. Judith Butler discute de ce film dans le chapitre final de Trouble dans le genre, trad. Cynthia Kraus, La Découverte, Paris, 2006..
C’est la notion de devenir qui m’intéresse, parce qu’elle opère une distinction qui n’est pas seulement d’échelle entre majeur et mineur. Pour résumer, le majoritaire c’est la constante (l’état, l’établi, l’institué) obtenue par extraction et normalisation des usages dominants dans un groupe donné. Le minoritaire, c’est à la fois la constante correspondant à des usages dominés – par exemple, « le féminin » stéréotypé – et la variation ou les usages qui font dévier cette constante – le devenir-femme ou le queer – que Deleuze et Guattari appellent aussi le devenir. Par exemple, le refus du travail, de la famille ou du binarisme de genre sont à la fois des pratiques déviantes des institutions majoritaires et des normes propres aux communautés anarchistes ou queers. Ce qui est une variation ou un écart par rapport à la règle dominante (masculine) peut fonctionner aussi comme règle ou constante par rapport à un sous-ensemble (féminin), et réciproquement.
On le voit, il y a un rapport dialectique entre ces deux termes. Mineur et majeur fonctionnent ensemble : il n’y a pas d’usage sans règleCentre d’étude de la Torah et du Talmud, généralement aussi lieu de vie des étudiants, dont les femmes sont traditionnellement exclues. ni de constante sans variation. Ce sont deux opérations qui se nourrissent l’une de l’autre : le majeur a besoin d’absorber de nouveaux usages pour conserver son pouvoir de normalisation, le mineur a besoin d’une constante pour maintenir sa puissance de subversion. Ces concepts viennent nommer comment l’usage se transforme en règle et comment la règle peut être transformée ou abolie par l’usage. Seulement, dans cette dialectique, on peut choisir son camp. Voyons ce qui se passe en appliquant la distinction deleuzo-guattarienne au concept d’institution.
I.3. Institution majeure et institution mineure
Ce qui distingue institution majeure et mineure n’est pas seulement leur position dans les rapports de pouvoir, mais un rapport différent à la constante ou à la variation. On dira que l’institution majeure produit de la constante par effacement de la variation, là où l’institution mineure fait proliférer les variations en se jouant des normes. État versus devenir.
Depuis Bourdieu, la sociologie n’a cessé de démontrer comment l’école reproduisait les différences de classes au nom de l’égalité. La langue effectivement parlée dans les salons bourgeois est bien plus complexe et variée que celle qui est enseignée à l’école. C’est une version standardisée des codes dominants qui est transmise par l’institution – les prolétaires même les plus doué·es auront ainsi toujours un train de retard sur leurs camarades bien-né·es. L’institution majeure est un appareil de reproduction des dominations parce qu’elle fabrique une constante à partir d’usages dissimulés. La constante ne peut s’imposer partout que parce qu’elle paraît sans lieu. Si on reprend notre définition initiale, on peut dire qu’une institution est majeure dès lors qu’elle organise la réalisation de son « idée d’œuvre » en la présentant comme universelle, d’où sa tendance intrinsèquement hégémonique et sa production standardisée de citoyen·nes, de soldat·es ou de croyant·es. Il est évident que l’État joue un rôle central dans cette opération de production de constantes.
La notion d’institution majeure ne pose pas vraiment problème. Elle correspond à un sens assez commun de l’institution, celui de forme sociale figée, voire sclérosée, et dominante. Le terme permet surtout de faire apparaître l’opération de standardisation sur laquelle elle repose. Celui d’institution mineure, en revanche, est nettement plus obscur.
Avant d’aller voir comment la psychothérapie institutionnelle met pratiquement en mouvement les institutions psychiatriques, prenons rapidement deux exemples très différents, l’institution talmudique et les balls de la culture queers afro-américaine. Les minorités – juives ou noires américaines, ici – n’ont pas les moyens de rendre leurs usages hégémoniques ; elles doivent donc inventer d’autres manières de faire communauté, de transmettre leurs pratiques ou de donner forme à leurs existences. Ces institutions ne sont pas minoritaires seulement parce qu’elles sont juives ou queer racisées, mais parce qu’en elles, bien que de deux manières très différentes, le cercle de l’usage et de la norme est du côté de la variation.
Les ballsInfra, « Irrécupérables », p. 133. usent de la norme hétérosexuelle des défilés de mode pour faire proliférer toutes sortes de catégories, de l’imitation la plus stricte du businessman en costume aux butchs en talons. L’effet ne produit pas une nouvelle norme de beauté queer et noire plutôt que masculine ou féminine blanche, mais donne une forme, plus ou moins flamboyante, à différents rapports vécus à la norme de genre. Plutôt que de produire une nouvelle constante, les balls font un usage parodique des catégories qui permet le jeu des variations, et affaibli l’emprise de la constante sur les participant·es aux balls – en renforçant par ailleurs les structures communautaires des différentes maisons qui accueillent les jeunes en rupture familiale, en créant une reconnaissance par les pairs, etc.
Les yeshivahsFrançois Tosquelles, « Que faut-il entendre par psychothérapie institutionnelle ? », dans Joana Maso, Soigner les institutions, L’Arachnéen, Paris, 2021. enseignent la loi juive. Pourtant celle-ci ne se donne pas à lire sous la forme d’un code juridique, mais sous la forme de discussions perpétuelles et perpétuellement sédimentées à travers les siècles dans les textes talmudiques. La seule manière de déterminer si et comment la règle s’applique à une situation, c’est d’entrer dans cette discussion infinie par l’étude répétée de toutes les discussions antérieures. Institution exilique, le Talmud n’a pas vocation à faire régner une loi unique sur un territoire donné, mais à faire perdurer une forme de vie juive hors d’Israël, sans tribunaux et sans juges. La loi ne se rencontre qu’ à travers son histoire. N’ayant pas les moyens de l’hégémonie, elle est immédiatement éthique et ne peut s’appliquer que dans les communautés où son usage est vivant.
Bien entendu, il existe désormais un État juif et des défilés de mode queers ; je ne reviens pas sur la dynamique de la récupération ou d’étatisation du devenir-mineur, étudiée ailleursSupra,« Sur la pédagogie institutionnelle », p. 71..
Résumons. Il y a du majeur et du mineur dans toute institution. Usage et norme fonctionnent en cercle. Cependant, dans ce cercle, retenons que majoritaire signifie État ou état (constante) et minoritaire, devenir (variation).
L’institution minoritaire n’est donc pas une petite institution, ni une institution marginale ou alternative. L’institution minoritaire est une institution en mouvement, c’est-à-dire quasiment une contradiction dans les termes. Si institution signifie forme stable, et minorité variation ou devenir, on peut formuler ce problème de diverses manières : comment ordonner des usages sans les standardiser ? Comment faire durer un mouvement sans le figer ? Comment donner forme à des forces sans les détruire ? Bref, comment instituer du devenir ?
II. L’analyse institutionnelle ou l’institution en mouvement
Notre but n’est ni une réforme, ni une révolution précise de l’assistance, qui viendrait la figer dans une nouvelle structure prévue, une fois pour toute, comme la meilleure. Notre but est le mouvement même par où quelque chose du désir des malades, dépassant ses distorsions ou ses blocages habituels, puisse accéder à la paroleSusana Caló, « Can an Institution be Militant ? », dans Metabolic Rifts. A Reader, Atlas Projectos, Lisbon/Berlin, 2019, p. 115–131, disponible en ligne sur : https://academia.edu/38568214/Can_an_Institution_be_Militant/.
Je vais me concentrer sur un exemple, parce que c’est une histoire qui mérite d’être racontée et qu’elle est la source d’inspiration derrière cette proposition théorique. Le contexte général est celui du mouvement de l’analyse institutionnelle, qui débute avec différentes expériences psychiatriques et pédagogiques dès les années 30 ou 40 en Europe et se formalise après la Seconde Guerre mondiale. Je vais surtout parler de Saint-Alban et de La Borde, pour des raisons de temps et parce qu’elles sont bien documentéesParti Ouvrier d’Unification Marxiste, mouvement communiste espagnol antistalinien fondé en 1935, qui participe activement à la Guerre d’Espagne.. Essayons de comprendre en quel sens on peut parler d’institution en mouvement.
II.1. Une histoire de la psychothérapie institutionnelle
Le mouvement de l’analyse institutionnelle (AI) part d’une intuition qui paraît assez évidente, celle de l’importance du milieu sur la relation soignant·e-soigné·e ou enseignant·e-enseigné·e. Plus exactement, l’AI refuse à la fois l’asile et le divan, l’institution disciplinaire et la relation interindividuelle de la psychanalyse libéraleLe documentaire Les heures heureuses de Martine Deyres (2019) donne à voir quelque chose de l’atmosphère qui régnait à Saint-Alban – on verra que l’ambiance est une question centrale de l’AI.. Elle déplace l’attention de l’individu au collectif. Pour soigner les malades, il faut soigner l’institution, malade de ses scléroses et de ses hiérarchies.
La psychothérapie institutionnelle naît pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que le terme ne soit forgé qu’une dizaine d’années plus tard. Le mouvement doit beaucoup à la figure de Tosquelles, psychiatre et psychanalyste catalan, communiste, ancien militant au POUMRéforme initiée en 1960 qui développe la prise en charge « hors les murs » de la maladie mentale et rompt ainsi avec l’enfermement asilaire qui caractérise la période précédente.. Il passe par les camps de réfugié·es espagnol·es en France avant de se retrouver à Saint-Alban, en Lozère, invité par des psychiatres antifascistes, dans un hôpital presque en ruines où iels ont le champ libre. Les murs sont détruits par les pensionnaires et leurs encadrant·es, les soignant·es recruté·es parmi les habitant·es, les uniformes abolis, un journal et différentes activités sont créées, divers ateliers de production ainsi qu’un réseau d’échange avec les campagnes environnantes sont mis en place, tout cela en multipliant les réunions et les prises de parole. La prise en charge collective de la vie matérielle et symbolique permet à la fois la resocialisation des malades et leur simple survie, dans une période où l’on a laissé mourir de faim en France 40 000 interné·es. L’histoire de Saint-Alban est liée à celle de la résistance, car l’hôpital a accueilli nombre d’opposant·es et de victimes du régime et de l’occupation, dont certains célèbres (Éluard, Canguilhem, Fanon, etc.)Par exemple, Valentin Schaepelynck, L’institution renversée, Eterotopia, Paris, 2018..
Après la libération, le psychiatre Jean Oury, passé par Saint-Alban et rejoint par Félix Guattari, entame à la Clinique de La Borde une expérience similaire. De nombreuses activités sont développées, et notamment un « club thérapeutique », sorte de comité autogestionnaire de l’hôpital où se retrouvent patient·es et soignant·es, ou seulement les patient·es, pour discuter des problèmes quotidiens, des différentes activités, répartir l’argent qu’elles génèrent ou dont elles ont besoin, organiser des fêtes, des sorties, etc. Sa fonction est précisément de travailler le collectif (soignant·es/soigné·es) et de « lutter contre l’indifférenciation » (Oury) en permettant la mise en place d’espaces distincts (ateliers, espaces, etc.) et en favorisant la parole singulière. Plusieurs générations de militant·es en rupture avec le PCF passent par cette clinique, encore ouverte aujourd’hui bien que sa dynamique n’ait pas entièrement survécu à la mort d’Oury.
Le mouvement de l’analyse institutionnelle ne se restreint pas au domaine du soin – je ne vais pas parler de la pédagogie institutionnelle, ni de l’analyse institutionnelle de Lapassade et Loureau. Il se structure autour de revues (Recherches, Chimères), de rencontres de soignant·es ou d’enseignant·es animé·es par ces questions (GTE, GTPSI, FGERI, CERFI). Le mouvement a une influence importante, qui se traduit dans le champ majoritaire par la réforme de la psychiatrie de secteurIci, j’entends par inconscient simplement l’idée d’une source du désir inaccessible à la conscience, et par désir ce qui nous meut, sans prétendre entrer dans les questionnements internes à la psychanalyse..
II.2. L’institution comme dispositif de subjectivation
Voilà pour la grande histoire, que d’autresGilles Deleuze, « Trois problèmes de groupe », préface à Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité, Maspero, Paris, 1972. ont raconté bien mieux que moi. Ce qui m’intéresse, c’est qu’elle fait apparaître l’institution comme un dispositif de subjectivation, caractéristique qui n’est pas propre à l’hôpital. Si on soigne les malades en soignant l’institution, ce n’est pas (seulement) parce qu’on améliore leur bien-être, mais parce que la structure psychique est directement branchée sur la structure institutionnelle.
L’intuition sur laquelle se fonde l’analyse institutionnelle, inspirée par Marx autant que par Freud, c’est que l’inconscientWilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, trad. Pierre Kamnitzer, Payot, Paris, 1998. est politique. On hallucine l’histoire, on délire les conflits de classes ou les guerres, on angoisse la pauvreté ou le changement climatique, et pas seulement un Papa-Maman mythique. Et réciproquement, les structures institutionnelles sont libidinales, investies par le désir : « 1936 (ou 1968) n’est pas seulement un évènement dans la conscience historique, mais un complexe de l’inconscientDans un tout autre registre, c’est bien avec l’inconscient collectif européen que joue Jean Genet quand il hallucine une scène de sexe entre Hitler et un jeune collaborateur français dans Pompes Funèbres, Gallimard, Paris, 1978 (A Bikini, 1947).. » Pour Deleuze et Guattari, la notion doit rendre raison de l’adhésion populaire au fascisme, qu’ils se refusent à réduire à une tromperie de masse ; comme ReichFélix Guattari, De Leros à La Borde, Lignes, Paris, 2022, p. 71., ils considèrent que les Européen·nes ont désiré le fascismeLes Unités Psychothérapiques de Base, « espèce de familles artificielles », sont composées d’environ 8 pensionnaires et 1 ou 2 moniteurices. En leur sein la différence soignant·e/soigné·e est abolie au maximum : pour quelque question que ce soit, prise des médicaments, emploi du temps, sortie, etc., les instances extérieures ne s’adressent pas aux personnes « normales » ou « saines », mais à l’ensemble de l’UPB en tant que groupe-sujet. « Et loin que cela les élimine, les individus en question, cela les requinque. » Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité, op.cit., p. 266..
L’institution a une fonction symbolique : elle fabrique des subjectivités en structurant l’inconscient collectif autour de son « idée » par des dispositifs très matériels. L’asile crée les malades comme la caserne fabrique des soldat·es ou l’école des citoyen·nes français·es en série. Et la discipline n’y est pas seulement répressive : elle rend hautement désirable le viril courage qui entoure l’idée de nation. L’institution détermine les objets du désir – être un homme, par exemple.
Que l’institution soit un dispositif de subjectivation signifie deux choses : d’abord, qu’on peut avoir prise sur l’inconscient en changeant les institutions ; ensuite, qu’il n’existe pas une subjectivité authentique qui préexisterait aux structures sociales. C’est pourquoi l’AI accuse l’antipsychiatrie italienne, dont elle est pourtant très proche, de « refuser au fou le droit d’être fou ». Pour l’antipsychiatrie, l’aliénation mentale se réduit à l’aliénation sociale. Pour ce courant, il suffit de détruire les structures aliénantes pour soigner les malades. Pour l’AI, il s’agit plutôt de travailler l’ordre institutionnel pour transformer les subjectivités.
II.3. Faire tourner les rôles
À Saint-Alban, on ne cherche pas d’abord à occuper les malades, mais à leur permettre de manger. Cependant, la mise en place d’activités liées à la vie économique qui donnent à l’hôpital une certaine autonomie matérielle est aussi pensée comme une manière de diversifier les lieux et les rôles. Ainsi, il n’y a pas que des malades et des médecins dans l’hôpital : il y a des couturier·es, des berger·es, des comédien·nes, des cuisinier·es, des promeneureuses, des joueur·ses d’échecs, etc. Multiplier les espaces différenciés donne à la subjectivité éclatée du·de la psychotique une chance de trouver de nouveaux points d’accroche.
Concrètement, cela signifie instituer des qualités d’ambiance différentes – que les espaces ne soient pas tous peints en blanc, qu’on s’y habille et qu’on y parle des langages différents, qu’ils ne soient pas tenus par des personnes formées dans les mêmes endroits, etc. L’intuition qui guide l’agencement collectif à Saint-Alban comme à La Borde, c’est la différenciation : l’existence du collectif vise à faire ressortir le caractère distinct des êtres et des chosesVoir aussi les constellations, ces conférences qui rassemblent tout l’entourage d’un·e patient·e sans distinction de statut pour discuter d’un problème lae concernant.. Cette diversification vise également les soignant·es, car iels participent directement de l’ordre institutionnel dont sont malades les malades.
Un des outilsTerme qui désigne à La Borde l’ensemble du personnel de l’hôpital, comptable et jardinier·e comme aide-soignant·e, à l’exception des médecins et de la direction. Cette exception a été très contestée. que Guattari imagine pour mettre en mouvement les rôles et les hiérarchies est celui de la grille, un tableau qui permet d’organiser la rotation régulière des différentes tâches.
Les moniteurs formés par les « roulements », pilotés par la « grille » et participant activement aux réunions d’information et de formation devenaient peu à peu bien différents de ce qu’ils étaient à leur arrivée dans la clinique. Non seulement ils se familiarisaient au monde de la folie, tel que le révélait le système labordien, non seulement ils apprenaient de nouvelles techniques mais leur façon de voir et de vivre se modifiait. Précisément, ils perdaient cette cuirasse protectrice au moyen de laquelle beaucoup d’infirmiers, d’éducateurs, de travailleurs sociaux se prémunissent contre une altérité qui les déstabilisentFélix Guattari, « La transversalité », Psychanalyse et transversalité, op. cit., p. 83. Pour la distinction entre rôle, statut et fonction, voir Valentin Schaepelynck, op. cit..
Il n’y a rien d’idyllique dans ce fonctionnement, qui rencontre des résistances, notamment des personnels qui craignent d’endosser un rôle de soignant·e pour lequel iels ne sont pas formé·es, permet des prises de pouvoir ou des évitements de responsabilité, engendre des abus, etc. Il y a d’ailleurs eu plusieurs grèves de la grille, occasion d’analyser les rapports de pouvoir dans l’institution.
Pourquoi cependant faire tourner les rôles plutôt que les abolir ? Ne pourrait-on pas imaginer une institution où il n’y a ni médecin-chef·fe ni infirmier·es ni cuisinier·es, mais simplement des membres d’un groupe de soin qui accomplissent différentes tâches ?
Il y a là certainement une résistance des dépositaires du pouvoir à destituer véritablement l’ordre qui les glorifie, résistance qu’il faut combattre (les médecins à La Borde continuent de percevoir un salaire supérieur à celui des moniteuricesGilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », dans L’autre journal, no 1, mai 1990.).
Il y a là aussi, peut-être, l’intuition que dans un milieu plat le désir trouve peu d’accroche. Ou encore l’idée que le déploiement de subjectivités différenciées a besoin de règles avec lesquelles jouer. Toustes, à La Borde, partagent la fonction soignante : mais cette fonction ne peut s’exercer dans un milieu uniforme, qu’il soit hiérarchique ou horizontal. L’existence d’un statut de médecin et de sa contestation (un·e médecin-chef·fe qu’on peut interpeller dans le club ou moquer à la vaisselle) permet la disponibilité de ce rôle au plan symbolique pour que d’autres personnes puissent s’y identifier et exercent la fonction médicale attenanteMichel Crozier, « L’administration française face aux problèmes du changement », dans Sociologie du travail, vol. 8, no 3, Seuil, Paris, 1966, p. 225-226. – que lae cuisinier·e puisse se prendre pour lae médecin. Le rôle du·de la médecin est ainsi éclaté, mais il ne disparaît pas ; au·à la médecin réel·le d’assumer à la fois les privilèges de son statut et l’épreuve de sa remise en cause, indispensable pour rendre le partage de sa fonction. C’est pourquoi le terme d’institution minoritaire me paraît pertinent : il s’agit bien d’user de la norme pour permettre la variation, qui ne peut s’exercer dans le vide. On reviendra sur cette idée que Guattari nomme transversalité.
II.4. L’institution en mouvement
Je crois qu’on peut dire que la psychothérapie institutionnelle fait usage de la distinction soignant·e/soigné·e pour permettre l’existence de diverses subjectivités, celles des patient·es comme du personnel de soin. La structure institutionnelle est conservée, mais trouée, modulée, moquée, de manière à offrir une multiplicité de points d’accroche au désir éclaté des psychotiques. Si l’enjeu est que « ça parle », il faut qu’il y ait plusieurs langues possibles. L’institution minoritaire assume la fonction symbolique de l’institution, mais elle ne forme pas les subjectivités selon un modèle unique – lae bon·ne élève, lae soldat·e dévoué·e, le bon père de famille (dont la caractéristique commune, d’ailleurs, est de se taire) et une discipline intangible. L’idée qui donne sa densité ontologique à l’institution est ici immanente : elle s’incarne dans des formes et des pratiques sur lesquelles les membres de l’institution ont prise par le jeu complexe et très imparfait des micro-institutions à l’intérieur de l’hôpital et des circulations avec l’extérieur.
Si les expériences de Saint-Alban et de La Borde ont été pour nous les matrices du concept d’institution minoritaire, c’est qu’on y trouvait à la fois une solide machine collective, l’accueil d’une multiplicité de manières d’être et l’opposition aux formes majoritaires, dans le champ de la psychiatrie et au-delà. De différentes manières, notamment la mise en place de lieux distincts et d’espaces de parole différenciés, de « techniques d’ambiance », le déplacement des rôles sociaux, la prise en compte des moments de crise, etc., on s’y est donné les moyens de travailler la singularité dans le groupe et la singularité du groupe. Tous ces dispositifs analytiques construisent une attention collective aux mouvements du désir. En ce sens, l’analyse institutionnelle tente effectivement d’instituer le devenir.
II.5. Limites
Derrière les roulements de la grille, il y a cependant l’imposante figure d’Oury. Les expériences de la psychothérapie institutionnelle font l’éloge du collectif (on y reviendra), mais semblent étrangement dépendantes du charisme de leurs fondateurs. En témoigne l’ironie involontaire de ce panneau, retrouvé lors de la démolition d’un bâtiment de l’hôpital de Saint-Alban : « L’infirmier ou l’infirmière qui aura camisolé ou aidé à camisoler un malade ou une malade sans l’autorisation formelle du Directeur sera renvoyé immédiatement. »
Aujourd’hui, il est difficile de partager l’enthousiasme de Guattari sans le teinter d’une certaine méfiance, pour nous qui vivons à l’ère du nouvel esprit du capitalisme :
Et l’on se prend à rêver de ce que pourrait devenir la vie dans les ensembles urbains, les écoles, les hôpitaux, les prisons, si, au lieu de les concevoir sur le mode de la répétition vide, on s’efforçait d’orienter leur finalité dans le sens d’une re-création permanente interne. C’est en pensant à un tel élargissement virtuel des pratiques institutionnelles de production de subjectivité qu’au début des années 60, j’ai forgé le concept d’analyse institutionnelle. Il s’agissait de remettre en cause […] de proche en proche, l’ensemble des segments sociaux, qui devaient être l’objet d’une véritable révolution moléculaire, c’est-à-dire d’une révolution permanente. Je ne proposais nullement de généraliser l’expérience de la Borde à l’ensemble de la société, aucun modèle en la matière n’étant transposable. Mais il m’apparaissait que la subjectivité, à tous les étages du socius où l’on voudra la considérer, n’allait pas de soi, qu’elle était produite dans certaines conditions et que ces conditions pouvaient être modifiées par de multiples procédures et de façon à l’orienter dans un sens plus créatif.
Modifier les conditions de production de la subjectivité pour l’orienter dans un sens plus créatif, c’est probablement l’objectif partagé par tous les RH de la Silicon Valley. Si on s’en tient à une lecture superficielle de l’analyse institutionnelle comme simple mise en mouvement des institutions traditionnelles, on risque de la réduire à la critique des rigidités bureaucratique dans les institutions disciplinaires (asile, école, usine, parti), critique partagée par l’extrême gauche et les revues managériales des années 60, aujourd’hui parfaitement intégrée. Dans l’entreprise contemporaine, quand une règle est inefficace, on la change ; quand une pratique innovante émerge, elle s’impose ; quand un·e PDG ne fait pas d’assez bons chiffres, on lae vire ou on coule la boîte. Qu’on la nomme stratégie du choc ou management par la crise, l’une des caractéristiques de notre époque dite néolibérale est la sape des institutions traditionnelles. L’école, l’hôpital ou la justice sont en perpétuelle réforme depuis 40 ans, cela ne suffit pas à en faire des institutions minoritaires. Nous vivons dans un monde en transformation constante dont le mot d’ordre épuisant est « adaptez-vous ». Si on veut tirer parti du potentiel révolutionnaire de la proposition politique de l’AI, on ne peut pas se contenter de définir l’institution minoritaire comme une institution en mouvement.
Dans un texte de 1990, Deleuze prend acte de la mutation advenue durant ce que son comparse a nommé « les années d’hiver ». La « crise des institutions » est le symptôme d’un changement de régime. On passe des sociétés disciplinaires, caractérisées par de grands milieux d’enfermement distincts, école, caserne, usine, aux sociétés de contrôle, où le champ social dans son ensemble est géré par les modulations du langage numérique qui est celui de l’entreprise. Le régime de domination est désormais celui du flux ; la variation est la nouvelle constante.
Il n’y a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c’est en chacun d’eux que s’affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple dans la crise de l’hôpital comme milieu d’enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d’abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armesQui correspond à l’actualisation près à ce qu’on trouve actuellement dans les manuels de sociologie des organisations. La première édition de ce livre date de 1965, il est réédité et mis à jour par Lapassade après 68. Georges Lapassage, Groupes, organisations, institutions, Economica/Anthropos, Paris, 2006..
Le mouvement de dissolution des structures et des identités traditionnelles est le mouvement même du capital. La posture réactionnaire cherche à l’arrêter, la puriste à y échapper. Le geste révolutionnaire consisterait plutôt à analyser et à retourner une partie de ce mouvement contre lui-même. Il me semble que c’est ce que propose l’analyse institutionnelle. Je vais donc revenir sur le contexte historique de cette proposition, celui du déclin de l’institution et de l’essor de l’organisation, pour comprendre ce qui meut l’entreprise contemporaine et comment l’institution mineure peut détourner les flux du capital.
III. Institution et organisation, discipline et contrôle
Nous n’assistons pas, en effet, comme ce fut le cas par le passé, à une crise temporaire survenant à l’occasion du passage à une nouvelle étape de l’évolution technique et économique, nous entrons dans une période où la crise est destinée à devenir permanente et où la qualité essentielle de toute structure institutionnelle devra être la capacité d’adaptation et de changement« [Lewin] réalise pendant la guerre une expérience à la demande de l’armée consistant à trouver la meilleure manière de convaincre les citoyen·nes de consommer des abats afin que la viande puisse être envoyée aux troupes. Dans les groupes de contrôle, un nutritionniste faisait un cours sur l’alimentation, la rareté et le patriotisme. Dans les groupes expérimentaux, le même cours était administré, les mères de famille se réunissant ensuite pour discuter de ce qu’elles devaient faire. Les groupes expérimentaux modifièrent beaucoup plus leur comportement que les groupes témoins. » « Kurt Lewin » (dernière modification le 23 avril 2025), Wikipédia, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin/.
Le mouvement de l’analyse institutionnelle participe d’un courant plus général de critique de la bureaucratie et de déclin de l’institution, au profit de l’éloge contemporain de l’organisation. La critique de l’institution a, en un certain sens, été institutionnalisée : le néolibéralisme est aussi une contre-révolution moléculaire, ce qui n’avait pas échappé à Guattari. Il s’agit de comprendre ce que les propositions de l’AI conservent malgré tout de leur portée révolutionnaire. Qu’est-ce qui distingue une institution minoritaire d’une entreprise contemporaine ? Et (en quoi) la première peut-elle permettre de lutter contre la seconde ?
III.1. Organisation vs institution
La sociologie des organisations
Recontextualisons. L’inscription de l’AI dans un courant réformateur interne à l’économie n’est pas un point aveugle du mouvement. Dans l’un des ouvrages fondateurs, Groupes, organisations, institutions, Lapassade fait l’histoire de l’étude des organisationsLapassade a découvert ces travaux dans le cadre du plan Marshall, qui introduit en France les innovations américaines dans le cadre de la reconstruction ; sont mises en place différentes structures dont l’AFAP (Association française pour l’accroissement de la productivité) qui organise de nombreuses « missions de productivité » auxquelles participent plus de 4 000 haut·es fonctionnaires, ingénieureuses, psychologues, syndicalistes, économistes : l’une des conclusions de leurs rapports est que le retard français ne vient pas tant d’un retard technologique mais plutôt de l’ignorance française « du rapport direct qui existe entre un niveau élevé de productivité et l’application de saines méthodes en matière de rapports humains ». Voir Valentin Schaepelynck, op. cit., p. 54., où se mêlent critiques marxistes de la bureaucratie soviétique et études américaines de la sociologie des organisations se donnant pour tâche de débureaucratiser l’entreprise. On jettera peut-être ainsi quelques doutes sur l’évidence du mot d’ordre « il faut s’organiser » !
La sociologie des organisations prend ses sources au XIXe siècle, avec des figures comme celle de Saint-Simon, qui publie à partir de 1819 une revue périodique nommée L’Organisateur, ancêtre des revues modernes pour la gestion des entreprises où il annonce déjà le remplacement des politiques par des gestionnaires. Je ne parlerai pas d’Auguste Comte qui joue évidemment un rôle important dans cette histoire, lui qui propose de transformer les clubs révolutionnaires en cercles de gestion des conflits de la société industrielle.
Au début du XXe siècle, les théoriciens classiques de l’organisation de l’usine (Taylor, Ford) se calquent sur le modèle disciplinaire des institutions majoritaires, qui est avant tout militaire. Stricte hiérarchie, concentration spatiale, parcellisation des tâches, séparation maximale de la conception et de l’exécution, etc. Dans les grands ensembles industriels qui se multiplient au XXe siècle, en URSS comme aux USA, on assiste à une bureaucratisation des usines (et des syndicats), c’est-à-dire à l’apparition d’une classe d’administrateurices qui ne sont ni les ouvrier·es ni les patron·nes et dont la tâche est d’organiser le travail sur des bases scientifiques et rationnelles.
La sociologie des organisations naît avec la critique du système tayloriste et de ses rigidités improductives. En 1924, Elton Mayo est appelé à la Western Electric Compagny pour conduire une étude, aujourd’hui célèbre, sur les facteurs du rendement. Il observe pendant deux ans une équipe d’ouvrières, en modifiant différentes variables comme les pauses ou la directivité des consignes, puis il mène des expériences sur un atelier où travaillent des soudeureuses et des monteureuses. D’une part, il montre que l’amélioration des conditions matérielles du travail augmente le rendement. Surtout, Mayo met en évidence l’existence d’un système informel de relations qui n’a rien à voir avec l’organigramme. Les soudeureuses et les monteureuses ne cherchent pas à maximiser individuellement leurs gains : il existe un code implicite de conduite qui régule les comportements au sein de l’atelier autour d’une logique d’entraide. Une analyse psychosociologique plus fine met au jour des phénomènes de sous-groupes, de rivalité, d’alliance. Un peu plus tard naît la dynamique des groupes, qui formalise et approfondit les recherches de Mayo. Le terme est proposé dans un article de 1944 de Kurt LewinValentin Schaepelynck, « Avant-propos », op. cit., qui crée l’année suivante au MIT un centre de recherche du même nom et développe ce qu’on appelle encore aujourd’hui la recherche-action.
On découvre que la rationalité bureaucratique dont fait l’éloge Weber implique un ensemble de « dysfonctions », qui correspondent plus ou moins à la résistance de « l’humain » à l’organisation machinique. On substitue un modèle organiciste ou vitaliste à un modèle mécanique. C’est la naissance du domaine des ressources humaines, promis à un brillant avenir. Selon Lapassade, la tâche de la psychosociologie sera de « retrouver le lien entre le formel et l’informel pour moderniser la bureaucratie ». Il serait trop simple de considérer les psychosociologues comme les simples flics du patronat, comme le font certain·es marxistes. Iels sont bien plutôt les agent·es de la réforme du capital, venu·es adapter les rapports de production aux forces productives. Pour LapassadeVoir le cours en ligne de l’IAE Lille - École universitaire de management, « Lecture des environnements institutionnels. La bureaucratie comme institutionnalisation de la domination légale-rationnelle », disponible sur : modules-iae.univ-lille.fr/M24/cours/co/01_03.html/, sont vrais à la fois le caractère réformiste de leur action et la valeur révolutionnaire de leur découverte.
L’analyse institutionnelle se distingue de la dynamique des groupes en ce qu’elle veut prendre en compte la dimension institutionnelle, c’est-à-dire politique, des relations : « sous les “rapports humains”, il y a les rapports de production, de domination, d’exploitationLa distinction entre organisation et institution est évidemment schématique, et la pensée économique n’est pas univoque. Le néo-institutionnalisme (école plus récente de la sociologie des organisations) montre comment des logiques institutionnelles jouent au sein de l’organisation, lui conférant un caractère distinctif auquel les individus s’identifient et qu’iels cherchent à préserver. », de race, de genre, etc. Mettre au jour ces relations de pouvoir implique parfois de faire éclater le groupe, lorsque le conflit est trop profond. C’est tout le travail de l’analyse institutionnelle, sur laquelle on reviendra, qui se donne pour tâche de faire advenir une autogestion véritable et non d’accompagner la modernisation de la bureaucratie.
Institution et organisation
Pour le moment, ce qui m’intéresse, c’est le terme d’organisation que toustes ces réformateurices – psychosociologues, dynamicien·nes des groupes, etc. – choisissent d’opposer à la bureaucratie (la première synthèse du domaine est un livre de 1958 de March et Simon, intitulé sobrement Les Organisations). Qu’est-ce que cela change de parler d’organisation plutôt que d’institution ?
La distinction entre institution et organisation est une banalité de l’enseignement des business schoolsRobert Lafore, « Qu’est-ce qu’une institution ? », L’individu contre le collectif, Presses de l’EHESP, Rennes, 2019.. La différence entre les deux, c’est ce que j’ai appelé la fonction symbolique de l’institution. L’organisation serait un agencement ponctuel servant à coordonner des individus pour réaliser certains buts déterminés, tandis que l’institution serait, elle, une œuvre sociale guidée par un sens auquel doivent adhérer les sujet·tes de l’institutionFrançois Dubet, Le déclin de l’institution, Seuil, Paris, 2002..
La science des organisations se passe en effet de toute référence à un système de valeurs, ou à ce que la théorie du droit institutionnel nommait « l’idée d’œuvre » qui conférait à l’institution une densité ontologique. Elle considère les structures collectives comme un réseau de relations affectives et stratégiques, où chaque agent·e déploie son activité de manière plus ou moins efficiente selon la division des tâches et la qualité des communications. Il n’y a pas besoin de savoir ce qu’on fabrique pour étudier et améliorer la dynamique d’un groupe d’ouvrières. Chez Crozier, figure française de cette école, ce programme de recherche aboutit à dissoudre jusqu’ à la notion d’organisation elle-même dans celle de « système d’actionFrançois Dubet, « Institution : du dispositif symbolique à la régulation politique », dans Idées économiques et sociales, no 159, Réseau Canopé, 2010. ». Les constructions institutionnelles perdent ainsi toute substance, et avec elles les rapports de pouvoir correspondants. Les termes actuels comme celui de collaborateurice, qui vient remplacer ceux de salarié·e ou d’employé·e, sont directement issus de ce type de théorie.
Le déclin de l’institution
Cette distinction n’est cependant pas une simple vue théorique. Elle correspond à une situation historique bien réelle dont cherche à rendre raison François Dubet dans Le déclin de l’institutionGrégoire Chamayou, La société ingouvernable, La Fabrique, Paris, 2019..
Dubet part d’un constat paradoxal : l’institution décline, et pourtant les services croissent. Aujourd’hui plus qu’hier la plupart de nos actions – manger, se déplacer, se loger, donner naissance, vieillir, etc. – passent par des médiations collectives dont le fonctionnement impersonnel échappe à l’individu. L’expression « déclin de l’institution » fait évidemment écho à l’ambiance générale d’indignation, réactionnaire comme progressiste, face à la destruction de l’hôpital, aux réformes de l’Éducation nationale, à la fin du service militaire, à la précarité des chercheureuses, etc. Dans le même temps, il n’y a jamais eu autant de monde qui fait des études, on a bien moins recours que dans les années 70 à l’automédication, les postes de dépenses de la Sécu ou de l’Éducation nationale n’ont pas cessé d’augmenter. Pourquoi a-t-on le sentiment d’un déclin ou d’une destruction ? Qu’est-ce qui décline exactement ?
D’après Dubet, ce qui décline c’est l’institution entendue comme dispositif de subjectivation, tandis que prolifèrent les organisations. Toute institution, mineure comme majeure, exerce une fonction symbolique. Le type historique de l’institution, c’est l’Église : Dubet identifie un certain nombre de traits, parmi lesquels l’affirmation de principes sacrés, universels, transcendants et incontestables, l’existence d’une hiérarchie chargée d’exercer la puissance de ces principes à travers des rites charismatiques, dans la mesure où les membres ont la vocation, elle-même évaluée par un ensemble d’épreuves internes à l’institution. Le fidèle accède à l’universel du principe en se soumettant à l’épreuve de la discipline, dont les règles permettent l’incorporation des principes et la formation d’une subjectivité nouvelle.
Ces différents traits se retrouvent presque mot pour mot dans l’école républicaine. On se contentera de l’exemple du·de la professeur·e, ou du·de la bien nommé·e « instituteurice ». Le rôle de l’instituteurice relève de la vocation : iel a foi dans les valeurs de l’école et incarne la transcendance de l’institution, de là le caractère charismatique de son autorité. Lae maître·sse n’est pas respecté·e en tant qu’individu ou professionnel·le compétent·e, mais comme représentant·e du Savoir. Iel ne rend de compte qu’ à sa hiérarchie, c’est-à-dire à celleux qui partagent le rapport à ces valeurs transcendantes, et non au monde extérieur (parents, enfants, autres institutions) dont l’école est séparée tel un sanctuaire. Or ce modèle de la vocation tend à être remplacé par celui de la profession : l’instituteurice est recruté·e sur ses compétences pédagogiques, son autorité ne doit venir que de ses capacités, ellui et son école sont évalué·es et doivent rendre des comptes aux financeureuses comme aux usager·es. Bref, l’école a cessé d’être sacrée. Pourtant, on lui demande toujours de transmettre le respect des autorités et le goût du savoir, autrement dit d’exercer une fonction symbolique. D’où le malaise des profs, pris·es entre ces deux postures sans pouvoir en adopter franchement aucune. D’après Dubet, le même mouvement de sécularisation qui a permis à l’école républicaine de se constituer contre l’institution ecclésiastique emporte aujourd’hui cette dernière au profit d’une organisation désacralisée dont la fonction est de transmettre un ensemble de contenus, et dont l’efficacité se mesure à cette aune.
Plus largement, l’avènement de l’ère des organisations se traduit par le déploiement d’une classe identique de gestionnaires dans tous les secteurs d’activités et par le recours à des cabinets de consulting pour améliorer les performances dans les hôpitaux comme à l’école, dont le nombre ne cesse de croître, accroissant avec lui la complexité de ces institutions. La seule différence avec les bureaucrates, c’est que ces nouvelleaux gestionnaires sont elleux-mêmes remplaçables, à la merci du dernier plan de restructuration.
Là où les vocations communes permettaient une régulation spontanée par l’adhésion implicite aux mêmes objectifs et aux mêmes modèles professionnels, il faut installer des professionnels de l’organisationPour ne donner qu’un exemple, voici les lamentations d’un journaliste surnommé le « parrain du néo-conservatisme américain », Irving Kristol, en 1975 : « Le problème qui se pose aujourd’hui pour la grande entreprise, c’est qu’elle n’a plus la moindre légitimité théorique. [….
Il nous faut cependant cesser de suivre Dubet ici. Ce dernier adhère en effet au discours que l’économie porte sur elle-même, comme si l’organisation était réellement cette forme souple, « neutre en valeur », quasi évanescente, qui plutôt que faire adhérer des sujet·tes à une idée transcendante au moyen d’une pesante bureaucratie, se chargerait d’arbitrer entre des intérêts, de prioriser les objectifs ou d’harmoniser les relations entre des individus grâce à des régulations immanentes. Car il faut bien les fabriquer, ces individus – personne ne sort du ventre maternel tout armé·e du jargon managérial, sachant parler la langue du flux et de la performance.
III.2. Micropolitique néolibérale
L’entreprise n’est pas une institution majoritaire à la manière des anciennes institutions disciplinaires – bien que celles-ci, usines ou prisons, n’aient pas disparues : comme le nucléaire s’ajoute au charbon, les nouvelles formes de contrôle se surajoutent aux anciennes, elles ne les remplacent pas. Attentive à la qualité des relations informelles, insérée dans son environnement, elle sait qu’elle doit perpétuellement adapter ses formes aux forces productives pour rester dans la course. Pour cela, elle déploie un nouveau sens, celui de l’organisation.
Marchandisation du contrôle
Pour y répondre, le discours des sciences humaines sur l’organisation doit être replacé dans son contexte, celui de la contre-révolution néolibérale. C’est ce que fait Chamayou dans La société ingouvernableMichael C. Jensen, William H. Mecking, « A Theory of the Firm », dans Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, 1976, cité par Grégoire Chamayou, op. cit., p. 104..
Qui contrôle les organisateurices ? Comment discipliner les managereuses ? On le sait : par le marché. Mais l’évidence de cette réponse a une histoire, celle de l’opération de marchandisation du contrôle qui constitue une autre généalogie du néolibéralisme.
Au cours du XXe siècle, le développement des sociétés par action implique la séparation de la propriété et du contrôle, des actionnaires et des gestionnaires. Il brise du même coup le fondement moral du capitalisme paternel, où lae patron·ne de l’usine qui en est aussi lae propriétaire a intérêt à prendre soin de ses biens, réunissant ainsi en sa personne « bien public » et intérêt personnel. Le livre qui révèle ce scandale, dans les années 30, enclenche un débat qui dure un demi-siècle. On découvre que la firme est un lieu de pouvoir, et on se demande comment la gouverner. Différentes théories s’affrontent après-guerre, parmi lesquelles celle de la responsabilité sociale de l’entreprise, qui propose de s’appuyer sur le sens éthique des gestionnaires, sorte de despotisme managérial éclairé, à laquelle s’opposent fermement les néolibéraux·ales.
Ce débat devient crucial dans le contexte de la contestation profonde de l’ordre économique et politique des années soixante – partout, ça se révolte, et les tenant·es de l’ordre établi en ont bien conscienceMadsen Pirie, Micropolitics, Wildwood House, London, 1988. De quel droit le management, cette oligarchie consanguine, exerce-t-il son pouvoir ? »]. L’article fondateur des nouvelles théories de la firme, de Meckling et Jensen, publié en 1976, est aujourd’hui le 3e texte le plus cité en économie. Or ces derniers définissent la firme comme « une certaine forme de fiction juridique servant de nexus [systèmefootnote:] pour des relations contractuelles ». Autrement dit, l’entreprise n’existe pas. Comparons avec la définition initiale de l’institution où il s’agissait justement pour les théoriciens du droit de doter l’institution d’un mode d’existence propre, irréductible à une somme de contrats. Le but ici est assumé : « concevoir la firme comme un nexus de relations contractuelles entre individus sert […] clairement à montrer que des questions telles que “quelle doit être la fonction objective de la firme ?” ou “la firme a-t-elle une responsabilité sociale ?” reposent sur une grave erreur de personnificationMadsen Pirie, Dismantling the State : The Theory and Practice of Privatization, National Center for Policy Analysis, Dallas, 1985. La mise en place d’une telle micropolitique implique cependant, pour être menée résolument, qu’au plan macropolitique le pouvoir étatique ait été lui-même marchandisé, par la financiarisation de la dette publique.. » Les nouvelles théories de la firme, aujourd’hui enseignées comme des doctrines neutres, sont explicitement conçues comme des armes pour la défense d’un capitalisme contesté.
Évidemment, la réponse n’est pas seulement théorique. En pratique, ce qui garantit que les entreprises ne soient pas dirigées par les bonnes ou mauvaises volontés de la direction, ou pire, que celle-ci cède à la pression des mouvements sociaux, c’est l’existence d’un marché du contrôle. Les managereuses sont directement incité·es, par un système de primes, de parts actionnariales ou de bonus, à viser la croissance économique de l’entreprise. Surtout, toute déviation significative par rapport à un comportement de maximisation du profit sera immédiatement sanctionnée par une chute du cours de l’action impliquant rachat, réorganisation et limogeage de l’équipe dirigeante. L’efficience organisationnelle est cotée en Bourse. Faire du management une marchandise : voilà comment le néolibéralisme protège le monde libre des risques d’un contrôle politique, conscient et finalisé de l’économie, en construisant l’ordre spontané du marché, contrôle de second ordre, impersonnel et mécanique. La liberté individuelle garantie grâce à l’autorégulation sociale ; toustes étant asservi·es à la machine, nul·le ne risquera de l’être à une autre volonté humaine.
Micropolitique néolibérale
Persuadé d’être l’inventeur du concept, Madsen Pirie définit en 1988 dans un ouvrage du même nomComme le disait l’ami infirmier venu nous parler de la psychothérapie institutionnelle cet hiver, aujourd’hui il ne s’agit plus de former des institutions minoritaires pour faire des choses plus excitantes que ce que permet l’ennui bureaucratique ; on construit des institutions minoritaires parce que l’institution majoritaire se casse la gueule (les moyens massifs qui forment le capital des institutions comme l’école ou l’hôpital se retournent contre elles, deviennent une manière de limiter l’exercice de leur fonction). la stratégie nécessaire pour opérer la privatisation des services publics, indispensable pour garantir la marchandisation du contrôle étatique lui-même : la micropolitique, ou « l’art de générer des circonstances dans lesquelles des individus seront motivés à préférer et à embrasser l’alternative de l’offre privée, et dans lesquelles les gens prendront individuellement et volontairement des décisions dont l’effet cumulatif sera de faire advenir l’état de choses désiré. »
Les politicien·nes néolibéraux·ales n’ont pas essayé de convaincre les masses du bien-fondé d’une régulation par le marché : sous forme d’un choix de société global, la bataille était trop dure à gagner. L’ingénierie sociale que propose Pirie consiste à doucement inciter les acteurices individuel·les à choisir le bus privé plutôt que le train public, à accélérer la cadence, à choisir la formation où l’on aura le plus de chance d’être pris·e, à pratiquer un acte chirurgical plutôt qu’une surveillance au lit, à publier deux articles au lieu d’un, etc., sans jamais contraindre trop directement. C’est ce qu’on appelle aussi aujourd’hui le nudging. Pirie, dans un autre ouvrage, recommande différentes tactiques pour opérer sans heurt ces privatisationsGilles Deleuze, « Trois problèmes de groupe », op. cit., même s’il y a bien sûr parfois besoin de faire sauter des verrous législatifs à coup de gaz lacrymogènes. L’hôpital continue de soigner, l’école d’enseigner et la prison d’enfermer, mais elles doivent le faire d’une nouvelle manière, plus performanteFélix Guattari, « Autogestion et narcissisme », Psychanalyse et transversalité, op. cit.. L’idée d’œuvre de l’institution n’est pas remplacée, elle est simplement désactivée. En s’inscrivant dans le champ du marché, les anciens dispositifs de subjectivation perdent leur pouvoir propre, sans cesser de fonctionner.
Il ne s’agit certainement pas de défendre l’institution (majeure) contre l’organisation. Cela reviendrait à être acculé·e dans la posture défensive qui est depuis 40 ans celle de la gauche. Les progressistes qui hier dénonçaient l’école de la reproduction défendent aujourd’hui l’école de la République contre les assauts du néolibéralisme, lorsqu’iels ne regrettent pas purement et simplement les coups de baguette sur les doigts. Il me semble que F. Dubet a raison de considérer que le déclin général de l’institution au profit de l’organisation est l’effet d’une tendance profonde, celle de la sécularisation des sociétés occidentales, et qu’il n’est pas évident d’attribuer au néolibéralisme la responsabilité de la mort de Dieu. Plutôt que de nous lamenter avec les nostalgiques de l’institution, oublieux·ses de toutes les existences brisées parce qu’elles ne rentraient pas dans le moule du·de la bon·ne élève, essayons plutôt de déceler quelles sont les formes capables de susciter du désir tout en résistant à l’intégration dans la grande machine productive. C’est depuis cette position qu’on s’intéresse à la notion d’institution mineure.
Le désir du capital
Je ne prétends pas découvrir en 2022 que notre monde est régi par la loi du marché. Ce qui m’importe, c’est que ce régime de domination diffère de celui, disciplinaire ou institutionnel, qui était encore en partie l’adversaire des mouvements révolutionnaires du siècle dernier.
La prétendue neutralité axiologique de l’économie est évidemment un mensonge : comme le montre avec brio Grégoire Chamayou, la construction du marché comme technologie de gouvernement est un projet construit, consciemment contre-révolutionnaire. Les nouvelles formes d’organisation sont fluides, mais il importe que le cash-flow coule dans le bon sens, celui de l’accroissement du capital. Cependant, il est vrai que le contrôle a changé de forme. Il est devenu indirect, et donc plus efficace. Il n’est pas nécessaire de prêter allégeance à la loi du marché quand on prend un poste ; au contraire, on voudra plutôt tester vos motivations, probablement votre esprit d’équipe. L’entreprise capitaliste moderne ne fait pas rentrer à coup d’exercices répétés et douloureux la valeur de l’argent dans le corps de ses futur·es cadres. C’est que le primat de la valeur actionnariale ne régit pas les organisations à la manière dont l’idée transcendante de Dieu ou de la nation régissent l’institution ecclésiastique ou militaire. Il est la règle du jeu d’un champ où se meuvent les acteurices et leurs intérêts stratégiques. Toustes n’ont pas besoin d’être animé·es par la recherche du profit ; il suffit qu’aucun désir directement antagoniste ne surmonte les mille et une petites incitations qui maintiennent les coups possibles dans les limites du jeu.
La différence entre institution et organisation se trouve bien au niveau de la fonction symbolique. Je n’ai pas ici les moyens théoriques d’analyser le capitalisme contemporain en tant que dispositif de subjectivation – ce que font ailleurs Deleuze et Guattari. Disons schématiquement que là où l’institution majoritaire structure les subjectivités autour d’objets transcendants (Dieu, la Nation, le Savoir) par la discipline, l’organisation coordonne les intérêts d’individus incité·es par des dispositifs immanents à se comporter en agent·es efficaces. Le déclin de l’institution est aussi le déclin du·de la sujet·te. Le mouvement du capital, en colonisant les anciennes structures, ronge également les identités qu’elles produisaient, rendant manifeste leur inconsistance – de l’identité professorale à la précarité du vacataire – sans les remplacer par d’autres.
Il y a bien une poignée de fanatiques directement branché·es sur le mouvement de l’échange ; pour la plupart, faire du profit n’est pas ce qui nous meut dans nos activités professionnelles ou quotidiennes. Et pourtant, le champ du marché, comme sous-jacent aux interactions qui se déroulent en son sein, en donne le sens : il indique la direction où convergent tous ces flux, celle de l’accroissement du capital. Ce qui nous anime, ce peut être autant de soigner un·e malade, de gagner de quoi manger ou de voir du pays ; de plaire à nos parents, de rassurer nos angoisses ou de nous autodétruire ; quel que soit notre désir, il travaille à accroître la valeur.
Autrement dit, la puissance du capital vient de sa capacité à libérer et mobiliser le désir en détruisant les structures qui le cristallisaient. Au lieu de le réprimer pour déterminer, plus ou moins violemment, les subjectivités du·de la citoyen·ne, du·de la fidèle, ou du·de la militant·e, le marché épouse les courbures du désir, lui fournit les moyens de se satisfaire, éventuellement l’intensifie, pour l’infléchir et en diriger le cours. C’est pourquoi il s’accommode d’une hétérogénéité identitaire et d’une licence sexuelle beaucoup plus grande que les sociétés disciplinaires. Il n’impose pas à toustes la même langue, il forme le langage chiffré de tous les discours. Il y a bien une production de constante, et même une homogénéisation visible du réel, mais elle n’opère pas du tout de la même manière que les institutions traditionnelles. Il resterait tout un travail à accomplir pour analyser le marché en tant qu’institution majeure et comprendre son fonctionnement en tant que dispositif de subjectivation.
Quoi qu’il en soit, c’est bien sur le plan du désir que doit se situer le travail de l’institution mineure :
On voit la différence avec Reich : il n’y a pas une économie libidinale qui viendrait par d’autres moyens prolonger subjectivement l’économie politique, il n’y a pas une répression sexuelle qui viendrait intérioriser l’exploitation économique et l’assujettissement politique. […] C’est l’économie politique en tant que telle, économie des flux, qui est inconsciemment libidinale : il n’y a pas deux économies, et le désir ou la libido sont seulement la subjectivité de l’économie politique. « L’économique, en fin de compte, c’est le ressort même de la subjectivité. » C’est ce qu’exprime la notion d’institution, qui se définit par une subjectivité de flux et de coupure de flux dans les formes objectives d’un groupeGilles Deleuze, « Trois problèmes de groupe », op. cit..
Aparté sur l’autogestion
Ce travail est aussi une manière de répondre à la suggestion de Grégoire Chamayou : contre le libéralisme autoritaire, « rouvrir le chantier de l’autogestion », dont l’anti-étatisme, la pensée de l’immanence et de l’autonomie faisaient selon lui le véritable adversaire, du moins sur le plan théorique, des contre-révolutionnaires néolibéraux·ales, le seul capable de représenter un danger pour l’avenir. Le terme apparaît assez peu chez Tosquelles ou Oury, beaucoup plus avec Lapassade ou Lourau, mais il est de toute façon cohérent avec ce qui se tente en général dans le courant de l’analyse institutionnelle.
Voici ce que dit Guattari de cette notion dans un très court texte de 68 intitulé Autogestion et narcissimeCe dont on discute, ce n’est pas seulement des affects ou des relations, ni même des rapports de pouvoir (dynamique des groupes) ; analyser le sens de ce qu’on fait, c’est se demander pourquoi on le fait, pour qui on le fait, avec qui, quels effets cela produit, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. :
L’autogestion, comme n’importe quel mot d’ordre, peut être mis à n’importe quelle sauce. De Lapassade à De Gaulle, de la CFDT aux anarchistes. […] La détermination dans chaque situation de l’objet institutionnel correspondant devrait permettre de clarifier la situation. […] Le ressort de l’autogestion d’une entreprise implique le contrôle effectif de la production, des programmes, des investissements, de l’organisation du travail, etc. De ce fait, un collectif de travailleurs qui se mettraient en autogestion dans une usine auraient à résoudre d’innombrables problèmes avec l’extérieur […] Les expériences d’autogestion pendant les grèves, la remise en place de secteurs de la production pour répondre aux besoins des travailleurs, l’organisation du ravitaillement, de l’autodéfense, sont des expériences très importantes. Elles montrent les possibilités de dépasser le niveau revendicatif des luttes. […] Le contrôle ouvrier pose en fait des problèmes politiques fondamentaux dès qu’il touche à des objets institutionnels mettant en cause l’infrastructure économique.
Ce texte permet de saisir ce que signifie une autogestion véritable : la définition collective de l’objet institutionnel.
Si on décrétait demain l’autogestion ouvrière, qu’est-ce qui changerait ? Probablement, les salaires augmenteraient parce qu’on se répartirait l’argent capté par la direction. Mais à partir du moment où l’unité de production en question dépend du marché pour réaliser les investissements nécessaires pour rester compétitive, on voit bien que les conditions de travail, donc d’existence, ne peuvent pas changer profondément. Autrement dit, l’inscription dans le marché interdit de poser la question fondamentale : qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ? Pour qui le fabrique-t-on, et comment le fabrique-t-on ? La question du sens n’est pas décorrélée de celle, très matérielle, des moyens de production. L’autogestion implique de pouvoir se poser ces questions, et de se donner les moyens d’y répondre. Concrètement, cela veut dire sortir du marché, transformer les manières de produire et les circuits de l’échange. Plus facile à dire qu’ à faire bien sûr.
IV. Conclusion Qu’est-ce qu’une institution mineure ?
Introduire dans l’institution une fonction politique militante, constituer une sorte de « monstre » qui n’est ni la psychanalyse ni la pratique d’hôpital, encore moins la dynamique de groupe, et qui se veut applicable partout, à l’hôpital, à l’école, dans le militantisme – une machine à produire et à énoncer le désir« Cette dimension ne peut être mise en relief que dans certains groupes qui, délibérément ou non, tentent d’assumer le sens de leur praxis et de s’instaurer comme groupe-sujet, se mettant ainsi en posture d’être l’agent de leur propre mort. » Félix Guattari, « La transversalité », Psychanalyse et transversalité, op. cit..
Y a-t-il donc quelque chose comme des institutions mineures, ou communistes ? Quelles en sont les formes ?
Peut-on donner forme à des pratiques qui leur permettent de durer dans le temps et de s’inscrire dans l’espace sans épouser l’ordre du monde qu’elles combattent ?
Contrairement aux institutions majoritaires qui construisent leur hégémonie en produisant, à partir d’une pratique particulière dominante, une constante abstraite universellement imposée aux autres usages, les institutions minoritaires usent de la norme pour permettre, dans une situation donnée, l’expression d’une variété de pratiques. Elles ne peuvent pas produire de constante car en elles la norme est toujours modifiée par l’usage. En d’autres termes, c’est une institution où l’instituant n’est pas détruit par l’institué, et réciproquement.
L’exemple de la psychothérapie institutionnelle devait faire sentir ce qu’un tel cercle pouvait pratiquement signifier dans le contexte particulier du soin de la psychose. De cet exemple, on tire que l’institution exerce une fonction symbolique : elle fabrique du sens. Si l’on peut soigner les malades en soignant l’institution, c’est parce que la psyché est structurée par les formes institutionnelles. En modifiant ces dernières (au niveau micropolitique comme macropolitique), on rend possible l’expression de singularités qui ne trouvent pas d’accroche dans le monde majoritaire.
Au-delà d’un contexte de soin, Guattari propose d’opérer une révolution moléculaire en multipliant ce type de formes institutionnelles, y compris dans les organisations militantes. Au lieu de proposer une réforme ou une prise révolutionnaire du pouvoir étatique pour transformer les institutions selon une autre idée du bien commun, il s’agirait que tous les lieux de production – de subjectivité comme de marchandise – se mettent à subvertir la norme majoritaire selon leur singularité propre. La proposition est séduisante, mais elle demande à être approfondie pour ne pas se contenter d’alimenter le mouvement du capital.
Ce qui distingue l’institution mineure de la forme-entreprise, c’est le sens de ce mouvement. Quel que soit le bien ou le service produit par l’entreprise, ce qui détermine les formes de l’organisation est sa capacité à réaliser des objectifs dont la définition échappe aux membres de l’organisation – en général, un profit. D’où l’homogénéité de ces formes et de la classe qui les met en place. Il y a bien sûr du sens qui circule dans nombre de lieux de travail. D’abord, parce qu’on ne peut pas vivre sans, et que les travailleureuses en fabriquent autant qu’iels le peuvent. Ensuite, parce que les possédant·es ont compris depuis quelques dizaines d’années qu’une participation des travailleureuses à l’organisation de leur travail augmentait la rentabilité. Cependant, il me semble que c’est la possibilité d’autodétermination des formes par le désir collectif qui distingue le plus clairement le travail dans une boîte ou un prestataire de service public et l’œuvre au sein d’un collectif autonome.
IV.1. Agencement collectif de production de subjectivité
On appellera institution mineure un lieu où le sens du mouvement qui relie les formes d’organisation aux usages est déterminé par les membres de l’institution, c’est-à-dire par l’existence d’un désir collectif. Tel usage plutôt que tel autre sera institutionnalisé, formalisé, s’il est jugé signifiant par le collectif, selon des critères qui lui sont propres, et pas ceux du champ majoritaire, État ou marché. Bref, une institution mineure est un lieu où l’on discute de ce qu’on fait et où cette discussion produit des effetsCollectif autonome rennais qui annonce la décision de mettre fin à ses activités après une dizaine d’années d’existence dans un texte disponible sur : lundi.am/Nos-hypotheses/. D’où la question favorite d’Oury, « qu’est-ce qu’on fout là ? », c’est-à-dire qu’en est-il du désir de l’infirmier·e, du·de la médecin, du·de la malade d’être là. C’est la possibilité de cette question qui fera la différence entre une institution mineure et une organisation qui délègue le problème du sens au champ majoritaire. Évidemment, c’est une question délicate, qu’on ne résout pas en demandant lourdement « comment ça va » en assemblée générale. La notion d’analyse institutionnelle désigne justement un ensemble de techniques possibles pour faire émerger du sens au sein d’une institution en analysant les expressions du désir collectif et individuel. Par exemple, répondre aux évènements ou aux paroles qui dérangent, à l’échelle micropolitique (un pétage de plomb, un départ) ou macropolitique (un mouvement social). Pour finir, on va essayer de dégager un certain nombre de traits de l’institution mineure pour faire travailler cette définition un peu abstraite.
L’institution mineure se distingue de l’organisation parce qu’elle est automotrice ; se donne à elle-même son propre sens en fournissant au désir des moyens d’expression.
Guattari définit l’institution comme un agencement collectif de production de subjectivité. Un groupe institué n’est pas un ensemble de sujet·tes, mais un processus de subjectivation collectif. Autrement dit, des institutions mineures sont des machines de production désirante. À quoi les reconnaît-on ?
IV.2. Quelques traits de l’institution mineure, ou « agencement collectif de production de subjectivité »
Savoir mourirInfra, « La naissance de la philosophie d’après Giorgio Colli », p. 21.
Une institution mineure ne vise pas le maintien de sa propre structure, et il y a autre chose dans sa précarité qu’une simple faiblesse. Contrairement aux institutions traditionnelles ou aux entreprises, elle est capable de mettre fin d’elle-même à sa propre forme. Soit qu’un conflit trop profond les déchirent, soit que les désirs individuels deviennent trop différents, soit même qu’on ait le sentiment d’être au bout de ce que l’institution pouvait produire, des institutions mineures prennent nécessairement le risque de la mort dès lors qu’elles mettent en jeu le sens de ce qu’elles font. La durée de l’institution dépend de sa capacité à maintenir en mouvement le cercle des formes collectives et des forces désirantes, d’où la nécessité de construire une intelligence des relations.
Exemples : la Maison de la Grève en 2020Félix Guattari, De Leros à La Borde, op. cit., le CIDOC de Illich. Fondé en 1961 au Mexique par Ivan Illich et Valentine Borremans pour lutter contre l’idéologie du développement, c’est-à-dire le déploiement universel des institutions occidentales, le « centre de dé-Yankeefication » réunit des participant·es du monde entier et en particulier des Amériques autour d’un système d’enseignement entièrement libre, qui fait une large part à l’histoire et la culture de l’Amérique du Sud. Illich s’appuie sur les séminaires qui y sont proposés pour rédiger ses pamphlets contre les institutions scolaires et médicales, entre autres. Près de 20 000 personnes y passent. Après huit années d’existence, une énorme fête est organisée pour mettre formellement fin au CIDOC.
La singularité
On comprend bien que si une institution mineure repose sur la production d’une subjectivité collective, celle-ci va prendre des formes à chaque fois différentes selon les personnes qui composent le groupe, le lieu, l’époque où il se trouve, les autres groupes avec qui il est en relation, ses moyens de subsistance, bref sa situation. Concrètement cela se traduit par des styles et des ambiances distinctes, à la fois entre les différentes institutions et à l’intérieur de chacune de ces dernières.
La perspective idéale serait donc qu’il n’existât pas deux institutions semblables et que la même institution ne cesse d’évoluer au cours du temps« Celle-ci implique qu’au sein des groupes soient prises en compte les productions conscientes et inconscientes de ses participants, et que le groupe soit capable de remaniements permanents voire même de se dissoudre s’il tourne à vide, ou n’a plus pour seule fonction que de défendre ses frontières ou préserver son entre soi. Le mot “transversalité” a connu le succès que l’on sait. Il est passé dans le vocabulaire commun. On en fait désormais une sorte de principe de “bonne communication” au sein des entreprises ou des administrations. Mais en se popularisant, repris par les DRH et les médias, il a perdu sa force intempestive. Toute référence à des processus inconscients a disparu, ainsi que l’idée de finitude et de remaniements constants. On oublie sa fonction opératoire et de critique des hiérarchies en place. La transversalité est versée au compte de la pérennisation des structures et de l’assouplissement de leurs rouages. » Paul Brétécher, « Transversalités, chaosmoses et cuisines », dans Chimères, no 77, 2012, disponible sur : https://cairn.info/revue-chimeres-2012-2-page-91.htm/.
TransversalitéDont le livre coordonné par Camille Soffer et Coline Zuber, Justice partout. Outils féministes pour répondre par nous-mêmes aux violences (Le passager clandestin, Lorient, 2025), issu d’un groupe de travail qui s’est intéressé au mouvement de la justice transformatrice.
L’horizontalité pure ne permet pas la production de désir, et ne résiste de toute façon pas longtemps à la différenciation de rôles, même informels. La verticalité signifie que la subjectivité du groupe est en fait celle de ses dirigeant·es. La transversalité correspond à des relations diagonales. Elle met en mouvement les différents rôles – pensons à la grille. Elle empêche que des bastions protégés de l’extérieur se constituent dans l’institution, dans la cuisine comme dans la direction. Elle implique que soient prises en compte les productions conscientes et inconscientes de l’ensemble du groupe et que celui-ci soit capable de remaniement permanent, voire de se dissoudre, pour leur être fidèle.
La transversalité est une dimension qui prétend surmonter les deux impasses, celle d’une pure verticalité et celle d’une simple horizontalité ; elle tend à s’effectuer quand une communication maximum s’effectue entre les différents niveaux et surtout dans les différents sens. […] La transversalité est le lieu du sujet inconscient du groupe, l’au-delà des lois objectives qui le fondent, le support du désir du groupeFélix Guattari, « La transversalité », Psychanalyse et transversalité, op. cit..
L’intermittence du collectif
La présence du collectif n’est jamais garantieVoir Jean Oury, Le Collectif, Champ social éditions, Nîmes, 1986 et Infra, Le Collectif de Jean Oury », p. 121.. La production collective du désir peut échouer, et aucune technique ne peut la garantir, à moins de tomber dans des formes fascistes qui produisent de la subjectivité en série. L’analyse institutionnelle, contrairement à la dynamique des groupes, ne se pense pas comme une science. Ses outils ne marchent pas à tous les coups – on ne convoque pas le collectif. Oury raconte une anecdote qui moque la naïveté de la hiérarchie : « Convoquez-moi la constellation » demande l’inspecteur [de l’hôpital public], et là, ça ne parle pas ! », car bien entendu le discours commandé n’a plus la même fluidité.
Prolifération plutôt qu’extension (à chacun·e son groupuscule)
Une institution mineure ne peut pas croître au-delà d’une certaine échelle, que je ne me hasarderai évidemment pas à définir. Disons simplement que la nécessité de maintenir un lien vivant entre les formes organisationnelles et les usages qui y ont cours interdit de concevoir un modèle général qui puisse s’étendre au-delà de la situation particulière où s’ancre une institution. En revanche, l’hypothèse minoritaire n’est pas une hypothèse élitiste. Si on prend au sérieux la proposition de révolution moléculaire, des institutions mineures doivent se donner les moyens d’essaimer, ce qui implique d’intervenir dans le champ majoritaire pour affaiblir son emprise.
Institution mineure et alternative
Une institution peut être dite mineure parce que ses propres formes sont en mouvement et parce qu’elle demeure dans un rapport conflictuel avec les formes hégémoniques. Une institution mineure qui se laisse enfermer dans un ghetto culturel ou une niche économique perd le mouvement qui la caractérise. L’Atelier Paysan, coopérative d’autoconstruction de machines agricoles, a récemment dénoncé l’échec des prétentions de l’agriculture bio à transformer les modes de production agricole en démontrant son statut de niche économiqueL’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, Seuil, Paris, 2021.. Leur propositionLa mise en place d’une sécurité sociale alimentaire à l’échelle nationale pour sortir l’agriculture biologique du marché paraît problématique dans un contexte où le rapport de force est aussi défavorable – on est loin de 1945 et de ses communistes armé·es. me paraît discutable, mais le constat est clair : des pratiques minoritaires perdent leur sens dès lors qu’elles cessent de menacer le champ majoritaire. Ce qui implique évidemment de ne pas abandonner le plan de la macropolitique, mais de s’y rapporter, peut-être, uniquement sur le mode de la destitution.
Remarques finales
1. La nécessité de construire des institutions pour travailler notre dépendance à la puissance organisationnelle du capital, et cela dans tous les domaines – production, enseignement, soin, justice, etc. Encore une fois, cela ne règle en rien la question des formes institutionnelles nécessaires à la lutte.
2. L’importance de prendre en charge la subjectivité collective, ou encore la fonction symbolique inhérente à tout groupe organisé. Il me semble que son déni est destructeur pour les membres du groupe comme pour le groupe. Assumer la dimension institutionnelle, c’est-à-dire la fonction symbolique me semble indispensable à l’existence d’organisations communistes capables à la fois de ne pas écraser les subjectivités en leur sein et de lutter contre le capital sur le terrain du désir.
Enfin, la notion d’institution mineure est peut-être aussi une manière de réconcilier autonomie désirante et autonomie organisée. La première repose en effet sur une conception du désir comme puissance spontanée, qu’il suffirait de libérer du travail, et la seconde sur un déni du désir lui-même. L’analyse institutionnelle permet de penser la subjectivité ou le désir comme une production dont il y a à prendre en charge collectivement les formes.
Le collectif de Jean Oury
J’ai découvert ce texte de Jean Oury en lisant le mémoire d’un ami, qui mobilisait le concept de Collectif pour comprendre ce qui se jouait dans un lieu où il avait travaillé comme éducateur spécialisé, le Village des jeunes de Vaunières. Dans ce hameau isolé vivent des mineur·es placé·es par l’Aide sociale à l’enfance, des services civiques et des salarié·es encadrant·es. Très régulièrement des colos ou des séjours de jeunes (souvent internationaux) viennent y passer quelques semaines. Le lieu fonctionne autour de la pratique du chantier collectif que partagent les habitant·es et personnes de passage. Après y avoir passé plusieurs années, cet ami a cherché à comprendre ce qui se tramait à Vaunières, comment fonctionnait le collectif, qu’est-ce qui rendait ce lieu thérapeutique pour certain·es jeunes… Il avait, entre autres, utilisé le concept de Collectif de Jean Oury pour tenter de démêler ce qui faisait collectif. En commençant cette année de réflexivité sur l’école de philo, il m’a semblé intéressant de voir en quoi le concept de Collectif pouvait nous aider à penser l’école de philo, le chantier n’étant ici pas avec des truelles et du ciment, mais avec des livres et des concepts. Je me demandais comment ce concept pouvait m’aider à comprendre les dynamiques de l’école : comment elle peut produire du collectif (au sens commun) malgré les différents statuts symboliques (les « profs » ou fondateurices vs les néophytes), les parcours de chacun·e ? Mais aussi, comment les références culturelles et politiques partagées par une large majorité des participant·es peuvent uniformiser l’ambiance, forçant celleux qui ne les partagent pas à singer ou mimer la complicité et comment le concept de Collectif de Jean Oury pouvait m’aider à mettre au travail cette uniformisation ?
Ce texte est donc à la fois une présentation du concept de Collectif chez Jean Oury et une tentative de le mettre en perspective pour le cas de l’école de philosophie.
Ce concept, assez touffu, Jean Oury tente de le définir lors de son séminaire donné à l’hôpital Sainte-Anne en 1984-1985. Je me base sur Le CollectifJean Oury, Le Collectif. Le séminaire de Sainte-Anne, Champ social Éditions, Nîmes, 2005. qui est une retranscription de ce séminaire. Ici, je vais tenter de restituer une partie du travail d’Oury, mais surtout de voir ce que ce concept de Collectif peut apporter dans la compréhension des mécanismes de groupe de l’école de philosophie.
Le Collectif chez Jean Oury n’est pas ce qu’on appelle un collectif au sens courant, ce n’est pas le collectif politique, ou même un groupe formé avec un objectif précis. Pour distinguer le concept de Jean Oury et le collectif classique, j’écrirai « Collectif » pour le concept de Jean Oury, et « collectif », avec c minuscule, pour le terme dans son acception courante.
Jean Oury est psychanalyste et psychiatre, il a longtemps été médecin-chef à la clinique de La Borde. C’est une figure de la psychothérapie institutionnelle, qu’il a beaucoup pratiquée et discutée. En préambule, j’aimerais faire quelques petites remarques parce que Le Collectif est un livre qui m’a donné beaucoup de fil à retordre, que j’ai longtemps erré dans les brumes de ce texte et qu’il n’est pas impossible que se glissent ici ou là quelques erreurs de compréhension voire des contresens. Naviguer dans ces concepts n’a pas toujours été une partie de plaisir, j’ai plusieurs fois été tenté d’abandonner. Mais je me suis accroché grâce aux passages plus lumineux qui me semblaient faire sens pour mon travail.
Jean Oury avait pour habitude de ne jamais écrire ses séminaires, ce qui donne lieu parfois à de longues digressions et à un discours peu structuré. Il est aussi lacanien, son séminaire est donc imprégné de concepts psychanalytiques et lacaniens, de formulations de Lacan ou « à la Lacan », ce qui le rend particulièrement ardu, touffu et complexe à comprendre. Enfin, dans ce séminaire Oury essaye de faire une traduction théorique de sa pratique : il tente de comprendre ce qui se passe à La Borde. À aucun moment il ne donne une méthode de psychothérapie institutionnelle ; son but n’est pas de théoriser LA psychothérapie institutionnelle, mais de faire saillir ce qui se joue à La Borde.
Jean Oury pose ce concept dans un contexte thérapeutique, dans un lieu de soin, ce qui n’est pas le cas de l’école de philo. Dans cette présentation, certains aspects du Collectif ne sont donc pas développés, parce que trop éloignés des questionnements liés à l’école de philo.
Je vous propose donc une lecture du séminaire dans ce qu’il peut apporter à notre réflexion et je laisse volontairement de côté ses implications trop psychanalytiques que, de toute façon, je maîtrise mal – et qui me semblent moins pertinentes pour notre objet d’étude de l’année qui est l’école de philosophie et les institutions mineures. Vous allez voir que je vais prendre des libertés avec les concepts d’Oury et de la psychanalyse. Car si le séminaire Le Collectif apporte beaucoup d’idées intéressantes, Oury les approche avec les concepts de sa discipline, la psychanalyse. Dans ce texte je vais donc les utiliser, les déformer, les reprendre avec une liberté qui étonnera ou dérangera ceux et celles qui les maîtrisent. Je les interprète, souvent en les simplifiant, pour les sortir de leur champ habituel et les amener dans mes réflexions sur l’école de philo, qui n’est pas un lieu de soin ou de pratique psychanalytique.
Je vais commencer par tenter une sorte de définition du Collectif, puis je vais montrer les critères – même si le mot ne convient pas – ou les conditions pour la fonction Collectif. Ensuite on verra comment le Collectif fonctionne. Et je terminerai par voir comment ce concept peut éclairer certains des questionnements qui traversent l’école de philosophie.
I. Tourner autour du collectif
Oury tente plusieurs approches pour cerner cette fonction Collectif. Il va tenter de la définir en tournant autour parce que le Collectif n’est pas définissable en soi, il ne peut être défini que par ses effets.
Chacune de ses définitions prises séparément est loin d’épuiser le concept Collectif tel qu’il est pensé par Jean Oury, ça reste une image, un concept touffu qui n’existe pas en tant que tel, et qui n’est concevable qu’en tournant autour, qu’en observant ses effets sur le réel. Cette première partie sera donc forcément décevante, car comme moi lors de ma lecture du séminaire, vous n’aurez pas de définition simple et claire du Collectif, mais des bribes, des entrées qui permettront de le mettre au travail dans le cadre de l’école de philo.
Parfois, mais rarement, Jean Oury tente de ramasser son propos, de le rendre lisible. À sa manière, il définit un bout de Collectif :
Le Collectif, c’est un ensemble de fonctions complexes. Par exemple, une des fonctions d’un Collectif X, ce serait de veiller à ce qu’il n’y ait pas de trop grande homogénéisation des espaces, qu’il y ait de la différence, qu’il y ait une fonction diacritique qui puisse distinguer les registres, les paliers, etc. ; et que chacun puisse articuler quelque chose de sa singularité, même dans un milieu collectifIbid., p. 108-109..
Le concept de Collectif pour Jean Oury n’est pas ce qu’on appelle habituellement un collectif. Ce n’est pas un groupe de personnes, une institution, un établissement… Il parle autant du Collectif, que de la fonction Collectif qu’il définit comme « une machine abstraite à traiter la double aliénation sociale et psychique ». Ce qui ne nous avance pas beaucoup.
Pour comprendre ce que signifie « une machine abstraite à traiter la double aliénation sociale et psychique », je vous propose de découper les différents termes qui composent cette phrase.
Une machine abstraite, c’est une référence directe au travail de Gilles Deleuze et Félix Guattari (qui passera beaucoup de temps à La Borde). Difficile de résumer ce concept, mais disons qu’une machine abstraite est une machine qui marche en se détraquant sans cesse, en se modifiant lors de chaque nouvel agencement. C’est une structure qui se déstructure en permanence.
L’aliénation sociale, c’est par exemple ce qui, dans une société, nous aliène, nous rend fou·lle. Dans le cas de la prise en charge du·de la fou·lle c’est l’aliénation créée par l’hôpital-caserne ou l’hôpital-prison, qui s’ajoute à la souffrance psychique liée à la maladie.
L’aliénation psychique, c’est l’aliénation du·de la fou·lle à sa maladie. Pour Oury, antipsychiatrie et psychiatrie classique sont insatisfaisantes, au sens où l’antipsychiatrie ne s’occupe que de l’aliénation sociale et la clinique psychiatrique classique ne prend en charge que l’aliénation psychique. Et le pari de la psychothérapie institutionnelle c’est de travailler sur la double aliénation, notamment avec ce qu’il appelle la fonction Collectif. En disant donc que le Collectif est « une machine abstraite à traiter la double aliénation sociale et psychique », il faut comprendre que le Collectif est une condition du soin ; pour que le milieu soit thérapeutique il faut que le Collectif soit présent.
Pour approcher d’un peu plus près cette notion, on peut faire un détour par Pierre Johan Laffitte et son article « Le concept de Collectif chez Jean Oury » :
Collectif, chez Oury, ne désigne pas une équipe, par exemple un « collectif de soins », ni même un regroupement, uni autour d’un idéal, comme on parle d’un collectif de citoyens. La présence d’un Collectif rend possible que de tels groupes n’écrasent pas, dans leur réalité, la part du sujet et de son fantasme, mais les y branche. Le danger de tout groupe est de n’y être qu’un membre, un moi parmi d’autres moi. Transversal à toutes les structures organisationnelles, le Collectif étaye au contraire l’essai de déployer le singulier, malgré et grâce à notre participation au groupePierre Johan Lafitte, « Le concept de collectif chez Jean Oury », dans Chimères, no 87, 2015, disponible sur : shs.cairn.info/revue-chimeres-2015-3-page-193 ?lang=fr&tab=texte-integral/.
Si, comme on l’a vu, le Collectif pour Jean Oury n’est pas un collectif comme on l’entend dans le langage courant, c’est plutôt ce qui rend possible de brancher la singularité du sujet et celle de l’institution. Le sujet en tant que personne désirante, dont la singularité se refonde en permanence avec son désir, est une singularité irréductible à une quelconque définition. Cette singularité vient se brancher sur la singularité de l’institution, c’est-à-dire sur sa machinerie qui permet le soin. Par singularité de l’institution, il faut penser à l’inverse de l’hôpital-caserne qui fonctionne de manière sérielle ; tous les hôpitaux fonctionnent de la même manière, sans adaptation aux individus qui y travaillent ou s’y font soigner ; alors que l’institution est elle singulière, particulière, en mouvement, grâce aux singularités, aux individus qui la traversent.
On dit bien qu’on essaie d’organiser un champ collectif (que ce soit un hôpital, un secteur, une école, etc.), un champ collectif qui n’ait de sens que si chaque personne est considérée dans sa singularité, si chaque personne « compte » pour quelque chose, et qu’il n’y ait pas d’amalgame, d’agglutination. Autrement dit, que chaque personne puisse compter comme sujetJean Oury, op. cit..
Le Collectif est donc la machine qui permet de brancher ces deux singularités sans les écraser, chaque singularité est vivante dans l’institution sans que celle-ci ne vienne uniformiser ou sérialiser les individus.
Pour continuer dans cette définition, Oury reprend la cybernétique. Pour lui, le Collectif est une boîte noire : on sait ce qui y rentre, ce qui en sort, mais on ne sait ni ce qui s’y passe ni ce qu’il contient vraiment. On ne sait pas ce qu’est le Collectif, mais on sait quand il a été là. On peut dire « là, il y a eu du Collectif, pendant telle réunion, telle activité… », mais on ne peut pas le décréter a priori, on peut simplement constater qu’il a été présent après coup.
Dans la même idée, le Collectif est une qualité d’ambiance, on ne le voit pas en tant que tel, mais par les effets qu’il a sur le groupe, sur le milieu. Il ne se manipule donc pas, mais on peut tenter de mettre en œuvre les critères de son apparition :
Oury parle de pathoplastie, c’est-à-dire que le milieu, les entours dit-il, ont des effets sur les patient·es, autrement dit le milieu est thérapeutique. Pour qu’il y ait du soin il faut donc modifier le milieu, l’agencer pour qu’il soit effectivement thérapeutique.
Pour terminer je dirai que si le Collectif est insaisissable entièrement, on peut l’approcher par ses entours donc, ses effets, ses marques dans le réel. Un dernier détour par la cybernétique permet de le définir comme ces machines dont nous sommes à la fois le rouage, le carburant et le produit. Toujours rouage, souvent produit et parfois carburant.
Pour résumé, on peut tenter de définir le Collectif comme boîte noire de la cybernétique ou comme machine à traiter la double aliénation. Une fonction agençant le milieu et branchant les singularités des sujet·tes et de l’institution. Ces différentes portes d’entrée sur le Collectif sont, chacune à leur manière, une façon de définir un bout du Collectif, et c’est ces différents éléments et chemins que l’on va mettre au travail plus tard pour voir ce que ce concept peut amener à l’école de philo.
II. Conditions
Je vais tenter de tracer quelques lignes pour ce qui pourraient être des conditions de la présence du Collectif. Je pense que Jean Oury serait très insatisfait de cet exposé, et particulièrement de parler de conditions pour l’émergence de la fonction Collectif – Oury n’a aucune intention de donner un manuel pour la psychothérapie institutionnelle avec son séminaire sur le Collectif, c’est plutôt le fruit de ses réflexions sur la vie à la clinique de La Borde. Mais en creux, on peut quand même déceler ce qui pourrait ressembler à des conditions pour qu’il y ait du Collectif, des conditions minimales pour que le travail des soignant·es ne soient aliénant ni pour elleux ni pour les soigné·es.
La seule condition qu’Oury énonce clairement est l’hétérogénéité. Il le dit, le répète, le martèle tout au long de son séminaire. Il faut donc de l’hétérogénéité dans le milieu, des différences d’ambiances, des différences dans les personnes. Qu’on sente une réelle rupture d’ambiance entre la bibliothèque, le jardin ou la cuisine, que ces lieux aient une atmosphère, une qualité d’ambiance, dit Oury, spécifique et propre à eux-mêmes.
Pour que cette hétérogénéité existe, il faut aussi que ces lieux soient accessibles, qu’il y ait de la libre circulation et que le·a jardinier·e, le·a cuisinier·e ou le·a plombier·e soient en lien avec les patient·es. Le contact avec les patient·es n’est pas réservé au personnel médical, il n’y a pas de rupture dans les rôles du personnel, du·de la jardinier·e au·à la médecin, toustes ont un rôle de soignant·es.
Mais lorsqu’on parle d’hétérogénéité ça se joue aussi à un autre niveau. C’est aussi avoir une attention à ce que tout le monde n’ait pas le même langage, que les représentations, les désirs ne s’agglutinent pas au même endroit. Qu’il y ait la variation la plus large possible entre les individus. Cette hétérogénéité est donc une condition de l’apparition du Collectif, mais il en est aussi une production. Dans le sens où un groupe, une situation dans laquelle émerge du Collectif, produit de l’hétérogène. Le collectif doit alors en prendre soin, le faire vivre, le faire exister. L’hétérogène est donc à la fois une condition et une production du Collectif.
Un petit aparté technique, pour faire sentir les enjeux thérapeutiques de cette réflexion d’Oury à propos de la cure pour les schizophrènes. Cela est dit en passant, trop rapidement, mais ça nous permettra de poser la distinction d’avec la situation de La Borde et d’interpréter plus librement ses réflexions en direction de l’école de philo et d’autres situations semblables. Si l’hétérogénéité, les différences d’ambiances, sont si importantes, c’est que l’individualité du·de la schizophrène est éclatée, elle part dans tous les sens. L’hétérogénéité permet de donner une pluralité d’éléments auxquels se raccrocher, des lieux, des espaces, des temporalités où fixer son désir, où lui donner une accroche. Autrement dit, on parle de cure multi-transférentielle. Un·e névrosé·e classique, vous ( ?), moi, dans la cure psychanalytique va faire un transfert avec sa·on analyste. Le·a schizophrène, le·a psychotique n’a pas le Moi assez unifié pour ce transfert unique, et l’hétérogénéité des ambiances, des personnes, va lui permettre d’avoir des bouts de transferts qui s’enclenchent ici et là, d’avoir une multiplicité de micro-transferts.
Chaque groupe ou collectif s’organise selon un signifiant-maître, un S1 comme les spécialistes l’écrivent. Signifiant-maître est un terme technique qu’Oury reprend à Lacan. Je vais le dire très simplement – même si Oury, et Lacan encore moins, ne serait pas d’accord –, ici, à l’école de philo, notre S1, c’est le désir de faire de la philo. Pour le dire autrement, on s’organise sur la base d’un commun, d’une idée commune, qui pourrait être tout simplement : l’envie de philosopher. À la différence que le S1, ce n’est pas un désir unique et uniformisé, mais au contraire qu’il est « l’intégral des désirs présents », dit Jean Oury. Pour lui, il y a du Collectif quand il y a production commune de S1 et quand cette production est partagée. C’est-à-dire que la fabrique du commun dans la clinique de La Borde est partagée, elle n’est pas l’apanage des soignant·es ou des cadres de la clinique. Ce S1, que j’appelle vulgairement « commun », est le démarrage, le point de départ du Collectif. Chaque jour, dans chaque projet, si le S1 n’est pas partagé alors les patient·es sont laissé·es de côté.
Autre condition, une équipe (médicaux·ales, technicien·nes, jardinier·es, secrétaires, femmes de ménages…) qui se demandent : « Qu’est-ce que je fous là ? » Oury pose tout le temps cette question et invite le personnel à se la poser en permanence. Soigner c’est se tenir aux côtés des psychotiques, c’est sans cesse se poser la question de son rapport aux patient·es. Oury insiste sur l’importance du désir de soigner, sur l’éthique du soin. « L’éthique c’est, dit Lacan, l’articulation entre son désir et sa propre actionIbid., p. 80.. » Et donc sans désir de soigner, il n’y a pas d’éthique du soin possible. Et Oury crée deux catégories dans les équipes de soignant·es (soignant·es au sens large, le·a cuisinier·e est un·e soignant·e) : les ça-ne-va-pas-de-soi et les ça-va-de-soi. Et il faut absolument des ça-ne-va-pas-de-soi qui posent des questions, qui viennent interroger les évidences, qui grattent là où ça fait mal… Sans ça le service se sclérose, prend des habitudes, tombe dans une monotonie, un quotidien qui étouffe l’hétérogène et les différences d’ambiances. L’institution ne roule plus que pour elle-même avec ses évidences. Sans les ça-ne-va-pas-de-soi « on devient gardien de nécropoleIbid., p. 212. », dit Oury.
Résumons, Jean Oury ne parle pas de conditions pour l’émergence du Collectif, mais à la lecture de son séminaire il s’avère que sans certains éléments, le Collectif ne peut advenir. Des conditions qui parfois peuvent aussi être des conséquences du Collectif. Je pense à la production partagée du signifiant-maître ou à l’hétérogénéité. Mais le rôle des soignant·es est capital, le Collectif est possible quand iels se demandent « qu’est-ce que je fous là ? » et qu’il y a des ça-ne-va-pas-de-soi…
III. Le Collectif comme fonction
Si on doit se poser la question « qu’est-ce qu’on fout là ? », on pourrait aussi se poser la question au niveau du groupe, du collectif. Ici à l’école de philo, qu’est-ce qu’on fout là ? Et le collectif, qu’est-ce qu’il fout ? Pour essayer de déplier ces questions, on va voir comment fonctionne le Collectif, ou plutôt comment certaines fonctions peuvent être liées à lui. Comme on l’a vu, Oury utilise le concept de la boîte noire venue de la cybernétique pour cerner le collectif. Dans cette même veine, on peut dire que c’est une fonction, au sens mathématique du terme, comme opération qui transforme une donnée initiale en quelque chose de nouveau.
Jean Oury lie le Collectif à d’autres fonctions, les fonctions phorique, diacritique, décisionnelle et stratégique. Là encore, c’est une lecture que je fais, ces fonctions sont exposées dans le séminaire, mais ne sont pas toutes clairement ni toujours bien définies.
Tout comme il insiste sur l’hétérogénéité, Oury insiste sur la fonction diacritique. C’est-à-dire la fonction de distinction, de distinguer. Cette fonction est partagée dans le collectif, c’est la capacité de repérer l’hétérogène et surtout de lui permettre d’exister sans l’écraser par un mouvement homogénéisant. Les ça-ne-va-pas-de-soi, comme dit Oury, vont tenter de distinguer les évènements qui ne vont pas d’eux-mêmes, qui font sens, qui viennent perturber le réel. Une fois qu’on a distingué un évènement (fonction diacritique) il faut ensuite décider collectivement, par la fonction de décision, comment on le définit.
La fonction de décision est peu présente dans le séminaire Le Collectif , mais Oury en esquisse une définition. Je pense que c’est intéressant pour nous. Ce n’est pas ce qu’on appelle habituellement une décision, mais c’est une fonction partagée s’il y a du Collectif ; elle permet de repérer les évènements qui font sens, qui perturbent l’état des choses. Cette fonction est différente de la fonction diacritique qui consiste simplement à distinguer les évènements, à saisir ce qui est saillant. La fonction de décision consiste à acter que tel ou tel évènement vient bousculer le réel, vient modifier l’état des choses.
Il y a ensuite la fonction stratégique, qui n’est pas partagée et qui consiste à faire des choix stratégiques suite à ces évènements qui font sens. Décider ce qui fait sens, ce qui vient bousculer l’institution, est une fonction partagée et c’est la fonction décisionnelle. Par contre, la fonction stratégique est réservée aux soignant·es. Oury vient là battre en brèche les défenseureuses de l’autogestion dans les institutions psychiatriques, pour qui la fonction stratégique doit aussi être partagée.
Il y a donc une chaîne de fonctions : la diacritique (repère les évènements), la décisionnelle (lesquels font sens et perturbent) et stratégique (qu’est-ce qu’on en fait ?). Ce qu’on appelle couramment une décision serait alors la fusion des fonctions stratégique et décisionnelle. Si la distinction entre ces fonctions a du sens dans le cadre clinique, dans le cadre de l’école de philo il n’y a pas lieu de réserver les décisions stratégiques à certain·es.
Oury parle aussi de la fonction phorique du Collectif. Il la définit comme « porter [quelqu’un·e /un évènement…] sur les épaules psychiques du groupe ». L’accueil, par exemple, n’est pas l’apanage de quelques-un·es, ni le rôle d’un·e accueillant·e, mais il est partagé par le Collectif, il est pris en charge par la fonction phorique du Collectif, qui prend sur ses épaules psychiques le rôle d’accueil. Quelqu’un·e qui va extrêmement mal, qui est en crise, n’est pas porté·e par un·e soignant·e, par une équipe, mais par les épaules psychiques du groupe, du collectif.
IV. Le collectif et l’école de philo
Une fois ce concept de Collectif vaguement débroussaillé, et que l’on a dressé un tableau de ce que pourrait être (ou ne pas être) le Collectif, on peut essayer de déceler en quoi cette fonction Collectif peut être utile pour comprendre certains des enjeux de l’école de philosophie.
D’emblée, disons-le, tout n’est pas pertinent dans ce concept de Collectif pour nous aider à penser l’école. Oury le dit, le répète, la psychothérapie institutionnelle n’est pas un modèle. Elle peut être inspirante, mais n’est certainement pas une doxa à appliquer dans tous les champs de la vie. Son séminaire Le Collectif n’est pas un manuel, il essaye simplement de déceler ce qui fonctionne ou pas à la clinique de La Borde. En aucun cas il ne désire faire école, et il ne parle dans ses séminaires qu’aux praticien·nes de la psychothérapie institutionnelle. Tout semble mener à croire que le concept de Collectif devrait rester dans les plates-bandes de la psychothérapie institutionnelle.
Aussi, le Collectif pour Jean Oury est conceptualisé dans le cadre thérapeutique d’une clinique, ce qui n’est pas le cas de l’école de philo. Cependant, les exemples que Jean Oury expose dans son séminaire permettent d’élargir le concept et de l’amener hors du champ thérapeutique. Ainsi, il explique comment l’organisation d’un voyage en Côte d’Ivoire par un cuisinier et des patient·es, était un exemple du jaillissement du Collectif. Ce voyage est thérapeutique au sens clinique pour les patient·es, mais il l’est aussi pour le cuisinier et les autres infirmier·es qui y participent ; il y a du Collectif qui émerge dans cette organisation de voyage. On pourrait tout à fait étendre cet exemple à toute institution. Parfois, à un moment, il y a du Collectif (on a vu plus haut les conditions pour qu’il puisse émerger). C’est pourquoi il me semble légitime d’apporter cette notion venue de la psychothérapie institutionnelle au cas de l’école de philo. Tenter de l’amener ici pour penser à l’école reste un geste à faire avec précaution, et je vais essayer de montrer en quoi la fonction Collectif peut éclairer l’école de philo.
On peut déjà tenter de comprendre ce qui fonde le groupe « école de philo », ce qui fait que l’on se retrouve ici. Il y a d’autres groupes qui ont bien mieux travaillé sur le sujet que moi, mais je dirai qu’il y a deux facteurs qui nous réunissent : l’école comme espace de socialisation et l’école comme lieu de réflexion théorique. Espace de socialisation et de réflexion donc ; à partir de là je fais l’hypothèse que l’école de philo peut être un lieu de formation de subjectivité.
D’abord, dans le sens où l’espace de socialisation qu’ouvre l’école de philo est forcément un lieu de composition ou recomposition de soi par les relations avec les autres, par l’influence du groupe, par sa place dans le collectif (au sens habituel du terme). Que la vie de groupe réagence, ne serait-ce qu’ à minima, notre individualité.
L’école, comme lieu de réflexion, est aussi lieu de subjectivation par l’apport philosophique et politique qu’ouvre l’école, et je ne parle pas seulement des cours magistraux mais aussi des ateliers, des différents groupes et de toutes les discussions informelles qui émaillent les semaines ou les weekends philo.
Si on accepte cette première proposition de l’école comme lieu de subjectivation, on peut se demander quels pourraient être les outils pour éviter que la subjectivation à l’œuvre dans l’école ne soit ni uniformisation ni sérialisation. Se poser la question du pouvoir normatif de l’école, institution qui charrie des signifiants puissants, à travers le concept de Collectif me semble donc un travail pertinent.
Il me semble difficile de dire si le Collectif a été présent, s’il a traversé des moments, des espaces dans l’école de philosophie. En tout cas, je ne vais pas me risquer à cet exercice, et il faudrait lancer un chantier de réflexion, notamment avec celles et ceux qui ont mené des enquêtes sur l’école, pour analyser ce qu’il en est de l’hétérogénéité, du partage des fonctions diacritique ou de décision, de la place des ça-va-de-soi et des ça-ne-va-pas-de-soi… Par contre, je vais essayer de montrer à travers l’exemple de l’hétérogénéité et de la fonction diacritique ce que le Collectif peut amener à la réflexion sur l’école.
L’hétérogénéité des ambiances, des personnes est une première condition. Il faut déjà se rappeler que lorsque Jean Oury parle d’hétérogénéité, c’est dans l’idée que les patient·es psychotiques aient ainsi une multitude d’accroches à leurs désirs, une pluralité de lieux, d’ambiances, de personnes sur lesquels des bouts de transferts peuvent avoir lieu… N’étant pas un lieu d’accueil de psychotiques, ce premier critère pourrait sembler impertinent. Cependant, dans un processus de subjectivation, on peut imaginer assez facilement qu’une ambiance uniforme risque de ne pas être le meilleur milieu pour la formation de subjectivités propres et hétérogènes. Il semble donc que l’hétérogène, au sens de Jean Oury, pourrait faire partie des éléments à penser pour le futur de l’école.
Je pense que la fonction diacritique, c’est-à-dire de distinguer les éléments, peut être également un concept qui éclaire le futur de l’école. Car s’il y a de l’hétérogène, encore faut-il le voir, le distinguer, qu’il ne se fasse pas écraser par le groupe. Et c’est là le rôle de la fonction diacritique. On a souvent dit que le groupe « école de philo » était trop homogène. Je fais plutôt l’hypothèse inverse : les subjectivités présentes à l’école sont hétérogènes, mais le groupe a un pouvoir normatif qui les écrase. On pourrait alors dire que le rôle de la fonction diacritique serait de remettre au jour la distinctivité de chacun·e, de la « valoriser », de lui permettre de se brancher à la machine collective sans perdre sa qualité hétérogène.
On pourrait aussi se demander si l’école de philosophie est un « un champ collectif qui n’a de sens que si chaque personne est considérée dans sa singularité » ? Autant dire, est-ce qu’on peut se brancher à l’institution école de philosophie en respectant sa singularité ? La fonction Collectif étant la fonction qui permet, lorsqu’elle est présente, de garantir ce branchement des singularités avec l’institution.
Dans la même veine, poser la question du partage de la fonction de décision (décider quel évènement fait sens) ou stratégique (prévoir ce qu’on fait de cet évènement) a du sens. On pourrait alors imaginer des champs d’expressions aux ça-ne-va-pas-de-soi, se demander collectivement et individuellement « qu’est-ce que je fous là ? »… Le Collectif donne des outils pour penser conceptuellement certaines des problématiques qui agitent l’école de philosophie.
Tout n’est pas à reprendre dans le concept de Collectif et il faut toujours garder en tête qu’il a été pensé dans le champ de la clinique et de la psychothérapie institutionnelle. Cependant, sa manière de voir les dynamiques de groupe, d’imaginer des fonctions partageables, de penser la vie collective sont des éclairages nouveaux pour des enjeux qui dépassent largement le champ de la psychothérapie institutionnelle.
Irrécupérables
Le parti est trop rigide : embryon d’appareil d’ÉtatGilles Deleuze, « Trois problèmes de groupe », préface à Félix Guattari, Psychanalyse et transversalité, Maspero, Paris, 1972. voué à la récupération, s’il ne l’est pas toujours déjà, récupéré. Mais l’absence de parti est inconsistante, vouée à l’échec par son inefficacité comme par sa propension à se fondre dans l’existant – d’où la tyrannie de l’absence de structuresJo Freeman, La tyrannie de l’absence de structures, 1972, disponible sur : https://infokiosques.net/spip.php?article2/. Entre le centralisme de l’organisation type parti ou syndicat qui n’échappe pas au modèle étatique et la suite ininterrompue mais toujours décevante de mouvements spontanés sans cesse voués à dépérir : l’alternative est désespérante. Le spontanéisme laisse advenir la récupération par dissolution. Le centralisme lui en donne l’occasion par intégrationContradiction que les Soulèvements de la Terre semblaient avoir un temps résolu. Mais n’est-ce pas aujourd’hui, depuis la fin de l’année 2024, le moment où s’ouvre pour le mouvement l’alternative entre son intégration (se rapprocher des partis institutionnels) ou sa perte de vitesse (l’efficacité des luttes de terrain est soumise à une répression intense qui les paralyse) ?. Récupération ou récupération : faut-il choisir ?
Comment imaginer un mode d’organisation anarchiste qui tienne dans la durée ? Autrement dit : quelle forme d’organisation pourrait correspondre à une politique destituante ? « Il faut s’organiser. » Organiser, s’organiser, c’est instaurer un ordre, des règles, si implicites soient-elles : quelque chose qui tient, quelque chose à quoi l’on tient. Mais toute forme qui dure, toute institution est constituante. S’organiser c’est durer, durer c’est s’institutionnaliser. Quel est alors cette contradiction qui consiste à s’organiser pour la destitution ? Seule l’insurrection est-elle vraiment destituante ? Cela nous voue-t-il au spontanéisme ? Comment intervenir politiquement sans se heurter à l’écueil du centralisme ; sans se heurter non plus à celui du spontanéisme ?
Je vais argumenter en faveur de l’idée d’institution mineure telle qu’introduite précédemmentSupra,« Institutions mineures », p.91., au sens où elle permet je crois de décaler ce paradoxe. Héritant de l’analyse institutionnelle, qui hérite elle-même de la psychothérapie institutionnelle, je définis minimalement une institution comme « un espace singulier (…), un lieu découpé dans l’espace et le temps sociauxGeorges Lapassade, « L’analyse institutionnelle », dans L’Homme et la société, no 19, 1971. ». Autrement dit : « L’institution, c’est un système de normes. Et c’est aussi un système de rapports sociaux institué par les normes, et les modifiantIbid.. » Je choisis donc, provocation ou compromission, une définition large et consensuelle.
Je donne pourtant du crédit à la suspicion, voire au rejet suscité par la notion d’institution dans le milieu politique autonome. Puisqu’une institution est le résultat d’une institutionnalisation, et qu’institutionnalisation signifie récupération, les institutions ne sont-elles pas notre ennemi no 1 ? À l’évocation de l’idée d’institution, je pense : répression, identification et individualisation des identités, des responsabilités, des vies. Pourquoi alors parler d’institution mineure ; pourquoi conserver le mot d’institution ?
Moitié par fidélité à la psychothérapie institutionnelle et au mouvement de l’analyse institutionnelle à partir desquelles nous avons collectivement élaboré ces réflexions ; moitié par provocation à l’égard d’une pensée certes politiquement nécessaire de la destitution, mais souvent trop peu encline à mon goût à questionner ses paradoxes. L’idée d’institution mineure permet d’interroger et de mettre au travail les angles morts de la destitution, qui constitue mon hypothèse politique no 1. Elle desserre le nœud qui lie institutionnalisation et récupération et permet ainsi d’imaginer quelle forme d’organisation collective est compatible avec l’ambition destituante.
Si l’idée de destitution nous dissuade de créer toute forme qui dure, elle me semble diablement inefficace. Si elle alimente aussi de ce fait le fantasme anti-institutionnel de relations qui devraient être pures et non médiées, rapport pur de pleines présences qu’oblitéreraient les institutions dans leur tentative d’instaurer de l’ordre dans le chaos, elle me semble qui plus est complètement fallacieuse. Je ne reproche pas aux institutions d’instaurer de l’ordre. Je reproche aux institutions de figer un ordre inique. Créer une forme qui dure, est-ce seulement instaurer un ordre autoritaire dans le chaos ? Critiquer la sclérose des façons de faire et des façons d’être ensemble, critiquer les médiations rigidifiées, celles qui nous confinent dans des rôles et des fonctions, critiquer l’ordre en place et sa sauvegarde par les institutions existantes, cela n’implique pas de critiquer toute médiation ni de verser dans le regret romantique de l’immédiateté, de la spontanéité, de la pure présence. Je crois que de telles confusions nous entravent dans nos volontés et capacités d’organisation.
Comment imaginer une forme d’organisation durable (une institution) qui ne soit pas constituante ? Institution mineure signifie institution anarchiste, signifie institution destituante. Si une institution destituante est une contradiction dans les termes, comment faire exister et perdurer une contradiction dans les termes – comment faire exister une contradiction dans le temps ?
Je propose de partir du rejet produit par la notion d’institution. C’est bien contre la plupart des institutions qu’on se bat. Ce rejet vient aussi d’une trahison vécue, celle qui concerne l’inéluctable récupération des mouvements sociaux : leur institutionnalisation, qui semble constituer un destin social. Comment parer à cette trahison ?
Je propose de retourner le problème de la récupération, soit l’inéluctable institutionnalisation des mouvements sociaux et des formes d’intervention politique, contre celui que recèle le terme d’institution destituante avec la contradiction qui le fonde. C’est à penser l’institutionnalisation et la récupération qui semble en découler fatalement qu’on peut résoudre la contradiction de l’idée d’institution destituante – une hypothèse politique qui me semble éthiquement autant que tactiquement souhaitable d’investir, pour mettre à bas les institutions majoritaires.
I. Comment les forces sociales deviennent des formes sociales, ou l’inéluctable digestion sociale
I.1. Qu’est-ce qu’un moment, qu’est-ce qu’un mouvement qui dure ?
En attendant qu’on s’organise – mais ils n’attendent pas, évidemment –, les mouvements sociaux se succèdent sans trouver comment subsister, incapables de trouver comment muter quand ils en viennent à s’essouffler. Les mouvements, les moments ne durent pas : s’ils durent, c’est soit qu’ils se font récupérer, soit qu’ils s’institutionnalisent eux-mêmes, ce qui revient au même – bref, ils ne durent pas. Ils se font lentement digérer. Leur lente digestion sociale, la répression l’accélère – mais n’est-elle pas, de toute façon, inexorable ? Soit ils se font réprimer et disparaissent : forme de digestion par dissolution. Soit ils se sclérosent, et deviennent alors solubles dans l’ordre existant : forme de digestion par conformation. Soit ils sont récupérés par des institutions qui, par le haut, les avalent : digestion par capture.
La récupération : on dirait que ce n’est pas qu’une trahison, c’est une logique. Quand ce n’est pas la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui, après l’abandon du projet d’aéroport, s’institutionnalise, c’est la mairie de Bordeaux qui récupère le modèle d’athénée, forme d’agora politique issue des pratiques anarchistes durant la guerre d’Espagne. Quand ce n’est pas Eric Bompard qui met en scène le black bloc pour vendre des pulls de luxe, c’est Paul B. Preciado qui se vend lui-même à Gucci. Il faut dire que la pub utilise tout : même le mouvement anti-pub est récupéré par la pub. Sclérose, bureaucratisation, marchandisation, normalisation : les avatars de la capture semblent capables de se suppléer les uns aux autres. Quand ce n’est pas le mouvement qui se sclérose, quand ce ne sont pas des composantes du mouvement qui le trahissent, ce sont les institutions existantes qui avalent le mouvement.
i.2. Effet Mühlmann : la digestion sociale
C’est là une dynamique qui a intéressé le courant de l’analyse institutionnelle, telle qu’elle émerge du mouvement de la psychothérapie institutionnelle après 1968. René Lourau, sociologue gauchiste de Paris 8, ponte de l’analyse institutionnelle, conceptualise cette dynamique sous la forme d’une loi sociologique qu’il appelle effet Mühlmann. Wilhelm Mühlmann est un anthropologue allemand, nazi, charmant, auteur d’un ouvrage sur les mouvements messianiques dans le tiers-monde, qu’il aime à mettre en perspective, parfois, avec le messianisme révolutionnaire soviétique, qu’il ne porte probablement pas dans son cœur. C’est le nom de ce collègue nazi depuis tombé dans l’oubli que choisit René Lourau pour qualifier l’inéluctable processus de récupération auxquels semblent voués les mouvements populaires, notamment messianiques – un processus qui, en effet, ne donne à personne l’envie d’y accoler son nom.
L’effet Mühlmann, habituellement décrit en termes de « récupération » ou « d’intégration », désigne le processus par lequel des forces sociales ou marginales, ou minoritaires, ou anomiques (ou les trois à la fois) prennent forme, sont reconnues par l’ensemble du système des formes sociales déjà là. L’institué accepte l’instituant lorsqu’il peut l’intégrer, c’est-à-dire le rendre équivalent aux formes déjà existantesRené Lourau, « Analyse institutionnelle et question politique », dans L’Homme et la société, no 29-30, 1973..
Lourau appelle l’institué ce qui est déjà là, les formes sociales existantes, et l’instituant, les forces sociales, mouvements populaires, révoltes, qui viennent contester l’institué.
L’effet Mühlmann, c’est une loi sociale. Les formes sociales telles qu’elles existent finissent par avaler les forces sociales qui viennent les contester. Inéluctablement, l’institué prend le pas sur l’instituant. Voilà ce qu’on appelle institutionnalisation. Autrement dit : tout mouvement s’il perdure est voué à s’institutionnaliser. L’institutionnalisation est un destin social : les forces sociales deviennent des formes sociales.
Qu’il s’agisse de la corruption des personnes ou des causes, de la traduction gouvernementale des « revendications » qu’on comprend d’un mouvement insurrectionnel, de la marchandisation des mots d’ordre, des symboles, des attitudes, les exemples n’en finissent plus.
La transformation des avant-gardes en académisme (le surréalisme, le situationnisme), ou des groupes religieux minoritaires en religion établie (le christianisme en général, ou le calvinisme en particulier) ; le désamorçage des énergies révolutionnaires par la promulgation d’une nouvelle Constitution (Maroc en 2011, Chili en 2020), par la nomination d’un nouveau dirigeant (Sri Lanka en 2022) ou par la traduction électorale d’une « revendication » (le RIC des Gilets jaunes) ; la marchandisation de la révolution cubaine ou de Mai 68, etc. L’institution récupère tout.
Dynamiques de « domestication » (le mot est de Mühlmann), de normalisation, d’intégration sociale… Tous ces phénomènes, si différents soient-ils, peuvent être ramenés à une dynamique unique : la transformation d’un élément subversif (organisation, initiative, lutte, personne, idée, slogan…) en un rouage de la société, c’est-à-dire un élément ne mettant plus en cause ses principes fondamentaux – voire les renforçant. Désamorçage.
I.3. L’institution est une trahison
Lourau choisit l’exemple du protestantisme et de son processus d’institutionnalisation. Il montre comment, au fil des rééditions d’un livre appelé (à juste titre) L’institution de la religion chrétienne, qui passe de 17 à 80 chapitres en vingt ans, Calvin en vient peu à peu à récuser les mouvements prophétiques dont le protestantisme est issu, et à les condamner. C’est pourtant de ces mouvements mêmes que procède le pouvoir auquel Calvin, qui les récuse, accède. « Ce faisant il niait le mouvement sans lequel il n’aurait jamais existé », dit Lourau. C’est par cette trahison que le protestantisme, de secte hérétique et subversive, devient une religion instituée – et c’était bien là l’ambition de Calvin. Ce manuel devient en effet la somme de la théologie de la Réforme.
I.4. Échec de la prophétie
Mais l’analyse de Mühlmann, dont les recherches portent sur des mouvements religieux prophétiques, est plus tragique encore. Ce qu’il met au jour, c’est que l’institution ne se développe que sur les cendres de la prophétie dont le mouvement initial se réclame. C’est précisément l’échec de la prophétie qui provoque l’institutionnalisation du mouvement.
L’avortement de la prophétie n’entraîne pas du tout l’avortement de la prophétie millénariste. Des exemples historiques témoignent que des communautés millénaristes, loin de réduire leur nombre, l’ont parfois vu croître à la suite de prophéties avortées. […] La plupart des mouvements (pas tous cependant) survivent à l’échec de la prophétie, mais ils n’y survivent pas comme mouvements. Ils changent de structure, ils s’institutionnalisent en secte ou en Église [en parti pour un mouvement politique], et ce changement de structure, c’est bien l’échec de la prophétie qui en est causeWilhelm Mühlmann, Messianismes révolutionnaires du tiers-monde, trad. Jean Baudrillard, Gallimard, Paris, 1968..
Ainsi l’institution naît et se développe quand la prophétie révèle son échec : le Messie n’est pas venu, le Salut n’est pas arrivé. Si l’institutionnalisation n’est que le résultat de l’échec d’une prophétie, l’institution, c’est un débris de prophétie. C’est ce qu’il reste d’une eschatologie déçue.
Et qu’importe que cette prophétie soit ou non de nature directement religieuse. Mühlmann compare explicitement l’eschatologie marxiste aux mouvements millénaristes religieux du tiers-monde. La bureaucratisation de l’URSS peut alors apparaître comme le résultat logique de l’échec de la prophétie marxiste. Face à la guerre, puis à la guerre civile, la prophétie marxiste échoue. Malgré sa promesse, scientifique plutôt que religieuse, eschatologique quoi qu’il en soit, la lutte des classes n’a pas été abolie, la société sans classes n’a pas vu le jour – et la fervente énergie sociale des soviets révolutionnaires s’est sclérosée en bureaucratie.
De même, tout débordement insurrectionnel ne contient-il pas une promesse ? Quand cette promesse se trouve déçue, c’est l’heure de l’institutionnalisation qui sonne : capture de la promesse.
Continuons, nous-mêmes, à généraliser. Si tout mouvement s’institutionnalise depuis l’échec d’une prophétie, existe-t-il des institutions qui n’ont pas été des mouvements sociaux ? De quelles prophéties, et de quelles déceptions sont-elles nées ? Sur quelle prophétie bafouée s’est fondée l’institution policière ? Sur quelle prophétie, sur quel échec l’institution judiciaire, ses tribunaux, ses Marianne et les grands airs de ses juges et de ses procureur·es ? Sur quelle promesse déçue les élections, ses isoloirs, ses urnes ?
I.5. Prophétie de l’échec de la prophétie
L’institutionnalisation est-elle une force tellurique, l’équivalent de la glaciation ou de la dérive des continents ? Dans le mode de production capitaliste, monopoliste ou étatique, la réponse est : oui. Il est tout aussi « naturel » de voir les groupes avant-gardistes russes, quelques années après 1917, se fondre dans un organisme artistique d’État, que de voir la plupart des groupes avant-gardistes des pays de capitalisme « libéral » se nier dans la mode, la culture et le marché culturelRené Lourau, « Autogestion, institutionnalisation, dissolution », dans Autogestions, no 1, 1980..
Loi sociale et historique, qui condamne toute tentative de changement : où l’on se souvient l’obédience politique de Mühlmann. L’effet Mühlmann est la formulation désespérante, et non sans raison d’origine fasciste, d’un processus rendu inéluctable. Il y a du fascisme dans l’inéluctable – et du désespoir. Et cet effet agit de fait comme une prophétie : la prophétie de l’échec de la prophétie. L’effet Mühlmann énonce que toute prophétie, tout rêve, toute idée, finira institutionnalisée : oubliée au profit d’une cathédrale immense qui en a oublié son sens. Et cela de façon inéluctable : prophétie elle-même, qui ne peut avoir pour effet que l’arrêt immédiat de toute tentative, au nom du refus d’une irrémédiable institutionnalisation, d’un renforcement de l’institué toujours vainqueur.
Si tout mouvement social, toute tentative d’organisation collective mène au renforcement des institutions existantes ;
et que le refus d’une telle institutionnalisation nous condamne à la faiblesse et à l’éphémère, à des mouvements sociaux toujours désavoués et d’ailleurs trahis par les forces constituantes ;
La résignation ne porte pas sur l’advenue de nouvelles situations révolutionnaires : elles s’ouvrent et continuent de s’ouvrir. La résignation porte plutôt sur la certitude qu’elles se referment à chaque fois.
I.6. Institutionnalisation = récupération ?
Si le destin d’un mouvement social est son institutionnalisation, comment contrer ce destin – si ce n’est en s’en ressaisissant ? Peut-on alors penser une institutionnalisation qui ne rime pas d’emblée avec récupération ?
Que serait une institutionnalisation qui ne soit ni une simple trahison du mouvement collectif initial, ni une intégration dans les formes sociales établies ? Autrement dit, existe-t-il une forme d’organisation durable (une institution, si je puis me permettre) qui ne soit pas récupérable ?
Lourau appelle récupération toute institutionnalisation. Il décrit en même temps l’institutionnalisation comme une dialectique – plus précisément, comme la synthèse d’une dialectique entre formes instituées et forces instituantes. N’est-il pas possible de retourner la logique de cette dialectique : d’en inverser ce qui s’affirme (l’institué) et ce qui le nie (l’instituant) ? Comment penser une dynamique d’institutionnalisation qui relève de la mise au pas de l’institué (ce qui est déjà) par l’instituant (ce qui le perturbe et le nie), plutôt que l’inverse ?
Faire en sorte que l’instituant garde le pas sur l’institué : voilà donc une première réponse à l’encontre de la récupération des mouvements politiques, qui vaut en même temps en faveur de la construction d’« institutions destituantes ».
Comment alors renverser la dialectique de l’institutionnalisation au sein d’un groupe pour faire en sorte que les forces instituantes gardent le pas sur les formes instituées – pour faire en sorte que la destitution soit le pôle positif, premier ? Dans les faits, la destitution n’est-elle pas inaugurale, avant de se faire avaler et normaliser ?
1.7. Pas de côté : le système est-il omnivore ou nos mouvements sont-ils digérables ?
On peut considérer que l’effet Mühlmann est en fait réversible. La dynamique d’institutionnalisation que qualifie cet effet opère par le bas : c’est le mouvement lui-même qui se rend compatible, soluble dans les formes sociales existantes. Mais cette dynamique d’institutionnalisation renvoie en miroir à une logique du phagocytage qui procède à l’inverse par le haut, quand ce sont les institutions existantes qui récupèrent le mouvement pour le neutraliser. On peut donc appeler phagocytage le processus par lequel les forces instituantes se trouvent reconnues par les formes instituées ; et institutionnalisation le processus par lequel les forces instituantes se coulent elles-mêmes dans les formes instituées. Ce sont deux sens inverses d’une même dynamique, celle de la récupération.
La démocratie et le capitalisme semblent en effet pouvoir tout digérer. L’État-providence, par exemple, en tant qu’il est directement issu des caisses de solidarité, mutuelles et assurances ouvrières, est en soi une récupération. Ou les luttes ouvrières, sans même être directement récupérées : elles ont permis l’augmentation des salaires, contribuant ainsi incidemment à l’émergence de la société de consommation.
Toute revendication sociale est faite pour être intégrée ; et chaque revendication prise en compte est à la fois une victoire démocratique (une reconnaissance) et une victoire du capitalisme (une récupération). Si la reconnaissance de la légitimité des revendications est une victoire, elle porte aussi l’ombre de la diabolique capacité du système à tout récupérer – l’ombre de sa défaite finale.
La société occidentale moderne comme le capitalisme de la créativité se caractérisent par une certaine ouverture au désordre et une reconnaissance de fait de l’imprévu, du chaos et de la dissidence. Cette porosité au nouveau, au chaos, caractérise à la fois le délire capitaliste et le projet démocratique – c’est en cela aussi qu’ils sont progressistes.
La lecture que je propose met l’accent non sur la puissance de phagocytage du « système », mais sur l’aptitude de ce qui surgit à être assimilé d’une manière ou d’une autre.
Au final, parce qu’iels représentent les deux sens d’une même dynamique, phagocytage et institutionnalisation en arrivent au même : institué et instituant se rejoignent dans le maelström social, qui toujours remue, mais toujours avale tout – ainsi pacifié dans son propre remous. Les logiques de récupération par phagocytage, plutôt que par institutionnalisation, ouvrent d’autres problèmes – que je laisse de côté.
Lourau s’intéresse en vérité, comme Mühlmann, et comme moi, aux dynamiques d’institutionnalisation, plutôt qu’ à ses revers.
Considérons pour cette fois que si le capitalisme et la démocratie sont omnivores, c’est parce que le subversif tend, de lui-même, à se rendre digérable, en se rendant équivalent à ce qui existe déjà. L’institué accepte l’instituant lorsqu’il est capable de l’intégrer, c’est-à-dire le rendre équivalent aux formes déjà existantes. Qu’est-ce qui rend donc un mouvement digérable ? Qu’est-ce qui, dans une organisation, la rend bureaucratisable, oligarchisable, marchandisable, bref récupérable ?
II. La courbure étatique des institutions, ou l’État-inconscient
Les forces deviennent formes et les formes prennent la courbure de l’existant : de l’État, de l’État-inconscient.
II.1. Comment ça glisse vers l’existant
Ce qu’il me semble intéressant à retenir de l’effet Mühlmann, c’est cette idée que l’instituant, si subversif, disruptif, inopiné soit-il, finit spontanément par se couler dans le moule du déjà institué. Glissement spontané de l’instituant vers l’institué : « courbure du social par la politique instituée » dit Lourau. Tout mouvement se coule dans le moule des institutions. Constat qu’il faut bien admettre pour trouver à le contrer.
Pourquoi tout glisse irrémédiablement vers le déjà existant ? Quelle est cette pente qu’emprunte toute formation sociale ?
« Crise sacrificielle », dit Lourau (sacrifice de la prophétie pour la sauver d’elle-même), qui se passe souvent de manière progressive et même imperceptible pour une grande partie de ses acteurices et témoins. (Les avant-gardes qui continuent à cracher sur les académismes bien après en être devenus un !) Trahison sans sentiment de trahir : une trahison sans regret.
Ça glisse lentement vers l’institué. L’institué, c’est ce qui est là, l’état de fait, et l’état de fait, ce n’est rien d’autre que l’État avec un É majuscule. Ce qui rend un mouvement récupérable, ce n’est donc pas à proprement parler son institutionnalisation, c’est cette tendance inconsciente à glisser vers l’institué : vers l’état de fait.
Dans ce lent et irrémédiable glissement, on peut détecter l’action inconsciente de l’État comme force d’aimantation qui subordonne la totalité du social. Les forces instituantes sont ainsi refoulées au profit d’une subordination à « l’État-inconscient ».
Lourau caractérise ainsi l’État comme le principe d’équivalence des formes sociales. L’État est la forme institutionnelle hégémonique en même temps que l’étalon de la valeur sociale.
Le principe d’équivalence élargi à toutes les formes sociales signifie que l’étatique, puissance de légitimation de l’institution en même temps qu’aboutissement de toutes les légitimités institutionnelles, est ce qui dirige toute vie sociale, tout mouvement et même l’action révolutionnaire, afin que les nouvelles forces sociales donnent le cadre d’équilibres changeants, évolutifs ou régressifs, mais toujours définis par l’existence sacrée d’un État, comme garantie métaphysique du socialRené Lourau, L’État-inconscient, op. cit..
II.2. État inconscient
Pour comprendre pourquoi tout glisse vers les institutions majoritaires, je propose de chercher à comprendre ce que Lourau appelle « État-inconscient » en faisant un rapide détour par la notion d’Urstaat chez Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe.
Deleuze et Guattari voient dans l’État un appareil de pouvoir autant qu’une forme inconsciente qui hante toute la société et à laquelle il n’est pas possible d’attribuer une origine historique. L’État, c’est s’en remettre à supposément supérieur à soi : c’est donc la séparation entre gouvernant·es et gouverné·es, ainsi que la conservation de cette séparation. Cette séparation et l’organisation de son maintien ne naissent pas à un moment précis de l’histoire, mais sont latentes, sous la forme de ce qu’ils nomment Urstaat (État originel en allemand). L’Urstaat n’est pas un programme destiné à être réalisé, mais une tendance qui, d’emblée, obsède et habite en profondeur toutes les figures historiques et donc réelles de l’État. L’Urstaat, c’est le désir qui est au cœur de la forme-État, ce qui caractérise l’État comme une forme du désir, dans sa violence native : une façon de désirer parmi d’autres. Mais un désir-limite, qui veut sa propre répression, fonctionnant simultanément comme contre-désir :
Désir de l’État, la plus fantastique machine de répression est encore désir (…). Désir, telle est l’opération qui consiste toujours à réinsuffler de l’Urstaat originel dans le nouvel état des choses, à le rendre autant que possible immanent au nouveau système, intérieur à luiGilles Deleuze, Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, Paris, 1972..
Ainsi peut-on dire que la courbure étatique des institutions vient de cet inconscient qui nous hante, l’Urstaat. Il faut comprendre que cette tendance n’est ni intentionnelle ni consciente : elle nous agit.
III. Subjectivité sociale inconsciente, ou le communisme de la subjectivité
L’institutionnalisation est inéluctable, mais ce n’est pas elle, directement, qui implique la récupération : c’est son déni. Qu’est-ce qu’on dénie, quand on dénie l’institutionnalisation ?
III.1. Sortir du déni
Si c’est l’inconscient étatique qui nous malmène, ce qu’il nous faut c’est sortir du déni. Il y a, je crois, une erreur très préjudiciable dans le déni de notre propre dimension institutionnelle : de la façon dont l’institution, l’institutionnel nous traversent. Sortir du déni institutionnel, c’est voir qu’un groupe est toujours surdéterminé par des institutions, et ceci de façon inconsciente. Dans tout groupe il y a une telle dimension, non analysée et pourtant (ou d’autant plus) déterminante : la dimension institutionnelle.
Plutôt que de faire preuve de pureté (« l’institution, très peu pour nous : on est contre »), il vaut mieux nous dire que l’institution existe déjà. Sans souscrire à une définition trop extensive de l’institutionComme celle d’un Frédéric Lordon dans Vivre sans ?, La fabrique, Paris, 2019, qui fait de la moindre poignée de main une institution : à être trop extensive la notion perd complètement en intention., on peut dire, suivant Tosquelles et la psychothérapie institutionnelle, qu’il y a institution dès qu’il y a rencontre répétitive dans un espace déterminé. Il y a déjà de l’institution, et déjà, heureusement, de l’institutionnalisation : une dialectique entre forces instituantes et formes instituées au sein de nos formes de vie et d’organisation. Sommes-nous déjà récupéré·es pour autant ?
Travailler cette dimension occulte de l’institutionnalisation, c’est justement découvrir « le cadavre dans le placard » dit Lourau : ce qu’il y a de rigide et sclérosé, dans les formes que nous inventons. C’est seulement en menant ce travail qu’on peut lutter contre les tendances à la clôture idéologique, organisationnelle et libidinale d’une institution, c’est-à-dire lui permettre de résister à la longue et lente glissade sur la pente de l’institué, du naturel, du « ça va de soi » et « ça ne peut pas être autrement » – et à sa finale adaptation à tout l’institué qui existe et nous écrase.
III.2. Ce qui mène à la récupération n’est pas l’institutionnalisation, mais son déni
Je propose de penser que c’est le déni de l’institutionnel qui mène à la récupération, non l’institutionnalisation elle-même. Le déni mène à la répétition du même, et ce qui se répète, c’est ce qui est rigidifié, c’est le dur dans ce qui dure : l’institué. Le déni produit la répétition du même ; la répétition du même produit la cristallisation et la sclérose de l’institution, c’est-à-dire la mise au pas de l’instituant sur l’institué. L’institution devient une forme plus qu’une force sociale, et se met peu à peu à glisser, le long de la courbure étatique du social.
Autant donc assumer l’institutionnalisation, plutôt que de la laisser à son inconscience et à la pente qu’elle y prend. L’assumer, c’est se donner les moyens de se demander, face à l’inéluctable processus de récupération, comment ne pas se complaire dans un cynisme du genre « de toute façon ça finira bien par arriver ».
[Le fait que l’institutionnalisation vienne objectiver une énorme masse immergée de notre pratique sociale et la pratique historique,] c’est là une caractéristique qui entre de plein droit dans la théorisation même de l’institutionnalisation : cette dernière a quelque chose de honteux, de refoulé, elle a à voir avec ce qu’on nommera sommairement l’inconscient social. […] Que les espérances tournent court, que les normalisations insidieuses jouent au supplice de la goutte d’eau sur le crâne, que tout cela soit vécu comme naturel, normal, fatal, donc insignifiant du point de vue politique, voilà une autre caractéristiqueRené Lourau, L’État-inconscient, op. cit..
III.3. Déni et naturalisation des institutions
Le refoulement du processus d’institutionnalisation participe aussi à faire apparaître l’institué comme immuable et sans histoire. Dénier l’institutionnalisation est une façon de naturaliser l’institution. Sa genèse est dissimulée, inavouée, truquée, du fait de la honte que génère l’institutionnalisation. Mais cacher la genèse de l’institué produit son apparente naturalité. Et cette apparente naturalité ne peut que déjouer tout désir de contestation.
III.4. L’inconscient social
Le problème, donc, ce n’est pas notre petit État intérieur, notre petit·e flic inconscient·e personnel·le ; ce n’est pas l’État ou lae flic de chacun·e contre laequel·le il faudrait lutter pour ne pas laisser glisser nos mouvements et organisations vers l’état de fait. On parle d’un inconscient social, qui est structuré comme le sont les institutions.
Penser un État-inconscient, penser des logiques sociales qui nous agissent inconsciemment, c’est penser un inconscient social. Les dynamiques d’institutionnalisation sont l’équivalent, à l’échelle du groupe, des dynamiques de l’inconscient « psychique » à l’échelle de l’individu. De même que l’inconscient « psychique » est structuré comme un langage (autour du phallus), l’inconscient groupal ou social a la forme de ses institutions (autour de l’État).
Cette origine commune, ni individuelle ni collective, c’est l’inconscient tel qu’on peut l’appeler institutionnel – celui qu’un Lacan a touché du doigt, tout en le réduisant strictement au langage. Le langage est une institution parmi d’autresSupra,« Règles d’énonciation pour une machine philosophique », p. 41..
Toute institution a une dimension fantasmatique, à la fois intangible, symbolique et efficiente, propre en fait à l’inconscient d’un groupe.
La socioanalyse s’attache à mettre au travail de tels écarts entre ce qu’un groupe dit de lui-même (son idéologie) et ce qu’il fait effectivement d’un point de vue matérialiste (sa structure institutionnelle).
L’étatisation, la bureaucratisation et toutes les logiques de glissements vers l’institué constituent des processus dynamiques analogues au refoulement. L’étatisation est à l’inconscient social ce que le refoulement est à l’inconscient psychique. Si on ne travaille pas cet inconscient de groupe, celui-ci glisse lentement et tranquillement le long de la courbure étatique des institutions. Alors c’est l’institué, l’état de fait qui s’impose, et le groupe va se rigidifier, chacun·e se trouvant assigné·e à un poste, à une fonction, à un rôle.
III.5. Subjectivité de groupe
L’idée d’inconscient social implique celle de subjectivité sociale, qui implique elle-même une puissance de désir se jouant à l’échelle collective. L’idée d’inconscient social ou institutionnel n’est pas seulement celle de lois historiques qui nous traversent ou de grandes logiques qui nous déterminent. Dire subjectivité sociale, c’est presque (je vais expliquer ce presque) parler de l’institution comme d’un « sujet » : lui attribuer une agentivité et surtout une puissance de désir.
De la subjectivité plutôt que des sujets
Guattari parle d’une « subjectivité socialeFélix Guattari, « La transversalité », Psychanalyse et transversalité, op. cit. » inconsciente. Comment comprendre cette idée ? Avant Freud (chez Descartes, par exemple), on a toujours dit : sujet = conscience. Freud pose : sujet = désir = inconscient, tout en continuant à considérer qu’il y a sujet là où il y a (in)conscience ; ainsi l’inconscient est dans une certaine mesure personnel. Guattari va plus loin en décorrélant la notion de sujet de celle de conscience. Pour Guattari : subjectivité = désir = inconscient. Il n’y a aucune raison que cet inconscient, cette subjectivité soient contigües aux consciences. C’est pourquoi Guattari préfère l’idée de subjectivité à celle de sujet. Le sujet comme moi conscient, figure principale de la philosophie classique, est même le pire ennemi de la subjectivité : le pire ennemi du désir.
La subjectivité est collective
Guattari pense le fait qu’il n’y a pas d’abord « un sujet », mais de la subjectivité (il y a de la confiture, avant les pots de confiture). La subjectivité est d’abord collective. En tant qu’individus nous n’en sommes que des fragments. Ce ne sont pas des consciences individuelles qui apportent leur contribution au pot commun : il y a déjà de la confiture psychique. En ce sens, la subjectivité sociale, comme la subjectivité d’un groupe, n’est pas une simple addition des petits désirs de chacun·e, n’est pas réductible à une totalisation des subjectivités individuelles.
La subjectivité est inconsciente
Si la subjectivité est inconsciente, c’est au sens où elle est invisible aux « moi ». L’inconscient, dans le langage de Guattari, c’est simplement ce que la conscience ne voit pas : il n’y a pas d’inconscient en soi, mais seulement pour le moi. La conscience ordinaire n’est qu’une faculté du moi ; elle ne correspond pas à un sujet.
La psyché est structurée par les institutions
Dire que la subjectivité est d’abord collective, c’est dire que le désir n’est pas psychique ni personnel. Il traverse et circule dans les groupes. Ce sont justement ce qu’on peut appeler des institutions qui viennent formater cette confiture psychique. La psyché est structurée par les formes institutionnelles.
Il faut donc comprendre les individus (ceux qu’on appelle « sujets ») non comme des moi dotés d’une conscience, des cogito cartésiens, mais comme les produits des institutions. On peut ainsi définir l’institution par sa fonction symbolique : elle fabrique du sens, elle donne des contours à la psyché. Toute subjectivité est un carrefour (dans ma tête un rond-point) :
Nos individualités sont donc les émanations d’une subjectivité plus grande que nous, d’un désir qui circule – et qui circule plus ou moins bien. Le désir, considéré comme ce qui donne enthousiasme et force d’initiative, est strictement coextensif à ce que permet le cadre institutionnel : peut-il circuler ?
Remarque analogique. On rejoint avec Guattari une idée énoncée par Tronti, quand il avance que l’émergence d’une puissance destituante est concomitante et analogue à la disparition du sujet moderneEntretien avec Mario Tronti, « Sur le pouvoir destituant », dans lundimatin, 2022, disponible sur : lundi.am/Sur-le-pouvoir-destituant/. La fin des luttes ouvrières marque la fin de l’ère du sujet révolutionnaire ainsi que celle du sujet tout court – ouvrant l’ère d’une politique destituante.
Remarque métaphysique. La subjectivité collective produit des possibilités de manières d’être : des possibilités d’être sujets. On peut dire qu’un sujet est une manière en tant qu’une manière est cadrée, c’est-à-dire en partie contrainte. Une manière est ce qu’il y a de libre dans un système de contraintes qui la rendent possible : qui rendent sa liberté possible et la définissent. (Ces contraintes étant pour la plupart suggestives plutôt que coercitives, on peut dire que tout sujet est sous hypnose.)
IV. Analyse institutionnelle, ou comment s’autodestituer en tant qu’institution
Où comment faire en sorte que l’instituant garde le pas sur l’institué au sein d’une institution. Une telle institution est une destitution.
IV.1. Débusquer la subjectivité sociale
Faire en sorte que l’instituant garde le pas sur l’institué, pour ainsi inverser la dialectique de l’institutionnalisation. L’instituant, il semblerait que l’on comprenne désormais mieux de quoi il s’agit : c’est ce qu’on a défini comme subjectivité sociale.
Parce qu’elle est collective, donc inaccessible au moi et transversale au groupe, cette subjectivité est toujours inconsciente. « Porteuse de vie et de désirFélix Guattari, La transversalité, op. cit. », elle est aussi empêchée par tout un tas d’habitudes et de dénis. Ce sujet collectif, « il faudra le débusquer, à l’occasion d’une poursuite analytique impliquant quelquefois d’immenses détours qui pourront amener à se poser les problèmes cruciaux de notre époqueIbid.. » Voilà ce que j’appelais tantôt « sortir du déni institutionnel ». Comment donc débusquer cette subjectivité sociale refoulée emprisonnée dans le carcan de l’institué ?
Cette subjectivité, c’est du désir, et le désir, on ne peut pas le saisir : on n’en a que les effets. Ces effets, ce sont l’équivalent, sur le plan collectif, des symptômes, actes manqués, lapsus et autres manifestations de l’inconscient sur le plan individuel : des révélateurs d’une subjectivité inconsciente. Comme tout désir, la subjectivité sociale ne s’exprime que dans les failles. La subjectivité collective perturbe l’institution comme un acte manqué ou un lapsus surprennent et troublent le moi individuel. Ces ratés de l’institution fonctionnent comme des symptômes de la subjectivité inconsciente. Celle-ci n’est donc accessible qu’ à de rares moments : dans les failles, les ratés du fonctionnement de l’institution. À comprendre l’instituant par la subjectivité sociale, on peut le caractériser comme ce qui s’exprime à travers les failles, ce qui déborde quoi qu’il arrive – une définition de l’émeute comme une autre.
IV.2. Analyseurs
Ces révélateurs de la subjectivité sociale inconsciente, Lourau et Lapassade, l’autre ponte de l’analyse institutionnelle, les appellent des analyseurs. Les analyseurs sont les éléments de la réalité sociale qui manifestent les contradictions du système.
Ce qui permet de révéler la structure de l’institution, de la provoquer, de la forcer à parler. Provocation institutionnelle, acting out institutionnel… Le passage à l’acte institutionnel suppose un passage à la parole (une provocation, au sens premier du terme) et par conséquent exige la médiation d’individus particuliers que leur situation dans l’organisation fait accéder à la singularité de « provocateur ». Ces « provocateurs », les bureaucrates les appellent aujourd’hui « gauchistes » ; les sociologues préfèrent le terme de « déviants »Georges Lapassade citant René Lourau, « L’analyse institutionnelle », op. cit..
Les analyseurs peuvent être des évènements, des individus appartenant ou non à l’institution, etc. C’est tout ce qui provoque l’apparition du sens dans un groupe, tout ce qui révèle la structure d’une institution : ce qui provoque l’impensé de cette structure sociale et l’oblige à se manifester. Un analyseur produit une analyse en acte. C’est ce qui fait l’analyse avant même l’intervention d’un analyste. C’est aussi une critique en acte, qui constitue d’emblée une intervention en introduisant du mouvement dans le groupe. Le souci analytique est donc à la fois théorique et pratique, il est d’emblée tourné vers un remaniement des structures, des positions et des objectifs des groupes.
Mai 68, par exemple, est un analyseur en tant qu’il révèle les contradictions de la société de consommation. Certaines positions politiques et/ou sociales sont elles-mêmes des analyseurs. Par exemple, telle qu’elle est localisée par des codes sociaux, l’homosexualité peut devenir un vecteur d’analyse de l’ensemble des rapports sociaux assujettis aux discours sur la sexualité. Cette capacité vient du fait que l’homosexualité subit et réagit directement à ces rapports de force. Or elle peut remettre en question les rôles sociaux et les fonctions proclamées, à commencer par celles de l’institution familiale. On retrouve aussi l’idée que la capacité d’analyse est en acte, en tant qu’elle est liée à une pratique : celle d’expérimentation de nouvelles formes relationnelles qui pourront être reprises, sous d’autres modes, par d’autres collectifs, dans un ébranlement élargi du codage social qui régit la sexualité.
En échappant au modèle hétérosexuel, à la localisation de ce modèle dans un type de rapports comme à sa diffusion dans tous les lieux de la société, l’homosexualité est capable de […] servir de révélateur ou de détecteur pour l’ensemble des rapports de force auxquels la société soumet la sexualitéGilles Deleuze, préface à Guy Hocquenghem, L’Après-mai des faunes, Grasset, Paris, 1974..
On retrouve là l’idée d’un privilège épistémique, d’une rente de savoir depuis les marges, analogue à celle que formule la théorie des savoirs situésL’école de philosophie, « Savoirs situés et objectivité forte. Une perspective féministe sur la vérité scientifique », La Science, 2024..
À l’échelle d’un groupe, les figures du « malin génie » (le semeur de doute radical), du « mauvais esprit », du « souffre-douleur » ou « bouc-émissaire », du « trouble-fête », du « maniaque de l’esprit de contradiction » sont toutes des figures de l’analyseur.
· Dans les contradictions : par exemple entre ce qui est dit et ce qui est effectivement fait, entre le discours idéologique et la pratique concrète et matérielle. En analyse institutionnelle, un groupe se définit par le jeu entre trois couches : son idéologie proclamée ; ses règles et son fonctionnement organisationnel ; sa base matérielle. C’est le rapport et notamment les contradictions entre ces trois plans que travaille l’analyse institutionnelle – en partant du principe que l’infrastructure matérielle et organisationnelle de l’institution parle plus fort que les discours articulés (« c’est pour cela qu’elle est dissimulée par les rationalisations idéologiques, la canalisation de l’information, le secret »). Plutôt que de voir dans les contradictions une faiblesse, il faut y voir une force en tant qu’elles constituent des facteurs de mouvement. Les contradictions sont comme des indices donnés au groupe, qui lui permettent d’évoluer : il faut donc travailler les contradictions, accepter de s’y confronter. Les contradictions sont nos seules potentialités de transformation du groupe ; mais aussi du monde !
· Dans le non-sens : ce qui est communément rejeté comme faisant sens à l’échelle du groupe, mais à l’inverse mis sur le compte du caractère de telle personne. On dira « M. Machin fait son M. Machin », « untel fait un caprice », « unetelle fait sa crise » (l’hystérie est un analyseur). Cet inexprimable, ou ce non-sens, c’est ce qui tend à être ignoré ou refoulé par l’institution, « pour que ça marche ».
· Dans les tensions, voire les conflits à l’intérieur du groupe : son hétérogénéité malgré son apparente homogénéité et les buts communs dont il se réclame. Un dissensus permet de faire émerger le non-sens (le consensus n’étant jamais qu’une coalition d’egos associés pour conjurer la menace du non-sens : il tend à étouffer la subjectivité sociale).
De même qu’un lapsus ou un acte manqué manifestent la force de l’inconscient et la faiblesse de l’ego, de même le dissensus ou la crise manifestent la force de la subjectivité inconsciente, en même temps que l’impuissance des pouvoirs officiels.
Une façon efficace de rejeter les analyseurs et les opportunités de mise en mouvement de l’institution qu’ils ouvrent, c’est de « ramener tous les types de déviance à la déviance idéologique. Une telle réduction permet en effet de rationaliser la crise et de la ramener à des schémas de conflit bien connus : questions d’opinion, de génération, d’obédience philosophique… “mauvais esprit” dû à l’individualisme, à l’ambition personnelle, etc.Ibid. »
IV.3. Analyser
Se mettre à l’écoute de ce qui sourd dans les failles par lesquelles s’exprime la subjectivité sociale inconsciente, c’est permettre au collectif d’affronter ses tendances fondamentales à la clôture idéologique, organisationnelle et libidinale, c’est-à-dire lui permettre de résister à la longue et lente glissade sur la pente de l’institué, du naturel, du « ça va de soi » et « ça ne peut pas être autrement ».
La victoire de l’institué sur l’instituant ne relève pas tant du caractère fatal de la récupération et de la normalisation, qu’ à l’inaptitude au dépassement que manifeste un mouvement ou une organisation collective dès qu’il méconnaît et rejette ses analyseursRené Lourau, L’analyse institutionnelle, Les Éditions de Minuit, Paris, 1970..
Dire et entendre
La plupart du temps, le problème n’est pas que les choses soient dites (elles le sont toujours, même si elles ne sont pas forcément articulées) ; c’est qu’elles soient entendues. Or à partir du moment où elles ne sont pas dites parfaitement (par exemple quand elles s’expriment avec ressentiment, ou de façon floue, ou sous forme de reproche) on considère que c’est une raison suffisante pour ne pas les entendre et les rejeter. Ce sont moins les conditions du dire que les conditions de l’écoute qu’il s’agit de soigner. Comment entendre ce que dit vraiment une personne, au-delà du rôle dans lequel on l’a enfermée ? La réponse de la psychothérapie institutionnelle est très claire : il faut élaborer des endroits formels où l’on puisse sortir de ces rôles.
Circulation : que le pouvoir circule, et donc que les rôles tournent
L’institution est la mécanique qui nous objective, nous réifiant dans des statuts et des rôles. Ébranler les statuts et les rôles qui se sont figés, c’est désobjectiviser, c’est-à-dire restituer de la subjectivité : lui permettre de circuler. Pour ébranler les statuts et les rôles, il faut commencer par les faire tourner, au moins à certains moments. C’est le principe du club en psychothérapie institutionnelle, auquel participent aussi bien soignant·es et soigné·es. Cela permet que la subjectivité sociale circule ; et d’éviter que le pouvoir sclérose et abuse de lui-même.
Il faut comprendre que le pouvoir, dans l’institution, a certes une dimension officielle et manifeste, mais ce pouvoir tel qu’il est personnalisé, celui des chef·fes, n’est que formel. Le pouvoir réel, lui, est diffus, insaisissable. Il réside dans cette subjectivité inconsciente de groupe, qui circule (et qui circule plus ou moins) dans l’institution. Cette subjectivité ne se confond pas avec les personnes qu’on peut toujours désigner comme cheffes : inconsciente, elle est sous-jacente à la hiérarchie officielle, elle échappe à l’administration. Surtout, elle n’est pas appropriable : on ne peut pas la posséder comme on possède le pouvoir.
Considérer le groupe comme sujet
On a tendance à se rapporter aux caractères des gens plutôt qu’ à la dynamique du groupe pour en comprendre les mécanismes internes. Considérer le groupe comme sujet, c’est par exemple considérer que ce n’est pas un·e leadereuse qui prend le pouvoir, mais le groupe qui lae lui donne. Ou que ce n’est pas la sur-implication de quelques personnes qui pose directement problème, mais les problèmes que cette sur-implication résout et pose. Si telle personne se met en retrait et exprime de la frustration ; on peut se dire « elle ne vient plus trop, elle n’est pas bien en ce moment », ou bien se demander collectivement d’où vient cette colère et y voir l’occasion d’avoir un autre point de vue sur la situation.
Considérer le groupe comme sujet revient donc à questionner les structures qui font émerger tel comportement individuel, plutôt que de ramener celui-ci à la psychologie de la personne. C’est un rapport inversé à la psychologie : une psychanalyse du sujet dans laquelle on considère que c’est le groupe qui est sujet, et non l’individu.
IV.4. Vacuole analytique
Si les institutions sont notre milieu d’évolution, le milieu dans lequel on baigne, comment y créer les conditions d’un travail analytique du sujet social inconscient ? « Sans répit, chaque problème devait être repris, rediscuté » dit Guattari. Jean Oury, psychiatre et créateur de La Borde, dit à sa façon, qui est la sienne, qu’il faut ouvrir « cette chose difficile que j’appelle “espace du dire”, cette possibilité de rencontre, de transfert où puisse s’exprimer quelque chose de l’ordre de ce qui habituellement est considéré comme inexprimableJean Oury, Félix Guattari, François Tosquelles, Pratique de l’institutionnel et politique, Matrice, Vigneux, 1985. ». C’est-à-dire qu’il faut de l’espace, du vide, pour « faire leur place au non-sens, à la parole vide », à ce qui ne veut pas être entendu. Cela requiert une attention, une disponibilité, pour que les non-dits, les ruptures de sens, les inhibitions, les angoisses, non seulement trouvent à s’exprimer, mais surtout soient entendues. Cette lucidité existe toujours, à différents degrés, mais éclatée, dispersée et confinée en chacun·e des membres et parfois des personnes moins proches, elle sourd en permanence autour des machines à café, dans les couloirs, les embrasures, les halls d’immeubles… (On peut même considérer les moments révolutionnaires comme le surgissement et la coalition de ces lucidités populaires contre les discours du pouvoir.) Guattari décrit ces espaces comme des « vacuoles analytiques ». En biologie, une vacuole désigne un petit compartiment à l’intérieur des cellules, qui n’a pas de forme ou de taille particulière, celles-ci variant en fonction des besoins de la cellule. Ces fonctions sont : la gestion des déchets à l’aide d’enzymes de digestion, le maintien de l’équilibre hydrique et de la pression cellulaire. Il en va de même en socioanalyse. Les vacuoles peuvent se constituer dans les couloirs, ou autour de la machine à café. La vacuole analytique n’a pas besoin d’être formalisée.
IV.5. Institutions autodestituantes
La critique en acte de l’institué au sein de nos groupes donne donc ce que Guattari appelle des « institutions processuelles » – il dit aussi mutante, je dis aussi mineureAu sens deleuze-et-guattarien où la variation prime sur les constantes. Supra,« Institutions mineures », p. 91.. Pour que l’institutionnalisation ne soit pas une simple négation du mouvement qui l’a rendue possible, il faut sans cesse remettre du mouvement dans l’institution dont la tendance spontanée est à l’inverse à la rigidification. Ce mouvement réinjecté dans les formes sociales en voie de rigidification ne peut se diriger que dans un sens très précis : celui de l’accroissement de la transversalité. C’est à cela que sert, et là où mène l’analyse.
Voilà comment construire des institutions qui critiquent en acte l’institué, ce que Lourau appelle des « contre-institutions ». Des « machines de désir, c’est-à-dire de guerre et d’analyse », dit DeleuzeIbid. : machines de guerre, c’est-à-dire irréductibles à l’État et contre lui, et d’analyse, pour que le désir puisse continuer à s’y jouer, à y être opérant. Des formes qui à mesure qu’elles s’institutionnalisent sans cesse s’autodestituent. Car cette forme d’institution où l’instituant garde le pas sur l’institué, c’est autant une institutionnalisation à proprement parler, qu’une désinstitutionnalisation permanente, non sans rapport avec l’idée de destitution.
IV.6. Micropolitique ?
La question est récurrente bien que souvent inassumée : est-ce que le turn-over des rôles, la plasticité de nos formes d’organisation en faveur de la circulation du pouvoir favorisent notre force, ou l’entravent ? Il peut sembler plus efficace de s’organiser hiérarchiquement pour mener une campagne de lutte à l’échelle macropolitique. Mais cette campagne sera d’autant plus facilement ravalable, et cela sans que personne ne le veuille pour autant. S’il y a hiérarchie, il y a moins de capacité d’initiative « en bas », donc moins d’enjeu, moins d’implication, moins de sens. Logiquement, un élément contestataire est d’autant plus facilement intégré à l’ordre des choses qu’il n’en conteste pas les mécanismes.
Faire tourner les rôles ; destituer les chef·fes ; assumer les crises et les conflits plutôt que les gérer et les régler : tout cela ne vise pas seulement à lutter contre les oppressions systémiques entre nous (ce qui relève de l’éthique indépendamment de la tactique ; la politique étant une conjonction des deux), c’est aussi œuvrer à l’irrécupérabilité. Le travail micropolitique en faveur de la transversalité d’un groupe est plus qu’une position éthique en faveur de la circulation du pouvoir. C’est également une question d’efficacité politique – mais d’efficacité politique à long terme : éviter la récupération, le lent et inconscient glissement vers l’institué. Le travail micropolitique, en tant qu’il œuvre à la transversalité d’un groupe, est une façon de lutter contre la récupération.
Je souligne néanmoins que la proposition de Guattari déplace l’idée de micropolitique telle qu’on l’entend habituellement. Celle qu’il propose a trait à la découverte des contenus latents, du désir, de la subjectivité sociale inconsciente qui circule plus ou moins, plutôt que la déconstruction frontale des structures de pouvoir et rapports de domination qui traversent un groupe. Ceux-ci, néanmoins, entravent sa transversalité et seule la transversalité d’un groupe permet au désir de vraiment circuler. Ce que je veux dire, c’est qu’il ne s’agit pas de déconstruire frontalement les rapports de domination et les structures de pouvoir, mais de débusquer le désir, la subjectivité sociale et ce qui les coince en considérant les groupes comme des sujets à part entière. Cultiver le désir et la capacité d’action : façon d’envisager le travail micropolitique d’une façon qui me semble moins morale et plus désirable que celle qu’on pratique habituellement dans les milieux anti-autoritairesUn livre comme Micropolitique des groupes de David Vercauteren (Amsterdam, Paris, 2007), s’inspire néanmoins beaucoup de l’analyse institutionnelle.. Pour le dire avec les mots de François Tosquelles, le fondateur de la psychothérapie institutionnelle : il s’agit de se brancher sur l’inconscient plutôt que sur la prise de conscience des rapports de domination. « Si j’avais à prophétiser, j’envisagerais que le prolétariat puisse rester brancher directement sur l’inconscient et pas sur la prise de conscience…Jean Oury, Félix Guattari, François Tosquelles, op. cit. »
IV.7. Management par la crise ?
Ce qui reste très perturbant dans ce propos, c’est que l’analyse institutionnelle semble s’être elle-même fait mühlmanniser. N’a-t-elle pas été récupérée par les managereuses et psychosociologues au sein des entreprises, et à leur profit ?
Entre l’analyse institutionnelle et le management par la crise, l’accointance n’est pas seulement conceptuelle, elle est d’abord historique. Michel Crozier, sociologue des organisations, écrit en 1966 : « Nous entrons dans une période où la crise est destinée à devenir permanente et où la qualité essentielle de toute structure institutionnelle devra être la capacité d’adaptation et de changement. » De même que l’analyse institutionnelle promeut l’attention et l’adaptation aux crises, le management de crise invite à voir dans celles-ci des opportunités de changement – et de profit. Guattari revendique comme précaires les institutions mouvantes qu’il défend : non sécurisantes et transitoires, au sens où les rôles et les statuts peuvent sans cesse être remis en question et que le groupe menace toujours d’éclater. Dans le monde du travail on prône aussi l’adaptation, ou dans le langage managérial la flexibilité. Le mouvement et la flexibilité deviennent la norme, dans la vie comme dans la lutte.
Attaquer la fixité de l’idéologie, des rôles, des fonctions et critiquer le parti unifié, hiérarchique et idéologique : n’est-ce pas alors se fondre dans l’ordre existant ? Peut-on dire que l’analyse institutionnelle s’est elle-même fait récupérer ? Pire, qu’elle était d’emblée compatible avec le capitalisme de son temps ?
Les remèdes à la récupération que j’y trouve risquent alors malheureusement de ne pas valoir grand chose.
Que serait une telle récupération ? Qu’est-ce qui y résiste ? Malgré leurs accointances conceptuelles et historiques, qu’est-ce qui distingue l’analyse institutionnelle et le management par la crise ?
Première différence : à moins de déserter, jamais un·e managereuse ne quittera son rôle de managereuse. Le management par la crise n’envisage jamais de faire tourner les rôles. En analyse institutionnelle, « l’analyse des formations de subjectivités conscientes et inconscientes n’est pas l’apanage de quelques spécialistes ; elle est l’affaire de tous. » La question du sens de ce qu’on fait ensemble et du sens que chacun·e y met (« qu’est-ce que je fous là ? ») est une question qui revient à toustes, pas à des managereuses ou des psychosociologues. L’effort de reconnaître concrètement le collectif comme sujet, un sujet auto-institué, aussi difficile et contre-intuitif soit-il, n’a aucun sens à être l’apanage d’un·e spécialiste.
Deuxième différence : puisque les crises sont des blocages qu’il faut gérer, et que le but de toute entreprise est le même (le profit), les managereuses peuvent appliquer des méthodes reproductibles d’un secteur d’activité à l’autre. Pour Guattari et Oury, à l’inverse, il n’y a pas de recette, parce que le fonctionnement du groupe doit être adapté à sa mission, c’est-à-dire à sa raison d’être, que ce soit organiser un séminaire, faire une cantine ou s’équiper pour être efficace en manif. À la question de savoir comment s’organisent les pratiques institutionnelles, Guattari répond :
Question piège par excellence ! […] Il n’y a pas de protocole, pas de modèles et vous me demandez un mode d’emploi. Proposez-moi une situation concrète, dites-moi comment elle est agencée, quel rapport « d’incarnation » vous entretenez avec elle. […] [La question] consistera à repérer les éléments indiciels, les séquences de non-sens vécues comme symptôme, comme lapsus institutionnels qui, au lieu d’être tenues de côté, marginalisées, se verront conférer un champ d’expression, une gamme de possibles qu’elles n’avaient pas auparavant. À partir de là, en association avec les divers interlocuteurs concernés, une autre cartographie processuelle des formations inconscientes de ce champ de subjectivité deviendra peut-être possible. […] C’est cela pour moi faire « travailler l’inconscient »Jean Oury, Félix Guattari, François Tosquelles, op. cit..
V. Pouvoir durer, savoir mourir
V.1. Temps messianique / temps à fragmentation
N’est-ce pas encore une prophétie déçue, une prophétie déçue de plus ? Que se passe-t-il quand une prophétie se révèle inspirante, décisive, belle – mais bel et bien fausse ? Comment y renoncer ? L’institutionnalisation, dit Mühlmann, résulte de l’échec d’une prophétie. C’est donc une conséquence logique des mouvements prophétiques, parce que les prophéties sont fausses, toujours, un peu, au moins. L’analyse institutionnelle nous promet donc l’irrécupérabilité, et du fait même de faire une promesse : se fait récupérer. Toute promesse est une petite prophétie. Mais comment arrêterions-nous de croire dans les promesses qu’on se fait à nous-mêmes ?
Si c’est le caractère prophétique du communisme qui le voue à l’échec et à la récupération, n’est-ce pas une raison de plus de renoncer, enfin, au communisme prophétique (le marxisme, le Grand soir) ? Le prophétisme implique un rapport au temps linéaire, guidé par un telos. Linéaire et tragique, aussi : quoi qu’il arrive, l’avenir d’un groupe serait toujours déjà écrit, voué qu’il est à la récupération. Telles qu’on les distingue des religions prophétiques, les religions mystiques conçoivent d’une façon différente l’histoire et le passage du temps. Si le prophétisme induit un temps linéaire, les religions mystiques ouvrent l’idée d’un éternel recommencement du même, au sein duquel les ères se succèdent dans un cadre cyclique. Le mysticisme peut alors prendre deux formes : la recherche d’une origine perdue (le Bouddha) avec son équivalent politique : le retour à un communisme primitif ; la quête d’un accès à des dimensions secrètes de l’existence pour et par la subversion de celle-ci : quel serait son équivalent politique ? Je pense à certaines descriptions que fait Agamben du communisme : un monde où tout serait simplement déplacé d’un millimètre ou deux, transfiguréCe qui n’empêche pas un tel mysticisme d’être messianique. Voir Giorgio Agamben, La communauté qui vient, (Seuil, Paris, 1990) : « Un rabbin, un vrai cabaliste, dit un jour : “Afin d’instaurer le règne de la paix, il n’est nullement besoin de tout détruire et de donner naissance à un monde totalement nouveau ; il suffit de déplacer à peine cette tasse ou cet arbrisseau ou cette pierre, en faisant de même pour toute chose. Mais cet à peine est si difficile à réaliser et il est si difficile de trouver sa mesure qu’en ce qui concerne ce monde les hommes en sont incapables, c’est pourquoi l’avènement du Messie est nécessaire.” ». Conception non exempte de messianisme pour autant.
Quand on se sent plus proche d’un barbecue sur un rond-point en 2020 que du dîner de famille auquel on est en train d’assister, on le sent bien, que le temps n’est pas linéaire. Même quand un évènement s’est refermé, même quand un mouvement s’est éteint ou même fait capturer, il continue d’agir sur le présent. Sous forme de questions, sous forme de savoir, cumulé – un savoir dont on n’a pas forcément conscience. Action du passé dont on n’a pas toujours connaissance.
Une telle conception non prophétique, non progressiste du temps, je la trouve chez Greil Marcus dans Lipstick Traces. Le mouvement punk dont Greil Marcus fait l’histoire est présenté comme un éclat : éclat d’une bombe du passé, qui réexplose. Un temps cyclique permet ainsi de telles explosions fractales du passé. Cette idée, Greil Marcus la trouve exprimée dans cette page d’une revue surréaliste publiée en 1954 :
Le siècle a connu quelques grands incendiaires. Ils sont morts aujourd’hui, ou bien s’achèvent devant le miroir… Un peu partout la jeunesse (comme elle dit) découvre sous une poussière lourde de trente années quelques couteaux émoussés, quelques bombes désamorcées qu’elle lance en tremblant…Greil Marcus, Lipstick Traces, Éditions Allia, Paris, 1998 (Harvard University Press, 1989).
Il me semble maintenant que l’Internationale lettriste (à peine quelques jeunes gens qui pour quelques années s’étaient groupés sous ce nom en quête d’amusements, d’une façon de changer le monde) était elle-même une bombe, passée inaperçue à l’époque, qui exploserait des décennies plus tard sous la forme d’Anarchy in the UK et de Holidays in the Sun. (…) Si Anarchy in the UK distille vraiment une vieille critique sociale oubliée, c’est intéressant ; si, dans le brouhaha de milliers de chansons [que ce morceau inspire et porte à l’existence], Anarchy in the UK ramène cette critique à la vie – c’est quelque chose de beaucoup plus intéressantIbid..
Car Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, reformule une critique sociale du passé produite par des gens dont il ignorait parfaitement l’existence. Une « histoire souterraine » (underground**culture) joint des évènements, parfois séparés de plusieurs siècles : le mouvement punk, les situationnistes, le mouvement dada, mais aussi, les millénaristes du Moyen Âge, les gnostiques du début de l’ère chrétienne. Leurs représentant·es n’ont pas besoin de se connaître.
C’est ainsi que la bombe situationniste explose, ou réexplose, après des années d’endormissement. Un mouvement peut donc être récupéré, et pourtant produire des rejetons révolutionnaires, qui surgiront dans leur temps. Comme le dit Greil Marcus : « Dada est la seule caisse d’épargne qui paye ses intérêts dans l’éternitéIbid.. »
V.2. Savoir vouloir mourir
N’est-ce pas parce que Dada est mort à temps ? Tué par les surréalistes lors de la « soirée du cœur à barbe », quand les Breton, Desnos, Soupault, Éluard, répartis dans la salle, zbeulèrent la pièce de Tristan Tzara, montant sur scène, le frappant au visage – tué, donc, par les surréalistes qui eux, ne sauront pas mourir à temps. Pour lutter contre la récupération, une telle réponse semble fort efficace : il faut savoir mourir à temps.
Le but d’une institution majoritaire, à l’inverse, n’est-il pas, en plus de son but revendiqué, et plus fort que ce dernier, de se conserver elle-même ? Même son organisation verticale est au service de cette autoconservation, en ce qu’elle permet de contrer toute possibilité de surgissement du non-sens et donc toute possibilité d’éclatement. Perdurer, perdurer, perdurer : voilà comment on perd le sens de ce qu’on fait.
Situation où les gens, à partir de mobiles qui ne sont pas nécessairement idéalistes – faire carrière, ne pas se brouiller avec le milieu, ne pas vivre en état de déchirement –, sont amenés à remplir des fins idéales, aussi scrupuleusement que s’ils s’intéressaient à ces fins par goût personnel ; on voit donc que les valeurs qui sont à l’origine et à la fin d’une institution ne sont pas celles qui la font durer. D’où une tension perpétuelle entre le désintéressement que supposent les fins de l’institution et l’égoïsme naturel de ses membresPaule Veyne, Comment on écrit l’histoire, Seuil, Paris, 1971..
Trop souvent nous n’avons pas en vue, ou pas vu au bon moment la possibilité d’une mort collective désirée, et peut-être même joyeuse. Il y a pourtant des exemples, comme celui du CIDOC initialement créé par Ivan Illich, qui décide d’arrêter ses activités et solde sa clôture par une fête somptueuse.
L’alternative, donc, est claire : « ou bien nourrir les idéologies modernistes qui sous le nom “d’innovations sociales” sont en passe d’être intégrées par le capitalisme de crise ; ou bien accepter de mourir. » Ce n’est qu’un choix entre deux façons de mourir :
Ou bien la dissolution pure et simple, imposée de l’extérieur par les forces du capital et de l’État. Ou bien l’auto-dissolution, qui prend les devants par rapport à la dissolution imposée, et présente l’avantage considérable d’être un acte conscient, une analyse, donc une base de départ en vue d’autres expériences fondées non sur la spontanéité ou au contraire la généralisation arbitraire, mais sur un savoir cumulatif et opératoireRené Lourau, L’Auto-dissolution des avant-gardes, Éditions Galilée, Paris, 1980..
Mais comment cumuler un tel savoir opératoire, comment faire d’une telle autodissolution une base de départ plutôt qu’une inéluctable case d’arrivée ? Au moment de son autodissolution, le Parti des Indigènes de la République produit par exemple un texte pour tirer le bilan de ses tentatives et donner à comprendre ses échecs. « En attendant des jours meilleurs, il y a ici, un modeste héritage à la disposition de qui veutHouria Bouteldja et Youssef Boussoumah, « Splendeurs et misères de l’autonomie indigène », dans QG décolonial, 2021, disponible sur : qgdecolonial.fr/splendeurs-et-miseres-de-lautonomie-indigene/. » Ce suicide éclairé est aussi ce qui lui permet de renaître plus tard, sous une autre forme, plus efficace. Savoir mourir, c’est aussi permettre les explosions fragmentées du passé. Sans quoi une telle autodissolution ne serait qu’une fuite, un pur et simple abandon de nos tentatives à la grande pieuvre qui dévore tout.
VI. Conclusion
Quelles formes d’organisation anarchistes et irrécupérables pouvons-nous imaginer ? Pourquoi les appeler institutions mineures, alors que les institutions sont pour la plupart totalitaires et répressives, et qu’elles se définissent par la façon dont elles nous font perdre le sens de ce qu’on fait ? Si je choisis de continuer à parler d’institution, c’est non seulement parce que toute formation collective est traversée de dynamiques d’institutionnalisation. Et non seulement l’institutionnalisation semble inéluctable, mais aussi qu’elle peut l’être à notre avantage. Je propose ainsi de distinguer une institutionnalisation comprise comme normalisation, qui mène à la constitution d’institutions oppressives et répressives, d’une institutionnalisation comprise comme constante réélaboration des formes collectives à partir des questions : « Qu’est-ce que je fous là ? », « Quel est le sens de ce que je fais ? »
Les institutions destituantes que je revendique sont de celles que Guattari appelle « groupes-sujets ». Pour résumer :
· Un groupe-sujet est un groupe rétif à sa conformation à des formes existantes. Il « cultive rituellement ses symptômes », c’est-à-dire ses analyseurs. Rôles, statuts, identités, bref toute rigidification des formes peut être mise en question. Conjurant ainsi les totalités et les hiérarchies, il cultive la transversalité, c’est-à-dire la circulation du pouvoir compris comme possibilité d’initiative de chacun·e.
· Le groupe-sujet se caractérise aussi par la possibilité constante de l’éclatement du groupe, matérialisé par des luttes et tensions internes, mises au travail plutôt que sous le tapis.
Puisque l’analyse institutionnelle s’est fait, au moins en partie, capturer, on ne peut qu’en conclure qu’il ne suffit pas de rester attentif·ves à nos dynamiques instituantes pour éviter la récupération. Il faut aussi savoir pouvoir mourir, ne serait-ce que pour renaître.
Ou alors : faudrait-il chercher encore ce qu’il y a d’irréductible et d’irréconciliable avec l’ordre des choses – toujours plus irréconciliable, toujours plus irréductible, enfin capable de nous extraire du destin que semble constituer la récupération ? Je soutiens qu’un idéal, si irréductible soit-il à l’ordre des choses, ne suffira jamais en soi à nous prémunir contre la capture et la récupération. Ce n’est pas seulement la fin visée par un groupe (son objet, son objectif) qui doit être irrécupérable, mais sa forme aussi. C’est pourquoi je propose de penser la forme d’une institution mineure en tant que forme, indépendamment de sa fin, comprise comme objet ou objectif. Considérer une organisation politique en tant que forme, en tant que moyen indépendamment de sa fin, c’est précisément analyser ses dynamiques d’institutionnalisation. Refuser de dénier celles-ci, c’est se donner les moyens de les contrer. Quelle forme, donc – et pas seulement : quelle fin – permet d’éviter la récupération ? Forme et fin : ce sont ces deux questions qu’il faut tenir ensemble.
VI.1. À quoi être fidèles, en tant que révolutionnaires ?
Telle qu’elle mène à la cristallisation d’institutions majoritaires, l’institutionnalisation nous amène à perdre de vue la fin qu’on vise ; c’est ainsi qu’elle nous fait perdre le sens de ce qu’on fait. Le but avoué de l’institution est supplanté par un but inavoué : celui de faire perdurer l’institution coûte que coûte. Faire perdurer le groupe devient le but visé, quoi qu’on en dise.
On croit donc que si un groupe ou un mouvement se fait récupérer, c’est faute d’avoir tenu assez à ses idées, à sa mission : s’il a trahi c’est qu’il a cédé. On croit que c’est par manque de fidélité qu’un groupe se fait capturer. Pour lutter contre l’inévitable trahison, il faudrait alors s’accrocher à l’idéal du groupe, à la fin qu’il vise, puisque c’est cela qu’il trahit.
Pourtant, l’effet Mühlmann décrit l’institutionnalisation qui résulte du fait de rester, à l’inverse, trop accroché·es à la fin visée par un groupe. Y être tellement attaché·es qu’on continue à être fidèle à une prophétie alors même qu’elle se révèle toujours au moins un petit peu fausse. À camper sur ses positions, aveugle à ses contradictions, parce que celles-ci nous intéressent moins que l’idéal (et l’idéologie) auquel on ne pourra, pour de bonnes raisons, jamais renoncer de croire. Pensons à la radicalité convenue des syndicats, politiquement désamorcés, qui continuent d’agiter leurs drapeaux, de diffuser leurs tracts, en y croyant pourtant, probablement. Mauvais credo, ou excès de fidélité ?
Plutôt que de se montrer fidèles à un futur que l’on vise (le monde que l’on veut faire advenir) ou à un passé que l’on honore (la rupture historique dont on veut continuer de creuser le sillon), je propose de nous montrer fidèles aux contradictions : aux crises, aux conflits, plutôt qu’ à une hypothèse de départ ou à un but visé dans le futur. La vérité n’est jamais énoncée originellement, pas plus qu’il faudrait la faire advenir : elle s’exprime par et dans les conflits et les contradictions.
Une telle hypothèse politique permet de renvoyer dos à dos l’opposition tragique entre l’hypothèse spontanéiste d’un côté et l’hypothèse « programmatique » de l’autre. Toutes deux s’opposent à l’expérimentation que requiert une politique révolutionnaire destituante, qui seule permet de se laisser bouleverser par les évènements, tout en cumulant les expériences[multiblockfootnote omitted].
Rester fidèles aux contradictions, c’est rester fidèles aux évènements qui contredisent ce monde. S’inscrire ainsi dans une histoire souterraine, aux éclats passés et futurs.
Dans les milieux politiques autonomes qui valorisent la destitution, un autre « mécanisme conjuratoireFélix Guattari, Gilles Deleuze, « Traité de nomadologie », Mille plateaux, Les Éditions de Minuit, Paris, 1980. Ils reprennent cette idée à Pierre Clastres dans La société contre l’État, Les Éditions de Minuit, Paris, 1974. » habituellement mis en place pour contrer la récupération me semble tout aussi à côté de la plaque : celui qui veut qu’on échappe à la capture en se rendant insaisissable, en entretenant un flou non sans rapport avec la clandestinité (ou une conception romantique de la clandestinité). Se rendre insaisissable permet certes d’éviter la répression, mais il ne faut pas croire qu’elle permettra, d’une pierre deux coups, d’éviter en même temps la récupération. Ce flou alimente au contraire une ambivalence qui n’incite pas toujours à être honnête avec ses propres fonctionnements – d’être en prise avec ce que Guattari appelle la subjectivité collective. Il renforce le déni de l’institutionnalisation qui, comme on l’a vu, participe plus à la récupération que l’institutionnalisation elle-même. Je propose, plutôt, de considérer un groupe comme sujet et de jouer à saisir l’inconscient collectif là où il pointe son nez.
VI.2. Destitution et institutionnalisation
Au final, ce que je prône, « ce n’est pas l’institution, mais l’institutionnalisation, c’est-à-dire le processus de création, mais aussi de destruction dès qu’apparaît un risque de pétrification et d’hégémonie de telle ou telle institutionFernand Oury, « Institutions : de quoi parlons-nous ? », dans Institutions, mars 2004 (1980).. » (Je souligne.) Ce sont là les mots de Fernand Oury, qui a fondé la pédagogie institutionnelle. Et lui d’ajouter :
Où l’on découvre le rapport entre ce qu’on appelle chez les institutionnalistes les forces instituantes, et ce qu’on appelle, chez nous les révolutionnaires, destitution. Une force instituante n’est pas strictement constituante : c’est ce jeu qu’il s’agit d’ouvrir pour permettre aux forces instituantes de s’opposer aux formes instituées, de se faire destituantes.
Colophon
Relecture par Coralie Guillaubez.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Ce qui tient, réflexions sur les institutions mineures, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Olin Colours Spring Green vélin mat FSC Mix Credit 240 g/m² et Holmen Book Extra 20 Blanc PEFC 80 g/m² en 1 050 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en octobre 2025 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-424-8.
Cette version a été composée par Fulax Pecida en Garamontio (Michele Casanova) et Work sans (Wei Huang).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.