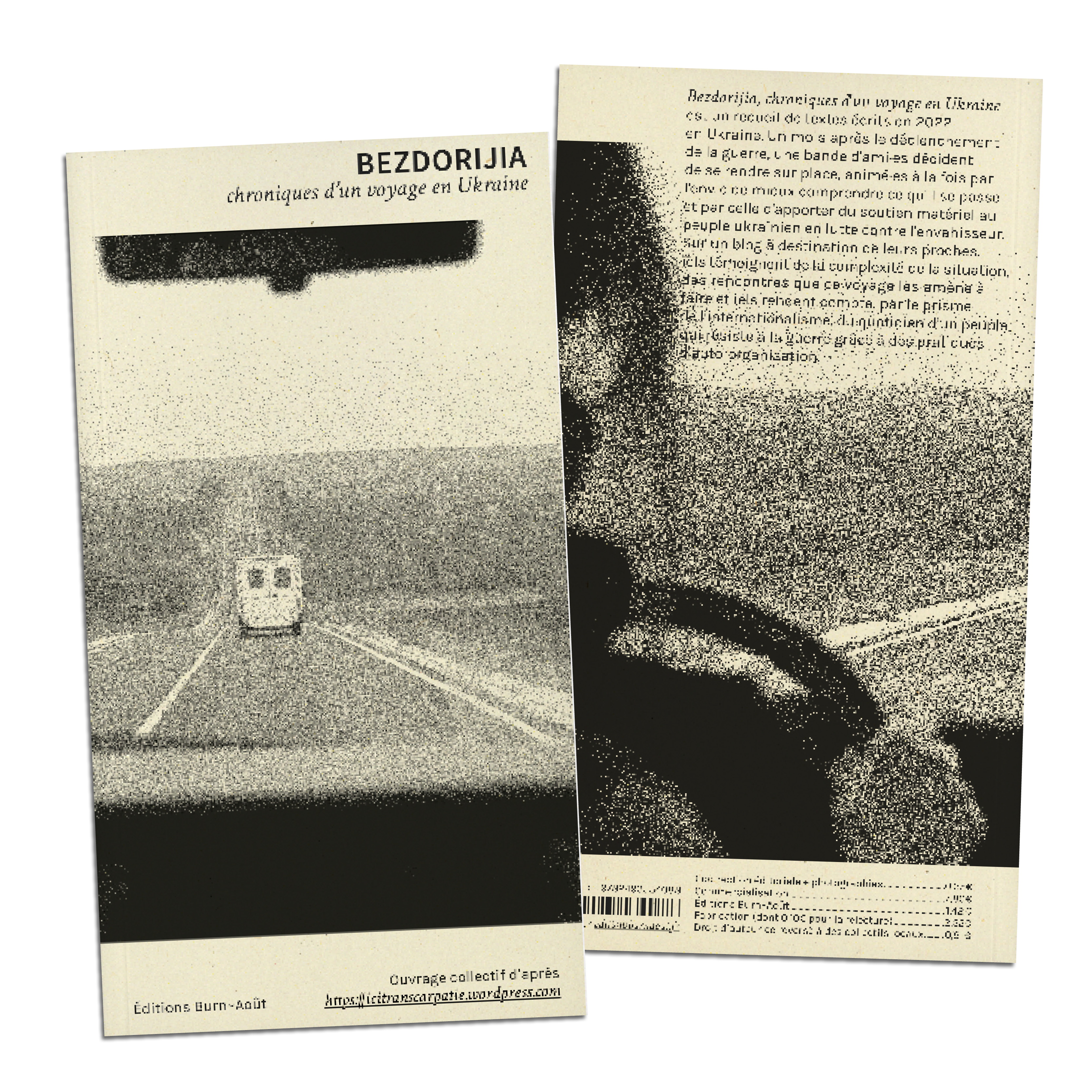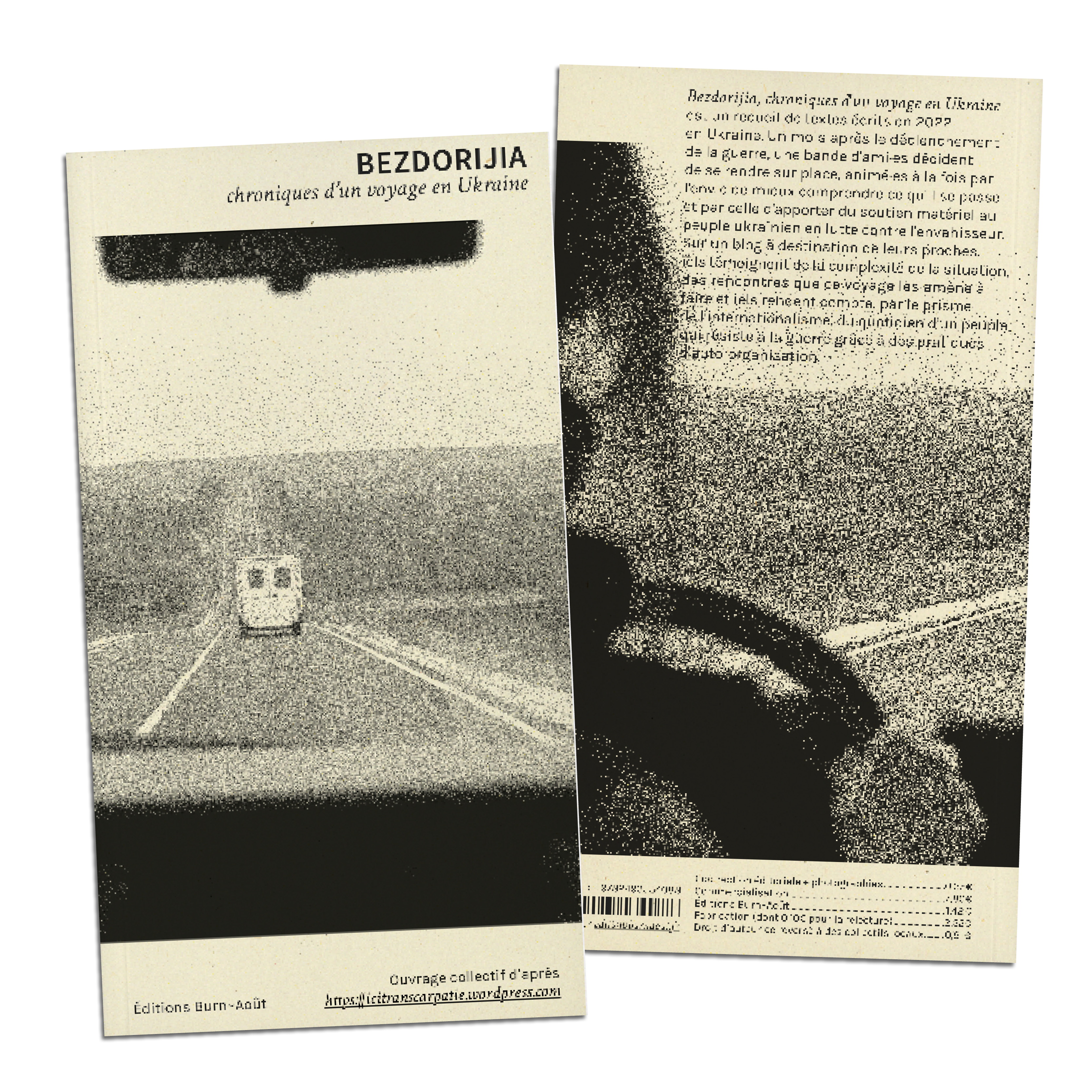
Table des matières
Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine
Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine est un recueil de textes écrits en Ukraine en 2022. Un mois après le déclenchement de la guerre, quelques ami·es décident de se rendre sur place, animé·es à la fois par l’envie de mieux comprendre ce qu’il s’y passe et par celle d’apporter un soutien matériel au peuple ukrainien en lutte contre l’envahisseur. Sur icitranscarpartie, un blog à destination de leurs proches, iels témoignent de la complexité de la situation et des rencontres que ce voyage les amène à faire. Iels rendent compte, depuis une perspective militante, du quotidien d’un peuple qui résiste à la guerre en mettant en place des pratiques d’auto-organisation.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 24/12/24 à 17 h 12.
- Crédits photos
- Appendix A: Note Raspoutitsa
- Appendix B: Note sur les langages inclusifs
- Nous sommes toujours dans le présent — [1]
- Avant-propos
- Ici Transcarpatie : Par le collectif Ici Transcarpatie
- Solidarité en transcarpatie
- Voyage, voyage
- Première journée
- Trajet à Oujhorod
- Au restaurant
- Aller à Kyiv en ambulance… Et rentrer à Carpates !
- Entretien avec des étudiants
- Errance à Kyiv
- Entretien avec Sergï
- Entretien avec Sergiy Movchan d’Operation Solidarity
- Entretien avec des Ukrainiennes originaires de Lougansk et Severodonetsk
- De l’autre côté
Appendix A: Note Raspoutitsa
Raspoutitsa, littéralement « saison des mauvaises routes », est le nom du groupe Signal avec lequel le collectif Ici Transcarpatie communiquait.
Il s’agit d’un mot russe désignant les périodes de l’année durant lesquelles, du fait de la fonte des neiges au printemps ou des pluies d’automne, une grande partie des terrains plats se transforme en mer de boue sous l’action de l’eau. Ce terme évoque aussi la débâcle des armées tentant d’envahir la Russie, la fonte des neiges rendant la route impraticable.
Appendix B: Note sur les langages inclusifs
Le langage, parce qu’il est enchevêtré dans les constructions sociales, est le reflet des rapports de pouvoir qui nous entourent. Conscient·es de sa capacité à pouvoir dans un même temps les subir et les transformer, nous faisons le choix d’employer dans ce livre des formes de langues qui expérimentent d’autres façons d’écrire le genre. La pluralité des formes qui s’inventent nous paraît plus intéressante que l’homogénéisation, c’est pourquoi plusieurs types d’écritures inclusives sont employés par celles et ceux qui ont participé à l’élaboration de ce livre.
Dans le texte du collectif de la Cantine syrienne de Montreuil, Nous sommes toujours dans le présent (p. 25), et dans celui de Juliette, De l’autre côté (p. 201), le point médian est utilisé pour les noms, adjectifs et participes passés dont les formes féminines et masculines ne différent que par la présence ou l’absence d’un-e final (par exemple : les habitant·es sont parti·es) ; la contraction est utilisée pour les noms et adjectifs ayant des suffixes différents au masculin et au féminin (par exemple : auteurice, acteurice).
Dans Avant-propos (p. 31) de Nollaig et les textes de Ici Transcarpatie (p. 51), les mots dont la forme varie en genre sont accordés au féminin. Dans le cas d’institutions ou de groupes de pouvoir qui maintiennent l’ordre patriarcal en place, la forme masculine est utilisée : ainsi pour la police, les groupes d’extrême-droite et l’armée régulière, c’est le masculin qui est choisi, tandis que pour les volontaires, c’est le féminin.

Non loin de l'attaque de missiles russes du 14 juillet ayant détruit plus de trente-six immeubles.

Les volontaires organisent les navettes d'évacuation des civil·es fuyant le territoire.

Camp d'attente des déplacé·es.

Les voitures font la file pour entrer en Ukraine.

Un groupe d'artistes colle les affiches de l'atelier de lithographie des étudiant·es des Beaux-Arts de Paris.
Nous sommes toujours dans le présent — La Cantine syrienne de Montreuil est un espace transnational de rencontres et d’entraide impulsé par des révolutionnaires syrien·nes en exil et des militant·es internationalistes à Montreuil. Depuis 2019, en plus des repas solidaires hebdomadaires, la Cantine syrienne organise des moments de discussion et de partage pour réfléchir aux expériences des soulèvements populaires des dernières années avec ceux et celles actif·ves sur le terrain. « Inspirés par d’autres cantines populaires comme la Cantine des Pyrénées (XXe, Paris), nous avons décidé de créer un lieu de solidarité et de rencontre où l’on s’installe autour de grandes tables pour partager de savoureux repas et des discussions animées. Chaque semaine, voisin·es et volontaires se rassemblent afin d’aider le collectif à concocter des plats gastronomiques syriens servis aux habitant·es du quartier. Le profit ne figure pas parmi nos objectifs. Nos repas, activités et événements sont tous à prix libre ou gratuits. De plus, à partir des principes d’autogestion, nous souhaitons élaborer un modèle alternatif à celui du salariat et de la hiérarchie. Loin des démarches humanitaires ou caritatives souvent dépolitisantes, nous croyons en l’entraide. Pour nous, c’est un moyen de répondre aux difficultés matérielles tout en conservant la dignité, l’égalité et la confiance. » D’après cantinesyrienne.fr.
Au nom de la « guerre contre le terrorisme », Vladymyr Poutine annonce le 30 septembre 2015 l’intervention militaire russe en Syrie aux côtés du regime génocidaire de Bachar al-Assad. La présence de l’armée russe en Syrie est alors décisive pour vaincre militairement le mouvement de révolte populaire déclenché en 2011. Au-delà des désastres politiques et humains dans le pays, l’intervention russe eut des conséquences dépassant largement les frontières nationales de la Syrie.
Quand les atrocités commises par l’armée de Poutine en Syrie (et ailleurs) trouvent comme réponse l’hypocrisie et l’impuissance de la « communauté internationale », personne ne devrait s’étonner de la poursuite franche et décomplexée de la politique meurtrière et impériale du régime russe, cette fois-ci en Ukraine. Pourtant, l’invasion de l’Ukraine a suscité une vague de stupéfaction, notamment en Europe. Comme s’il existait une incapacité cognitive à percevoir la possibilité d’une guerre, au sens classique, sur les sols européens. La guerre en Europe, avant l’invasion de l’Ukraine, faisait partie de l’histoire. Mais le passé a-t-il cessé un jour de se réintroduire dans le présent ?
Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, les révolutionnaires syrien·nes ont bien compris ce qui allait suivre : attaques aveugles, ciblage de localisations civil·es, doubles frappes visant les secouristes et surtout futilité des « solutions diplomatiques » portées par les États ou orchestrées par les « Nations unies ». Ce n’est pas l’histoire qui se répète… Nous sommes toujours dans le présent quand nous regardons l’anéantissement de Marioupol huit ans après celui d’Alep.
La Russie a utilisé la Syrie comme un véritable laboratoire de guerre. Sans gêne, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a pu affirmer que deux cent dix nouveaux prototypes d’armes ont été « testés » par l’armée russe en Syrie. Les mêmes pilotes militaires que ceux envoyés en Syrie pour « s’entraîner » au bombardement des populations locales sont aujourd’hui mobilisés dans la guerre en Ukraine. L’impunité dont bénéficie toujours le régime de Poutine concernant l’intervention de son armée en Syrie est l’une des raisons qui expliquent l’audace avec laquelle il a lancé une guerre totale en Ukraine.
À côté de la stupéfaction, nous avons également vu les réactions d’une certaine gauche radicale déterminée à nier la réalité des choses afin de conserver un pseudo anti-impérialisme hérité de la guerre froide. Les « anti-impérialistes » qui ont défendu le régime de Bachar al-Assad au lieu de soutenir les expériences révolutionnaires d’auto-organisation en Syrie sont les mêmes qui défendent aujourd’hui Poutine sous prétexte qu’il incarnerait, tout comme le régime syrien, la résistance contre l’impérialisme occidental. Malheureusement, cet anti-impérialisme manichéen et abstrait, en plus de prendre le parti des régimes autoritaires et sanglants, refuse d’entendre les voix des personnes directement concernées par les événements et activement impliquées sur le terrain.
Les textes réunis ici parient sur l’importance du geste inverse : les auteurices vont chercher les analyses, les récits et les impressions des personnes qui s’organisent sur place, dans plusieurs domaines et à de multiples endroits. Pourquoi faut-il écouter ces voix-là en priorité ?
Même s’il est toujours souhaitable de tenter de comprendre les intérêts économiques, diplomatiques et militaires des grandes puissances, se contenter d’une lecture géopolitique de la situation pousse à se déconnecter des réalités vécues depuis le terrain. Cela conduit à éclipser les protagonistes ordinaires du conflit, ceux et celles qui nous ressemblent, ceux et celles à qui l’on peut s’identifier, ceux et celles que l’on peut soutenir.
Se reposer essentiellement sur le discours de médias dominants (qu’ils soient pour ou contre l’OTAN, pour ou contre l’Union européenne) et leurs cortèges d’expert·es, qui ont généralement si peu (voire pas) de liens avec la situation qu’iels « commentent », accentue parfois l’état de confusion sans permettre de poser les questions pertinentes.
Ce livre apporte des éléments précieux pour commencer à comprendre et à penser ce qui se déroule en Ukraine, non seulement depuis l’invasion russe, mais aussi depuis la révolte de Maïdan. Ici, il ne s’agit pas de faire parler des spécialistes, mais plutôt de recueillir et d’écouter les voix de celles et ceux qui font face dans leur quotidien aux conséquences du conflit. Depuis 2014 pour certain·es.
En plus des entretiens menés avec des personnes rencontrées sur place, le livre rassemble des notes de voyage écrites par ceux et celles venu·es soutenir. Les descriptions des géographies et réalités traversées donnent un aperçu de l’ampleur et de la diversité des expériences d’auto-organisation en temps de guerre.
Une des questions fondamentales que ce livre nous pousse à réfléchir est la suivante : comment continuer à faire exister, en temps de paix, le même niveau d’auto-organisation que celui dont fait preuve la résistance populaire en Ukraine actuellement ? Comment faire durer l’entraide dans et entre différents territoires une fois que les crises et leurs effets se stabilisent ? Comment maintenir en vie les structures autonomes ayant émergé pour répondre aux nécessités matérielles une fois que l’urgence est moindre ?
En Ukraine comme ailleurs, il est crucial de poser ces questions dans un monde où les catastrophes écologiques, politiques, économiques et sociales ne cessent de se multiplier. Si nous voulons construire des avenirs où les peuples auront le pouvoir de se sauver par eux-mêmes au lieu de dépendre des États et des « grandes puissances », il est d’autant plus essentiel de faire circuler idées, matériel, personnes et savoir-faire entre différentes géographies.
Nous ne pouvons pas nous contenter de trouver des réponses aux urgences ou aux crises. Il nous faut, de manière continue, construire des relations d’entraide, d’apprentissage et de complicité qui dépassent les frontières des identités et des nations. Non comme une éthique abstraite, mais comme une stratégie révolutionnaire.
Ce livre et le voyage qui en a permis l’écriture est un excellent exemple de l'internationalisme par le bas que nous défendons et essayons de raviver depuis la France. Espérons que nous continuerons à chercher en Syrie, en Ukraine et ailleurs, des expériences de la même tonalité que celles que permet de découvrir cet ouvrage.
Avant-propos
To my dear friend Sergï Kopchuk and his family et à Longo Maï, un de ces arcs-en-ciel que l’on peut toucher
Entre le 20 mars et le 20 avril 2022, un mois presque jour pour jour après le début de l’invasion russe, je suis parti en Ukraine avec un groupe de neuf personnes. À notre arrivée, Kyiv est encore à portée de l’artillerie russe. D’Irpin à l’Est de Brovary, la campagne est largement occupée par l’envahisseur et à Marioupol, le bataillon Azov est encore loin de se rendre.
Bezdorijia, chroniques d’un voyage en Ukraine est un recueil composé de photographies et de textes écrits pendant ce voyage et dont la plupart ont été publiés en temps (presque) réel sur le site Ici Transcarpatie — Nouvelles d’Ukraineicitranscarpatie.wordpress.com., à l’exception de l’entretien avec des Ukrainiennes originaires de Lougansk, paru sur Lundimatinlundi.am est un journal d’information sur internet qui paraît tous les lundis depuis décembre 2014. C’est aussi une revue papier semestrielle depuis mai 2017.`" D’après wikipedia.org. en août 2022, et de deux textes inédits : une préface de la Cantine syrienne et un texte de Juliette.
Si nous nous sommes prêtées avec enthousiasme au jeu de l’écriture, c’est en nous gardant bien d’une quelconque prétention journalistique, d’analyse théorique ou d’expertise. Il s’agit essentiellement de récits situés et d’entretiens faits avec des personnes que nous avons rencontrées dans notre quotidien là-bas, hormis l’entretien avec Sergiy Movchan (Entretien avec Sergiy Movchan d’Operation Solidarity, p. 145), que j’ai volontairement contacté.
Les récits de ce recueil n’étaient pas destinés à être publiés dans un livre. Ils sont le fruit d’une aventure collective et on ne savait pas très bien qui en était l’adresse. C’était, pour nous, une manière un peu travaillée de donner des nouvelles à un entourage large par l’intermédiaire du blog — nouvelles qui ont connu une plus vaste diffusion avec la publication de certains textes sur Lundimatin. Presque un an après leur rédaction, faire entrer ces publications dans un livre n’est toujours pas une évidence, mais l’enthousiasme des éditions Burn~Août conjugué à la préface encourageante du collectif de la Cantine syrienne a fini par l’emporter sur le doute.
Ajouté au fait que nous ne sommes pas toutes des habituées de la plume, écrire durant ce voyage a été par moments le fruit d’un certain acharnement. En ce qui me concerne, les quatre textes que j’ai écrits ou co-écrits l’ont été sur le bloc-note de mon smartphone sous perfusion de batterie externe, souvent ballotté dans un minibus zigzagant entre les nids-de-poule, d’un checkpoint à un autre. Cela souvent suivi d’un ping-pong de SMS parfois interminables pour se relire entre co-autrices et corriger les textes avec des amies qui s’occupaient, en France, de la mise en page et des publications.
Le fait d’écrire pendant ce voyage a eu deux intérêts que je ne soupçonnais pas. D’abord, savoir que nous pouvions être lues par de nombreuses personnes pousse à mieux mâcher ses mots, à mettre à mal ses positions initiales. Il a fallu essayer de ne rien affirmer dont nous n’étions pas sûres, re-vérifier les informations, éviter les généralités ; par conséquent, on s’informe mieux et on questionne davantage, ce qui implique une plus grande présence à la situation. Ensuite, le travail d’écriture nous a incitées à toujours prendre des notes et des photos. Habitude plutôt bien perçue par nos interlocutrices qui, en nous considérant parfois comme des journalistes, nous poussaient à la limite de l’imposture. Une imposture qui nous donnait un prétexte pour aller là ou nous ne serions pas allées d’ordinaire.
Les récits antifascistes de la guerre d’Espagne de 1936 dans Hommage à la Catalogne de George Orwell, ceux moins connus d’Antoine Gimenez dans Les Fils de la nuit ainsi que les écrits sur la révolution libyenne de 2011 publiés sur le blog En route ! nouvelles de l’insurrection libyenneConsultable sur setrouver.wordpress.com. Les auteurices à propos du blog : « Prendre au sérieux une insurrection c’est, entre autres choses, tenter de déceler ce qui partout résonne avec elle. Ce qui demande de l’appréhender politiquement : tout autant affectivement, que matériellement ou techniquement. C’est un des objectifs de ce blog. Voir, décrire ce qui se passe, aujourd’hui en Libye, hier en Tunisie, demain ailleurs. Ramener, partager les paroles, les images, les expériences qui nous touchent. Nous ne sommes pas des journalistes. (…) Pour l’instant nous avons choisi de retranscrire quasi tels quels les récits que nous font nos camarades présents sur place. Jour après jour, et avec tout ce qu’ils peuvent éventuellement contenir d’anecdotes, d’échecs, d’imprécisions, de contradictions. Il nous faudra, dans un second temps, reprendre, corriger, réorganiser toute cette matière. » sont autant de textes qui ont participé à alimenter mon imaginaire.
Les deux premiers récits parlent du front, de ce qu’est la guerre dans toute sa monstruosité, mais, surtout, il y est question d’internationalisme, de femmes et d’hommes qui racontent leur quotidien, leur lutte contre le fascisme, tandis que les écrits du blog En route ! nouvelles de l’insurrection libyenne témoignent, sur le mode du reportage, d’un peuple qui, par la révolution, décide d’en finir avec un régime qui l’oppresse.
Plaquer l’imaginaire qui découle de ces lectures sur cette guerre serait mal comprendre la spécificité ukrainienne. Ce n’est pas une guerre civile, mais une nation entière qui se défend contre l’invasion de l’empire russe. Mon départ pour l’Ukraine en 2022 est le fruit d’un questionnement qui m’a souvent traversé. Par le passé, il m’est déjà arrivé d’envisager de me rendre dans des régions ou des pays connaissant des changements majeurs, qu’il s’agisse de la Guadeloupe en 2009, quand le LKPLe Liyannaj Kont Pwofitasyon, abrégé en LKP (« Collectif contre l’exploitation outrancière »), est un collectif guadeloupéen qui regroupe une cinquantaine d’organisations syndicales, associatives, politiques et culturelles de la Guadeloupe. Ce collectif est à l’origine de la grève générale de 2009 qui a touché l’île entre le 20 janvier et le 4 mars.`" D’après wikipedia.org. organisait la grève générale, de la Syrie en 2011, pendant la révolution, ou encore, en 2014, des événements de Maïdan en Ukraine. À chaque fois, sans trop connaître le pays mais profondément interessé par les événements et désireux d’en savoir plus, de m’immerger pour comprendre ce qui n’interésse généralement pas les expertes de la géopolitique.
Sans vraiment le formuler comme ça au départ, c’est une sensibilité internationaliste telle qu’on la trouve décrite par le collectif de la Cantine syrienne dans Guerre en Ukraine, 10 enseignements syriensfootnote:[Guerre en Ukraine, 10 enseignements syriens est un texte publié le 07/03/22 sur le site crimethinc.com. Il est signé par le collectif de la Cantine syrienne de Montreuil et l’équipe du festival Les peuples veulent. qui est le carburant d’un tel voyage. En effet, quoi de plus enthousiasmant, dans un système économique basé sur le profit et la guerre de tous contre tous, que ces situations où les peuples reprennent leur histoire en main et où agir pour sa propre survie revient à agir pour celle des autres ?
Avant de me décider à partir, j’ai vu des reportages fascinants sur les initiatives de solidarité qui se pratiquent là-bas, sur « l’effort de guerre ». J’étais sûr qu’il fallait que j’aille voir de plus près mais je ne savais pas encore où, comment et combien de temps. L’appel à soutien lancé par la coopérative agricole du réseau Longo MaïLongo Maï est un réseau de dix coopératives — cinq en France, les autres en Allemagne, Autriche, Ukraine, Suisse et Costa Rica — qui œuvre à la mise en pratique de principes libertaires, antimilitaristes et anticapitalistes. Voir plus sur prolongomaif.ch. en Ukraine tombait à pic. Après quelques réunions en visio avec des membres de mon entourage qui, elles aussi, se questionnaient, nous avons rapidement formé un groupe pour répondre à l’appel à l’aide pour faire tourner les fermes et soutenir les dynamiques d’accueil de la coopérative. Très vite, nous avons chargé trois véhicules de tout ce qui semblait être utile là-bas et nous nous sommes mis en branle pour quatre jours de trajet.
Sur la route, le gavage de vidéo YouTube aidant, nous pensions trouver un pays baigné dans le chaos, des centaines de réfugiées dans les fermes de Longo Maï, des gens à fleur de peau, de la nourriture insuffisante, du gasoil rationné. On imaginait aussi l’omniprésence de militaires et le bruit des explosions au quotidien. Certes, il y eut un peu de ça, mais comme Juliette le décrit dans De l’autre côté (p. 201), il y a un décalage entre le fantasme du pays en guerre et la réalité qu’on y trouve — particulièrement dans la région de Transcarpatie, qui est épargnée du bruit des mitraillettes et de l’artillerie et dont la mitoyenneté avec les pays de l’Union européenne assure un bon ravitaillement. C’est donc principalement en tant que terre d’accueil que cette région est concernée par la guerre.
Durant ces cinq semaines de voyage, de fin mars à fin avril 2022, j’alterne entre travaux dans la ferme Longo Maï du village de Nijnié Sélichtché et voyages. Un premier convoi nous permettra de livrer une ambulance à Kyiv (Aller à Kyiv en ambulance… et rentrer à Carpates ! p. 69). Je décide d’y rester quelques jours avec Sergï et Juliette (Errance à Kyiv, p. 119), avant de rejoindre les autres en Transcarpatie. Nous retournerons ensuite à Kyiv et principalement à Brovary, dont l’armée russe a récemment quitté les alentours. Avec Sergï et Marie, nous prospectons et livrons des produits de première nécessité à Rozhivka avant de partir pour Zaporijia, première destination des réfugiées de Marioupol, afin d’y distribuer les dons venus de l’Ouest et dont le hangar de Khoust, prêté au Forum civique européenLe Forum civique européen (FCE) est un réseau international de solidarité. Voir plus sur forumcivique.org., regorge.
C’est durant ces voyages qu’en lieu et place du chaos tant promis en l’absence, même partielle, des institutions d’État, j’ai l’occasion de découvrir un large panel de pratiques de solidarité. De la petite équipe d’amies au village de Rozhivka à la grosse manufacture de portiques de balançoires et à l’association sportive de Zaporijia, en passant par l’église évangélique de Vinnytsia, il est impressionnant de voir comment ici, la cuisine d’un traiteur, ou là, un atelier, peuvent se mettre au service de l’effort commun — allant même parfois, en plus de la nourriture, fournir en grande quantité du matériel manquant à l’armée, alors même que l’État concentre l’essentiel de ses moyens sur la partie militaire des opérations.
L’un des constats que je tire de ce voyage est que, durant cette guerre, la capacité matérielle et économique des Ukrainiennes et des Ukrainiens joue un rôle majeur. Derrière l’héroïsme tant mis en avant de Volodymyr Zelensky et de l’État qu’il représente, il y a des millions d’Ukrainiennes, des milliers de petites entreprises et d’associations qui, depuis 2014, s’auto-organisent militairement d’une part et humanitairement de l’autre. Sans ça, beaucoup de gens n’auraient aucun accès aux produits de première nécessité, particulièrement dans les zones les plus touchées par la guerre, desquelles les grosses ONG à but humanitaire ont rapidement décampé.
En rentrant en France avec un groupe de Longo Maï et trois Ukrainiennes, j’ai pu élargir ma vision de la situation en accompagnant l’une d’elles faire les démarches administratives d’accueil à Villeurbanne. On m’a fait part des difficultés auxquelles font face les exilées en provenance du Moyen-Orient, du Maghreb ou des pays d’Afrique pour obtenir l’asile. Des démarches qui, quand elles arrivent à terme, n’aboutissent qu’après de longues années. Quelle ne fut pas ma surprise de voir Marina revenir au bout de deux heures et demie avec un permis de séjour, une sécurité sociale, un compte en banque avec carte de paiement et une allocation mensuelle d’environ quatre cents euros, la gratuité des transports sur simple présentation de la carte d’identité ukrainienne, une assurance maladie, une carte SIM avec forfait de téléphone offert par Free et une proposition d’hébergement ! La plus grande difficulté a été de déjouer la rigidité du protocole d’orientation vers le lieu d’accueil pour qu’elle puisse rejoindre son amie déjà hébergée dans le département de la Loire. Malgré la joie ressentie pour elle et pour toutes les réfugiées ukrainiennes, je suis resté perplexe en constatant une telle disparité des traitements selon les situations. Sur le court trajet en banlieue lyonnaise pour aller au pôle administratif destiné aux réfugiées ukrainiennes avec Marina, nous croisions quasiment à chaque feu rouge des familles syriennes contraintes de faire la manche. Cette image est révélatrice du traitement réel des réfugiées en France.
De retour chez moi, dans le bocage nantais, j’ai repris mes activités dans la structure coopérative d’agriculture et d’artisanat directement issue de la lutte anti-aéroport dans laquelle je suis investi depuis quatre ans bientôt. Avant ce voyage, je craignais que ce que je participe à construire ici soit totalement vidé de sens au regard des réalités de la guerre. Pourtant, en constatant d’une part les processus d’auto-organisation du peuple ukrainien déployés pour répondre aux enjeux de la guerre et d’autre part, à une autre échelle, les moyens que des structures comme Longo Maï et le FCE arrivent à mettre en œuvre, je ne peux m’empêcher de penser que toute dynamique ancrée localement et qui se dote de moyens matériels en tissant des liens économiques et sociaux de manière pérenne peut à tout moment avoir un rôle conséquent à jouer face aux crises que nous vivons.

Arrivée à l'une des fermes de Longo Maï.

Des jeunes de Kyiv aident à travailler la terre.

Les animaux de la ferme sont nourris par les volontaires.

LLe dortoir est organisé pour les neuf personnes arrivant de France.

Dans chaque classe de l'école sont organisés des dortoirs pour les déplacé·es des zones bombardées.

Trajet vers Kyiv pour la livraison de l'ambulance.
Solidarité en transcarpatie
Version originale publiée le 15/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com/solidarite-en-transcarpatie.
Nous sommes quelques amies à avoir décidé d’aller en Ukraine pour apporter notre soutien à une coopérative agricole située en Transcarpatie, tout près de la frontière roumaine.
Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, nous suivons avec attention les nouvelles envoyées par cette coopérative. Leur correspondance est publiée sur le site RadioZinzineVoir radiozinzine.org.. Leur village est situé très loin des zones de conflits (même si celles-ci se rapprochent ces derniers jours) et beaucoup de gens viennent s’y réfugier. D’autres y transitent puis traversent les frontières et restent souvent dans les pays limitrophes.
Comme beaucoup, nous nous sommes demandé comment nous pouvions apporter de l’aide et du soutien : en accueillant des gens ici en France, en allant chercher des personnes à la frontière, en récoltant du matériel… Après plusieurs discussions, nous avons compris que notre présence à leurs cotés était la bienvenue.
Là-bas, la situation change de jour en jour et il n’est pas possible de savoir précisément ce que nous allons faire. Nous savons qu’il y a des chantiers à entreprendre pour aider à rendre plus de maisons habitables dans le village et permettre ainsi à davantage de personnes d’être accueillies dans de bonnes conditions. Il y a aussi des repas à préparer pour plusieurs dizaines de personnes par jour ainsi qu’un soutien logistique à apporter concernant le rapatriement des gens jusqu’au village.
Une première équipe de dix personnes partira vendredi matin pour arriver dimanche en Ukraine. Suivant l’évolution de la situation et les besoins dans le village, nous aimerions arriver à mettre en place un système de roulement qui nous permettrait de maintenir une présence sur un temps long.
Nous savons la situation complexe et voulons nous en faire une idée plus précise en allant voir et discuter, à partir de liens bien réels, avec des gens que certaines d’entre nous connaissent et estiment.
Voyage, voyage
Version originale publiée le 23/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
21 mars. Nous voilà arrivées en Transcarpatie après une route un peu plus longue que prévu. Nous sommes parties depuis la Zad et Rennes avec trois camions. Nous avons traversé la France (où les douaniers français nous ont souhaité « bon courage » — étrange sensation), l’Allemagne (où un de nos camions a eu un problème mécanique préoccupant), l’Autriche (où nous avons fait une pause d’un jour et une nuit pour nous reposer et nous réorganiser) et la Hongrie (très plat pays). Sur notre route, nous croisons plusieurs convois de camions chargés d’affaires, très probablement en direction de l’Ukraine. En milieu d’après-midi, nous arrivons au bout de l’Europe : la frontière hongro-ukrainienne. Les formalités sont rapidement réglées côté hongrois ; côté ukrainien, c’est moins évident. On nous fait patienter longtemps, on ne comprend pas bien s’il manque quelque chose ou s’ils nous font poireauter pour rien. Les douaniers jettent plusieurs fois des coups d’œil superficiels à nos chargements. La file de voiture est bien plus longue pour sortir que pour entrer, mais pas si longue non plus… Après quelques heures d’attente, le douanier passe un coup de fil aux gens qui nous accueillent. On comprend qu’il faut que quelqu’une vienne nous chercher à la frontière. On comprendra après qu’un autre coup de fil aura permis d’outre-passer cette obligation toute nouvelle (hier, une ambulance est passée sans problème). Nous entrons finalement en Ukraine. Nous avions prévu d’arriver avant la nuit, mais les douaniers auront eu raison de notre ponctualité. On ne verra donc pas grand chose ce premier jour, seulement quelques ornières dans la route (on nous avait prévenues). L’accueil à la ferme est très chaleureux, on ne sent la guerre que dans les discussions. Demain nous déchargerons les camions et ferons le tour des lieux où nous pouvons nous rendre utiles.
Première journée
Version originale publiée le 24/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Nous découvrons à notre réveil que nous sommes sur les hauteurs. Les montagnes encore enneigées ne sont pas très loin. Pas de ville à l’horizon et le premier village est à plusieurs kilomètres.
Nous sommes dans une ferme qui, en temps normal, abrite une famille, des cochons, des vaches, des chèvres. En ce moment, il y a une vingtaine de personnes en plus, des réfugiées de Kiev(NdA) Pendant notre séjour, nous nous sommes rendu compte que certains des noms de villes ukrainiennes que nous connaissons en France sont orthographiés selon la langue russe. Dès que nous avons appris ça, il nous a paru évident d’orthographier en français le noms des villes selon l’orthographe ukrainienne. On écrivait Kiev dans nos premiers textes ; à partir du texte Trajet à Oujhorod (p. 61), nous écrivons Kyiv. essentiellement et plusieurs personnes venues de France pour filer des coups de main. Nous passons une partie de la journée à essayer de comprendre comment nous rendre utiles. Qu’est-ce qu’on vient vraiment leur apporter en plus ? Est-ce qu’on ne va pas être une charge supplémentaire ?
Nous commençons par décharger nos camions, retrier quelques cartons pour vérifier que nous n’apportons pas de médicaments périmés ou d’autres choses, soit trop inutiles, soit mal conditionnées. Il semblerait que beaucoup de dons arrivent et, parfois, on se demande si l’Europe ne prend pas l’Ukraine pour une poubelle.
Les gens qui gèrent les dons ici nous disent que, maintenant, ils préfèrent qu’on leur envoie de l’argent. Ils vont en Roumanie et achètent des palettes de produits uniques. Ça évite d’avoir quinze mille sachets de produits dépareillés. Il y a aussi « l’effet liste » : on demande un produit que l’on n’a pas et on se met à en recevoir beaucoup trop. Les dons ont toujours un temps de retard.
Après avoir rechargé les camions, nous descendons à Khust, la petite ville du coin. Là-bas, une usine de chaussures prête une partie de son hangar pour le stockage de dons. Une mère et son fils nous accueillent, c’est elles qui ont l’air de gérer tout ça. On vide notre chargement et on le répartit dans des palettes par catégories : affaires pour bébés, médicaments, affaires pour dormir, piles, batteries, lampes, nourriture. On ne repartira pas les camions vides : deux palettes de cartons sont à livrer dans une école occupée par des réfugiées, avec beaucoup de matériel pour bébés.
Une fois cette petite mission accomplie, nous remontons à la ferme pour la réunion d’organisation qui a lieu une fois tous les deux jours.
Les gens d’ici veulent acheter des machines à laver et un sèche-linge pour un des endroits occupés. Les dons permettent largement de répondre à ce besoin. Il est aussi question de mettre internet dans l’école pour que les enfants puissent suivre leurs cours en visio.
Pendant la réunion, puis pendant le repas, on entend les alarmes anti-aériennes sonner sur les portables. Ça n’a l’air d’inquiéter personne. En tous cas, pas visiblement. Il y a les alarmes de Khust, la petite ville juste à coté, et les alarmes de Kiev, que plusieurs personnes ici ont quittée à cause de la guerre.
L’ambiance à la ferme est très chaleureuse. D’ici, la guerre n’est pas visible. Si presque tout tourne autour de ça, la vie quotidienne continue aussi : nourrir les bêtes, faire la cuisine, planter des arbres… Cet endroit est un petit eldorado.
À la fin de la journée, nous avons une vision un peu plus claire des choses que nous allons pouvoir faire ici :
Trajet à Oujhorod
Version originale publiée le 26/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Mardi. Nous partons à quatre femmes avec un de nos bus pour aller livrer des médicaments dans un entrepôt du Comité d’Aide Médicale en Transcarpatie (CAMZ)Le CAMZ, c’est sept femmes et un cercle d’amies bénévoles dont le bureau est à Oujhorod, mais nous travaillons danstoute la Transcarpatie (la région à l’ouest de l’Ukraine). Nous sommes un groupe d’amies qui sait faire beaucoup de choses différentes ensemble : l’organisation et la gestion des travaux de construction, le montage de meubles, l’organisation de conférences et rencontres. Nous avons appris à travailler avec des personnes handicapées mentalement et physiquement et nous parlons au bureau cinq langues. Et il n’est pas rare que l’après-midi, quelques-unes de nos six enfants viennent au bureau pour manger ou pour attendre quelques heures avant les cours de musique, langues étrangères, natation, tennis, autres… ou bien pour faire leurs devoirs scolaires. Sans parler de toutes les rencontres, consultations juridiques, fêtes, etc. Notre bureau a vu passer beaucoup de personnes différentes : il s’est transformé en cybercafé pour les réfugiées qui venaient consulter leurs mails ou bien boire un café, pour parler via Skype avec leur famille, mais il a aussi été l’endroit où nous avons collecté des témoignages sur les expulsions illégales en Slovaquie et en Hongrie, où les expertes du Human Rights Watch faisaient des interviews sur la situation en Ukraine à ce sujet. Il a été un point de rencontre pour des personnes séropositives qui ont finalement pu fonder leur propre association (Le réseau des personnes séropositives) avec notre soutien, un lieu d’accueil des personnes déplacées de l’Est de l’Ukraine pendant les deux premières années du conflit avec la Russie, dont l’initiative revient aujourd’hui à une ONG, ''Donbas-Zakarpattia'', qui s’occupe des questions des personnes déplacées. En même temps, nous avons accueilli chez nous des ambassadrices et des expertes, des journalistes et des partenaires de projet. Pendant les vingt ans de sa vie, le CAMZ a traversé les diverses périodes qui ont marqué l’Ukraine, de la crise de la chute de l’Union soviétique en passant par deux révolutions civiles, et pour finir une guerre qui dure depuis six ans en Ukraine. Un hasard humain nous a toujours permis de trouver des partenaires pour la réalisation de nos idées et de développer nos projets, formalisés pour être efficaces mais qui se basent sur des relations humaines et solidaires. Et ce n’est pas si évident que cela, car les associations en Ukraine sont dépendantes des changements d’orientations des fondations.`" Extrait de « UKRAINE : 20 ans du CAMZ », un article de Nataliya Kabatsiy, présidente du CAMZ, publié le 10 février 2020 sur forumcivique.org. à Oujhorod. Le CAMZ est une sorte d’ONG active sur de nombreux fronts en Transcarpatie : l’accueil de réfugiées, l’aide aux personnes en situation de handicap, la lutte pour les droits humains fondamentaux…
Aujourd’hui, le CAMZ s’occupe en grande partie de récolter des fonds et des dons et de les faire parvenir dans des zones de guerre par le biais du train — d’après ce que j’ai compris.
Notre mission est, dans un premier temps, d’aller récupérer des cartons de médicaments qui ont été achetés par le Comité grâce aux dons, pour ensuite les apporter à Oujhorod, ville frontalière de la Slovaquie où de nombreuses personnes ont trouvé refuge depuis le début de la guerreVoir « Oujgorod, le havre de paix des déplacés », un article de Jacques Duplessy publié le 20/03/22 sur blast-info.fr.. Il n’y a que cent vingt kilomètres mais ils sont longs à parcourir, les routes étant parfois dans un état qui fait mal aux suspensions.
Nous arrivons dans les entrepôts du CAMZ où transitent de nombreuses choses. Natacha nous explique qu’aujourd’hui, l’entrepôt n’est pas très plein car beaucoup de choses sont parties, notamment une grosse cargaison de duvets. Ce qu’il manque en ce moment, c’est surtout de la nourriture.
Un peu de manutention à faire pour nous : on décharge les cartons, on colle des étiquettes dessus pour indiquer leur point d’arrivée et on les recharge dans le camion. Nous allons ensuite à la gare et redéchargeons les camions. On doit faire comprendre aux hommes qui nous aident que nous avons aussi des bras et qu’ils ne sont pas en sucre ni en carton.
Une fois notre tâche terminée, nous avons le temps de boire un café avec Natacha du CAMZ, qui est accompagnée d’un ami journaliste, Jacques, de son cameraman, d’un correspondant pour une chaine de télévision de Kyiv et de Iuliana, son interprète. Elles tournent un film sur les activités du CAMZ afin de récolter des fonds.
Il faut savoir que cette organisation a été mise sous les feux des projecteurs depuis le début de la guerre. Natacha, qui parle un français impeccable, a été sollicitée par plusieurs médias nationaux et étrangers. Elle est donc d’autant plus contactée.
Natacha et Jacques nous délivrent quelques anecdotes ; par exemple, qu’elles ont récupéré environ cent vingt mille euros de dons de particulières et de mairies, ou alors qu’elles attendent, depuis plusieurs jours, dix semi-remorques venant de la Protection civile de Paris.
Il faut remonter à la guerre du Kosovo ou de la Tchétchénie pour voir un tel afflux de dons et d’aide humanitaire.
J’essaye de trouver des traces de la guerre dans la ville, mais je n’en trouve pas vraiment, à part d’immenses panneaux qui disent aux soldats russes « d’aller se faire foutre », par exemple.
Bien sûr, il y a aussi les discussions avec Iuliana, qui a fui Kyiv avec ses enfants et son mari dès le deuxième jour de la guerre.
Au restaurant
Version originale publiée le 27/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Dans le village où nous sommes, il y aurait entre cinq cents et huit cents réfugiées. Les chiffres exacts sont impossibles à donner car beaucoup de personnes logent chez l’habitante et ne se déclarent pas forcément auprès de la mairie. D’abord parce que certains hommes ne veulent pas voir leurs noms dans les registres, de peur d’être appelés en réserve ou à la défense territorialeLa Force de défense territoriale est formée après la réorganisation des bataillons de défense territoriale, des milices de volontaires créées pendant la guerre russo-ukrainienne sous le commandement du ministère de la Défense. Ces bataillons ont existé de 2015 à 2021, avant d’être officiellement organisés en brigades au sein de la Force de défense territoriale.`" D’après wikipedia.org.. Ensuite parce que tout le monde n’a pas l’intention de rester ici longtemps : certaines espèrent retourner chez elles, à l’Est (la plupart viennent de Kyiv), et au plus vite ; d’autres sont ici en attendant de trouver un pays ou une destination plus à l’ouest où elles pourront se poser. Dans tous les cas, ça fait du monde. Des groupes logent au jardin d’enfants, d’autres dans l’école du village. Rien n’est parfait, mais c’est mieux que rien. De notre côté, nous sommes allées donner un coup de main au restaurant du village, transformé en cantine gratuite qui nourrit deux fois par jour entre quatre-vingts et cent vingt personnes.
Le restaurant a ouvert l’année passée, les cuisines sont neuves, ça nous change des cantines mobiles : une planche de chaque couleur par ingrédient, des couteaux qui coupent ; bref, du matériel professionnel. L’équipe aussi est bien rodée : une équipe de femmes, dont deux travaillaient déjà au restaurant avant la guerre. Les autres sont des réfugiées qui viennent aider tous les jours. Certaines viennent en cuisine depuis le début et une certaine familiarité a déjà émergé, même si l’ambiance est parfois lourde, en fonction des nouvelles du front mais aussi de l’incertitude qui plane autour de l’avenir. La plupart ont laissé leur travail, à Kyiv ou ailleurs, et ne savent absolument pas où aller. On parle un peu avec elles dans la cuisine, mais il s’y passe autre chose, à côté des mots. Comme si la solidarité dans ce genre de situation était évidente, sans phrase : pas besoin de l’expliquer, elle se donne au rythme des boulettes de viande, des soupes, des petits biscuits secs que les gens peuvent emporter chez eux. Pas question de s’en tenir au strict nécessaire : on peut encore se permettre le petit geste et l’ingrédient qui mettent les gens bien. Le midi, le service est à l’assiette ; le soir, on sert des tablées entières. On se croirait au restaurant, sauf que l’ambiance n’est pas toujours joyeuse et que c’est gratuit.
À vrai dire, notre aide n’est pas nécessaire : la cantine pourrait largement fonctionner sans nous. Mais l’ambiance est bonne avec l’équipe et on se dit qu’on va continuer à venir dès qu’on peut.
On parle beaucoup des néo-nazis qui combattent avec les Ukrainiens dans le bataillon Azov, de la résistance « héroïque » des soldats, etc. Certes, la résistance armée est une nécessité, et les bataillons qui s’organisent maintenant construisent sans doute aussi le rapport de force qui ne manquera pas d’exister à la fin de la guerre. Mais il ne faudrait pas oublier alors toutes les autres formes de résistance et de sensibilités qui, malgré tout, s’organisent ensemble pour faire face à la situation : se loger, se nourrir, s’entraider. Évidemment, on aurait vite fait de ranger tout cela dans la catégorie de l’aide humanitaire ; reste à voir en quoi celle-ci est toujours dépassée par autre chose.
Parfois, entre deux patates à découper, on se prend à imaginer que cette situation exceptionnelle se retourne, que les restaurants demeurent gratuits après la guerre, avec des équipes tournantes et des produits venant d’un peu partout pour nourrir toutes celles qui le veulent. Bref, de l’auto-organisation comme on peine à la faire exister en temps de paix.
Aller à Kyiv en ambulance… Et rentrer à Carpates !
Version originale publiée le 01/04/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
De proche en proche et de prise de contact en prise de contact, l’accueil des réfugiées a constitué un vaste réseau d’organisation qui dessine une géographie inédite dans l’Ukraine en guerre et au-delà. Ici, nous allons faire le récit du voyage d’une ambulance à travers l’Ukraine, jusqu’à Kyiv. Tout d’abord, cette ambulance a été achetée par le réseau Longo Maï et le Forum civique européen dans les Alpes de Haute-Provence, en France. Puis, on l’a emmenée jusqu’en Transcarpatie. Ensuite, et c’est là que commence notre récit, nous sommes passées au travers des Carpates et avons sillonné la plaine ukrainienne pour aller la livrer à bon port.
Une station de ski dans les Carpates
Dans les Carpates, des liens préexistaient à la guerre. Si, maintenant, presque tout le monde veut se battre et qu’il y a trop de volontaires pour cette guerre, ce n’était pas le cas avant, lorsque se battre signifiait s’opposer ouvertement à l’impunité des oligarques. On pouvait facilement se retrouver très isolée dans les luttes et plus exposée à la répression. Rostislav est un montagnard de Svydovets, l’immense massif d’une centaine de milliers d’hectares dans les Carpates qui abrite notamment des forêts vierges non protégées, victimes de coupes illégales chaque année. L’oligarque Kolomoïsky, troisième fortune du pays et propriétaire de la chaîne de télévision 1+1 qui a propulsé Zelensky à la tête du gouvernement, projette d’y construite une gigantesque station de ski sur mille quatre cent cinquante hectares (vingt-huit mille touristes à la fois, avec le personnel, cela fait une ville de trente-cinq mille habitantes). Celles et ceux qui se battent contre lui sont en minorité dans la région, même si elles ont pu remporter quelques batailles avec le mot d’ordre : « Free Svydovets »À propos de « Free Svydovets » : « Le massif de Svydovets se situe dans les Carpates à l’Ouest de l’Ukraine, dans la région de la Transcarpatie. Il est composé de nombreuses forêts, d’alpages et de trois lacs naturels. Caractérisé par son aspect sauvage, il est un des massifs les plus riches en faune et flore du pays. Le mouvement Free Svydovets regroupe des militant·es du village de Lopukhovo, niché sur le flanc du massif, des organisations écologiques de la Transcarpatie, de Lviv et de Kyiv, des juristes et les membres de la coopérative de Longo Maï en Ukraine. Le massif de Svydovets est menacé par un complexe touristique complètement démesuré, une énorme station de ski à une altitude où les précipitations de neige sont loin d’être garanties. 33 remontées mécaniques pour 230 km de pistes, 60 hôtels, des centres commerciaux, des parkings de plusieurs étages. Une ville nouvelle conçue pour 28 000 touristes et 5 000 employées, construite sur 14 000 ha de forêts qui seraient détruits ! » Voir plus sur prologomaif.ch..
Selon nos amies de Longo Maï qui font partie de la lutte contre la station de ski, Rostislav n’avait déjà pas peur d’assumer ouvertement ses positions avant la guerre. Rostislav et nos amies partagent ensemble une forte confiance née de l’expérience de la lutte sur le terrain, loin des idéologies. Le langage dessiné par le rapport aux idéologies n’a pas la même grammaire en Ukraine qu’en Europe occidentale. Ici, se rassembler pour lutter contre un projet écocide gigantesque porté par des oligarques constitue un acte fort en soi. L’espoir qu’il promet ne donne pas le luxe de contenir en son sein la somme des luttes d’émancipation que l’on voudrait voir fleurir de concert. Alors, on ne sait pas bien de quelle idéologie répond Rostislav. On sait qu’il est nationaliste, sa région (l’oblastUn oblast est une unité administrative de type « région » existant en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Biélorussie, au Kirghizistan et en Bulgarie.`" D’après wiktionary.org. d’Ivano-Frankivsk) l’est très fortement aussi ; pour lui, la guerre n’a pas commencé en 2022 et son engagement date de Maïdan, en 2014. On sait qu’il fait face à la situation de manière sérieuse, qu’il se donne les moyens d’aider des réfugiées, mais aussi de fournir un appui à des bataillons de paramédics au plus près des combats. S’il demande de l’aide, le possible sera fait pour y répondre.
Nous ne savons pas bien ce que veut dire ici « être nationaliste », d’autant plus dans le contexte de la guerre.Alors que ce sujet est au cœur de certains débats dans la presse occidentale, ici ce n’est pas le cas. C’est la volonté d’unité qui prédomine. Il nous semble qu’il y a différents rapports au nationalisme, mais nous pouvons nous demander ce que qui est de l’ordre d’un nationalisme de défense et ce qui relève d’un nationalisme de la domination. Dans la situation actuelle, saluer avec un « Slava Ukraïni ! » (Gloire à l’Ukraine !) ne veut pas forcément dire un engagement fort dans le nationalisme, mais plutôt un sentiment commun d’être toutes et tous dans la même situation. Nous n’avons pas les réponses, ces questions restent donc ouvertes.
Sergï est un ami de Rostislav arrivé en vitesse à Nijnié Sélichtché depuis Kyiv au début de la guerre avec sa femme et ses enfants, qui ont très vite rejoint l’Allemagne. Il est le premier des réfugiées à retourner à Kyiv au moment où cela paraissait inenvisageable et dangereux pour tout le monde. Accompagné de son ami Roman, ils mettent en place des transports pour apporter des médicaments à l’aller et ramener des personnes au retour. Ils proposeront aussi de mettre en place ce qu’ils appelleront des « hubs » : des lieux d’accueil de réfugiées pour leur permettre de faire des étapes sur la route. Ce sont donc les réfugiées, avec l’appui logistique de Longo Maï (dons de véhicules et administration de douane), qui ont mis en place ce petit réseau d’évacuation et de mise à l’abri de personnes en difficulté proches des zones bombardées. Des réseaux comme celui-là, il doit actuellement en exister beaucoup en Ukraine.
Donc voici l’histoire : Rostislav aimerait ramener une ambulance pour un bataillon de paramédics actif à Kyiv et dans l’Est. Il demande à son ami de Transcarpatie quelles sont les possibilités. L’ambulance arrive, les papiers sont faits, elle est « dédouanée ». Sergï organise le voyage jusqu’à Kyiv. Il est calme, droit, attentif. On aurait envie de le suivre les yeux fermés. Nous avons avec nous des papiers attestant que nous sommes un convoi humanitaire, avec une liste exhaustive de tout le matériel médical que nous transportons. Cela nous permettra d’aller plus vite pour passer les checkpoints . Ce voyage sera l’occasion d’aller voir sur notre route les différents lieux qui sont en lien étroit les uns avec les autres depuis le début de la guerre.
La route
Le 25 mars, nous partons dans un convoi de six personnes pour livrer l’ambulance et deux véhicules supplémentaires. Au départ de Nijnié, huit cent cinquante kilomètres et quinze heures de route nous séparent de Kyiv. Nous ferons une escale chez Rostislav à Kossiv, deux cent cinquante kilomètres plus loin, puis nous serons accueillies le lendemain soir à Kyiv dans une église évangéliste. Vers 13 h 30, notre convoi s’ébranle et s’élance sur les routes des Carpates. Nous les traversons d’est en ouest.
Les sommets avoisinent les deux mille mètres d’altitude. Pas de quoi faire de l’ombre aux Alpes ni aux Pyrénées, et pourtant, la neige y est abondante. Malgré les températures assez douces, elle est bien décidée à profiter encore un peu de sa blancheur avant d’aller doucement se jeter dans la mer Noire.
De petites scieries bordent les forêts de hêtres et d’épicéas communs, la petite paysannerie sculpte les collines et les mains habiles des artisannes ont laissé leurs traces sur les maisons aux ornements généreux.
Le rythme est soutenu, notre convoi serpente sur les routes sinueuses en se mouvant habilement entre les nids-de-poule et les attelages de chevaux.
Kossiv
À Kossiv, capitale des HoutsoulesLes Houtsoules sont une population montagnarde ukrainienne vivant essentiellement dans la chaîne des Carpates ukrainiennes et dans les régions voisines de Ruthénie subcarpathique et de Bucovine septentrionale.`" D’après wikipedia.org., nous sommes accueillies alternativement par le délégué du département de la Culture et le maire du village. Kossiv, commune de trois mille habitantes, accueille autant de réfugiées dans les infrastructures publiques, les écoles et chez l’habitante. Il est toujours difficile de compter car tout le monde ne se déclare pas. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place une allocation pour les réfugiées, ce qui pourrait motiver les inscriptions.
Les infrastructures publiques sont détournées de leurs fonctions habituelles pour répondre aux impératifs de la guerre. La Maison de la Culture voit son théâtre se transformer en plateforme logistique. Ici, des tonnes de dons en nourriture, médicaments mais aussi powerbanks , gilets pare-balles, casques, etc. sont réceptionnées, triées puis dispatchées à différents endroits selon les besoins et les contacts.
Il est notable que la majorité des choses s’organisent dans les infrastructures officielles, mais sous des formes non institutionnelles. On nous raconte qu’une bonne partie de l’aide part pour la ville de Dnipropetrovsk, où beaucoup de personnes de Marioupol et Zaporijia se sont réfugiées. Il n’y aurait pas de stratégie établie concernant l’envoi de l’aide. On envoie là où des demandes arrivent. Lorsqu’il y a des surplus de nourriture après de grosses arrivées, ils sont envoyés aux gars du bataillon de défense territoriale 108. C’est là que beaucoup de mecs de Kossiv se sont engagés.
Au centre de formation des métiers de l’artisanat, les ateliers répondent à leur manière à l’urgence de la situation. La production d’artisanat houtsoule s’est mise en pause. Par exemple, les bibelots en bois ont donné leur place à la fabrication de poignées pour tourniquets (garrots chirurgicaux) ; à la place de la confection de robes traditionnelles, l’atelier couture fabrique des sacs tactiques en jean récupérés ; l’atelier de tapisserie est mis à profit pour la fabrication de filets de camouflage. Ces filets, nous les retrouverons d’ailleurs sur la majorité des checkpoints croisés en route. C’est touchant de voir comment, à leur échelle, les personnes que nous croisons mettent tout en œuvre pour agir dans la situation.
Kossiv-Kyiv
Départ de Kossiv : cinq heures trente. Le paysage rompt drastiquement avec celui des Carpates. Des parcelles gigantesques ondulent à perte de vue. Nous naviguons désormais sur l’océan agricole.
De gigantesques bâtiments délabrés cherchent maladroitement à se cacher derrière les haies larges tantôt de peupliers, tantôt de robiniers, comme un enfant se cache derrière ses mains.
On peut s’y perdre en tracteur, et pour labourer il faudrait un supertanker. La Beauce, à côté, c’est de la petite paysannerie et le bocage nantais, un jardin japonais.
Kyiv
Nous arrivons devant l’église sur la rive gauche du Dniepr, dans le raïonUn raïon ou raion est le terme utilisé dans plusieurs États de l’ancien bloc communiste pour désigner deux types de subdivisions administratives : une subdivision territoriale ou une subdivision de ville`". D’après wikipedia.org. de Dniprovskyi, au centre-est de Kyiv. L’église est d’allure modeste, son pasteur qui nous reçoit en jean et sweat-shirt l’est aussi. Il a accueilli tout un régiment de pompiers du district, parce que les militaires ont pris place dans leur caserne habituelle. Des lits de camp disposés par rangées occupent toute la place. Les pompiers n’ont pas eu à intervenir près des zones de combats parce que leur intervention est cantonnée à leur district, qui n’a pas été touché pour l’instant. On nous demande de ne pas faire de photo de l’intérieur, pour ne pas prendre le risque de révéler la position des pompiers à l’armée russe. C’est la règle en vigueur partout. Nous la respectons scrupuleusement, bien qu’il y ait une touche légèrement comique lorsque l’on voit le peu de discrétion affichée par les camions de pompiers bien garés en rang sur le parking.
C’est Sergï qui nous a amenées là, il a des amies dans cette église. Iaroslav le pasteur nous parle de toutes les choses qu’il a entreprises depuis le début de la guerre. Sa principale activité est la mise en place de distribution de nourriture pour, au départ, deux cents personnes, et mille cinq cents maintenant.
La discussion dévie plusieurs fois sur la guerre en général, avec quelques envolées de Iaroslav contre le communisme et pour la défense de la propriété privée. Sergï ne cache pas ses désaccords avec lui, tranquillement, comme lorsqu’il nous dit que dans ses contacts au sein de l’église, il y a différentes tendances, celle-ci étant plus « dure ». Nous demandons tout de même à Iaroslav ce qu’il pense de Zelensky. Avec son air légèrement illuminé, il répond : « Bah… J’ai voté Zelensky, mais avait-on vraiment le choix ? En 2014, quand les séparatistes ont attaqué l’aéroport de Donetsk, Porochenko a demandé aux soldats de garder la position. L’aéroport a été détruit et beaucoup de personnes sont mortes, sacrifiées héroïquement. Là, en 2022, au premier jour de l’invasion russe, un aéroport de fret près de Kyiv (à Hostomel) se fait bombarder et alors Zelensky ordonne de lâcher la position en expliquant que les bâtiments n’ont pas d’intérêt mais que la seule chose qui importe est la vie des Ukrainiennes. Il a fait la même chose pour Marioupol, il a dit qu’il fallait partir. Voilà la différence entre Porochenko et Zelensky selon moi. » Sergï acquiesce. Zelensky a gagné, pour eux en tout cas, une crédibilité qu’ils ne lui accordaient pas avant la guerre.
Un repos s’impose. Nous allons nous installer aux côtés des pompiers. La nuit, la sirène sonne parfois. Mais il semblerait qu’à Kyiv, comme en Transcarpatie, on ne s’y fie plus trop. En Transcarpatie, c’est parce qu’elle indique qu’un avion survole une zone qui est extrêmement large — elle n’indique à peu près rien. A Kyiv, c’est aussi parce qu’elle n’est pas précise et peut-être parce qu’elle sonne trop souvent. On nous dit que les gens vont se mettre à l’abri désormais quand ils entendent la première bombe tomber.
La remise de l’ambulance
Notre contact dans le bataillon de paramédics paraît être la personne qui gère l’acheminement des véhicules (ambulances, etc.) depuis la frontière. Nous le retrouvons au matin devant l’église, très affairé. Il arrive de Lviv avec des véhicules, accompagné de ses deux gardes du corps. L’un fait deux mètres et paraît être une réplique typique des bonhommes qui ont pris d’assaut le Capitole — cheveux longs, lunettes spéciales, insignes divers, et des armes un peu partout. Heureusement que l’autre fait la moitié de sa taille et a une mine sympathique. Nous étions déjà prévenues qu’il serait difficile de rencontrer le bataillon parce qu’il est constamment en action et débordé. Nous insistons pour aller dans leur base, pour comprendre ce qu’on y fait concrètement. L’argument avancé étant celui d’avoir un regard sur les organisations qui sont soutenues, au vu de prochaines aides éventuelles.
Nous allons donc à la base, surprenante, dans des bâtiments historiques assez grandioses. Pour nous y rendre, nous empruntons un des nombreux ponts qui traversent le Dniepr, immense et magnifique.
À la base, nous voyons des véhicules de type ambulance, ou jeep militaire ; des volontaires en treillis et des personnes armées qui accompagnent les paramédics dans leurs interventions pour les protéger. Ces bataillons de paramédics sont des organisations de volontaires bénévoles qui existent depuis 2014 et se sont formalisées après Maïdan dans la guerre du Donbass. Bien qu’ils ne dépendent pas de l’armée, ils sont en étroite relation avec celle-ci, étant donné qu’ils interviennent au plus près des combats. Leur maxime est : « sauver des vies ». Ils se composent en petites unités de trois ou quatre personnes qui vont intervenir dans la ligne de front pour prendre en charge les blessées civiles et militaires qu’ils mettent en sécurité dans des points de stabilisation puis dans les hôpitaux. Il y a trente et une unités mobilisées à Kyiv en ce moment. Cette organisation s’est largement professionnalisée depuis 2014 et bénéficie d’un large soutien financier et médiatique, mis en scène dans une publicité très héroïque. En apparence, la distinction avec le corps militaire n’est pas évidente et toute bénévole participant à ce bataillon doit suivre une formation exigeante de secours militaire. La différence, nous dit-on, se situe dans le fait que chez les paramédics, il n’y a pas de salaires, pas de notion de désertion (on peut s’en aller quand on veut, bien qu’il faille demander une permission pour faire une pause lorsqu’on est mobilisée), et surtout « que l’on respecte la sensibilité de chaque personne ». Depuis le début du conflit, de nombreuses personnes ont cherché à les rejoindre, alors ils ne prennent plus de nouvelles volontaires parce qu’ils ne dispensent pas de formation actuellement. S’ils manquent de personnel, ce n’est pas au niveau médical mais plutôt dans des fonctions précises comme celle de chauffeuse ou de mécanicienne. Il faut suivre une formation spéciale pour être capable de conduire dans des conditions extrêmes et savoir faire les principaux gestes d’urgence vitale (être capable d’installer un garrot tourniquet sur soi-même, par exemple).
Ils manquent beaucoup aussi de matériel de protection militaire, comme les casques et les gilets pare-balles. Sur la question des gilets pare-balles, nous expliquons à notre contact que nous ne souhaitons pas fournir à l’armée du matériel qui serve aux combats directement, mais que dans le cas d’une protection pour des unités de médics, cela pourrait être envisageable. On nous répond honnêtement que la frontière entre les personnes qui combattent et celles qui les protègent n’est pas si nette, et qu’en conséquence il n’est pas possible d’assurer qu’un gilet pare-balles qui sert à une médic ne soit pas transmis par la suite à un soldat. Ceci est renforcé par le fait que certains soldats sont très mal équipés, alors dans la perspective de protéger les personnes, l’intérêt des paramédics va forcément dans le sens d’un meilleur équipement de protection pour les soldats. Pour conclure ce débat, on nous conseille, dans ce cas précis, de ne pas chercher à leur fournir cette aide.
La rencontre fut rapide mais plutôt efficace. Le contact a été plutôt bon, mais en s’intéressant un peu plus à ces organisations de volontaires, on se pose beaucoup de questions sur l’articulation entre le volontariat armé et l’armée régulière, une spécificité qui existe en Ukraine depuis au moins 2014 mais qui a certainement explosé avec la guerre maintenant.
Nous repartons, faisons un tour de la place Maïdan non sans une certaine émotion, et filons du centre-ville plutôt désert.
Nous sommes encore à Kyiv lorsque nos amies de France nous demandent ce que les Ukrainiennes pensent de l’annonce des Russes qui vient de tomber. Il s’agit de l’annonce du 25 mars par l’armée russe qui dit avoir « rempli ses objectifs » et prévoit de concentrer désormais ses efforts sur la « libération du Donbass ». Toute la presse française parle d’un possible recul des troupes russes, mais ici personne ne semble au courant. Selon Sergï, avant de faire cela, elles essaieront une dernière grosse tentative sur Kyiv avant de se concentrer sur l’Est tout en disant que « c’était ça le plan depuis le début ». Une volontaire paramédic dit : « Je ne sais pas mais ce n’est pas ce que nous observons présentement sur le terrain, et s’ils partent, il y a toutes les chances qu’ils pilonnent avant. »
Un nouveau couvre-feu est annoncé pour le samedi soir jusqu’au lundi matin. Nous ne savons pas ce qu’implique pour notre sécurité de circuler pendant qu’il est en vigueur. Nous n’allons pas risquer de rester bloquées deux jours, alors nous nous hâtons de partir. Finalement, le couvre-feu est annulé. Le ciel est chargé de pluie lorsque nous repartons de Kyiv pour Khmelnytskyï. Nous nous hâtons car un autre couvre-feu nous attend là-bas, à vingt-deux heures. Ce fut étrange de découvrir une grande ville si furtivement et dans de telles circonstances. On la découvre ainsi sans élément de comparaison possible. Sergï nous indique les endroits où, un mois plus tôt, il était impossible de trouver une place pour se garer. Maintenant, les rues et les avenues sont presque vides. Il règne un certain calme que seuls quelques lointains bombardements viennent troubler. On aperçoit une file énorme de personnes qui attendent une distribution de pain. La circulation est rythmée par les nombreux checkpoints qui ont chacun leur style. Surtout, il y a des hommes en armes partout, en uniformes la plupart du temps mais pas toujours. Ce sont les gars de la défense territoriale qui sont présents sur les checkpoints. Parfois, on les croise dans des voitures banalisées, avec certains emblèmes, et c’est peu dire que certains n’inspirent pas franchement le professionnalisme. On nous dit que dans beaucoup de cas, certaines personnes se sont engagées dans la défense territoriale pour éviter d’aller au front. Puis plus tard, lorsqu’elles en ont marre de ne rien faire, elles finissent par s’inscrire dans l’attente d’être mobilisées. Selon les villes et les villages, la défense territoriale est très différente. Parfois, dans les campagnes, les volontaires se retrouvent sur-équipées et avec des tâches de moindre importance, ce qui peut accroître leur zèle, alors qu’à Kyiv, elles manquent d’équipements. Lorsqu’un jeunot de dix-huit ans lève nonchalamment le canon de son arme vers nous sans même nous apercevoir, on a envie de glisser illico sous le siège. Au moins la première fois qu’on les voit ; après, peut-être que l’on peut s’habituer.
Khmelnytskyï
Khmelnytskyï est une capitale régionale de deux cent soixante mille habitantes. Nous y faisons une étape pour aller rencontrer celles qui sont devenues des alliées de circonstance dans la situation. De nombreuses réfugiées ont pu faire étape ici avant de rejoindre la Transcarpatie, et les chauffeuses ont pu y faire escale sur la route pour aller chercher des personnes à évacuer plus à l’est. Le pasteur de l’église évangéliste, évêque de cinquante-huit églises dans la région, s’est mobilisé pour accueillir les réfugiées. Celles-ci ne restent en général que quelques jours mais le pasteur espère garder contact avec celles d’entre elles qui, dans la situation, ont trouvé le chemin de Dieu. Loin de douter de l’effort fourni par l’évêque évangéliste pour aider les réfugiées, nous ne doutons pas non plus de sa volonté missionnaire d’accroître sa communauté religieuse. Khmelnytskyï est à la croisée des chemins de l’exil : que l’on vienne de Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Marioupol ou Odessa, on passe par Khmelnytskyï, et même précisément par la route juste en face de l’église. Il est huit heures trente et les sœurs du pasteur nous servent un festin à base de borsch [борщ], kacha [каша] et viande en sauce. Nous faisons la connaissance d’une famille rom de neufs personnes tout juste arrivées de Kharkiv sans aucun argent, ni aucune idée pour la suite. Nos amies de Transcarpatie échangent les contacts pour envisager de les aider plus tard. Avant de partir, alors que les fidèles commencent à arriver pour la messe du dimanche, le pasteur insiste pour nous offrir une prière collective en l’honneur de notre engagement. Il précise à ses frères et sœurs que nous l’avons prévenu que nous n’étions pas croyantes, alors tout le monde sourit, certain que cela est bien sûr impossible !
Les liens tissés entre personnes locales et réfugiées à l’intérieur de l’Ukraine depuis un mois ont conduit à des rencontres improbables. Nous ne pensions pas partager une nuit avec des pompiers dans une église, ni accepter la bénédiction d’un évêque évangéliste pour la fin de notre voyage. Nous pouvons espérer que tous ces réseaux d’entraide et d’organisation concrète par le bas puissent tisser des liens au-delà de l’absolue nécessité. Qu’ils soient assez solides et nombreux pour faire perdurer cette capacité d’auto-détermination qui avait déjà été une des promesses du Maïdan de 2014. Et ainsi de ne pas laisser l’ingérence, qu’elle soit russe ou occidentale, décider de l’avenir des habitantes d’Ukraine.

Trajet vers Kyiv pourla livraison de l'ambulance.

Une école est aménagée en dortoir pourles déplacé·es des zones bombardées.

Le théâtre est devenu lieu de stockage pour les denrées humanitaires. À l'arrière, on fabrique des gilets pare-balles.

À l'étage du musée, un atelier fabrique des filets de camouflage.

« Russes, bienvenues en enfer »

Fumée d'une explosion de la veille.

Kyiv déserte. Sept heures du matin, avant la livraison de l'ambulance.

La soupe du midi se prépare pour les habitant·es du quartier.
Entretien avec des étudiants
Version originale publiée le 12/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Pendant notre voyage, nous avons réalisé un entretien avec trois jeunes de seize, dix-huit et vingt-et-un ans. Comme plusieurs personnes ici, ils ont décidé de ne pas participer à la mobilisation générale imposée par l’état de guerre et ne sont pas allés s’enregistrer auprès des autorités. Depuis le début de la guerre, ils sont donc cachés dans un village de Transcarpatie car la loi martiale interdit aux hommes entre dix-huit et soixante ans de quitter le pays.
Nous leur avons posé quelques questions sur leur situation. L’entretien a été fait en russe, la langue avec laquelle ils sont le plus à l’aise, puis traduit en français.
Pouvez-vous vous présenter ? Quel âge avez-vous, que faites-vous dans la vie, comment vous êtes-vous retrouvés là ?
V ~ Depuis huit ans je m’intéresse à la musique, j’en fais beaucoup. J’ai fait une petite pause dans les études et là je suis en première année des Beaux-Arts. Je suis de Kyiv, je suis né là-bas et j’ai dix-huit ans. On est arrivés ici grâce à notre grand-frère. On se sent bien ici, surtout en comparaison avec d’autres situations de réfugiées. Ici on est dans un paradis.
I ~ Ça fait cinq ans que je vis à Kyiv. Je suis aussi aux Beaux-Arts, spécialité histoire de l’art. Je suis arrivé ici avec V. et N. J’avais pas vraiment d’endroit où partir et je suis très reconnaissant parce que I. [le grand-frère] a vraiment eu la tête froide pendant le trajet de Kyiv jusqu’ici et c’était très rassurant.
N ~ J’ai seize ans, je viens de finir l’École des Beaux-Arts et j’aurais dû rentrer à l’Académie des Beaux-Arts… Avant que la guerre ne commence, notre frère nous a demandé de faire nos valises. Une semaine avant la guerre il y avait déjà un soupçon que ça allait commencer. Et le premier jour de la guerre on est partis.
Vous êtes jeunes, qu’est-ce que le mouvement Maïdan et tout ce qui a suivi depuis représente pour vous ?
I ~ Moi c’est pareil, c’est pas vraiment un événement qui m’a touché parce que j’avais quatorze ans. Quelques semaines après le Maïdan, je suis arrivé pour m’installer à Kyiv avec ma mère. Je me souviens qu’à RechiateRue principale à Kyiv où il y a eu la révolution de Maïdan. il y avait des trous d’impacts de balles dans les murs et des gens qui étaient encore en train de nettoyer des armes, mais à cette époque-là ça ne m’avait pas trop impressionné. Récemment j’ai vu un documentaire sur le Maïdan et j’ai compris l’importance que ça avait eu et l’influence sur la guerre actuelle.
Nous avons compris qu’à partir de dix-huit ans tous les hommes devaient aller se présenter à l’administration afin de pouvoir être mobilisés. Est-ce que vous vous êtes fait enregistrer, et si non, pourquoi ?
V ~ Oui, à partir de dix-huit ans tous les hommes doivent s’enregistrer. Moi je ne l’ai pas fait. Je me cache des militaires. Dès le premier jour de la guerre je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Mais j’ai compris que je ne voulais pas tuer des gens. J’ai beaucoup de choses à voir et à vivre. Peut-être que ça va sonner arrogant de dire ça mais je ne crois pas que le fait de ne pas vouloir aller se battre soit une faiblesse, et je ne me sens pas mal par rapport à ça. Par ailleurs, j’aime mon pays et sa culture. J’ai beaucoup de reconnaissance pour tous ces gens qui luttent dans l’armée, sans eux je ne pourrais pas moi-même ne pas y aller. Je ne peux pas m’imaginer tuer quelqu’une mais je vois bien que s’il n’y avait pas d’armée… Je ne pourrais peut-être pas rester en vie. Et en même temps je me demande… S’il n’y avait que des gens armés et pas de gens comme moi, comment ça serait ? Et vice versa…
I ~ Normalement, tant que tu fais tes études, l’armée ne peut pas te prendre même si tu as dix-huit ans. Mais les gens qui ont dix-huit ans, même ceux qui ne font pas d’études, ils ne veulent pas aller dans l’armée. Presque tous mes amis ne veulent pas aller à l’armée. Pour ma part je crois que je ne suis pas patriote et je ne me sens pas prêt à y aller. Je n’ai pas envie de tuer des gens. Par contre je pense que si le pays tient aujourd’hui c’est grâce à des villes comme Kharkiv et d’autres villes de l’Est, grâce à la résistance qu’il y a là-bas. Moi je ne veux pas m’engager dans l’armée parce que j’ai encore jamais voyagé, j’ai rien vu du monde… Peut-être que si j’avais un peu plus vécu j’aurais pu m’engager.
V ~ Je sens qu’il y a une pression. Je sens que le pays s’est uni pendant cette guerre. C’est évident qu’il y a des gens qui jugent. Probablement que les gens pensent qu’on a peur ou qu’on ne soutient pas l’armée. En ce qui me concerne, personne ne me met la pression pour l’instant et même si c’était le cas ça ne changerait pas le fait que je n’ai pas envie de faire la guerre.
I ~ Du coté de la famille, c’est évident que personne ne me met la pression, bien au contraire. Elles ne veulent pas que les militaires me repèrent. Du coté des amies il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans la défense territoriale. Mais même elles ne jugent pas, ne mettent pas la pression. La seule pression qu’il pourrait y avoir est celle des militaires. Mais je n’ai jamais vu de civiles mettre la pression à d’autres civiles en ce qui concerne le fait de s’inscrire à l’armée ou de participer à la guerre.
Pendant notre séjour, des patrouilles de policiers et de militaires sont plusieurs fois venues voir si des hommes se cachaient. Ils sont repartis bredouilles.
Est-ce que vous aimeriez quitter le pays ? Que ressentez vous quand au fait de cette impossibilité de sortir du territoire ukrainien ?
I ~ J’ai une immense envie d’aller à l’étranger. J’aimerais faire des études à l’étranger et en même temps je vois ce qu’il se passe à Kharkiv et j’aurais vraiment envie d’aider à reconstruire la ville, de retaper des maisons. J’avais fait une demande pour faire mes études en République tchèque. J’ai même une lettre de l’Université où je devais aller qui dit que tout peut m’être payé dès la frontière : le transport, le logement. Je pourrais même avoir une bourse. Mais je sais très bien qu’à la frontière on ne me laissera pas passer. Je trouve ça dommage que tous les hommes soient mis dans une seule catégorie. Aucune différence n’est faite entre les histoires des gens. Ils ne comprennent pas que certaines personnes ne peuvent pas faire la guerre mais pourraient être utiles pour d’autres choses.
V ~ C’est sûr que je trouve ça dommage que les hommes ne puissent plus partir à l’étranger mais en même temps je pense que c’est normal. On est dans un moment de guerre, donc on doit rester solidaire. Même si j’avais pu faire mes études à l’étranger, et j’aimerais vraiment le faire, je ne serais pas parti. Pas maintenant. J’aurais ressenti de la honte et de la faiblesse en partant. Je veux rester solidaire avec les gens qui se battent. En même temps, j’ai mes propres rêves… Ce que j’aimerais faire en Ukraine, c’est du cinéma et du dessin. J’aimerais faire des films d’animation mais ici ce n’est pas développé. J’aimerais donc aller faire mes études à l’étranger et revenir en Ukraine avec ce que j’ai appris, pour développer le pays. Mais je ferai ça après la guerre. Si je pars je ne pourrais pas regarder dans les yeux mes amies qui se battent en ce moment dans ce pays
Quelles nouvelles recevez-vous de vos amies qui se battent ? Est-ce que vous partagez des discussions avec les gens qui se battent ?
V ~ J’ai des amies qui sont inscrites dans la Force de défense territoriale mais pas d’amies qui sont au front. Ce que je comprends c’est qu’elles sont très motivées, comme toutes les volontaires. Évidemment qu’elles se sentent mal, mais elles sont motivées. Pour ma part, je sais que j’aurais mal vécu le fait de me retrouver dans la Force de défense territoriale. Encore pire que les autres. Après… J’aimerais vraiment parler de la haine des Ukrainiennes envers les Russes. Cette guerre provoque une haine des Russes et je trouve ça dommage. En même temps, ce sont les Russes qui ont envahi le territoire ukrainien. C’est ça qui motive l’armée ukrainienne : défendre son territoire. C’est maintenant commun en Ukraine de haïr les Russes. Cette haine nourrit l’esprit des gens qui font la guerre. Dans le contexte c’est acceptable, mais c’est pas normal de haïr toutes les Russes. Il y a des Russes qui ne sont pas d’accord avec la propagande d’État. Il y a des écrivaines, des peintres, des artistes qui ont partagé sur la scène internationale le fait de souffrir de cette guerre. On ne peut pas mettre toutes les Russes dans le même sac.
I ~ Mes amies qui sont en guerre sont en même temps positives et agressives, c’est ça qui leur permet de combattre. Leur grande phrase à l’intention des Russes c’est : « Venez, on vous attend ». J’ai l’impression qu’il y a un certain patriotisme chez les volontaires. Et moi je n’ai pas ça… Je pense que les soldats russes, de leur coté, ont été lâchés. On entend des enregistrements vocaux de soldats rapportant qu’ils ont les pieds trempés, qu’ils sont au beau milieu d’un champ ou dans une maison à moitié démolie, qu’il ne leur reste que trois jours de nourriture, que leur hiérarchie ne répond pas au téléphone, qu’ils ne savent pas comment ils vont continuer… Ils sont faits comme des rats. C’est pas de ces soldats-là qu’on doit avoir peur, mais des attaques qui viennent du ciel. Récemment, l’Université de Karazin à Kharkiv a été bombardée. C’est de ça qu’on doit avoir peur.
V ~ J’aimerais revenir sur le sujet de la haine des Russes, parce que ça me touche beaucoup. J’essaye de me mettre à la place des soldats russes et je ne sais pas si j’aurais agi autrement, parce que je crois que c’est le système qui les fait agir comme ça. Je ne crois pas qu’on puisse construire de la paix avec de la guerre. La guerre change les gens. Une personne qui fait la guerre ne pourra plus être comme avant. La guerre produit des animaux. C’est des gens qui ne pourront plus être sincères ensuite. Ça détruit tout en toi.
I ~ J’espère qu’après la guerre, lorsqu’on va devoir reconstruire le pays, toutes les grandes architectes d’Europe participeront. Je pense que cette guerre montre les vrais visages de l’Ukraine et de la Russie. J’espère aussi que cette guerre va faire changer les choses dans notre pays. Ici, tu peux tout vendre et tout acheter : c’est la corruption généralisée. Même la médecine est corrompue. Cette guerre peut être une chance pour reconstruire le pays à partir de zéro, à partir d’autres valeurs, plus justes. J’espère que le pays deviendra meilleur. Le processus est terrible mais c’est peut-être une chance.
V ~ Pour moi c’est aussi une chance pour que le pays change. On est dans un pays post-soviétique, envahi par la corruption. C’est pas un pays qui aide les gens à se développer. Je pense que la guerre va aussi montrer le vrai visage des gens, les vrais visages des gens qui sont au pouvoir, au parlement, etc. La guerre peut faire partie d’un processus de développement du pays. Dans une démocratie, normalement, ce sont les gens qui ont le pouvoir et pas le pouvoir qui a le pouvoir ! Le mouvement Maïdan et cette guerre nous montrent que ce sont les gens qui ont le pouvoir. Ça nous montre la direction vers laquelle veulent aller la plupart des Ukrainiennes, à savoir plutôt vers l’Union européenne. Peut-être qu’on a l’occasion de construire la démocratie dans notre pays et de montrer à tout le monde quelle direction veulent prendre les Ukrainiennes
De notre point de vue, l’Europe n’est pas forcément un idéal… Est-ce que vous imaginez que la société d’après guerre ne soit pas une société juste comme vous venez de la décrire ? Est-ce que vous vous imaginez lutter pour ces idées ? Vous projetez-vous aussi dans le fait que ça ne soit pas vraiment comme vous l’imaginez
V ~ Après la guerre, je me vois plutôt partir à l’étranger. Je me sentirai plus utile là-bas. Ça veut pas dire que je ne voudrai jamais habiter ici. Je suis né ici, j’aime l’Ukraine. Évidemment, je sais que ça ne sera pas idéal comme on se l’imagine mais je me battrai pour que ça le devienne. Bon, en même temps je dis ça et en même temps en ce moment je ne fais pas grand chose pour lutter [dit-il en montrant sa jambe dans le plâtre]. Pour moi c’est important de lutter mais pas avec des armes et pas en faisant la guerre
I ~ Moi j’arrive pas à imaginer, par exemple, que la Russie gagne. Personne ne soutiendrait ça parmi la population. Si en Ukraine tout reste comme avant la guerre, ça veut dire qu’il y a encore de la corruption. Moi je ne peux pas m’imaginer faire physiquement une révolution comme sur le Maïdan, par exemple. Je me vois plus m’engager par le biais de l’art. De toute façon c’est impossible de battre la corruption, enfin rien n’est impossible mais c’est très compliqué. Il n’y a que les hommes avec les cravates qui décident..


Rendez-vous pour mettre en place des cantines. Les panneaux d'indication sont noircis pour empêcher les soldats russes de se repérer dans la ville, des barrières anti-tanks sont installées.

À l'arrêt depuis le début de la guerre, l'entreprise produit en temps normal plusieurs tonnes par an.

Le pain est ensuite distribué pour les civil·es resté·es dans la ville.

Rendez-vous pour mettreen place une cantine.

Errance à Kyiv
Version originale publiée le 14/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Le texte qui suit a été rédigé à partir de notes prises entre fin mars et début avril, après une livraison de matériel à Kyiv ( Aller à Kyiv en ambulance… et rentrer à Carpates !Voir page 69.). À ce moment-là, les troupes russes étaient aux abords de la capitale ukrainienne sans parvenir à y pénétrer. Elles se sont repliées depuis pour se concentrer dans le Donbass.
Le lendemain de la livraison de l’ambulance, Juliette et moi-même décidons de ne pas repartir directement dans les Carpates. Sergï y retournera la semaine suivante et, en attendant, nous découvrirons avec lui comment, depuis ses activités d’avant-guerre, il met en place un réseau de solidarité. Ces quelques jours d’immersion nous permettront de mieux comprendre comment la vie continue de frayer son chemin dans une ville à moitié assiégée. Nous avons donc égrené les kilomètres pendant cinq jours en voiture entre la maison de Sergï, dans le petit village de Rozhivka, et l’immensité de Kyiv.
Un jour, entre le samedi 26 au soir et le mardi 29 mars. Une vingtaine de kilomètres au nord de Kyiv, chez Sergï, à Rozhivka.
Au pied des derniers buildings commencent des plaines vides, fin de la capitale. Ballotté, j’écris dans mon carnet en lettres minuscules. Villages fantômes, lumières éteintes, maisons cloîtrées, l’armée russe n’est pas loin. Le bruit de roulement trahit le silence, l’auto glisse dans la nuit. On se déplace avec des frontales dans la maison. Ici, contrairement à Kyiv, on n’entend pas la guerre (pour l’instant), mais le vent qui agite les pins sylvestres. Le sol est sableux, on se croirait dans les Landes. Drôle d’ambiance dans cette maison neuve parachutée là comme un parpaing sur une plage déserte. Malgré moi, mes sens cherchent en vain l’océan. À trois kilomètres à l’est se trouve le village de Skybyn, au nord de Brovary, qui est au nord de Kyiv. Après ce village se trouve le no man’s land qui précède les positions de l’armée russe. C’est ici qu’une colonne de plusieurs dizaines de tanks s’est fait mettre en déroute par une embuscade ukrainienne dès le début de l’invasion. Un petit oligarque de Brovary, ami de Sergï, possède une importante production de tomates et de concombres hors-sol. Ses trente-huit hectares de serres sont à l’arrêt depuis le début de la guerre. Les millions de plants de tomates abandonnés à leur sort se dessèchent lentement. Les bombardements sont trop proches, impossible d’assurer la sécurité des six cents employées. Les quartiers autour sont presque déserts, la majorité des habitantes ayant décidé de quitter la zone. Notre petit oligarque reste ici, avec deux amis à lui, dans cette villa esthétiquement digne de celle de Tony Montana en bien plus modeste. Il vend des tomates et des concombres, pas de la cocaïne. Les femmes et les enfants des trois hommes sont parties se réfugier ailleurs, alors ils dorment dans des lits de camp dans la cave sous la cuisine, entre potes. Mines patibulaires, joggings noirs, bagouses et chaînes en or. Leur look de mafieux tout droit sortis d’un film de Scorsese contraste bien avec leur bonhommie enfantine et leur goût pour les papouilles avec le chat de la maison. Dans le jardin flotte fièrement un gros drapeau ukrainien, comme un avertissement donné aux éventuels militaires russes qui oseraient s’aventurer dans le coin. Une Bible est exposée sur un meuble pompeux au milieu des icônes orthodoxes. La protection de Dieu semble insuffisante pour se défendre. De chaque côté du front, on prie pour sa protection. On pourrait être tenté d’y voir un certain paradoxe. On nous montre une collection de sabres et un Mossine, fusil soviétique emblématique de la seconde guerre mondiale. Ça ne suffira pas non plus. Leur assurance et les sous-entendus nous font comprendre qu’ils ont ce qu’il faut. Ils sont prêts à mourir ici en héros. Puis ils décident de nous emmener aux dernières positions de la défense territoriale, très proches de la ligne de front. En quelques minutes, on est au bout d’une voie express parsemée de hérissons tchèques en ferCe sont les dispositifs anti-char de type obstacle statique inventés lors de la seconde guerre mondiale contre les chars russes. Ils sont une alternative aux « dents de dragon »., de longrines en béton et de débris divers. C’est un axe stratégique car il permet d’aller tout droit dans le centre de Kyiv en venant du Nord-Est. Nous arrivons au pied d’une voie ferrée surélevée où nous sommes accueillies par quelques membres d’un bataillon. L’adrénaline et la tension sont palpables. Ils nous distribuent des chocolats avant de nous emmener aux postes avancés dans un van noir. Nous finissons à pied, zigzaguant entre les mines anti-chars. Au loin nous apparaissent les tanks russes, immobiles devant une usine Coca-Cola. Deux nuances de rouge. Les empires se côtoient. Chargé de sable, le vent, encore lui, ponce nos visages et balaie la route. Sec et froid, dans la dramaturgie il joue son rôle à merveille. Il souffle où il veut et chaque soldat est un condamné à mort. Un jeune russe gît là dans son uniforme. Débris humain parmi les débris de tanks et de maisons explosées. Épargnées par les missiles à sous-munitions« Une arme à sous-munitions, également appelée bombe à sous-munitions (BASM), ou roquette à sous-munitions, est un conteneur transportant de nombreux autres projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites “sous-munitions”. Cette munition “anti-matériel” ou “antipersonnel” permet de traiter des surfaces étendues en demandant moins de munitions que les munitions classiques. » D’après wikipedia.org., certaines sont encore habitées.
Un autre jour. Mes notes en vrac zigzaguent entre les arrêts nombreux, les checkpoints et les nids-de-poule.
De retour dans les rues de Kyiv, je mets plus de temps à différencier le délabrement ordinaire des stigmates de la guerre qu’à faire la différence entre le bruit de l’explosion d’un missile russe et celui d’un tir de missile de défense anti-aérien. Comment c’est possible que d’aussi loin ça fasse trembler toute la ville ? Le regard aussi s’affine : dans les nombreux checkpoints on distinguera ceux tenus par l’armée régulière de ceux gardés par les bataillons de volontaires. Des subtilités dans les équipements, les attitudes et les comportements. D’un certain point de vue, le front n’est qu’un petit bout de la guerre, une sorte de mirage où ça tire en rafales. Un jeu entre présence et absence. Absence des enfants et de la femme de Sergï dans la maison de celui-ci, de toute la famille dans les appartements de ses amies où tout montre qu’ils ont été quittés à la hâte. Brovary, Skybyn, Boutcha, Marioupol, Kharkiv, Kramatorsk… Le nom des villes m’apparaissent à mesure qu’elles se font bombarder.

Le camp de déplacé·es s'est vidé.

Le quartier de Podil a repris ses activités.


Un des villages largement détruits pendant l'invasion russe de mars.
« Mines »

Les dégâts d'un missile S-300.

Slava : « J’en ai marre de la guerre, je vais vous montrer comment on peut vivre en Ukraine et tout oublier. »
Entretien avec Sergï
Version originale publiée le 18/03/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Sergï Kopchuk fait partie de la diversité de gens que l’on peut rencontrer dans l’une ou l’autre des deux maisons de la coopérative de Longo Maï en Ukraine. L’entretien est un bricolage fait à partir des discussions que nous avons eues durant deux voyages réalisés ensemble : d’abord la livraison d’une ambulance à un bataillon de paramédics à Kyiv et ensuite la livraison de matériel et de nourriture à Zaporijia.
Étant donné le large manque de maîtrise de la langue anglaise qui fut, en dehors de la communication non verbale et des silences qui en disent long, notre seul moyen de parler, il se peut que tout ce qui est écrit là soit totalement faux et que l’amitié qui est née de ces moments partagés soit un pur malentendu.
Je connais VladymyrÀ propos de Free Svydovets, voir page 58. qui possède un hôtel dans le parc de Svydovets depuis longtemps, et il connaît Longo Maï par le biais de Free Svydovets.
Je suis arrivé pour la première fois à la ferme sept jours après le début de l’invasion russe, c’était pour faire passer la frontière à ma famille. Ensuite on m’a demandé si je pouvais aider, notamment pour les transferts de réfugiées.À Dortmund, en Allemagne. Ma femme voulait partir avant le début de l’attaque car elle était sûre que ça craignait mais je n’y croyais pas. Quand l’invasion a commencé nous avons décidé de ne pas partir dans la panique en même temps que des millions de personnes. Donc ma femme et nos deux enfants, Léa et Lukas, sont chez des amies là-bas [à Dortmund] maintenant.
En temps normal, j’ai plusieurs activités. Je suis consultant dans la promotion immobilière, j’organise des séjours sportifs et je dirige une petite boulangerie industrielle solidaire d’une vingtaine d’employées, un café social et j’étais en cours d’ouverture de mon propre bar.
La boulangerie et le café social sont des projets sociaux à la base, mon ami et ex-collègue qui dirige ZeelandiaZeelandia est une entreprise qui vend des mélanges de farines pour les boulangeries industrielles. (je ne travaille plus là-bas) a un fils trisomique et il a décidé de créer une dynamique qui permet son inclusion. Dans la boulangerie comme dans le café social, l’idée est de donner l’occasion aux personnes trisomiques d’être confrontées à la vie en société pour éventuellement pouvoir devenir autonomes par la suite.
La boulangerie s’appelle 21.3 : vingt-et-un pour la trisomie 21 et trois comme les trois étapes pour une intégration sociale. Un : découverte/immersion/familliarisation dans un milieu mixte, deux : intégration au travail, et trois : autonomie.Mes activités de consulting et d’organisation de séjours sportifs sont à l’arrêt complet. Le café n’a pas eu le temps d’ouvrir mais j’ai décidé de le transformer en point de distribution de denrées alimentaires et autres si besoin, de plats chauds gratuits, et en un lieu de partage et d’échange.
Pour la boulangerie, toutes les travailleuses sont des volontaires bénévoles, à part une cheffe dont la production dépend. Au début de la guerre il n’y avait que deux, trois volontaires au lieu des seize employées en temps normal et maintenant il y en a une dizaine. Beaucoup de gens veulent aider d’une manière ou d’une autre. Mon ami de Zeelandia essaie de trouver des fonds pour payer tout le monde, au moins partiellement.
Actuellement nous produisons mille trois cents pains de quatre cents grammes deux fois par jour, et des gâteaux.
La distribution se fait essentiellement au café social avec de la soupe, deux cent soixante-dix par jour, mais aussi aux checkpoints et dans une clinique de Brovary. À la boulangerie, les riveraines peuvent venir se servir à heures fixes.
Tout est distribué gratuitement.
Il y a d’autres points de distribution dans la ville, comme à Druzy Christa, une église évangeliste où nous sommes allées ensemble, mais je pense qu’il faut multiplier les points de distribution pour que ça soit accessible pour les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer facilement. Surtout avec les checkpoints, le maintien partiel et aléatoire des transports en commun ainsi que les couvre-feux.
On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais pour l’instant, c’est calme à Kyiv, même si ça bombarde au loin. Par contre, autour de Marioupol et du Donbass, beaucoup de gens sont dans le besoin, et avec la possibilité d’un corridor d’évacuation, ça va augmenter. Avec l’aide de Longo Maï, je pense que ça serait intéressant de faire quelque chose là-bas sur le même modèle qu’ici mais il faut aller voir d’abord.Je vois bien l’idée de l’aide et de la solidarité, mais concrètement tout ça coûte de l’argent. Comment tu fais pour faire face aux charges alors que tout est distribué gratuitement ?
Déjà il faut savoir que pour moi, c’est impossible d’imaginer faire de l’argent pendant la guerre. Les gens sont dans le besoin et la question c’est : comment aider quand on peut ? Et pas : comment faire du profit ? L’entreprenariat, ça pourra reprendre après, en temps voulu.
Pour la boulangerie, je m’occupe de trouver de l’argent pour payer les charges de l’atelier, mais mon ami, qui est PDG de Zeelandia à Brovary, fournit tous les ingrédients gratuitement, il se débrouille pour avoir des dons pour financer les pertes, mais je ne m’occupe pas de ça, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Pour le reste, les travailleuses sont bénévoles comme je l’ai déjà dit. Le café social est aussi subventionné, des personnes s’occupent de trouver des fonds.
Pour mon café j’utilise mes fonds personnels, et quand je fais des aller-retours dans les Carpates et que j’emmène du monde aussi. Je fais jouer mes relations pour avoir des dons en matériel et du soutien technique. En fait, le gros secteur de dépense pour moi, c’est l’essence et la voiture, le reste c’est presque rien, surtout que je suis toujours invité à manger ailleurs que chez moi.
Je peux citer mon ami Andreï aussi, il est traiteur et actuellement il fournit trois cents à mille repas par jour gratuitement pour la police et la défense territoriale qui sont sur les checkpoints : les autorités locales lui fournissent les ingrédients et lui, il travaille gratuitement.Mais j’imagine qu’il a un contrat qui lui permettra par la suite de conserver cette clientèle-là, non ?
Et ça ne vous inquiète pas que par la suite, des entreprises qui participent peu, voire pas du tout à l’effort de guerre comme vous le faites, récupèrent les marchés ? Parce qu’on voit qu’il y a un gros effort de votre part et ça pourrait être normal qu’il y ait une forme de reconnaissance en temps voulu, non ?
Tu sais, c’est pas la première fois que le pays est en crise et on est habituées à l’idée qu’il faut parfois repartir de zéro ou presque.
Peut-être qu’après la guerre, il y aura un genre de « plan Marshall », peut-être pas, peut-être qu’on en profitera un peu ou peut-être que ce sont des grosses multi nationales qui empocheront les aides et les marchés… Ceux qui profitent de la guerre, c’est leur affaire ; nous, on n’attend pas de reconnaissance, on sait pourquoi on le fait.Comme tu as pu le voir, dans les églises évangélistes où nous sommes passées (à Khmelnytskyï et Kyiv) il y a beaucoup d’accueil de familles, de stockage et de distribution de nourriture et produits de base. T’as vu aussi que tout le monde se moque bien de porter des masques et les normes ne sont évidemment pas respectées. On peut alors considérer que le fait que les autorités ne nous entravent pas, c’est déjà une forme de soutien.
À Brovary, des bénévoles ont organisé un lieu de stockage et de distribution dans la salle de sport. Et puis un jour, le maire a décidé de reprendre ça sous la direction de la mairie en communiquant sur le fait que c’était une de leurs initiatives…
Il faut savoir que pour certaines élues, c’est une opportunité facile pour demander des budgets additionnels. Dans un des villages où nous sommes allées ensemble par exemple, quatre-vingts pour cent des denrées gérées par la commune, personne ne sait où elles vont. Je préfère participer et organiser des réseaux depuis des connaissances déjà établies ou qui s’établissent de proche en proche, de personne de confiance en personne de confiance.
Et puis ces réseaux-là, en cas de nouvelle crise, de nouveau problème, on peut se dire qu’ils seront de nouveau mobilisables.
Mais à Kyiv le maire est plus progressiste et les réseaux de volontaires sont assez conséquents, ça a l’air de se passer différemment.Tu penses que c’est quoi la proportion d’aide qui est assumée par les citoyennes et celle assumée par les autorités locales ?
Je peux parler uniquement pour le district de Brovary mais je dirais que l’aide et la solidarité sont assurées à quatre-vingts pour cent par les citoyennes. Le maire a mis beaucoup de temps à se réveiller, entre dix et douze jours avant de faire quoi que ce soit : tout le monde se demandait où il se cachait. Alors que les volontaires ont réagi très rapidement.
Pour ce qui est de l’État, je trouve que la réaction militaire a été plus qu’à la hauteur et que là-dessus Zelensky a été efficace.
Pour ce qui est de l’aide et de la solidarité, c’est le peuple qui a été très fort.J’y ai pensé mais je suis convaincu que je suis plus compétent à l’arrière qu’au combat, domaine dans lequel je n’ai aucune expérience. La boulangerie, le café, le café social sont utiles, d’ailleurs c’est officiellement considéré comme d’utilité publique dans le cadre de la guerre. Grâce à ça, j’ai une dispense de mobilisation. Cependant, j’ai quand même pris conscience après l’annexion de la Crimée et le début de la guerre dans le Donbass qu’il fallait prendre les choses au sérieux, j’ai donc décidé de faire une formation succincte autour des savoir-faire paramédicaux dans le bataillon Asap RescueAsap Rescue est une organisation bénévole officiellement enregistrée. Dans le but de sauver la vie et la santé des citoyennes ukrainiennes, elle participe à des opérations de sauvetage en cas de catastrophes naturelles et de troubles sociaux. EIle intervient lors de manifestations de masse et d’émeutes, en cas d’instabilité interne, d’agression externe et d’opérations militaires. Voir plus sur asap-rescue.com. et j’ai aussi fait une formation au maniement des armes à feu pendant six mois (un à deux jours par semaine) dans un organisme privé. Bref, prendre les armes, je suis prêt à le faire mais ça voudrait dire que la guerre est généralisée et même si je m’engage, je ferai en sorte d’être ambulancier.
Ce qui est certain par contre c’est que si le pays est annexé à la Russie je préfère l’exil.
Entretien avec Sergiy Movchan d’Operation Solidarity
Version originale publiée le 02/05/22 sur icitranscarpatie.wordpress.com.
Peux-tu nous raconter comment et quand s’est créé Operation SolidarityOperation Solidarity était un réseau de volontaires anti-autoritaires organisé pendant la guerre pour aider conjointement toutes les forces progressistes de la société à contrer l’agression impérialiste contre l’Ukraine. Operation Solidarity est devenu, depuis le 6 juillet 2022, Solidarity Collective. Vous pouvez les suivre sur Instagram (@solidaritycollectives), sur Telegram (@ContactCollectives) et par mail à l’adresse : solidaritycollectives@riseup.ne. ?
Quand il y avait la menace de la guerre, deux semaines avant qu’elle commence, certaines personnes ont organisé une réunion pour parler de la manière dont nous voulions agir si la Russie attaquait l’Ukraine. À l’issue de cette réunion, elles ont décidé que certaines rejoindraient la défense territoriale et que d’autres formeraient un groupe de volontaires. C’est à ce moment-là qu’est née Operation Solidarity (OpSol).
Avez-vous, au sein de votre groupe, des discussions à propos du soutien et de l’investissement à apporter ou pas à la partie militaire de cette guerre ?
Non, je pense que nous n’avons pas ce genre de conversation parce que l’organisation même a commencé dans le but de soutenir des combattantes. Je dirais même qu’il n’y a pas du tout ce genre de discussion dans la gauche ukrainienne en ce moment. La plupart partage l’idée de la nécessité de résister maintenant. Peut-être que quelques personnes disent qu’il ne faut pas résister, je ne sais pas, ça paraît presque impossible, à moins d’être à l’étranger. Ici, je pense que la plupart des anarchistes, gauchistes et tout le monde voient que nous avons besoin de lutter et de rejoindre la résistance. Peut-être que tout le monde n’est pas prêt à prendre les armes, bien sûr, mais alors on aide les réfugiées, on aide dans la logistique de groupes de volontaires, on décharge l’aide humanitaire, etc. Tout le monde veut faire au moins quelque chose.
Je connais des personnes qui sont parties d’Ukraine et c’est très douloureux pour elles de ne rien faire.Le premier jour de la guerre je suis parti de Kyiv. Je suis allé trois ou quatre jours à Ivano-Frankivsk, ensuite j’ai compris que je ne pouvais pas être ailleurs et je suis donc retourné à Kyiv. Le cinquième jour, la première chose que j’ai faite c’est d’aller au bunker (notre quartier général) pour dire que je voulais rejoindre Operation Solidarity en tant que volontaire et depuis ce jour, j’y suis. Maintenant je suis volontaire à plein temps.
Nous faisons régulièrement des appels aux dons sur notre canal Telegram, et nous essayons de participer à des événements en Europe. Nous partageons aussi des informations sur notre organisation et sur comment les choses avancent en Ukraine. Nous essayons de diffuser nos idées à propos de la situation pour faire une contre-propagande à la propagande russe parce que beaucoup de gauchistes en Europe continuent de croire à la communication de Poutine. La situation est mauvaise. C’est ce que nous essayons de changer : montrer ce qu’il se passe ici, parler des vraies raisons de la guerre pour démontrer que les déclarations de Poutine sont fausses. Une grosse partie de notre activité est liée à l’information. Par exemple, je participe moi-même à trois ou quatre visioconférences par semaine. Des personnes de l’Ouest nous écrivent et nous disent qu’elles souhaitent mieux comprendre ce qui se passe ici, et demandent à ce que nous nous joignons à des discussions qu’elles organisent.
C’est une organisation ancienne, je ne sais pas quand elle a été créée, certainement avant 2014, ça doit avoir dix ans, quelque chose comme ça. Elle travaille surtout avec des syndicats de travailleuses pour les droits sociaux, le droit du travail, notamment chez les cheminotes ou les constructrices. Elle a aussi des bons contacts dans la grande ville industrielle de Kryvyï Rih où il y a de grosses usines, des mines. Nous avons des liens avec le Social Movement, nous partageons notre espace de stockage avec lui à Lviv, mais il soutient surtout les travailleuses et les syndicats, ceux des infirmierères, ceux du secteur médical. Elles ont aussi des membres présentes dans les défenses territoriales et dans l’armée ukrainienne. Elles cherchent des équipements pour elles. Elles apportent également beaucoup de médicaments aux infirmières. Elles travaillent avec les syndicats les plus actifs, parce que beaucoup sont des « jaunes », des vieux syndicats soviétiques qui ne sont pas vraiment impliqués dans les luttes pour les droits des travailleuses. Les syndicats des médecins et infirmières s’organisent depuis deux ans et c’est très bien je pense, ils sont très actifs et radicaux. Maintenant, comme ils travaillent dans les hôpitaux, ils savent parfaitement ce dont il y a besoin. Le Social Movement, ce sont de bonnes amies. Je les connais depuis des années, pour moi c’est l’organisation de gauche la plus active en Ukraine. Avant la guerre, elles avaient une stratégie, des vrais liens dans les syndicats et elles essayaient vraiment d’aider la classe des travailleuses. Elles font aussi une campagne en faveur de l’annulation de la dette ukrainienne auprès des partis européens de gauche.
Nous avons un bar à Kyiv qui est rempli de cartons, et un hangar partagé à Lviv. Certaines d’entre nous sont tout le temps dans le bar. C’est notre lieu de travail, j’y vais tous les jours. Au début, nous avions des réunions téléphoniques quotidiennes, aussi avec notre branche à Lviv. Maintenant, nous avons des réunions téléphoniques générales tous les quatre jours, et nous avons mis en place des petits groupes comme la commission médiatique, la commission logistique, pour lesquels nous faisons des réunions à part. Notre quartier général sert aussi à stocker du matériel que la défense territoriale peut venir chercher selon ses besoins. Pour la nourriture et les médicaments nous n’avons pas de point de distribution, nous donnons directement aux hôpitaux ou aux endroits de distribution en fonction des listes que font les hôpitaux. Nous les livrons avec nos deux voitures.
Comme je le disais, avant que la guerre ne commence, les personnes qui ont lancé OpSol ont fait une réunion dans laquelle elles ont décidé que certaines d’entre elles iraient dans la défense territoriale et que les autres mettraient en place une organisation de volontaires. C’était vu comme deux formes distinctes mais nous travaillons toutes ensemble maintenant. Nous avons donc deux volets : la partie militaire et la partie humanitaire. Notre priorité est sur la partie militaire, qui est elle-même déclinée en quatre parties. Maintenant, certains détachements de défense territoriale ont commencé à bouger de Kyiv depuis que les troupes russes se sont retirées de la région. Alors, même si certains d’entre eux ne sont pas encore sur la ligne de front, ils pourraient la rejoindre à tout moment. Notre tâche est de faire en sorte que, lorsque les personnes arriveront sur le front, elles aient tout l’équipement nécessaire.
Donc pour la partie militaire, nous soutenons en premier les personnes de notre réseau réparties dans différents bataillons au front ou qui sont prêtes à y aller. En deuxième, nous soutenons notre détachement qui se prépare aussi à rejoindre un bataillon. En troisième, les camarades dans la défense territoriale. Et en dernier lieu, des proches mais qui ne sont pas dans le réseau et qui sont sur les checkpoints ou ailleurs. Parfois certaines amies nous écrivent simplement en disant : « Salut, je suis de Loutsk (ou une autre ville) et est-ce que vous pourriez m’aider pour ça, ça ou ça ? »
Une fois que nous avons répondu à nos priorités, nous envoyons à ces amies le matériel en surplus. Si une amie non-activiste sur le front a besoin de quelque chose qui n’est pas trop cher, nous pouvons lui envoyer. Mais le matériel comme les gilets pare-balles, nous allons d’abord le donner suivant l’ordre de nos priorités. Nos ressources sont limitées et les Européennes qui nous soutiennent le font parce qu’elles souhaitent aider des activistes. C’est par rapport à nos positions politiques que nous recevons cet argent donc pour cela, nous n’aidons pas tout le monde et nous devons avant tout aider les activistes politiques.
Les Hospitallers« Le Hospitallers Medical Batallion est une organisation ukrainienne de secouristes bénévoles. Ses membres sont des médecins et des personnes de professions et d’âges divers qui se sont portées volontaires pour rejoindre l’équipe de premiers secours et apporter une aide vitale à toutes celles qui en ont besoin. » D’après hospitallers.org.uk., par exemple, peuvent aider n’importe qui. C’est très bien parce que beaucoup de gens les connaissent, mais nous, nous ne pouvons pas acheter là, maintenant, cinquante casques pour toute une unité de l’armée ukrainienne. Nous ne sommes pas une grande organisation et ne le deviendrons pas, aussi parce que nous sommes idéologiquement engagées, même si notre idée est d’avoir un nom qui soit connu au-delà des milieux de gauche.Non, en priorité le militaire. Je ne peux pas dire ici combien d’argent cela fait, mais c’est en tout cas notre priorité depuis le début. L’objectif était de trouver du matériel pour équiper la défense territoriale, et ensuite c’est devenu plus grand, ça a pris de l’ampleur. On a commencé à recevoir de plus en plus de produits humanitaires et à les distribuer. Nous avons ouvert notre deuxième volet à ce moment-là. Notre premier travail est de répondre à toutes les requêtes des personnes qui sont au front ou pourraient y aller à tout moment. Notre second volet est le travail humanitaire, comme distribuer des médicaments et tout ce qui n’est pas de l’équipement militaire.
Oui, nous en avons beaucoup parce que parfois les gens ne savent pas exactement quoi acheter, ni ce dont les combattantes ou les médecins de guerre ont vraiment besoin. Alors on nous envoie des produits basiques pour les hôpitaux. Par exemple, des antidouleurs, nous en avons beaucoup plus que pour nos besoins. Alors nous apportons ces antidouleurs aux hôpitaux ou dans les centres humanitaires. Pour certains médicaments spécifiques, nous allons directement les donner aux gens. Nous faisons une annonce sur notre canal Telegram pour dire que nous avons tel ou tel type de produits, qui sont en pénurie par moments. Aussi, il y a plusieurs jours nous avons reçu beaucoup de sacs de couchage. Nous avions déjà fourni notre détachement, alors nous sommes allées dans les villes au nord de Kyiv, à Boutcha, Hostomel, Irpin et nous les avons distribués là-bas directement, parce qu’elles en avaient besoin. Nous avons aussi une liste de produits spécifiques pour la médecine tactique. Nous voulons faire des kits de premier secours qui soient efficaces.
Oui bien sûr, mais nous ne sommes pas vraiment spécialisées là-dedans, alors parfois on amène de la nourriture qui vient d’autres organisations de volontaires. Nous collaborons avec d’autres initiatives comme par exemple une coopérative à Lviv qui fournit de la nourriture vegan parce que nous avons des personnes vegans dans l’unité anarchiste.
Pour en revenir à la division militaire de l’organisation, que font les personnes que vous soutenez ?
Nous avons un détachement qui se fait appeler Resistance Committee« Resistance Committee est un espace de dialogue et de coordination des initiatives anarchistes, libertaires et antiautoritaires. Nous croyons que l’Ukraine et toute l’Europe de l’Est devraient être libérées de la dictature. La liberté, la solidarité et l’égalité doivent devenir les principes fondamentaux de l’organisation sociale dans la région. Notre tâche : unir les efforts des combattantes contre l’autoritarisme afin de lutter efficacement pour nos idéaux et nos valeurs. Nous aspirons à influencer l’avenir de l’Ukraine et de toute la région, à protéger les libertés qui existent déjà et à contribuer à leur extension. » D’après “Anti-Authoritarian Collective of Ukraine”s Territorial Defense Forces Releases New Manifesto. A Look at the Resistance Committee’s Position on the War and Future of Ukrainian Society’ par Militant Wire sur theanarchistlibrary.org". Voir plus sur Telegram : t.me. sur Telegram, il s’entraîne actuellement. Et je pense que c’est une très bonne chose, parce que la plupart des volontaires dans la défense territoriale n’ont aucune expérience militaire. Certaines défenses territoriales s’occupent de garder les checkpoints , mais ce détachement-là ne fait pas ça. Il s’entraîne pour le front.
C’est un bar ouvert et tenu par des activistes biélorusses qui ont quitté leur pays. Quand la guerre a commencé, elles nous ont proposé de l’utiliser. C’est comme une sorte de bunker pour nous, parce qu’il est au sous-sol. Des gens vivent en permanence dedans. Officiellement, il est fermé. Il était d’ailleurs déjà plus ou moins fermé avant la guerre, c’est un bar pour les gens qui connaissent. Bon, même si la plupart des groupes d’extrême-droite sont au front, il y a toujours la possibilité d’être attaquées par eux. Deux activistes ont été attaqués à Lviv, même si ce n’était pas une attaque organisée. Ils allaient juste acheter de l’équipement dans un magasin militaire et deux nazis stupides les ont vus et leur ont dit : « Oh vous êtes qui vous ? Vous êtes antifascistes, donc vous êtes pro-Poutine ! » et ils les ont attaqués. Pour nous, c’est comme ça depuis 2014, quand les Russes ont commencé à s’accaparer le terme « antifasciste ». Le gouvernement russe (et ceux et celles qui le suivent) a construit sa mythologie sur la grande victoire de la seconde guerre mondiale contre le fascisme, et maintenant ils prétendent se battre contre les nazis, etc. C’est pourquoi en Ukraine le terme d’antifascisme a été discrédité. Depuis l’Union soviétique, le terme fasciste n’a pas beaucoup de sens politique. Ça fonctionne un peu comme une insulte classique. Mais si tu commences à promouvoir des idées antifascistes en critiquant directement les nationalistes ukrainiens, la première chose qu’ils vont faire en retour c’est de t’accuser d’être pro-russe. Bon, déjà avant 2014, si tu pensais que quelqu’une était contre toi politiquement, tu l’accusais d’être pro-Poutine. C’est presque drôle parce que la société civile ukrainienne et les ONG ont commencé à blâmer les nationalistes ukrainiens avant la guerre en disant que c’étaient eux les pro-Poutine, qu’ils étaient des agents de la Russie parce qu’ils promouvaient des idées conservatrices. Elles disaient : « Poutine est contre les LGBT, et vous aussi, donc vous êtes des agents de Poutine. » Et bien sûr, l’extrême-droite ukrainienne a répondu : « Non, c’est vous les agents de Poutine. »
Eh oui, ça marche comme ça ! Mais maintenant, il n’y a presque plus ce genre de disputes parce que la plupart d’entre elles, les ONG libérales et l’extrême-droite, se sont portées volontaires ou sont allées au front, alors pour l’instant cette confrontation s’est arrêtée. Mais ce n’est qu’une trêve parce que quand la guerre sera finie, il y aura de nouvelles confrontations. Je suis sûr que ce sera à propos de qui aura été le plus proche du front, qui sont les vrais héros… « Et vous, vous êtes restées tranquillement à Lviv, donc vous êtes lâches », etc. C’est très difficile de faire de quelconques prédictions maintenant, mais je pense que ça ressemblera plus ou moins à ça parce que j’ai déjà commencé à entendre certaines discussions, à de très petites échelles pour l’instant. Tout de suite, nous avons la même menace, le même ennemi et même les personnes dont les avis politiques divergent sont prêtes à se battre ensemble et même parfois à coopérer.Oui, j’ai même vu que des personnes proches de l’extrême droite ont dénoncé l’attaque dans le magasin d’équipement militaire à Lviv en disant que l’ennemi était Poutine et non la gauche ou la droite.
Oui, cette action à Lviv était vraiment stupide et de ce que l’on sait, des leaders de leur organisation l’ont vraiment dénoncée et ont exhorté les gars à ne pas refaire ça, que ce n’était pas le moment. Beaucoup de gens pensent comme ça, que ce n’est pas le moment d’avoir des batailles politiques internes au pays.
J’imagine que vous avez aussi une analyse à propos des communications officielles ukrainienne et européenne et sur la manière dont elles traitent les faits réels ? Par exemple, les journaux européens répètent simplement l’information principale de l’État ukrainien.
Toutes ces dernières années, j’ai été très critique de l’État ukrainien et de sa politique officielle. Mais présentement, pour nous c’est assez important de montrer les mensonges de la propagande russe parce que la guerre a commencé à cause de ça. Vous vous rappelez le discours de Poutine dans lequel il donnait plusieurs arguments qui justifiaient la guerre : dénazification, démilitarisation, libération, etc. La plupart de ces points sont des mensonges. Nous ne parlons presque pas des avancées de la situation militaire actuelle parce que ce n’est pas notre rôle. Notre rôle n’est pas de donner des nouvelles du champ de bataille. C’est mieux de chercher d’autres sources parce que nous ne sommes pas des expertes militaires. Nous sommes un réseau de volontaires et nous ne voulons vraiment pas vérifier les chiffres quant au nombre exact de tanks russes détruits.
Je ne sais pas… Je sais parfaitement que si les journaux ukrainiens disent que ce sont cent tanks, ça pourrait être un chiffre très différent en vrai, mais je n’ai pas la possibilité de le vérifier. Là où nous pouvons vérifier, nous le faisons. Par exemple à Boutcha, nous avons été sur place, parlé avec les habitantes, nous avons vu ce qu’il s’est passé là-bas. Je l’ai vu de mes propres yeux, je peux dire que c’est vrai et que dans ce cas c’est la propagande ukrainienne qui dit la vérité face à celle de l’État russe.Oui, je pense que ce que les Ukrainiennes disent est vrai, mais qu’elles ne disent pas tout par contre…
Oui, bien sûr, je n’ai aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu’on ne sait pas. Par exemple elles ne publient pas le nombre de victimes dans l’armée ukrainienne. Mais bon, pour nous ce n’est pas très grave maintenant, je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Je ne suis pas faussement optimiste comme d’autres gens le sont. Du genre : « Nous sommes en train de gagner, demain nous récupérerons la Crimée, etc. » Je n’ai pas cet optimisme-là parce que je sais que nous ne savons pas tout. Je peux comprendre cette stratégie de ne pas parler de nos pertes, parce que ça rend optimiste. Le fait que les gens croient réellement que nous pouvons gagner, c’est ce qui permet la lutte. Et elles disent : « Nous nous battons contre une énorme armée mais nous pouvons toujours gagner. »
Je pense qu’il est intéressant pour les étrangères de comprendre comment les chaînes d’information officielles du gouvernement peuvent utiliser cette situation de guerre pour mettre en avant un certain sentiment nationaliste, faire des raccourcis pour passer des nouvelles lois liberticides. C’est cette idée que les crises sont toujours des façons d’augmenter le pouvoir des gouvernements. Votre critique est intéressante parce que de loin, depuis la France ou l’Europe, c’est très difficile pour les gens de comprendre comment ça marche en Ukraine, et aussi ce qui se passe en dehors du front, parce que tout est focalisé sur les combats.
Mais tu sais, jusqu’ici tout était focalisé sur les combats et le front. Peut-être que maintenant, la vie politique reprend un peu et une nouvelle opposition commence à critiquer Zelensky alors qu’elle ne le faisait pas quelques semaines plus tôt.En disant que tout n’était pas bien préparé pour la guerre, que les opérations d’évacuation ont été mal faites, etc. Mais tu dois comprendre que cette opposition est plus nationaliste encore que Zelensky. Tu as raison à propos du sentiment nationaliste : quand la guerre a commencé, la haine envers les Russes était un sentiment partagé par la plupart des gens, même s’ils étaient anarchistes ou gauchistes. Maintenant, nombre d’entre eux partagent ces idées nationalistes, avant tout contre les Russes. Et je ne sais vraiment pas ce qui pourrait être fait face à cette haine, nous en avons pour des décennies.
Beaucoup de personnes qui sont loin d’ici et voient la guerre depuis chez elles pensent que ce serait important maintenant de développer la solidarité entre les Russes et les Ukrainiennes. C’est peut-être un sentiment normal lorsque tu viens de France, mais quand tu viens d’ici et que tu discutes avec les gens, j’ai l’impression que ce n’est pas trop le sujet du moment. Je voulais te demander ce que tu penses de ça.
Ce n’est pas le sujet, non. Présentement, il est tout à fait impossible, très malheureusement, d’arrêter la guerre en disant aux gens d’arrêter de se haïr les unes les autres. À cause de tous ces soldats russes présents en Ukraine et de tous ces crimes de guerre, je pense que le niveau de haine va encore augmenter. Je pense ça car, au début, le gouvernement russe imaginait qu’il allait capturer l’Ukraine en quelques jours, sans rencontrer de réelle opposition. Ils pensaient que les gens seraient heureux de les voir parce qu’avant la guerre, beaucoup de personnes soutenaient des partis pro-russes, ou étaient simplement contre le nationalisme ukrainien. Mais ces personnes ne voulaient pas de tanks russes, ni que leurs villes soient détruites, elles ne voulaient pas que les choses se passent de cette manière. Et plus encore, cette mal nommée « libération des Russes » a lieu aujourd’hui principalement dans les régions russophones. Donc ce sont les russophones qui sont les principales victimes de cette guerre. Marioupol est absolument une région russophone.
Donc tu penses que Poutine a fait une grosse erreur, parce qu’il aurait pu avoir beaucoup de soutien en Ukraine, mais pas de cette manière ?
C’est pas Poutine directement qui y perd mais les partis pro-russes ukrainiens, comme la Plateforme d’opposition Pour la vie« La Plateforme d’opposition — Pour la vie (ukrainien : Опозиційна платформа — За життя), anciennement Union panukrainienne “Centre” (ukrainien : Всеукраїнське об’єднання “Центр”), puis Pour la vie (ukrainien : За життя), est un parti politique ukrainien fondé en 1999. Il est réactivé en 2016 par des membres dissident·es du Bloc d’opposition, avant que les deux factions ne rompent définitivement en 2018. Accusé d’entretenir des liens avec la Russie, il est banni en 2022 dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. » D’après wikipedia.org. qui a déjà été le second parti du pays, ou le troisième. Il a toujours de bons résultats, et il avait une grosse représentation au parlement, des maires dans certaines villes, de nombreux députés dans les conseils municipaux. Ils ont du soutien. Mais, après cette guerre, il n’y en aura plus, plus aucun soutien ! Poutine est en train de tout ruiner, même ses bonnes relations avec ces gens qui le soutenaient auparavant.
J’ai la sensation que pour certaines d’entre nous à l’Ouest, il y a une nette différence entre l’aide humanitaire et l’aide militaire. Pour certaines gauchistes en Europe, il semble que ce soit un problème de soutenir la résistance armée.
Oui, c’est très bien, mais malheureusement je ne vois pas d’issue sans résistance militaire. Les négociations que nous aurons avec les Russes dépendront fortement des succès militaires. Si la Russie capture la moitié de l’Ukraine, il y aura une négociation. Si l’Ukraine tient bon et force le retrait de l’armée russe, ou la bloque en un certain point, la négociation sera toute autre. Je me considère moi-même comme antimilitariste. Avant que la guerre ne commence, j’étais complètement en faveur d’une solution pacifique, je pensais que nous devions trouver un compromis. Maintenant, je ne vois pas comment un tel compromis aurait pu être possible si nous n’avions pas une position forte et si nous n’avions pas résisté à l’invasion russe. Sans cela, ce sera l’occupation avec encore des atrocités de crimes de guerre comme à Boutcha. Comme je disais, au début de la guerre, l’idée de la manière dont elle se déroulerait était totalement différente d’aujourd’hui, lorsque les Russes essayaient d’utiliser des armes précises, des roquettes. Mais maintenant, un crime de guerre de plus ou de moins leur importe peu. Les victimes civiles augmentent, et l’armée russe s’en soucie de moins en moins. Nous pouvons le voir avec l’attaque de la gare de Kramatosk aujourd’hui (le 8 avril 2022), par exemple. Je sais bien que beaucoup de gauchistes en Europe ne sont pas prêtes à soutenir les actions militaires. J’aimerais beaucoup voir un mouvement antimilitariste puissant surgir après cette guerre, parce que maintenant, nous savons ce qu’un pays peut faire quand il a l’arme nucléaire et des quantités d’armes conventionnelles. Un mouvement antimilitariste global est très important mais ce sera possible seulement si la Russie perd la guerre, parce que si elle la gagne, il y aura une nouvelle course à l’armement. Tout le monde veut produire encore plus d’armes et avoir l’arme nucléaire. Si tu es une activiste antimilitariste, tu dois être contre les guerres que mène la Russie. Je ne suis pas très optimiste à propos de la société ukrainienne et à quoi ça ressemblera après la guerre, il y a beaucoup de haine ici, le nationalisme va totalement se normaliser malheureusement. Mais maintenant, tout est préférable à l’occupation russe parce que la Russie est presque un État fasciste pour moi, et si nous la comparons à l’Ukraine d’avant la guerre… L’Ukraine était un État bien plus démocratique, avec tous ses problèmes certes, mais vraiment, quand les personnes du Biélorussie ou de Russie venaient en Ukraine, elles disaient : « Waouh, c’est possible ? Vous pouvez faire ça ? »
Oui bien sûr, je suis en contact avec ces personnes et c’est très dur pour elles. C’est très dur pour elles de croire ce qui se passe ici, parce que toutes les chaînes d’information sont contrôlées, donc elles reçoivent des informations par les canaux Telegram. Mais quand elles voient les informations officielles ukrainiennes sur Boutcha, et celles de l’Ouest, elles ne croient plus en rien alors elles nous demandent : « Pouvez-vous nous dire si c’est vrai ce qui se passe, parce que je n’arrive pas à y croire ? Je suis totalement contre Poutine et notre gouvernement, mais je n’arrive pas à croire que des soldats russes aient pu faire ça. » C’est très dur pour elles d’accepter cette réalité.
Et, c’est un autre point, mais ne penses-tu pas que l’État, considérant vos groupes, mais aussi les groupes contestataires d’extrême-droite, comme étant des menaces potentielles, pourrait profiter de la situation pour envoyer tout le monde au casse-pipe ?
Je ne crois pas, je crois que l’État ne s’occupe pas maintenant de qui répond de quelle idéologie, il a d’autres choses à faire. Parfois, le commandement d’une unité pourrait dire : « Ah, s’il vous plaît, nous n’avons pas besoin de politique ici », mais en réalité, à plus large échelle, il se fiche de qui répond de quelle idéologie, la plupart ne comprennent même pas les différences. Peut-être que les services secrets savent, mais ils ne sont pas si bons là-dedans non plus. Ils ont bien sûr des spécialistes, mais là ce n’est pas important pour eux. Je ne pense pas qu’ils pourraient dire à tel officier militaire d’envoyer telle unité à Marioupol par exemple, non.
Et à part ça, l’extrême-droite est un bien plus gros problème pour le gouvernement ukrainien que l’extrême-gauche. Mais je n’ai entendu aucun exemple de personnes envoyées volontairement au casse-pipe à cause de leurs idées. Et je dirais même plus, la guerre en 2014 était bien plus politisée parce que le rôle des bataillons de volontaires était plus important, l’armée était faible et les bataillons nationalistes volontaires étaient vraiment des héros parce qu’ils venaient de Maïdan. Ils ont commencé à se battre et sont revenus en héros. Puis ils ont mené des projets politiques comme la fondation de partis nationalistes.
Le bataillon Aydar, par exemple, était très populaire en 2014, mais maintenant, ce bataillon n’existe plus. Le Secteur Droit (Pravy Sektor) était au front en 2014, et il l’est encore aujourd’hui, mais maintenant il n’est qu’un bataillon parmi tant d’autres. Personne ne parle beaucoup du Secteur Droit maintenant.C’est une question complexe. À la base, Azov est une structure, ou plutôt un mouvement large.
Le bataillon Azov a été créé en 2014 par des organisations nazies et des hooligans de droite. Dans un premier temps, le cœur de l’organisation était clairement composé d’une assemblée de nationaux-socialistes. Il a commencé à être connu en Europe, on a commencé à parler de lui, à faire de la publicité. Et il s’est scindé en différentes ailes. Le noyau originel d’extrême-droite du bataillon Azov a créé un parti politique appelé Corps National« Le Corps National (en ukrainien : Національний корпус), aussi appelé le Parti du Corps National, est un parti ukrainien d’extrême-droite fondé en 2016, et dirigé par Andriy Biletsky. La base du parti est constituée de vétérans du régiment d’Azov au sein de la Garde nationale ukrainienne, et de membres du Corps civil Azov (une organisation civile affiliée au régiment Azov). » D’après wikipedia.org. et il y a eu une aile paramilitaire, les « National Vigilants », renommée ensuite « Centuria ». Le régiment Azov a ensuite été intégré à la Garde nationale.
En 2016, la plupart des bataillons de volontaires ont été intégrés à l’armée ukrainienne donc ils ont perdu leur indépendance et ont été déplacés de la ligne de front. De ce que j’en sais, avant que l’invasion russe ne commence, il n’y avait plus que deux bataillons de volontaires : Azov et Secteur Droit. Mais même eux avaient plus ou moins été enlevés du front, donc parfois ils rejoignaient des opérations militaires, sinon ils étaient dans leur base. Au vu de leur popularité et de leurs compétences militaires, beaucoup de gens les ont rejoints. La proportion de membres d’extrême-droite dans le régiment diminue donc. Aussi, le mouvement Azov« Le mouvement Azov est une galaxie d’organisations liées à l’histoire du bataillon Azov. On y trouve notamment Corps National (branche politique du mouvement), la Milice nationale (organisation paramilitaire distincte du bataillon Azov), le Corps civil Azov (organisation activiste non-militaire de vétérans du bataillon), Centuria (organisation paramilitaire). » D’après wikipedia.org. est une galaxie d’organisations liées à une autre petite organisation d’extrême-droite qui est autonome mais coordonnée par Corps National. Cette petite organisation a aussi créé son propre détachement de défense territoriale, comme les anarchistes. Les liens entre le Corps National et le régiment Azov sont devenus plus faibles ces dernières années. Il n’y a pas de déclaration politique de la part du régiment, seulement du parti. Bien sûr, ils gardent ce background politique mais ce n’est pas l’échelle dont parle la propagande russe. Je dirais que le régiment Azov à Marioupol est moins radical que le bataillon de défense territoriale créé par des activistes d’extrême-droite du Corps National et des petits groupes membres du mouvement Azov à Kyiv et dans d’autres villes. Mais bien sûr, ils comprennent qu’il y a des attaques sur leur rhétorique. Vu que Poutine a dit qu’ils étaient des nazis, ils disent : « Nous ne sommes pas des nazis, mais des patriotes. » Je pense que dans le régiment Azov, à Marioupol, c’est plus proche de la réalité parce que le nombre de nazis / extrême-droite dedans est plus petit.
Je pense qu’une des raisons pour lesquelles le régiment Azov se bat jusqu’au bout, c’est que ses combattants savent qu’ils seront liquidés par l’armée russe s’ils sont pris, parce qu’ils représentent le diable pour les Russes. Ils ne seront pas faits prisonniers. Ils ont aussi de grandes motivations à défendre la ville. Avant la guerre, c’était mon sujet principal que de parler de l’extrême-droite. La violation des droits humains commis par l’extrême-droite, c’est un vrai problème ! Mais en même temps, c’est incomparable avec l’échelle de la guerre. Nous avons eu cent quatre-vingts faits de violence et confrontations par l’extrême-droite l’année dernière, et ce nombre n’inclut pas seulement les attaques sur les personnes mais aussi des attaques sur des propriétés, des événements, etc. Il n’y a eu aucun mort. L’échelle de gravité est incomparable.Je crois que ce que tu dis est important à comprendre pour les Européennes. Qu’est-ce que le nationalisme en Ukraine ? Quels types de nationalismes existent ? Parce que beaucoup de personnes de la gauche en France se concentrent là-dessus et personne ne comprend vraiment ce qui se passe, moi-même je suis là depuis trois semaines et je ne comprends pas grand chose…
Oui, je pense qu’il faut consacrer une discussion entière à ça parce que c’est vraiment très complexe ! Nous avons des recherches sur les violences d’extrême-droite ici qui nient complètement le problème. Je ne fais pas partie de celles-là. À cause de la guerre, je ne peux pas surinvestir ce problème, mais si nous nous étions rencontrées deux mois avant, notre conversation aurait beaucoup plus tourné autour de ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie de nier complètement l’existence de l’extrême-droite ici, mais il faut montrer les vraies échelles. Et les vraies échelles ne sont pas celles des Russes.
Le canal Telegram c’est le mieux. Nous avons aussi un blog, créé dans les premiers jours par un camarade mais ce n’est pas notre média principal. Je fais moi-même partie de la commission média et je suis responsable du canal Telegram. Au début, il n’y avait pas de stratégie éditoriale. Quelqu’une voulait publier quelque chose, elle l’envoyait et c’était publié. Maintenant, nous essayons d’être plus efficaces et de montrer au mieux ce que nous faisons.
Depuis Operation Solidarity, comment pensez-vous les prochaines étapes ? Pensez-vous que la priorité de soutenir des volontaires au front va durer longtemps ? Quelles sont vos perspectives ?
Ici, pour moi personnellement, l’horizon est très proche. Je vis un, deux ou trois jours et je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Peut-être que maintenant, c’est plus facile d’avoir des plans, mais il y a une ou deux semaines, tout était au jour le jour. Nous avons des discussions sur ce que nous allons faire après la guerre, nous voulons continuer Operation Solidarity parce que cette organisation a réuni différentes personnes de milieux divers, pas seulement les anarchistes et les gauchistes, ce qui est une bonne chose. Il n’y a pas de plan écrit quelque part mais nous avons parlé de trouver des locaux ou des coopératives, de créer une infrastructure. Peut-être ce bar qui nous sert actuellement de quartier général.
Entretien avec des Ukrainiennes originaires de Lougansk et Severodonetsk
Lors de notre passage à Nijnié, nous avons rencontré quatre personnes originaires des régions occupées par les pro-russes depuis 2014, à l’Est de l’Ukraine. Lorsque la nouvelle phase de la guerre a commencé, le 24 février 2022, elles ont décidé de partir vers l’ouest. Depuis lors, elles rénovent une maison dans la forêt, non loin du village, dans laquelle elles comptent habiter pour les prochains temps, faute de pouvoir retourner dans le Donbass. Malgré notre distance géographique et des réalités bien différentes, le temps passé ensemble nous a permis de sentir avec elles une vraie proximité éthique et politique.
Depuis ce printemps, la situation en Ukraine a beaucoup changé. L’armée russe n’a pas réussi à se déployer dans l’ensemble du pays comme elle le souhaitait et a été mise en échec aux abords de Kyiv. Leurs forces militaires se sont donc petit à petit concentrées sur les régions de Lougansk puis de Donetsk. La ville de Severodonetsk a été particulièrement impactée ces dernières semaines car c’est un point stratégique pour contrôler la région.
N ~ Je m’appelle Nastia, je suis native de Lougansk et je suis artiste. J’ai trente ans et j’ai fait mes études aux Beaux-Arts de Lougansk. J’ai juste eu le temps de finir en 2014, puis j’ai déménagé à Severodonetsk. Je suis partie de Lougansk en 2014 parce que j’avais pris une part active dans le Maïdan de Lougansk et il était dangereux pour moi de rester. Ensuite, j’ai fait du volontariat et j’ai décidé de rester à Severodonetsk car j’y avais des connaissances et que ce n’était pas trop loin de Lougansk. J’avais envie d’être proche pour pouvoir y retourner. À Severodonetsk, nous avons créé une association, TumblerVoir plus sur tumbler.tilda.ws. Nous avons beaucoup travaillé avec des jeunes, notamment des jeunes frontalières qui vivaient sur les territoires séparatistes. Nous avons monté des festivals et autres projets, à Shastya et à Severodonetsk. + Avec Zhenia et d’autres personnes, nous avons aussi fondé la Lougansk Contemporary Diasporafootnote:[« Lougansk Contemporary Diaspora est un collectif libre qui a été initié en 2015 par des artistes réfugiées de Lougansk. L’objectif principal du groupe est la problématique des conflits militaires, ses racines et ses conséquences. Pour l’instant, à côté des réfugiées, le collectif compte des participantes résidant à Lougansk. Le groupe travaille avec différents moyens: expositions, magazines (Golden Coal, TroubleSide), films (Severodonetsk), festivals, événements musicaux,etc. » Plus d’informations sur cargocollective.com. (LCD), un collectif d’artistes. Une partie de nos amies de LCD sont dans la musique et nous, nous sommes plutôt dans la partie graphisme. Nous avons travaillé avec A. qui habite ici, c’est comme ça que l’on s’est rencontrées.
Z ~ J’ai trente-trois ans, je suis peintre et activiste de la culture dans son sens le plus large. Mon art est lié à mon activité militante. Je suis né à Lougansk mais ma famille est de Crimée et c’est là que j’ai passé mon enfance. Ensuite, je suis allé à l’école à Lougansk, où j’ai passé la plus grande partie de ma vie. Avant le début de la guerre, en 2014, à Lougansk, nous avions plusieurs communautés d’artistes et de musiciennes, nous organisions divers événements. Il n’y avait aucune aide publique à la culture non conventionnelle donc si nous voulions que des choses se passent, il fallait le faire nous-mêmes. Lougansk est une petite ville, tout le monde se connaissait et nous nous regroupions par affinités. En 2014, il y a eu un pic d’activité, avec beaucoup de jeunes très actives, une grande offre culturelle. Des amies ont ouvert des cafés ou des clubs… On avait le sentiment d’un essor culturel sans précédent. Il y avait beaucoup de bonnes musiciennes et artistes. Lougansk est une petite ville proche de la frontière avec la Russie, un peu isolée du reste de l’Ukraine. Les échos de ce qui s’y passait arrivaient au maximum jusqu’à Kharkiv. On avait l’impression de vivre dans notre petite enclave où nous pouvions êtres actives.
La guerre a commencé en 2014, précédée des événements de Kyiv. Lougansk a aussi eu son Maïdan, avec un petit mouvement pro-Ukraine d’un côté et l’anti-Maïdan pro-russe, plus massif et agressif, de l’autre. Je me suis retrouvé pris dans ce flot. Nous avons voulu nous engager avec les copines, pour soutenir le mouvement Maïdan dans un premier temps, puis pour nous opposer aux actions des anti-Maïdan. Bien que ces événements aient fortement polarisé la ville, la plupart de mes amies se sont retrouvées du côté ukrainien. C’est certainement parce que nous étions dans un milieu plus « progressiste », davantage tourné vers l’Europe. Nous penchions pour la démocratisation du pays plutôt qu’un retour à l’Union soviétique… Quand les affrontements armés ont commencé, j’ai quitté Lougansk pour m’engager dans un bataillon de volontaires pendant deux ans, puis lorsque la guerre a stagné quelque peu, je me suis retrouvé à Severodonetsk, où j’ai voulu reconstruire un peu ma vie. C’est là que j’ai rencontré David et Lena. J’avais rencontré Nastia précédemment, au moment du Maïdan de Lougansk.
À Severodonetsk, j’ai voulu retrouver les activités culturelles que nous avions à Lougansk. Severodonetsk est une petite ville et le niveau d’activité était à peu près équivalent à ce qu’il y avait à Lougansk quand j’étais enfant. Nous avons donc essayé de reproduire ce que nous avions fait à Lougansk. Avec des artistes locales nous avons créé une communauté d’artistes : le Contemporary Art Center. Comme le disait Nastia plus haut, nous avons aussi participé, avec des artistes qui avaient fui Lougansk, à la création d’une union d’artistes, la Lougansk Contemporary Diaspora, qui avait pour vocation de traiter les questions qui nous préoccupaient : le conflit armé, ses conséquences et ses origines. Ces deux activités étaient séparées car nous n’abordions pas le thème de la guerre au sein de la communauté de Severodonetsk.L ~ J’ai trente-cinq ans, je suis née dans la région de Lougansk et ma maison a été sous occupation depuis 2014. Je suis actrice comme Nastia. Nous avons étudié au même endroit, à l’Académie de la Culture et des Arts, mais nous n’étions pas dans la même promo. Nous nous sommes rencontrées plus tard, en 2016, au théâtre de Severodonetsk. Après mes études, j’ai déménagé à Ivano-Frankivsk, où j’ai travaillé environ huit ans au théâtre dramatique de Kolomya. Fin 2015, mon professeur de l’Académie des Arts de Lougansk a fondé son propre théâtre à Severodonetsk et j’ai rejoint sa troupe. J’avais entendu parler de Longo Maï plusieurs années auparavant, quand j’avais commencé à travailler dans l’Ouest de l’Ukraine. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici, mais jamais je n’aurais imaginé y arriver dans ces conditions.
D ~ J’ai vingt-deux ans. Je suis né à Severodonetsk et j’y ai vécu la plus grande partie de ma vie. Les événements du 24 février 2022 m’ont obligé à partir. Maintenant, je suis ici, je réfléchis aux valeurs qui régissent la vie, au sens de la vie et à ce que je pourrais en faire… J’ai fait un lycée avec une spécialisation en maths et en sciences, puis je suis entré à l’Université de Severodonetsk. J’étais en train de finir mes études d’ingénierie électrique. J’avais déjà ma licence, il ne me manquait que huit mois pour finir mon master. J’espère qu’on va me le donner quand même. J’ai été dans la même université que Zhenia, et celle-ci a dû déménager trois fois à cause de la guerre[Ndlr de Lundimatin] : depuis 2014.].
D ~ Nous connaissions toutes A. depuis 2017. Nous nous sommes rencontrées à Kyiv. Elle voulait travailler avec les enfants au Donbass et ensemble nous avons créé, à Severodonetsk, l’association Tumbler, qui a été active pendant un an. Puis A. est partie pour Nijnié Sélichtché. Nous sommes restées en contact et nous sommes venues ici pour la première fois à l’automne dernier pour aider à planter des pommiers, puis pour le Nouvel an. Quand la situation a commencé à se tendre, A. nous a dit qu’on pouvait venir ici si besoin, et deux mois après le Nouvel an nous étions de nouveau là.
DL ~ Pour venir planter la pommeraie l’automne dernier, David avait pensé venir en voiture, mais il y avait renoncé tant le trajet lui semblait long depuis Severodonetsk. Cette fois-ci, c’est ce que nous avons fait et cela a duré une semaine, à cause des couvre-feux, etc. Nous n’avions pas imaginé que nous reviendrions ici en voiture, et encore moins avec tous nos chats… Au début on ne voulait pas partir, c’était le plan B que nous venions toutes ici. Arrivées à Dnipro, nous avons voulu rebrousser chemin, mais nous avons vite compris que ce n’était plus possible et nous avons continué vers Nijnié.
Pouvez-vous raconter le contexte du Maïdan à Lougansk et nous parler des implications que le mouvement a eues dans votre vie ?
Z ~ Le Maïdan a commencé avec les manifs à Kyiv. J’allais souvent dans cette ville car j’y avais beaucoup d’amies artistes. J’ai suivi le mouvement dès ses débuts, car je n’appréciais pas le président de l’époque et je voyais là une possibilité de changements positifs dans le pays. Avec les événements en Crimée et le Printemps Russe (le mouvement anti-Maïdan), je suivais les infos en me demandant par quel biais agir. À l’époque, je n’imaginais pas à quoi tout cela allait mener et tout ce que je pouvais faire, c’était de participer aux quelques manifs organisées à Severodonetsk. C’est là que j’ai rencontré Nastia. Nous réfléchissions ensemble aux actions à faire pour soutenir le côté ukrainien et montrer qu’il y avait une position pro-Ukraine dans le Donbass.
L ~ Il est faux de dire qu’il n’y a que des séparatistes dans les territoires occupés. Oui, il y a des gens à qui ça ne fait ni chaud ni froid d’être sous occupation russe, mais d’autres sont pro-ukrainiennes et sont obligées, pour diverses raisons (parents âgés, emploi…), de rester là-bas. Il est impossible d’établir des statistiques pour déterminer qui est pro-russe ou antirusse et de plus, les choses ont changé au cours des années. A titre d’exemple, en 2014, au début du conflit, il y avait des gens qui soutenaient le mouvement pro-russe, pas énormément, mais plus qu’aujourd’hui. Puis, au fil des années, en se rendant compte de la violence engendrée par la guerre, même des pro-russes convaincues se sont retrouvées de l’autre côté, quasiment pro-ukrainiennes. Ceci dit, il y a des exemples de l’inverse aussi…
Est-ce que des Russes sont venues s’installer dans ces zones dans le but de déclencher un mouvement à visée séparatiste ?
N ~ Les liens sont très étroits. Comme nous vivons juste à côté de la Russie, nous avons toutes de la famille russe. Presque toutes les habitantes des régions de Lougansk et Donetsk sont allées au moins une fois en Russie ou y ont travaillé et vice versa. Même moi je ne peux pas m’identifier ni comme Russe ni comme Ukrainienne car la moitié de ma famille est russe et l’autre ukrainienne. C’est comme ça dans pratiquement toutes les familles. Tout est donc très mêlé et dire que des Russes sont « venues s’installer », alors à quelle époque ? Il y a longtemps ou après 2014 ?
N ~ Comme je le disais, ma famille est moitié russe et moitié ukrainienne. Au moment du Maïdan, il y a eu un schisme dans ma famille : mes parents avaient toujours été plutôt pro-russes, ma mère avait même voté pour Lanoukovytch[Ndlr de Lundimatin : Viktor Lanoukovytch était le président pro-russe que le mouvement Maïdan a destitué., or j’ai commencé à manifester en 2014 après avoir entendu que des étudiantes avaient été durement réprimées dans les manifestations à Kyiv et qu’un mouvement Maïdan émergeait à Lougansk. J’étais moi-même étudiante et j’étais révoltée. J’ai donc rejoint ce mouvement ; ma mère m’a soutenue et a adopté une position pro-ukrainienne, en revanche mon beau-père est resté sur ses positions pro-russes, ce qui a provoqué leur séparation. Ma mère m’a rejointe à Severodonetsk et lui est resté à Lougansk. Voilà, c’est aussi ça, les conséquences de Maïdan. J’ai participé très activement au Maïdan de Lougansk, même si ce n’était pas comme à Kyiv, où les manifestantes étaient présentes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous nous réunissions dans le centre, tous les soirs, avec des actions ou bien simplement en tenant un grand drapeau. Parfois c’est tout ce que nous arrivions à faire, dix personnes avec un très grand drapeau et voilà ! Le 9 mars 2014, la situation s’est dégradée : la manifestation a été dispersée avec violence et cela a été un tournant. Nous avons compris que c’était devenu dangereux pour nous de manifester alors qu’une vague pro-russe montait. Nous avons commencé à nous réunir clandestinement la nuit pour fabriquer des drapeaux ukrainiens, pour faire de l’affichage, accrocher des rubans, etc. Nous avons continué comme ça jusqu’à l’été, puis le 22 juin j’ai quitté Lougansk avec une amie, pour Kyiv. Là-bas, c’était étrange pour nous, parce que tout le monde déclarait la victoire — le Maïdan de Kyiv avait tenu bon. On avait l’impression qu’on nous disait, en somme : « Vous n’avez pas su défendre Lougansk et Donetsk, c’est votre problème / tant pis pour vous ! ». Cela nous a beaucoup gênées et deux semaines après nous avons rejoint un bataillon de volontaires (d’abord à Spatovo, puis à Severodonetsk). Nous y sommes entrées de justesse, elles nous ont prises en cuisine. On peut dire que nous avons servi la cause, mais depuis la cuisine… Quand le conflit a semblé se geler et qu’il était clair que la situation n’allait pas évoluer, j’ai compris que je n’apporterais rien au bataillon et que je pouvais être plus utile en mettant mes compétences artistiques à contribution.
J’y suis restée neuf mois en tout. Vers la fin, je n’étais plus seulement en cuisine. J’ai travaillé à l’état-major, sur des tâches administratives, de la paperasse. Je le faisais tout simplement parce que j’avais un ordinateur et parce que personne n’aime ce travail-là. Les filles, ça sert à faire le travail que personne d’autre ne veut faire…!
Je suis partie de Lougansk en juin 2014 quand il y a eu l’occupation, via un des derniers trains qui circulaient pour rejoindre la zone ukrainienne, avant que les liaisons ne s’arrêtent définitivement. Contrairement à Lena qui peut encore passer la ligne de démarcation, Zhenia et moi ne pouvons plus retourner à Lougansk. Nous sommes inscrites sur les listes noires non seulement pour notre participation active aux événements pro-Maïdan mais surtout à cause de notre engagement militaire dans le bataillon.L ~ Au moment de Maïdan, je vivais déjà en Ukraine de l’Ouest et j’avais très peu de contacts avec Lougansk car toutes mes amies étaient parties après leurs études, soit à l’étranger, soit ailleurs en Ukraine. Pour moi, ce mouvement du Printemps Russe a été une grande surprise. À l’époque où j’avais quitté Lougansk, les gens ne remettaient pas en question l’appartenance à l’Ukraine, il n’y avait pas de velléités de séparatisme. Je suis allée à Kyiv dès le premier jour du Maïdan, un peu par hasard, en accompagnant une amie qui voulait y aller et que je ne voulais pas laisser seule. Jusque-là, je ne m’étais pas trop intéressée à tout ça, mais elle m’a dit que les étudiantes se faisaient tabasser et qu’elles ne pouvaient pas rester les bras ballants. Il fallait se décider rapidement et partir le soir même, tout le monde partait en masse à Kyiv. Par la suite je suis retournée plusieurs fois au Maïdan de Kyiv. Il y a eu beaucoup d’autres « petits » Maïdan dans toute l’Ukraine, mais j’ai compris que manifester en Ukraine de l’Est était réellement dangereux et que celles qui le faisaient (à Lougansk, Donetsk, Severodonetsk…) prenaient de grands risques et qu’elles faisaient preuve d’un grand courage. Maïdan, c’est un peu le déclencheur d’une prise de conscience chez celles qui ne s’étaient pas posé de questions jusque-là. Ce mouvement m’a permis de rencontrer beaucoup de gens très intéressants. Peut-être que David pourrait parler de ce qui s’est passé dans les régions de Lougansk et Donetsk, car pour ma part j’avais quitté la région en 2008 et je n’avais pas été témoin du développement de ce mouvement pro-russe. Quand tout a commencé en 2014, j’aurais beaucoup aimé être en contact avec des personnes qui auraient pu m’expliquer comment on en était arrivé là, alors que tout allait bien quand j’étais partie. Mais je n’avais plus d’amies dans la région et vivant en Ukraine de l’Ouest, Kyiv était plus près de chez moi, ainsi « mon » Maïdan a été celui de Kyiv.
D ~ J’aimerais reprendre la chronologie de tous ces événements : le début du mouvement était à Kyiv, en novembre 2013. Ensuite, il s’est propagé dans les autres grandes villes ukrainiennes, dont Lougansk, villes dans lesquelles il y a eu des manifestations. Mais à Severodonetsk, qui est une petite ville [environ cent dix mille habitantes en 2014], il ne se passait rien. Il y avait par contre beaucoup de discussions, des groupes organisaient des voyages pour aller au Maïdan à Kyiv et à Lougansk. Mais les groupes qui organisaient des voyages pour se rendre aux manifs anti–Maïdan étaient beaucoup plus actifs. La situation a commencé à changer et à devenir instable après l’annexion de la Crimée, en mars 2014. À partir de ce moment, en plus des idées simplement anti-Maïdan, on a commencé à entendre des idées séparatistes à Severodonetsk. Chaque samedi, des gens ont commencé à se réunir sur la place principale, a priori des locaux car j’en reconnaissais certains, avec des drapeaux bizarres. Pour la passante lambda qui regardait ces manifestantes défiler, tout ça était incompréhensible, mais nous, nous avons assez vite compris qui étaient ces gens, ce que représentaient leurs drapeaux et ce qu’ils voulaient. C’étaient des anti-Maïdan, des pro-russes dont les slogans principaux appelaient au référendum pour l’indépendance ou tout au moins l’autonomie de certaines régions comme Lougansk et Donetsk ; il y avait ce genre de manifestation également à Kharkiv, Zaporijia ou Kherson, principalement en Ukraine de l’Est. La situation était plus stable dans les régions de Dnipro et Zaporijia où les autorités locales réagissaient avec moins de violence qu’à Lougansk, Donetsk ou même Kharkiv. Petit à petit, ces manifestations ont commencé à prendre de l’ampleur, avec leurs figures de proue farfelues qui se donnaient l’image de gens du peuple prétendant mener les masses… Un jour, je suis passé devant la mairie, qui avait toujours été ornée d’un drapeau ukrainien, et ce jour-là il avait été remplacé par un drapeau soviétique. En fait, on a trouvé ça drôle, parce qu’on n’aurait pas été étonnées si cela avait été le drapeau de la LNR« République populaire de Lougansk, selon la transcription du nom russe de la ville, ou de Louhansk, selon sa transcription ukrainienne (en abrégé RPL ; en russe Луганская Народная Республика, Louganskaïa Narodnaïa Riespoubika ; en ukrainien Луганська народна республіка, Louhans’ka narodna respoubika), est entre 2014 et 2022 un État sécessionniste de l’Ukraine, créé par des forces séparatistes soutenues par la Russie, et proclamé le 27 avril 2014 dans l’oblast de Louhansk contrôlant la quasi intégralité de ce dernier. La grande majorité de la communauté internationale ne reconnaît pas cette entité comme un État indépendant. Sa capitale était la ville de Louhansk, importante ville russophone et ukrainophone de l’Est de l’Ukraine située dans le Donbass. » D’après wikipedia.org. ou même de la Russie, mais le drapeau soviétique…! À Severodonetsk il n’y avait que des anti-Maïdan. Moi j’avais quatorze ans, j’étais observateur de ce qu’il se passait. Je faisais quelques actions avec mes amies, plutôt des tags : « LNR c’est de la merde » ou « Gloire à l’Ukraine ». Mais le temps des plaisanteries a pris fin et la situation a commencé à devenir plus compliquée quand des groupes pro-russes se sont concrètement constitués dans la ville, des gens qui avaient aussi fait la guerre en Afghanistan. Ils organisaient des réunions avec des objectifs précis. Ils ont constitué un groupe de seize personnes mené par un chef dont je ne me rappelle plus le nom, un homme qui était précédemment vendeur de patates sur un marché. Ils ont trouvé des mitraillettes et ont pris le contrôle d’un commissariat de police, où tous les policiers, pourtant armés, se sont rendus, avec le reste du personnel civil (environ cent à cent cinquante personnes). Puis Ils ont pris la mairie, où Ils ont été accueillis à bras ouverts. Quand les dirigeants plus haut-placés de la LNR sont arrivés, l’ancien vendeur de patates ne voulait plus céder son poste de chef de la « cellule » de Severodonetsk. Ils l’ont fourré dans le coffre d’une voiture, l’ont emmené dans une forêt, l’ont tué et enterré. A la fin mars, début avril 2014, les pro-ukrainiennes ont commencé à s’organiser à Severodonetsk, se rassemblant d’abord en petit nombre — une quarantaine de personnes, ce qui n’était rien comparé aux manifs pro-russes qui rassemblaient environ un millier de personnes. Les pro-ukrainiennes ne comprenaient pas trop les enjeux ou alors avaient peur et étaient prudentes. Le 6 avril 2014, il y a eu des affrontements importants. Les séparatistes avaient organisé un grand rassemblement au centre-ville, devant le Palais de la Culture. C’est là qu’était le plus grand drapeau ukrainien de la ville. Ils ont descendu le drapeau pour le remplacer par celui de la LNR. Ils chantaient l’hymne de la région de Lougansk. Il y avait environ cinq cents personnes du côté de la cérémonie, et de l’autre côté de la rue, il y avait une contre-manifestation que nous avons rejointe avec mes amies. Nous étions une cinquantaine à observer la scène quand nous avons été chargées par la foule qui criait « Russie ! » À mon grand étonnement, la police a fait son travail : elle a fait un cercle autour de nous pour nous protéger, mais ça n’a pas suffit et la foule enragée s’est jetée sur nous. Ensuite, certains policiers sont passés de leur côté quand ils ont compris que les forces étaient inégales, mais heureusement, la plupart d’entre nous a réussi à s’enfuir. Il n’y a pas eu de victimes, mais certaines d’entre nous, moi y compris, ont quand même eu des blessures, mais dans l’ensemble nous avons eu de la chance. Après ça, tout le mouvement est passé dans la clandestinité.
N ~ J’ai déjà parlé de mon expérience militaire. Après avoir quitté le bataillon, je suis restée à Severodonetsk car c’était le nouveau chef-lieu de la région de Lougansk et parce que je voulais rester au plus près de chez moi, afin de pouvoir rentrer rapidement si la possibilité se présentait. De plus, je connaissais bien Severodonetsk. Il s’y passait relativement peu de choses, c’était une ville peu développée sur le plan culturel et une partie des quelques personnes actives auparavant avait quitté la ville. Je me disais qu’il y avait un espace pour agir et que c’était nécessaire. Il en allait de même pour les villes des alentours, que presque tout le monde avait quittées. J’ai eu le sentiment que je devais me consacrer à cet endroit, parce qu’en tant qu’artiste, c’était ma vocation et il me semblait que je pouvais y être beaucoup plus utile. Nous avons amorcé plusieurs activités : d’abord un modeste ciné-club, puis un théâtre. Nous avons fondé une association, nous faisions de plus en plus de choses et, avec le recul, il est clair que nous avons beaucoup fait pour recréer une communauté comme celle que nous avions à Lougansk (rencontres artistiques, etc.). Nous voulions que des gens nous rejoignent et s’installent. Avec le temps, j’ai compris que je voulais recréer Lougansk à Severodonetsk et que c’était vain, que ça n’avait pas de sens, qu’il fallait simplement faire autre chose et qu’au fond nous étions tout de même des étrangères dans cette ville qui avait sa propre dynamique. Nous avons été déçues par ce constat et nous nous sommes un peu éloignées de Severodonetsk pour nous consacrer davantage à la LCD (Louganskaya Contemporary Diaspora), axée sur Lougansk. Nous avons commencé à rétablir nos liens avec les gens de cette ville ; beaucoup de temps avait passé et nous nous sommes rendu compte que notre vécu et celui des personnes restées là-bas appartenaient à des mondes parallèles. Après cette interruption, nous avons cherché à comprendre ce qui s’était passé pendant cette période et comment nous pourrions rétablir le lien. Nous avons aussi fait la connaissance de nouvelles personnes. Les activités autour de la LCD ont commencé à ce moment-là et se sont poursuivies jusqu’à maintenant.
N ~ Le pic d’activité était il y a environ trois ans, quand des personnes ont commencé à nous rejoindre sur place à Severodonetsk. Nous les emmenions voir Kharkov, Kyiv… Il y a eu beaucoup de nouveaux contacts et le sentiment que nous devenions très proches. Il y avait beaucoup de projets pour l’avenir et d’ailleurs, le jour avant le début de cette guerre, nous avons publié une bande dessinée que nous préparions depuis longtemps sur les liens entre les gens des deux camps opposés. C’était écrit dans un genre un peu fantastique mais inspiré de faits réels. Le gros du stock est encore chez nous — nous n’avons pas pu l’envoyer aux lectrices à cause des événementsVoir la BD sur cargocollective.com..
LCD et Tumbler ont existé en parallèle. Diaspora est simplement un collectif d’artistes, ce n’était pas une association déclarée, contrairement à Tumbler, qui était enregistrée et qui avait des activités sociales. Ces deux groupements étaient constitués de personnes différentes, bien que certaines faisaient partie des deux.L ~ Pour ma part, j’ai beaucoup d’histoires à raconter qui concernent des personnes qui ne sont pas présentes ici, donc c’est compliqué. Tout comme les événements que nous traversons aujourd’hui créent un « avant » et un « après », les événements de 2014 ont bouleversé ma vie : ma famille s’est retrouvée sur un territoire et moi sur un autre et nous n’avons plus pu nous voir aussi souvent. En 2014, j’avais envie de revenir dans ma région natale depuis un moment déjà. La steppe me manquait. Les circonstances ont rendu possible ce retour : mon professeur de théâtre, metteur en scène et directeur artistique a souhaité fonder un théâtre à Severodonetsk, sa ville d’origine. C’est intéressant comme tout s’entremêle dans la vie. J’avais déjà entendu parler de Nijnié et j’avais envie d’y aller, mais à chaque fois que je passais par l’Ukraine occidentale, en tournée par exemple, je manquais de temps pour le faire. C’est aujourd’hui, après toutes ces années, que je m’y retrouve, dans des circonstances toutes autres. C’est pareil pour Severodonetsk : à la fin de mes études, comme j’étais boursière, je devais travailler dans un théâtre public, à Severodonetsk. Je ne voulais pas y aller et j’ai tout fait pour l’éviter ; Severodonetsk est une ville-usine, or j’aime les montagnes et la nature et je voulais échapper à cette région industrielle. J’aurais préféré vivre dans les Carpates et connaître autre chose. Mais j’y suis allée quand même et j’y ai vécu de 2016 à aujourd’hui. Je pensais que je verrais mes proches plus souvent, mais cela n’a pas été le cas, car traverser la frontière n’était pas sans danger, c’était coûteux et chronophage, difficile à concilier avec un travail à plein temps. Nastia vous a montré le trajet sur la carte : il se fait normalement en deux heures, mais il pouvait prendre vingt-quatre heures avec les arrêts aux checkpoints. Nous avons commencé à travailler dans le théâtre de mon professeur. Il avait quitté Lougansk en 2014 pour Severodonetsk.
Les expériences professionnelles jusque là — travailler avec différentes metteuses en scène, participer à des festivals — avaient été très précieuses, mais j’avais compris que ce n’était pas exactement ce que je voulais. Mon professeur travaillait selon sa propre méthodologie, avec une vision très personnelle de l’art théâtral que je trouvais passionnante. J’avais toujours voulu travailler avec lui, ainsi lorsque je suis arrivée à Severodonetsk, j’en ai eu la possibilité. Travailler sous sa direction permet aussi de s’exprimer et de déployer son propre potentiel. Dans les théâtres publics, de grandes équipes s’occupent de tout (décoratrices, chorégraphes…), alors que dans ce petit théâtre on faisait tout soi-même. J’ai eu l’occasion de mettre en scène deux contes pour enfants et une pièce pour adultes. C’est une expérience très précieuse et je n’ai jamais regretté de m’être installée à Severodonetsk. C’est un grand morceau de vie qui prendrait beaucoup de temps à raconter si on regroupait toutes les personnes qui en ont fait partie. La vie à Severodonetsk était très remplie, très intense. Mais nous avons rencontré des difficultés : nous avons perdu le lieu qui nous servait de théâtre, ensuite il y a eu le Covid. Nous avons donc entrepris d’autres activités en parallèle, avec David notamment. Il y a eu Tumbler, il y a eu une « éco-école » et un atelier qui recyclait le plastique et fabriquait des objets avec{fn-objets avec}… Nous avons fait beaucoup de travaux pour rénover cet atelier (la toiture a été refaite et nous avons installé un système d’extraction d’air très performant) et c’est douloureux de ne pas pouvoir nous en servir à cause des circonstances.D ~ Pour moi, il convient de commencer par le simple fait que l’année 2014 a plus ou moins coïncidé avec le début de ma vie d’adulte, car j’avais quatorze ans à l’époque. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me demander ce que j’allais faire dans la vie et 2014 a été une sorte de vecteur d’impulsion. Ainsi, 2014 n’a pas été pour moi une fracture ou un basculement, mais plutôt le début de ma vie. Jusque là, j’allais à l’école et je suis simplement passé à autre chose, donc il n’y a pas eu de rupture dans le quotidien, contrairement à ce qu’ont traversé d’autres personnes.
D ~ Oui, j’avais la vie stable et ordinaire de toute collégienne de quatorze ans et 2014 a donné une orientation à ma vie. Tout comme il y a un avant et un après 2022, il y a eu un avant et un après 2014. Ce sont des événements qui reconfigurent la vie en profondeur. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Les activités que j’ai eues, ce qui a mené aux événements actuels… En moi, j’ai compris que l’enfance était terminée et que c’était la vraie vie d’adulte qui commençait, avec toute sa rudesse.
D ~ Oui, mais je me souviens d’avoir ressenti que la vie n’était plus un jeu et que les choses sérieuses et dangereuses commençaient. Peut-être que je prenais tout avec plus de légèreté à l’époque. L’échelle du drame qui se déroule en ce moment est toute autre. En 2014, nous pensions que c’était la fin des haricots, mais si nous avions imaginé ce qui nous attendait en 2022… C’était le jardin d’enfant. Les échelles ne sont vraiment pas comparables. Notre réaction intérieure est donc proportionnelle.
Je comptais construire une maison — heureusement que je ne l’ai pas fait, à la veille de la guerre ! J’aime plaisanter et dire que « Dieu merci, je n’ai pas eu le temps de le faire ». Les projets de vie aujourd’hui doivent repartir de zéro. C’est comme naître une seconde fois. Mais naître avec déjà une tonne de problèmes…D ~ Oui, tout à fait, on a envie de recommencer quelque chose et on le pourrait, mais on a toutes sortes de doutes, on se dit : « Peut-être qu’on reviendra, peut-être pas… » et avec chaque jour qui passe, on se rend compte qu’on est parties depuis un mois déjà, puis deux… Il y a quelques jours, nous coupions du bois avec Zhenia et je me suis rendu compte avec horreur que nous étions déjà le 30 mars et que le lendemain c’était le premier avril… La guerre a commencé en fin février, c’était l’hiver, et le temps est passé très vite.
Alors que cette nouvelle phase de la guerre a commencé, avez-vous encore des contacts avec les gens de Donetsk, Severodonetsk, Lougansk ?Z ~ Oui, nous avions un chat, un fil de discussion sur Telegram où nous postions des nouvelles sur les événements que nous organisions, ce qui était planifié, ce qui était sorti, il y avait des annonces de concerts, de parutions. Nous avions une radio qui n’existe plus depuis peu. Chaque mois une radio italienne à BerlinVoir plus sur rbl.media. nous donnait un créneau, une partie de son temps d’émission et nous annonçions aussi ça sur le chat. Maintenant le chat sert aux personnes sur place, restées à Lougansk. La plupart sont chez elles à la maison parce qu’il est dangereux de sortir et il y a le risque de se faire enrôler dans l’armée de la LNR et de la DNR« La République populaire de Donetsk (RPD en forme abrégée ; en russe : Донецкая Народная Республика, Donetskaïa Narodnaïa Respoublika) est une organisation quasi-étatique sécessionniste de l’Ukraine, créée par des forces séparatistes soutenues par la Russie, qui s’autoproclame État, dans l’oblast de Donetsk le 7 avril 2014 et contrôlant une partie de celui-ci. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine annonce la reconnaissance russe de l’indépendance des républiques du Donbass, dont celle de Donetsk. Cette reconnaissance fait immédiatement l’objet d’une large condamnation au Conseil de sécurité des Nations unies et précède de trois jours l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 ordonnée par le président russe. Le 30 septembre 2022, la Russie annonce l’annexion de la république au sein de son territoire, en même temps que les autres territoires occupés. » D’après wikipedia.org..
Je parle seulement de Lougansk et éventuellement un peu de Donetsk. Depuis que tout ça a commencé, beaucoup de personnes participent au chat, demandent ce que font les autres et, même sans ma présence ou celle de Nastia, les gens continuent de discuter car ils ont beaucoup de temps et ils font part des nouvelles de leurs différentes villes, Lougansk ou des petites villes alentours, Donetsk aussi, et ils partagent des nouvelles sur les manières de partir, de quitter ces endroits si c’est dangereux ou pas de sortir dans la rue. Ils partagent aussi des nouvelles des personnes qui ont été enrôlées dans l’armée. Voilà, donc c’est un canal de communication que nous avons.N ~ Oui, j’ai des amies avec lesquelles je ne communiquais plus parce que nous n’avions plus grand chose à nous dire, nous n’avions plus vraiment de thèmes communs, à Donetsk ou à Lougansk, et à partir du début de ces événements, nous avons commencé à communiquer très intensément, et même des personnes à qui je n’avais pas écrit depuis un an et demi, tout d’un coup on a commencé à beaucoup communiquer. Sur la route pour venir ici, j’avais trois appels par jour de personnes avec qui j’avais pas communiqué depuis longtemps qui nous demandaient : « Vous êtes où ? Où est-ce que vous allez ? Qu’est-ce que vous faites ? »
Z ~ Dans ce chat il y a des personnes qui sont de Rarkof ou d’autres villes qui sont sous contrôle russe et j’ai lu aujourd’hui qu’un ami avait pu quitter Marioupol par ses propres moyens et a réussi à aller jusqu’à Zaporijia. On n’avait pas de nouvelles de lui depuis un petit moment. Ce chat est un média où les gens peuvent échanger sur la guerre, et ce de chaque coté de la ligne de front.
>Pourquoi avez-vous quitté les bataillons et quelle est la forme qui vous a semblé la plus pertinente pour participer à cette guerre ? Et pourquoi c’est cette forme de résistance que vous avez choisie ?
Z ~ J’ai passé deux ans dans le bataillon et j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. La fin de ce temps-là était un moment relativement instable. Je n’étais pas loin de Severdonetsk, à l’arrière du front. Le conflit était gelé, il n’y avait pas de combat actif, il y avait des tentatives de pourparlers, d’accords, c’est pourquoi nous étions simplement là à attendre. Pour agir en cas d’exacerbation du conflit. Et nous occupions la routine du quotidien. J’ai eu le temps de beaucoup bouquiner et je me suis rendu compte que je pourrais passer mon temps à quelque chose de beaucoup plus productif, parce que pour être soldat, il n’y a pas besoin de compétences particulières. N’importe qui peut devenir soldat. Et si tu veux faire quelque chose de plus productif, utiliser tes compétences, tes connaissances individuelles, ça va être difficile. En fait c’est toi qui sait le mieux comment utiliser tes connaissances. À l’armée, personne ne se préoccupe de ce que tu sais faire et de ce que tu ne sais pas faire, tout le monde est au même niveau. Voilà le premier aspect. Deuxièmement, j’ai compris que ce conflit n’allait pas être réglé par la voie militaire. Même avec un avantage militaire d’un coté ou d’un autre, de toutes façons le mieux qui pouvait arriver était un gel du conflit, parce que les conditions de ce conflit, ce qui y avait mené, n’allaient pas disparaître et toutes celles qui en avaient souffert allaient vouloir se venger, infliger une riposte. Il ne pouvait y avoir victoire seulement si on éliminait tout le monde ou si on éliminait la Russie, à ce moment-là ça serait la victoire idéale mais c’était peu probable. En tant qu’acteur de la culture, je pouvais faire quelque chose de plus productif, qui aurait plus de sens. J’ai vu des choses et des thèmes dont personne ne parlait et j’ai voulu en faire quelque chose en tant qu’artiste.
N ~ Oui, je rejoins Zhenia sur ce qu’il a dit et de mon coté je me suis rendu compte que les personnes à mes côtés dans le bataillon, que je pensais être du même bord que moi, étaient en fait très différentes et pour beaucoup d’entre elles la victoire était à n’importe quel prix : entrer dans Lougansk, prendre la ville et tant pis si la ville était entièrement détruite. Selon elles, c’était leur terre et elle ne devait être à personne d’autre qu’à elles. Pour moi, ce n’était pas pareil. C’était chez moi mais ma maison détruite, ça me faisait une belle jambe.+ En plus, il y avait un niveau d’agressivité important et tout était pensé en noir et blanc : l’idée que nous sommes Ukrainiennes et que nous sommes des saintes, que les gens de Donetsk et les Russes sont le mal incarné et personne n’essayait de comprendre ce qu’il y avait à l’intérieur de ces différents groupes. Voir le monde en noir et blanc comme ça et essayer de montrer que les choses n’étaient pas comme ça, ce n’était vraiment pas facile et j’ai compris au bout d’un moment que j’avais beaucoup moins en commun avec ces personnes-là qu’avec des personnes que je connaissais à Lougansk. Là bas, je connaissais plein de gens bien, pro-Ukraine, mais expliquer ça à mes co-combattantes était complètement impossible. En fait beaucoup d’entre elles n’étaient jamais allées à Lougansk et pourtant elles voulaient à tout prix défendre cette ville en la détruisant. En fait c’est pareil aujourd’hui, c’est-à-dire que pour moi toutes les Russes ne sont pas intrinsèquement mauvaises, je sais qu’il y a plein de Russes très bien mais qui ne peuvent rien faire dans cette situation et je comprends aussi qu’en Ukraine tout le monde n’est pas super classe. Par exemple, il y a des gens qui profitent de la situation et se font du fric en louant leur appartement à des prix mirobolants. Maintenant je connais les coulisses de ce côté militaire, je sais comment ça fonctionne, je sais aussi que ce qui est montré aux infos n’est pas la réalité. Et donc j’ai compris que ça n’était pas ce que je voulais faire de ma vie et qu’on n’exploitait pas mes compétences, on ne me laissait rien faire, rien voir et que je ne voulais pas gaspiller ma vie à cela, rester en cuisine et faire des listes de je–ne–sais-quoi ; ça, n’importe quel idiot pouvait le faire.
Est-ce que les unités dans lesquelles vous vous battiez faisaient partie de l’armée ukrainienne régulière ?
N ~ Il y a aussi un lien qui s’est fait grâce à un journaliste suédois qui est venu à Donetsk en 2014 pour essayer de comprendre la situation. Il travaillait avec des groupes antimilitaristes en Suède et ceux-ci ont formé une sorte de groupe de rencontres antimilitaristes pour des pacifistes. À l’origine, ces rencontres avaient lieu entre des Suédoises et des Finlandaises parce qu’elles avaient des relations conflictuelles depuis très longtemps. Ensuite, des Russes se sont jointes à elles et une rencontre entre ces trois pays a eu lieu parce que ce conflit entre la Suède et la Finlande avait un lien avec la Russie.
Et donc en 2018 ou 2019, des Ukrainiennes ont pris part à ces rencontres et il y avait donc la Suède, la Finlande, la Russie et l’Ukraine. Il y avait seulement quelques participantes Ukrainiennes et nous en faisions partie. C’était vraiment intéressant pour nous parce que nous avons pu rencontrer des activistes russes, des pacifistes et antimilitaristes et parler avec elles de leurs problèmes, leur expliquer mieux notre propre situation. Après ça, nous avons gardé des liens avec certaines de ces personnes et aussi avec des activistes finlandaises et quelque activistes suédoises.
Donc à la suite de ces rencontres, on a eu encore de nouveaux soutiens en Russie. L’un d’eux est venu en Ukraine et a acheté des trucs qu’on a faits.>Est-ce que la Lougansk Contemporary Diaspora est encore active en ce moment ou c’est trop compliqué ?
Avant de partir, nous avons lu une lettre écrite par des anarchistes qui disaient s’engager dans l’armée et pour nous, c’était une chose compliqué à comprendre.
Z ~ Ça me fait penser à un groupe d’anarchistes de je ne sais plus quel pays d’Europe qui est venu prendre part à la guerre en 2014 mais dans le camp des pro-russes. J’ai vu des articles à propos de ces gensVoir plus sur www.nihilist.li.. Ils disaient qu’ils étaient des anarchistes de droite et qu’ils soutenaient le système soviétique. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes radicales qui prennent parti dans les deux camps.
Dans mon bataillon, j’ai connu un gars qui avait des tatouages anarchistes, une étoile en rouge et noir. Il a été capturé par l’armée russe, et il a du scalper ses tatouages parce que ces couleurs-là sont celles du parti nationaliste ukrainien. Ce sont les Russes qui lui ont demandé de faire ça. Mais les couleurs de son étoile n’avaient rien à voir avec celles du parti nationaliste. Les anarchistes utilisent aussi ces couleurs.
Et depuis ici, est-ce que vous arrivez à soutenir vos amies qui ont décidé de se battre ? Ici il y a un conflit entre deux positions, l’une d’entre elles est un pacifisme très radical qui refuse de donner de l’aide aux personnes qui se battent. Qu’en est-il de votre position ?L’entretien commençant à dater, voici quelques mots plus récents concernant leurs activités actuelles :
« Nous sommes toujours en train de faire des rénovations sur la maison. Nous sommes peu et les travaux avancent doucement. Nous voulons finir au moins une chambre avant d’emménager pour de bon. David fait des évacuations de personnes près de Dnipro. Il a même prévu d’aller y vivre pour un temps et Lena va aussi le rejoindre. Elles n’ont pas de plans précis pour le futur et pourraient peut-être revenir par ici. De notre coté, on essaye de passer le permis. On est pas inquietètes, on avait déjà pris quelques leçons avant. Il y a quelques jours (le 3 juillet), la région de Lougansk a été occupée complètement. On dirait que ça va durer un bon moment… »

La ville est vide, le front est à quelques kilomètres.

Un groupe de jeunes volontaires vit dans le bar depuis le début de la guerre.

Un concert est organisé avant le couvre-feu. Volontaires, militaires et ami·es s'y retrouvent.
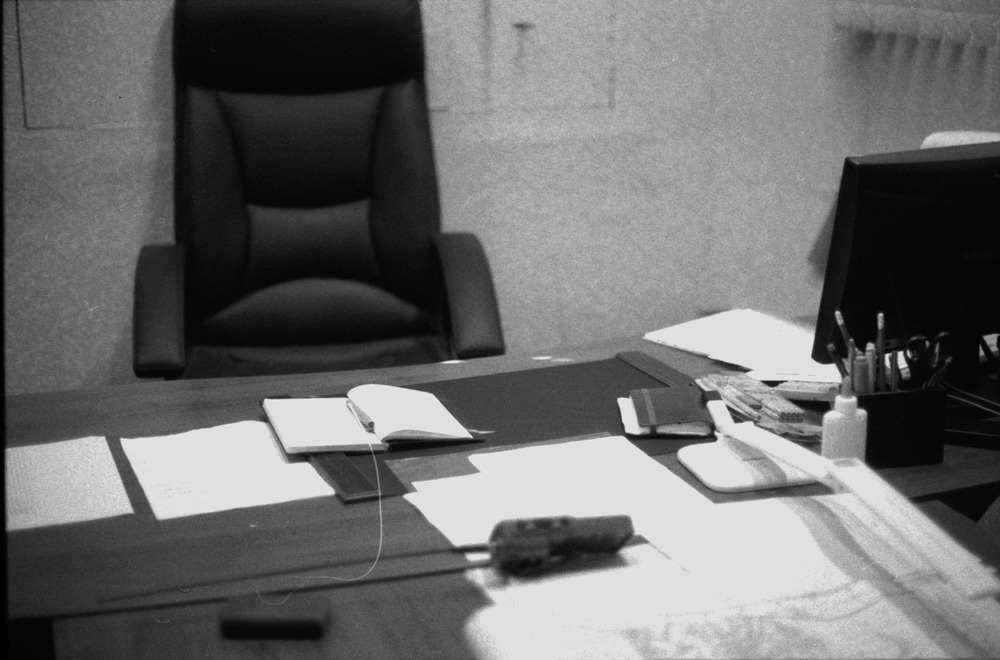
Proche de la ligne de front, ce village est devenu logement, refuge et lieu de vie pour les soldats.

Les ateliers de camouflage de Kossiv prennent tout leur sens.

Le sous-sol d'une école est devenu un bunker pour les soldats.
De l’autre côté
Le 24 février, j’ai rendez-vous aux Beaux-Arts avec Misha pour finaliser le portfolio d’une étudiante ukrainienne qui tente le concours. Pendant plusieurs heures, nous ne parlons pas de la guerre déclarée le matin même par Vladymyr Poutine. Plus tard, pendant que nous rejoignons une manifestation de soutien organisée place de la République, Misha commence à me raconter l’histoire de son pays dont je ne connais presque rien, je ressens une envie inexplicable, comme un impératif, d’aller en Ukraine. J’évoque cette idée à mes proches, à moitié comme une blague.
Depuis quelques années, je suis impliquée dans la réalisation de projets documentaires sur l’exil. Parmi eux, un projet co-réalisé en 2019 à Moria sur l’île de Lesbos. Ces rencontres et récits ont modifié en profondeur ma perception des situations de conflits.
Cette fois il faut réagir de manière physique à cet événement et une semaine plus tard, nous sommes en route vers la Pologne avec Ali, un ami. Pour aider, filmer, c’est encore flou. Misha nous a donné le contact d’Artem, l’un de ses ami·es ukrainien·nes, qui réalise des documentaires. Lorsque nous le rencontrons dans un appartement mis à disposition par le réseau d’entraide, il nous explique que ce n’est pour lui pas le moment de filmer mais d’agir, que tout s’est mis en place très vite. Les réseaux d’entraide proposent logements, transport de personnes et acheminement de matériel de première nécessité ; une multitude de groupes Telegram voient le jour et la plupart des volontaires ne se connaissent pas. Avec sa voiture, Artem fait la navette entre les différentes villes polonaises et la frontière ukrainienne plusieurs fois par jour, une tâche que de plus en plus de personnes s’engagent à faire. Pour être plus efficace, faudrait-il rejoindre l’armée ? Une discussion éclate. Ali, reporter en Irak dont il est originaire, est le seul à connaître le sujet, à l’avoir vécu. Il explique le front, le point de non-retour, l’importance de l’image. La guerre, en pratique, est encore bien abstraite pour nous.
Nous restons toustes les trois pendant dix jours entre Przemysl et Medyka. Cette dernière est une des villes frontalières côté polonais. Là, une fois que les gens ont passé les contrôles, iels montent dans des bus en direction des camps de Przemysl ou Korczowa, à quelques kilomètres de la frontière. Les camps sont d’anciens centres commerciaux où les déplacé·es attendent des heures, parfois des jours les navettes qui les conduiront dans les différentes villes européennes. Régulièrement, de nouveaux volontaires arrivent, des tentes apparaissent, des militaires investissent les lieux, des barrières sont installées, des journalistes affluent. Des rumeurs circulent sur le camp : ceux et celles qui organisent les transports profiteraient de la situation pour faire du trafic d’êtres humains, ou encore un agent du FSB s’y serait infiltré pour collecter des informations.
Entre des militaires qui pénètrent sur le territoire, un musicien avec son piano à queue, des camions chargés de matériel, des lumières, des écrans plats pour les live des JT, c’est une confusion générale dans un grand calme. Beaucoup pensent que tout cela ne durera que quelques jours ou semaines tout au plus. Celles et ceux qui s’engagent répètent qu’iels resteront « jusqu’à la fin de la guerre ».
Des gens du monde entier sont venus pour aider et l’organisation se fait dans une multitude de langues — les ONG n’arriveront que plus tard. Les volontaires, souvent jeunes, sont venu·es spontanément, seul·es ou en groupe. Iels dorment par petites tranches horaires dans les bus et le reste du temps travaillent sans répit à réceptionner les dons qui affluent, organisent les navettes, mettent en place des lits de camp…
Ali ne peut pas entrer en Ukraine faute de passeport européen, il a besoin d’un visa. Quant à Yura, il a apporté un camion humanitaire et attend patiemment, le visage fermé, ne pouvant rentrer dans son pays au risque d’y être bloqué jusqu’à la fin de la guerre : les hommes entre dix-huit et soixante ans ont l’interdiction de quitter le pays.
L’intérieur du pays fait peur et plus nous en discutons entre personnes de l’extérieur, plus nous alimentons nos fantasmes. Comme si de l’autre côté de la frontière, à quelques mètres seulement, tout changeait : d’un côté la paix, de l’autre la guerre. Diana, journaliste pour MBC, une chaîne saoudienne, me demande de l’accompagner pour prendre des images de Shehyni, une ville frontalière ukrainienne. Son caméraman ne peut pas entrer car il n’a pas de passeport européen. J’accepte sans trop savoir pourquoi. Elle demande au garde frontière : « Est-ce que c’est sécurisé ? » Le douanier répond froidement : « Pologne, sécurisée. Ukraine, guerre. » On passe.
De l’autre côté, une tente militaire fait office d’accueil des volontaires comme il est indiqué sur un bout de carton. Tout paraît plus calme ici. Diana s’en exaspère : « Il n’y a rien à filmer, on abandonne le reportage. » Puis, un homme passe avec une béquille, elle voudrait que le live commence tout de suite pour saisir cette image misérabiliste, je tiens l’iPhone, mais la chaîne est en retard. Finalement, elle a froid et nous retournons en Pologne.
Le 13 mars, j’entre à nouveau dans le pays avec Artem. Nous amenons des affiches de Misha qui dénoncent l’invasion. Ce sont des lithographies qui portent des slogans contre la guerre, des caricatures de Poutine ou des blagues sur la destruction de l’armée russe. Nous arrivons à Lviv qui est remplie de déplacé·es, il est difficile de se loger. Dans mon imaginaire la guerre change de forme et ma perception de la réalité avec, plus rien ne concorde : il fait beau, les magasins et les restaurants sont ouverts, on se balade du côté de l’opéra. Pourtant, celles et ceux que je recontre semble absorbé·es, téléphone à la main, dans des missions logistiques : apporter un sac en Pologne, récupérer un chien, évacuer une grand-mère, trouver des lunettes thermiques…
Le soir, c’est la première fois que j’entends l’alarme sonner, on s’abrite dans la cave et on joue aux cartes. La deuxième fois, je rentre dans un café pour demander ce qu’il faut faire et la serveuse hausse les épaules. Petit à petit, je comprends qu’un gros pourcentage de la population n’y prête plus attention, ou du moins très peu. Le danger semble imprégner les corps dans une tension permanente mais invisible.
Avec la famille d’Artem, nous décidons de quitter la ville pour nous rendre dans la ferme de Longo Maï à Nijnié. Iels sont resté·es deux semaines bloqué·es dans une cave, sans réseau, et ont réussi à fuir il y a quelques jours. Son père a reçu un éclat de bombe à sous-munitions dans le doigt que les docteurs ne peuvent pas enlever pour l’instant. Dans trois mois, il aura soixante ans et pourra quitter le territoire. En attendant, il va se reposer.
Les quais de la gare de Lviv sont bondés et la sécurité essaye de réguler le flux de passager·ères. Notre train est presque plein. Nous arrivons au village dans la nuit, un homme nous attend devant une école qui sert de lieu d’accueil, nous avons du mal à la trouver dans la brume et l’obscurité. Il ouvre une classe où une dizaine de lits sont installés. Le lendemain je rencontre Sergï, Oreste et les habitant·es de la ferme de Longo Maï. Bientôt, les neuf Français·es du collectif Ici Transcarpatie arrivent. Je rencontre Nollaig avec qui, quelques jours plus tard, nous livrons l’ambulance.
Fin mars, je suis de retour en France. L’armée russe, en échec militaire, se retire des régions nord pour se concentrer sur l’est du pays.
En juillet 2022, je retourne en Ukraine avec le convoi humanitaire de Yura. Nous devons livrer des choses aussi diverses qu’un chapeau pour une femme à Lviv, des médicaments pour un hôpital à Vinnytsia, deux valises pour un couple ainsi qu’une voiture pour l’armée à Kyiv.
Tout a changé. Je passe par le camp de Przemysl qui est presque vide maintenant. Il ne reste plus aucune tente humanitaire, seulement quelques familles en déplacement accompagnées du peu de volontaires
restant·es. En Ukraine, les checkpoints ne contrôlent plus, les sacs de sable sont usés et les panneaux publicitaires sur la guerre vieillis. On ressent clairement que la guerre s’est déplacée vers l’est. Pourtant, son écho est partout. Arrivée à Kyiv, la vie a repris son cours. L’église où nous avions apporté l’ambulance a repris ses fonctions initiales et il ne reste plus aucune trace de la base des médics recontré·es au moment de la livraison.
De Kyiv à Kharkiv en passant par Mykolaiv, je rencontre volontaires, militaires et civil·es. Les organisations de volontaires semblent plus structurées, certaines se sont professionnalisées et sont devenues permanentes, d’autres sont maintenant sous la tutelle d’ONG internationales comme la« World Central Kitchen (WCK) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui se consacre à fournir des repas à la suite de catastrophes naturelles. Fondée en 2010 par le célèbre chef cuisiner José Andrés, l’organisation a préparé de la nourriture en Haïti à la suite de son tremblement de terre dévastateur. Sa méthode de fonctionnement est d’être un premier intervenant, puis de collaborer et de galvaniser des solutions avec des chefs locaux pour résoudre le problème de la faim, immédiatement après une catastrophe. » D’après wikipedia.org.. Parmi les volontaires, certain·es sont retourné·es à leurs activités d’avant la guerre, d’autres encore ont abandonné par manque de reconnaissance. Des groupes ont perdu certain·es leurs membres, les donneureuses internationaux·ales privé·es — les particulier·ères — sont moins réactif·ves. Dans un train pour Lviv une jeune femme me raconte : « Les deux premières semaines il fallait répondre à l’urgence, j’étais volontaire. Puis, il a été possible d’envoyer des colis à l’extérieur du pays. Nous avons recommencé nos activités de stylisme en exportant nos produits aux État-Unis. Aujourd’hui, j’essaye d’acheter une maison pour mes parents. Iels sont dans un village très proche du front, mais ne veulent pas quitter leur maison. »
Des noyaux durs de volontaires survivent en continuant leurs activités, d’autres groupes sont fondés et prévoient déjà des permanences pour l’hiver, notamment dans les zones détruites. Un nombre incalculable de réseaux anonymes demeurent, liés par les groupes WhatsApp ou Telegram. C’est le cas de Khrystina, ancienne organisatrice de festival, qui se sert des réseaux sociaux pour évacuer des milliers de civil·es d’Irpin dont elle est originaire. Son numéro circule beaucoup et ses contacts d’avant-guerre prêtent des bus ou deviennent des conducteurices. Elle les met en contact avec des civil·es bloqué·es. Aujourd’hui, son activité s’est transformée, elle est en relation avec des soldats qui lui passent des commandes de matériel.
Un nombre conséquent de volontaires continue à répondre à l’urgence de la situation : un hôtel chic à Kyiv devient un logement pour les enfants des déplacé·es internes, une juriste crée des liens avec d’autres organisations pour acheminer nourriture et produits de première nécessité dans les villages libérés, des camions d’eau potable s’acheminent vers Mykolaiv. Et lorsque je demande à tous·tes s’iels reçoivent des subventions ou une quelconque aide de l’État pour leurs organisations volontaires, on me répond à peine. Les réseaux se constituent en dehors de l’État et personne n’en attend du soutien. On m’explique que les Ukrainien·nes défendent un territoire, une langue, une histoire, un peuple mais pas un gouvernement. Sergï me dit que la société ukrainienne a toujours dû repartir de zéro, de l’indépendance à la révolution orange« La révolution orange (ukrainien : Помаранчева революція, Pomarantchéva révolioutsiya) est le nom donné à une série de manifestations politiques ayant eu lieu en Ukraine à la suite de la proclamation le 21 novembre 2004 du résultat du deuxième tour de l’élection présidentielle, que de nombreux·ses Ukrainien·nes perçoivent comme truqué par le gouvernement de Viktor Ianoukovytch et par le puissant clan de Donetsk, dont l’oligarque Rinat Akhmetov. » D’après wikipedia.org., de Maïdan jusqu’à la guerre et que depuis 2014, leur capacité de réaction tient à cette logique d’organisation collective.
Tout de même, le discours sur la guerre est moins homogène qu’au début. Elle s’étire et demande de l’endurance. Les morts et les destructions, mais aussi d’autres dommages, moins quantifiables, affectent les corps. La parole se libère, laisse la place à la critique. L’épuisement et l’état d’exception font partie du quotidien. On me confie la colère contre les oligarques, la corruption qui façonne le pays et le détournement des aides humanitaires. Malgré l’aide occidentale conséquente apportée sur le terrain, beaucoup n’ont pas le nécessaire. L’agacement gagnerait les rangs de l’armée. Depuis le 24 février, le changement semble radical : mental, physique, social et pratique. La guerre a apporté sa propre temporalité, ses normes. Chaque personne vit où elle le peut, au jour le jour, prête à reprendre la route. Parler du lendemain est un exercice de projection impossible à faire maintenant. Les discussions se remémorent le passé, rêvent parfois d’un futur mais le temps présent de la guerre domine. Les rapports marchands d’avant-guerre ont perdu tout leur sens pour les civil·es, volontaires et militaires que j’ai croisé·es. Certain·es font écho au communisme, le vrai me dit-on, surtout pas celui de l’URSS. Les liens humains se sont transformés : fractures familiales, nouvelles amitiés, conflits interpersonnels, souffrances indicibles, solidarité et léthargie. On me dit aussi que l’on se lie de façon plus instinctive parce qu’on comprend ce que les autres ont vécu, ou parce qu’on a les mêmes positions. Un proche ukrainien me confie : « L’attaque est claire, ce n’est pas un conflit entre deux parties mais un camp agressé et un agresseur. Le seul moyen de survivre c’est de se réunir pour être efficace, prévenir à l’arrière pour le bon fonctionnement du front. Il faut aussi que les infrastructures et que l’économie fonctionnent pour que le pays puisse continuer d’agir. »
Un commandant me dit : « la guerre aspire ». C’est cette aspiration vers la violence qui crée ces points de non-retour dont Ali me parlait aux premiers jours. Il y a bien l’autre côté, qui n’est pas palpable aux premiers instants : ce n’est pas l’écroulement visible, mais une tension continue dissimulée dans les corps. Les réalités s’entrechoquent sans cesse, d’une zone de guerre à un bar en fête, des bombardements permanents aux silences infinis, des discours déterminés aux doutes, en passant par le vide qui domine les zones proches des combats. Chaque personne exprime une tonalité particulière de ce bouleversement général. Chacun·e fabrique son chemin, comme iel le peut, face à cette guerre.
En septembre 2022, je retourne à Longo Maï. Là aussi tout a changé : la maison s’est vidée, un équilibre entre les activités liées à la guerre et celles de la ferme a été trouvé. À table, nous discutons de ces longs mois, de celles et ceux qui rentrent du front, de l’impact psychologique. Les étudiant·es sont à Lviv mais le foyer n’aura pas de chauffage cet hiver, iels reviendront à la ferme. Un refuge est en cours de construction et l’école — anciennement aménagée en dortoir d’accueil — a repris sa fonction initiale. Les déplacé·es logent chez des habitant·es. La famille d’Artem est quant à elle retournée dans son village de la région de Kyiv.
À mon retour en France, les médias parlent d’inflation, de pénurie d’essence, de rationnement énergétique mais on perçoit aussi l’inquiétude sous-jacente d’un conflit qu’on ne veut pas voir s’étendre, l’écho de la guerre, lointain mais audible.
Ce recueil de textes collectifs donne à entendre le début de la guerre en Ukraine et questionne notamment le rapport à la violence qu’elle induit. J’y ajoute des bribes de récits, des bouts de trajets, non pour y mettre un point final, mais pour tenter de les étirer comme des fragments d’histoires inachevées.
Photo de fin

Rendez-vous pour mettreen place une cantine.
Les auteurices remercient
-
Longo Maï, les fermes de Zeleni Haï en particulier et tous les gens avec qui iels ont partagé leur quotidien.
-
Sergï Kopchuk, qui en plus des actions menées ensemble, a fait office à la fois d’hôte, de guide, d’interprète et de sujet.
-
Toustes les Ukrainien·nes qu’iels ont croisé·es sur leur route et qui leur ont donné de leur temps et les ont accueilli·es. Un grand respect pour l’ouverture, l’enthousiasme et la détermination qu’iels ont trouvé sur place.
-
Vasyl, professeur de ramassage de fumier à Zeleni Haï, grâce à qui iels connaissent une bonne partie du nom des animaux de la ferme en ukrainien.
-
Les montagnes de Transcarpatie, les forêts majestueuses qui ont été d’un vrai réconfort lorsqu’iels sont revenu·es de zones sinistrées. Aux grands corbeaux sans qui les collines de Zeleni Haï n’auraient pas la même aura.
-
Les ami·es de Villeurbanne qui ont mis à disposition appartement et voiture à leur retour en France pour leur permettre de faire les démarches administratives de Marina en toute simplicité.
-
L’association Nddl poursuivre ensemble (association citoyenne du mouvement post-abandon de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nddl-poursuivre-ensemble.fr) pour leur soutien financier et leur éternel enthousiasme.
-
La Maison de la Halle de Verfeil pour son soutien financier.
-
L’association All Behind Ukraine de Rennes qui leur a fait confiance en remplissant leurs camions de dons sans poser de questions.
-
Toustes celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre ont soutenu le projet.
Colophon
Relecture par Mio Koivisto.
Photographies de Juliette Corne.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Bezdorijia, chroniques d'un voyage en Ukraine, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Woodstock Betulla Blanc 260 g/m², bouffant blanc 80 g/m² en 1 500 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en mars 2023 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-408-8.
Cette version a été composée par Burn~Août en Crimson text (Sebastian Kosch), Karmilla (Jonny Pinhorn, Raphaël Bastide, Manuel Schmalstieg et Nicolas Maravitti).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre.