
Table des matières
Vandalisme queer
Vandalisme queer est un recueil de trois textes de la philosophe et militante féministe et décolonniale Sara Ahmed. Ces trois textes, initialement publiés sur le blog de l’autrice, explorent la manière dont les modes d’existence queer peuvent être des stratégies de défense, de survie, de détournement ou même de retournement. L’écriture de Sara Ahmed est située, sensible, elle ancre la recherche théorique dans une expérience de l’intime à travers une analyse de l’affecte. Elle nous invite à observer et nous emparer du potentiel subversif de nos existences déviantes, étranges, obliques, queer.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 15/02/26 à 12 h 16.
- Origines des textes
- Choix de traduction
- Graphie des genres
- Préface des traducteur·ices
- La collective t4t - translators for transfeminism
- Vandalisme queer
- Usage Queer
- La plainte, méthode queer
- « Un homme important » (et autres histoires de reproduction)
- Conclusion : Non, et autres contes queers
- Références
Origines des textes
« Vandalisme queer » (2019) est un extrait de la conclusion de What’s the Use? On The Uses of Use [À quoi ça sert ? sur les usages de l’usage], paru chez Duke University Press. « Usage queer » (2017) et « La plainte, méthode queer » (2021) sont les textes de conférences données dans différents centres de recherche et espaces militants. Les trois textes sont disponibles gratuitement sur le blog de Sara Ahmed.
Au moment de publier « Usage queer », Ahmed précise combien il a été important pour elle de donner conférence dans des lieux dédiés aux études queers. Et elle ajoute :
Choix de traduction
En anglais, straight et queer sont des mots qui désignent à la fois des orientations sexuelles (« hétéras » vs. « déviantes ») et spatiales (« droites » vs. « pas droites »). Dans ses textes, Ahmed revendique souvent cette double signification, que nous signalons en redoublant parfois la traduction : straight est ainsi parfois traduit en « straight », « hétéro » et « droit » ; le verbe straightening par le néologisme « hétéroredresser » ; et queer tantôt en « queer », tantôt en « oblique ».
Graphie des genres
Pour les êtres au genre incertain ou distinctement non binaire dans l’original, nous mobilisons tantôt le féminin générique (elles), tantôt des formes épicènes (l’enfant, les partenaires, les féministes, les militanz, ol, uls), tantôt des agglutinations non binaires (i·els, læ philosophe, racisé·e, certainEs…) Certains féminins génériques et certaines agglutinations sont écrit·es grâce aux glyphes Baskervvol et Amiamie dessinés par la collective Bye Bye Binary. Certains épicènes sont empruntés à la grammaire du français inclusif d’Alpheratz.

Préface des traducteur·ices
« Où est Sara Ahmed ? » Une phrase, un hashtag, un slogan qui se recopie sur des murs, sur des affiches, sur des réseaux sociaux. À l’Université Goldsmiths de Londres, Ahmed enseigne les études féministes et les études critiques de la race. Après des années à lutter contre une épidémie de harcèlement sexuel, après des années à récolter les témoignages des étudiant·es agressé·es et à soutenir les plaignant·es, elle démissionne de son poste de professeure pour protester contre l’inaction de sa hiérarchie. « Où est Sara Ahmed ? » La formule remplit les murs de Goldsmiths et fait retentir une absence comme une affirmation : on se lève et on se casse, non ça ne va pas, non ça ne passera pas.
Une autre formule attachée au nom de Sara Ahmed, une formule dense et poétique, vient cette fois de l’un de ses textes : « La solidarité est un verbe. » La formule, mobilisée par la Bad Activist Collective pour décrire la solidarité avec la lutte décoloniale en Palestine, est accompagnée de cette définition :
La solidarité ne présuppose pas que nos luttes sont les mêmes luttes, ou que nos douleurs sont les mêmes douleurs, ou que nos espoirs sont les mêmes espoirs. La solidarité implique l’engagement et le travail, elle demande de reconnaître que même si nous n’avons pas les mêmes sentiments, ou les mêmes vies, ou les mêmes corps, nous vivons sur un sol communSara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion, Edinburgh University Press, 2004, p. 189 ; cf. également Haya Mahfouz, « Emma Watson Shares a Message in Solidarity With Palestine », Vogue, 4 janvier 2022..
Le travail de Sara Ahmed : tendre l’oreille, prendre note, écrire. Au fil de ses livres et des publications sur son blog (feministkilljoys.com), elle a développé une méthode unique d’analyse des situations d’oppression, dont elle décrit méticuleusement les ressorts, les vices de raisonnement et les habitudes fatiguées. Elle invente des personnages conceptuels, renomme des figures qui servent à nous décrire et que nous pouvons revendiquer : les rabat-joies féministes, les queers ennems du bonheur, les femmes Noires en colère, les migrant·es mélancoliques. Est-ce que toi aussi, il te suffit d’ouvrir la bouche pour qu’on lève les yeux au ciel ? À toi aussi, on a déjà dit : « mais enfin, je ne veux que ton bonheur ! » pour te faire comprendre que tes désirs n’étaient pas orientés vers les bons objets ? Toi aussi, personne ne t’écoute tant que tu ne hausses pas le ton et dès que tu hausses le ton, on te reproche d’être trop émotive ? Hé bien Sara Ahmed écrit pour toi, pour nous.
Elle nous donne des armes, sans pour autant piocher dans « les outils du maîtreAudre Lorde, « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître » (1979), in Sister Outsider. Essai et propos sur la poésie l’érotisme, le racisme, le sexisme…, traduit de l’anglais (États-Unis) par Magali C. Calise, Grazia Gonik, Marième Hélie-Lucas et Hélène Pour, Carouge, Mamamélis, 2020. » : ni accusation, ni punition, ni prison, ni jugement. Et il ne s’agit pas d’un combat à mener chacun·es dans notre coin. Ce dont il s’agit plutôt, c’est de constituer des collectives de pensée, de soutien et d’actions. Ainsi, ce qu’Ahmed nous donne, ce sont des voies pour nous reconnaître, nous retrouver, nous réunir et fomenter ensemble nos joies rabat-joies. On nous positionne comme des ennems du bonheur ? Hé bien peut-être devons-nous abandonner le projet d’être heureus. Ce qui ne signifie pas renoncer à la joie, mais plutôt reconnaître que trop souvent le bonheur en est une version tiède, diminuée, pré-mâchée et surtout porteuse d’impératifs normatifs. « Mais je veux seulement ton bonheur ! » : un mariage, des gosses, une carrière, une maison, un compte épargne, une participation au roman national. Et si, à la place du « sol mal assuré du bonheur normatifSara Ahmed, The Promise of Happiness, Duke University Press, p. 204, 2010. », nous faisions des difficultés que nous affrontons et des formes d’entraide que nous inventons, des terreaux d’un autre genre ?
Il se pourrait bien que ces stratégies par lesquelles nous créons des contre-mondes soient lues comme destructrices :
Ne pas s’aligner = détruire : voilà la formule qui interprète les existences queers comme vandales. Mais nous pouvons retourner cette interprétation, et faire du vandalisme une pratique volontaire : nos désirs sont jugés comme dommageables à la famille ? Hé bien, peut-être devons-nous donner dans la dégradationSara Ahmed, « Vandalisme queer », infra, p.18 !
Le retournement de l’insulte est une stratégie ancienne : « féministes », « queers », « pédales », « gouines », « Indigènes », « Noir·es », « estropié·es », des mots comme des cicatrices retournées en cris de ralliement. Dans toute son oeuvre, Ahmed poursuit ce travail en retournant non seulement les mots-stigmates, mais aussi les descriptions qui sont faites de nous. On t’accuse de vandalisme ? Hé bien peutêtre dois-tu apprendre à devenir læ vandale qu’on t’accuse d’être ! On dit que tu es un·e monstre ? Hé bien peut-être dois-tu apprendre à étudier les voies par lesquelles la monstruosité peut être synonyme d’une lutte pour la libération de tous·tes cell·eux qu’on désigne comme monstrueux·ses ? Dans sa Phénoménologie queer, Ahmed a détaillé avec finesse les mécanismes du redressement : comment l’insulte qui nous dit « déviant·es », « vandales », « monstrueux·ses », « communautaristes » a pour principale vocation de nous faire rentrer dans le droit chemin (le chemin du désir straight, le chemin de la blanchité, le chemin de la vie bonne, le chemin de l’individualisme). Mais que se passe-t-il si, dans tous ces termes, on s’aiguise au contraire à entendre des promesses ?
L’histoire du mot « vandale », par exemple, peut être lue comme un appel à la dissidence. Le terme apparaît dans la langue française à l’occasion de la Révolution de 1789, au moment où les classes bourgeoises « victorieuses » commencent à s’inquiéter des franges les plus radicales de la révolte populaire : voilà qu’elles se mettent à détruire les monuments de l’Ancien Régime ! C’est alors que l’abbé Grégoire, député de la Convention, forge le concept de « vandalisme » pour décrire ces mauvais révolutionnaires. Il construit le mot à partir de la figure du peuple Vandale, une tribu scandinave plus ou moins mythiquement fantasmée comme responsable d’une mise à sac de Rome en 455, et symbole de violence et de destruction de l’empire et de sa civilisation. Le mot de « vandalisme » est ainsi dès ses origines l’objet d’un trafic de signifiants où se mélangent des histoires de races (les Scandinaves contre les Latins) et de classes (la bourgeoisie contre les classes populaires). Quand on nous décrit comme vandales — parce que nous nous embrassons dans l’espace public, parce que nous aimons les mauvaises personnes, parce que nous occupons des postes traditionnellement occupés par d’autres (hommes, blancs, bourgeois) — ces histoires sont des armes qui nous permettent de dire : oui, nous nous dédions à la destruction des formes oppressives et non, nous ne nous laisserons pas redresser.
Ahmed répond, riposte, réplique. Cela, sans doute, n’aurait rien de remarquable si tant de personnes n’étaient pas rendues incapables de répondre quoi que ce soit. Nous absorbons les dégâts, nous vivons au milieu des malédictions ; mais Ahmed nous rassemble en écrivant et en n’écrivant pas seulement pour elle, mais pour les femmes, pour les personnes racisées, pour les opprimées, pour celle·ux pour qui le silence est devenu une sentence de mort. Elle nous dit ce qui s’est passé. Elle nous raconte une histoire. Elle la démonte, syllabe par syllabe. Elle expose le racisme, le sexisme, la haine, la structure grammaticale de l’oppression. Elle nous montre le fonctionnement de l’oppression, en nous parlant non seulement de la manière dont on en parle ou de la manière dont on l’efface en n’en parlant pas, mais aussi en nous montrant comment il est possible de ne pas l’accepter, de ne pas la tolérer, mais au contraire, de la retourner, de retourner les énoncés empoisonnés, de les inspecter, de les démonter, de les renvoyerJudith Butler, introduction à Sara Ahmed, « Queer Use », Kessler Lecture, Center for Lesbian and Gay Studies, 2017..
« Une affinité pour les marteauxSara Ahmed, « An affinity of hammers », Transgender Studies Quarterly, vol. 3.1-2, 2016. » : c’est ainsi qu’Ahmed désigne l’art de répondre aux accusations, l’art de parler des armes qu’on utilise pour nous attaquer, l’art d’en rire entre nous, l’art de les retourner en outils pour se construire. Avec et pour soutenir cet effort, Ahmed propose une critique unique des « politiques de la diversité », cet optimisme institutionnel qui célèbre sa propre inclusivité sur le papier tout en continuant à produire les mêmes effets d’exclusion. Refuser les inclusions incapacitantes, démissionner, porter plainte : des gestes de dissidence discrète, ordinaire et que l’institution (l’université, le centre d’art, l’entreprise, l’administration) s’ingénie quotidiennement à récupérer. Ces gestes ne fonctionnent que parce que nous nous y mettons en nombre. Le débordement, la fuite, l’excès : des figures qu’Ahmed sollicite pour penser ce qui ne peut être contenu. Les trois textes rassemblés dans ce livre sont construits autour d’un même mot-marteau : queer. Queer, un mot avec une histoire qu’Ahmed s’évertue à réveiller. Sous les usages contemporains et sous l’intégration normative à la séquence l.g.b.t.q.+ où queer devient une identité à inclure parmi d’autres, Ahmed fait surgir dans queer une force de désidentification. Queer, du bas-allemand qver, oblique, pas droit, pas à sa place : un signe accolé aux choses faibles, branlantes, branques (comme la voix éraillée d’une vieille dame ou d’un piano désaccordé) ; une marque de bizarrerie, d’étrangeté, d’inadéquation (comme une idée saugrenue ou un château hanté) ; et pour finir, une insulte accolée aux existences qui dévient des normes de genre ou de sexualité. Qu’apprend-on des systèmes et des mondes qui font de nous des vandales ? Qu’obtient-on à suivre les pistes suggérées par nos trajectoires obliques ? Autant de questions que soulèvent ces textes-manifestes.
La collective t4t - translators for transfeminism
« Nous », des traducteur·ices pour des textes transféministes, écrivons depuis des expériences diffractées, trans, non-binaires, fèm, masc, Noir·es, blanc·hes, afropéen·nes, français·ses, (post-)colonial·es, Fou·lles, neurodivergent·es, travailleur·euses de l’art, pédagogues, démissionnaires, chômeur·euses, humain·es, mammifères, lesbien·nes, féministes, queers. Ces mots dessinent les contours d’une multiplicité dont le transféminisme rabat-joie de Sara Ahmed nous apprend à tirer nos forces.
Vandalisme queer
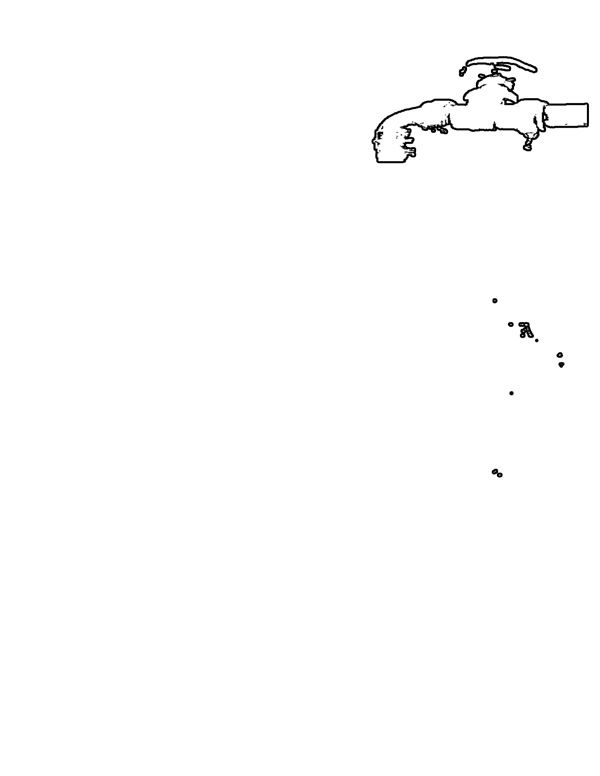
Lorsque nous réveillons les potentiels d’une matière, lorsque nous refusons d’utiliser les choses de la bonne manière, il y a de fortes chances pour que nos actions soient considérées non seulement comme des dégradations, mais encore comme des dégradations intentionnelles. L’usage queer des choses, leur usage oblique ou détourné, peut ainsi être interprété comme une forme de vandalisme, une « destruction volontaire du vénérable et du beau ».
La famille nucléaire est parfois considérée comme une source de respectabilité et de beauté. Dans The Promise of Happiness [La Promesse du bonheur] (2010), j’ai exploré la manière dont l’image de la famille est maintenue par une activité permanente de polissage : au sein de la famille, un important travail de maintien des apparences et de sourires forcés s’emploie à masquer tout ce qui ne correspond pas à l’image du bonheur. Ce travail de polissage s’assimile à un dispositif d’hétéroredressement : en cherchant à polir l’image de la famille, en cherchant à éliminer les taches et les aspérités, on élimine parfois du même coup les traces des existences queers. Quand nos désirs sont interprétés comme dommageables, il n’y a qu’un pas pour en faire des actes de défiance : comme si nous étions activement à la recherche de stratégies pour gâcher la belle image de la famille, ou comme si notre intention était de rabaisser les valeurs familiales en n’y adhérant pas. Ne pas s’aligner sur la famille revient ainsi à vouloir la briser. Queer, clac, clac : sous prétexte qu’i·els ne suivent pas les pointillés des lignes familiales, on en vient à penser que les queers veulent tailler la famille en pièce. Ne pas s’aligner = détruire : voilà la formule qui interprète les existences queers comme destructrices. Mais nous pouvons retourner cette interprétation et faire de la destruction une pratique volontaire : nos désirs sont jugés comme dommageables à la famille ? Hé bien, peut-être devons-nous donner dans la dégradation ! Peut-être devons-nous nous donner pour mission de détruire la famille nucléaire et le mariage, puisque telle semble être la condition pour vivre nos vies de manière oblique.
Certaines personnes pensent que l’extension du mariage aux gays et aux lesbiennes suffit à détruire le mariage : le mariage gay serait déjà la destruction du mariage comme institution sacrée ; il serait déjà, en lui-même, un vandalisme queer. Je trouve cette affirmation bien trop optimiste : les queers, les gays et les lesbiennes, ont besoin de faire bien plus que se marier entre elle·ux pour détruire l’institution du mariage. De fait, les politiques queers vont plus loin, en cela, elles s’inscrivent notamment dans la lignée de la deuxième vague du féminisme qui s’était fixé pour tâche de détruire l’institution de la famille nucléaire. On peut penser notamment à La Dialectique du sexe de Shulamith Firestone (1970) qui repose sur l’invitation à détruire toutes les institutions (et notamment la famille) qui promettent le bonheur au prix d’une vision étriquée de la vie « bonne ». Étant donné la manière dont la famille est occupée, il nous appartient peut-être de la squatter : squatter la famille, entrer illégalement dans le bâtiment et l’habiter différemment — traînasser, nous y attarder, nous y perdre.
Il arrive qu’on utilise le mot famille pour décrire nos alliances queers. Voilà un usage queer des mots : les réutiliser et leur donner un sens nouveau. Je pense à la manière dont Susan Stryker (1993 [2020]) décrit ce qui est devenu possible pour la « famille queer » qu’elle et sa compagne ont commencé à construire à la naissance de leur enfant. Elle écrit : « C’était entre nous une sorte de blague. Nous nous disions que nous étions des “pionnières à l’envers” : parties à l’aventure au coeur de la civilisation elle-même, nous revendiquions le droit à la reproduction biologique contre sa capture hétérosexiste, nous cherchions à la libérer de ses usages. » Elle ajoute : « Nous étions féroces ; dans un monde de “valeurs familiales traditionnelles”, nous n’avions pas le choix. » Quand les choses sont utilisées par celle·ux auxquelles elles n’étaient pas destinées, l’effet peut être queer. On peut en faire des blagues. Ces blagues sur les effets queers de nos usages ne sont pas sans lien avec la rage qui nous anime contre la machine de la famille qui considère nos enfants comme déviant·es, voire monstrueux·ses. Et cette rage peut être transformatrice. Comme le dit Stryker : « Par l’opération de la rage, le stigmate lui-même devient une source de pouvoir transformateur. » Cela demande un certain travail de revendiquer la reproduction biologique « pour nos propres usages », réoccuper la famille, rendre le familier étrange. De même, cela demande un certain travail d’organiser nos corps autrement et de nous organiser entre nous autrement. Stryker nous livre l’histoire de ses propres réorganisations. Elle nous apprend à donner une nouvelle figure à la manière dont les corps transgenres s’incarnent : une affinité avec les monstres, avec les personnes qui ont été considérées comme monstrueuses — une réponse à Frankenstein forgée dans la rage. L’usage oblique, l’usage queer : quand nous cherchons à briser ce qui tente de nous contenir.
Pour te frayer un chemin dans des institutions qui ont cherché à te contenir ou à t’exclure, il te faut en inquiéter l’usage, le mettre en crise ; il te faut interrompre les habitudes ; et les habitudes, ce sont parfois des personnes qui ont tendance à apparaître à certains endroits et non à d’autres. Il se peut qu’il nous faille occuper la famille en réarrangeant nos corps. Il se peut qu’il nous faille occuper un bâtiment ou une rue, qu’il nous faille en troubler l’usage ordinaire, qu’il nous faille nous mettre en travers de la manière dont cet espace est habituellement utilisé (destiné à telles fins ou telles personnes). La manifestation implique souvent le blocage. Il se peut qu’on ait besoin de mettre nos corps en travers d’une porte. Manifester, c’est accepter de créer une obstruction. Bien sûr, parfois il suffit d’exister, ou de questionner des existences, pour créer de telles obstructions. Nous avons beaucoup à apprendre de la manière dont notre travail politique implique de troubler les usages. Des usages qui invisibilisent certaines choses, une injustice, une violence. Pour rendre la violence visible, il est parfois nécessaire de « faire une scène » : d’interrompre les activités habituelles ; de bloquer la circulation ; de mettre un pied dans la porte ou d’empêcher certaines personnes de passer.
Parfois, nous perturbons l’usage pour attirer l’attention sur une cause que nous défendons. Parfois, inversement, c’est l’interruption d’un usage qui nous enseigne les causes pour lesquelles nous nous battons. Ainsi, quand tu fais usage d’un bâtiment inoccupé, tu deviens « une squatteuse ». Il se peut que tu ne cherches pas à créer une perturbation : il se peut que tu ne squattes que parce que tu as besoin d’un abri. Mais ce faisant, tu refuses en même temps une instruction, tout un manuel d’instructions qui te disent qui peut entrer légitimement et comment. Entrer dans une maison vide sans permission, tu le réalises alors, c’est faire une déclaration : c’est déclarer que le droit de propriété ne justifie pas qu’une maison reste vide. Tu montres ainsi que la propriété n’est pas seulement un droit d’utilisation, mais aussi un droit de non-utilisation ; que la propriété, c’est un droit d’occuper non seulement le présent, mais aussi le futur. Lorsque tu refuses les maisons vides, lorsque tu ne leur accordes pas de légitimité, tu crées une perturbation.
Un squat peut faire partie d’une manifestation politique. Tu te retrouves peut-être à entrer dans un bâtiment inoccupé pour attirer l’attention sur ta cause. En 2017, les Sisters Uncut (un groupe d’action directe féministe) ont occupé la prison de Holloway pour « exiger que l’espace vide soit utilisé pour soutenir les survivantes des violences domestiques. » Occuper un bâtiment est parfois le seul moyen d’exiger qu’il soit utilisé pour soutenir celle·ux qui ne reçoivent aucun soutien. Nous avons beaucoup à apprendre de la manière dont les stratégies de survie et les stratégies de manifestation peuvent parfois faire cause commune. Si tu as besoin d’occuper un bâtiment pour survivre, pour avoir un refuge où échapper à la violence de ta maison, à la violence domestique, alors il y a des chances pour que l’occupation ellemême devienne un projet politique : tu vas à l’encontre de la violence d’un système en la révélant.
Squatter peut aussi consister à occuper des espaces vacants d’une manière différente : investir, par exemple, les espaces laissés en jachère par la famille blanche bourgeoise, questionner les normes d’usage pour chaque pièce, ce que les corps peuvent faire en relation les uns aux autres (ce à quoi sert la chambre, ce à quoi sert la cuisine). Squatter, c’est faire usage d’un espace sans le posséder, c’est se demander, c’est redemander, à quoi il sert, c’est ne plus se sentir obligé·es d’utiliser chacune des pièces d’un bâtiment selon une règle prédéterminée. Ainsi les queers peuvent-i·els devenir les squatteur·euses de la famille : même si nous n’avons pas les clefs pour entrer, nous pouvons enfoncer la porte en combinant nos forces. Un usage queer : en recyclant les mots et leurs usages pour décrire ce que nous faisons quand nous nous rassemblons, nous élargissons leurs sens. Comme Erica Doucette et MartyHuber le remarquent : « l’éventail des usages pour les bâtiments squattés est souvent bien plus large que la seule création de lieux de vie. Ces projetslient réalités matérielles et utopies ; et c’est ainsi qu’un élément crucial de nombreux projets d’habitats queers et féministes est qu’ils sont souvent à la fois financièrement accessibles et politiquement engagés. » (2008) Un élargissement des usages est nécessaire étant donné les restrictions qui leur sont imposées. Les expérimentations avec les modes d’habitation sont un projet de transformation queer des usages : un changement dans la manière dont nous occupons l’espace ; un changement qui affecte autant les personnes que les lieux.
L’usage queer nous donne par ailleurs une autre manière de parler du travail de la diversité : le travail que tu dois mener pour ouvrir les institutions à celle·ux pour qui elles n’ont pas été conçues. Puisque la valeur des choses tend souvent à dépendre de la restriction de leur accès, il suffit parfois de tenter d’ouvrir cet accès pour être considéré·es comme nuisibles ou dommageables. Je pense à la façon dont, lorsqu’un plus grand nombre d’entre nous obtient des postes à l’université, nous sommes utilisé·es comme une preuve de la diminution de la qualité de l’université. Étant donné la manière dont les institutions sont fermées — et souvent se maintiennent fermées en se donnant les apparences d’être ouvertes --, ouvrir les institutions n’est pas une tâche qui peut s’accomplir par une action unique. Dans What’s the Use? (2019), j’ai tenté d’expliquer comment c’est au travers d’actes apparemment anodins que les possibilités en viennent à se restreindre ; comment les histoires deviennent concrètes, plus denses et plus dures, se transformant en murs. Ma tâche a donc été d’épaissir encore et encore ma compréhension de l’usage, d’en faire quelque chose de plus lourd et de plus dur ; de montrer la manière dont des histoires peuvent occuper des bâtiments, peuvent interrompre la possibilité même d’utiliser certains espaces, y compris quand ils sont vides ou déclarés disponibles.
Il y a tant de choses qui sont reproduites par l’imposition d’une marche à suivre. Dans What’s the Use? je parle notamment de la manière dont on nous demande de suivre les sentiers battus de la citation ; et comment bien citer, dans un tel cas, c’est citer celle·ux qui exercent le plus d’influence. Si nous souhaitons façonner des savoirs nouveaux, il nous faut probablement apprendre à citer différemment ; la citation devient notre résistance à l’effacement. On peut considérer les oeuvres d’universitaires féministes Noires et autochtones telles que Zoe Todd (2016) et Alexis Pauline Gumbs (2016) qui ont montré comment il est possible d’inventer des formes différentes de savoir en refusant de suivre ces voies citationnelles éculées. Dans Vivre une vie féministe (2017), je me suis engagée dans une pratique de la citation tranchante : je ne citais aucun homme blanc. Ici, je n’ai pas réussi à m’y tenir : en suivant le concept d’usage, j’ai été obligée de m’engager dans une histoire de l’utilitarisme, qui est une histoire de livres écrits principalement par des hommes blancs morts. Même en étant critique de cette tradition, je l’ai maintenue vivante en la ré/utilisant et me la réappropriant. Ma réutilisation était toujours une utilisation, et voilà comment je me suis faite avoir ! Mais si j’ai utilisé leurs noms, ce n’est pas à eux que j’ai écrit, ce n’est pas pour eux que j’ai écrit. J’écris à et pour celle·ux dont les noms sont absents, dont les noms sont inconnus, dont les noms ne peuvent être utilisés, celle·ux qu’on perçoit à peine, qui s’effacent, qu’on efface. Une occupation peut être garantie par l’imposition d’une marche à suivre, d’un sentier battu. Parler de la blanchité à l’université ou du colonialisme comme contexte de production de la philosophie des Lumières, c’est porter avec soi le scandale du vandalisme. Le projet de décoloniser des programmes a été considéré comme un acte vandale, une destruction volontaire de nos universaux ; la décapitation des statues, la destruction des trônes sur lesquels siègent les philosophes-rois. Dans What’s the Use?, je parle de la manière dont l’eugénisme continue de recevoir une place institutionnelle au travers des noms donnés aux bâtiments, amphithéâtres et chaires, baptisé·es en hommage à des eugénistes, comme Francis Galton au University College de Londres (UCL). En 2014, à l’occasion d’une discussion collective intitulée « Why Isn’t My Professor Black? » [Pourquoi est-ce que je n’ai pas de professeur·e Noir·e ?], cette utilisation du nom de Francis Galton a notamment été justifiée comme un héritage. À la suite de quoi, de nombreuses discussions se sont tenues sur l’héritage de Galton, discussions qui ont été rapportées au grand public sous la forme d’un slogan, « Galton Must Fall » [Il faut abattre Galton]. J’aurais sans doute soutenu une telle campagne si elle avait eu lieu, mais le fait est qu’elle n’a jamais existé ; elle a été créée de toutes pièces afin de discréditer l’idée même d’interroger l’héritage, ainsi présentée comme un « vandalisme culturel ». Quand il a été montré aux journaux que cette campagne n’avait jamais eu lieu, ceux-ci ont certes publié de menues corrections pour clarifier les choses, disant que même si une telle campagne n’a jamais existé, « ce n’est qu’une question de temps » ; ce qui apparaît très clairement cependant, c’est le fonctionnement du discrédit. Si tu veux discréditer la remise en question d’un héritage, il te suffit de discréditer celle·ux qui se posent des questions. Le simple fait de poser une question, ou d’évoquer la possibilité de remettre une histoire en question, est jugé comme un acte de vandalisme.
Un jugement peut être transformé en projet. Si la remise en cause d’un héritage est perçue comme une tentative de dégradation, cela veut peut-être dire qu’il nous faut donner dans la dégradation. Une plainte peut aussi très bien être traitée comme une dégradation (potentielle) de l’institution. Ces dernières années, j’ai dédié une longue étude de terrain au mécanisme de la plainte. Cette étude était inspirée par mes propres traversées de différentes enquêtes au sujet de cas de harcèlements et d’agressions sexuelles, ce qui revient à dire que ce projet était inspiré par mes étudianz. Après trois années à tenter de mener ces plaintes à leur terme, après trois années à faire face à des murs, j’ai finalement démissionné. J’ai démissionné parce que j’en avais eu assez et parce que je ne voulais plus me taire sur ce qui s’était passé. La démission est une autre manière de dire non au système ; tu lui soustrais ton travail, ton corps, toi-même. Le mot démission peut suggérer le renoncement, la résignation voire la réconciliation avec un destin. J’entends le mot démission et j’entends un long soupir qui pourrait aussi bien dire, après tout, à quoi ça sert ? Mais la démission peut aussi être la manière de refuser de se résigner à une situation. Peut-être qu’au moment où tu abandonnes quelque chose, la croyance selon laquelle il est possible de faire ton travail ici, tu t’accroches à une autre chose, ta conviction dans la nécessité de ce travail. Tu as peut-être l’air de démissionner, mais en réalité, tu te refuses simplement à céder.
J’ai démissionné en partie en raison du silence qui entourait ce qui se passait. Pour que l’information sorte, parfois, il faut que tu sortes toi aussi. Cela n’a pas de sens de continuer à se taire si tu démissionnes pour contester un silence. Quand j’ai rendu publiques les raisons de ma démission, on a commencé à m’accuser de causer des dégâts. Prendre la parole, c’est souvent devenir le tuyau percé de l’institution : ploc, ploc.
Et les institutions feront de leur mieux pour contenir la fuite. Les relations publiques font cela : elles tentent de limiter les dégâts, de réparer la blessure faite à la réputation de l’institution. C’est souvent ainsi que le travail de la diversité fonctionne : une stratégie pour limiter les dégâts. Des programmes flambants neufs seront mis en place ; le bonheur sera promis ; les trous seront bouchés sans laisser aucune trace de ce qui s’est produit. Des bouts de papiers seront signés et employés comme cachemisère : la paperasse utilisée par les institutions sert souvent de papier peint pour camoufler les fissures et les fuites. Les institutions produisent beaucoup de papier pour prouver qu’elles ont fait quelque chose. Or, créer des preuves qu’on a fait quelque chose n’est pas la même chose que faire quelque chose.
Mais il y a de l’espoir, ici. Les institutions ne peuvent pas tout nettoyer derrière nous. Un tuyau percé peut mener à un autre ; il peut le faire et il le fait. Il suffit parfois de desserrer un écrou, un petit peu, juste un tout petit peu, pour que l’explosion ait lieu. Et nous avons besoin de plus d’explosions. Les usages queers, les usages obliques, décrivent ce potentiel d’explosion. Ils décrivent la manière dont les petites déviations, les petits desserrements, la création d’une issue de secours, l’ouverture d’une échappée, peuvent aider à multiplier toutes sortes de fuites et de sorties.
Références
« Why Isn’t My Professor Black? », University College de Londres, Discussion collective, 21 mars 2014.
Ahmed, Sara. Vivre une vie féministe, (2017), traduit de l’anglais (Royaume- Uni) par Sophie Chisogne, Marseille, Hors d’atteinte, 2024.
Firestone, Shulamith. La dialectique du sexe : le dossier de la révolution féministe, (1970), traduit de l’anglais (États-Unis) par Sylvia Gleadow, Paris, Stock, 1972.
Gumbs, Alexis Pauline. Spill: Scenes of Black Feminist Fugitivity, Durham, Duke University Press, 2016.
Sisters Uncut. “Feminists occupy Holloway Prison to demand more domestic violence services”, sistersuncut.org, 27 mai 2017.
Usage Queer

J’aimerais commencer ces considérations sur l’usage queer en envisageant les usages de queer. Queer : un mot qui a une histoire ; un mot qu’on a jeté, comme une pierre ; qu’on a ramassé et qui nous a été lancé à la figure ; un mot que nous pouvons reprendre. Queer : bizarre, étrange, improbable, dérangé·e, dérangeant·e. Queer : un sentiment, le sentiment d’être malade ; feeling queer, « avoir la nausée ».
Dans des usages anciens de queer, où le mot était utilisé pour décrire toute chose remarquable en raison de son étrangeté, queer et fragilité se tenaient souvent compagnie. Dans un essai de George Eliot, « Trois mois à Weimar », le narrateur décrit le son d’un vieux piano en parlant de « ses tonalités, aujourd’hui aussi étranges (queer) et aussi faibles que celles d’une vieille femme invalide dont la voix pouvait jadis embraser votre coeur d’une tendre passion » (1884, 91-2). Faible, frêle, invalide, incapable, défaillant·e, malingre, larmoyant·e, éraillé·e, éreinté·e, usé·e ; et queer aussi, queer est là aussi. Ces proximités racontent une histoire. Une vie queer est peut-être une vie où nous sommes au contact des choses au point où elles sont, où nous sommes abîmées, éreintées ; ces moments où nous cassons, où nous nous brisons, quand nous tombons en morceaux sous le poids de l’histoire. Les sons d’un vieux piano évoquant le son d’une vieille femme invalide : cette évocation peut-elle vibrer d’affection ? Un coeur peut-il battre avec passion pour cela qui vacille et qui tremble ?
Que certain·es d’entre nous puissions vivre nos vies en endossant queer, en disant « oui » à ce mot, montre comment un ancien usage n’épuise ni le mot, ni la chose à laquelle il renvoie, aussi épuisés soient-ils l’un comme l’autre. Comme Judith Butler le remarque dans Le Pouvoir des mots : « Mettre en scène esthétiquement un mot injurieux peut impliquer à la fois d'utiliser le mot et de le mentionner, c’est-à-dire de l’utiliser pour produire certains effets tout en faisant référence à cet usage lui-même : ainsi, on attire l’attention sur le fait que le terme est cité et que cet usage s’inscrit dans un héritage citationnel, on fait de cet usage un objet discursif explicite qui doit faire l’objet d’une réflexion et non plus être considéré comme relevant du fonctionnement naturel du langage ordinaire. » ([1997] 2017, 152) Nous pouvons interrompre la signification d’une insulte en faisant entendre son usage comme une histoire qui ne saurait décider, une fois pour toutes, ce que ce mot peut faire. Faire un usage queer peut consister à faire entendre l’usage, à l’écouter ; à faire entrer au-devant de la scène ce qui d’ordinaire recule à l’arrière-plan.
Parfois, les mots sont réutilisés comme s’il était possible de les couper de leur histoire. Quand une insulte est lancée par exemple et qu’elle atteint sa cible tout en prétendant n’être qu’une taquinerie, comme si c’était quelque chose de léger. Si nous réutilisons le mot queer, nous le faisons en gardant son poids à l’esprit ; les valises qu’il traîne derrière lui. Eve Sedgwick suggère que ce qui donne à queer sa puissance politique, c’est la manière dont il s’attache à « des scènes d’humiliation qui remontent à l’enfance » (1993, 4). Queer tire sa force et sa vitalité du fait que nous refusons justement de prendre l’histoire à la légère. Recycler ou réutiliser un mot, c’est réorienter notre relation à une scène qui occupe une place, un souvenir, un contenant, aussi percé soit-il.
Queer : réutilisé. La réutilisation comme utilisation queer. Dans cette conférence, je vais m’appuyer sur des arguments tirés d’un livre que je viens de terminer, What’s the Use? [À quoi ça sert ?]. Dans ce livre, je suis l’usage à la trace, un peu à la manière dont je me suis mise à suivre le bonheur dans The Promise of Happiness [La Promesse du bonheur] et la volonté et l’obstination dans Willful Subjects [Sujets obstinés]. Le mot usage est un bien petit mot, mais il a une longue histoire. C’est un mot très occupé, qui a eu et continue d’avoir de nombreux usages. Suivre l’usage m’a permis de me connecter à des corpus qui sont généralement tenus pour distincts : le design, la psychologie, la biologie, qui font usage de l’usage pour expliquer l’acquisition de formes. Suivre l’usage m’a ainsi permis d’explorer la manière dont les mondes prennent forme, en un certain sens, de bas en haut.
Usages de l’usage
Dans cette section, j’aimerais méditer sur l’usage en tant que biographie, en tant que manière de raconter l’histoire des choses. Le verbe utiliser peut signifier : employer à certaines fins, dépenser ou consommer ; traiter quelque chose ou se comporter envers quelque chose d’une certaine manière ; exploiter ou tirer un avantage injuste de quelque chose ; s’habituer ou s’accoutumer à quelque chose. L’usage est une relation en même temps qu’une activité, qui pointe souvent au-delà de la chose utilisée, même quand l’usage porte spécifiquement sur telle ou telle chose : utiliser quelque chose renvoie à ce « pour quoi » la chose est utilisée. Certains objets sont faits en vue de leur utilisation. On pourrait désigner ces objets comme des objets du design. L’usage pour lequel ils sont produits est ce qui les amène à exister. Une tasse est faite afin que je dispose d’un contenant pour boire ; elle tient sa forme de ce but, avec son trou au milieu, son vide prêt à être rempli par un liquide. On pourrait résumer la relation impliquée dans ces objets en disant que « le pour quoi d’une chose vient avant cette chose (for is before) ». Cela dit, même si quelque chose tient sa forme de sa fonction, ce n’est pas nécessairement la fin de son histoire. Comme Howard Risatti le remarque dans sa Theory of Craft [Théorie de l’artisanat] :
L’usage ne correspond pas à la fonction visée. La plupart des objets, si ce n’est tous les objets, peuvent avoir un usage, ou plus exactement peuvent être rendus utilisables en étant utilisés. Un marteau peut être utilisé pour clouer, mais aussi comme presse-papier ou comme levier. Une scie à main peut couper une planche, mais elle peut aussi être utilisée comme une règle, ou pour faire de la musique. Une chaise peut être utilisée pour s’asseoir ou pour garder une porte ouverte. Ces usages en font des « objets utiles », mais puisqu’ils ne sont pas liés au but et à la fonction qui étaient visés lors de la conception de ces objets, la connaissance que nous procure ces usages ne nous apprend pas nécessairement grand chose de ces objets.
L’usage peut correspondre à la fonction visée, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Ce « n’est pas » (pas nécessairement) nous ouvre une porte. Ces usages, contrairement à ce que dit Risatti (« la connaissance que nous procure ces usages ne nous révèle pas nécessairement grand-chose de ces objets »), pourraient bien être révélateurs. Certaines qualités du marteau ne sont-elles pas révélées du fait qu’il puisse servir de presse-papier ? Qu’un marteau puisse être utilisé comme presse-papier me dit en effet quelque chose de son poids. Rien ne peut être utilisé pour tout : cela implique que l’usage est une restriction matérielle des possibilités. Toutefois, il y a quelque chose de queer dans l’usage ; les intentions n’épuisent pas les possibilités. Les clefs qui servent à ouvrir une porte peuvent être utilisées comme jouet, peut-être parce qu’elles brillent de couleurs argentées ; peut-être pour le son de leur cliquetis. Des usages queers, des usages obliques : même quand les choses sont utilisées pour des buts différents de ceux initialement visés, les qualités et propriétés des choses ne sont pas perdues ; il se peut même au contraire que ces usages s’attardent à ces qualités, les rendant plus vivantes.
L’usage queer peut aussi être compris comme usage impropre : l’usage queer comme perversion. Le mot perversion peut renvoyer non seulement à ce qui dévie de ce qui est vrai ou juste, mais aussi à l’usage impropre de quelque chose. On ne qualifie pas de pervers·e l’enfant qui se sert des clefs comme d’un jouet, même si ce n’est pas pour cela que les clefs sont faites. En effet, tout le monde s’attend à ce que l’enfant joue avec les choses. Mais un petit garçon qui joue avec le mauvais jouet, par exemple un aspirateur miniature destiné à une petite fille (le fait que les aspirateurs miniatures existent aurait bien sûr déjà de quoi nous inquiéter), peut être lu comme perverti ou du moins sur le chemin de la perversion. Corriger l’usage que fait le petit garçon du jouet, c’est corriger plus qu’un comportement à l’égard d’un jouet ; c’est corriger la manière dont le petit garçon est un petit garçon. La figure de la personne perverse surgit comme une figure où le mésusage des choses agit comme une forme d’auto-révélation.
Notons aussi que dans cette citation, Rissati défend l’idée que c’est l’usage qui rend une chose utilisable. Cet argument signifie que ce qui est possible advient de ce qui a été réalisé, et non l’inverse, comme on le décrit habituellement. L’usage semble avoir une étrange temporalité. L’usage est aussi ce qui rend une chose utilisée : l’usage use. Quand nous pensons à une chose qui a déjà servi, nous pensons peut-être aux objets « de seconde main ». Comme le livre ci-dessous, un livre qui parle justement de mains et que j’avais sous la main. Un livre usagé devient un livre d’occasion, généralement moins cher qu’un livre neuf. Plus il a de traces d’utilisation, moins il a de valeur, à moins que l’utilisateur·ice précédent·e soit estimé·e, auquel cas la valeur de la personne peut se transmettre à la valeur de la chose. Karl Marx discute de l’usure matérielle des machines dans Le Capital : « L’usure matérielle des machines se présente sous un double aspect. Elles s’usent d’une part en raison de leur emploi, comme les pièces de monnaie par la circulation, d’autre part par leur inaction, comme une épée se rouille dans le fourreau. » ([1867], livre I, ch. XV, §3) Marx montre comment les machines intensifient plutôt qu’elles n’économisent le travail : il faut tirer le maximum de la machine avant qu’elle ne s’use, une usure qui se transmet aux travailleuz, qui se transmet et qui accable ; des travailleuz utilisé·es et usé·es.
L’usure dans cette économie est la perte de valeur déterminée par l’extraction de la valeur. Donner de la valeur à l’usage pourrait bien exiger de changer nos valeurs. Nous donnons peut-être de la valeur aux vêtements rapiécés ou aux objets fêlés en raison des vies qu’ils ont vécues, parce qu’ils nous montrent ce qu’ils savent : la griffure comme pédagogie, la ride comme expression. Donner de la valeur à l’usage, ce n’est pas romantiser ce qui est préservé en tant qu’archive historique : les signes de vie peuvent être des signes d’épuisement, c’est-à-dire que les signes de vie peuvent être les signes d’une vie qui a été éreintée. Peut-être pouvons-nous penser l’usage comme une archive de la fragilité d’une vie. Au cours de mon écriture sur l’usage, j’ai ainsi délibérément utilisé des « livres usagés ».
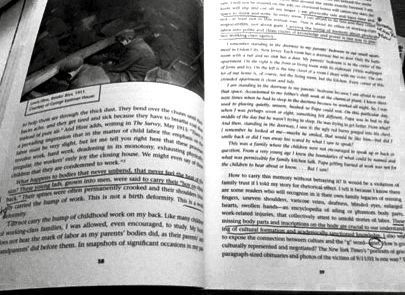
Avec ce livre dans mes mains, je peux dire que d’autres ont été là avant moi. Je pense à læ lecteur·ice qui a entouré le mot grief, « le deuil, la peine, le chagrin ». Je ne peux pas remonter jusqu’à toi, mais tu as laissé une trace.
Une chose peut être dite en cours d’utilisation ou bien hors d’usage. Quand quelque chose se casse, il peut arriver qu’on la retire de la circulation, comme une tasse cassée qui aurait perdu sa poignée.

Quand on pense à quelque chose en cours d’utilisation, on peut penser à un signe sur une porte : « occupé » .

Il nous dit que nous ne pouvons pas utiliser les toilettes tant que la personne qui les utilise n’a pas fini. L’usage nous arrive souvent sous la forme d’instructions concernant les distances corporelles et sociales acceptables. Parfois, les instructions servent à désigner les personnes autorisées à utiliser telle ou telle chose et dans quel but. Prenez cette image.

Il affirme que la porte du garage est constamment utilisée afin de justifier une instruction : n’approchez pas ! Si tu gares ta voiture ou ton vélo en face de la porte, gare à toi : tu deviens une obstruction. Devenir une obstruction, voilà le destin qui attend certains usages et certain·es usagèr·es.

Si les toilettes étaient occupées parce qu’elles étaient en cours d’utilisation, la boîte aux lettres est maintenant hors d’usage parce qu’elle est occupée. Même si bien sûr, d’un autre point de vue, elle est en cours d’utilisation. La boîte aux lettres sert de nid à des oiseaux. Si la fonctionnalité visée est non seulement ce pour quoi une chose est faite, mais aussi celle·ux pour qui elle est faite, alors il peut arriver que cette chose se retrouve utilisée par celle·ux pour qui elle n’a pas été faite. L’usage queer, l’usage oblique : quand une chose est utilisée par des êtres pour qui elle n’a pas été faite.
Puis-je ajouter ici que ce n’est qu’au moment d’écrire la conclusion du livre que j’ai réalisé que d’autres avaient utilisé « l’usage queer » de cette manière ; notamment dans un article daté de 1899 où l’on parle de l’usage queer d’un cloître [recyclé, par la paroisse, en garage pour cycles]. De quoi se demander si l’usage queer d’un cloître pourrait s’étendre au-delà de la fonction de ranger des machines.
Si nous revenons à la boîte aux lettres qui devient nid, on peut remarquer comment cet usage nous informe sur la nature de l’objet ; ce qui permet à cette boîte d’être utilisée pour poster des lettres, la fente, est ce qui permet aux oiseaux d’entrer. Si un changement de fonction ne requiert pas un changement de forme, un changement de fonction requiert cependant une pancarte, « ne pas utiliser », pour interrompre l’action usuelle : poster une lettre. La pancarte, suppose-t-on, est temporaire. La boîte redeviendra utilisable en tant que boîte aux lettres quand elle cessera d’être un nid.
Redevenir utilisable, reprendre du service : l’usage est susceptible d’allés et venues. Prenons l’exemple du sentier battu. Le sentier existe parce que des personnes l’ont utilisé. L’usage implique le contact et la friction ; le passage des pieds lisse la surface ; le chemin devient plus lisse, plus facile à suivre.

Comme il est étrange que cette phrase ait du sens. S’il n’est pas utilisé, un chemin peut disparaître ; la végétation se densifie, le sol devient inégal ; inutilisable.

L’usage peut être nécessaire à la préservation. « Utilise-le ou perd-le » : ce n’est pas simplement un mantra de développement personnel ; c’est une philosophie de vie. Ne pas utiliser ; ne pas être.
Si ne pas utiliser signifie ne pas être, l’usage peut être utile en tant que technique. Tu peux faire en sorte que quelque chose cesse d’exister en la rendant difficile à utiliser. L’utilisation peut aussi servir de cadre de pensée : un bloc-notes peut paraître inutilisé si les marques de crayons ont été effacées. Les cadres pour penser l’usage peuvent servir bien des projets.
Par exemple, de nombreux usages de la terre n’ont pas été nommés en tant qu’usages par la culture occidentale car elle ne considérait la terre que dans sa fonction agricole. La théorie selon laquelle la propriété est obtenue par le travail est en ce sens une théorie de l’usage. Les Deux Traités de John Locke font ainsi un usage massif de l’usage : « on ne saurait supposer que [la terre] puisse rester commune et sans culture » et c’est pourquoi elle doit être livrée à « l’usage des hommes industrieux, laborieux, raisonnables » ([1689] 1795, livre I, chapitre 5, §34). Ici, la définition de l’usage est, et se limite à, l’agriculture. La terre qui n’est pas cultivée devient une friche inutilisée et par conséquent disponible à l’appropriation. Edward Saïd était bien au fait de cet usage de l’usage ; il a ainsi décrit la manière dont la Palestine a été transformée en « tout un territoire essentiellement inutilisé, déprécié, incompris… qu’il fallait rendre utile, apprécié et compréhensible. » (1979, 31 ; c’est Saïd qui souligne).
On peut déclarer qu’une chose est inutilisée ou s’assurer qu’elle le soit pour établir les fondements qui justifieront son appropriation.
Les sentiers battus ont beaucoup d’histoires à nous raconter. Un chemin peut apparaître comme une ligne dans un paysage. Mais il peut aussi être un chemin de vie. Le sens collectif de ces tracés peut nous servir d’orientation ; plus un chemin est parcouru, plus il est clair. Un chemin peut être soigné, conservé, maintenu.

Le chemin straight, le chemin bien droit, le chemin hétérosexuel, n’est pas seulement conservé par la fréquence de son usage (et une fréquence peut être une invitation), mais par un système de soutiens complexes. Quand il est difficile d’avancer, quand il est difficile d’emprunter un chemin, on peut s’en trouver découragéEs et chercher d’autres voies.

Pensons à la manière dont des rappels permanents soulignant la difficulté de telle ou telle entreprise peuvent nous en dissuader. Dévier n’est pas facile. Dévier est rendu difficile.
L’usage peut rendre le passage plus facile. William James cite à ce propos les travaux de Léon Dumont sur l’habitude : « Tout le monde sait qu’un vêtement, après avoir été porté un certain nombre de fois, se prête mieux aux formes du corps que lorsqu’il était neuf ; il y a eu un changement dans le tissu, et ce changement est une habitude de cohésion. Une serrure joue mieux après avoir servi ; il a fallu d’abord plus de force pour vaincre certaines résistances, certaines aspérités du mécanisme » ([1876] 1950, 105 ; c’est moi qui souligne) Plus un vêtement est porté, plus il s’accorde au corps qui le porte. Je reviendrai sur cette image du vêtement usagé en temps voulu. C’est l’exemple de la serrure qui m’intéresse ici : il suggère que c’est à force d’usage que certaines choses deviennent plus faciles à utiliser. Si l’usage prend du temps, l’usage en économise aussi ; à force d’usage, il y a moins d’efforts à faire pour réaliser une action.
L’idée selon laquelle l’usage maintient certaines choses en vie, ou que l’usage les rend plus faciles d’utilisation, est complétée par une autre idée, centrale à l’émergence de la biologie moderne : l’idée selon laquelle l’usage étant capable de rendre un être plus fort (et l’absence d’usage de le rendre plus faible) jouerait un rôle clef dans la formation de la vie ellemême. Ainsi Jean-Baptiste Lamarck, le naturaliste français qui fut le premier à utiliser le terme biologie dans son sens moderne, propose une loi d’usage et de non-usage : « l’emploi plus fréquent et soutenu d’un organe quelconque fortifie peu à peu cet organe, le développe, l’agrandit et lui donne une puissance proportionnée à la durée de cet emploi, tandis que le défaut constant d’usage de tel organe l’affaiblit insensiblement, le détériore, diminue progressivement ses facultés et finit par le faire disparaître. » ([1800] 2016) Pour Lamarck, ces modifications acquises peuvent être héritées, c’est ce que l’on appelle « héritage des caractères acquis » et qu’en anglais on désigne comme use inheritance, « héritage d’usage ». Bien qu’il ne l’utilise qu’une seule fois, c’est l’exemple du cou de la girafe qu’on a le mieux retenu de l’argumentaire de Lamarck. Pour Lamarck, le cou de la girafe s’agrandit, non pas sous l’effet d’une volonté, mais en conséquence des efforts répétés qui lui donnent cette direction. Il écrit : « Les efforts dans un sens quelconque, longtemps soutenus ou habituellement faits par certaines parties d’un corps vivant, pour satisfaire des besoins exigés par la nature ou par les circonstances, étendent ces parties, et leur font acquérir des dimensions et une forme qu’elles n’eussent jamais obtenues, si ces efforts ne fussent point devenus l’action habituelle des animaux qui les ont exercés. » ([1800] 2016 ; c’est moi qui souligne). Quand un effort se normalise, une forme est acquise. Quand une telle forme est acquise, il y a moins d’effort requis ; la girafe n’a plus besoin d’étendre son cou pour atteindre le feuillage. L’héritage des caractères acquis se traduit ainsi en une diminution de l’effort requis pour survivre au sein d’un environnement.
Marquons une pause ici et déployons certaines implications queers de l’argument de Lamarck. Si les normes se transforment en formes, cela veut dire que les formes sont toujours légèrement en retard par rapport aux normes. Stephen Gould suggère que ce décalage temporel entre le changement comportemental et le changement formel est ce qui permet de rendre compte des inventions animales les plus « bizarres » et les plus « curieuses ». Les exemples sollicités par Gould incluent les flamants roses, décrits comme faisant partie des « rares créatures qui ont réussi à s’acclimater à l’environnement inhabituel de ces déserts salés » (1985 [1988], 22-23). Les flamants roses ont une manière inhabituelle de se nourrir, « la tête à l’envers » (23). Cette « inversion » est décrite comme « totale » non seulement en termes de forme, mais aussi en termes de mouvement. L’action est également décrite comme « sens dessus dessous » (31). Gould en conclut qu’une « inversion d’un aspect spécifique du comportement a provoqué l’inversion — complexe — des parties correspondantes de sa morphologie » (31). L’usage queer renvoie aussi à de telles inversions : comment les choses finissent dans le mauvais sens : « Imaginons qu’un organisme dont la morphologie est adaptée à des conditions de vie bien précises soit tout à coup soumis à un nouveau type d’environnement ; cet organisme modifiera son comportement, mais ses nouvelles habitudes s’avéreront incompatibles avec son “ancienne” morphologie » (38). Une incompatibilité temporelle entre passé et présent se manifeste comme une incompatibilité entre forme et fonction. Les formes peuvent être comprises comme des « traînées temporelles », pour utiliser les termes d’Elizabeth Freeman (2010) : la viscérale « traction du passé sur le présent ». Quand les formes traînent à l’arrière des fonctions, cette traînée est exprimée dans des termes queers : « des imperfections et des solutions bizarres, bricolées avec les moyens du bord » (Le Sourire du flamant rose, 35 [traduction légèrement modifiée]).
Je reviendrai aux formes retardataires et aux solutions étranges en temps voulu. En attendant, revenons à Lamarck qui suggère que l’utilité d’une chose en vient à la faire exister. C’est l’une des raisons pour lesquelles Charles Darwin n’avait guère d’estime pour l’oeuvre de Lamarck, il y voyait impliqué (à juste titre ou pas), l’idée selon laquelle un organisme produit volontairement ce dont il a besoin. On peut trouver un signe du mépris de Darwin dans un autre livre usagé ; l’exemplaire personnel de Darwin de l'Histoire naturelle de Lamarck. Dans les marges, il écrit : « Parce que l’usage améliore l’organe — le désirer, ou désirer un usage, le produit ! Oh. » Malgré les différences qui semblent opposer Lamarck et Darwin — du moins du point de vue de Darwin sur cette question de l’usage --, Darwin lui-même présente la sélection naturelle et la loi d’usage et de non-usage comme articulées l’une à l’autre. Et il est intéressant de remarquer que Darwin réutilise la métaphore de l’architecte, malgré le risque d’invoquer, avec cette métaphore, l’idée de dessein :
Supposons qu’un architecte soit obligé de construire un édifice avec des pierres non taillées, tombées dans un précipice. La forme de chaque fragment peut être qualifiée d’accidentelle ; cependant, cette forme a été déterminée par la force de la gravitation, par la nature de la roche, et par la pente du précipice, toutes circonstances qui dépendent de lois naturelles ; mais il n’y a aucun rapport entre ces lois et l’emploi que le constructeur fait de chaque fragment. […] On peut dire que la forme des fragments qui se trouvent au fond du précipice est accidentelle, mais cela n’est pas rigoureusement exact ; la forme de chacun d’eux dépend, en effet, d’une longue suite d’événements, tous obéissant à des lois naturelles : de la nature de la roche, des lignes de dépôt ou leur clivage, de la forme de la montagne qui dépend elle-même de son soulèvement et de sa dénudation subséquente, et enfin de la cause qui a déterminé l’éboulement. Mais relativement à l’emploi qu’on peut faire des fragments, on peut dire que leur forme est rigoureusement accidentelle. ([1869] 1880, p. 219 et 455)
Un architecte peut être un constructeur qui fait un usage des pierres qu’il trouve sans les tailler au service de son dessein. Les pierres sont tombées, ou elles étaient déjà là, suivant des lois naturelles. Ces pierres n’ont pas été faites pour être utilisées de la manière dont une tasse est façonnée pour être remplie d’eau. Si la forme de la pierre est déterminée par une longue séquence d’événements, c’est un accident que la forme de cette pierre convienne au trou dans le mur. Il y a plus de chance pour que tu utilises une pierre s’il se trouve qu’elle convient à l’espace où tu es censée la mettre ; l’usage comme coup du sort, l’usage comme circonstance fortuite, l’usage comme heureux hasard. Je reviendrai, en temps voulu, à cet usage darwinien de l’heureux hasard dans sa métaphore de l’architecte.
L’institutionnel comme usuel
Ma tâche dans cette section est d’épaissir la compréhension de l’usage qui a été proposée jusqu’ici en pensant son rapport aux institutions, en pensant l’institution comme habitude. Celle·ux qui s’efforcent de transformer les institutions ont beaucoup à nous apprendre de ce qu’est l’institutionnel. Dans un projet antérieur, j’ai longuement enquêté auprès de travailleur·euses de la diversité. En me replongeant dans ces données, j’ai réalisé combien le travail de la diversité implique de devenir conscientes des usages. Les travailleur·euses de la diversité s’efforcent de transformer les habitudes institutionnelles, i·elles essayent de ne pas suivre les sentiers battus, de ne pas se contenter de suivre le sens du courant.
Bien sûr, à un autre niveau, la diversité peut sembler justement aller dans le sens du courant, un chemin déjà bien balisé.

La facilité avec laquelle la diversité passe d’une main à une autre est sans doute une des raisons pour lesquelles le travail de la diversité n’est pas un travail aisé. Une travailleuse de la diversité m’en parle ainsi comme d’une « grosse pomme bien brillante » qui aurait pourri de l’intérieur : « tout a l’air merveilleux mais personne ne fait rien contre les inégalités ». Le mot diversité est ainsi utilisé pour en faire moins ; le mot devient le signe d’une difficulté à faire passer l’idée. La même praticienne décrit son travail de la manière suivante : « Ce travail, c’est comme se taper la tête contre un mur de briques. » Ta fiche de poste devient la description de ces murs. Si tu n’as de cesse de te taper la tête contre un mur de briques et que le mur reste en place, c’est toi qui souffres. Et qu’arrive-t-il au mur ? Il semblerait que tu n’aies fait qu’en gratter la surface.

Faire le travail de la diversité, cela implique de collecter des histoires de mur ; les murs deviennent tes données ; un condensé d’informations sur les institutions. Voici une des histoires de mur que j’ai collectée :
Lorsque j’ai commencé à travailler ici, il existait une politique selon laquelle chaque comité devait comprendre trois personnes ayant reçu une formation en matière de diversité. Mais dès le début de mon mandat, il a été décidé que tous les membres du comité, au moins les personnes internes, devaient avoir suivi cette formation. Cette décision a été prise lors du comité pour l’égalité et la diversité, auquel plusieurs membres de l’équipe de direction ont assisté. Mais par la suite, le directeur des ressources humaines en a pris connaissance et a décidé que nous n’avions pas les ressources nécessaires pour faire cela. Le conseil a donc été saisi de la question. Au conseil, le directeur des ressources humaines a dit qu’il était satisfait de n’avoir que trois membres formé·es par comité, mais une personne du conseil qui était un membre externe du comité sur la diversité a piqué une crise — je ne plaisante pas — et a déclaré que le procès-verbal ne reflétait pas ce qui s’était passé lors de la réunion, qu’il indiquait une conclusion différente de ce qui avait été réellement décidé (et ce n’est pas moi qui ai dressé le procès-verbal, soit dit en passant). Ils ont donc dû reprendre le dossier et renverser leur décision. Et la décision du Conseil était que toutes les personnes devaient être formé·es. Malgré cela, j’ai assisté à des réunions où l’on continuait à dire qu’il ne devait y avoir que trois personnes formé·es dans le comité. J’ai dit : « Mais non, le Conseil a changé d’avis et je peux vous donner le procès-verbal » et ils m’ont regardée comme si je disais quelque chose de vraiment stupide, et cela a duré des lustres, même si le procès-verbal du Conseil disait clairement que tous les membres du comité devaient être formé·es. Et pour être honnête, parfois, tu abandonnes.
Une décision institutionnelle semble avoir été prise. Il est nécessaire que les individus d’une institution agissent effectivement comme si une décision avait été prise pour que celle-ci fonctionne. S’ils ne le font pas, c’est comme si la décision n’existait pas. Une décision faite au présent concernant le futur peut être contrecarrée par le poids du passé : le passé devient un sentier battu, ce qui se passe d’ordinaire continue de se passer. Dans ce cas, le chef du personnel n’a même pas besoin d’effacer le procès-verbal de la décision pour la rendre ineffective. J’appelle cette dynamique « non performativité » : quand le fait de nommer quelque chose ne suffit pas à produire des effets, ou quand quelque chose est nommé précisément afin de ne pas en produire.
Le mur : cela qui reste debout. Le mur est un verdict. Je résume ce verdict de la manière suivante : ce qui interrompt le mouvement est lui-même en mouvement. En d’autres termes, les mécanismes pour empêcher quelque chose de se produire sont mobiles, ce qui signifie que lorsqu’on regarde le mouvement, on peut passer à côté du mécanisme. C’est important parce que les institutions sont expertes en réorganisations, elles créent des preuves qu’elles sont en train de faire quelque chose. Mais créer des preuves qu’on est en train de faire quelque chose n’est pas la même chose que faire quelque chose. C’est la raison pour laquelle je désigne le travail de la diversité comme de la plomberie institutionnelle : il faut s’ingénier à comprendre non seulement où mais aussi comment le blocage a lieu. Dans notre exemple, la suppression du procès-verbal aurait pu être ce qui empêche la décision d’être suivie ; ou bien la cause aurait pu être le fait que personne ne remarque cette suppression ; mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Ce qui a bloqué la décision, c’est la manière dont les personnes présentes dans l’institution se sont comportées à l’égard de celle-ci après qu’elle ait été acceptée.
Un programme en faveur de la diversité peut être généré sans pour autant être mis en application. J’ai remarqué plus tôt comment les pancartes sont souvent utilisées pour signaler une transition entre une chose en cours d’utilisation et une chose hors d’usage, comme dans le cas de la boîte aux lettres. Les institutions sont aussi des systèmes postaux. Peutêtre læ travailleur·euse de la diversité a-t-i·el déposé sa proposition de programme dans la boîte aux lettres en pensant qu’elle était en service. Une boîte aux lettres hors d’usage peut être utilisée pour une autre fonction : empêcher qu’un programme soit mis en place dans le reste du système. Le programme prend la poussière, un peu comme l’épée de Marx qui rouille dans son fourreau ; de la rouille à la poussière. Un programme peut devenir inutilisable à force de ne pas être utilisé.
Considérons encore l’énergie que cette praticienne de la diversité a déployé pour développer un programme qui n’a pas été mis en place. L’histoire des murs qui restent debout est la même histoire qui parle de travailleur·euses de la diversité brisées ; comme elle le dit elle-même, « il arrive qu’on abandonne ». Parfois, c’est l’impression d’avoir été utilisée ; tu te sens vide, évidée, un peu à la manière de ce tube de dentifrice.


Ou parfois, c’est se perdre au point de se sentir perdre les pédales. Perdre pied, c’est parfois se perdre soi-même ; tu deviens alors cell·ui qui, perdant pied, ne peut plus rien gérer.
Pas besoin de dire quoi que ce soit pour qu’on t’entende comme une personne qui craque et qui casse. Une autre praticienne décrit les choses ainsi : « Tu sais, c’est ce qui se passe dans ce métier : dès que tu t’apprêtes à parler, les gens commencent à se dire “et voilà, c’est parti”. » Nous avons toutes les deux ri, reconnaissant simultanément que nous reconnaissions toutes les deux cette scène. La rabatjoie féministe, ce tuyau percé, surgit ici ; elle surgit dans ce que nous entendons. Nous nous entendons les unes les autres dans les mots éculés que nous partageons ; nous entendons ce que c’est que de s’affronter aux mêmes murs, encore et encore. Nous imaginons les yeux se lever au ciel comme pour dire : bien sûr, elle dit ça, que pourrait-elle dire d’autre ? C’est au travers d’expériences comme celles-là que j’ai développé mon équation : des yeux qui se lèvent au ciel = une pédagogie féministe.
Je pense qu’il est important de noter que la décision qui a été empêchée en n’étant pas appliquée était une décision sur la manière dont les universitaires sont sélectionné·es. Les comités de sélection deviennent ainsi des lieux privilégiés pour apprendre la manière dont les institutions se reproduisent ; comment des décisions y sont prises sur qui est « sélectionnable ». Dans une formation sur la diversité à laquelle j’ai assisté, une personne a parlé de la manière dont les gens dans son département utilisaient un critère non officiel de sélectionnabilité, en se demandant si un·e candidat·e « était la sorte de personne avec laquelle on aurait envie d’aller au bar ». I·els cherchaient des personnes qui habiteraient ces espaces avec elle·ux ; être avec devient être comme ; une personne avec qui tu peux t’identifier, avec qui tu peux aller boire un verre. Je me rappelle d’un jour où l’on examinait la candidature d’une femme racisée qui travaillait sur la race et la sexualité. Au cours d’une réunion du département, quelqu’un·e a dit d’un air inquiet : « mais, nous avons déjà Sara ». Comme si le fait d’avoir embauché l’un·e d’entre nous était déjà bien assez. Le consensus, à peine formulé, était que cette femme n’aurait fait que répliquer ma présence, même si nos travaux étaient différents. Il n’y avait pas la même inquiétude concernant d’autres disciplines. De l’inquiétude ; pas d’inquiétude ! Ou comment les choses restent à l’identique lorsqu’on cherche chez les autres à retrouver ce que l’on connaît.
Mais revenons à notre discussion des usages de l’usage. Une institution est un environnement. Les environnements sont dynamiques ; c’est parce que les environnements changent que les usages changent. Toutefois, les institutions sont des technologies spécifiquement conçues pour contenir. Elles assurent la reproduction en stabilisant les besoins nécessaires à la survie ou au succès dans un environnement donné. Quand un besoin est stabilisé, il n’a plus besoin d’être explicité. L’usage devient une question d’ajustement, d’adaptation. Vous vous souvenez de la métaphore de l’architecte qu’utilisait Darwin ? Le constructeur utilise la pierre qui se trouve être adaptée. Les institutions aussi sont construites. On peut avoir l’impression qu’usage et utilisation sont le fruit du hasard : qu’une personne a été sélectionnée parce qu’il se trouve qu’elle était adaptée aux besoins, un peu comme une pierre n’est sélectionnée que parce qu’il se trouve qu’elle a la bonne taille pour boucher le trou dans le mur. Le hasard peut être utilisé idéologiquement : comme s’ils n’étaient là que parce qu’il se trouve qu’ils conviennent ; au lieu de voir qu’ils sont là en raison de la manière dont la structure a été construite.
Une structure : l’élimination graduelle du hasard dans l’usage afin de déterminer un besoin. Dans le modèle de Lamarck, l’usage se transforme en hérédité, une forme qui diminue l’effort demandé pour faire telle ou telle chose dans un environnement donné. Quand tu es adapté·e, et l’adaptation ici est formelle, une question de forme, tu hérites de la diminution d’un effort. Ce n’est pas seulement la constance de l’usage qui rend le passage plus facile. Certaines personnes ont des voies toutes tracées en face d’elles parce qu’elles sont adaptées aux besoins. La formule selon laquelle « le pour quoi d’une chose vient avant cette chose » résonne ici autrement, car quand un monde est construit pour quelqu’un·e, ce quelqu’un·e passe avant les autres.
Ne convient pas
Oui, il arrive que des personnes en viennent à habiter des organisations qui n’ont pas été conçues pour elles ; on peut passer la sélection sans correspondre au profil. Si tu débarques dans une organisation qui n’a pas été construite pour toi, tu fais l’expérience de ce pour comme une restriction, un étau. Si c’est toi la personne pour laquelle l’institution a été conçue, ce même pour peut paraître ouvert ; l’institution te paraît ouverte parce qu’elle est ouverte pour toi. C’est la raison pour laquelle je pense l’institution comme une sorte de vêtement usagé : l’institution, comme le vêtement usagé, acquiert sa forme en fonction de celle·ux qui la portent ; il devient ainsi d’autant plus facile de porter une institution s’il se trouve que tu as la même forme que celle·ux qui te précèdent. C’est donc la raison pour laquelle je pense le privilège comme un appareil à économie d’énergie : il y a besoin de faire moins d’efforts pour circuler dans un monde qui s’est formé autour de toi. Si tu débarques, avec tes origines douteuses, inattendu·e, ton arrivée est déjà par ellemême en désaccord avec les attentes : tu n’es pas cell·ui qu’on attendait, tu ne fais pas ce qu’on attend de toi ; l’institution n’a alors pas la bonne forme.
Annette Kuhn parle de ce que cela fait d’étudier les lettres classiques en tant que jeune femme issue de la classe ouvrière : un sentiment d’être « ostensiblement pas à ma place ». Elle décrit ce « pas à sa place » en faisant une biographie de l’uniforme qu’elle devait porter au lycée ; comment, le temps que son uniforme mal ajusté en soit venu à lui convenir, il était déjà « élimé » et lui donnait un air « dépenaillé ». Le mot anglais wear [« la tenue », mais aussi « l’usure »] vient d’un mot germanique qui renvoie au vêtement. Il acquiert la signification d’« usagé, endommagé » en raison du fait que le port des vêtements, en effet, les élime. Quand on utilise quelque chose de manière répétée, on ne s’y adapte pas toujours davantage : si tu n’as pas les moyens de t’acheter de nouveaux vêtements, tes vêtements de seconde main s’éliment et donnent le signe de ton inadéquation.
« Ne convient pas » peut aussi décrire ton propre corps, tes propres besoins. Quand tu ne conviens pas aux besoins ou quand tes besoins ne conviennent pas, il peut arriver que tu deviennes, pour reprendre le terme de Rosemarie Garland-Thomson, un·e inadapté·e. Ainsi décrit-elle une personne handicapée dans une institution validiste comme un « cube qu’on essaye de faire entrer dans un trou rond » (2011, 592)Mon travail doit beaucoup à celui de Rosemarie Garland-Thomson sur les mécanismes de « désadaptation » ainsi qu’à celui d’autres chercheur·e uses en Disability Studies qui ont proposé parmi les critiques les plus importantes des « usages de l’usage » (en particulier de l’utilisabilité), notamment Aimi Hamraie, Jay Dolmage, Margaret Price, Tanya Titchkosky et Alison Kafer.. Convenir, s’adapter, peut se transformer en travail pour celle·ux qui ne conviennent pas ; il faut pousser, pousser, pousser ; et parfois, tu peux pousser autant que tu veux, tu n’arrives jamais à entrer.
On peut être une inadapté·e à des routines qui se sont installées. Une organisation qui organise de longues réunions sans pauses présuppose l’existence d’un corps qui peut être assis sans prendre de pause. Si une personne arrive sans pouvoir soutenir cette position, elle ne remplit pas les conditions. Si tu t’allonges pendant une réunion, la réunion entre en crise.
Un projet de justice sociale pourrait bien impliquer de provoquer une crise dans nos manières de nous réunir.
Peut-être parce que les organisations s’efforcent d’éviter de telles crises, les inadapté·es finissent souvent dans les mêmes comités (mieux connus sous le nom de « comités pour la diversité »). Nous finissions dans les comités pour la diversité en raison de ce que nous ne sommes pas : pas blanc·hes, pas cis, pas valides, pas hommes, pas hétéras. Plus tu n’es pas, plus tu finis dans des comités ! Nous pouvons être des inadapté·es, même dans ces comités. Une universitaire racisée me dit : « J’étais dans le groupe égalité et diversité à l’université. Dès que j’ai commencé à mentionner des choses en rapport avec la race, ils ont changé le profil des membres du comité et j’ai été écartée. » J’ai remarqué plus tôt combien le mot diversité peut être davantage utilisé parce qu’il permet d’en faire moins. Il est probable que le mot race soit moins utilisé parce qu’il en fait davantage. Tout usage du terme race est ainsi déjà un usage excessif. Elle ajoute : « Chaque fois que tu soulèves une question, on te fait comprendre que tu ne fais pas partie du groupe. » Pas partie du groupe : utiliser des mots comme race, cela amplifie ce qui fait que tu ne conviens pas ; cela fait saillir ce que tu n’es pas. Peut-être ce ne pas (faire partie du groupe) peut-il être entendu comme un cri, une insistance, un point de tension, un point douloureux, un point d’exclamation.
Parfois, il suffit de se rendre à un endroit pour que s’y introduise avec toi une histoire, une histoire qui se met au travers d’une manière d’occuper un espace. Une porte peut être fermée en raison des personnes qui y entrent. D’autres fois, la porte peut paraître ouverte, on t’y souhaite même la bienvenue. Pensons à la manière dont la diversité est souvent représentée comme une porte ouverte, ou comme un slogan, les minorités sont les bienvenues ; entrez, entrez, un slogan, une étiquette qu’on te colle sur le dos. Ce n’est pas parce qu’on te dit que tu es la bienvenue qu’on s’attend à ce que tu débarques. Une femme racisée décrit son département comme une porte battante, les trucs qui ont à voir avec les femmes et les minorités n’entrent que pour ressortir aussitôt : woosh, woosh.

L’institution de la famille nucléaire peut te sembler ouverte et te dire : « Chère tantine queer, viens, entre ! ». Mais l’hétérosexualité peut aussi devenir une occupation : prendre tout l’espace, comme de l’eau qui déborde d’une tasse, pas de place, pas de place ; sous forme de mots de bienvenue polis, de déclarations, ou de projections futures imposant, mine de rien, l’hétérosexualité aux enfants. Même ma chienne Poppy se voit investie de cette mission (« si seulement Poppy pouvait rencontrer Tommy, ça ferait un joli couple »). C’est un peu comme se sentir disparaître : tu vois ta propre vie s’effilocher, fil après fil. Personne n’a cherché ou voulu que tu disparaisses. Tout le monde est gentil, accueillant. Mais doucement, tout doucement, au fil des conversations sur la famille, sur l’hétérosexualité comme futur, sur des vies que tu ne vis pas, doucement, tout doucement, tu disparais.
Je repense à notre boîte aux lettres. Il pourrait y avoir une autre pancarte sur la boîte aux lettres : « Oiselles, oiseaux, soyez les bienvenu·es ».

Cette pancarte nous enseigne comment « ne pas faire » certaines choses avec les mots ; elle nous enseigne que dire, parfois, c’est « ne pas faire ». Parce que si la boîte aux lettres était utilisée, les oiseaux seraient délogé·es par les lettres, leur nid détruit avant même de pouvoir être habité. On peut empêcher les autres d’utiliser un espace en lui donnant un usage particulier. J’ai précédemment signalé que l’utilisation est une restriction de possibilité bien matérielle. On peut utiliser un papier pour certains usages et pas d’autres, car les qualités matérielles du papier nous limitent. Seulement, l’utilisation n’est pas limitée que par les possibilités matérielles. Des restrictions peuvent devenir matérielles à force d’utilisation. Ce qui est matériel pour certain·es, ce qui ne te fait aucune place, ce qui ne te laisse pas la place de respirer, de faire ton nid, d’exister, peut être une chose que d’autres trouveront insignifiante parce que cela ne se met pas en travers de leur chemin, de leur manière d’occuper l’espace ; cette chose peut même être ce qui rend cette occupation possible.
Tu arrives et tu trouves un espace déjà occupé. Tu arrives à l’hôtel avec ta petite amie et tu dis que vous avez réservé une chambre. On vous regarde, on hésite. Une hésitation peut en dire long. Le fichier indique que votre réservation est pour un lit double, c’est bien ça, Madame ? Des sourcils se lèvent ; un coup d’oeil rapide sur vous deux, de quoi saisir suffisamment de détails. Êtes-vous bien sûre, Madame ? Oui, tout à fait ; un lit double. Tu dois le dire, le répéter ; le dire une fois encore, fermement. J’ai déjà mentionné mon équation des yeux qui se lèvent au ciel = une pédagogie féministe. Et bien, j’en ai une autre :
Vraiment, vous êtes sûre ? Cela n’a de cesse de se produire ; tu en viens presque à t’y attendre, la nécessité d’être ferme ne serait-ce que pour recevoir ce que tu as demandé. L’incrédulité te poursuit, où que tu ailles ; encore. Une fois, après les questions, êtes-vous sûre Madame ? êtes-vous sûre Madame ?, tu entres dans la pièce : des lits jumeaux. Est-ce que tu retournes en bas ? Est-ce que tu essayes à nouveau ? Cela peut être éprouvant. Parfois, c’est trop éprouvant, parfois, c’est trop ; alors vous réunissez vos deux petits lits, vous trouvez une autre manière de vous blottir dans les bras l’une de l’autre.
L’usage queer : une autre manière d’être ensemble, de se blottir les unes contre les autres, de se tenir chaud.
Pour certaines personnes, être, c’est être remises en question. C’est ta soeur ou ton mari ? Voilà une question qu’une voisine m’a posée, un jour que je rentrais chez moi. T’es qui ? T’es quoi ? D’où tu viens ? En tant que personne racisée vivant au Royaume-Uni, je me suis habituée à ce qu’on me pose cette question. D’où tu viens ? Je veux dire : d’où, vraiment ? Voilà la manière qu’on a de te dire que tu ne viens pas d’ici ; la peau brune, pas d’ici, pas ici, pas. Ces questions peuvent te déloger ; tu en viens à les attendre. S’attendre à être délogée, voilà qui a de quoi changer ta relation à l’endroit que tu habites.
Le lieu que tu habites, ce peut être la manière que tu as d’être reçue. Tu entres dans une salle de classe avec un homme blanc ; toi comme lui, vous êtes professeur·es. Mais tu sens bien que le regard se pose sur lui. Ploc, ploc. Tu n’apparais pas comme un·e professeur·e parce que tu ne corresponds pas à la manière dont un·e professeur·e apparaît habituellement. On s’adresse à lui comme s’il était le seul professeur. Et si tu venais à dire « Hey, moi aussi je suis professeure ! », on t’accuserait de vouloir attirer l’attention sur toi. Le travail de la diversité : ce qui te fait apparaître aux yeux des autres comme cherchant à attirer l’attention. Tu fais tache. On finit par croire que si tu rencontres des murs, c’est parce que tu te plains. Une universitaire interrogée au cours de mon projet sur les plaintes me dit : « On m’a dit que j’étais aigrie, que j’étais aigrie et sensible parce que je suis juive, parce que je suis étrangère. Parce que tu vis dans ce pays et le Brexit te perturbe, ou parce que tu es gay alors tu vois des problèmes partout. Alors tu te mets à penser, est-ce que je cherche les problèmes ? Je retourne la situation contre moi : est-ce que c’est moi, est-ce que c’est ma faute ? Je passe des nuits, éveillée, à me demander : est-ce que c’est vraiment moi le problème ? » Aigrie, aigrie : quand tu donnes des aigreurs aux autres, on a vite fait de te prendre pour quelqu’un d’aigri. Plus tu n’es pas, plus on te trouve aigrie.
Mais cela peut être assommant, au point que tu peux finir par croire que c’est toi le problème. Faire cette expérience, ajouterai-je, c’est faire l’expérience de la structure ; comment on t’empêche de faire quelque chose, d’être quelque chose.
Tout ce que tu dois dire, ou faire, afin qu’on ne t’ignore pas, peut être entendu comme une plainte, comme si tu te plaignais d’être ignorée. Parfois, il nous faut en effet nous plaindre à propos des choses ou des personnes qui sont ignorées. Quand j’ai rendu publiques les raisons de ma démission, en protestation contre les manquements de mon institution qui n’a pas voulu reconnaître le harcèlement sexuel qui avait lieu en son sein, je suis rapidement devenue la cause des dégâts : quel gâchis Sara, regarde tout le travail que tu nous laisses sur les bras.

Les institutions feront de leur mieux pour contenir la fuite. Les relations publiques font cela : limiter les dégâts. C’est ainsi que le travail de la diversité institutionnalisé est souvent employé comme stratégie pour limiter les dégâts. Mais il y a de l’espoir ici. Les institutions ne peuvent pas tout nettoyer derrière nous. Un tuyau percé peut mener à un autre ; il le peut et il le fait. Une fuite peut devenir une piste. Après que j’ai rendu publiques les raisons de ma démission, de nombreuses personnes se sont mises à partager avec moi leurs histoires, celles de leurs propres batailles institutionnelles.
Conclusion : Vandalisme queer
Limiter les dégâts : c’est ainsi que les institutions finissent par utiliser la paperasse, comme cache-misère, comme papier-peint pour camoufler les fissures et les fuites, ce qui permet que les défauts de l’institution soient enregistrés sans être entendus. Peut-être qu’à force, ces défauts deviennent les nôtres ; et voilà comment nous devenons des marchandises endommagées, des personnes abîmées.
La paperasse elle-même peut être recouverte, invisibilisée. Dans Queer Phenomenology, je remettais en question le fantasme d’une « philosophie zéro papier » ([2016] 2022, 67). Je critiquais la manière dont la philosophie peut parfois s’orienter vers certains types de corps, des corps pour lesquelsla matérialité est une distraction inutile, des corps qui ont du temps libre pour la contemplation pendant que d’autres se chargent de la paperasse, du travail domestique, du travail du soin, du travail de la diversité.
Les papiers comptent. Les papiers peuvent même être queers ; ils peuvent faire l’objet d’un usage queer. Je me souviens de la discussion que propose Homi Bhabha des usages de la Bible dans son article, « Signs Taken for Wonders » [Des Signes pris pour des merveilles]. Bhabha y cite le Missionary Register [Registre des missionnaires] de 1817 : « Et cependant [les Indien·nes] acceptaient volontiers les Bibles qui leur étaient distribuées. Pourquoi ? Par curiosité, pour les revendre ou pour en utiliser le papier. Tel est le destin bien connu des Bibles dans ce pays. Certaines sont encore exposées comme des curiosités par celle·ux qui ne peuvent pas les lire ; d’autres se voient troquées sur les marchés ; d’autres enfin sont utilisées pour rouler des cigarettes ou comme papier d’emballage. » (1985, 163-164) La Bible, en n’étant pas proprement utilisée, est ainsi délibérément détruite ; elle devient une curiosité ; utilisable ou réutilisable à d’autres fins, comme papier d’emballage, comme un déchet à recycler.
Bien sûr, les missionnaires ne racontent ce destin de la Bible dans les colonies que comme le résultat d’une incapacité des Autochtones à l’intégrer : « Certes, les Autochtones lettrés disposent de suffisamment de temps libre pour lire la Bible ; mais ils sont si indolents, si épris de nourriture et de sommeil, ou si absorbés dans les passe-temps les plus vicieux, qu’à moins qu’on ne leur présente quelque chose d’à la fois bref, simple et puissant, aucune lecture ne saura les extirper de la torpeur et de la sensualité dans lesquelles leurs esprits sont plongés. » (1817, 186). Si d’une part le racisme est utilisé pour expliquer l’incapacité à intégrer des connaissances, présentant l’autre racialisé comme sujet queer, oblique, déviant (« les passe-temps les plus vicieux », « la torpeur et la sensualité »), le racisme est également utilisé en raison de l’incapacité de la mission coloniale à transformerles esprits des colonisé·es en réceptacles dociles et consentants.
La demande qui pèse sur le bon usage est une demande de révérence pour ce qui a été donné par le colon. L’empire, en tant que don, se présente avec un manuel d’utilisation. Si ne pas s’assujettir à la volonté du colon revient à faire un usage queer des choses, ou à devenir soi-même queer en les utilisant de travers (la perversion comme auto-révélation), les usages queers sont alors synonymes de proximité avec la violence. Faire un usage queer, queeriser l’usage, c’est s’attarder aux qualités matérielles des choses qu’on souhaiterait que tu négliges ; c’est réveiller des potentiels abandonnés de la matière, toutes ces choses qu’on peut faire avec du papier quand on refuse les instructions qui lui sont attachées. Ce réveil des potentiels peut être dangereux. La créativité de l’usage queer devient un acte de destruction, qu’il soit volontaire ou non ; se refuser à ingérer une chose, la recracher, la diminuer.
L’usage queer, en d’autres termes, peut être compris comme vandalisme : « la destruction volontaire du vénérable et du beau ». Plus tôt, j’ai parlé du travail de la diversité comme d’un travail de plomberie institutionnelle. On pourrait penser, en entendant cette description, que le travail de la diversité consiste à débloquer le système. Mais que se passe-t-il quand le blocage est la manière même dont le système fonctionne ? Le système fonctionne en empêchant celle·ux qui essayent de le transformer. Cela veut dire que pour transformer un système, il nous faut interrompre son fonctionnement. Arrêter une machine, c’est l’endommager. Il nous faut peut-être faire de la plomberie un artisanat vandale, ou encore nous faire passer pour des plombier·es (censément venu·es réparer les fuites) afin de vandaliser (empirer la fuite, augmenter son débit). Il nous faut peut-être lancer des pavés dans la mare, mettre des bâtons dans les roues ou, pour reprendre l’expression de Sarah Franklin (2015), nous mettre nous-mêmes dans les roues du système, y lancer nos corps pour tenter d’empêcher les mêmes corps de faire, encore et encore, les mêmes choses. Nous qui nous jetons dans les roues du système, nous formons une drôle de petite famille avec les rabatjoies féministes (la parenté des figures dont nous nous réclamons peut ainsi nous rendre parentes les unes des autres) : ensemble, nous voilà des agenz de la contrereproduction ; nous nous efforçons d’interrompre ce qui se produit habituellement.
Pour devenir un obstacle, pour faire obstruction, il faut souvent y mettre de la volonté. Les manifestations sont elles aussi présentées comme vandales : non seulement en raison de dommages causés aux biens, mais encore en raison d’un supposé désir de nuire.

Parfois, il suffit d’exister ou de questionner des existences pour créer des obstructions. Le simple fait de se demander comment vivre, comment aimer,peut être présenté comme dommageable. Queer, clac, clac : sous prétexte qu’i·els ne suivent pas les pointillés des lignes familiales, on en vient à penser que les queers veulent tailler la famille en pièces.

Il y a tant de choses qui sont reproduites par l’imposition d’une marche à suivre. À l’université, on te demande de suivre les sentiers battus de la citation : bien citer, c’est citer celle·ux qui exercent le plus d’influence. Plus un chemin est utilisé, plus on l’utilise.
C’est tout un travail d’entretenir un sentier ; l’occupation dépend de l’effacement ; tel ou tel homme blanc se retrouve à l’origine d’un concept, une idée devient séminale, par l’élimination des traces de ses prédécesseurEs. Les féministes Autochtones, les féministes Noires et les féministes racisées ont inventé de nouveaux chemins pour cela et pour celle·ux que nous refusons de laisser disparaître. Je pense au travail de Zoe Todd (2016), Eve Tuck (2018) et Alexis Pauline Gumbs (2016). Parler de la blanchité à l’université ou du colonialisme comme le contexte de production de la philosophie des Lumières, c’est porter avec soi le scandale du vandalisme. Le projet de décoloniser des programmes a été considéré comme un acte vandale, une destruction volontaire de nos universaux ; la décapitation des statues, la destruction des trônes sur lesquels siègent les philosophes-rois.
Si remettre en question une manière de vivre ou une manière de lire est considéré comme dommageable, nous sommes prêt·es à causer des dégâts, à retourner ces jugements en projets. Et le vandalisme devient une tactique lorsqu’il nous faut couper le message du corps qui l’a émis, afin que le message ne compromette pas la source qui l’a lancé. Si les organisations tentent de contenir ce qui pourrait nuire à leur réputation, nous trouverons d’autres moyens de diffuser l’information. Nous aurons parfois besoin d’utiliser des tactiques de guérilla, et nous avons une histoire éministe et queer sur laquelle nous appuyer pour cela ; nous continuerons à dénoncer les harceleurs, dans des livres ou sur des murs, nous écrirons leurs noms.

Ce qui est traité comme dommage peut être un message envoyé aux autres : nous pouvons nous tendre la main au travers des griffures et des griffonnages que nous laissons derrière nous.
La nécessité d’être inventif·ves n’est pas seulement une question de communication. Audre Lorde dans son poème « Une Litanie pour la survie » évoque « celles d’entre nous » qui « aiment dans les couloirs vont et viennent entre deux aubes » ([1978] 2021). Et toi, est-ce qu’à toi aussi il t’arrive de devoir utiliser des sentiers moins fréquentés, de faire d’un couloir le lieu d’une rencontre ? De devoir te faufiler pour rester indétectable, parce qu’être vue est dangereux quand on est vue comme dangereuse ? L’usage queer est parfois une question de survie : tu deviens moins visible parce que c’est ainsi que tu as le plus de chance de rester en vie.
Et donc : il existe des possibilités queers non seulement dans l’usage, dans la manière dont les matières sont employées quand nous refusons une instruction, mais encore dans le fait de n’avoir aucun usage. Un livre usagé peut nous laisser entrevoir des pistes à peine visibles. Dans L’Origine des espèces, Darwin parle des organes vestigiaux, des parties qui ont cessé d’être utiles mais qui, bien que réduites à l’extrême, restent comme à la traîne (qu’on pense, par exemple, aux très petits yeux des taupes) ; ces organes sont parfois désignés comme des restes, des débris, des résidus. La vestigialité désigne la rétention de structures ou d’attributs d’espèces ancestrales qui ont perdu leur fonctionnalité ; une autre version de l’étrange temporalité de l’usage. C’est ce qu’indique cette citation de L’origine des espèces : « Les organes rudimentaires, comme il est généralement admis, sont capables de la plus extrême variabilité… Et c’est ainsi qu’un organe primitivement formé par la sélection naturelle, parce qu’il est devenu inutile, peut devenir variable, ses variations n’étant plus empêchées par la sélection naturelle. » ([1859] 1906, p. 537 ; je souligne) + L’inutilité : une assignation qui peut s’avérer mortelle. J’imagine que nous la connaissons bien, l’histoire de celle·ux dont on s’est débarrassé·es, dont les fragments ont été écartés et jetés aux oubliettes. Nous pouvons ramasser ces fragments. Nous pouvons trouver d’autres manières de raconter l’histoire de l’usage et de l’inutilité, entendre le potentiel queer jusque dans une phrase tirée d’un livre usé jusqu’à la corde comme L’Origine des espèces. Ce potentiel : ne pas être sélectionné·e, c’est ne pas être soumis·e à la vérification, c’est avoir l’espace nécessaire pour errer, pour varier, pour dévier ; pour proliférer. Si l’usage queer peut nous parler de survie, de celle·ux qui suivent les sentiers moins fréquentés afin de ne pas être détecté·es, il peut aussi nous parler de créativité, de ces variations qui sont possibles quand tu n’as pas été sélectionné·e ou récompensé·e pour avoir suivi la bonne voie. Mais, ne pas être sélectionné·e, cela peut aussi vouloir dire ne pas être soutenu·e. Et donc, nous créons nos propres systèmes de soutien ; des poignées queers, comme des poignées de porte, des prises auxquelles s’accrocher ; nos stratégies pour permettre à la vie de continuer quand nous sommes brisé·es, parce qu’il nous arrive d’être brisé·es. Rien de surprenant donc, à ce que nos histoires d’épuisement, nos histoires d’incapacité à habiter un monde qui ne nous fait pas de place, nos histoires de fatigue et de déchirement, soient les mêmes histoires que celles où se déploie notre inventivité, où nous créons des choses, où nous faisons des choses.
Audre Lorde parle de son écriture alors qu’elle s’apprête à mourir, et elle écrit : « Je voudrais écrire le feu jusqu’à ce qu’il me sorte des oreilles, des yeux, des narines — de partout ! Jusqu’à ce qu’il soit mon souffle. Je veux quitter cette terre comme un foutu météore ! » (131)
Et c’est ce qu’elle a fait.
Et c’est ce qu’elle a fait.
Elle s’en va, et elle en fait quelque chose. Elle nomme cette capacité à tirer quelque chose du feu : « l’érotique ». Elle décrit l’érotique de la manière suivante : “Il existe une différence entre peindre la clôture du jardin et écrire un poème, mais c’est une
différence de quantité et non de qualité. Et pour moi, il n’y a pas de différence entre écrire un beau poème et me promener sous la lumière du soleil, serrée contre le corps de la femme que j’aime.” ([1978] 2003, 56) Des mots où la vie scintille, pareille à la lumière du soleil sur sa peau.
Un poème d’amour
Un poème amoureux
Nous pouvons briser les étaux qui nous contiennent pour faire d’autres choses. Nous regardons
les mots se déverser. Se déverser sur nous. Je pense aussi au poème de Cherríe Moraga, “The
Welder” [La Soudeuse]. Moraga parle du feu qu’on utilise pour donner forme à de nouveaux éléments, pour créer « l’intimité de l’acier en fusion, le feu qui fait de vos vies des sculptures, érige des édifices » (1981, 219). Nous avons besoin de construire nos propres bâtiments quand le monde ne fait pas de place à nos désirs. Quand tu es empêchéE, quand ton existence est prohibée ou perçue avec suspicion, quand des sourcils se lèvent sur ton passage (et oui, ils sont notre pédagogie), il te faut inventer tes propres systèmes pour avancer.
Que d’invention Voilà quelque chose Qui ne vient pas de nulle part Une chose qui vient d’une autre Une table de cuisine qui se transforme en maison d’édition Un couloir qui se transforme en lieu de rendez-vous Une boîte aux lettres qui se transforme en nid.
Voilà qui peut peut-être former un héritage queer ; une manière d’hériter des luttes passées. De petites modifications, l’élargissement d’un passage, la création d’une ouverture juste assez large pour permettre à un plus grand nombre d’entre nous de faire face, et même d’y trouver assez de place pour passer. Une sociabilité qui se transforme en sagesse ; des passages secrets, des lieux de rendez-vous, des refuges, des informations qui passent et se transmettent pour savoir où aller et quoi faire. Tant de choses se produisent quand nous luttons pour exister, quand nous sommes confrontéEs aux vents contraires ; des inversions, des becs renversés, tout ce que nous bricolons ensemble avec les moyens du bord.
Comme c’est étrange, que de cette nécessité, nos vies se remplissent de possibilité ; comme c’est étrange et comme c’est queer.

Elle nous enseigne qu’il est possible pour celle·ux qui sont considéréEs comme des étrangerEs de s’installer dans des espaces qu’on avait pourtant considérés comme appartenant à d’autres. La boîte aux lettres aurait pu rester en usage ; le nid aurait pu être détruit avant d’être fini ; les oiseaux déplacé·es. Une histoire de l’usage est une histoire de déplacements, pour beaucoup violents, et souvent ignorés, parce que c’est ainsi que les choses, comme les lieux, restent occupées. C’est en raison de cette occupation, de cette manière qu’a l’histoire de s’installer, de ce poids, que les usages queers demandent de nous plus qu’un acte d’affirmation du caractère queer de l’usage. L’usage queer est le travail que nous devons mener pour queeriser l’usage.
Références
Bhabha, Homi K. « Signs Taken fsor Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi, May 1817. » Critical Inquiry, vol. 12.1, 1985.
Butler, Judith. Le Pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, (1997), traduit de l’anglais (États-Unis) par Charlotte Nordmann et Jérôme Vidal, Paris, Amsterdam, 2017.
Darwin, Charles. De la variation des animaux et des plantes à l’état domestique, tome 2, (1868), traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Edmond Barbier, Paris, C.Reinwald et Cie, 1880.
Darwin, Charles. L’Origine des espèces, (1859), traduit de l’anglais (Royaume- Uni) par Edmond Barbier, Paris, C. Reinwald et Cie, 1906.
Dumont, Léon. « De l’Habitude », Revue Philosophique de la France et de l’étranger, 1ère année, tome 1, n° 1-6, 1876.
Freeman, Elizabeth. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories, Durham, Duke University Press, 2010.
Garland- Thomson, Rosemarie. « Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept, » Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. vol. 26(3), 2011.
Gould, Stephen. Le Sourire du flamant rose. Réflexions sur l’histoire naturelle, (1985), traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Teyssié et Marcel Blanc, Paris, Seuil, 1988.
Gumbs, Alexis Pauline. Spill: Scenes of Black Feminist Fugitivity, Durham, Duke University Press, 2016.
Lamarck, Jean Baptiste. Discours d’ouverture des cours de zoologie donnés dans le Muséum d’Histoire Naturelle, (1800), Paris, Hachette-BNF, 2016.
Locke, John. Traité du gouvernement civil, (1689), traduit de l’anglais (Royaume- Uni) par David Mazel, Paris : Garnier-Flammarion, 1992.
Lorde, Audre. Journal du cancer suivi de Un souffle de lumière, (1988), traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédérique Pressmann, Laval/Carouge : TROIS/Mamamélis, 1998.
Lorde, Audre. « Les Usages de l’érotique », (1978), repris dans Sister Outsider. Essais et propos sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme…, traduit de l’anglais (États-Unis) par Magali Calise, Grazia Gonik, Marième Hélie-Lucas et Hélène Pour, Carouge, Mamamélis, 2003.
Lorde, Audre. La Licorne noire, (1978), traduit de l’anglais (États-Unis) par Gerty Dambury, Paris, L’Arche, 2021.
Moraga, Cherríe. « The Welder », dans Cherríe Moraga et Gloria Anzaldúa (dir.), A Bridge Called My Back : Writings by Radical Women of Colour, Watertown, Persephone Press, 1981.
Risatti, Howard. A Theory of Craft: Function and Aesthetic Expression, University of North Carolina Press, 2007.
Saïd, Edward. « Le Sionisme du point de vue des victimes », (1979), La Question de Palestine, Arles, Actes Sud, 2010.
Sedgwick, Eve Kosofsky. « Queer Performativity: Henry James’s The Art of the Novel. » GLQ, vol. 1.1, 1993.
La plainte, méthode queer

Tu pourrais bien avoir un combat à mener. Tu pourrais bien avoir à te battre pour te faire une place, une place pour exister, une place pour faire des choses, une place pour faire ton travail sans être remis·e en question ou surveillæ. Il se peut que tu doives te battre dans la vie pour te frayer un chemin sans danger, pour trouver une manière d’avancer, de progresser, d’arriver quelque part, sans avoir à rien abandonner, ni toi ni tes désirs. Un combat peut être riche de leçons : nous apprenons beaucoup en tentant de transformer des mondes qui ne s’adaptent pas à nous. Mais ce combat peut aussi s’avérer sacrément difficile ; lorsque tu dois lutter pour exister, à la fin tu peux avoir l’impression que l’existence est une lutte. Voilà pourquoi nous avons besoin les un·es des autres : nous devons devenir des ressources les un·es pour les autres. Lorsque je pense à la plainte comme méthode queer, je fais référence à cette histoire qui retrace les combats menés pour se faire de la place, et au fait que c’est en menant ce combat que nous sommes devenuz des ressources les un·es pour les autres. Si nous avons des programmes queers, des espaces queers, des événements queers, ce n’est pas simplement parce que ça fait du bien de les avoir (même si c’est le cas, et heureusement), c’est aussi parce que nous en avons besoin pour survivre aux institutions qui ne sont pas faites pour nous.
Dans mon dernier livre Complaint! [La Plainte !] (2021), je décris ainsi la plainte comme un travail contre-institutionnel ; pour créer des espaces au sein des institutions, il arrive bien souvent que nous finissions par y travailler à contre-courant. J’ai entamé mes recherches à ce sujet, inspirée par ce que j’ai traversé en soutenant un groupe d’étudianz qui avaient déposé une plainte collective pour harcèlement sexuel. Les étudianz avec lesquel·les je travaillais alors sont devenu·es ma collective de plainte. J’éprouve de la reconnaissance pour la participation de Leila Whitley, Tiffany Page, Alice Corble, avec le soutien de Heidi Hasbrouck, Chryssa Sdrolia et d’autres à l’écriture de l’une des deux conclusionsdu livre, au sujet du travail qu’ols ont réalisé en tant qu’étudianz. À la fin de leur conclusion, ols disent comment ols « ont fait bouger quelque chose » et comment « les choses ne sont plus telles qu’elles étaient avant ». Faire bouger quelque chose au sein d’une institution, revient parfois à bouger beaucoup de choses. Et cela peut réclamer beaucoup de nous.
J’introduis l’idée de « la plainte comme méthode queer » dans ma conclusion du livre. Et je souhaiterais aujourd’hui expliquer un peu plus ce que j’entends par là. Lorsque je parle de la plainte, je n’évoque pas seulement les mécanismes formels, j’inclus aussi les sens plus affectifs et incarnés de ce terme. Je m’intéresse en particulier à la manière dont certaines d’entre nous sommes entendues comme plaintives et jugées négatives, tant dans ce que nous sommes que dans ce que nous disons. Être entendues comme plaintives, c’est ne pas être entendues. Le livre s’ouvre sur ces mots, délibérément formulés avec force. Une universitaire lesbienne donne cette description :
Si un problème se présente et que tu portes plainte, alors tu deviens la femme qui se plaint, la lesbienne qui se plaint. Et ensuite, évidemment, tu deviens la sorcière que l’on chasse, la bouc-émissaire, la prétentieuse qui pose problème ; tu deviens la femme qui n’est pas à sa place ; tu deviens tout ce que ton harceleur t’accuse d’être, parce que personne ne t’écoute. Et tu n’aimes pas t’entendre parler ainsi mais tu finis par te retrouver dans cette situation, encore une fois. Tu les entends déjà dire « Et voilà, c’est reparti. »
Nous avons ri ensemble lorsqu’elle a dit cela, conscientes que l’une et l’autre reconnaissions la dynamique en jeu. Nous nous entendons au travers du son familier de l’usure des mots que nous partageons, de l’expérience de devoir affronter les mêmes situations, encore et encore.
La plainte semble saisir d’un tenant comment celle·ux qui défient le pouvoir deviennent le lieu de la négation, les plaignant·es deviennent alors des réceptacles pour les affects négatifs, des réceptacles qui fuient, qui débordent tout autant qu’ils parlent. Ce n’est pas rien, cette sensation de la négation. Pensez aussi au mot queer. Nous revendiquons ce mot, utilisé pour nous insulter ou nous calomnier, non pas en essayant de nous séparer de sa négativité mais en lui réassignant une nouvelle fonction, celle d’outil. La plainte peut, elle aussi, ré-orienter la négativité : en faisant de la négativité un outil.
Lorsque j’emploie l’expression « la plainte, méthode queer » je pense également à ma propre méthode, ma propre manière d’écouter les personnes qui portent plainte et comment cette écoute permet de collecter et de conserver des données, afin de leur donner une chance de mieux se déverser ailleurs. Ma méthode est une affaire d’oreilles : non pas un queer eye for the straight guy [regard queer pour mec hétéro], mais deux oreilles queers pour mes pairEs queers.
Les plaintes, des histoires pour sortir du placard
Les plaintes sont rendues confidentielles à partir du moment même où elles sont enregistrées. Elles ont lieu « à huis clos » — huis, un vieux mot pour dire porte — c’est la raison pour laquelle il y a tant de portes dans ces histoires.

L’oreille queer est peut-être une oreille collée contre une porte : nous n’écoutons pas simplement ce qui se dit de l’autre côté de la porte, mais nous écoutons aussi ce que nous dit la porte. Très tôt lorsque j’ai commencé cette recherche, j’ai remarqué que les portes ne cessaient d’y faire leur apparition, des portes concrètes, des portes aux poignées difficiles à actionner, des portes battantes, des portes qui servaient à indiquer ce que l’on peut ou ne peut pas faire, des portes pour désigner les lieux où l’on peut ou ne peut pas aller. L’expression « huis clos » peut décrire des portes bien réelles qui ont été fermées pour permettre à quelqu’un de raconter son histoire en toute confidentialité. Elle peut aussi faire référence au processus qui consiste à maintenir une chose secrète, à éviter qu’elle ne soit divulguée à un large public.
Dans Complaint!, je tente d’ouvrir une porte, de faire sortir ou d’exprimer une chose qui avait été gardée secrète. Ouvrir une porte peut prendre du temps. Une étudiante est harcelée par son directeur de recherche. Cette étudiante est une femme queer racisée, issue de la classe ouvrière, elle est la première personne de sa famille à entrer à l’université. Elle a dû énormément se battre pour arriver là où elle se trouve. Elle sait que quelque chose ne va pas. Son encadrant ne cesse de repousser les limites un peu plus loin, lui propose de se rencontrer en dehors de la fac, puis dans un café, puis chez lui. Elle essaye de gérer la situation : « J’ai fait de mon mieux pour que toutes les rencontres aient lieu à l’université, et pour qu’il y ait toujours une porte ouverte. » Elle garde la porte ouverte ; une porte bien concrète, au moment même où elle ferme une autre sorte de porte, qu’on pourrait nommer la porte de la conscience. « J’ai pensé que j’allais me porter préjudice en acceptant de voir la violence qu’il démontrait. » Se porter préjudice : parfois admettre la violence, accepter de la voir en action, peut te donner le sentiment d’être ta propre rabat-joie, de te mettre en travers de ta propre progression. Admettre peut signifier avouer, accepter de dire une vérité ; admettre peut aussi signifier intégrer, laisser quelque chose entrer. Notons combien les portes peuvent être le siège de contradictions : garder la porte du bureau ouverte revient à admettre une vérité que l’étudiante manie de sorte à ne pas la laisser entrer en elle. Il arrive que l’on ne puisse plus manier certaines poignées de portes :
À un autre déjeuner, j’étais assise avec une collègue et il a commencé à m’envoyer des photos de lui, nu, par texto, et ça a été le moment où j’ai atteint la masse critique, le seuil de ce que je pouvais supporter. J’ai dit, regarde ça, et elle était, tu vois ce que je veux dire, complètement abasourdie… Que tout d’un coup, ça s’insinue en moi, en elle, au milieu de cette conversation, à quel point c’était horrible et violent que j’aie à recevoir ces choses, et, voilà, en gros, c’est ça qui a mis le processus en marche.
Parfois, nous utilisons une poignée pour empêcher une violence dirigée contre nous de s’insinuer ou de s’infiltrer en nous. Lorsque la poignée cesse de fonctionner, la violence ne s’insinue pas seulement en elle mais elle atteint aussi sa collègue, ses conversations, l’espace même dans lequel elles ont cette conversation. Lorsqu’une plainte est adressée contre une chose, contre un objet, alors le sujet de cette plainte est difficile à contenir. Les objets volent en éclats. Les plaintes peuvent queeriser le temps aussi bien que l’espace, elles finissent éparpillées, en charpie, tout comme nous.
Lorsque la violence entre, une plainte sort. Cependant, ce n’est pas un interrupteur, une qui entre, une qui sort. Pour qu’une plainte voie le jour, l’étudiante doit porter plainte, elle doit continuer d’énoncer sa plainte : « Je pense que j’ai commencé à croire que si j’exposais ça publiquement, ma propre carrière allait en souffrir. » Son usage du terme « exposer », et ce, « publiquement » nous enseignent comment les plaintes, voyageant loin de nous, emportent quelque chose de nous au passage. Exprimer une plainte, l’exposer, c’est précisément l’envoyer dans le monde au sujet duquel la plainte est déposée. D’où le titre donné à la deuxième partie de Complaint!, « The Immanence of Complaint » [L’Immanence de la plainte]. Judith Butler a demandé en 1991 : « Le sujet enfin sorti du placard est-il libre de toute subjectivation et enfin à l’abri ? » Il me semble que nous savons que non. Butler poursuit : « par convention, on dit qu’une personne “sort du placard” […] nous sommes donc sorti·es du placard, mais où sommes-nous alors entræs ? Dans quelle nouvelle spatialité sans bornes ? La chambre, le salon, le sous-sol, le grenier, la maison, le bar, l’université ? » Butler évoque ensuite une porte qui enferme : la porte de Kafka, une porte qui semble promettre quelque chose, une ouverture, « de l’air frais », la « lumière d’une illumination qui n’arrive jamais. »
Porter plainte, c’est aussi en un sens sortir du placard, s’exposer, ne plus être à l’abri. C’est « entrer » dans le monde même qui refuse d’admettre cela et celle·ux-là qui se plaignent. Peut-être es-tu parvenu·e à admettre ce qui t’était arrivé, mais lorsque tu essayes de le dire aux autres, comme l’a fait cette étudiante, tu entends encore davantage de portes se refermer. Entrer quelque part, c’est aussi atteindre quelque chose ou quelqu’un : tu adresses ta plainte à une personne, à un bureau. Elle s’adresse au bureau responsable de la gestion des plaintes : « I·elles faisaient genre, “tu peux déposer une plainte. Mais il est vraiment très apprécié de l’université, il a de nombreuses publications à son actif, tu vas devoir passer par toute cette souffrance émotionnelle.” On m’a même suggéré qu’il pourrait ensuite porter plainte contre moi pour diffamation. En gros, on me disait “tu peux le faire, mais pourquoi le voudrais-tu ?” » L’avertissement qui te prévient qu’une plainte aura de sérieuses répercussions pour toi peut prendre la forme du fatalisme institutionnel : des affirmations qui décrivent les institutions, qui décrivent ce qu’elles sont en décrivant ce qu’elles seront, en désignant quels types de personnes elles sont susceptibles d’apprécier, de protéger.
En fin de compte, elle n’a pas déposé plainte officiellement parce qu’elle comprenait ce qu’on lui disait : qu’elle n’irait nulle part, que ça n’aboutirait à rien, parce que lui au contraire irait là où il voulait.
Quel lien existe-t-il entre le fatalisme institutionnel et ce que j’appelle le fatalisme queer ? Le fatalisme queer (Ahmed, 2017), c’est le présupposé selon lequel être queer c’est se précipiter vers un destin pitoyable, qu’être queer (une vie faussement décrite comme un « style de vie »), c’est se mettre sur la voie de ce qui fait du mal, de telle sorte que si ça tourne mal — et soyons réalistes, ça arrive toujours à un moment ou à un autre — tu ne pourras t’en prendre qu’à toi-même. Lorsqu’on te déconseille de te plaindre, ce que l’on te demande c’est de rectifier ton attitude, de rentrer dans le rang des institutions, de donner de la valeur à ce qu’elles valorisent, d’aimer celle·ux qu’elles aiment, de protéger celle·ux qu’elles protègent, si du moins tu prétends suivre la voie de la réussite. Rien de surprenant dès lors, à ce qu’une plainte puisse avoir une trajectoire queer.
Si tu t’éloignes de cette voie, si tu te plains non seulement des personnes qui sont aimées et protégées par les institutions mais aussi du système lui-même, alors quoi ? Tu ouvres la porte de la conscience pour t’apercevoir qu’une nouvelle porte se ferme. C’est ainsi que les portes nous parlent du temps, le temps de la répétition, des actions que nous devons sans cesse entreprendre, des arguments que nous devons sans cesse défendre. Cela peut exiger du temps et aussi des efforts pour qu’une plainte sorte au grand jour. Les personnes queers et trans savent bien que faire son coming-out, sortir du placard, ne se fait pas en une fois, en un événement unique. Il te faut sans cesse faire ton coming-out à cause de l’habitude qu’a le monde de s’attendre à un certain type de corps ; sans cesse corriger les pronoms qu’on utilise pour tes partenaires ou pour toi. S’exposer, sortir du placard, comporte cet épuisant travail de correction, et la correction est souvent entendue comme une plainte, un reproche, comme négative, assertive, exigeante. Si tu dois continuer à sortir du placard à chacune de tes remarques, les frontières entre l’intérieur et l’extérieur finissent par devenir floues. Je pense à la manière dont Ahmed Ibrahim (2020) crée une brèche dans cette structure dedans/dehors en offrant une puissante relecture du placard à la lumière des vies et des archives queers en Égypte. Ibrahim utilise le langage de l’infiltration, la manière dont la queerité suinte, rendant plus difficile la distinction entre le dedans et le dehors.
Une enseignante-chercheuse en début de carrière était harcelée sexuellement par un professeur plus âgé, son supérieur hiérarchique, principalement sous la forme de sollicitations constantes — il lui envoyait des e-mails sur son désir de lui sucer les orteils. Elle pensait avoir géré la situation en s’adressant à sa responsable hiérarchique pour que celle-ci demande à ce professeur d’arrêter, sans savoir que sa responsable n’avait pas donné suite à sa demande. Lorsqu’une plainte n’est pas transmise, le harcèlement se poursuit.
Ensuite, j’étais en réunion avec ma responsable hiérarchique et son responsable hiérarchique, et nous étions dans ce bureau tout petit, une salle de réunion qui ressemble à un bocal à poissons rouges. Et à côté, il y avait le grand espace de travail où les bureaux de toute l’équipe se trouvent, et il m’a envoyé l’e-mail et j’ai émis un son, « eehhhhh », c’est impossible de bien le décrire, c’est comme si on moulinait lentement tes tripes comme dans un hachoir à viande, « mon dieu, ça ne va pas s’arrêter », et j’ai émis ce son à voix haute, et le responsable de ma responsable a demandé : « Qu’est-il arrivé ? » J’ai retourné mon ordinateur et je lui ai montré et son commentaire fut : « Bon sang, comment peut-on être aussi stupide pour mettre ça dans un e-mail ! » On pouvait voir la panique dans son regard à elle. Du genre, merde, ça n’a pas disparu comme par magie.
Ce son, ce « eehhhhh » transperce la réunion, cette réunion qui prend place dans la petite pièce en verre, un bocal, où tous·tes sont visibles. Une chose peut devenir visible et audible parfois malgré toi. Une plainte, c’est ce qui sort lorsque tu ne peux pas en encaisser davantage, tu ne peux tout simplement pas en recevoir davantage ; tes tripes comme de la viande hachée, une plainte comme ce qui te retourne de fond en comble. Remarquez comment, une fois le problème entendu, il n’est pas tant traité comme celui du harcèlement que comme celui d’en avoir une preuve (« Bon sang, comment peut-on être aussi stupide pour mettre ça dans un e-mail ! »). Un son peut devenir une plainte car il fait remonter à la surface la violence présente dans une pièce, une violence que l’on n’aurait pas affrontée autrement. Le responsable de sa responsable, maintenant alerté, et ce, en présence de témoins, entame une procédure officielle. Elle utilise le mot implosé pour décrire ce qui arriva ensuite. Elle participe à une nouvelle réunion.
Et cette réunion n’en finissait pas, et c’était genre, on passait par tous les points et mon chef n’était pas là, il ne participait pas, et il est devenu évident à ce moment-là que quelque chose se jouait qui me dépassait. C’était la première fois que je me rendais compte de l’ampleur du pétrin. Le professeur a disparu ; soudain il n’était plus là. Avait-il été renvoyé ou avait-il démissionné ? Je ne l’ai jamais su. Mais ce qu’il raconta à mes collègues, c’est qu’il avait été forcé de partir à cause de moi. On a toutes entendu ça des milliers de fois.
La plainte, des histoires sur les institutions
Je voulais commencer par ces deux histoires de plaintes, par la manière dont elles sont sorties au grand jour : des histoires assez compliquées, des histoires queers. Les récits de plaintes produits par l’institution sont assez différents. Sur le papier, et telle est probablement la manière institutionnelle de raconter l’histoire, une plainte peut prendre l’aspect d’un diagramme bien propret, avec des lignes droites et des flèches bien pointues, offrant à la personne qui deviendra la plaignante un itinéraire tout tracé. Mais si l’on voulait représenter le dépôt de plainte du point de vue des plaignant·es, cela ressemblerait plutôt à l’image ci-dessous : une belle pagaille, un imbroglio. Une fois qu’on est dedans, on ne trouve plus comment en sortir.

Et si cette pagaille donne l’image d’une plainte, elle peut aussi être l’image de ta vie, une vie qui s’effiloche. L’enseignante-chercheuse en début de carrière dont la plainte est sortie sous la forme d’un son donne cette description : « C’était comme être prise au piège dans un mauvais rêve où tu dois sauter d’une partie à une autre car tu n’en connais pas le scénario. » Déposer plainte peut donner l’impression d’être le personnage de l’histoire de quelqu’un d’autre. Tu sais que ce qui se passe n’est pas ce qui est censé arriver, mais tu ne comprends pas pour autant ce qui arrive. Je m’en souviens pour l’avoir vécu : tu as toutes ces conversations, les réunions s’enchaînent, mais la plupart des personnes avec lesquelles tu travailles ne savent pas ce qui se passe ; tu dois continuer ton autre travail, le travail pour lequel tu as été embauché·e ; et ce monde, prétendument réel, ce monde lumineux et parfait sous tout rapport, commence à devenir de plus en plus irréel, à l’envers, sens dessus dessous. Une plainte peut faire de ta relation à l’institution une relation queer, queer dans son ancien sens de bizarre. Dans mes entretiens, je retrouve partout ces mêmes mots : particulier, bizarre, étrange, surréel, déroutant.
Le manque de clarté devient le monde que tu habites. Une enseignante-chercheuse dépose plainte pour harcèlement contre la cheffe de son département, et elle le fait en partie parce que son université a développé de nouvelles politiques et procédures de dépôt de plainte. Elle décrit ces nouvelles réglementations comme « une simple façade », et dit qu’« i·els ne pensaient pas ce qu’i·els disaient ». Une politique annoncée peut être l’affiche de premier plan d’une institution. Lorsque tu portes plainte, tu commences à voir au-delà des apparences. C’est la raison pour laquelle je parle de la plainte comme d’une phénoménologie de l’institution : tu fais passer à l’avant ce qui avait été relégué à l’arrière-plan. Tu dois faire demi-tour, retourner sur tes pas. Porter plainte, c’est assurément revenir en arrière, rembobiner le temps. Tu dois repasser sur ce qui n’est pas passé ; la plainte a une temporalité particulière, une temporalité queer, qu’on pourrait décrire avec l’expression temporal drag [traînée temporelle : un temps qui traîne et s’étire] de Elizabeth Freeman (2010) : les plaintes traînent, les réunions s’étirent, encore et encore. Se plaindre, c’est retourner en arrière dans un sens spatial, tu vois ce qui se trouve « au dos des choses », pour réemployer une expression que j’utilise dans Queer Phenomenology.
Une autre universitaire tente de faire appel à des réglementations existantes au cours de sa plainte déposée pour plagiat et racisme. Elle aboutit au même constat : « Ces réglementations sont vides de sens ». On pourrait décrire ces réglementations comme non performatives. Elle ajoute : « On m’a dit qu’il s’agissait désormais d’une procédure officielle. Il m’a fallu éplucher toutes les réglementations. J’ai découvert ce brouillard. Il était permanent. Chaque fois que quelque chose de clair m’apparaissait — si l’on suit la réglementation, n’est-ce pas cela qui est censé se passer ? blablabla — ça a duré environ dix ans, n’est-ce pas cela qui est censé se passer ? Et on me répondait non. » Se voir répondre « non », c’est entendre que peu importe depuis combien de temps une réglementation est en vigueur, elle n’aura pas d’influence sur ce qui se passera. Même si les réglementations ne sont pas respectées, elles existent tout de même sur le papier. Pour ces réglementations qui n’existent pas sur le papier, elle parle de « réglementations de l’ombre ». Elle utilise cette expression pour rendre compte du fait que ses collègues universitaires blanc·hes se voyaient accorder plus de temps de recherche que les universitaires racisæs. En raison d’arrangements passés en coulisse, et malgré des engagements officiels censés garantir une équité de traitement, la répartition des crédits de recherche finit toujours par avantager les universitaires blanc·hes.
Une ombre est une surface sombre qui résulte d’une obstruction : une source projette une lumière, qui se retrouve bloquée par un objet opaque. L’expression « réglementations de l’ombre » nous dit quelque chose du lieu où les décisions sont prises, nous apprend quelque chose des surfaces non éclairées d’une pièce, tout comme elle nous informe sur la manière dont ces zones sont créées. La première partie de Complaint!, intitulée « Institutional Mechanics » [Mécaniques institutionnelles], explore le fossé entre ce qui est censé se produire lorsque l’on porte plainte et ce qui se produit effectivement. Porter plainte revient à découvrir le fossé entre deux universités : d’une part, l’université telle qu’elle apparaît sur le papier, avec des réglementations qui existent et qui ne sont pas appliquées, une université fictive « dédiée à la diversité et à l’égalité » (comme elle n’a de cesse de le dire à propos d’elle-même) ; et d’autre part, l’université telle qu’elle est, avec des réglementations qui n’existent pas mais qui sont appliquées, avec l’inégalité comme mode opératoire.
Tu te retrouves au bord d’un trou. « Prenez garde à l’intervalle entre le marchepied et le quai ». Tu tombes en plein dedans.

Cet écart, parce qu'il nous donne des informations sur la plainte, nous en donne aussi sur l’université. C’est pourquoi il était important pour moi de montrer ce que celle·ux qui portent plainte savent. J’ai parlé avec une enseignante-chercheuse en début de carrière au sujet d’une plainte déposée après que son université a refusé d’adapter sa charge de travail au retour d’un long congé maladie. Elle est neuroatypique et elle a besoin de temps pour reprendre le travail, pour faire son travail. Même si elle a la preuve que l’université n’a pas respecté ses propres réglementations et procédures, sa plainte n’aboutit pas. Voici les mots qu’elle utilise pour décrire ce travail :
C’était comme un oisillon qui aurait essayé de se défendre en griffant de ses petites pattes sans que cela ait le moindre effet. Un tout petit, tout petit oisillon ; petit et caché derrière une porte fermée. Je pense que peut-être les gens croient qu’à cause de la nature de la plainte, et parce que j’avais été en congé maladie, il fallait être poliEs et ne pas en parler. Et je pense aussi qu’une grande partie de leur politesse provenait du fait de ne pas vouloir dire quoi que ce soit à ce sujet. Et cela a peut-être à voir avec le fait d’être dans une institution et avec la manière dont elles sont construites ; de longs couloirs, des portes qui ferment à clé, des fenêtres rendues opaques par des volets que l’on déroule, il semble que cela s’imprègne dans chaque espace, une impression d’enfermement, sans air, où on suffoque.
La plainte que tu portes peut revêtir un caractère d’extériorité, devenir une chose dans le monde ; tu grattes, petit oiseau, tu mets toute ton énergie dans une activité qui a tant d’importance pour ce que tu peux faire, pour ce que tu peux être, mais qui semble à peine laisser une marque. Plus tu essayes, plus cette trace s’estompe et plus tu t’estompes avec elle ; comme elle, tu deviens de moins en moins visible. Je pense à ces oiseaux qui grattent de leurs griffes et je pense aussi à la description donnée par une travailleuse de la diversité au sujet de son travail : « un boulot à se cogner la tête contre un mur en brique ». Lorsque le mur ne bouge pas, c’est toi qui finis par avoir mal. Et il semble que tu n’aies fait qu’égratigner la surface. Cette égratignure, cette griffure, te fait sentir les limites de ce que tu es en mesure d’accomplir.
Lorsque j’ai entendu les oisillons de son histoire, mes oreilles queers se sont dressées. Dans mon livre sur les usages de l’usage, What’s the Use? [À quoi ça sert ?] (2019), j’utilise l’image de l’usage queer, cette manière dont les choses peuvent être détournées des usages pour lesquels elles avaient été conçues, par celle·ux pour qui elles n’avaient pas été conçues.

Les oiseaux font de la boîte aux lettres un nid. Voici une image plutôt heureuse et pleine d’espoir. Généralement, lorsque nous nous retrouvons dans des institutions qui n’ont pas été pensées pour nous, on nous intime de retourner à notre propre boîte, de retourner d’où nous venons, de rentrer chez nous.
Si cet oiseau qui donne des coups de griffes constitue une plainte, la tentative de créer un (presque) nid dans un environnement hostile constitue une plainte. Pourquoi convoquer l’expression « environnement hostile » ? De nombreuses mesures pour lutter contre le harcèlement utilisent l’expression « environnement hostile » pour décrire les cultures du travail discréditant ou humiliant une ou plusieurs personnes. Au Royaume-Uni, l’expression « environnement hostile » a depuis été utilisée par le gouvernement pour nommer des mesures sur l’immigration illégale. Le fait qu’une expression qui servait déjà de définition pour nommer le harcèlement au travail se retrouve employée pour décrire ces mesures nous montre comment le harcèlement devient une mesure nationale. La catégorie de « l’immigrant·e illégal·e » est une catégorie racialisante ; tu peux être racisé·e ou Noir·e et né·e ici et il se peut pourtant que l’on continue de te demander de repartir, de rentrer chez toi — oui c’était un message exhibé sur une fourgonnette — le harcèlement racial comme mesure nationale, le droit de questionner celle·ux qui semblent ne pas être d’ici.
Le droit de questionner celle·ux qui semblent ne pas être d’ici, le droit de questionner certaines personnes en raison de ce à quoi elles ressemblent. Um étudianx trans racisæ porte plainte pour harcèlement sexuel et harcèlement transphobe de la part de son encadrant qui ne cesse de lui poser des questions intrusives sur son genre et ses organes génitaux. Les questions peuvent devenir des coups de massue ; pour certains, être questionnæs = être remiz en question. Ces questions s’intègrent à un langage du souci pour la sécurité de l’étudianx, partant du principe qu’ol serait en danger si ol menait ses recherches dans son pays natal. Les jugements racistes placent souvent le lieu du danger « là-bas » dans un ailleurs non blanc. Les jugements transphobes placent souvent le lieu du danger « ici même », dans le corps de la personne trans : comme si le fait d’être trans était une incitation à la violence que tu reçois. Lorsqu’ol porte plainte, que se passe-t-il ? Ol raconte : « Les gens essayaient d’évaluer s’il avait raison de croire que j’étais en danger physique ou non à cause de mon identité de genre… comme pour dire qu’il avait raison d’être inquiet. » Les mêmes questions intrusives qui t’ont amenæ à porter plainte te sont à nouveau posées parce que tu portes plainte. Avoir raison de s’inquiéter devient avoir le droit de s’inquiéter. Aujourd’hui, un grand nombre de cas de harcèlement est produit sous couvert du droit à s’inquiéter. Nous avons le droit d’être préoccupé·es par l’immigration (en tant que « citoyen·nes ») ; nous avons le droit d’être préoccupé·es au sujet des droits liés au sexe (en tant que « femelles humaines adultes »). Ce droit à l’inquiétude est ce qui cautionne la production de la violence, une violence qui s’appuie sur la suspicion que certaines personnes ne sont pas qui elles prétendent être, que certaines personnes n’ont aucun droit d’être là où elles sont, que certaines personnes n’ont aucun droit d’être.
Les plaintes au sujet d’environnements hostiles sont déposées dans des environnements hostiles. Une femme racisée m’a parlé d’une conversation qu’elle a eu avec son chef de département. Elle essaye de lui expliquer pourquoi les étudianz racisæs ne pensent pas qu’i·els peuvent porter plainte pour racisme :
Il a dit qu’il avait de la compassion à cause du Brexit puis il a commencé à parler d’étudianz musulmanEs attaquéEs dans le bus. J’ai répondu : « Le département reproduit une culture qui n’est pas inclusive, malgré toute la compassion que tu peux ressentir. Si tu as vécu cette expérience dans le bus, tu ne vas pas venir dans ce département universitaire pour en parler, n’est-ce pas ? Ce même département où les personnes blanches, lorsque tu viens te servir une tasse de thé, s’éloignent dans un autre espace de la pièce. » Il semblerait qu’une plainte pour racisme puisse être reçue avec compassion si le racisme est ailleurs, à l’extérieur, dans la rue, dans le bus.
La déclaration de compassion du responsable du département, sa performance de la compassion, est dirigée vers le racisme se trouvant là-bas. Mais regarder le racisme qui a lieu là-bas peut être ta manière de ne pas voir celui qui se produit ici, cela peut être ta manière de ne pas voir comment tu le produis ici (des personnes blanches qui changent de place dans une pièce). Le racisme peut être ce qui empêchera une plainte pour racisme d’être déposée.
Je pense à la manière dont les réglementations peuvent, quand elles sont promulguées, devenir ce qui nous empêche de voir ce qui se passe. La diversité aussi peut produire cet effet : quand la diversité apparaît, elle peut nous empêcher de voir ce qui se passe et comment cela se passe. L’institution peut donner l’impression d’être accueillante, l’institution et sa porte ouverte, entrez entrez minorités, vous êtes les bienvenues. Mais ce n’est pas parce qu’on t’annonce la bienvenue qu’on s’attend pour autant à ce que tu débarques. Parfois tu ouvres une porte et la seule chose que tu trouves derrière c’est un environnement hostile, autrement connu sous le nom de comité pour la diversité. Cette chercheuse racisée décrit son expérience : « Je siégeais dans le groupe pour l’égalité et la diversité de l’université. Et dès que je commençai à évoquer des sujets relatifs à la race, on changea le profil des personnes qui pouvaient participer au comité et j’en fus virée. » Si on se débarrasse de toi lorsque tu commences à mentionner des choses en lien avec la race, c’est que le comité pour la diversité est ce qui permet de ne pas mentionner des choses en lien avec la race. À un autre moment, elle écrit un article pour un numéro spécial d’une revue sur la décolonisation de sa discipline. Elle reçoit un retour de l’éditeur·ice blanc·he : « On me répond : “a besoin d’être adouci, pas suffisamment d’apports de la littérature scientifique pour soutenir les arguments avancés.” En gros, retourne dans ta boîte. Et si tu veux décoloniser, on le fera à notre façon. » Être renvoyée du comité pour la diversité pour avoir « mentionné des choses en lien avec la race » est en continuité avec la demande d’adoucir les propos d’un article rédigé pour un numéro spécial sur la décolonisation. La blanchité peut très bien occuper des territoires avec le label décolonial, je nomme parfois cela la blanchité décoloniale.
« Retourne dans ta boîte. » Je repense à la boîte aux lettres qui est devenue un nid. On aurait pu imaginer un autre mot sur cette boîte : cher·es oiseaux, soyez les bienvenu·es !

La diversité est ce mot, cette affiche. Cette affiche serait non performative si la boîte aux lettres était toujours utilisée, car les oiseaux seraient délogé·es par les lettres, un nid détruit avant d’avoir eu le temps d’être créé. Toutes ces questions : « Qu’est-ce que tu es ? », « D’où tu viens ? », ces consignes : « Baisse d’un ton, adoucis ton propos », fonctionnent comme des lettres s’accumulant dans la boîte jusqu’à ce qu’il ne reste plus de place, plus d’espace pour respirer, pour faire un nid, pour exister. Si la diversité est cette affiche, alors la diversité masque l’hostilité d’un environnement.
« Un homme important » (et autres histoires de reproduction)
Une étudiante de master hésitait à porter plainte contre le comportement d’un professeur. Elle avait déjà remis en question son programme qui ne comportait jusqu’à la dixième semaine que des hommes blancs. Un jour, elle doit rédiger un essai dont il assure le tutorat ; elle lui dit qu’elle souhaite rédiger un essai sur le genre et la race. Il lui répond : « Si tu écris sur ces sujets de merde, je t’assure que tu ne valideras jamais ce cours ; si tu crois que ces questions sont pertinentes dans mon cours, alors t’as vraiment rien pigé. » Lorsque tu poses les mauvaises questions, tu constates la violence de la correction. Mais ensuite il dit : « Attends, tu sais quoi ? T’es tellement vieille, on en a un peu rien à faire de tes notes, c’est pas comme si t’avais une carrière universitaire devant toi. Donc vas-y, tu peux bien écrire ce que tu veux. T’auras pas ton semestre, mais on s’en tape, pas vrai ? T’es pas là pour avoir de bonnes notes, t’es pas là pour une carrière, c’est clair que t’es là parce que tu veux apprendre. Donc ouais, tu peux bien écrire ce que t’avais en tête, ça n’a pas la moindre importance. » Elle se voit effacée par ses propos. La plaignante, qui remet en question le contenu du programme, devient la féministe qui pose les mauvaises questions. Elle devient la vieille femme dont personne ne se soucie qu’elle ait raison ou non, à la fois sorcière et vieille bique, parce qu’elle ne peut pas aller plus loin, elle n’ira pas plus loin.
Elle décide de déposer une plainte officielle parce qu’elle « veut éviter à d’autres étudianz d’avoir à subir de telles pratiques. » La plainte peut être pensée comme un travail non reproductif : le travail que tu dois fournir pour empêcher que les mêmes choses se produisent, pour empêcher la reproduction d’un héritage. Lorsqu’elle informe læ déléguæ syndicalx du master qu’elle a l’intention de porter plainte, elle reçoit un avertissement : « Fais attention, c’est un homme important. » Un avertissement est autant un jugement qu’une consigne à suivre. Elle poursuit la procédure. Et, au passage, elle « sacrifie les lettres de recommandation qu’il aurait pu [lui] écrire ». Évoquant son projet de doctorat, elle dit « cette porte est fermée. » Cette porte est fermée, les recommandations peuvent être des portes, ce qui empêche certaines personnes de continuer d’avancer. Quand la porte se referme sur sa plainte et sur elle, elle n’est plus là pour apporter à l’institution ce qu’elle aurait pu lui apporter, alors que la porte est maintenue ouverte pour lui, pour qu’il puisse continuer de faire ce qu’il a toujours fait, là où il a l’habitude de le faire, en huis clos.
La figure de l’« homme important » nous montre comment fonctionnent les institutions, pour qui elles fonctionnent. Une universitaire à la retraite m’a raconté la manière dont sa candidature pour être promue professeure avait été « mise à la poubelle ». L’université avait décidé de n’accorder qu’un seul poste de professeur·e au cours de ce processus d’avancement, « donc, à votre avis, qui a effectivement été mis en avant ? Évidemment, un homme largement moins compétent que n’importe laquelle des femmes qui avaient postulé… L’argumentaire du responsable du département reposait sur l’importance des contacts et relations qu’avait cet homme dans la communauté… pour qu’il reste, il fallait lui donner la promotion, parce que le département ne voulait pas le perdre. » Le département ne voulait pas le perdre : une porte lui est ouverte en raison des personnes qu’il amène avec lui.
L’importance dépend souvent des relations. Pour progresser, il est probable qu’on te dise qu’il te faut le bon réseau, les bonnes relations. On te dira peut-être de ne pas te plaindre au sujet d’un homme important parce que tu as besoin d’une recommandation de sa part. Ou on te dira peut-être de te référer à un homme important. Plus on emprunte un chemin, plus ce chemin est emprunté. Plus on le cite, plus il est cité. Nous n’apprenons pas seulement qui citer mais aussi comment le faire. Sarah Franklin a mené une enquête sur le sexisme à l’université (Franklin, 2015) en partant de la réaction assez extrême du professeur P à l’une de ses dissertations, une dissertation féministe sur Émile Durkheim. Les annotations du professeur P, principalement réalisées au stylo rouge, recouvraient l’ensemble de son écrit et en faisaient une sorte de document sanglant. Franklin montre comment le sexisme peut être un « moyen de la reproduction » fonctionnant par « interdiction ou encouragement à choisir un chemin — en bloquant par exemple une conversation ou un débat qui s’engageraient dans la “mauvaise” direction, ou en facilitant la “bonne” manière de penser ou de critiquer, créant ainsi des espaces dans lesquels évoluer. »
L’interdiction ou l’encouragement. L’interdiction est une histoire de portes évidente : on t’empêche de faire quelque chose parce qu’on t’interdit d’accéder à l’endroit où tu pourrais le faire. Tu pourrais bien te retrouver sans carrière tracée devant toi si tu ne suis pas le bon chemin, qu’il s’agisse du choix d’une discipline ou d’autre chose. Un chemin, une ligne. Je pense à la manière dont même le processus de décolonisation de certaines problématiques nous demande de « marcher en équilibre sur un fil ». Rappelez-vous cette femme racisée à qui l’on a demandé « d’adoucir son propos », peut-être ne lui demandait-on pas seulement d’estomper sa présence dans son texte mais aussi de citer correctement, de citer blanc. L’encouragement est également une histoire de portes, une histoire de portes un peu moins évidente, mais une histoire de portes néanmoins : on te dit comment tu dois procéder pour qu’une porte ne te soit pas fermée. Un peu plus tôt, j’ai suggéré que les avertissements nous conseillant de ne pas porter plainte sont une manière de nous dire de nous aligner sur l’institution. Les avertissements déconseillant de porter plainte font partie d’un ensemble d’actes discursifs que nous nommons souvent conseils d’orientation professionnelle.
Ne pas se plaindre revient à développer une attitude plus positive envers l’institution et tout ce qu’elle lègue à sa suite. Une chercheuse racisée décrit,
Il y a un accord entre les gens : il ne faut pas faire de vagues. Les gens parlent de l’institution comme d’un héritage, et suggèrent que tu ne comprends tout simplement pas l’histoire de l’institution, la manière dont elle s’est formée. Cela implique de respecter la manière dont ce lieu s’est organisé, de même que l’essence de ses traditions. Et si tu ne te plies pas à cela, c’est parce que ça ne fait pas encore dix ans que tu es là.
Faire d’un héritage un projet, c’est s’engager dans une relation à ce qui a été reçu du passé. Pensez aux mots qu’elle emploie : « respecter », « se plier », mais aussi « comprendre ». Cela sous-entend que porter plainte revient à donner la preuve de notre manque d’expérience dans une institution que l’on n’a pas fréquentée assez longtemps pour la respecter, pour respecter son organisation, ses traditions.
Tu deviens un·e plaignard·e lorsque tu n’as pas, ou pas encore, intégré les normes de l’institution. Plus haut, j’ai montré comment la figure de la plaignante devient un contenant pour de l’affect négatif. La négation est aussi une relation à l’institution. Tu deviens unE plaignardE lorsque tu ne parviens pas à reproduire un héritage institutionnel. Vous vous souvenez de la femme racisée qui a été virée du comité pour la diversité après avoir parlé de sujets relatifs à la race ? Il te suffit d’utiliser le mot race pour qu’on dise que tu es en train de te plaindre ; ce mot est la preuve que tu n’as pas intégré les normes de l’institution. Elle explique : “Dès que tu soulèves un problème, on te répond que tu n’es pas l’unE des leurs.” Une plainte semble amplifier ce qui te rend inadaptéx, en mettant le doigt sur ce que tu n’es pas.
La personne qui se plaint devient l’étrangère. Tu n’as pas besoin de porter plainte pour devenir cell·ui qui se plaint. Je parlais avec une universitaire lesbienne qui est devenue la première femme à prendre la tête de son département et, comme on s’en doute, la première lesbienne. Un jour, um étudianx la présente comme la responsable lesbienne du département. « Des collègues en ont ensuite discuté, c’était comme si j’exhibais une pancarte, incitant les étudianz à prendre part à cela. » Le simple fait d’être appelée responsable lesbienne du département peut donner l’impression que tu cherches à servir tes propres intérêts, tes intentions cachées. Certaines personnes sont jugées insistantes, comme si elles cherchaient à faire des vagues, à s’imposer par le simple fait de ne pas être ou de ne pas chercher à reproduire le même. Être désignée comme une universitaire lesbienne c’est presque déjà « soulever un problème », c’est comme brandir un drapeau. + Lorsque tu soulèves un problème, ou qu’un problème est soulevé à ton sujet, cela est considéré comme la preuve que tu n’as pas ta place ici ou que ce lieu n’est pas fait pour toi. Le fait d’être à sa place, cette appartenance au groupe ou au lieu, peut s’exprimer par une proximité ou par une gentillesse. Une autre universitaire décrit ainsi un incident :
C’était vraiment étrange. On était au bureau, à l’université, et il a commencé à parler de l’un de mes cours et a dit : « L’inspecteur a dit quelque chose » et j’ai répondu : « En fait je ne suis pas d’accord avec l’inspecteur »… et là il a répliqué : « Eh bien va te faire foutre, t’y connais rien, cet inspecteur est un grand professeur. Dégage ! Tu te prends pour qui pour parler de lui comme ça en public ? » J’ai appris plus tard que l’inspecteur est l’un de ses plus proches amiz. Alors je suis allée voir la présidente de l’université pour dire ce qui était arrivé et elle m’a répondu : « Tu sais, c’est un peu l’oncle relou de l’établissement. Il est comme ça c’est tout, faut laisser couler. »
Des réseaux d’amiz, des relations familiales. L’oncle relou apparaît ici comme une figure, comme ce qui est familier, mais aussi comme une consigne qui lui est donnée à elle : laisser couler, ne pas se plaindre, accepter le comportement agressif et abusif, parce que c’est de cela que les familles sont faites, parce que c’est comme ça qu’on fait en famille. La personne qui se plaint devient non seulement extérieure au nous mais aussi extérieure à la famille. Pour être « l’unE des leurs » ou bien pour ne pas être « pas l’unE des leurs » tu dois être en relation avec « un homme important », t’apparenter à lui. Je pense à cette post-doctorante qui a été incapable de trouver qui que ce soit pour soutenir sa plainte déposée contre ses encadranz. Um autre étudianx lui dit : « Je suis là depuis l’âge de 17 ans. J’ai grandi avec ces personnes. Je ne peux rien faire. » Progresser dans les études s’apparente à grandir en tant que personne, se plaindre devient une chose que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire est ce qui les protège. J’ai échangé avec une universitaire dont le travail a été plagié par un collègue. Le président lui demanda de « garder le silence à ce sujet car c’est la famille. Il ne cessait de me rappeler à moi, une lesbienne, que [ce collègue] a une femme et un enfant. » Elle entendait très bien ce qu’on lui disait, que si elle portait plainte elle ne lui porterait pas seulement préjudice à lui mais aussi à sa famille. Il est possible que ce rappel lui soit adressé à elle comme à une personne n’ayant pas de famille à protéger. La protection d’une personne devient la protection de ses proches.
Quand je pense à la protection, j’entends le silence. Quand je repense à mon expérience de plainte, j’entends le silence. Le silence peut être un mur. Je pense aux efforts fournis pendant trois années pour essayer d’obtenir de l’université qu’elle reconnaisse le problème de harcèlement sexuel. Nous n’avons même pas réussi à obtenir une reconnaissance publique du fait que ces enquêtes avaient eu lieu. C’est comme si ça n’avait jamais existé, ce qui était, je n’ai aucun doute là-dessus, l’effet recherché. La toute première mention publique à leur sujet fut d’ailleurs une publication sur mon blog, écrite juste après avoir démissionné, ce qui vous en dit certainement beaucoup sur les raisons de ma démission. L’université traita mes publications en ligne au sujet de ma démission comme une fuite d’informations, une pagaille que je semais, des dommages que je leur causais. Mais il n’y a pas que l’université qui a jugé mes révélations dommageables. Une collègue féministe a décrit mon action comme « non professionnelle » car elle a eu « des répercussions qui nous nuisent à nous tous·tes maintenant et dans l’avenir. » Nous apprenons ce que signifie être professionnel·les. Être professionnel·le, c’est accepter de garder les secrets de l’institution. Il est important de noter que ce silence n’est pas uniquement soutenu et renforcé par les services de management et de marketing. Le silence peut aussi être le produit d’une loyauté transformée en devoir par nos propres collègues, y compris·es nos collègues féministes. Le silence pour protéger les personnes importantes, le silence pour protéger des ressources, le silence pour protéger une réputation individuelle, institutionnelle, le silence comme agent de promotion, la manière dont tu maximises tes chances d’aller loin ou d’obtenir plus de la part de l’institution.
En d’autres termes, si l’histoire d’un « homme important » est l’histoire de cell·ui qui reçoit protection et promotion, elle est aussi celle du nombre de personnes se retrouvant enrôlées à faire ce travail. Une universitaire en début de carrière parle de la raison pour laquelle les gens ne portent généralement pas plainte dans son université, à cause du comité d’accueil qui les attend : « Les gens ne veulent pas faire de vagues avec [leurs supérieur·es hiérarchiques universitaires], parce qu’i·elles sont très influentxs et importantxs et qu’i·elles ramènent de l’argent issu de subventions dans les caisses et que leurs noms comptent. » Ne pas vouloir faire de vagues peut participer d’un effort pour maintenir de bonnes relations avec les personnes plus importantes du fait qu’elles détiennent davantage de ressources. Une grande part de la violence est rendue possible et reproduite parce que les gens pensent ne pas pouvoir « faire de vagues ». Autrement dit, il y a de la violence à « maintenir les choses en place, stables », de la violence à « stabiliser ». Lorsque tu portes plainte, en particulier publiquement, on te juge coupable d’essayer de déstabiliser l’édifice dans son ensemble, de nous nuire à « nous tous·tes », et par « nous tous·tes », il faut entendre : celle·ux pour qui les institutions promettent davantage de ressources. Audre Lorde (1979) nous avait prévenu·es que ça arriverait. Elle nous avait dit que celle·ux qui trouvent leurs ressources dans la maison du maître jugeraient comme menaçantes toutes les personnes qui s’efforcent de la détruire, ou même de simplement demander ce que le maître fait là-dedans.
Si se plaindre, porter plainte, c’est entendre le silence, se plaindre, porter plainte, c’est aussi entendre le clic clac de la machine institutionnelle, le système qui fonctionne en empêchant celle·ux qui tentent de l’empêcher de fonctionner. Nous comprenons comment les institutions se reproduisent quand nous tentons d’interférer dans leur reproduction. Quand tu portes plainte, tu ne te dis peut-être pas tout de suite que tu fais partie d’un mouvement, tu ne te vois probablement pas non plus comme critique de l’institution, et sans doute pas non plus comme une personne qui veut « détruire la maison du maître » pour reprendre le titre de cet essai majeur d’Audre Lorde. Mais c’est pourtant là que finissent par se retrouver grand nombre de cell·eux qui portent plainte. Il y a de l’espoir dans cette trajectoire.
Conclusion : Non, et autres contes queers
La troisième partie de mon livre sur la plainte s’intitule « If These Doors Could Talk? » [Si ces portes pouvaient parler ?]. En écoutant les portes, j’ai beaucoup appris sur le pouvoir, sur la manière dont la porte laissée grande ouverte pour certaines personnes est la même que l’on referme au nez des autres. L’image sur la couverture de Complaint! a été réalisée par l’artiste Rachel Whiteread (2006-07)Double Doors II, A+B de Rachel Whiteread, est une installation apparemment constituée de deux portes de taille ordinaire, placées côte à côte contre un mur. Ce sont en réalité deux blocs de plâtres moulés sur des portes réelles : des « négatifs » de portes.. Ce que j’apprécie dans cette image, c’est la manière dont ces deux portes ainsi réunies nous parlent de temps, aussi bien que d’espace. J’aime la manière dont elles ressemblent à des dalles funéraires, la manière dont elles nous parlent de celle·ux qui ne sont plus parmi nous. Les portes ont des histoires à raconter, elles peuvent être notre manière de raconter nos histoires. Les portes ont des usages queers. Vous vous souvenez des oiseaux qui ont transformé une boîte aux lettres en nid ? Je vois ces oiseaux comme nos parentxs queers, uls ont fait d’une ouverture prévue pour des lettres une porte, une porte queer, une manière de rentrer et sortir de la boîte. Une porte queer peut être ce qui nous permet de nous créer un espace. Je repense à ce que dit Judith Butler sur le coming-out, la sortie du placard assimilée à une entrée dans un espace limité, comme un sous-sol ou une université. Il y avait une porte dans cette histoire. Dans Défaire le genre (2016), Butler raconte une autre histoire de portes ; i·el parle d’un moment où i·el était au sous-sol de leur maison « ayant fermé la porte à clé », et où, dans les coulisses d’une pièce sans air « saturée de fumée », i·el trouvait des livres qui avaient appartenu à ses parents, ou qui étaient tout du moins passés par leurs mains, des livres de philosophie qui enflammèrent son propre désir. Des espaces qui ont l’air de placards ou de boîtes peuvent devenir des lieux où des choses queers, des choses étranges et obliques, ont une chance de se produire. Ces espaces peuvent devenir des lieux où nous trouvons de quoi ouvrir de nouveaux horizons.
J’écoute une chercheuse autochtone. Elle m’explique combien il est devenu presque impossible pour elle de se rendre à l’université après avoir subi une longue période de harcèlement et de brutalité de la part de professeur·es blanc·hes, à laquelle s’ajouta l’effort concerté d’un de ses encadrants, un autre homme important, sans aucun doute, pour saboter sa titularisation de même que celle d’autres universitaires autochtones. Lorsqu’on vous ferme une porte, que dis-je, lorsqu’on vous claque une porte au nez, c’est souvent l’histoire que vous devez affronter. Sa plainte n’a abouti à rien. Alors elle a trouvé une autre façon de les défier :
J’ai retiré tout ce qu’il y avait sur ma porte, mes affiches, mon activisme, mes pamphlets. Je les ai éparpillés dans l’ensemble de l’établissement. Je savais que j’entrais en guerre ; j’ai réalisé un rituel guerrier de notre tradition. J’ai baissé le volet. J’ai enfilé un masque — mon peuple, nous avons un masque… et je n’ai pas rouvert ma porte pendant un an. Elle est devenue une faille, par laquelle je ne laissais entrer que mes étudianz. Durant une année, je n’ai laissé entrer dans mon bureau que les personnes qui y avaient déjà été invitées auparavant.
Fermer la porte est sa manière de dire non à l’institution qui veut sans cesse accéder à elle, qui veut tirer d’elle tout ce qu’elle peut. Elle ferme la porte à l’institution en se retirant, en retirant ses engagements de la porte. Elle continue de faire son travail ; elle continue d’enseigner auprès de ses étudianz. Elle se sert de la porte pour maintenir à l’extérieur ce qu’elle peut, qui elle peut. Elle se retire de la porte ; elle dépersonnalise la porte. Elle abaisse les volets. Elle enfile un masque, le masque de son peuple, reliant sa lutte aux combats qui ont précédé, parce que, très honnêtement, pour elle, il s’agit d’une guerre.
Nos combats ne sont pas les mêmes combats. Mais il y a de nombreuses batailles menées à huis clos. À huis clos, de l’autre côté des portes fermées : c’est souvent là que l’on trouve les plaintes, donc c’est aussi là que vous avez une chance de nous trouver, celle·ux d’entre nous pour qui l’institution n’a pas été construite ; et ce que nous apportons avec nous, les personnes que nous emmenons avec nous, les mondes qui n’existeraient pas si certainEs d’entre nous n’étaient pas là, nos corps, nos souvenirs. Plus nous débordons, plus l’étau se resserre sur nous. Plus il nous faut continuer de déborder.

On peut penser ce meuble de rangement comme une sorte de placard institutionnel. Ce qui est enterré là, c’est ce que l’institution ne veut pas voir révélé. Nous aussi nous pouvons être enterræs là ; nos vies devenir les détails de leurs documents. Une étudiante m’a dit que sa plainte avait été « fourrée dans une boîte. » Um autre étudianx évoque « le cimetière de la plainte » comme ce lieu où aboutissent les plaintes. Peut-être que les classeurs sont le lieu où les plaintes se rendent pour mourir.
Si les plaintes finissent dans le placard institutionnel, le travail nécessaire pour porter plainte inclut de faire sortir les plaintes de leurs boîtes, de les rendre publiques. Alors qu’une étudiante handicapée ne parvenait à rien avec sa plainte déposée contre l’université pour n’avoir pas effectué des changements satisfaisants en termes d’accessibilité, un dossier a fait son apparition : « tout un ensemble de documents ont été envoyés sur le fax du syndicat étudiant, et nous n’avons jamais su d’où ils venaient ; c’était des documents historiques qui parlaient d’étudianz qui avaient dû quitter l’université. » Ces documents incluaient une lettre manuscrite adressée à une association pour les droits humains par une ancienne étudiante qui, vivant avec le cancer, avait demandé à l’université de la laisser finir son diplôme avec un emploi du temps adapté. L’étudiante à qui ces documents sont envoyés suppose qu’il s’agit d’une personne au secrétariat qui « a fait sa petite part d’action directe », fuitant ces documents en signe de soutien à cette plainte déposée, un soutien que sa fonction de secrétaire ne lui autorisait normalement pas à donner. Il n’y a rien de surprenant à ce qu’um secrétaire puisse se transformer en sabotaire ; le mot secrétaire vient du mot secret ; læ secrétaire, c’est cell·ui qui garde les secrets. Si l’étudiante à laquelle j’ai parlé n’avait pas déposé sa plainte, la lettre serait restée à sa place, le fichier aussi, à prendre la poussière, enterré·es là. Il y a tant de personnes engagées à retirer, enlever, arracher, ôte quelque chose de quelque part. Une plainte déposée au présent peut faire ressortir des plaintes du passé.
Nous pouvons nous rencontrer dans une action sans nous rencontrer en personne. Je pense à toutes ces actions différentes dans le livre, que je nomme activismes de la plainte — des étudianz et des universitaires qui mettent en actes et en scène leurs plaintes, qui les transforment en affiches, les communiquent sur des flyers ou les expriment sous forme de graffitis dessinés dans des livres ou sur des murs. Les plaintes peuvent être ce qui échappe, ce qui fuit, autant que ce qui fuite. Lorsque tout est fait pour empêcher l’expression d’une plainte, la plainte peut devenir le son de sa libération, eehhhhh. C’est la raison pour laquelle j’ai donné une telle importance dans ce travail au son de l’action, du travail fournit, pas simplement le clic clac de la machine institutionnelle, mais aussi les grognements et gémissements de ce que nous ne cessons d’affronter. Les portes claquent. Alors nous frappons à la porte. Nous ne frappons pas à la porte pour demander à entrer mais pour créer une perturbation. J’entends Audre Lorde frapper à la porte et dire qu’il se passe quelque chose. Dans un entretien avec Adrienne Rich, Lorde décrit sa fascination pour le poème « The Listeners » [Celle·ux qui écoutent], un poème à propos d’un voyageur à cheval qui arrive devant la porte d’une maison qui semble vide (Lorde et Rich [1981] 2003, 84).
Il frappe à la porte et personne ne répond. Il demande : « Y a-t-il quelqu’un ? » et il a le sentiment que oui, qu’il y a vraiment quelqu’un à l’intérieur. Puis il fait faire demi-tour à son cheval et lance : « Dis-leur que je suis venu mais que personne n’a ouvert la porte. Que j’ai tenu parole. » J’avais l’habitude de me réciter ce poème, tout le temps. C’était l’un de mes préférés. Et si tu m’avais demandé : « De quoi parle-t-il ? », je ne pense pas que j’aurais pu te répondre. Mais c’est grâce à cela que j’ai commencé à écrire, pour satisfaire mon besoin de dire des choses que je ne pouvais pas dire autrement, quand je ne trouvais pas d’autres poèmes pour le faire à ma place.
Il est important de suivre Lorde, d’aller là où elle va. Lorsqu’une chose nous fascine, nous ne savons pas toujours pourquoi. Lorde continue de se réciter le poème ; elle dit qu’il « s’est gravé » en elle. Je pense à cette empreinte : l’impression d’un poème sur une personne. Ce n’est pas la réponse qui compte, que quelqu’un·e réponde ou vienne ouvrir la porte, c’est le coup sur la porte qui compte ; l’action est celle de frapper à la porte. Tu peux frapper à la porte de la conscience, essayant d’entendre quelque chose, essayant de reconnaître ce qui avait été chassé dehors, la violence qui rend si difficile notre concentration et notre action. Ou peut-être es-tu en train de frapper à la porte de la maison du maître parce que tu sais que cette maison est hantée. Frapper à cette porte, produire ce son, non pas « toc, toc, toc, qui est là ? » mais « toc, toc, toc, nous sommes là », c’est venir perturber les esprits qui traînent là à cause de la violence dont on ne s’est pas occupé. L’égratignure, la griffure, elles aussi, peuvent non seulement laisser des marques, elles peuvent également émettre un son, le son du labeur, de ce petit oiseau qui tente de se défendre à coups de griffes. La griffure peut résonner de différentes manières : comme un discours, comme une chose qui se déverse, comme un témoignage ; différents moyens de rendre audibles nos messages. L’égratignure, la griffure, l’éraflure, ces bousculades de lettres, eehhhhh, peuvent nous aider à exprimer nos plaintes sur des murs. Je pense à la manière dont, après avoir quitté mon poste, des étudianz ont extrait des mots de mon travail pour les afficher sur des murs.

Oui, ils ont été retirés. Mais on ne pourra pas effacer la mémoire de leur présence sur ces murs. Et je pense à la manière dont, par le fait de démissionner, de dire non publiquement, les gens sont venus vers moi avec leurs plaintes. J’ai rejoint une collective de personnes, une collective de plaignant·es, nous voilà rassemblé·es devant vous. Plus tôt, j’ai partagé une image de ce à quoi ressemble une plainte.

Peut-être que cette image est une carte queer présentant la manière dont nous nous organisons, un organigramme nous indiquant tous les lieux que nous avons parcourus pour essayer de faire aboutir nos plaintes. Plus il nous est difficile de progresser, plus nous avons de choses à réaliser. Oui, c’est dur, épuisant, bouleversant aussi. Mais pensez à cela : chaque ligne peut être une conversation, une conversation que vous devez avoir, une conversation qui peut ouvrir une porte, juste un peu, juste assez, pour que quelqu’un d’autre puisse entrer, puisse entendre quelque chose. Chaque ligne peut être du temps, le temps nécessaire pour arriver quelque part, une ligne de temps queer, lorsque nous allons et venons, de-ci de-là : c’est ainsi que nous apprenons. Chaque ligne peut être un chemin, les lieux où tu te rends, les pièces sombres, les ombres, les passages de portes, une ligne qui te sert de guide, les personnes que tu rencontres en chemin. Chaque ligne peut nous ramener dans le passé, nous apprendre que nous sommes davantage, nous faire savoir que des plaintes, par d’autres avant nous, ont déjà été déposées. Chaque ligne peut être projetée vers l’avant, une fuite comme un élan, la manière dont ces personnes qui viennent après toi peuvent ramasser quelque chose de ce que tu as laissé derrière toi, dans l’effort de ce que tu as essayé de faire, même si tu n’y es pas arrivæ, même s’il te semble que tu n’as rien réussi à laisser d’autre qu’une égratignure, une marque superficielle. Ce que tu laisses derrière toi sera découvert. Que nous puissions nous trouver les un·es les autres à travers nos plaintes : voilà la découverte. Quand nous déposons des plaintes, il devient possible de savoir que quelque chose s’est passé ici, il devient possible de savoir ce qui s’est passé : un non qui trace un sentier, une autre histoire queer à raconter.
Références
Ahmed, Sara. Queer Phenomenology, Orientations, objets et autres, (2006) traduit de l’anglais (Royaume-Uni/ Australie) par Laurence Brottier, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2022.
Ahmed, Sara. Manuel rabat-joie féministe (2023), traduit de l’anglais par Emma Bigé et Mabeuko Oberty, Paris, La Découverte, 2024.
Butler, Judith. « Imitation and gender insubordination » dans Inside/out : lesbian theories, gay theories, Fuss Diana, New York, Routledge, 1991.
Butler, Judith. Défaire le genre, (2004), traduit de l’anglais (États-Unis) par Maxime Cervulle, avec la collaboration de Joëlle Marelli, Paris, Amsterdam, 2016.
Franklin, Sarah. « Sexism As a Means of Reproduction : Some Reflections on the Politics of Academic Practice », New formations: a journal of culture/theory/politics, vol. 86, 2015, p. 14-33. Project MUSE muse. jhu.edu/article/ 604487.
Freeman, Elizabeth. Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories, Durham, Duke University Press, 2010.
Ibrahim, Ahmed. « In and/or/plus Out: Queering the Closet » dans a Journal for Body and Gender Research, Queer Feminism, vol.6 n° 3, 2020.
Lorde, Audre. « Nous ne détruirons pas lamaison du maître avec les outils du maître » (1979) et « Entretien avec Adrienne Rich » (1981) repris dans Sister Outsider. Essais et propos sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme…, traduit de l’anglais (États-Unis) par Magali Calise, Grazia Gonik, Marième Hélie-Lucas et Hélène Pour, Carouge, Mamamélis, 2003.
Colophon
Traduction : Emma Bigé, Mabeuko Oberty.
Titre original : What’s the Use? On the Uses of Use.
Publication originale en 2017 par Duke University Press, Durham.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Vandalisme queer, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Color-1802 Safran 270 g/m², bouffant blanc 80 g/m² en 2 000 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en avril 2024 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-405-7.
Cette version a été composée par Magalie Vaz en Baskervvol, Fluxisch Else, Cormorant, Avenir et Chopin Script.
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc par Laura Amazo.
