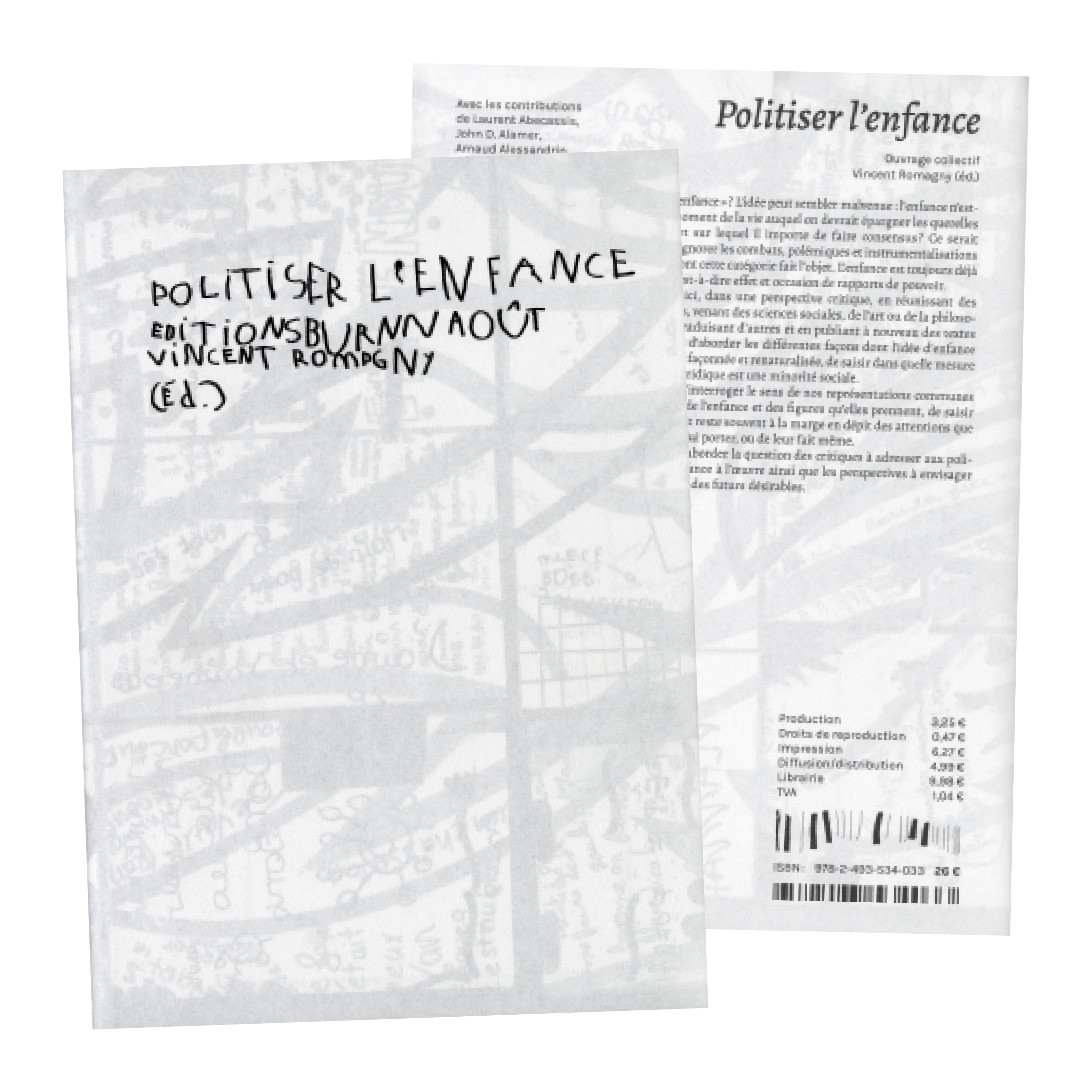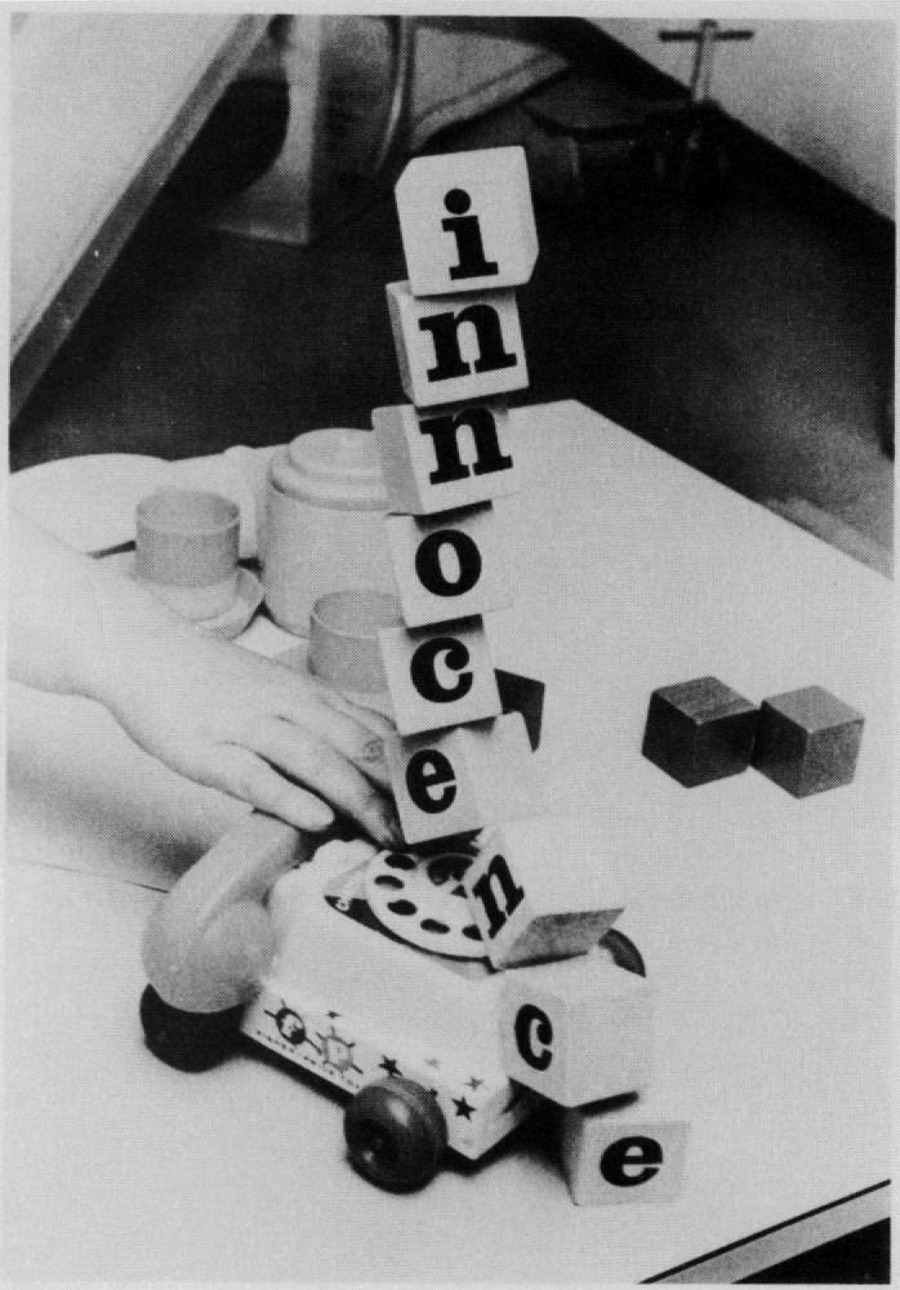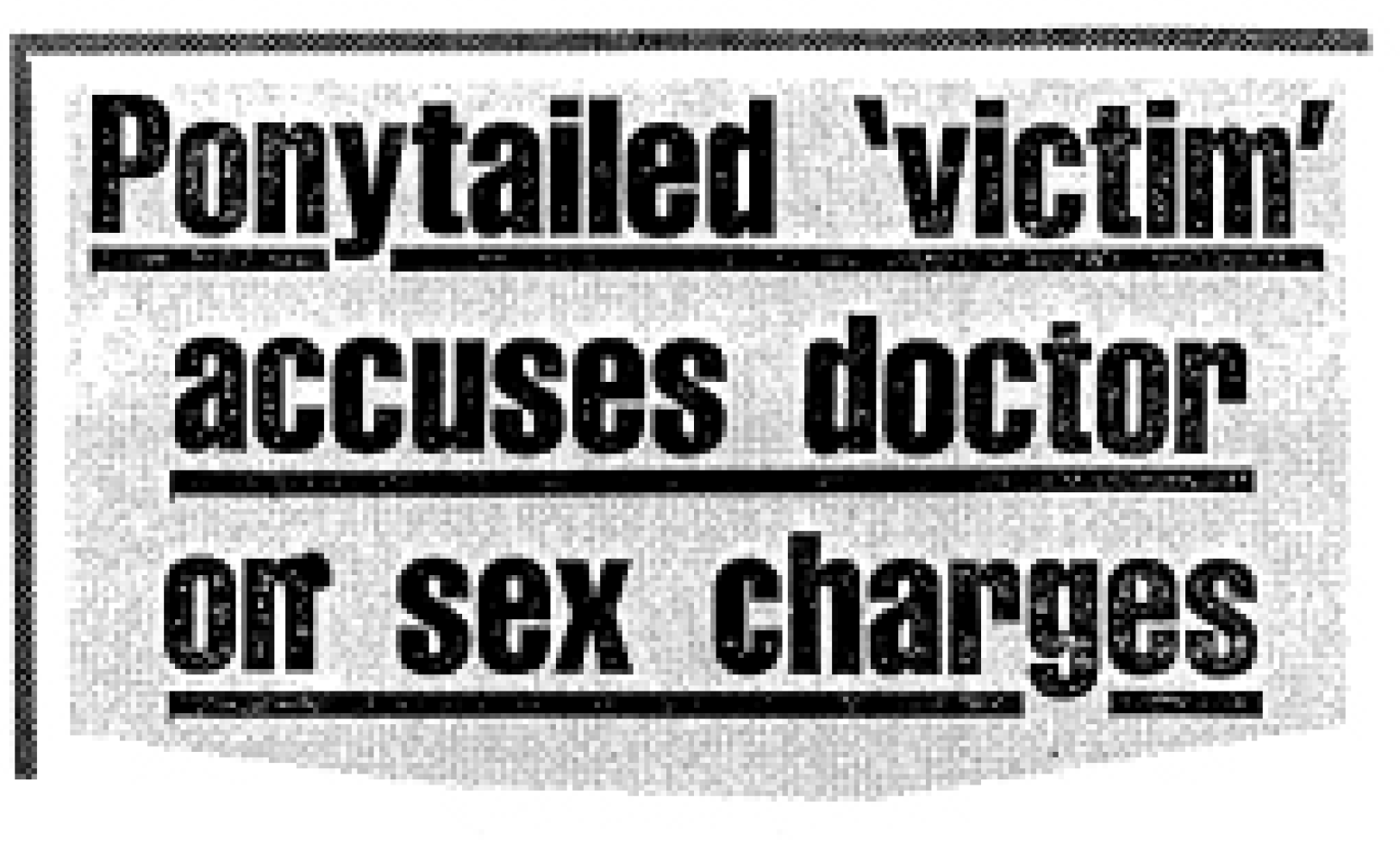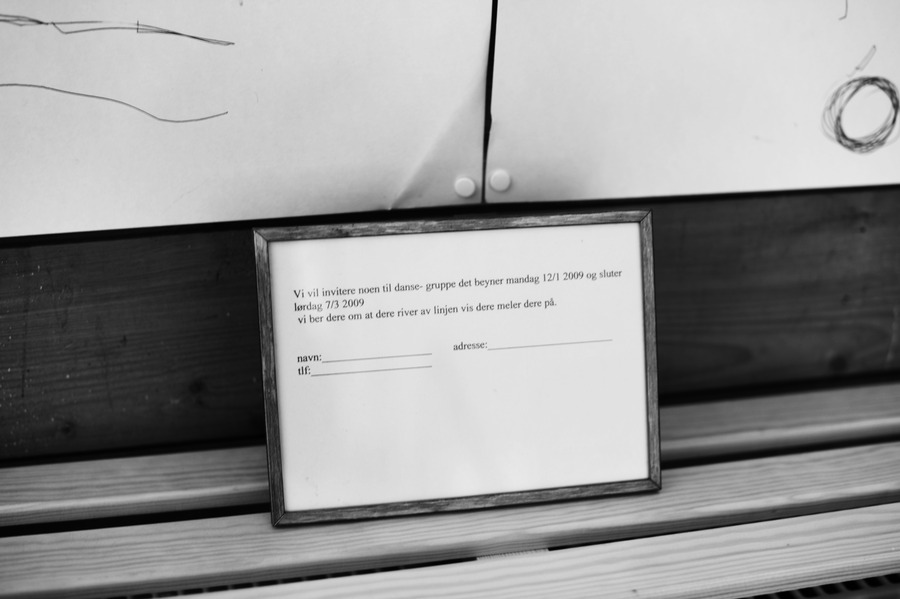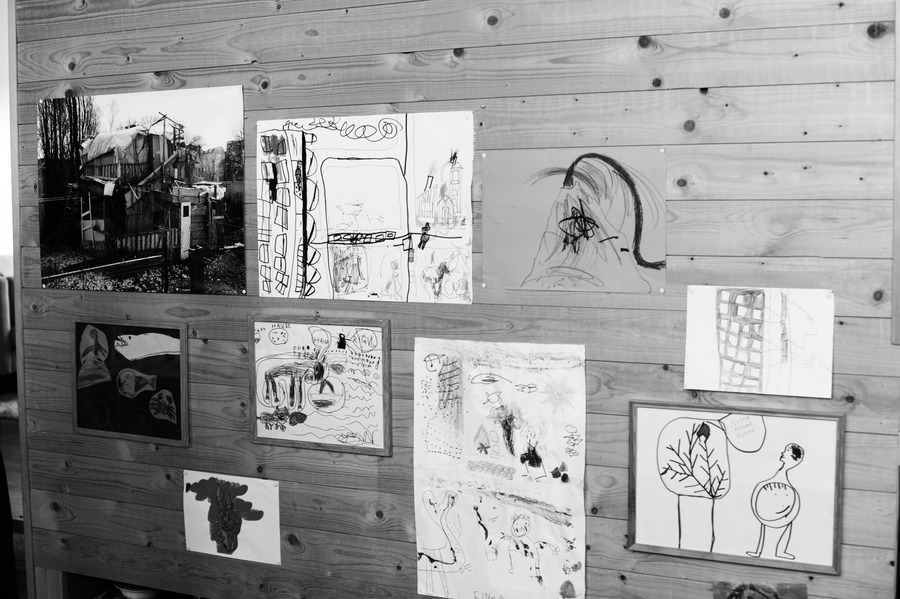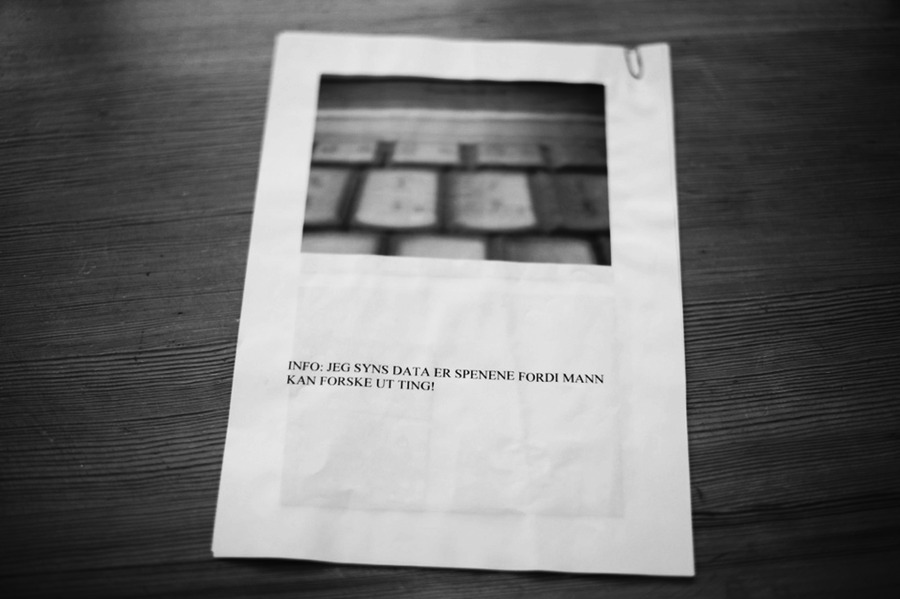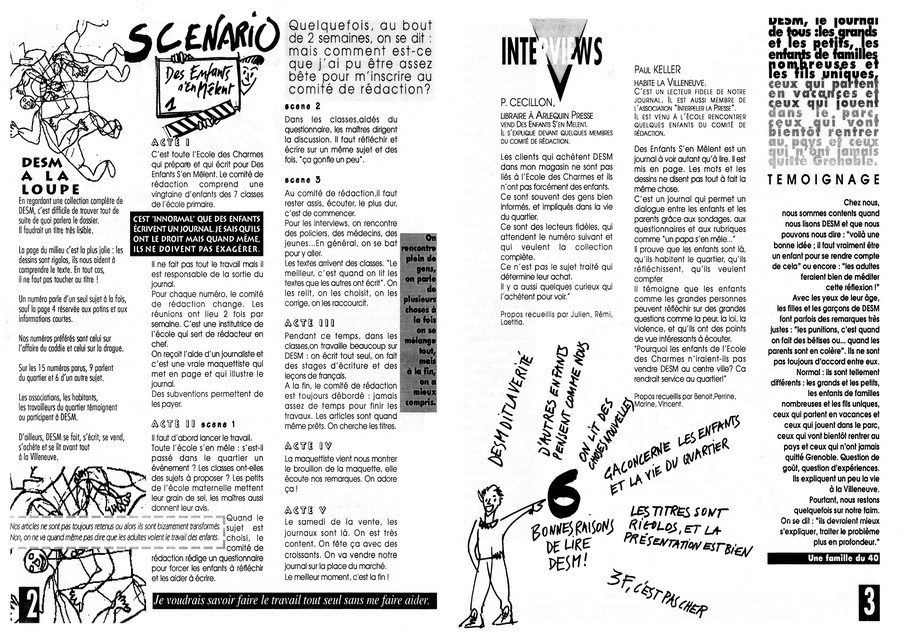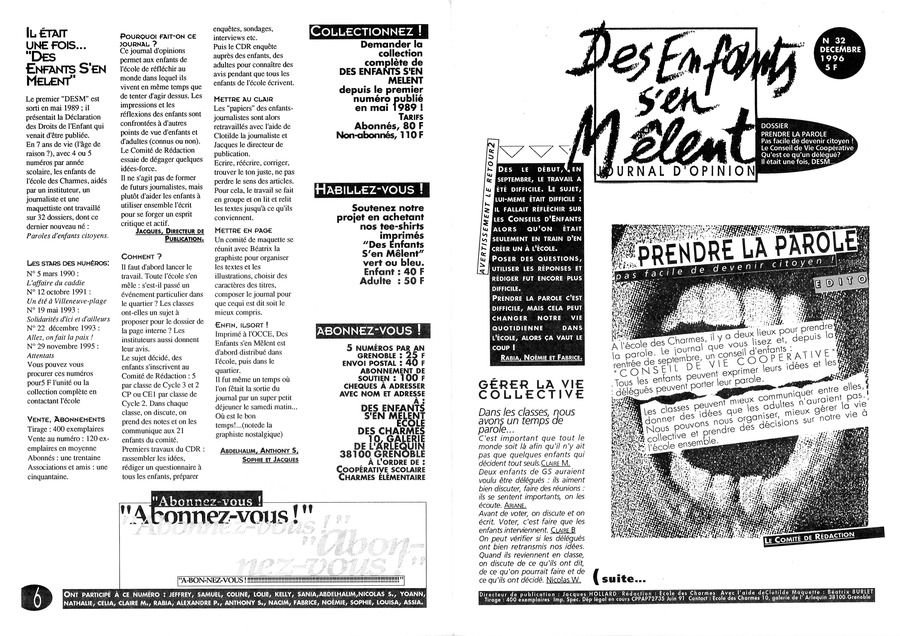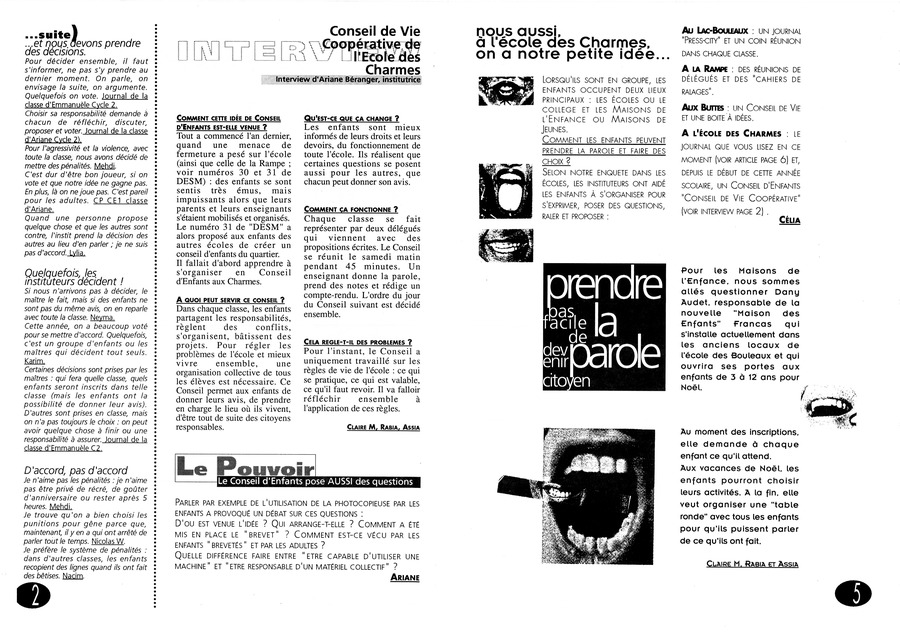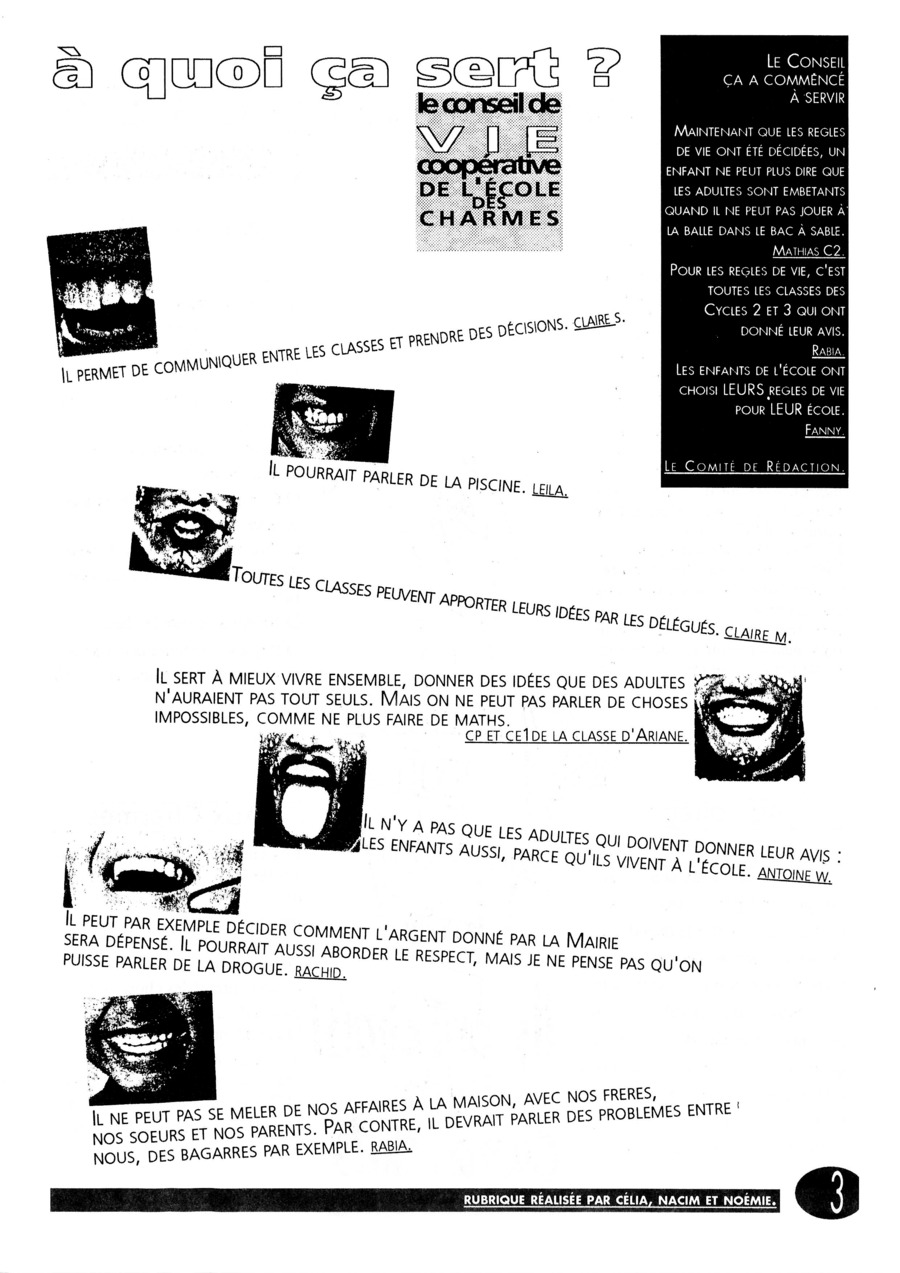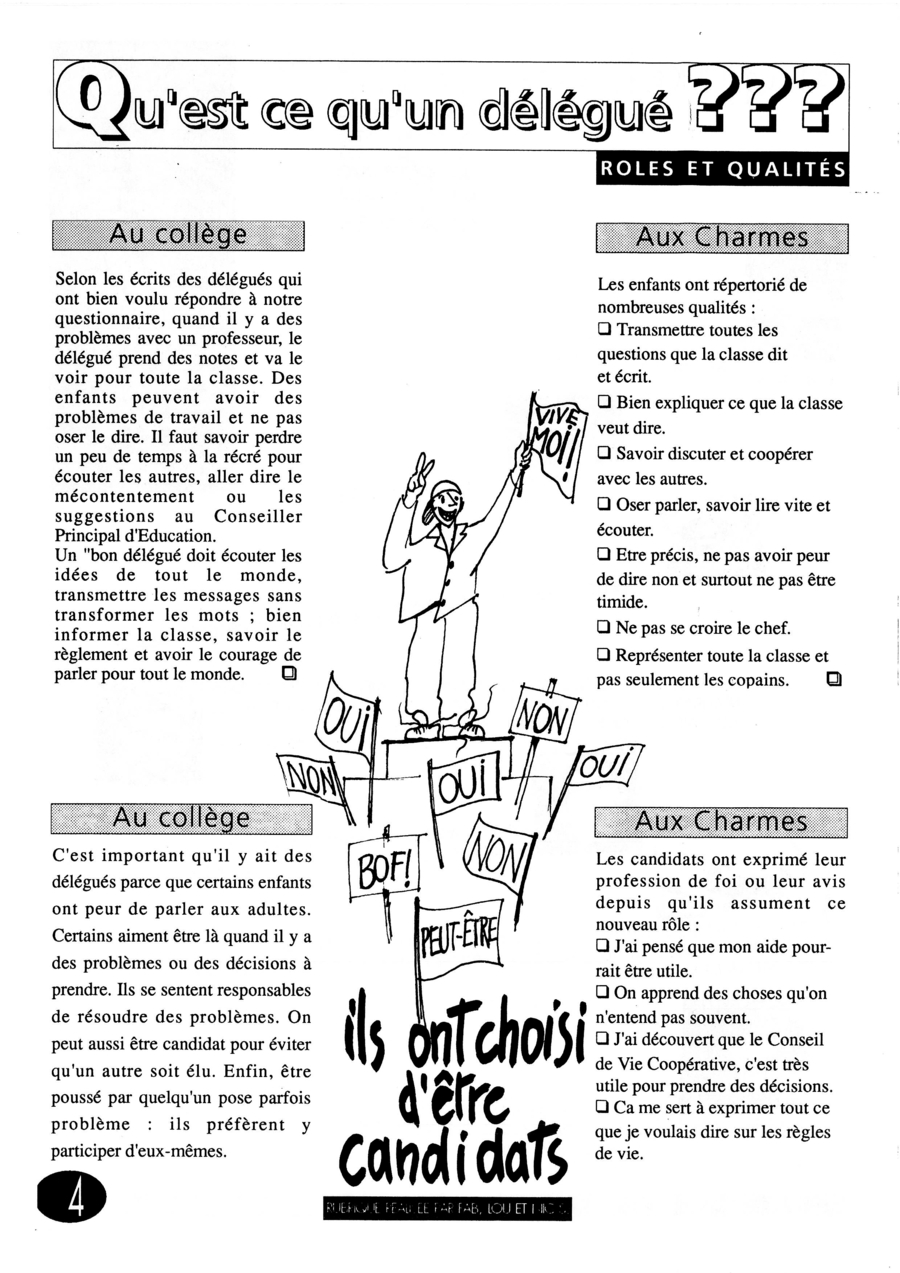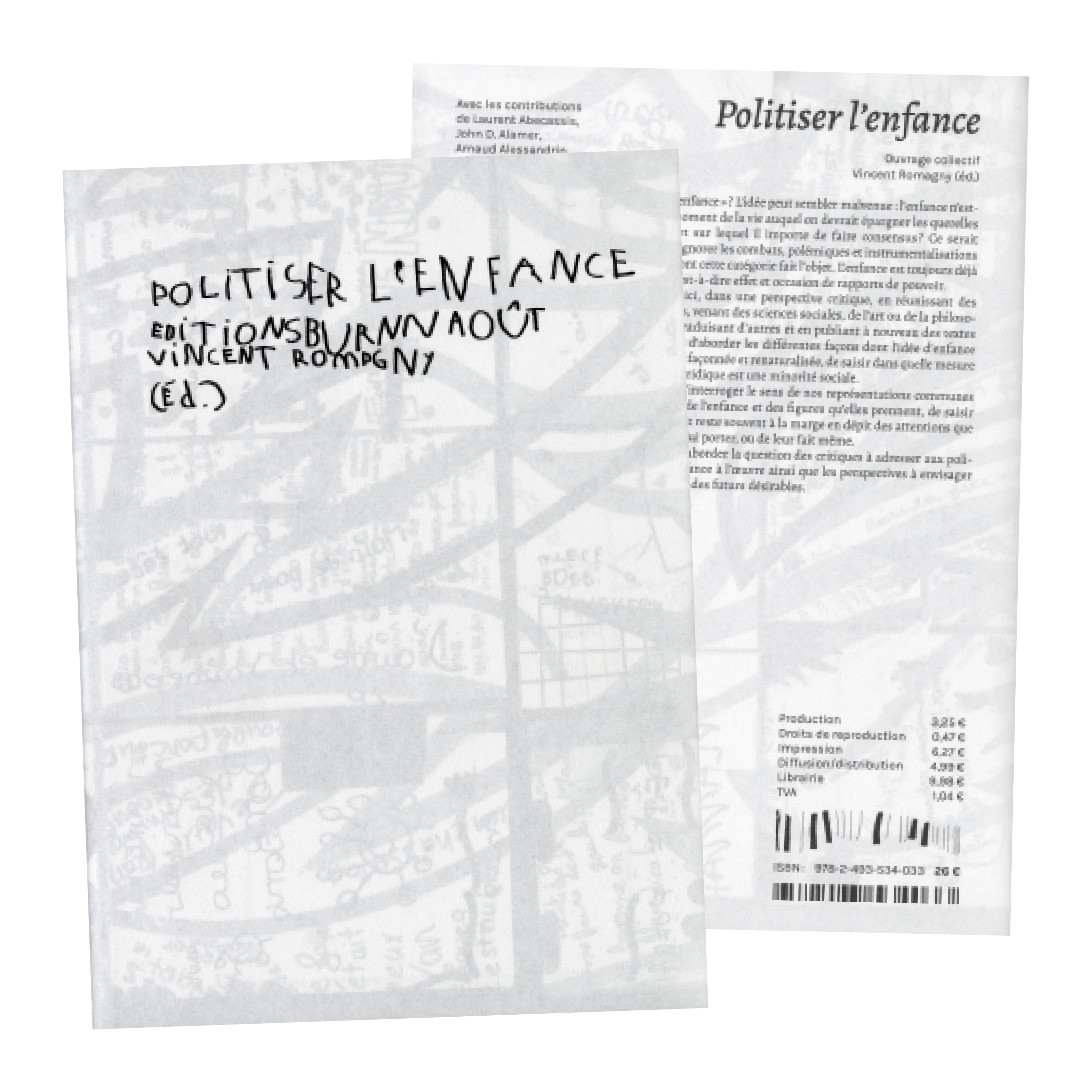
Table des matières
Politiser l’enfance
Politiser l’enfance est une anthologie de textes inédits, traduits ou réédités, écrits par des artistes, des philosophes, des sociologues, des journalistes, des critiques d’art, etc. Ces textes sont réunis par Vincent Romagny, docteur en esthétique et commissaire d’exposition. Ces textes abordent la question des rapports entre enfance et politique non pas depuis un point de vue unique, mais selon différentes perspectives : philosophique, sociologique, historique, poétique, artistique, féministe, queer, etc. et qui éventuellement se croisent.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 01/02/26 à 19 h 18.
- Préambule
- Introduction —
- Conjurer l’oubli, pour une réminiscence politique de nos enfances —
- Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence —
- Suite d’un dialogue interrompu avec Tal Piterbraut-Merx. « Domination adulte » et rôle éducatif de l’adulte —
- Cry me a River —
- Nature/Exposition —
- Pour le droit de vote des mineur·es —
- Des Enfants s’en Mêlent —
- Un journal d’opinion —
- Tout ce dont on parle est bizarre —
- Les mouvements antagonistes de politisation de la question des mineur·es trans et non-binaires —
- Éléments de vocabulaire
- La transidentité des mineurs : un fait nouveau ?
- Politiser la question des mineurs trans : le principe de précaution au service de la « non-action »
- Une perspective « trans-affirmative » pour lutter contrE les errances thérapeutiques et les exclusions
- Des situations et des recherches internationales controversées
- Et pourtant, iEls existent : l’exemple de l’école
- Comment élever vos enfants gayment —
- Un « Je » d’enfant sur scène —
- « Revolting children »? Les enfants acteurs de comédies musicales à Paris, Londres et New-York —
- Pourquoi politiser l’enfance ? —
- Les faux paradis de l’errance suivi de Le rapt ou petit propos sur un archaïsme —
- Pour l’abolition de l’enfance. Extrait de La Dialectique du sexe —
- Les enfants : une oppression très spécifique —
- L’espace public des enfants —
- La parole au foyer —
- Déjouer la minorité, retrouver l’enfance —
- L’enfant à problèmes. Provocations en vue du démantèlement de l’État carcéral —
- Kiss & Cry —
- L’« enfant-potentiel », un modèle en crise —
- Pédagogie critique à destination des enfants —
- L’enfant, l’alphabet, l’abolition —
- Réflexions sur la question enfantine —
- Remerciements
Préambule
Agencer des textes, c’est être continuellement traversé par un sentiment de doute : c’est se placer sous la tutelle d’un savoir qui se voudrait adulte, reconnu comme faisant autorité, mais dont on ne sait pas à quel point il est légitime. Revendiquer une position enfantine, c’est moins la critique délibérée de savoirs constitués que l’expression d’une relation complexe à un savoir que l’on ne maîtrise pas. La question se pose de savoir comment ne pas définir la catégorie de l’enfance uniquement à partir d’une activité adulte. C’est là tout l’enjeu de ce recueil de textes qui tente de présenter différentes manières de rendre à cette catégorie son autonomie en essayant de ne pas l’instrumentaliser.
Un discours univoque sur l’enfance est intenable, il s’expose à l’erreur et produit des assignations illégitimes, sources de violence sur la minorité appelée enfant. Il est forcément multiple et exposé à l’erreur. Les expériences pour lesquelles on invoque l’idée d’enfance n’épuisent pas la réserve de sens de l’enfance. « And then it’s like a kid; suddenly a toy shop opens up and the toy shop was called culture. Suddenly I thought I didn’t even have to pretend I was interested in this problem about identity anymore, I could just bloody copy straight onKathy Acker, « Devoured by Myths. An interview with Sylvère Lotringer », in Kathy Acker, Hannibal Lecter, My Father, New York, Semiotext(e), 1991, p. 11.. » Il s’agit de créer les conditions d’énonciation et d’autonomie de paroles auparavant inaudibles, de produire des savoirs spécifiques dans la lignée de ce que nous apprend le féminisme radical. Il s’agit de saisir le caractère temporaire des constructions sur l’enfance et, dans ce cas alors, pour aborder cette difficile catégorie sans l’essentialiser ni la naturaliser, de recourir à la métaphore des campements de fortune, repliés aussi vite qu’ils ont été déployés. On espère ainsi contribuer et inciter à tisser « des narrations autresTal Piterbraut-Merx, « Oreilles et mémoires mutines. L’inceste et les rapports de pouvoir adulte-enfant », in Iris Brey et Juliet Drouar, La Culture de l’inceste, Paris, Seuil, 2022, p. 87. ».
Introduction —
« Politiser l’enfance » ? L’idée peut sembler malvenue : l’enfance n’est-elle pas le moment de la vie auquel on devrait épargner les querelles partisanes et sur lequel il importe de faire consensus ? Ce serait pourtant là ignorer les combats, polémiques et instrumentalisations politiques dont cette catégorie fait toujours déjà l’objet. Si l’on considère, qu’ « en politique, les sujets ne sont pas des reflets mais des projetsSébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, « L’intersectionnalité contre l’intersection », in Raisons politiques, 2015/2, n° 58, p. 40. », alors l’enfance en relève pleinement : elle est projet du fait de son inachèvement. Mais du fait des projections adultes, elle risque de n’être que reflet. Cette incomplétude est alors souvent comprise comme l’indice d’une faiblesse « naturelle » que l’adulte doit pallier — et ce constat est trop souvent considéré comme le point final et indépassable de ce type d’interrogation. Plusieurs questions se posent alors. L’enfance est-elle « naturellement » vulnérable ? Les adultes pallient-iels toujours et en toutes circonstances ce constat de faiblesse ? Et comment comprendre ce « constat » : est-il aussi axiologiquement neutre qu’il ne le semble de prime abord ? Aussi la question se pose-t-elle de savoir dans quelle mesure celles et ceux placé·es sous le régime de la minorité juridique partagent la condition des minorités sociales et peuvent relever des politiques de l’émancipation. L’enfance ne serait-elle d’ailleurs pas le modèle principiel de tout processus de domination sociale, qui relève systématiquement de l’infantilisation ? Pour reprendre les termes de Colette Guillaumin, les enfants peuvent être compris·es « dans le sens de groupe doté d’un moindre pouvoirColette Guillaumin, « Sur la notion de minorité », in L’Homme et la société, n° 77-78, 1985, p. 101. « Une relation majoritaire/minoritaire signifie que l’un ou plusieurs des groupes impliqués se trouve dépendre de, être à la merci de, être privé de l’accès à certaines ressources ou à toutes et qu’un autre se trouve en possession des moyens dont le (ou les) premiers sont privés, soit par des circonstances non délibérées, soit par un ensemble d’actions et de pratique. ». Ibid., p. 105. » et, à l’instar d’autres minorités, iels font également l’objet d’une valorisation incapacitante. Il est indubitable que l’enfance partage avec d’autres minorités sociales un besoin similaire d’émancipation. Il s’agit là de questions de première importance, tant philosophiques que politiques, soulevées notamment par Tal Piterbraut-MerxTal Piterbraut-Merx préparait une thèse de philosophie politique sur la question de la domination des adultes sur les enfants comme angle mort des théories critiques et abordait la privatisation et la naturalisation dont le groupe des enfants fait l’objet à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Très actif au sein du collectif Claf’outils, il coanimait des ateliers de prévention des violences faites aux enfants à destination des personnels des écoles, des enfants et de leurs adultes référent·es. Cf. Pierre Niedergang, Vers une normativité queer, Toulouse, Blast, 2023, p. 119-120, ainsi que : https://www.editionsblast.fr/outrages. Une anthologie de ses textes est en préparation aux éditions Blast.. L’enfance est toujours déjà politique, c’est-à-dire effet et occasion de rapports de pouvoir. Il s’agit ici, au moyen des sciences sociales, de l’art et de la philosophie de mettre dans l’actualité éditoriale la question des rapports de pouvoirs auxquels sont soumis·es les enfants et l’idée même d’enfance.
Les questions que l’on se pose ne venant jamais d’elles-mêmes, pour introduire ce reader, il faut revenir sur le contexte artistique et esthétique dans lequel la question de la dimension politique de l’enfance s’est posée, et dans lequel elle a pris progressivement forme« L’occasion […] n’est isolable nid’une conjoncture ni d’une opération. » Michel de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 27..
Dans le cadre de ma recherche doctorale sur les expositions d’art contemporain abordant la question de l’aire de jeuxVincent Romagny, « Jouer l’aire de jeux. Les arts de l’exposition de Playgrounds: Reinventing the Square (Musée de la Reina Sofia, Madrid, 2014), PLAY TIME (biennale de Rennes 2014) et The Playground Project (Kunsthalle Zurich, 2016) », thèse en esthétique sous la direction de Jean-Philippe Antoine, Université Paris 8, Saint-Denis, 2022., je défends l’hypothèse selon laquelle, pour saisir conceptuellement la façon dont des commissaires d’exposition rendent compte de cet objet dans ce type de circonstances, il faut identifier les figuresCes figures sont « à l’intersection de l’imaginaire, de la représentation, de la rhétorique et enfin de la modélisation ; en un mot des différents modes de constitution de nos modes de réflexivité contemporains sur l’enfance ». Régine Sirota, « Les figures de l’enfance de la sphère médiatique à la sphère scientifique », in Louise Hamelin-Brabant et André Turmel (éd.), Les Figures de l’enfance : un regard sociologique, Cap-Rouge, Presses Inter Universitaires, 2012, p. 3. de l’enfance que ces expositions construisent. Elles peuvent être saisies conceptuellement en recourant à différents modèles de compréhension de l’enfance que philosophes et sociologues de l’enfance ont mis en évidence (en l’occurrence : l’enfance comme primitivité et prématuration/l’enfance comme manque et régression/l’enfance comme suivant un schème développemental). Représentations et évocations de l’enfant et de l’enfance dans l’art sont des constructions produites par des regards adultes et elles sont construites en relation dynamique avec une figure d’adulte exemplaire, celle de l’artiste, aux fortes affinités avec l’idée d’enfance au début du xxe siècle. La sociologie de l’enfance fournit ainsi un ensemble de concepts et de méthodes permettant d’identifier et de mettre en évidence ces différents sens donnés à l’enfant et à l’enfance par/dans des œuvres d’art contemporain et des expositions d’art contemporainPour une introduction à la sociologie de l’enfance : Martine Court, Sociologie des enfants, Paris, La Découverte, 2017. Cf. André Turmel, Une sociologie historique de l’enfance. Pensée du développement, catégorisation et visualisation graphique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013 ; Régine Sirota, Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.. Ces figures permettent alors de comprendre rétroactivement la façon dont les aires de jeux sont données à voir au moyen d’œuvres d’art et de documents. Or, explicitées par les sciences sociales de l’enfance, les compréhensions de l’enfance formalisées dans et par l’art ne sont pas nécessairement congruentes avec celles revendiquées par leurs auteurices, artistes et commissaires d’exposition. Les approches artistiques et curatoriales de l’enfance, qu’enfants et enfance soient l’objet d’œuvres et d’expositions ou qu’iels y soient donnés à voir de « biaisJean Dubuffet, « Causette », in Prospectus. Tome II : et tous écrits suivants, Paris, Gallimard, 1967, p. 73. Cité in Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l’art brut. Critique du primitivisme, Dijon, Les presses du réel, 2019, p. 18. », se retrouvent ainsi mises en perspective par les outils critiques des sciences sociales de l’enfance. Elles montrent l’écart entre l’enfant représenté et l’enfant réelLoin de délivrer des « vérités » sur l’enfance, elles en proposent des « vues de l’esprit ». Cf. Bruno Latour, « Les vues de l’esprit », Culture et technique, 5-27, 1987., ainsi que la façon dont le premier escamote le secondCf. Marie-José Chombart de Lauwe, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe, Paris, Payot, 1979..
Les sciences sociales de l’enfance aident à prendre la mesure de la difficulté à saisir l’enfant « réel » derrière ses représentations sociales et culturelles. Les représentations artistiques de l’enfance peuvent alors être considérées comme relevant du mythe ou, plus précisément, de la métaphore. Roland Barthes montre le caractère idéologique inaperçuRoland Barthes, Mythologies, Paris, Le Seuil, 1970. du premier quand Tal Piterbraut-Merx dénonce les « dérives » auxquelles l’emploi de la seconde donne lieuTal Piterbraut-Merx, « Des dérives d’un usage métaphorique de l’enfance », Le Télémaque, n° 56, 2019.. Se pose alors, de façon abstraite et théorique, mais également de façon pratique, la question de savoir dans quelle mesure ces schèmes de pensée et de représentation par lesquels l’enfance est perçue en réduisent le pouvoir d’agirPascale Garnier, « L’“agency” des enfants. Projet scientifique et politique des “childhood studies », Éducation et société, De Boeck Supérieur, n° 36, 2015.. D’où le doute selon lequel l’art, par des œuvres ou des expositions, naturalise des représentations qu’il est possible de s’en faire et participe au « long processus d’enfermement des enfantsPhilippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 1975, p. 8. », pour reprendre les termes de l’historien Philippe Ariès, loin de réaliser l’idéal d’émancipation dont il s’enorgueillit. Afin de vérifier cette hypothèse, je consacrais un cours à la question des représentations de l’enfance à l’œuvre dans nombre de pratiques artistiques contemporaines, comprises comme autant de constructions sociales et culturelles. J’y analysais un certain nombre de pratiques artistiques abordant de diverses façons la question de l’enfance, notamment à partir d’une liste que j’avais constituée en début d’année. Elle n’était évidemment pas complète, mais il y avait un artiste en particulier auquel je n’avais pas pensé.
Une série d’articles publiés dans la presse dès janvier 2021 informe que Claude Lévêque est accusé de « viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans » par Laurent Faulon, également artisteYann Bouchez et Emmanuelle Lequeux, « Le plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs », Le Monde, 10 janvier 2021 ; Michel Deléan et Magali Lesauvage, « Pédocriminalité : plusieurs témoins accablent l’artiste Claude Lévêque », Médiapart, 13 janvier 2021. Alors que cet ouvrage est maquetté, nous apprenons que l’artiste est mis en examen. Cf. Roxana Azimi, « L’artiste Claude Lévêque mis en examen pour viols sur des mineurs », Le Monde, 23 juin 2023.. Ce dernier dénonce l’emprise que Lévêque aurait eu sur lui et sa famille et la façon dont il aurait été manipulé, enfant puis adolescent. L’émoi fut d’autant plus considérable que Lévêque s’est toujours fait le porte-parole des voix qui ne comptent pas, en particulier celles des classes populaires. L’enfance est un thème récurrent de son œuvre, dans laquelle figurent nombre d’images d’enfants ou de jeunes adolescents et d’objets évoquant l’enfance. De même, nombre de ses néons sont écrits de main d’enfant. Les accusations de pédocriminalité soulevant la question de la domination des enfants par les adultes, j’invitai Tal Piterbraut-Merx à présenter ses recherches portant sur l’enfance comme angle mort des théories critiques et sur la privatisation et la naturalisation dont le groupe des enfants fait l’objet à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Sa conférence, intitulée « Politiser l’enfance », eut lieu le 28 avril 2021Cf. https://www.youtube.com/watch?v=xF6gSxKU7Zg&list=PLNpwp7daiR-6p5EeITXRNWjFwK5ZoQhd&index=7.6p5EeITXRNWjFwK5ZoQhd&index=7.. La présentation de cette conférence est la suivante :
L’approche libérale de l’enfance tend à considérer celle-ci à partir de ses caractéristiques dites naturelles et à en tirer un certain nombre de conséquences politiques. C’est parce que l’enfant serait un être fragile, vulnérable et dépendant qu’il importerait de mettre en place un ensemble de structures protectrices et c’est ainsi qu’est interprété par exemple le statut de minorité. Les représentations de l’enfance le dépeignent toutefois à travers une certaine ambivalence : l’enfant est à la fois en danger, mais il contient des potentialités destructrices et asociales. En partant de ces représentations antagonistes, nous chercherons à remettre en cause le modèle protectionniste pour proposer une politisation des relations adulte — enfant. Nous montrerons ainsi que la fragilité et la vulnérabilité de l’enfant pourraient bien être le résultat de processus de production institutionnelle et politique, qu’entérine le statut de minorité. Nous nous demanderons alors, à la suite d’une telle analyse, quelles stratégies d’émancipation et de lutte peuvent être proposées pour renverser un tel rapport de pouvoir. Le cas problématique des discours propédophiles d’extrême-gauche dans les années 1980 feront l’objet d’une attention particulièrehttps://www.ensba-lyon.fr/actualite_tal-piterbraux-merx.
Tal Piterbraut-Merx montre que l’enfance comme concept et comme catégorie a été principalement pensée en rapport à l’âge adulte, qu’elle lui soit opposée (comme pensée nue ou comme moyen d’accès au présocial) ou bien qu’elle en soit la finalité (dans ce cas, l’enfant est compris comme manque par rapport à l’adulte qui lui donne rétrospectivement tout son sens). Le philosophe se propose de dépasser cette approche de l’enfance « comme stade initial et liminaire » en remettant en cause le modèle protectionniste et en se demandant si la représentation de l’enfance comme fragilité et dépendance ne serait pas plutôt l’effet d’un rapport de domination naturalisé. Dans cette perspective, il s’agit de considérer les facteurs politiques et sociaux qui concourent à son oppression, notamment à partir d’une analogie avec les rapports sociaux de genre. Tal Piterbraut-Merx invite à renouveler l’approche de l’enfance en débusquant les fictions de naturalité, notamment celle de la famille — à quoi concourt la perspective ouverte par la féministe Shulamith Firestone. Les approches propédophiles des années 1980 retiennent son attention en ce qu’il y voit « une volonté qui a pu s’inscrire dans des stratégies émancipatricesConf. cit., à 1 h., 10 min. et 10s. ». Il lui importe alors de reprendre le fil de ce type d’argumentation et d’en saisir les lacunes, notamment en termes d’analyse de rapports de pouvoir qui se jouent entre enfant et adultePiterbraut-Merx reprend en particulier l’analyse qu’Éric Fassin propose de l’entretien entre Jean Danet, Michel Foucault, Pierre Hahn et Guy Hocquenghem intitulé « La loi de la pudeur » (transcription de l’émission Dialogues de France Culture diffusé le 4 avril 1978, publié dans le magazine Recherches, n° 37, avril 1979, Fous d’enfance, puis reproduit in Michel Foucault, Dits et écrits (1954-1988), tome II : 1976-1988, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001). Cf. Éric Fassin, « Somnolence de Foucault, violence sexuelle, consentement et pouvoir », Prochoix, n° 21, 2002.. Le philosophe fournit ainsi des outils critiques pour penser l’enfance et les rapports de pouvoir dans lesquels elle est toujours déjà enchâssée, autant de moyens pour envisager les conditions d’une émancipation non instrumentalisée. Mais comment la réaliser ? L’art pourrait-il y contribuer ?
Pour historiciser le moment où nombre d’expositions abordent la question des aires de jeux, j’avais émis l’hypothèse selon laquelle cette relative recrudescence était transitoire : succédant à la thématique très prégnante du jeu dans l’art dans les années 1990-2010, peut-être annonçait-elle des expositions abordant l’enfance, thématique qui n’avait depuis longtemps pas été abordée en tant que telle, en particulier en FranceL’exposition Présumés innocents au Capc à Bordeaux (du 8 juin au 1er octobre 2000) constituant peut-être, à cette époque et en France, une des dernières occurrences du thème de l’enfance en tant que telle dans l’art contemporain. Cf. Ondine Millot et Roxana Azimi, « Présumés innocents, l’expo sur l’enfance qui scandalisa Bordeaux et changea le monde de l’art », Le Monde, 20 mars 2021.. Outre quelques autres manifestationsAinsi Encore un Jour banane pour le poisson-rêve, présentée du 22 juin au 9 septembre 2018 au Palais de Tokyo dans le cadre de la « saison d’expositions » Enfance. On peut élargir ce spectre en citant Histórias da infância, présentée du 8 avril au 31 juillet 2016 au Museu de Arte de São Paulo et Spring Never Comes Again. Children and Art in the 20th & 21st centuries au Musée Zacheta de Varsovie, du 31 mars au 18 juin 2023., cette hypothèse se trouvait vérifiée en particulier par le cycle d’expositions Children Power organisé par Le Plateau/Frac Île-de-France. Le cycle, reprenant par son titre des appels à la mobilisation pour des luttes minoritaires, suppose une analogie avec les modèles des rapports sociaux de race, de sexe et d’orientation sexuelle (Black Power, Girl Power, Gay Power). Il comporte trois volets : Children Power. Une exposition sur l’enfance du 19 mai au 18 juillet 2021 au Château de Rentilly ; Children Power. Les réserves, une sélection d’œuvres de la collection choisies « par les enfants », du 19 mai au 6 juin 2021 dans les Réserves à Romainville ; Children Power. Une exposition interdite aux + de 18 ans, du 19 mai au 19 décembre 2021, au Plateau/Frac Île-de-France.
Cette dernière exposition était réservée aux moins de dix-huit ans et les personnes majeures ne pouvaient la visiter qu’à la condition d’accompagner un·e mineur·e. Fallait-il voir dans la règle du jeu curatorial de cette dernière exposition le moyen de faire aboutir le projet d’émancipation qu’invoque le titre ? Si tel est le cas, cette exposition, des plus réussies et convaincantes d’un point de vue artistique (choix des artistes, des œuvres, articulation dans l’espace), pose de façon problématique la question de l’émancipation de l’enfance et des enfants : quelle valeur accorder à la revendication de l’inversion du rapport de préséance de l’adulte sur l’enfant quand l’exposition est organisée par des adultes ? L’enfant est-iel vraiment acteurice ? N’est-iel pas toujours sujetGeneviève Bergonnier-Dupuy (éd.), L’Enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille, Paris, Érès, 2005. ? Est-iel libéré·e, comme le titre semble l’indiquer ? Ne serait-iel pas plutôt éduqué·e à l’art ? Une telle démarche, si elle peut sembler un point d’aboutissement du tournant éducatif de l’artL’idée de tournant [turn désigne, dans les sciences sociales et humaines comme en matière d’esthétique, une modification de paradigme au sens kuhnien du terme et un redéploiement de l’attention sur un aspect auparavant dévalorisé ou négligé de la discipline, proposant un renouvellement de son approche. [Suite de la note page suivante.\]], pourrait être interrogée à l’aune des critères politiques qu’elle convoque et des « enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques » que soulève « la parole des enfantsCarole Daverne-Bailly et Judit Vari (éd.), Recherches en éducation. La parole des enfants : enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques, n° 39, janvier 2020. On peut penser aux précautions méthodologiques des chercheureuses en sciences sociales qui s’interrogent sur les conditions de possibilité de l’émergence d’une parole enfantine dans un cadre organisé par des adultes. Cf. Isabelle Danic, Julie Delalande et Patrick Rayou, Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en sciences sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. ».
À l’occasion d’une exposition à Laurel Parker Book à Romainville, intitulée Playground Studies (du 10 septembre au 24 octobre 2021), je proposais de considérer les aires de jeux, réelles ou métaphoriques, dans des œuvres vidéo d’artistes, comme exemplifiant explicitement autant de mythes de l’enfance (comme innocence, comme modèle politique, comme subversion, comme utopie, etc.)Avec les œuvres de Arakawa, Pol Gallo, Ane Hjort Guttu, Palle Nielsen, Seth Price et Corin Sworn.. Il s’agissait ainsi de prendre acte du fait que ces œuvres sont des représentations de l’enfance, loin d’en être des présentations transparentes et neutres. L’aire de jeux devenait alors un outil critique pour mettre en évidence que si l’art obscurcit les représentations de l’enfance, il les manifeste tout autant. Mon hypothèse était alors que l’exposition pourrait être une occasion de les nommer en tant que telles, pour éviter que ces représentations soient naturalisées. Cette exposition était accompagnée d’une publication intitulée Politiser l’enfance : une pré-anthologie, coéditée par Laurel Parker Book et les éditions Burn-Août, qui reprenait le titre de la conférence de Piterbraut-Merx. Tal Piterbraut-Merx proposa un article inédit intitulé « Conjurer l’oubli. Pour une réminiscence politique de nos enfances », Pierre Zaoui nous autorisa à reprendre l’article « Réflexions sur la question enfantine » publié en 2009 dans la revue Vacarme et je contribuais avec un article intitulé « L’aire de jeux, un modèle politique ? »La publication peut être téléchargée sur le site des éditions Burn~Août : https://editionsburnaout.fr/.. Il s’agissait alors de la préfiguration d’un projet de reader qui regrouperait des textes abordant la question des rapports entre enfance et politique, et notamment dans l’art. Tal Piterbraut-Merx accepta de nous aider à choisir les textes qu’il pourrait contenir.
Tal Piterbraut-Merx a mis fin à ses jours le 25 octobre 2021. Tal a été victime d’inceste pendant son enfance. Politiser l’enfance entend rendre hommage aux recherches et à l’engagement de Tal Piterbraut-Merx en invitant des auteurices d’horizons différents (artistiques, universitaires, autodidactes) à envisager la question selon leurs perspectives propres. Conçue par des éditeurices formé·es en école d’art ou y enseignant l’esthétique, cette publication aborde la question de la politisation de l’enfance, celle qu’il faut dénoncer comme celle qu’il faut défendre et imaginer, mais n’entend pas pour autant se placer sous l’égide du paradigme de l’art comme production de connaissance. Il nous importe plutôt de mettre ce dernier à l’épreuve de la politisation de l’enfance. L’art est social de part en part et doit être passé au crible de la déconstruction et du questionnement critique. Avec les éditeurices de Burn~Août, il nous importe surtout de donner un plein sens à l’idée de politisation comprise comme mise au jour des rapports de pouvoir, loin de considérer que l’art opèrerait le moindre geste de dévoilement de vérité par nature ou par essence. Aussi les questions artistiques et esthétiques ne sont-elles pas l’objet principal de cette publication. Nous nous sommes tourné·es vers des approches militantes ou relevant des sciences sociales et de la philosophie pour aborder la double question des critiques à adresser aux politiques de l’enfance à l’œuvre et des perspectives à envisager pour imaginer des futurs désirables.
Pour réaliser ce reader, nous avons sollicité auteurices/artistes militant·es (Mégane Brauer, Juliet Drouar, Adel Tincelin, Laurent Abecassis), artistes-chercheuses (Ane Hjort Guttu, Marie Preston, Cendre Valente Rodrigues), chercheureuses en sciences sociales (Arnaud Alessandrin, Maialen Berasategui, Agnès Dopff, Ghislain Leroy, Belinda Mathieu, Erica R. Meiners, Julie Pagis, Irène Pereira) et philosophes (Antonia Birnbaum, Camille Louis, Arnaud Teillet, Pierre Zaoui) — ces différentes catégories n’étant pas exclusives les unes des autres. De même, nous avons réédité et/ou traduit des textes de militant·es féministes et/ou homosexuel·les (Shulamith Firestone, Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-Legry, Christiane Rochefort) et/ou chercheureuses (Jenny Kitzinger, Eve Kosofsky Sedgwick, Alexander Kluge et Oscar Negt) — nombre d’entre elleux ayant été des références importantes pour Tal Piterbraut-MerxAinsi Shulamith Firestone, Jenny Kitzinger, Christiane Rochefort, Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-Legry.. Ces contributions ont ensuite été réunies en différentes thématiques auxquelles elles ne se réduisent pas, mais auxquelles nous avons eu recours par commodité. Ce reader n’est en aucun cas le reflet d’une attente qui lui pré-existe et qu’alors il se contenterait d’illustrer. Loin de défendre une approche univoque, il s’agit d’élargir la façon dont nous pouvons comprendre et appréhender l’enfance. Cette publication est avant tout partielle et lacunaire.
Le premier chapitre, intitulé « Contrer les représentations incapacitantes », commence avec le texte de Tal Piterbraut-Merx « Conjurer l’oubli », dans lequel le philosophe relève la spécificité de la relation de domination adulte-enfant relativement à « la grande famille des rapports de pouvoir (classe sociale, genre, race, etc.) », soit son « schéma d’inversion nécessaire, en ce que tout adulte a un jour été enfant ». Un retour collectif sur nos mémoires de ce moment permettrait alors que soit ressaisie collectivement « la condition réelle et politique de l’enfance ». Jenny Kitzinger a accepté que nous reprenions un article de référence pour Tal, « Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence », dans lequel elle montre que le recours trop fréquent à l’idée d’innocence pour dénoncer les violences sexuelles contribue à vulnérabiliser les enfants. Dans l’article « Suite d’un dialogue interrompu avec Tal Piterbraut-Merx. “Domination adulte” et rôle éducatif de l’adulte », Ghislain Leroy, qui avait conduit avec lui le séminaire « Dominations, socialisations et émancipations enfantines », « précise » les théories de la domination adulte en tenant compte de « la complexité des relations sociales » et de l’ « incomplétude » définitionnelle de l’enfance, c’est-à-dire en prenant en compte la question de la socialisation.
Le deuxième chapitre, « L’expérience sensible du monde social », aborde la question des moyens qu’il est possible de mettre en œuvre pour saisir la perception enfantine de la complexité du monde social. Dans « Cry me a River », l’artiste Mégane Brauer retranscrit non pas des souvenirs d’enfance mais des « blocs d’enfanceGilles Deleuze, Felix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 206. », dans un environnement dont la précarité est évoquée par des sensations physiques (pluie d’été, piscine chlorée, odeur du testeur de parfum volé au supermarché…). Dans « Nature/Exposition », à l’occasion de l’exposition éponyme qu’elle organise avec son fils de neuf ans, l’artiste-chercheuse Ane Hjort Guttu s’interroge sur la façon dont cette expérience peut être menée de la façon la plus égalitaire possible. La chercheuse en sociologie politique Julie Pagis s’intéresse à la perception de la campagne des élections présidentielles d’une classe de CM2 d’un établissement situé en Seine-Saint-Denis (« L’expérience sensible de la politique chez les enfants. Retour sur la préZIZIdentielle de 2017 »), cette expérience faisant également l’objet de l’attention de la dessinatrice Lisa Mandel.
Le chapitre intitulé « Prendre la parole » reprend la revendication « Pour le droit de vote des mineur·es » portée par l’activiste Juliet Drouar, ainsi que des fac-similés des deux numéros du journal scolaire Des Enfants s’en Mêlent que les élèves de l’école des Charmes, dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, ont publié entre 1989 et 2001. Marie Preston, artiste et enseignante-chercheuse, en retrace le contexte intellectuel et pédagogique dans « Un journal d’opinion ».
Dans « Transidentité et enfances queer », Adel Tincelin et Charlie Tincelin-Perrier montrent que « si on regarde les relations parent/enfant au prisme de la transidentité, cela veut dire que la transidentité fait des relations parents/enfants un diamant » (« Tout ce dont on parle est bizarre »). Dans « Les mouvements antagonistes de politisation de la question des mineurs trans et non-binaires », Arnaud Alessandrin revient sur l’apparition de la figure du mineur trans et les controverses qui l’ont accompagnée. Les questions que soulève le sociologue résonnent avec celles formulées par Eve Kosofsky Sedgwick en 1991 dans l’article « Comment élever vos enfants gayment ».
Le chapitre « L’enfant et l’œuvre d’art » questionne la façon dont l’enfance est présente et représentée dans les arts. Dans « Un “Je” d’enfant sur scène », Agnès Dopff et Belinda Mathieu relatent les différentes façons dont le spectacle vivant évoque la figure de l’enfance, « phénomène [qui] trahit les impensés de la société adulte à [son] égard ». Maialen Berasategui revient sur la présence d’enfants acteurices dans des comédies musicales et les dynamiques de relations et représentations adulte/enfant qui s’y jouent. Dans « Pourquoi politiser l’enfance ? », je reviens pour ma part sur les mythes de l’enfance que l’on peut percevoir dans l’œuvre de Claude Lévêque et la généalogie intellectuelle avec laquelle il est possible de la mettre en relation.
Le chapitre « Fausses émancipations » contient des extraits d’un ouvrage dont les propos ont été minoritaires dans les années 1970 et 1980, alors que la parole propédophileL’usage du terme « pédophilie » a été remis en cause par des associations de protection de l’enfance et des organisations féministes au profit du terme de « pédocriminalité » car le premier élude le caractère criminel de l’acte. On le reprend ici car il était employé dans les débats intellectuels par celleux qui l’ont défendu comme par celleux qui ont argumenté pour sa condamnation. trouvait nombre de tribunes. Rééditer deux chapitres de L’Enfant et le pédéraste de Jean-Luc Pinard-Legry et Benoît Lapouge permet de revenir sur la réfutation de ces arguments et de dénoncer ce type d’approche, loin de l’instrumentalisation à laquelle sa condamnation peut donner lieu de nos joursRoxana Azimi, « La justice tranche en faveur du Palais de Tokyo dans la polémique autour d’une œuvre de Miriam Cahn », Le Monde, 27 mars 2023..
Dans le chapitre « Retours sur les années 1970 » est réédité le chapitre « Pour l’abolition de l’enfance » de La Dialectique du sexe de Shulamith Firestone (qui reprend et radicalise l’approche de Philippe Ariès sur la relativité de cette catégorie), ainsi qu’un extrait de Les Enfants d’abord de Christiane Rochefort, qui remet en cause nombre de fausses évidences. Dans « L’espace public des enfants », extrait de Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit [Espace public et expérience : sur l’analyse de l’organisation des espaces publics bourgeois et prolétarien], Alexander Kluge et Oskar Negt envisagent la présence des enfants dans l’espace public bourgeois comme étant fondamentalement oppositionnelle.
Dans « Enfances au xxie siècle », la designeuse graphique Cendre Valente Rodrigues interroge celle qui fut son ancienne éducatrice sur sa formation, le fonctionnement d’une maison d’enfants à caractère social qui accueille des enfants après décision d’un·e juge pour enfants dans le cadre de la protection de l’enfance, et sur les difficultés auxquelles ce type de structure est confronté, notamment en terme de moyens. Camille Louis (« Déjouer la minorité, retrouver l’enfance ») s’attache à montrer comment les « mineur·es migrant·es » « circul[ent] entre les bords des nominations qu’on leur donne arbitrairement, trouvent aussi les armes pour sortir (plus ou moins symboliquement) des institutions trop souvent pensées pour mais sans les enfants ». Erica R. Meiners s’attache à montrer la façon dont les nombreuses lois de l’État carcéral états-unien « donnent de la valeur à des enfants, au détriment de nombreux autres », les enfants trans, gay et racisé·es (« L’enfant à problèmes : provocations pour démanteler l’État carcéral »).
Dans le chapitre « Face aux injonctions néolibérales », Laurent Abecassis (« Kiss & Cry ») relate son expérience d’enfant sportif de haut niveau et les injonctions contradictoires qu’il a alors expérimentées : entraîner avec une rigueur d’adulte un corps qui doit rester celui d’un enfant. Dans « L’ “enfant-potentiel”, un modèle en crise », Arnaud Teillet examine les politiques néolibérales de l’enfance et les normes qu’elles imposent à la subjectivation des enfants, comprise comme potentiellement illimitée, selon une logique proprement capitaliste. Irène Pereira envisage, dans « Pédagogie critique à destination des enfants », une pédagogie qui « n’est pas en premier lieu […] centrée sur l’enfant », mais qui n’en permet pas moins de proposer « des règles concernant le rôle idéologique de l’école publique » et d’établir « la spécificité du temps de l’enfance ».
Dans le dernier chapitre, intitulé « Émancipations et hypothèses », Antonia Birnbaum revient sur une figure américaine de l’émancipation enfantine, le récit de l’autoapprentissage de la lecture de Frederick Douglass, alors qu’il était esclave, compris comme récit exemplaire du « nouage entre apprentissage et révolte « (« L’enfant, l’alphabet, l’abolition »). Le reader se clôt sur les « Réflexions sur la question enfantine » de Pierre Zaoui, dans lesquelles le philosophe met en garde contre la double tentative de « comprendre l’enfance […] comme un monde à part, [ou] comme la vérité profonde du monde […] parce que c’est toujours un « monde-avec » — avec les femmes, avec les serviteurs, avec les fleurs, les arbres et les animaux, avec les fous, avec les étrangers, avec les criminels et les bandits ».
Nous remercions très chaleureusement les auteurices qui ont contribué·es à la publication en nous proposant un texte inédit ou en nous autorisant à rééditer et, le cas échéant, à traduire un article ou un extrait d’ouvrage déjà publié, ainsi que les ayant droits qui nous ont autorisé·es à en faire de même avec les textes qui leur ont été confiés.
Conjurer l’oubli, pour une réminiscence politique de nos enfances —
La philosophie est bavarde, et les adultes aussi. Mais pour asseoir leurs discours, pour les informer, il leur faut des figures, des supports confortables qui fortifieront leur apparence. Les images ont cette vertu qu’elles offrent une surface accueillante, une matière qui convient à s’y établir pour un temps.
L’enfance — et non les enfants — fait partie des images prisées des adultes, et des philosophes. Tout soupçon de naïveté de leur part est rapidement écarté : attention, il ne s’agit aucunement d’évoquer les enfants réels, ces minots qui peuplent les aires de jeux, ou qui hantent les salles de classe. Iels ne le pourraient de toute façon que difficilement, tant leur fréquentation directe est rare, et le droit de réponse des enfants dénié dans les revues savantes. Les philosophes adultes évoquent des fantasmes enfantins, des enfances imaginaires, des émanations de leur esprit dont il n’est plus sûr, à la lecture des textes, de quelles créatures il est exactement question.
Deux écrits à la portée subversive assumée s’inscrivent dans une telle démarche et exhibent de manière inversée une représentation de l’enfance tantôt comme potentiellement révolutionnaire, tantôt comme au service d’un ordre réactionnaire. Il s’agit de l’album « Co-IreGuy Hoquenghem et René Schérer, « Co-Ire. Album systématique de l’enfance », Recherches, n° 22, avril 1977. » rédigé par Guy Hocquenghem et René Schérer, et de l’ouvrage No Future. Queer Theory and the Death DriveLee Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, Durham, Duke University Press, 2004. de Lee Edelman. L’avertissement qui ouvre ces textes se veut éclairant : les deux militants homosexuels nous l’assurent, ils ne sont « pas portés sur la révélation, surtout pas sur la révélation de l’enfance », mais se proposent d’en explorer l’évocation à travers les romanciers qui « ont le mieux parlé de l’enfanceG. Hoquenghem et R. Schérer, « Co-Ire. Album systématique de l’enfance », op. cit., p. 7. ». Une petite trentaine d’années plus tard, le théoricien queer Edelman, lorsqu’il prône dans une formule provocante la mort de l’Enfant en tant qu’ « emblème de l’advenirL. Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, op. cit., p. 30. », précise à son tour qu’il s’en prend à la figure imaginaire de l’enfant, au sens lacanien du terme.
Revenons rapidement sur la portée de la référence à l’enfance dans ces écrits. Chez Hocquenghem et Schérer, l’accent est placé sur les motifs littéraires qui figurent une saillie dans le système bourgeois d’éducation et de captation des enfants. Le « rapt » (autrement dit la « séduction » de l’enfant, ou encore le rapport sexuel initié par un adulte sur l’enfant) est — de façon déconcertante et assez révoltante — envisagé comme un des rêves de l’enfance : contrairement à la fugue qui contient un retour possible au foyer, le rapt vient faire rupture dans l’enfermement de l’enfance. C’est donc l’alliance de l’enfant et du pédophile, couple maudit, qui contient selon les auteurs des potentialités révolutionnaires ; les deux adultes ne parviennent, dans leurs mirages, pas tout à fait à s’évincer du projet de libération de l’enfant. La projection adulte vis-à-vis de l’enfant bat ici son plein : le corps enfantin, impubère, se fait ainsi pour eux, et dans la rencontre sexuelle avec l’adulte, promesse d’un renouvellement des pratiques sexuelles. Coucher avec un enfant permettrait alors de délaisser la sphère trop restreinte de la sexualité génitale, pour envisager d’autres usages. Comme s’il était besoin des enfants pour reconstruire des pratiques sexuelles ex-centriques !
Chez Edelman, le motif s’inverse : si la figure de l’Enfance est convoquée, c’est de manière négative pour désigner cet élan conservateur de toute politique. Sous le terme de « futurisme reproductif » (reproductive futurism), le théoricien dénonce cette projection de toute politique vers le futur, qui prend la forme d’une conservation de l’ordre social. L’Enfant, désigné comme le bénéficiaire potentiel de toute politique, entérine la reproduction de l’ordre symbolique : c’est pour nos enfants, au nom de ceux-ci, qu’il faudrait lutter et s’élever contre (les réformes du système du mariage, les politiques écologiques, les transformations sociales diverses et variées, etc.). À cette projection futuriste, Edelman oppose la satisfaction de la jouissance dans l’instant. Occuper l’espace de la négativité, c’est ainsi refuser de s’engager pour une temporalité qui n’est pas la nôtre, et qui s’efface à mesure qu’on la rejoint. C’est renoncer à agir politiquement en fonction d’un futur hypothétique incarné dans l’enfance.
Les deux textes, vous me l’accorderez aisément, examinent peu l’enfant réel (si tant est qu’il existe quelque part). Le reproche serait d’ailleurs injuste, car ces textes se refusent précisément à le faire. Contempler les enfants tel·les qu’iels existent, cela n’est pas leur affaire. Et pourtant, on peut se demander si cette multiplication des fantasmes adultes sur les enfants n’a pas pour effet une fixation de projections erronées, incorrectes et déformées, qui négligent trop rapidement le rapport de pouvoir exercé par les adultes sur les enfants. De la même manière que la pluralité de textes de philosophes hommes sur la « Fâme » (pas la vraie, attention, la symbolique, celle qui n’existe pas réellement) pourraient de façon justifiée être accusés d’être vecteurs de représentations sexistes, il en est de même des textes des adultes sur l’enfance.
Que faire alors ? Comment aborder l’enfance en tant qu’adultes, si ce n’est par ces billevesées d’adultes ? Doit-on choisir, pour contrecarrer les glissements de notre imagination, de se livrer, en chaussant des lunettes d’inspecteur·ices, à des enquêtes sur les enfants, sur leurs modes d’existence, leurs pratiques, etc. ? Oui, mais ne risquerait-on pas de négliger à nouveau notre position d’adulte, et donc de surplomb ? Celle-ci peut, comme nous le propose certain·es de nos ami·es sociologues, être objectivée. J’emprunterais cependant un autre chemin, qui se détourne de la rêverie autour de l’enfance imaginaire, et qui cherche à se rapprocher des enfants comme sujets politiques et de lutte, sans passer par l’enquête sociologique. Je vous le soumets maintenant.
Examinons pour introduire cette proposition la structure des rapports adulte-enfant. Ceux-ci appartiennent à la grande famille des rapports de pouvoir (classe sociale, genre, race, etc.) et doivent analysés en tant que tels. Un point d’importance les distingue pourtant de ces derniers : les rapports adulte-enfant s’organisent autour d’un schéma d’inversion nécessaire, en ce que tout adulte a un jour été enfant. Cela n’est pas le cas des rapports de classe, de genre et de race ; le caractère nécessaire de l’inversion est donc une spécificité du rapport d’âge. Cette caractéristique des rapports adulte-enfant produit un rapprochement phénoménologique inédit entre le pôle des dominant·es (celui des adultes) et celui des dominé·es (celui des enfants). En effet, l’adulte possède une expérience en première personne du statut d’enfant, bien que cela s’effectue sur le mode du souvenir ; la porosité entre les deux groupes s’en trouve considérablement accrue.
Comment, à partir de ce schéma d’inversion, les adultes se rapportent-iels à leur enfance ? Et, question plus difficile, comment des personnes peuvent-elles dominer des sujets qui se situent à la place qu’elles occupaient naguère ? Les enfants sont élevé·es dans l’idée que les comportements des adultes à leur égard sont justifiés par leur éducation, qu’iels agissent dans leur intérêt. Si un inévitable soupçon naît lorsque la maîtresse monte la voix, lorsque l’éduc’ frappe, et si ce système de justifications menace finalement sans cesse de se fissurer, la fiction a la peau dure. Mais qu’advient-il de l’autre côté, lorsque l’enfant devenu·e adulte et doté·e d’une autorité nouvelle rencontre des enfants ?
Un alliage étrange et monstrueux se forme : il semble d’un côté que l’adulte ait pour une grande partie et le plus souvent oublié les brimades, les humiliations et les violences vécues, ou les minimise (le fameux « j’en suis pas mort·e »). L’enfance se trouve alors idéalisée, comme un âge d’insouciance et d’irresponsabilité regretté. Et, en même temps, l’adulte se souvient des promesses qu’on lui a tenu enfant : il faut accepter cet état inconfortable pour pouvoir devenir adulte. Tu auras droit, plus tard, d’utiliser le couteau qui coupe fort, de rester dehors, de décider par toi-même de tes sorties, de tes ami·es ! L’inconfort du statut d’enfant est condition de possibilité de la liberté acquise chez l’adulte. L’oubli de l’adulte vis-à-vis de son enfance est ainsi paradoxal : la mémoire opère son travail de sélection et de tri, et les souvenirs se parent d’un éclat nouveau, qui réhabilite l’exercice du pouvoir.
Pour devenir adulte, il semble qu’il faille oublier la condition réelle et politique de l’enfance. Christiane Rochefort s’élève dans l’essai Les Enfants d’abordChristiane Rochefort, Les Enfants d’abord, Paris, Gallimard, 1983. contre un tel état de fait :
Mais être « adulte » après tout n’est qu’un choix, par lequel on s’oublie, et se trahit. Nous sommes tous d’anciens enfants. Tout le monde n’est pas forcé de s’oublier. Et dans la situation dangereuse où le jeu adulte aveugle nous a menés, et veut entraîner les plus jeunes, l’urgence aujourd’hui presse un nombre croissant d’anciens enfants qui n’ont pas perdu la mémoire de basculer côté enfantsIbid., p. 3._._
L’urgence est donc de se souvenir, non de l’enfance idéalisée, ou de l’enfance en général, mais de la condition politique des enfants, de ses affres et de ses injustices, pour mieux pouvoir la conjurer, et la transformer.
L’acte de réminiscence que j’envisage est une démarche politique et collective : elle ne renvoie pas au cheminement dual qu’est la thérapie analytique, qui vise souvent à « mettre de l’ordre » dans les souvenirs d’enfance et à faire entendre à un·e supposé·e enfant intérieur·e que sa place n’est pas celle de l’adulte advenu·e. Il importe cette fois de se rappeler, avec le plus de lucidité possible, de ce que furent nos enfances, de quelles matières elles étaient faites, quels en étaient les rythmes et les conditions.
Une œuvre m’a en ce sens particulièrement ému. Elle est littéraire et constitue un travail sûrement solitaire. Mais Mémoire de filleAnnie Ernaux, Mémoire de fille, Paris, Gallimard, 2014. d’Annie Ernaux est porteuse d’une justesse rare quand il s’agit d’évoquer le travail de mémoire vis-à-vis de soi (ici moins de l’enfance à proprement parler que de l’adolescence, qui est moins lointaine). L’auteure décrit au début du texte cet effort, pénible et exigeant, de remémoration d’un souvenir qui l’a longtemps hantée. Elle a tourné autour, a écrit des bribes de phrases, les a aussitôt délaissées. Cette fois, elle s’y met. Elle re-construit : quand elle avait dix-huit ans, l’été 1958, sa « première fois » avec un homme en colonie de vacances. Elle exhume des vieilles images, des photographies, des lettres écrites et peut-être altérées pour les besoins du récit littéraire. Que signifie se souvenir, vraiment ? Quel effet de réalité est exigé ?
La « fille de 1958 » n’est pas rangée, elle bouscule et détraque les attentes vis-à-vis de son genre. Elle ne mange plus, ou trop, cumule les partenaires masculins et le claironne sans saisir tout à fait la portée de ces déclarations. Ernaux veut pourtant mettre au jour non seulement les cadres de sa propre mémoire d’alors, mais également, comme le souligne le titre de l’ouvrage, celle de la plupart des filles de son époque, et peut-être encore un peu celles d’aujourd’hui. La portée universalisante du récit épouse les ambiguïtés des conduites de jeunes filles privées d’une part de savoir : si la première fois est présentée comme un rite de passage séduisant et attrayant, les jeunes filles ne savent pas réellement ce qu’il recèle. Comme le formule Ernaux, « il est le maître du jeu, je ne connais pas la suiteÉmission radiophonique « Violé·es : une histoire de dominations. Épisode 3 : Fabriquer d’autres récits », LSD La série documentaire, consultée le 4 août 2021, /lsd -la-serie-documentaire/fabri quer-d-autres recits-9261689. ». L’écrivaine dit alors cette honte féroce d’un événement pornographique qui se déroule sans elle, et qui crée du même coup les conditions d’un attachement et d’une fidélité à l’amant d’un soir. La jeune femme attend le jour suivant dans la chambre de celui-ci, se ridiculise aux yeux des autres, emploie à son encontre des expressions déplacées.
Ce qui me frappe dans le récit d’Ernaux, c’est cet acharnement délicat à vouloir ré-énoncer les conditions de possibilité d’un événement, à en retraduire les aspérités, le caractère déplaisant sûrement pour l’adulte advenu. Ernaux ne cache pas son désir d’alors, sa maladresse, ses tentatives gauches. À l’instar d’une telle démarche, se remémorer nos enfances pourrait passer par une relecture de nos conduites, de nos ratés, de nos attentes déçues. Cela peut se faire dans des ateliers collectifs et répétés, et en dialogue avec les enfants d’aujourd’hui. Il ne s’agit nullement à l’inverse de reproduire exactement les enfants que nous étions : une telle tâche est vaine car la mémoire altère, et elle ne répond en rien aux visées politiques de l’exercice. Appréhender le statut politique des enfants, c’est accepter de s’imprégner de cadres de pensée que nous ne possédions sûrement pas en l’état au moment de notre enfance. Ainsi, si Ernaux emploie en 2021 le mot « viol » pour désigner cette « première fois », elle ne le peut que parce que les mobilisations féministes post-#MeToo ont transformé son rapport à l’événement. La ressaisie de celui-ci est ainsi étirée et distendue entre le temps de l’enfance ou de l’adolescence et le temps ultérieur de la conscience politique acquise et digérée.
Comme Ernaux dit à l’auteure Mathilde Forget « Vous avez raison et maintenant, j’ai raison de dire violIbid. », disons-nous à nous aussi que nous avons raison de vouloir nous pencher à nouveau sur ces histoires perdues que sont nos enfances. Non sur le mode du fantasme, mais en réaménageant ces effets de réel, en les mettant au travail, afin de repenser radicalement les structures institutionnelles et sociales qui organisent l’enfance. Au risque, peut-être, de s’y cogner fort.
Défendre l’enfance : les idéologies de l’innocence —
Au cours des dernières années, la question des abus sexuels dont les enfants sont victimes a repris place au centre du débat public. On a pu voir se développer un mouvement pour la protection de l’enfance disparate qui fait la promotion du travail de prévention dans les écoles et se trouve à l’initiative de projets tels que la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants, la ChildLine. Une campagne publique d’information a été menée à grande échelle, la plupart des magazines féminins ont publié des articles sur le sujet et plusieurs documentaires ont été diffusés à la télévision. Ces différentes ramifications de la campagne visent à contester certaines idées fausses liées aux agressions sexuelles concernant leur nature, leur fréquence, le profil de l’agresseur et le rôle de la familleCaren Adams, Jennifer Fay, No More Secrets: Protecting Your Child from Assault, San Luis Obispo, Impact Publishers, 1981 ; Blair Justice, Rita Justice, The Broken Taboo, Londres, Peter Owen, 1979.. Ce mouvement cherche ainsi à remplacer d’anciens « mythes » par de nouveaux « faits ». Cependant, le paradigme mythe/fait opacifie la dimension politique de ces « nouvelles » approches des violences sexuelles sur les enfants. Jamais les faits ne « parlent d’eux-mêmes » et ces campagnes font émerger des représentations questionnables de l’homme, de la femme, de la maternité et de la vie de famille. Quelques-unes de ces questions ont été traitées ailleursJenny Kitzinger, « The Politics of the Child Protection Movement », in HOLLY, 1988. mais je voudrais, cette fois, mettre l’accent sur les représentations de l’enfance telles qu’elles se donnent dans les programmes scolaires publics et les reportages traitant des violences sur enfants dans les médias.
La plupart d’entre nous avons connaissance aujourd’hui de ces représentations de l’enfance qui émergent lorsqu’il est question de violences sexuelles sur mineur·es à la télévision, dans les journaux ou dans les brochures militantes pour la protection des enfants. L’enfant abusé·e est incarné·e par une silhouette anonyme, désarticulée et désolée qui se tient assise, la tête entre les jambes, ou bien ce sont un frère et une sœur affligées qui regardent au loin depuis la fenêtre ; parfois encore, l’enfant est figuré·e par une simple poupée brisée. Ces images peuvent être réificatrices et voyeuses en elles-mêmes, mais, que ce soit fait avec « goût » ou non, elles mettent systématiquement l’accent sur la jeunesse et la passivité de l’enfant.
Lorsqu’une affaire d’agression est rapportée, les portraits des victimes se concentrent toujours sur des attributs propres à l’enfance, comme les nattes, les rubans à cheveux, la petite robe marinière, « son sac à main en plastique préféré, avec les poignées arc-en-ciel » ou sa montre à l’effigie de l’ours PaddingtonThe Sun, 10 décembre 1986 ; The Mirror, 9 décembre 1986 ; Today, 2 juin 1987.. Même le journalisme d’investigation « sérieux » qui traite de l’exploitation sexuelle des enfants utilise parfois, en guise de fond sonore, le tintement d’une boîte à musiquePar exemple : R. Cook, émission télévisuelle, « The Cook Report », ITV, 8h30, 29 juillet 1987.. Tous ces artifices soulignent le fait que la victime est un·e enfant — le concept d’enfance étant un problème en soi ; si on venait à en douter, il n’y a qu’à voir comme les violences sexuelles sur mineur·es sont souvent désignées par des expressions telles que « le vol ou la violation de l’enfanceA. Barr, « Child Sex Abuse: We Need Money Not Sentiment », Observer, 9 novembre 1986 ; The Sun, 13 décembre 1986 ; A. Bardbury, « A Model of Treatment », Community Care, 4 septembre, 1986. ».
Ce type de documentation contient donc l’affirmation implicite de ce qu’ « est vraiment » l’enfance. L’enfance est parfois présentée comme un temps du jeu, une existence asexuelle et paisible au sein d’une cellule familiale protectrice. Cela dit, cette image est à la fois ethnocentrée et illusoire. Même en s’intéressant à certaines horreurs de l’enfance, ces reportages renforcent les mythes au sujet de l’ « essence véritable de l’enfance » qui contredisent le vécu de la majeure partie des jeunes. J’aimerais traiter ici de la façon dont le mouvement pour la protection de l’enfance insiste sur deux qualités inhérentes à la « vraie » enfance : l’innocence et la vulnérabilité.
Innocence de l’enfance
Le mouvement pour la protection de l’enfance lutte contre une tradition ancienne qui fait de la victime de violences sexuelles une participante active et qualifie les enfants victimes de « Lolita » ou de « nymphettesSarah Nelson, Incest: Fact and Myth, Edinburgh, Stramullion Press, 1987 ; F. Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, op. cit. ». L’accent qui est mis sur l’innocence propre aux enfants a donc en partie pour effet de contrebalancer ces clichés, mais il s’est lui-même transformé en une préoccupation fétichiste. Les livres qui traitent de violences sexuelles sur mineur·es portent des titres tels que The Betrayal of InnocenceSusan Forward. et Craig Buck, Betrayal of Innocence: Incest and its Devastation, Harmondsworth, Penguin, 1981. [l’innocence trahie] ou bien The Death of InnocenceSam Janus, The Death of Innocence, New York, Morrow, 1981. [la mort de l’innocence] et l’expression « voler l’innocence d’un enfant » est devenue synonyme d’agression sexuelleThe Sun, 13 décembre 1986 ; The Mirror, 10 décembre 1986 ; Star, 15 novembre 1986..
L’innocence est un symbole fort et touchant mais il est contre-productif de l’utiliser dans le but de révolter le grand public contre les abus sexuels. Pour commencer, la notion d’innocence enfantine elle-même émoustille les agresseurs. Un coup d’œil à la pédopornographie suffit pour écarter tout doute quant au fait que l’innocence est une marchandise sexuelle. Les magazines de pornographie juvénile font en sorte de mettre en avant tout particulièrement la pureté de leurs mannequinsFlorence Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, New York, McGraw-Hill, 1980, p. 164.© Droits réservés. Les publicités ont recours à des images de jeunes filles grimées en Marylin Monroe, accompagnées de slogans comme « l’innocence est plus sexy que vous ne le pensezIbid., p. 125. » et l’industrie de la mode se remplit les poches avec, pour les femmes adultes, des chemises de nuit de poupée et, pour les jeunes filles, des T-shirts portant l’inscription « Fruit défendu ».
Dans une société où l’innocence est fétichisée et où les hommes sont excités à l’idée de souiller ce qui est pur et déflorer ce qui est vierge, insister sur l’innocence présumée des enfants ne fait que renforcer le désir des hommes pour les enfants en tant qu’objets sexuels. Comme le disait un pédocriminel : « C’était grisant, elle était si jeune, si pure, si propreStar, 4 décembre 1986.. »
Ensuite l’innocence est un angle d’attaque discutable dans la lutte contre les violences sexuelles, car il stigmatise l’enfant « qui sait ». Romantiser une innocence de l’enfance, c’est exclure celles et ceux qui ne se conforment pas à cet idéal. Une enfant précoce, qui semblera séductrice et consciente de sa sexualité, pourrait se voir refuser toute protection puisque, si on juge l’acte d’agression sexuelle selon le critère d’atteinte à l’innocence, abuser un·e enfant « conscient·e » serait moins grave qu’abuser d’un·e enfant « innocent·e »Cette même notion de victime qui le mérite et de victime qui ne le mérite pas a bien sûr été utilisée pour parler de victimes de viol adultes. Lorsque Peter Sutcliffe a violé et assassiné des femmes dans le Yorkshire, les gens ont été plus touché·es pour ses victimes « innocentes » que pour les prostituées qu’il avait tuées.. C’est cette notion qui permet aux agresseurs de se défendre en prétendant que leur victime « n’avait rien d’un ange ». L’un deux, par exemple, a avancé que sa victime était loin d’être innocente : elle buvait, fumait et faisait rarement ses devoirs. Il était bien placé pour le savoir, c’était son proviseurThe Daily Mail, 14 décembre 1985..
La notion d’ « innocence » et, par extension, sa possible perte peuvent également ouvrir la voie à davantage de victimisation :
L’enfant qui a subi une agression sexuelle peut ne plus être vu·e ni comme un·e enfant, ni comme un·e adulte, mais comme un « produit endommagé » auquel manquent les caractéristiques, et de l’enfant, et de l’adulte […] Les enfants victimes d’agressions sexuelles peuvent devenir des « invitations ambulantesSuzanne Sgroi (éd.), Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, Cambridge, Lexington Books, 1982, p. 114.. »
Un·e enfant reconnu·e comme victime d’abus sexuels est souvent susceptible de subir d’autres formes d’exploitation :
Une conséquence étrange du processus de catégorisation est la fascination que la fillette suscite chez les autres… Déflorée en public de la sorte, elle n’est plus considérée comme digne de respect ni de protectionRoland Summit, Joann Kryso, « Sexual Abuse of Children: A Clinical Spectrum », American Journal of Orthopsychiatry, n° 48, 1978, p. 244..
L’innocence est donc un concept problématique car, d’une part, elle est en soi une marchandise sexuelle et, d’autre part, tout·e enfant qui s’éloigne un tant soit peu de l’image de « l’ange » pourrait être considéré·e comme une cible légitime, tant par la justice que par les autres hommes qui profiteront plus facilement d’un·e enfant qu’ils savent victime de violElizabeth Ward, Father-Daughter Rape, Londres, The Women’s, 1984 ; Frances Sarnacki Porter, Linda Canfield Blick, Suzanne Sgroi, « Treatment of the Sexually Abused Child » in Suzanne SGROI (éd.), Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual Abuse, op. cit., p. 114.. Cela dit, plus fondamentalement, l’innocence devrait être rejetée en bloc, car c’est une idéologie utilisée pour empêcher les enfants d’accéder à la connaissance et au pouvoirStevi Jackson, Childhood and Sexuality, Oxford, Blackwells, 1982..
Au nom de « l’innocence de l’enfance », les adultes répriment les expressions sexuelles des enfants, leur refusent tout contrôle vis-à-vis de leur corps et les « protègent » de la connaissance. En effet, c’est la notion d’innocence qui empêche certains parents de parler d’incesteIndependent, 28 avril 1987. puisqu’ils ne veulent pas « corrompre les quelques années d’innocence auquel chaque enfant devrait avoir droitM. Brown, « A Parent’s Dilemma », Sunday Times, 19 octobre 1986. ». Cela amène aussi les personnes qui s’emploient à dénoncer les violences sexuelles sur mineur·es à être accusées de détruire l’ « âge de l’innocence » en levant le voile sur l’exploitation sexuelleNews on Sunday, 3 mai 1987..
Protéger les faibles
Un autre motif récurrent dans les travaux traitant des abus sur mineur·es est celui de la « protection ». On y souligne la faiblesse des enfants, mais on analyse peu, voire pas du tout, les déséquilibres structurels dans les rapports de force qui en sont la cause. On rejette l’analyse du pouvoir au profit d’une approche paternaliste. On conseille aux parents de mieux surveiller leurs enfants et d’éviter de les laisser dehors seul·es ou le soirFoster Care (1986) « Streetproof Your Children », juin 1986.. On trouve même dans le commerce des « Todlers Minders », des badges électroniques qui fonctionnent comme ceux donnés aux personnes assignées à résidence sous contrôle judiciaire, et qui déclenchent une alarme si l’enfant s’éloigne d’une certaine zoneThe Observer, 17 août 1986.. Une telle ambiance de siège pèse lourd sur la mère. Elle soumet également les enfants à un couvre-feu et leur apprend à vivre dans la peur :
Dans quelle mesure est-il acceptable de limiter la liberté d’un·e enfant ? Le petit trajet jusqu’au kiosque ? Jusqu’à la friterie ? Cinq cents mètres ? Cent mètres ? Pas au-delà du portail ? Est-il possible, dans un tel cadre, de développer le sentiment individuel d’indépendance pourtant aussi important que celui de prudenceM. Brown, « A Parent’s Dilemma », art. cit. ?
Un autre problème consiste à se concentrer — encore une fois — sur la restriction de la liberté des potentielles victimes plutôt que sur celle des potentiels agresseurs. En se focalisant sur les victimes, il échappe au mouvement de protection des enfants que la vulnérabilité n’existe pas in vacuo et n’a de sens qu’en relation à quelque chose d’autre — à savoir, une menace. Cette approche est lacunaire, que ce soit d’un point de vue pratique, sur le court terme, ou d’un point de vue idéologique, sur le long terme. Imposer un couvre-feu ne protégera pas mieux les enfants, car la plupart des agressions surviennent au sein du foyer de la victime ou de celui de l’agresseurDavid Finkelhor, Sexually Victimized Children, Londres, Macmillan, 1979, p. 74.. Comme le soulève une personne victime d’inceste :
Il est troublant que tant de militant·es pour la protection des enfants s’obstinent à faire du foyer un sanctuaire et à avertir les enfants de « ne pas parler aux inconnus » (Say No to Strangers, un court-métrage du Home Office). Ironiquement, ce conseil pousse les enfants à s’isoler et se confiner d’autant plus dans l’enceinte de la familleM. Barrett et R. Coward, (1985) « Don’t Talk to Strangers », New Socialist, novembre 1985, p. 23. et sous-entend qu’il faudrait encore renforcer le contrôle parentalJudith Ennew, The Sexual Exploitation of Children, Cambridge, Polity Press, 1986, p. 69..
Faire appel à la protection paternelle est tout particulièrement inapproprié, étant donné que le père ou le beau-père peut très bien être l’agresseur. Le rôle de protecteur que joue le père est, en un sens, assez compatible avec celui de possesseur, la notion de propriété étant présente à la fois dans le devoir de protection et dans le droit d’exploitation. Le père ou le frère à qui on confie la défense de la virginité d’une femme et à qui on donne le droit de la « donner » en mariage peut, au même titre, revendiquer le droit de l’utiliser sexuellementJudith Herman, Father-Daughter Incest, Cambridge, Harvard University Press, 1981, p. 54..
La « protection » n’est donc pas une solution à l’exploitation des enfants sur le long terme (et ne l’est souvent même pas sur le court terme), de même, la « vulnérabilité » n’apporte rien à la conversation. En effet, la « vulnérabilité » est un obstacle de taille dans le combat pour la libération des enfants et permet d’empêcher toute discussion critiquant l’oppression d’un point de vue structurel. Même certain·es pionner·ères dans l’analyse féministe des abus sexuels sur les mineur·es ont accepté ce concept et leur analyse s’en est alors trouvée limitéeLe mouvement pour la protection de l’enfance conventionnel tel qu’il est évoqué dans ce chapitre correspond à un ensemble d’idées plus qu’il ne désigne un groupe d’individus. Certaines personnes citées ne se considèrent pas nécessairement « conventionnelles » et peuvent aussi exprimer des opinions plutôt révolutionnaires. Certain·es auteurices, tel·les que Rush, conçoivent les violences à l’encontre des enfants en termes de rapports de force et de constructions sociales, mais font des propositions qui sapent d’autres visions plus radicales ou, tout au moins, se prêtent à la récupération par l’idéologie libérale. Ce sont précisément ces contradictions ainsi que l’omniprésence de la pensée conventionnelle (ou la récupération d’idées radicales) qui rendent si importante l’analyse de ces constructions.. Après avoir étudié de façon poussée et détaillée le contexte culturel et historique dans lequel surviennent ces agressions, Florence Rush affirme :
Je crois qu’utiliser le terme de libération aussi négligemment dans le cas des enfants est à la fois dangereux et absurde. Comme iels naissent dépendant·es et vulnérables, les petit·es ont donc toujours compté sur les capacités supérieures de l’adulte pour survivre… Mettre sur le même plan l’oppression des enfants et celle des personnes noires et des femmes, c’est se tromper sur la nature de l’enfanceF. Rush, The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children, op. cit. p. 186..
Rush n’a pas tort sur le fait qu’il est trompeur de prendre le principe de libération développé par un groupe opprimé et de le calquer, tel quel, sur un autre. Les oppressions liées à l’âge, à la race, au genre ou à la classe sociale sont très différentes. Pourtant, ce n’est pas une raison pour rejeter le principe de « libération » et s’en tenir à une sorte de philosophie protectionniste. Plutôt que de se résigner à une approche réductrice selon laquelle les enfants sont « sans défense » et ont, par conséquent, davantage besoin de protection que de droits, on pourrait développer une analyse plus pertinente de la façon dont les enfants sont opprimé·es.
Les groupes opprimés ont de bonnes raisons de se méfier de toute théorie basée sur un déterminisme biologique. Il existe une longue tradition consistant à justifier et excuser l’oppression en prenant pour appui la biologie — comme si c’était la nature, et non la main humaine, qui nous enfermait. En Occident, par exemple, on a utilisé la notion de faiblesse innée, biologique, pour dispenser le « beau sexe » (autrement dit, les femmes blanches de classe moyenne) de tout travail rémunéré et des positions politiques de pouvoir. La faiblesse est un critère qui s’applique de façon sélective : les femmes noires et celles de la classe ouvrière se sont rarement vu offrir le privilège d’être protégées, et même les femmes blanches de classe moyenne doivent abandonner toute prétention à la fragilité quand elles deviennent trop arrogantes. De la même manière, la « vulnérabilité » qu’on accorde aux enfants en tant que catégorie ne protège pas celles et ceux qui ne s’y « rangent » pas ou qui sortent du rang.
Il est important de ne pas tomber dans des interprétations supposément sensées de « limites » biologiques ni dans la promesse d’une offre de protection. J’avancerais plutôt que cette notion de la vulnérabilité inhérente aux enfants — comme fait biologique, inaltéré par le monde qui les entoure — est une idéologie de contrôle qui détourne notre attention d’une oppression des enfants socialement construite. Comme le soulève JacksonS. Jackson, Childhood and Sexuality, op. cit., les enfants sont gardé·es dans la dépendance bien plus longtemps dans la société occidentale que dans d’autres sociétés. Les jeunes sont dépolitisé·es, économiquement restreint·es et les droits et responsabilités légaux qui définissent la citoyenneté pleine et entière leurs sont refusés. Leur dépendance est entretenue :
Beaucoup d’efforts sont consacrés à ce que les enfants restent puéril·es… Celles et ceux qui se comportent comme des adultes sont vu·es, au mieux, comme amusant·es et, au pire, comme complètement insupportables. Si nous ne cherchions pas autant à nourrir l’immaturité, le mot « précoce » serait-il devenu une insulteIbid., p. 27. ?
À cet endroit, les théories de la libération des enfants peuvent constructivement emprunter des idées à d’autres mouvements de libération qui exigent des droits et des ressources au lieu d’implorer la pitié et la protection (les femmes rejettent la galanterie et la place assise qu’on leur cède et demandent des congés maternité et des crèches ; les personnes présentant un handicap physique rejettent la main tendue, en faveur d’architectures plus adaptées).
Pour s’attaquer à la racine des abus sexuels sur mineur·es, il faut considérer la position des enfants dans la société. La première étape pourrait être de changer les termes du débat en remplaçant le concept de « vulnérabilité » par des termes tels qu’ « oppression » ou « impuissance » et en changeant les notions restrictives de la « protection » par des notions libératrices d’ « empouvoirement ».
Conscience d’adulte, affirmation des enfants : un pas en avant
Malgré ces critiques, de nombreux programmes de prévention font le lien entre l’agression des enfants et leur position dans la société, même s’ils échouent à développer des approches théoriques plus larges. Ces programmes de protection de l’enfance s’opposent au stéréotype qui veut que les enfants racontent souvent des mensonges et questionnent les méthodes utilisées par les adultes pour réduire les enfants au silence et les forcer à obéir en recourant à l’intimidation (« Fais ce qu’on te dit », « Parce que je te le dis », « C’est pour ton bien »). Ces programmes font donc le parallèle entre notre refus d’écouter les enfants de manière générale et notre manque d’attention quand iels nous parlent d’abus :
Nous avons trop l’habitude de considérer les enfants comme une source d’agacement, une nuisance sonore ingérable. Tant que l’on persiste à croire que les enfants devraient être vu·es mais pas entendu·es, le silence protège l’agresseurPaul Griffiths cité par E. Rantzen in « Dear Esther », Sunday Times, 9 novembre 1986..
Nombre d’écrits récents attirent l’attention sur la façon dont nous refusons aux enfants le droit de contrôler leur propre corps, que ce soit en les obligeant à faire un bisou à Papa ou en leur mettant des coupsCaren Adams, Jennifer Fay, No More Secrets: Protecting Your Child from Assault, op. cit., p. 14-15.. Ils nous mettent au défi de revoir notre propre usage du pouvoir et ce dans tous les domaines, pas seulement en tant que parent mais aussi en tant qu’ « inconnu·e », personne travaillant auprès des jeunes ou enseignant·es. Comme l’affirme une proviseure :
On ne peut pas enseigner aux enfants qu’iels sont responsables de certains aspects de leur vie, puis attendre d’elleux qu’iels restent assis·es dans une classe à ingurgiter des informations sans possibilité de débattre ou de poser des questions. L’enfant qui se plie aux règles et rentre dans le rang est un·e enfant en dangerLinda Frost, citée in C. Aziz, « Teaching Children to Say No », Guardian, 6 janvier 1987, p. 10..
Ces réflexions nous aident à prendre conscience de notre rapport quotidien aux enfants et à modifier notre propre comportement pour minimiser notre collaboration à une structure sociale qui est foncièrement contre les enfantsBien que les femmes fassent souvent l’expérience directe des oppressions de l’enfance, le mouvement féministe semble généralement éviter le sujet. Les écrits contemporains pour la libération des femmes ont tendance à parler des enfants uniquement en relation avec les femmes (source de joie ou de peine, accomplissement ou piège) ou bien en tant qu’objets de conditionnement sexiste. Sur les 175 références faites aux enfants dans The Feminist Dictionnary et The Quotable Woman,moins d’une douzaine s’intéressent à leur statut social. Cf. Cheris Kramarae, Paula A. Treichler, A Feminist Dictionary, Londres, Pandora Press, 1985, et Elaine Partnow, The Quotable Woman, New York, Facts on File, 1985..
Le traitement que nous réservons aux enfants n’est cependant pas une simple question d’attitude ; c’est le reflet de notre position de pouvoir vis-à-vis d’elleux :
L’enfance n’est pas qu’un état psychologique, c’est aussi un statut social — très peu élevé, au demeurant. Prenons comme exemple la fréquence à laquelle les enfants sont touché·es par les adultes. La quantité de contact physique non sollicité reçu par une personne est un bon indicateur de sa position sociale. On a pu observer que les patron·nes touchent les employé·es, que les hommes touchent les femmes et que les adultes touchent les enfants bien plus souvent que l’inverse. Toucher une personne dont le statut social est supérieur au sien, sans raison valable, constitue un acte d’insubordination. Considérons par exemple la façon dont l’enfant est souvent repoussé·e quand iel use du toucher pour attirer l’attention d’un·e adulte, alors que lea même adulte peut librement attraper l’enfant, lea recoiffer à sa guise, interrompre ses activitésS. Jackson, Childhood and Sexuality, op. cit., p. 26..
Pour remettre en question l’infériorité sociale des enfants, il est essentiel de reconsidérer la façon dont nous les traitons, mais cela ne suffira pas à résoudre les inégalités.
Les programmes de prévention essaient aussi de pousser les enfants à changer leur comportement. On les encourage à s’affirmer (« Tu as le droit de dire NON »), à être attentif·ves à leurs émotions et à les exprimer (« Mon corps, c’est mon corps »[N.D.T.] La version francophone de Feeling Yes, Feeling No.) et à développer la notion de contrôle sur leur propre corps. Voici la retombée positive des actions menées en réponse à l’idéologie de la vulnérabilité — ici, la vulnérabilité n’est pas seulement ce qui justifie la nécessité d’un·e adulte protecteurice, mais quelque chose que les enfants peuvent changer par elleux-mêmes en modifiant leur comportement. Des jeux de rôle et de société, des histoires et des chansons sont créés dans le but précis d’aider les enfants à résister aux agressions. Le message est, comme l’affirme ce refrain entraînant :
Une telle revendication de « droits » pour les enfants reste cependant superficielle tant que l’on attend d’elleux qu’iels obéissent aux figures d’autorité légitimes. Les campagnes de prévention visent à ce que les enfants aient davantage confiance en elleux, mais les adultes sont rassuré·es quant au fait qu’ « appendre aux enfants à dire non » n’a rien de « subversifC. Aziz, « Teaching Children to Say No », art. cit. » ; cela « ne veut pas dire qu’iels vont se mettre à refuser de boire leur lait ou de manger leurs légumes, juste pour le plaisirLinda Frost citée in ibid. ». Autrement dit, le mouvement pour la protection des enfants les encourage à exprimer leurs opinions mais attend quand même d’elleux qu’iels fassent ce qui est « pour leur bien », d’après la définition qu’en donnent ces adultes bienveillant·es qui demandent des choses « raisonnables ».
S’exercer à l’affirmation de soi de façon si isolée peut difficilement entraîner un changement radical et, dans tous les cas, cela a peu de chances d’avoir un effet sur le long terme. Même si l’on apprend à un·e enfant qu’iel a droit à l’autonomie corporelle, iel recevra quotidiennement des messages implicites qui lui diront le contraire. « Mon corps » devrait être sans doute « le corps de personne d’autre que moi », mais le fait est que les enfants font tous les jours l’objet d’invasions physiques : non seulement iels subissent des viols et des agressions, mais leurs corps sont assujettis à des lois face auxquelles iels sont impuissant·es, leurs images sont exploitées dans la publicité et les adultes contrôlent ce qu’iels portent, ce qu’iels font et quand iels peuvent le faire. Il est impossible pour un·e enfant de développer une quelconque notion d’autonomie corporelle sans avoir jamais vraiment pratiqué ce « droit » :
Les exercices visant à mieux s’affirmer forment donc un début, mais pas une solution, et le terme de mesure « préventive » n’est certainement pas approprié ; former des individus pour qu’iels s’affirment davantage afin de « prévenir » les agressions sexuelles sans remettre en question les inégalités concrètes revient à construire un abri antiatomique en « prévention » d’une guerre nucléaire.
Les programmes pour la protection des enfants qui ont pour priorité de changer isolément les attitudes des enfants offrent, au mieux, des solutions individuelles. Au pire, ils créent l’illusion que les victimes ont le pouvoir de résister, un pouvoir minime en réalité. S’il est important que les enfants ne soient pas terrorisé·es au point de penser qu’iels sont totalement incapables de se protéger (et il est des situations où iels seront bien capables de repousser un agresseur), il est également crucial de reconnaître qu’un·e enfant peut bien crier « non » à son père, et ce avec aplomb, cela n’empêchera pas forcément ce dernier de lea violer, puisqu’au final c’est lui qui a le pouvoir. Le message selon lequel les enfants peuvent se protéger s’iels s’affirment peut donc prêter à confusion. Il peut aussi avoir pour effet de renforcer un sentiment de culpabilité chez les enfants en faisant peser sur leurs épaules la responsabilité de ce qui leur est arrivé : peut-être qu’iels n’ont pas dit « non » assez franchement.
Pour résumer, si le mouvement contemporain pour la protection des enfants présente isolément quelques aspects encourageants, les campagnes conventionnelles échouent, de toute évidence, à prendre position contre l’oppression systémique des enfants. Elles ne sont donc pas seulement extrêmement limitées en termes de résultats, elles renforcent également les idéologies mêmes qui exposent les enfants à l’exploitation.
Suite d’un dialogue interrompu avec Tal Piterbraut-Merx. « Domination adulte » et rôle éducatif de l’adulte —
Ce texte prend place à la suite d’échanges hélas avortés avec Tal Piterbraut-Merx, avec qui j’avais bâti, ainsi qu’avec Kevin Diter, un séminaire, prévu pour 2021-2022Enfance(s) et sociologie(s) — CREAD (cread-bretagne.fr) Thématique retenue : « Dominations, socialisations et émancipations enfantines », séminaire croisé entre le séminaire « L’enfance comme catégorie sociale » (CRESPPA, GTM) et le séminaire « Enfance(s) et sociologie(s) » (université Rennes 2, laboratoire CREAD).. Après la disparition de Tal, Kevin et moi, en concertation avec les invité·es, avons pris le parti de mettre malgré tout en œuvre ce séminaire. S’il a donné lieu à des interventions passionnantes et à des échanges de grande qualité, je regrette en ce qui me concerne que beaucoup de questions que je voulais poser à Tal n’aient pu l’être. Elles étaient contenues dans le titre même du séminaire, visant à faire dialoguer les concepts d’ « émancipation » et de « socialisation ». Je vais ici en mentionner quelques-unes, qui se nourrissent également de ma note de synthèse d’HDR (qui a repris ces deux termes dans son titre) et des échanges que j’ai eu avec mon garant Bertrand Geay, mais également certains des membres du jury, tels que Jean-Yves Rochex.
Tal m’a fait découvrir le courant de pensée de la domination adulte et son actualité. Comment le définir ? On peut dire qu’il vise à penser le rapport adulte/enfant à l’instar d’autres rapports de domination, comme le rapport homme/femme, ou personne « blanche »/personne racisée. Règnerait une naturalisation du pouvoir sur l’enfant, indissociable d’une vision téléologique et développementale, dont l’enfant serait le départ. Il est alors essentiellement conçu comme « manque », ce qui légitimerait l’empire du pouvoir adulte. En mettant ensemble les enfants de 0 à 18 ans, en les rassemblant dans la « minorité », on s’interdirait également volontiers de saisir les différences de potentielles et possibles individualisations des enfants. Jusque dans les campagnes de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, la figure d’un enfant faible, innocent, règneTal Piterbraut-Merx, « L’émancipation des mineur·es, une prise en main ? », Délibéré(e), 2-13, 2021, p. 51-58.. Cela fonde en ricochet une forte légitimation du pouvoir adulte sur les enfants qui est justement à l’origine des violences subies par les enfants.
Si ces violences se produisent majoritairement sur la scène familiale, alors il semble que le système de tutelle légale ne remplisse pas correctement son rôle de protection. En dépassant l’affirmation vague selon laquelle l’enfance serait en danger, et en donnant un visage à la menace et donc aux agresseur·ses [très souvent, les membres de la famille], nous soulignons les insuffisances de ce modèleIbid., p. 54..
Ces entrées sont heuristiques pour renouveler la pensée sociologique sur l’enfance. Surtout dans une période sociale où l’ampleur des violences faites aux enfants se dévoile de plus en plus. Alerter sur le fait que la famille peut être, voire est souvent, un espace de non-droit et de violence est extrêmement important.
Il n’en reste pas moins que le schéma conceptuel de la domination adulte doit peut-être être précisé pour éviter certaines interprétations. À un premier niveau qui n’est pas le plus important, je dirais qu’il est nécessaire de ne pas trop isoler la relation adulte-enfant du reste de la société, ni de réifier ce qu’est un adulte (c’est peut-être le risque de l’expression « domination adulte »). On peut ainsi se demander si parler de relation adulte/enfant ne s’avère pas un peu trop en abstraction des raisons sociales qui fondent les manières d’être adulte, et les manières d’être enfant. C’est un reproche que l’on m’avait d’ailleurs fait en thèseGhislain Leroy, Figures de l’enfant et pratiques des maîtres de l’école maternelle contemporaine, thèse de doctorat en sciences de l’éducation sous les directions de Régine Sirota et d’Éric Plaisance, université Paris Descartes, 2016. Cette thèse a donné lieu à un ouvrage : Ghislain Leroy, L’École maternelle de la performance enfantine. Bruxelles, Peter Lang, 2020. ; réfléchir au rapport adulte de maternelle/enfant, sans assez prendre en compte ce que la manière d’être adulte doit à ses définitions sociales (ainsi, dans ce cas-là, qu’aux attendus professionnels qui structurent la profession). Bref, les manières d’être adulte doivent être resituées dans la complexité des relations sociales et des définitions sociales de l’adultéité, de la parentalité, à un moment donné.
De la nécessité du lien éducatif et non de son abolition
Ensuite, et plus fondamentalement, on peut se demander si les théories de la domination adulte ne peuvent pas avoir tendance, mal interprétées, à sous-estimer certaines incomplétudes réelles des enfants, comme le fait qu’ils sont effectivement plus capables de se mettre en danger par exemple, ou leur incomplétude éducative (langage par exemple) ; nous parlons ici bien sûr des plus jeunes. Pour eux, le refus de la violence est par exemple un apprentissage et le fruit d’une socialisation ; ainsi si l’adulte peut être violent avec l’enfant, l’enfant sans intervention adulte peut aussi être violent avec un autre enfant… Même s’il faut dire aussi que grandir dans une cellule familiale violente est une socialisation à la violence. Mais, si c’est un fait que l’adulte peut faire preuve de violence envers l’enfant et obérer fondamentalement son devenir, l’absence d’adulte « bon » (initiant au refus de la violence) peut également être à la source de graves carences. Pour Hannah ArendtValérie Gérard, Politique et violence selon Hannah Arendt : La violence antipolitique vs la politisation violente des rapports humains, in Guillaume Sibertin-Blanc (éd.), Violences : Anthropologie, politique, philosophie, Toulouse, EuroPhilosophie éditions, 2017. ., le devenir de chacun est de trouver place dans un groupe qui lui préexiste (ce qu’elle nomme le « politique »), et dans lequel seul peut se créer un horizon de sens (et éventuellement d’individualisation), au-delà de la violence initiale. Jean-Yves RochexJean-Yves Rochex, « Expérience scolaire et procès de subjectivation », Le français aujourd’hui, 2009/3, n° 166, p. 21-32. ., dans une inspiration proche, reprend à Lacan et Wallon l’idée selon laquelle l’enfant possède une incomplétude originelle très forte et qu’il ne se développe qu’en faisant siens des schèmes de pensées et d’action qui lui sont transmis par l’extérieur. La sociologie de l’éducation en général est fort diserte sur l’importance de la transmission des capitaux culturels, qui n’apparaissent pas ex nihilo, spontanément, chez les individus.
Je note que Tal à la fin de son article dans la revue Délibéré(e) évoque positivement certaines expériences éducatives, notamment issues du féminisme utopique qui sont, je pense, l’occasion de mettre en œuvre d’autres types de liens éducatifs, et non de les abolir.
Dans La Dialectique du sexe, Firestone pose ainsi, à partir d’un retour critique sur différentes expériences communales (les communes russes, les kibboutzim en Israël et Summerhill), les jalons d’un tel projet. Nous retiendrons en particulier deux éléments : le remplacement des familles nucléaires par des ménages d’environ dix personnes, régies par des contrats limités dans le temps et dont un tiers des membres seraient des enfants qui pourraient à leur demande être transféré·es vers d’autres foyers ; la désarticulation entre l’activité de procréation et de gestation, d’une part, et le régime de la filiation juridique, d’autre part. Si c’est le statut de dépendance juridique et matériel de l’enfant envers ses parents qui entérine particulièrement sa fragilité sociale et politique, alors il importe de déstabiliser la hiérarchie de pouvoir au sein de l’institution familiale, mais aussi de refuser l’idée selon laquelle la procréation devrait nécessairement conférer des droits élargis sur l’enfant à venir. L’utopie de Firestone, mais aussi celle de Sophie Lewis, comporte donc une attention particulière aux modes de reproduction artificielle. La force de tels écrits est qu’ils montrent que l’émancipation des mineur·es ne peut être véritablement conçue à partir de réformes juridiques ou pédagogiques isolées, mais doit l’être à travers une réflexion critique sur l’ensemble des institutions socialesT. Piterbraut-Merx, « L’émancipation des mineur·es, une prise en main ? », art. cit, p. 56. Au sujet de Full Surrogacy Now. Feminism Against Family, Marianne Modak écrit : « De manière provocatrice, Lewis ajoute qu’un enfant expérimente déjà à une vaste échelle cette situation de parenté élargie : l’enfant bourgeois blanc élevé par de multiples substituts maternels, ce qui prive “la classe ouvrière […] de ses mères engagées comme travailleuses maternelles dans les familles bourgeoises” (p. 150) ». Marianne Modak, « Sophie Lewis : Full Surrogacy Now. Feminism Against Family », in Nouvelles Questions Féministes, 2020/2, vol. 39, p. 160-163..
D’autres passages de ses travaux évoquent l’importance, et les ressources, que peuvent constituer l’insertion dans un collectif, notamment pour les victimes de violences sexuelles.
C’est ici qu’intervient l’inscription de l’individu dans des groupes sociaux ou des communautés qui doivent être comprises ici comme communautés linguistiques où circulent des éléments de vocabulaire, des moyens d’expression, des codes qui permettent d’approcher et de construire comme tels les événements traumatiques. Ce sont aussi, en plus des manières d’en parler, des occasions d’évoquer les violences vécues, des espaces de paroles qui sont fournis par la communauté. Chaque groupe ou ensemble de groupes distribue différentiellement la parole et sélectionne les sujets de discussion acceptables et inacceptables, et bien sûr, lesrègles du bien-direPierre Niedergang et Tal Piterbraut-Merx, « Violence sexuelle ou “initiation” ? », in GLAD!, n° 10, 2021. . Les auteurs renvoient à Pierre Bourdieu et son article « Censure et mise en forme » (in Ce que parler veut dire, 1982, Paris, Fayard)..
En somme, par son lien aux groupes féministes et queer, il est évident que Tal ne défendait pas un individualisme solipsiste, ignorant de la nécessité pour un individu de devenir soi dans un groupe qui lui pré-existe. Or cela peut être nommé « éducation » et permet de penser des articulations individualisation/insertion dans un collectif et donc individualisation/socialisation.
L’apprentissage de l’individualisation
Nous nous accordons à Tal pour considérer que l’émancipation individuelle (individualisation) est une chance pour l’individu. C’est la capacité à faire des choix propres, singuliers, différents peut-être de ceux que l’on attend de nous. C’est un enfant qui peut affirmer telle ou telle préférence et qu’elle soit entendue, même si telle n’était pas l’idée initiale de ses parents pour lui. C’est un individu qui peut se prononcer sur lui-même. Nous avons déjà dit que cette visée d’autodétermination a des limites. Il est évidemment normal qu’un parent refuse d’un bébé qu’il expérimente de toucher le feu par exemple. Mais surtout, il nous semble absurde d’opposer trop frontalement individualisation et socialisation. Cela pourrait être le risque, nous semble-t-il, d’une lecture trop rapide des travaux autour de la domination adulte. Les logiques d’individualisation sont aussi le fruit d’une certaine éducation (et non d’une autre). Cela apparaît justement dans l’entretien qui suit le texte de Tal dans Délibéré(e) (rédigé par la rédaction après un échange en visioconférence avec Laurence Francoz-Terminal). Ce texte évoque l’importance pour l’enfant « d’expérimenter de façon progressive et extrêmement concrète l’exercice de [ses] droits et la responsabilité de [ses] actes, en d’autres mots, de remettre davantage les mineur·es en capacitéRédaction de la revue Délibéré(e), « Remettre les mineur·es en capacité », Délibéré(e), 2-13, 2021, p. 57. De même que la vulnérabilisation est aussi le fruit d’une socialisation, comme le dit Tal : « Faire de la vulnérabilité un état naturel, c’est en effet abandonner toute réflexion sur la manière dont des conditions politiques spécifiques rendent vulnérables ; c’est se priver d’outils pour les transformer, ce que critiquent d’ailleurs nombres de théoriciennes féministes. » Tal Piterbraut-Merx, « Enfance et vulnérabilité. Ce que la politisation de l’enfance fait au concept de vulnérabilité », in Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE, n° 57, 2020. https://journals.. ». Est souligné alors le fait que l’individualisation est aussi une expérience permise ou non dans un certain contexte éducatif, qui y invite et y socialise. C’est ainsi que nous comprenons la démarche éducative mise en œuvre au sein du célèbre pensionnat de Summerhill. Il avait été fondé par Alexander Sutherland Neill qui avait subi une éducation religieuse austère. Dans ce pensionnat, le principe était que les enfants pouvaient s’adonner aux activités et aux apprentissages de leur choix. Neill disait qu’entre apprendre à faire une boule de neige ou apprendre la grammaire, peu importait. Si cette expérience présente un certain nombre de limites (logique spontanéiste), elle a peut-être eu le mérite de tenter de relier les enfants à leurs intérêts personnels et profonds, bref à les socialiser à être « eux », à faire des choix propres et personnels. Si l’on peut considérer qu’une telle manière d’être à soi est positive pour chacun de nous, il faut aussi admettre que l’on peut être accompagné à se retrouver et à oser être soi. Cela peut être long ; c’est le fruit d’une socialisation. Il est naïf de croire que tous les enfants (idem pour les adultes) spontanément font des choix de ce type. Il faut avoir évolué dans un certain contexte éducatif favorisant l’individualisation pour s’individualiser. C’est ainsi intéressant de concevoir que l’adulte peut aussi accompagner l’enfant à faire des choix propres, singuliers, à s’affirmer comme une personne. Peut-être que ce type d’attitude a quelque chose de « naturel » ; mais cela peut aussi être conforté par la socialisation.
Classes sociales et agency
Dans quelles classes sociales les enfants sont-ils les plus libres ? Cette question connexe aux présents développements n’est pas simple. Nous évoquerons ici un article d’Annette Lareau, reproduit dans un ouvrage collectif récent coordonné par Régine Sirota et Sylvie OctobreAnnette Lareau, « Ouverture. Les inégalités invisibles. Classe sociale et “élevage” des enfants dans des familles noires et des familles blanches », in Sylvie Octobre et Régine Sirota (éd.), Inégalités culturelles : retour en enfance. Paris, ministère de la Culture — DEPS, « Questions de culture », 2021, p. 39-101. .. Dans cet article, elle montre que les enfants de milieux moyens ont un emploi du temps très dense, très rythmé, qui permet une maximisation des apprentissages rentables scolairement. Nous pouvons alors faire l’hypothèse qu’ils y développent vraisemblablement des capitaux scolaires, indissociables d’un certain type de développement cognitif et de capacités de jugement, etc. De l’autre côté, les enfants populaires « zonent » dans le quartier, vont un peu où bon leur semble, etc. Lareau les compare à des plantes sauvages. Ils ne développent certes pas de capitaux scolaires, mais ils vivent des situations dans lesquelles ils font l’expérience de l’individualisation, de formes de « liberté » (suivre ses envies, etc.), terme qu’emploie Lareau. Certes, cela aura évidemment un coût social, la liberté étant ici à l’inverse de la carrière sociale. Mais Lareau nous invite aussi à nous méfier de la socialisation des enfants moyens, qui pourrait aboutir à des logiques qu’elle nomme « frénétiques » et que nous comprenons contraires à la logique d’individualisation, qui est importante pour le bien-être de chacun.
Pour conclure, la critique de domination adulte nous paraît utile pour démasquer les situations non éducatives, faussement éducatives, violentes, et non pas pour remettre en cause la valeur émancipatrice d’une (bonne) éducation, d’un compagnonnage, qui doit initier l’individu à son propre pouvoir d’agir, le servir. Un dialogue entre les travaux sur la domination adulte et la sociologie de l’éducation et de la socialisation, qui montrent l’importance de la transmission éducative des comportements, est ici heureux. Si plusieurs autrices féministes citées par Tal ont une vision critique de l’école comme lieu d’assujettissement de l’enfant, on n’en peut pas moins nous semble-t-il, au moins en partie, articuler critique de la domination adulte et valorisation du compagnonnage éducatif, avec l’adulte, le pair, ou encore le professeur, bref souligner l’importance des liens sociaux au service d’une émancipation qui est à la fois individuelle et collective.
Cry me a River —
Je crois qu’il n’y a rien à faire aujourd’hui, à part regarder MTV. Le classement des meilleurs clips de l’année. Ce sera sûrement les Destiny’s Child. Heureusement que j’ai un vélo et MTV. Il pleut très fort alors que c’est l’été. Je ne sais pas si j’ai mangé encore, ni quelle heure il est. La pluie a arrêté le temps. L’été aussi. Je crois qu’il est tôt. C’est sûrement le matin. Car il est sombre bizarre. Et. Quelque part, pas très loin. On entend pleurer pleurer très fort et crier crier. C’est une pluie bruyante et spectaculaire. C’est la S qu’on entend crier de quelque part elle est pourtant forte cette pluie mais on l’entend quand même fort fort par dessus. On peut se dire que c’est parce qu’elle a trop pillave qu’elle est comme ça parce qu’elle boit fort fort la S quand même. On a envie qu’elle arrête de pleurer comme ça. Qu’elle arrête d’être bruyante et spectaculaire. Car on entend même plus la pluie. Bruyante et spectaculaire. Il fait chaud alors je vais sous la pluie. Et je veux savoir ce qui se passe je crois. C’est le déluge. Et y‘a rien à la télé aujourd’hui. C’est agréable la pluie chaude mais ça rend tout plus dramatique aussi. La dernière fois je suis passée devant un PMU près de chez moi, il y avait le gérant qui arrosait ses lauriers, des lauriers rose fuchsia au bord de la route, ses lauriers ils sont un peu en train de crever, ils sont un peu en vie quand même, puisqu’ils fleurissent. Il fait chaud c’est la fin de l’après-midi. Les plantes sont dans des pots en pierre calcaire, tout engonçés contre les tables. Le patron tchatchait avec un type, un truc qui parait important, il faisait chaud et l’eau débordait des pots de fleurs, il ne se rendait pas compte que ça débordait depuis un moment. C’est une odeur au pluriel. L’odeur de l’eau fraîche sur le bitume chaud, l’odeur des bières fraîches sur les corps chauds restés au soleil, le bruit du match à la télé, les jeux à gratter toujours désespérément perdants, le mélange d’aftershave Scorpio volé à Casino (le testeur) et de Lucky Strike mal éteinte dans le cendrier. Une odeur qui rappelle. Des fleurs noyées. Mais habituées, car elles fleurissent, et crèvent un peu. Comme la pluie chaude sur le trottoir, et tout le reste. Déluge. Bruyant et spectaculaire. Ça déborde, et je me suis arrêtée pour sentir encore. Ça m’arrive souvent de m’arrêter et d’essayer de savoir pourquoi comme ça s’échappe. C’est une odeur qui m’a fait plaisir. Car c’est un rappel. C’est chez S que j’ai appris à nager, un été, avec sa fille qui était mon amie, et qui m’invitait tous les jours, quand on faisait pas du vélo. On rigolait bien. Elle avait une piscine en forme de 8 derrière sa maison, pas une piscine creusée, mais quand même assez pour nager. C’était pas une piscine gonflable non plus. Et à force de perdre mes brassards qui avaient un trou et qui se dégonflaient, à force de boire de l’eau chlorée de la piscine, j’ai appris. La nage du chien d’abord. Je me rappelle descendre de chez moi et aller en courant chez elle, en pleine cagne, sans mettre mes chaussures, avec les graviers brûlants qui font courir plus vite, les bouts de verre mais on s’en fout, les mégots de Chesterfield, je me rappelle plonger jusqu’à épuisement, faire le plongeon qu’on appelait l’araignée fada et aussi prendre le goûter, comme si ça avait duré 15-20 ans comme ça. Je ne suis pas beaucoup entrée chez elle, pas même dans sa chambre où il n’y avait rien à faire, je me rappelle de la musique que son grand frère écoutait très très fort tellement fort que ça faisait trembler les murs de la maison, on aurait dit une fête foraine sauf qu’au lieu de l’effervescence et des gens excités par le sucre, il y avait un monde au ralenti dans cette maison boum boum, jusque dans mon bide que ça tremblait, le reste ne bougeait pas. Je me rappelle aussi du canapé où il y avait sa mère qui regardait la télé l’après-midi. Parfois c’étaient les clips sur MTV mais presque sans son. Comme un chuchotement un chuchotement Beyoncé. Pour entendre mieux boum boum. Son grand frère, lui, me faisait peur, il pétait souvent les plombs, il mettait des survêt’ complets blancs éblouissants de lumière, il avait un chien blanc qui terrorisait les hommes du quartier, qu’il avait dressé à l’attaque soit disant, et dès qu’il sortait les gens apeurés et cons appelaient la police. Parfois le chien errait seul dans le quartier et ça faisait ambiance Jurassic Park, avec les gens qui couraient de partout et s’enfermaient chez eux avec le chien au cul, c’était cool, comme une attraction flippante et drôle. Et ça durait On ne se rappelle pas de son nom. Ça s’échappe. Les hommes disaient qu’il fallait l’euthanasier. Mais je me suis dit que comme sa sœur était ma super copine, il ne lâcherait jamais son chien sur moi. De toute façon il ne devait pas nous entendre avec tout ce bruit, et puis moi aussi j’ai un grand frère. Et je n’avais plus peur de lui. On rentrait juste pour prendre un paquet de gâteaux vite fait et on ressortait. Des faux Prince, à la vanille, ceux du Leader Price, que je déteste et que j’adore. De la fausse vanille. Je me rappelle de l’eau qui déborde sur les dalles en gravier compressé, posées sur le sol en chemin, de l’échelle où il manquait des marches, les tourbillons incroyables, les guêpes noyées, les lèvres violettes, les mains fripées et la musique qui s’appelait Les Rois du monde qu’on écoutait sur le poste de radio. Et qu’on adorait beaucoup trop.
Nous, on fait l’amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit À quoi ça sert d’être sur la terre si c’est pour faire nos vies à genoux ? (à quoi ça sert ?) On sait qu’le temps c’est comme le vent, de vivre, y’a que ça d’important (d’être sur la terre ?) On s’fout pas mal de la morale, on sait bien qu’on fait pas d’mal (on s’fout pas mal) Nous, on fait l’amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit (de la morale) À quoi ça sert d’être sur la terre (on sait bien qu’on fait pas d’mal) Si c’est pour faire nos vies à genoux ? (On fait pas d’mal) On sait qu’le temps c’est comme le vent (on sait qu’le temps) De vivre, y a que ça d’important (c’est comme le vent) On s’fout pas mal de la morale (on s’fout pas mal de la morale) On sait bien qu’on fait pas d’mal
C’est une odeur plurielle. Je me rapproche un peu de chez la S, je suis en retrait. Elle ne me voit pas. Je sais que tous les voisins regardent derrière leurs volets en se cachant. Je vois rien mais je sais qu’ils sont là, les fantômes. Je me dis fais ton regard énervé. Je n’ai pas encore cette gênante lâcheté qu’ont les adultes. D’éteindre. Ce même geste qu’ont uniquement les hommes du quartier, de fermer leurs volets quand une voisine est tabassée par son mari. On vous voit. C’est comme une alerte pour les autres. Fermer ses volets à 16 heures comme si de rien n’était. Quand les volets des hommes se ferment, j’ai le souvenir de ma mère qui sort pour hurler sur les hommes qui sont des hommes qui ignorent la femme, et hurler aussi sur le mari qui frappe fort fort fort. Les esprits frappeurs. Lui dire de descendre si c’est vraiment un homme. Et crier La honte ! La honte ! Leur crier aux volets fermés comme un Roméo. Honte ! Je la suivais pour être sûre qu’aucun des hommes n’allait descendre et lui tomber dessus. Sans surprise, aucun d’eux n’était vraiment un homme. Ni la police. Tout éteindre. Sauf ma mère en pyjama qui fonce dans le tas. Bruyante. Spectaculaire. C’est la S qui pleure aussi fort. Il y a un camion blanc aussi. Et je vois deux hommes qui portent un gros canapé en soufflant, sans trop la regarder, un peu penauds, et un autre homme en retrait qui prend une voix qui ne veut rien savoir, qui ne veut pas discuter avec vous madame, qui non non vous étiez au courant madame, Ah si je vous ai envoyé madame, Ah ben c’est comme ça madame, c’est pas moi qui, mais enfin ne pas faire le spectacle comme ça. Allez, bon allons madame, madame, fallait y penser avant madame, bon madame s’il vous plaît maintenant c’est bon. Et les deux hommes sortent le canapé, difficilement. C’est lourd à porter un canapé Attention à ne pas glisser. Et S dormait peut-être quoi, une heure avant dans son canap’, ils portent le canapé et le foutent devant chez elle, mais aussi devant chez d’autres, sous la pluie. Et S elle pleure devant son canapé. elle veut pas qu’il parte c’est comme une rupture dans les films américain. Mais d’État français. et bien planifiée. Car il a fallu louer un camion et deux hommes. Moi je me demande pourquoi ils mettent son canapé sous la pluie, il va être foutu ça c’est sûr. Personne ne pourra plus s’asseoir dessus. Ils mettent une grosse lampe à côté. Je sais pas pourquoi il mettent pas tout directement dans le camion. Et l’huissier regarde le travail se faire en notant des choses sur un papier. Un recul sur ce que je vois. Comme une photo Et ce moment je sais qu’il ne s’échappera pas. Je sais déjà ce qu’est un huissier, je ne sais pas où je l’ai appris, mais je sais. Je sais que c’est quelqu’un qui n’est pas notre pote, avec des papiers dans les mains, qui prend tes affaires, les mets dehors, je sais maintenant qu’il les prend pour les mettre sous la pluie. C’est quelqu’un qui atteste. Je crois qu’il est dejà venu chez nous mais que maman avait caché les choses chez tatie, ou quelqu’un de ce genre qui vient fouiner chez toi sans te demander. Il n’avait rien pu prendre. Parce que le plus important dans cette histoire c’est de prendre, pour eux, reprendre. De justifier physiquement le prendre, le donne-moi ça, le c’est plus à toi maintenant fallait pas rigoler avé moi. Pas à toi À moi. De l’acter collectivement. De le donner à voir. Car c’est aussi comme un avertissement envers les autres fantômes qui regardent derrière leurs volets en se disant quelle pauvre femme, ou en se disant qu’il fallait y penser avant hein S au lieu de pillave, t’es marrante aussi toi, Hé, à un moment donné. Son chez elle qui déborde chez les autres et qui leur dit à travers les volets Méfi ! le prochain sur ma liste c’est toi Faut pas rigoler avé moi ! Je reviendrai ! Comme un Terminator des canapés La Redoute payé en dix fois (sans frais). Ça y est le canapé est trop trempé, à quoi ça sert de le prendre maintenant. Il va puer le chien pour toujours. C’est du cuir en plus. Du faux cuir. Ça m’énerve un peu j’aimerais qu’ils aillent plus vite, ils vont tout abîmer. À force de prendre. La revanche de S est que personne d’autre qu’elle ne pourra jamais plus s’asseoir sur son canapé. Et que même si tu l’oses, tu sentiras la forme de son corps, qui année après année s’est fossilisé dans le faux cuir, ce moulage de corps qui n’ira pas avec le tien, son corps qui te gênera quand tu regarderas Walker Texas Ranger. Le mélange des corps de toute la famille qui s’est mué en un seul moule. C’est sûrement l’heure de Room Raiders sur MTV, où des gens cringe fouillent la chambre d’autres gens cringe pour savoir si oui ou non ils méritent de sortir avec. Et on sait que son mari travaille de nuit et va bientôt rentrer. On sait que son mari est très gentil et qu’il est fatigué aussi, enfin c’est ce que j’entends, qu’il s’inquiète tout seul, qu’il ne parle pas, qu’il fait de la peine un peu, le seul souvenir que j’ai de cette personne est le moment où il rentre du travail, sort de sa voiture et se traîne jusque chez lui. Surtout on sait qu’il ne se doute de rien encore, qu’il se dit tiens quand je rentre je me tape une sieste sur le canap’ avec la télé allumée tout doucement, pour m’endormir avec une présence, comme une berceuse et je laisserai ma clope se consumer dans le cendrier sans l’éteindre, distrait. Et qu’on dirait comme dans les tragédies grecques, où les vaudevilles nuls, qu’on sent qu’il va arriver bientôt et qu’il dira Bon sang de bonsoir Mais… Qu’est-ce qui s’est passé ici ! Ciel ! Mon canapé ! Stupeur. Mais pour l’instant ce personnage ne se doute de rien, laissons-le. Je pense qu’il ne dira pas Ciel ! Personne ne dit Ciel ! On ne sait pas finalement. Mais on sait qu’il y a ses enfants à l’intérieur, on sait aussi qu’il y a son fils, le grand, qui hésite peut-être à lâcher le chien sur eux, qu’il y a ma copine qui voit sa télé s’envoler, alors qu’il y a le top clip sur MTV et qu’il n’y a rien d’autre à faire. C’est très long un été sans télé chez nous. Plus long qu’un été avec télé. Peut-être ils démontent même notre piscine, prennent les dalles et les paquets de gâteaux à la vanille synthétique. Et qu’ils savent qu’il y a des gens derrière les volets qui témoignent pour eux-mêmes. Qui attestent. On ne sait pas. Mais on sait la honte, et on sait que les preneurs n’arrêteront pas de prendre, pourtant, S elle continue de crier d’arrêter de prendre en hurlant. Ça ne sert à rien. On sait. Et ma mère me dit de rentrer, un peu outrée. Et pour m’expliquer ce qui se passe elle me dit que ça peut arriver à tout le monde ce qui arrive à S et qu’on aimerait pas que les autres nous regardent si ça nous arrivait à nous. À tout le monde. Je pense que ça n’arrive que dans nos mondes pourtant. Ma mère m’explique avec des mots simples qu’il y a des règles quand même, il ne peut pas prendre la machine à laver, ni le frigo, ni le lit. Mais qu’il peut prendre les jouets, la télé, les tables et le canapé. Qu’il ne peut pas quand il fait froid, mais que nous ne décidons pas de quand il fait froid ou non. Il peut prendre et partir. Et les dalles de la piscine ? Mais non pas les dalles de la piscine, c’est aux guêpes ça. Et la piscine ? J’imagine alors qu’il faudrait vider la piscine pour la démonter, ça va tout inonder partout, comme un torrent, un barrage qui cède mais qui dure deux secondes et qui s’arrête laissant juste le sol spongieux et les gens cons. Un truc un peu ridicule. Tout le monde serait trempé. Trem-pé. Il faudrait ensuite la sécher au soleil, attendre que la pluie s’arrête, peut être des heures, peut être même quarante jours, retrouver le carton tout déglingué et délavé, et que la S elle a dû le jeter le carton depuis le temps, pétard, peut-être il est là-bas derrière ou dans le garage là-bas en bas, non pas là, je sais pas sous le bordel là-bas. Qui garde le carton de la piscine, et est-ce que c’est vendu dans un carton même ? J’imagine le trou dans l’herbe qui n’a pas vu le soleil depuis 1991, les fourmis et les scarabées qui vivaient en dessous, tous trem-pés, il y a peut-être une voiture en plastique ou un mégot de Chesterfield, oublié aussi, ou qu’on avait eu la flemme d’enlever après avoir galeré à monter cette putain de piscine en pleine cagne. Et avec l’eau ça fait de la vieille boue alors il faut rincer la piscine démontée avec le tuyau d’arrosage. Et voilà les pompes en cuir du gavalo avec ses papiers de merde elle sont toutes abîmées avec cette histoire. Ciel ! Mes godasses ! Stupeur Et la piscine qui finalement ne rentre pas dans le carton, parce qu’on sait pas comment la plier. Quel bordel… Et les hommes derrière les volets fermés finalement commencent à l’ouvrir brusquement et disent que Oh pétard vous vous y prenez comme des manches, il faut prendre les bouts, bien bien la tendre par les coins ! Tu tends bien la bâche et puis tu plies ! Mais on leur répond que c’est une piscine en forme de huit et que c’est difficile trouver les coins sur un huit, vous comprenez, et puis avec toute cette eau chlorée dans les yeux on y voit rien, mais ils n’entendent pas bien de là-haut avec les hurlements de S, ça s’impatiente, alors ils descendent pour le faire eux-mêmes, en claquettes ils arrivent, on entend un galop, de la fumée au loin, il y a beaucoup d’hommes tout à coup, une centaine. C’est vrai que c’est difficile à croire. Une centaine de personnes autour de la piscine et qui tirent qui tirent et qui tirent sur la bâche pour bien la tendre, elle va presque craquer. Attention… Ils sont très vite des milliers, à ouvrir leurs volets ensemble et à donner leur avis puis à descendre pour qu’on en finisse. Et ils crient Tirez ! Tirez encore ! Ensemble ! Pliez ! Bah voilà c’était pas compliqué. Et des milliards d’autres hommes les applaudissent. Et ils remontent vite à leurs volets pour reprendre leur place hors scène pour que le spectacle puisse continuer. Attention… Juste avant que le chien qui fait peur soit lâché sur eux. Silence Plateau ! Personne ne prend la piscine bien sûr. J’imagine notre salon sans canapé, sans télé. Le drame TV de l’été. Juste Du vide. Et le bruit du frigo. Car il faut laisser assez aux gens pour qu’ils comprennent leur punition divine. Et petit à petit, j’apprends qu’il peut aussi prendre plein d’autres trucs incroyables, comme l’électricité, tel un génie malin, qu’il n’a même pas besoin de venir avec son camion blanc et ses déménageurs, que, par la pensée, par magie, il peut te plonger dans le noir à n’importe quel moment, et que les keums n’attendront pas la fin de l’épisode de Room Raiders. Éteindre encore. Mais il doit te laisser une prise qui marche, pour que le son du frigo vide soit une bande son commune de réflexion autour du prendre. Pour la dignité des personnes et l’assurance des besoins élémentaires. 3 kw correspondent à : – Un radiateur – Une ampoule – Un frigo Et ainsi tu fonctionnes à prise unique, alternant frigo bruyant, machine à laver mal installée, téléphone, et chacun son tour, sinon ça pète les plombs et te voilà sans bruit de frigo, plus rien. Le vide dedans et dehors. Plus de leçons à apprendre, c’est comme une alarme, étendue des corps aux objets. Péter tes plombs. Et petit à petit je sais qu’il peut aussi te prendre toi, qu’il peut venir très tôt avec des connards armés et un papier, un papier qui commande, parfois il n’a pas le papier mais les connards suffisent, il vient et il prend à bout de bras ton corps et le corps des tiens, au petit matin, en slibard et le mettre dehors, comme un vieu canap’ défoncé et encore chaud, avec la forme de ton cul en négatif, les miettes de chips dans les interstices, le Télé 7 jours sous le coussin, et te balancer sous la pluie. Moins lourd à porter. Jamais foutu même sous la pluie mais mieux vaut vide que plein. Pour laisser le vide prendre la place. Et te reste que tes yeux pour pleurer. Péter les plombs. Et petit à petit je comprends que c’est une guerre du prendre, qui, peine exemplaire aux autres, mais qui laisse les volets fermés, les portes se murer et les femmes en pyj’ s’auto-défendre et s’organiser, qui dit que 3 kw suffisent au top clip et au congel, mais la lumière t’oublie, qu’il fallait y penser avant ma petite, qu’il fallait réfléchir, que c’est mieux que r, qu’il ne faut pas regarder, et que les larmes chlorées, les cris de rage, les corps fossilisés, les cartons trop petits et les American Staff ne suffisent pas à garder face à ces commandements à prendre. Gardons pour nous l’adelphité Les cris et les mauvais regards. De haut en bas, comme ça. On sait bien faire. Et ne leur laissons que. Une pluie bruyante et spectaculaire.
Nature/Exposition —
Au printemps 2009, mon fils aîné, Einar, qui avait alors sept ans, a proposé que nous fassions une exposition ensemble. Ou, plutôt, ce qu’il a réellement suggéré, c’est que nous organisions l’inauguration d’une exposition — un vernissage[N.D.T ] en français dans le texte.. Ayant assisté à certains de mes propres vernissages, il avait compris que, d’une manière générale, une exposition est le point culminant d’un processus de travail. On travaille encore et encore, puis vient le vernissage.
Il est impossible de connaître les pensées d’une autre personne et pour cette raison je ne peux pas dire à coup sûr pourquoi Einar voulait faire cela. Mais la façon la plus basique dont les gens apprennent, c’est en imitant celleux qui les entourent, dès les premiers jours de la vie, quand on regarde le visage d’une autre personne et que l’on sourit quand l’autre sourit.
La chose importante, m’a-t-il semblé, c’était que l’exposition d’Einar devrait ressembler à celles qu’il avait déjà vues. Elle devrait contenir quelques objets et quelques images sur les murs. Il devrait y avoir des biscuits salés et du champagne pour enfants dans des flûtes à champagne en plastique (de préférence celles avec les bases détachables, qui tombent parfois, a-t-il stipulé, parce que c’était si amusant de voir quelqu’un·e poser distraitement un verre qui a perdu son pied sans s’en rendre compte). Il y aurait des invitations disant aux gens quand l’événement a lieu et un poster annonçant tout cela.
J’avais hâte de travailler avec Einar sur une exposition. Je concevais cela comme un projet artistique. Ce qui m’intéressait le plus était l’idée de monter l’exposition à la maison, dans notre salon-atelier, sans avoir à libérer un espace spécialement pour cela. Cela permettait de mettre ensemble ses « œuvres », mes « œuvres » et nos objets domestiques ordinaires d’une façon qui soit susceptible de produire une zone intéressante dans laquelle le statut des objets exposés serait ambigu ; certains appartiendraient au décor de notre maison, d’autres existeraient comme des jouets, d’autres comme dessins d’enfant, d’autres peut-être en tant qu’art, et ils pourraient changer de sens simplement en étant déplacés de quelques mètres. L’effet serait similaire à celui d’un atelier d’étudiants en école d’art ou à celui d’une collection désorganisée et non systématique d’art Fluxus, dans laquelle les choses sont éparpillées et personne ne sait vraiment s’il s’agit d’ordures, d’art ou d’objets du quotidien.
L’examen du statut d’objets est aussi un examen de hiérarchies. Par exemple, dans la hiérarchie des choses, des déchets occupent un niveau plus bas que celui d’un objet fonctionnel ou artistique. Les choses qui changent de niveau dans une hiérarchie imaginaire peuvent servir à questionner cette hiérarchie et l’histoire de l’art est remplie d’exemples qui démontrent à quel point cela peut être une stratégie bénéfique. Dans notre cas, nous en avons un bon exemple avec le positionnement d’une lampe d’architecte, celle qu’Einar choisit de modifier en rapprochant son ombre portée du plateau de la table. D’un seul coup, sa fonction a changé, de celle de lampe de bureau à sculpture. C’était particulièrement efficace parce qu’une lampe identique, utilisée à un autre endroit de la table, ne faisait pas office de sculpture, mais éclairait un château construit en briques emboîtables. C’est aussi facile que cela de troubler l’ordre des choses. C’est une chose que les enfants font tous les jours, naturellement, et cela peut être perçu comme l’aspect révolutionnaire de leurs jeux.
Pour moi, c’était l’idée principale derrière le projet. Dans l’esprit d’une vieille blague qui m’a toujours fascinée, celle d’un·e visiteureuse d’un musée d’art contemplant le plus sérieusement du monde les aspects esthétiques d’une lance à incendie, croyant que c’est une œuvre d’art, ce projet offrait l’opportunité d’explorer une possible zone où le statut des objets est incertain, ambivalent et plein de potentiels, une zone dans laquelle tout peut être simultanément art et non-art.
En même temps, j’étais intéressée de voir comment une collaboration entre mon fils et moi pourrait fonctionner. Ma compréhension de l’idée de collaboration dans ce cas était qu’elle devrait être basée sur l’égalité, un processus au cours duquel nous pourrions tous deux avoir des avis, les idées de nous deux auraient de la valeur et nous parviendrions à notre concept pour l’exposition au moyen de la discussion. Je n’étais pas naïve au point d’imaginer que je pourrais passer outre mon rôle de mère qui implique un exercice continu de pouvoir sur l’enfant. De plus, je suis une artiste expérimentée et je pourrais par conséquent investir mon double capital, culturel et structurel, dans le projet. Mon objectif était de considérer les initiatives d’Einar avec autant d’ouverture d’esprit que possible, dans l’espoir que, peu à peu, une véritable égalité puisse se manifester de façon fugitive.
Pour moi, il était plus important que le projet aboutisse à quelque chose qu’Einar pourrait voir comme une exposition plutôt que ne soit « élargi le concept » de ce que pourrait être une exposition. Pour moi, cela aurait été une mauvaise approche que de commencer notre travail en lui enseignant des choses sur les expositions, ainsi le fait qu’il y en a de différents types ou que beaucoup d’artistes n’ont pas recours à cette forme de présentation. En d’autres termes, c’était une hypothèse fondamentale pour notre collaboration qu’aucun des deux partis ne devrait être l’enseignant·e ou lea superviseur·e indiquant à l’autre comment les choses devraient être. Sur ce point, j’étais influencée par la théorie de la pédagogie critique telle qu’exposée par exemple par sa principale figure, Paulo Freire, qui affirme que l’égalité est virtuellement impossible dans une relation traditionnelle entre enseignant·e et étudiant·e. Dans sa Pédagogie des opprimés, Freire écrit :
Plus nous analysons les relations éducateur-élèves à l’école ou en dehors, à tous les niveaux, plus nous pouvons être convaincus qu’elles présentent un caractère particulier et marquant : ce sont fondamentalement des relations de narration, de dissertation. La narration et la dissertation supposent un sujet : le narrateur, et des objets passifs, des auditeurs : les élèves. […] L’éducateur apparaît comme un agent indiscutable, auquel est impartie la tâche d’ « emplir » les élèves avec le contenu de sa narration. […] Dans la conception « bancaire » [la forme traditionnelle] que nous critiquons ici, selon laquelle l’éducation est l’acte de déposer, de transférer, de transmettre des valeurs et des connaissances, on ne constate pas et on ne peut constater ce dépassement. Au contraire, […] reflet de la société d’oppression, […] l’ « éducation bancaire » entretient et favorise la contradictionPaulo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, Maspero, 1974, p. 50-52..
On peut insister plus vigoureusement sur cette question, à la manière de Jacques Rancière dans son livre Le Maître ignorant :
L’explication n’est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à comprendre. C’est au contraire cette incapacité qui est la fiction structurante de la conception explicatrice du monde. C’est l’explicateur qui a besoin de l’incapable et non l’inverse, c’est lui qui constitue l’incapable comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu’un, c’est d’abord lui démontrer qu’il ne peut pas le comprendre par lui-mêmeJacques Rancière, Le Maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 10/18, p. 10..
Par conséquent, une véritable collaboration devrait être basée sur le respect de la connaissance qu’Einar a déjà acquise sur la façon dont les expositions fonctionnent et sur ce qu’est l’art. Ce principe pédagogique est en fait déjà raisonnablement établi, même s’il est loin d’être totalement appliqué dans l’éducation donnée dans l’école primaire norvégienne. Dans ce contexte, les écolier·ères se débattent toujours de la même façon que les paysan·nes de Freire :
Un aspect important de l’approche pédagogique de Freire était l’usage du dessin pour représenter des situations sociales et des objets avec lesquels ses étudiant·es étaient familiers. Présentés à de petits groupes d’étudiant·es habituel·les, ces dessins constituaient la base de discussions qui fournissaient aux participant·es un cadre commun de compréhension et un ensemble de références pour former leurs propres opinions. C’était là le fondement du sens de l’art du maître que Freire considérait comme un prérequis de la pédagogie de la libération.
Par conséquent, j’ai consenti à la plupart des idées d’Einar, bien qu’il ait toujours été important pour moi d’être sûre qu’il ne décide pas de tout. Dans le pire des cas, cela aurait conduit à une sorte d’exposition d’école « pour de faux » dans laquelle chaque œuvre de chaque enfant est exposée et embellie avec un passe-partout posé de travers. La finalité de ce genre d’exercices semble consister à donner aux travaux des enfants une plus grande valeur en recourant à quelques-unes des conventions les plus éculées du monde de l’art, comme si les dessins d’enfants n’avaient pas assez de valeur en eux-mêmes. Dans ce cas, l’institution artistique est utilisée comme un instrument de pouvoir et si c’était ce à quoi notre exposition finissait par ressembler, pour moi, ce serait un échec.
Notre collaboration devrait donc aboutir à une unique exposition qui me permettrait de considérer sérieusement mes propres idées sur une exposition d’art, mais qui en même temps satisferait les idées d’Einar sur un tel événement. Alors seulement cela serait une véritable collaboration. Cela serait comme deux expositions en une, et par conséquent nous avons tranché pour un titre en deux parties (ou bien était-ce seulement de mon fait ?). La proposition d’Einar était Nature. Il me semble qu’il pensait que c’était approprié pour une exposition. Ma proposition était Exposition, qui semblait simple au point que j’espérais que cela serait ambivalent. En d’autres mots, le titre sur lequel nous nous sommes accordés était Nature/Exposition. Cela aurait été plus correct si nous avions mis les mots dans l’ordre inverse, soit : Exposition/Nature. C’est une chose dont je ne me suis pas rendu compte sur le coup, mais qui depuis est devenue évidente. Je crois pouvoir dire qu’Einar n’a jamais compris le titre et qu’il croit toujours que c’était simplement Nature.
L’apparence et le contenu de l’exposition
Il fut décidé que l’exposition consisterait en choses qu’Einar et moi avions fait chacun·e de notre côté, ainsi que quelques-unes que nous avions faites ensemble. Sur les murs étaient accrochées quelques-unes de mes plus grandes photographies non encadrées et des dessins faits par Einar et son frère cadet Ole. Il y avait également un certain nombre d’images qu’Einar avait créées en utilisant des logiciels graphiques ou bien Word de Microsoft telles qu’une invitation à un « groupe de danse » fictif avec des lignes en pointillés à remplir par lea destinataire. Einar avait compris que cette invitation ne convenait pas à cette exposition, mais je tenais à ce qu’elle y soit parce que je pensais que cela permettrait d’esquiver de façon convaincante les conventions de l’exposition d’objets. Certains objets en deux dimensions ont été encadrés, d’autres ont été accrochés en utilisant des punaises.
Il y avait également une table avec toute une variété d’objets. Parmi ceux-ci, il y avait un bateau en Lego qu’Einar avait fait, une petite sculpture faite de briques de construction peintes, des objets en argile peints dont plusieurs bougeoirs, la maquette d’une de mes sculptures et un champignon séché qu’il avait trouvé dans les bois. Nous avons eu une discussion à propos de ce dernier que j’avais trouvé intéressant pour la façon dont il cassait le principe que nous avions suivi par ailleurs en montrant des choses que nous avions créées nous-mêmes, alors que pour Einar c’était un objet moche et répugnant qui n’avait pas de place dans une exposition d’art, en dépit du fait qu’il avait choisi le titre Nature. Là, j’ai dû insister mais il a subrepticement enlevé le champignon pendant le vernissage.
Et, enfin, il y avait un moniteur vidéo montrant des séquences filmées qu’Einar avait prises. Depuis le début, Einar considérait que c’était très important que nous ayons un vidéoprojecteur et quand nous avons échoué à nous en procurer un, j’ai dû déployer beaucoup d’efforts pour le convaincre qu’un moniteur était une alternative adéquate (il est fort probable que l’une de ses motivations principales pour réaliser ce projet était la perspective d’approcher un projecteur). La vidéo présentée consistait principalement en plans filmés autour de la maison et en vastes zooms avant et arrière.
Je reformulais continuellement des jugements esthétiques sur ce qui pouvait être approprié pour l’exposition. Par exemple, je ne voulais pas inclure toutes les œuvres en Lego d’Einar, sans quoi cela aurait ressemblé à Exposition Lego et, comme je l’ai déjà indiqué, pour nombre des images, je voulais d’autres cadres plutôt que des passe-partout (pourquoi ? probablement parce que les passe-partout étaient tabou quand j’étais en école d’art, alors que les cadres achetés aux puces étaient tout à fait ok). J’ai beaucoup réfléchi à la question de savoir quelle serait la façon la plus appropriée d’accrocher ces images. Einar était presque indifférent à cette question. Pour lui, de toute évidence, c’était le récit conjoncturel, le rituel de l’exposition, qui comptait le plus : les visiteureuses arrivant au compte-goutte, le court discours, la foule qui circule avec verre à la main en inspectant les œuvres, certains ayant des bouquets de fleurs. La publicité consistait seulement en affiches accrochées dans le voisinage et presque toutes les personnes qui vinrent étaient des gens que nous connaissions. Einar voulait envoyer beaucoup d’invitations mais je n’ai pas osé parce que je n’étais pas convaincue de pouvoir m’identifier totalement au projet.
J’ai insisté pour qu’il y ait un catalogue. Einar avait un peu l’expérience des catalogues et les considérait comme étant non-essentiels dans une exposition. Pour moi, pourtant, le catalogue était le médium par lequel je pouvais clarifier ce que le projet signifiait pour moi. J’ai proposé à Einar que nous écrivions un texte chacun·e. Mais c’est là que notre collaboration a achoppé et la différence entre les façons dont nous pourrions contribuer devint manifeste. Si Einar avait eu à écrire un texte, ç’aurait été quelque chose du genre
Un tel texte aurait sans aucun doute été adapté au cadre de mon propre récit conjoncturel, alors que cela n’aurait pas été le cas avec l’autre, parce que tout « texte curatorial » de ma part aurait porté sur ma méta-approche du projet. En fait, j’ai rédigé un texte, dont voici un extrait :
Je me suis également demandée si je devais écrire ce texte de catalogue et ai finalement suggéré que nous écrivions chacun·e un texte. Mon propre texte renforce ma propre exposition mais diminue partiellement celle d’Einar, alors que le sien, avec optimisme, va simplement donner plus de crédit à mon exposition. En même temps, je n’ai pas voulu éviter à ma propre voix d’être entendue, pour partie parce qu’un silence de ma part aurait donné l’impression que lui et moi n’avions pas la même passion pour ce projet ou que ce serait une exposition illusoire faite pour lui, et pour partie parce qu’il me semble que l’exposition ne fonctionnerait artistiquement pas sans cette dimension supplémentaire que j’essaie de lui donner au moyen de ce texte. Dans les deux cas, la chose que je trouve la plus intéressante, c’est qu’une exposition en contienne deux.
Quelques soient les problèmes liés à cette exposition, ils sont dus à l’asymétrie de pouvoir qui est toujours présente entre un enfant et un parent. De mon point de vue, il m’a semblé que je prenais en compte à la fois les intentions d’Einar et les miennes, alors qu’il n’était conscient que des siennes. Mais ce n’est peut-être pas totalement vrai ; dans quelle mesure ai-je vraiment saisi quelles sont les intentions d’Einar, par exemple ? Quelles images mentales a-t-il forgées, que je ne peux pas même imaginer ? Et peut-être qu’en fait Einar comprend mes intentions d’une façon ou d’une autre — le fait que je travaille à un autre niveau qu’il ne le fait, ce qui lui semble parfaitement acceptable.
Finalement, j’en suis venue à considérer que ce texte menaçait de subvertir le projet tout entier. Il me fut impossible de l’imprimer et je ne l’ai remplacé par rien d’autre. À la place, nous avons décidé de présenter un Livret sur les ordinateurs pour lequel Einar avait photographié le clavier et l’écran de mon ordinateur de différentes façons.
Le résultat (?)
Afin de mieux comprendre ce qui s’est passé dans notre travail sur Nature/Exposition, il peut être utile de regarder quelques discussions sur l’art de la participation qui a émergé à peu près au cours de la dernière décennie. Il est vrai que Nature/Exposition ne cherche pas l’implication de celleux qui sont venus la voir, ce qui est l’un des principaux aspects de cette forme de pratique artistique. C’est presque l’opposé : l’objectif était une exposition conventionnelle, si ce n’est hyper-conventionnelle, organisée sur la base d’une collaboration spécifique entre deux personnes. Même s’il en est ainsi, certaines des questions-clés concernant l’art de la participation sont pertinentes pour le projet, en particulier celles ayant à voir avec le pouvoir et la propriété. Une des forces qui ont vraiment guidé le développement de telles pratiques a été l’attrait des aspects démocratiques d’ententes collaboratives qui délèguent la prise de décision aux autres. Comme l’historienne de l’art britannique Claire Bishop l’écrit dans l’introduction à son anthologie Participation :
Le geste consistant à céder tout ou une partie de tout contrôle de l’auteurice est conventionnellement considéré comme étant plus égalitaire et plus démocratique que la création d’une œuvre par un artiste seul, alors qu’une production partagée est également considérée comme entraînant les bénéfices artistiques d’un plus grand risque et d’une plus grande imprédictibilité. La créativité collaborative est par conséquent comprise comme émergeant de, et produisant un modèle social plus positif et non-hiérarchiqueClaire Bishop, « Viewers as Producers », Claire Bishop (éd.) Participation, Londres/Cambridge, MA, Whitechapel Gallery/MIT Press, 2006, p. 11. [N.D.T. : Notre traduction].
Ces dernières années, une critique minutieuse des pratiques artistiques participatives a été formulée par Bishop dans son ouvrage Artificial HellsClaire Bishop, Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship, Londres, Verso Books, 2012. et par l’architecte allemand Markus Miessen dans sa trilogie Participation[N.D.T.] Une ultime publication, parue après la première édition de ce texte, a transformé la trilogie en une tétralogie. Elle est constituée des ouvrages suivants : Markus Miessen, Crossbenching. Toward Participation as Critical Spatial Practice, Berlin, Sternberg Press, 2016 ; Nina Valerie Kolowratnik et Markus Miessen (éd.), Waking Up From The Nightmare of Participation, Amsterdam, Expodium, 2011 ; Markus Miessen, The Nightmare of Participation. Crossbench Praxis as a Mode of Criticality, Berlin, Sternberg Press, 2011 ; Markus Miessen, The Violence of Participation, Berlin, Sternberg, 2007.. Ces publications explorent les façons dont l’art de la participation peut atténuer des conflits en prenant en charge des responsabilités sociales qui devraient être strictement celles de communautés ou de l’État, sa capacité à ignorer et modérer l’importance de considérations esthétiques ou même à promouvoir des esthétiques consensuelles et les façons dont il fonctionne indirectement comme la rhétorique créative du néolibéralisme. Une part relativement faible de ces analyses critiques a étudié les différents degrés de participation dans des processus de ce type ; les termes dans lesquels les personnes participent et la quantité d’influence que les participant·es ont sur les projets concernés sont des facteurs qui semblent devenir une variable superfétatoire au milieu des matériaux qu’utilise l’artiste. En d’autres mots, la question se pose de savoir si ce que l’on appelle une égalité véritable est réellement possible.
Dans une conversation entre l’artiste canadienne Patricia Reed et l’artiste anglais David Goldenberg intitulée « What is a Participatory Practice ? », Reed dit :
Proposer ou initier quelque chose est très largement différent du fait d’être auteurice [to author] de quelque chose. C’est la première étape d’un processus — à n’en pas douter une étape importante, mais sur une route potentiellement longue. C’est le lancement d’une idée — et l’ « accueil » [hosting] d’une idée au cours d’un processus. La capacité d’un « non-accueil » [un-hosting] — pour autant qu’un·e hôte conventionnel·le assume une autorité [autority] contextuelle — est tout aussi cruciale à cette idée d’ « accueil ». Ce que j’entends par un « non-accueil », ce n’est pas renoncer totalement à son autorité face à une dynamique de groupe, mais considérer le processus comme étant partagé — c’est-à-dire à la fois être et ne pas être un·e hôte. Tout au long du processus consistant à « accueillir de manière non directive », un certain degré de contrôle (pas tout) est dispersé et c’est précisément cette dispersion du « contrôle » qui trouble les conceptions conventionnelles de l’autorité de l’auteurice [authorship]David Goldenberg, Patricia Reed, « What is Participatory Practice ? », Fillip, 8, automne 2008. [N.D.T.] : Notre traduction].
Cette idée d’un « non-accueil », une sorte de condition intermédiaire ou de fluctuation entre directivité et non-directivité, nous emmène directement à Paolo Freire et à ses idées sur lea professeur·e-élève et sur l’élève-professeur·e. Dans un passage de Pédagogie des opprimés, il écrit :
Par le dialogue, le professeur-de-l’élève et l’élève-du-professeur cessent d’exister et un nouveau terme émerge : professeur-élève et élève-professeur. Désormais, le professeur n’est plus celui-qui-éduque, mais celui qui apprend du dialogue avec l’étudiant, qui à son tour apprend en même temps qu’il enseigne. Tous deux deviennent les responsables d’un processus dans lequel chacun granditPaolo Freire, op. cit..
Comment ai-je donc performé mon rôle comme non-accueillante ou professeur·e-élève dans Nature/Exposition ? La réponse est : mal. Qui plus est, je pense que la plupart des gens jouent mal ce rôle — c’est-à-dire qu’ils ne lui font pas honneur. Il me semble que dans beaucoup trop de cas la tentative d’aller au-delà du rôle traditionnel de chef·fe/professeur·e revient à le remplacer par une structure de pouvoir plus sophistiquée dans laquelle l’artiste/professeur·e finit par s’attribuer à la fois le mérite du projet et ses vertus démocratiques. Dans notre travail pour Nature/Exposition, j’ai fait accepter la plupart de mes idées, alors qu’Einar n’aurait jamais pu rejeter les miennes quand j’étais contre les siennes. Chaque idée devait emporter mon « approbation » et j’en suis venue à la suspicion tenace que mon travail de facilitatrice et motivatrice s’était réduit à être à peine plus qu’une façon encore plus sournoise d’exercer le pouvoir — la manipulation intangible plutôt que l’utilisation d’un veto normal. L’ironie, c’est que quand on applique ce modèle on s’en remet fréquemment au principe de l’explication (ou de l’abrutissement, comme l’appelle Rancière) ; on doit expliquer aux gens pourquoi leurs idées ne marcheront pas. J’ai dû expliquer à Einar pourquoi le champignon devait être inclus ou pourquoi c’était mieux avec peu de constructions en Lego. C’est ce qu’il y a eu tendance à se passer chaque fois que je me suis essayée à un non-accueil. Et cela me rend suspicieuse sur les pratiques participatives, particulièrement celles qui impliquent un public « profane » ou qui sont adressées à des groupes désavantagés d’une façon ou d’une autre ; trop souvent, il semble que les participant·es, comme iels sont appelé·es dans la documentation par les artistes de leurs projets, sont invité·es à participer en raison de leur appartenance à une catégorie symbolique ou autre.
En conséquence de quoi, au terme du projet, j’en ai conclu que l’égalité que j’avais visée pour Nature/Exposition était plutôt cosmétique. De mon point de vue, ce qui était supposé être une collaboration portant sur une sélection éclectique d’objets s’est avéré être la démonstration soigneusement gérée d’une prétendue transparence. D’un autre point de vue, interpréter le processus d’un point de vue exactement contraire ne requiert pas une énorme contorsion mentale : après tout, qui est-ce qui avait proposé le projet au départ ? Ici, nous devrions tout autant citer une théorie du management reconnue en lieu et place de la théorie de l’art de la participation. Par exemple, dans son ouvrage Les 21 lois irréfutables du leadership, le prêcheur américain John C. Maxwell indique :
La vraie mesure du leadership, c’est l’influence, rien de plus, rien de moins. Le leadership n’est efficace que si vous avez la capacité de persuader les autres de vous suivre et/ou bien de prendre en charge vos idéesJohn C. Maxwell, Les 21 lois irréfutables du leadership, Varennes, Québec, Groupe International d’Édition et de Diffusion, 2002..
Einar a fait preuve d’un exemple probablement inconscient, mais néanmoins brillant, de leadership démocratique en me laissant mettre en œuvre sa vision avec tant d’enthousiasme et d’énergie. Il n’y a eu que peu de situations dans lesquelles il a dû s’impliquer, par exemple en enlevant le champignon et en choisissant le format du catalogue. Pour toutes les autres situations, son non-accueil était exemplaire. Il m’a confié un grand nombre de décisions en m’induisant la ferme conviction que j’avais virtuellement pris en charge le projet.
En d’autres mots, toutes les situations de collaboration, y compris celles entre enfants et adultes, valent comme autant de jeux complexes de pouvoir. Personne ne devrait jamais douter que les adultes ont plus de pouvoir sur les enfants que l’inverse. Mais cela ne signifie pas que les enfants n’ont aucun pouvoir ou qu’iels ne l’utilisent pas, ce qu’iels font, souvent sans qu’elleux-mêmes ni celleux qu’iels manipulent ne s’en rendent compte. Loin d’être un projet « sans pouvoir », Nature/Exposition regorgeait de pouvoir qui se manifestait par lui-même toujours sous de nouvelles formes et dans des directions différentes. Comme Michel Foucault le constate :
Omniprésence du pouvoir : non point parce qu’il aurait le privilège de tout regrouper sous son invincible unité, mais parce qu’il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d’un point à un autre. Le pouvoir est partout ; ce n’est pas qu’il englobe tout, c’est qu’il vient de partout. Et « le » pouvoir dans ce qu’il a de permanent, de répétitif, d’inerte, d’autoreproducteur, n’est que l’effet d’ensemble, qui se dessine à partir de toutes ces mobilités, l’enchaînement qui prend appui sur chacune d’elles et cherche en retour à les fixer. Il faut sans doute être nominaliste : le pouvoir, ce n’est pas une institution, et ce n’est pas une structure, ce n’est pas une certaine puissance dont certains seraient dotés : c’est le nom qu’on prête à une situation stratégique complexe dans une société donnéeMichel Foucault, Histoire de la sexualité I, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 2006, p. 122-123..
Ainsi il ne reste plus qu’à demander : n’y a-t-il aucun aspect du projet dans lequel mon rêve d’ « égalité véritable » fut vraiment atteint ? N’y avait-il pas une espèce de point parfait, à l’instar de l’œil d’un cyclone ? En fait, je voudrais suggérer que l’égalité était apparente dans l’exposition elle-même, dans son langage esthétique (i.e., dans la juxtaposition des objets et dans leur arrangement dans l’espace). Et c’est cela qui fait de Nature/Exposition une contribution pertinente au débat portant sur l’art politique. Bien évidemment, je n’affirme pas que l’exposition avait la moindre des qualités remarquables conformes au « bon art ». De même, elle ne donnait pas l’impression d’avoir été créée par deux individus situés à égalité. Mais les objets étaient perçus comme étant égaux en statut du fait de la façon dont ils étaient placés ou accrochés côte à côte. Cela peut sembler très littéral, et ça l’est en fait ; beaucoup des choses étaient placées côte à côte dans une pièce d’une manière vraiment basique. Leurs interactions n’étaient pas claires et laissées à l’appréciation de lae spectateurice. De mon point de vue, c’était le plus proche que nous puissions être d’une situation d’égalité et j’affirmerai que c’était suffisamment évident pour que nos visiteureuses le perçoivent. C’était comme si, d’une façon ou d’une autre, les choses allaient bien ensemble ; elles étaient adaptées les unes aux autres et se renforçaient mutuellement, créant ainsi à un niveau micro le sentiment que tout était possible. Mais comment cela était-il possible ?
Il y a eu nombre de négociations durant Nature/Exposition. Par exemple, il y a eu la négociation entre les conceptions d’Einar sur une exposition et les miennes, ou la négociation entre les objectifs que je donnais au projet et ceux d’Einar. Nous avons cherché à conduire ces négociations en termes de collaboration, pourtant elles ont semblé ne jamais avoir été entièrement véritables, peut-être pour la bonne raison que notre relation était inégalitaire. Il en résulta qu’elles furent réduites à différents degrés de manipulation ; les participant·es contribuèrent sans que la moindre rencontre d’esprits n’ait jamais lieu. Mais alors il y eut un certain nombre de contradictions que nous n’avons pas négociées, par exemple la rencontre entre les objets d’Einar et les miens, ou bien celle entre une maison et une galerie. Et ces rencontres eurent lieu dans un espace ouvert, ambigu, sans aucune tentative d’explication, de négociation ou de réconciliation. Par conséquent, ce fut comme si nos tentatives de collaboration avaient implosé, alors même que les points de contact silencieux entre les objets eux-mêmes avaient été capables de communiquer la rencontre égalitaire qui avait été manquée dans le processus.
Cela nous reconduit à Rancière et à son essai sur « le maître ignorant », Joseph Jacotot. Sans préambule, Jacotot a donné à ses étudiant·es des exemplaires du roman didactique Télémaque en deux langues différentes, le flamand et le français, et leur a demandé d’apprendre le vocabulaire qui leur était inconnu en étudiant les deux textes en parallèle. Rancière nous dit que dans ce processus silencieux, dans la rencontre entre l’individu et le texte, et presque sans explication, négociation ou collaboration (mais aussi sans contact social), advient l’ultime moment de liberté. Le même thème surgit dans Le Spectateur émancipé dans lequel Rancière argumente que le spectateur émancipé, une personne qui regarde une performance théâtrale, est tout autant susceptible de réfléchir à son contenu que celle impliquée dans l’action. Il n’est pas plus libérateur d’agir que de penser, argumente-t-il dans cet essai, qui aurait tout autant pu porter sur l’art de la participation : être assis et discuter n’est pas plus démocratique qu’être debout et regarder. Comme d’habitude, on arrête de considérer ici l’artiste comme étant indépendant·e, à part, placé là comme un·e héros·oïne, à côté de son œuvre exposée et vulnérable. Il tire à pile ou face son interprétation du monde, laissant ensuite les autres la comprendre et l’expérimenter librement et selon leurs propres termes. Il a confiance dans la capacité des gens à penser par elleux-mêmes, quand bien même c’est fait dans la solitude, dans l’espace ouvert et désintéressé où l’on a le temps de reconnaître et d’apprécier sa propre indépendance. On peut seulement noter que le white cube est l’antithèse de la vie en famille. Au sein de la famille, il est rare de se retrouver sur un pied d’égalité. Non pas que cela n’arrive jamais. Mais quand cela arrive, c’est de façon inattendue et soudaine, de façon presque désarmante, quand des personnes partagent un éclat de rire ou pendant ces rares moments de travail en commun sur une tâche à laquelle tout le monde contribue et que tout le monde considère comme étant pleine de sens. Mais en tant que règle, ces moments de partage sont quelque chose à quoi nous aspirons alors même que nous nous maintenons à la zone frontalière entre le vrai et le faux, entre différentes pratiques du pouvoir, ou alors que nous jouons d’incessantes négociations, déceptions et flashs de sincérité, nous bagarrant en permanence pour suivre l’amour désespéré qui guide nos actions fortement imparfaites.
Pour le droit de vote des mineur·es —
Pourquoi 15 millions de personnes en France n’ont-elles pas le droit de voter ? Les personnes les plus jeunes ne sont-elles pas les plus concernées par les décisions prises aujourd’hui ? Plus généralement : pourquoi les personnes mineures sont-elles privées d’exercer leurs droits ?
Oui, je suis pour le droit de vote des personnes mineures. Et pourquoi pas ? Si je pose la question au débotté, la première réaction c’est la surprise. Hein ? Ha ? Heu… Je n’y avais jamais pensé ! Étonnant comme il peut sembler naturel que plus de quinze millions de personnes en France côtoyées quotidiennement soient dépourvues de ce droit d’élire et d’être élu·e, de peser d’une voix dans les décisions les concernant.
Attendez un peu que cette revendication soit portée par les personnes mineures iels-mêmes et/ou prenne de l’ampleur. On passerait de réactions de surprise, ou d’amusement teinté de paternalisme, à une levée de boucliers. Mais enfin, vous n’êtes pas sérieuses ? Que peuvent piger des enfants à des enjeux de grande politica ? Ces petites créatures ignorantes, intenables et adorables à protéger ou à dompter« La famille est-elle une institution protectrice ? […] L’enfant est tantôt cet être innocent et fragile dont la sécurité serait sans cesse menacée par un monde extérieur agressif et malsain, tantôt un agent perturbateur, proche de l’animal turbulent […]. » Tal Piterbraut-Merx, « Oreilles cousues et mémoires mutines. L’inceste et les rapports de pouvoir adulte-enfant », in La Culture de l’inceste, Paris, Seuil, 2022, p. 71. : on ne va quand même pas les laisser nous foutre le bordel, nous qui étions bien vissé·es sur notre siège.
1/ Ces discours : iels sont bêtes, iels sont des animaux, iels sont naturellement incapables/faibles, on doit les protéger de tout ce qu’énoncé précédemment ou les punir pour qu’iels intègrent quelle est leur place, etc. C’est du déjà vu et revu pour constituer un groupe social à dominer et le priver de droits. Exemples : contre les personnes noires américaines qui obtiennent finalement le droit de vote le 4 août 1965 aux États-Unis ; contre les personnes femmes qui obtiennent finalement le droit de vote en France le 21 avril 1944 dans le cadre du Comité français de libération nationale qui devient à Alger le gouvernement provisoire de la République française. (Pour un gouvernement en quête de reconnaissance, sous la menace d’une administration américaine provisoire, et aspirant à conserver une politique coloniale, était-il plus opportun par ailleurs de céder à ce moment aux femmes blanches sur le droit de vote ?). Un siècle donc après l’instauration du suffrage « universel » masculin en 1848. Universel, comprenez : homme blanc de plus de 21 ans.
Quand je tape sur Google « droit de vote femmes France », il est intéressant que Google m’explique pourquoi elles l’ont obtenu (c’est dans le menu déroulant, je n’ai rien demandé) : « C’est pendant l’occupation que les mentalités ont changé, dans la Résistance que les femmes ont gagné le droit de voter et d’être élues. » Je n’ai pas le temps de relever tout ce qui est problématique dans cette phrase. Je reviens néanmoins là-dessus parce qu’il se trouve que les remarquables mineur·es, innocentes créatures imprévisibles et naïvement coconnes, ont été des acteurices de premier plan dans la Résistance. Daniel Cordier, l’ex-secrétaire de Jean Moulin, affirmait en 2004 : « L’armée des ombres est une armée d’enfants. » Roger Faligot parle de ces mineur·es résistant·es oublié·es dans son livre La Rose et l’edelweiss. Ainsi, le premier groupe résistant qui commettra les premiers attentats d’envergure contre les nazis en France, la Main noire, est constitué d’adolescent·es alsacien·nes complètement autonomes. Ou encore, les piccoli partigiani, pour la moitié âgé·es de moins de 18 ans, sont celleux qui reconquirent l’Italie. Ou encore, les Pirates de l’edelweiss, un mouvement fort de plusieurs dizaines de milliers de garçons et de filles âgé·es de 12 à 20 ans qui se sont relayé·es pendant une douzaine d’années pour tenir tête à Adolf Hitler. Du début à la fin du nazisme.
4/ Iels n’auraient pas les capacités pour voter ? Mais où est le test que les citoyen·nes consacré·es passent pour avoir le permis de voter ? Ce dernier devient-il caduc à un certain âge ? Aurais-je raté un épisode ? J’aimerais bien voir le barème juste pour rire. Du coup, quel est-il (bon courage pour sortir de ce bourbier) ? Qu’est-ce qu’il faudrait pouvoir comprendre pour avoir le droit de vote ? Un M2 en économie gestion ? Ça laisserait la majorité de la population votante sur le carreau. D’ailleurs, c’est un peu le but, n’est-ce pas, ce jargon ?
Au fond, désolé, mais les lignes qui guident les décisions des élu·es ne sont-elles pas très très simples à comprendre ? J’ai eu le privilège de faire beaucoup d’études, et en sciences politiques (en accord avec la sélection sociale programmée : je suis blanc, valide et enfant de profs), et il m’apparaît pourtant que mes choix en la matière sont toujours éclairés par des directions assez évidentes : pas le programme des étrangers et des personnes racisées dehors — pas le programme de tout pour ma gueule et ma merde ruissellera sur vous — plutôt le programme de peut-être on pourrait ramener de l’égalité, partager les richesses et prendre en compte les enjeux écologiques. Du coup à partir de quel âge on peut comprendre ça ? À 18 ans seulement, vraiment ? Selon une étude scientifique publiée le 8 décembre 2021 dans The Lancet Planetary Health, soixante-quinze pour cent des adolescent·es qualifient l’avenir « d’effrayant » du fait du changement climatique. Alors les enfants sont miné·es par l’éco-anxiété mais ne seraient pas capables de voter pour un programme écolo ?
5/ Enfin, et au vu de l’état du monde, il est assez manifeste que les personnes qui décident aujourd’hui ne sont pas les bonnes. Que les personnes qui décident aujourd’hui ne seront pas celles qui devront assumer le poids de leurs décisions demain. N’est-ce pas précisément aujourd’hui et maintenant qu’il faut ramener le poids politique d’électeurices plus jeunes ? C’est évident pour moi que je veux remplacer Macron par des petites pelures de clémentine« Remplacer Macron par des petites pelures de clémentine » est l’une des affiches du Grand Soulagement : un programme de relaxation politique à objectif tendrement insurrectionnel lancé par Quentin Faucompré et Cyril Pedrosa. mais aussi par Vanessa Nakate et Greta Thunberg.
Quels sont les dispositifs à mettre en place pour l’accès à l’information et aux débats pour les personnes mineures ? Pour la formation à la prise de décision collective ? Ne peut-on pas dire à l’instar du mouvement zapatiste : prend part également à la décision toute personne qui ne s’endort pas pendant les débats ?
Si je prends l’exemple du droit de vote, c’est que j’y crois mais c’est aussi qu’il est parlant et concret. Si je prends cet exemple, c’est parce que c’est celui qui rencontrerait encore le moins d’opposition mais aussi celui qui pose les enjeux qui se retrouvent de manière transversale dans la question de la domination des personnes mineures par les adultes. Le droit de vote pourrait commencer à redonner un peu de pouvoir aux personnes mineures : on est obligé de considérer un électorat même si c’est d’une manière intéressée.
Cette domination des personnes mineures en France a une histoire qui remonte au moins aux calendes romaines où le patriarche est propriétaire des femmes et des enfants. Ce sont des biens meubles dont il peut disposer, qu’il peut céder, acquérir, utiliser, exploiter.
Les personnes femmes n’ont acquis qu’en 1907 le droit de disposer de leur salaire dans le cadre du foyer et en 1965 le droit d’avoir un emploi et un compte en banque sans autorisation de la part du mari.
Les personnes mineures n’ont rien. Iels sont complètement dépendant·es émotionnellement, affectivement, intellectuellement et matériellement des adultes de la famille. Iels n’ont pas de personnalité juridique, de ressources propres, de droit de vote, la possibilité de choisir où habiter et quoi apprendre. Iels sont souvent abusé·es au sein de cette même famille dépeinte comme le lieu de l’amour et même devant la qualification des abus les droits de visite ne sont pas retirés, les mineur·es ne sont pas extrait·es.
Ajoutons que les personnes mineures ne sont pas entendues dans leur volonté de vivre avec tel ou tel parent après un divorce (juridiquement iels devraient à partir de treize ans mais c’est rarement le casYves Bonnardel, La Domination des adultes : l’oppression des mineurs, Breux-Jouy, Le Hêtre Myriadis, 2015.). Ce qu’on octroie aux mineur·es c’est le droit d’être protégé·es par celleux qui précisément sont en pouvoir de les abuser ! La sacrosainte autorité parentale n’est que très rarement remise en question (sauf concernant les familles précaires et racisées dont on remet en question la « bonne » parentalité).
1/ La constitution de cette catégorie d’ « enfants » et de classes d’âge. Tout au long du xixe siècle, « la psychologie du développement a proposé une formalisation plus fine de ce schéma de développement à partir de la délimitation de stades séquentiels, qui définiraient l’acquisition de capacités rationnelles et/ou morales. On peut qualifier cette représentation du développement de l’enfant de téléologique, en ce que le point d’arrivée est l’adulte, érigé en modèle achevé » (Tal Piterbraut-MerxT. Piterbraut-Merx, op. cit., p. 73.]). Au xiie siècle par exemple les enfants étaient beaucoup plus mêlé·es aux adultes, il n’y avait pas de classes d’âge définies avec autant de précision. Par exemple, l’université était ouverte tous âges confondus. C’est à la Renaissance qu’apparaissent deux classes d’âge à l’université : de 0 à 17 ans et plus de 17 ans, comme l’écrit Yves Bonnardel5.
Progressivement, ces catégories d’enfance, puis d’adolescence6 sont soutenues par des discours scientifiques biologisant, afin de naturaliser leur existence, et accolées à des valeurs morales pour justifier la mise sous tutelle et l’exploitation des mineur·es.
Ainsi, Tal Piterbraut-Merx parle du mythe de la famille chaleureuse et bienveillante7 et du mythe de l’innocence de l’enfant, pour les enfants blancs du moins8. À partir de là, pourquoi les enfants auraient-iels besoin de droits puisque la famille est amour et que leur innocence ne peut appeler que la protection par un tiers ?
Le pourquoi de cette domination relève de la possibilité d’exploiter affectivement, émotionnellement, physiquement, sexuellement et matériellement les mineur·es. Affectivement et émotionnellement, ce sont pour beaucoup des doudous à qui l’on donne des ordres et qui procurent une sécurité émotionnelle absolue vu que, quoi qu’on leur fasse, iels ne peuvent aller nulle part (on pourrait se pencher cependant sur les quelque soixante-dix mille fugues par an9). Ce sont aussi souvent des punching balls à rage. Sexuellement, l’inceste et la pédocriminalité sont structurels : une personne mineure sur dix en est victime10. C’est également l’endroit où on est « formé·e » aux dominations. Comme l’explique Dorothée Dussy dans son livre Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’incesteDorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, Paris, Pocket, 2021._._
Pour ce qui est de l’exploitation matérielle : les travaux affectifs, émotionnels et domestiques ne sont évidemment pas rémunérés. On pourrait tout à fait penser la charge mentale des enfants, car bien souvent iels ne se consacrent pas à leur enfance, mais à régler des conflits ou faire du care à leurs parents ou à maintenir les apparences quand tout s’écroule. C’est assez fou que l’on disqualifie les enfants quand on voit ce qu’iels peuvent porter. Plus communément en tout cas, on peut parler d’exploitation matérielle car quand les enfants travaillent, iels le font pour des rémunérations au rabais et dans la clandestinité. Les organisations d’enfants et de jeunes travailleurs à travers le monde ne demandent pas de ne plus travailler, car cela peut être également vecteur de valorisation et d’émancipation, mais de pouvoir choisir de travailler ou non et d’avoir des droits au travail et des rémunérations décentesY. Bonnardel, op. cit..
En 1996, les organisations des enfants et jeunes travailleurs nicaraguayennes et allemandes se déclarent contre la Convention internationale des droits de l’enfant et pour le droit de vote, la participation aux décisions politiques, pouvoir décider librement de travailler, la redistribution d’un revenu mensuel pour les mineur·es, le droit de décider de rester ou non dans sa famille en cas de maltraitance.
En France et en Occident, on a déclaré que les enfants n’étaient pas en train de travailler quand iels allaient à l’école… Ça se discute. Ce qui est sûr, c’est qu’iels ne sont pas payé·es. C’est quand même pas mal d’heures passées le cul sur une chaise sans avoir le droit de se lever et pisser alors qu’on n’en a pas envie. L’allongement de l’école ne s’est d’ailleurs pas fait sans heurts comme l’explique Yves Bonnardel : en 1911, par exemple, des dizaines de milliers de jeunes Anglais·es, Écossais·es et Irlandais·es se révoltent avec des grèves dans soixante-deux villes. Iels revendiquent une limite d’âge fixée à quatorze ans pour l’école, des sous, stop aux coups et des congés. En France à la même époque, un tiers des élèves fait l’école buissonnière.
Si je dois appeler quelque chose de mes vœux, au-delà de cette question importante du droit de vote, c’est la constitution d’organisations de personnes mineures autonomes et puissantes qui permettent de réfléchir la naturalisation de ce groupe social, sa mise en dépendance, la privation de droits actuelle qu’elles subissent et leur conquête.
Je n’invente aucun concept, les faits étayés sont le fruit des travaux cités, je rends particulièrement hommage au travail de Tal Piterbraut-Merx dont la thèse qui était en cours sera, je l’espère, bientôt publiée et disponible.
Des Enfants s’en Mêlent —
Des Enfants s’en Mêlent est le journal scolaire que les élèves de l’école des Charmes ont publié entre 1989 et 2001. Au cœur de la Villeneuve de Grenoble, cet établissement faisait partie d’un groupement d’« écoles ouvertes » inauguré dans les années 1970 et au sein desquelles les enseignant·es pensaient que pour lutter contre l’échec scolaire tout le système éducatif devait être repensé. Ce journal, comme la création d’une radio, les classes vertes autogérées, les conseils d’enfants et d’autres activités participaient à cette transformation. Sous-titré « d’opinion », il permettait aux enfants d’avoir accès à une parole publique et d’être impliqué·es dans la vie sociale de leur quartier. Tiré à 400 exemplaires toutes les six semaines, il était vendu à la criée lors des marchés, déposé chez les commerçant·es et bien sûr lu par ses abonné·es. (Marie Preston)
Un journal d’opinion —
Les pédagogies des écoles de la Villeneuve, de Vitruve et de Jacques-Prévert sont mises en œuvre grâce à des « activités de production ». Il s’agit, comme l’écrit Évelyne Le Garrec dans l’article « Vitruve et ses enfants “ producteurs », « d’apprendre pour faire, en faisantÉvelyne Le Garrec, « Vitruve et ses enfants “ producteurs », Autrement, n° 10, « Dans la ville, des enfants… », septembre 1977, p. 152. ». Non sans provocation, elle ajoute que « les enfants, désormais, sont d’abord des producteurs. Chemin faisant, au hasard de leurs activités, ils apprendront peut-être à lire, à écrire et à calculerIbid., p. 153-154. ». À Vitruve, les projets menés sont de deux ordres, soit « de production : faire des gâteaux, faire des habits, faire de la poterie… », soit « de service : repeindre des objets, réparer les bancs et les chaises, faire un restaurant…Ibid., p. 156. ». Selon Jean Foucambert et au regard de cette pédagogie « de projet », il est nécessaire d’élargir la notion de travail productif car elle s’apparente encore trop aux chaînes de l’industrie. Le travail productif de la pédagogie de projet serait alors synonyme d’une « activité en grandeur réelle conduite à l’intérieur du corps social par un groupe dont la production est attendue en tant que répondant à un besoin et non comme une occasion d’apprendreJean Foucambert, « Jalons pour une pédagogie différente », in En sortant de l’école… — des enfants et des adultes racontent : un projet réalisé par des enfants de la rue Vitruve, Paris, Casterman, coll. « E3 », 1978, p. 25. ». C’est le cas par exemple des braderies de l’école Vitruve, qui mobilisent toutes sortes d’apprentissages (calcul, écriture, arts visuels, etc.) et qui ont corrélativement pour objectif de gagner l’argent qui permettra le départ en classes vertes.
Célestin Freinet préférait lui aussi le travail au jeu, qui prédomine chez sa contemporaine Maria Montessori. Il écrit : « Le bébé qui traîne son camion, qui patauge dans l’eau, qui explore une grotte, qui escalade un mur, travaille, puisqu’il poursuit, de la meilleure façon, l’adaptation de ses réactions aux nécessités ambiantes dans le but d’accroître son potentiel de puissanceCélestin Freinet, « Essai de psychologie sensible », in Œuvres pédagogiques, Paris, Seuil, 1994, p. 459.. » Pour Freinet, le travail est mené par le jeune enfant sans obligation productive. Cette perspective se distingue d’autres rapports à la production enfantine, notamment celle des écoles libertaires et en particulier celles de Paul Robin à Cempuis« Comme beaucoup d’autres, Robin […] considère que le problème de la gratuité est un faux problème, l’école étant en réalité payée par les contribuables. Et la réponse qu’il apporte à cette question est l’organisation de l’école-atelier sur une base économique qui assure à la fois l’autosubsistance de l’école et son indépendance. » Nathalie Bremand, Cempuis une expérience d’éducation libertaire à l’époque de Jules Ferry, 1880-1894, coll. « Bibliothèque anarchiste », Paris, Éditions du Monde libertaire, p. 54. ou de Sébastien Faure à La Ruche. Pour ce dernier en particulier, il s’agissait de rendre l’école autonome économiquement afin de ne pas dépendre de l’État. L’échelle économique émanant de la production était alors bien plus importante que celle qui alimentait chez Freinet la coopérative scolaire.
Contrairement au travail tel que défini par Freinet, les activités des enfants de Vitruve présentent, comme dans les écoles libertaires, des obligations de production. Le projet est effectif, utile, pris dans leur vie sociale, leur famille, leur quartier. Il est donc aussi social car il y trouve « à la fois son origine, son application et ses conditions de réalisation en même temps que l’ensemble des conflits internes et externes qu’il faut maîtriser pour agirJean Foucambert, « Jalons pour une pédagogie différente », in En sortant de l’école…, op. cit., p. 30. ». Les effets sont escomptés dans le réel et non dans un hypothétique avenir. À la Villeneuve, Vitruve ou Jacques-Prévert, on ne fait pas « semblant », on « [n’]émarge [pas] à la rubrique des investissements sociauxIbid., p. 27. ». La liste des projets réalisés dans ces écoles est longue car elle ne se résume pas à des « ateliers de production » substitués aux classes, comme c’était le cas notamment à La Ruche. Tout semble pouvoir faire office de « projet » si tant est qu’il soit investi sérieusement, à plein temps et qu’il engage le désir d’un groupe d’enfants. C’est le cas du journal scolaire que je prendrai comme exemple, car il est à la fois un projet « de production » et « de service » et que pour le réaliser, il faut des enfants « producteurs d’écritsChristian Bizieau (coord.), dossier « Rendre le journal scolaire aux enfants », in Le Nouvel Éducateur, n° 66, février 1995, p. 1. Si, traditionnellement, le journal est imprimé, dans les années 1970-1980, il peut être aussi en format vidéo. L’école JacquesPrévert en réalisera, les écoles de la Villeneuve et celle de Vitruve aussi. Néanmoins, je me pencherai ici sur l’imprimé. ».
L’imprimerie à l’école a été systématisée par Freinet en tant que technique pédagogique. Il la définit comme « un recueil de textes libres réalisés et imprimés au jour le jour selon la technique Freinet et groupés en fin de mois sous couverture spéciale à l’intention des abonnés et des correspondantsCélestin Freinet, Le Journal scolaire, Montmorillon, Éditions Rossignol, 1957, p. 15. ». Dès 1926, il déclare : « L’organisation des échanges d’imprimés entre écoles doit être notre première préoccupationÉlise Freinet, « Première lettre circulaire — le 27 juillet 1926 », dans Naissance d’une pédagogie populaire. Historique de l’école moderne (pédagogie Freinet), coll. « Textes à l’appui, pédagogie », Paris, F. Maspero, 1971 [1965], p. 53.. » La première revue d’enfants qu’il créa fut La Gerbe en 1927 (sous-titrée Revue d’enfants), suivie par Les Enfantines qui se rapproche plus des futurs albums enfantins. Ceci étant, bien qu’il l’ait développée, organisée et très largement diffusée, le journal scolaire n’est pas une invention de Freinet. Il mentionne lui-même la pratique d’Ovide Decroly, pédagogue et médecin belge dont l’école, L’Ermitage, publiait dès 1910 L’Écho de l’écoleChristian Poslaniec, « D’où vient le journal scolaire ? », Le Nouvel Éducateur, n° 212, p. 2., avec cette différence essentielle que, s’il était écrit par les enfants, il était imprimé avec l’aide des parents. Selon l’écrivain spécialiste de la littérature jeunesse Christian Poslaniec, d’autres pratiques encore antérieures sont aussi à prendre en compte. Dewey, dont Decroly avait été traducteur, mentionne notamment dans son livre Les Écoles de demain l’utilisation de l’imprimerie par certains établissements américains. Il donne l’exemple d’écoles publiques à Indianapolis et ajoute : « Un peu partout, des écoles ont adopté avec grand succès l’imprimerie à l’école. Le matériel n’a pas pour but d’apprendre aux élèves les diverses opérations du métier d’imprimeur, on cherche seulement à leur faire exécuter quelques-uns des imprimés dont ils ont sans cesse besoinJohn Dewey, Evelyn Dewey, Les Écoles de demain, trad. René Duthil, Paris, Flammarion, 1931 [1915]. Le traducteur renvoie en note au travail de Freinet et l’imprimerie à l’école, p. 84.. » Notons que pour Freinet, il ne s’agit pas d’imprimer des textes « utiles » comme ceux que mentionne Dewey (listes d’appel, programmes, circulaires…) mais des textes écrits par les enfants eux-mêmes. L’ « utilité » est ailleurs. Decroly faisait écrire des textes originaux aux élèves mais ne considérait pas l’impression comme aussi importante, d’autres faisaient imprimer aux enfants des textes qu’ils recopiaient, enfin l’imprimerie était également présente avant Freinet pour initier — en plus de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture — aux gestes professionnels de l’imprimeur·se. C’est le cas à l’école de l’anarchiste Paul Robin, le premier à mettre en œuvre l’éducation intégrale, à l’orphelinat de Cempuis en région parisienneNathalie Bremand, Cempuis, op. cit., p. 119.. Il la définit comme ce « qui tend au développement progressif et bien équilibré de l’être tout entier, [et] réunit les trois facteurs habituels, à savoir : l’éducation physique, intellectuelle et morale Roland Lewin, Sébastien Faure et « La Ruche » ou l’éducation libertaire, Vauchrétien, Ivan Davy Éditeur, coll. « Cahiers de l’Institut d’histoire des pédagogies libertaires », 1989, p. 38. ». C’est en 1885 qu’il « introduit une machine à écrire à l’école et mène, au sein de l’atelier d’imprimerie, un travail poussé de lecture-écriture à l’aide de lettres de plombNathalie Bremand, Cempuis, op. cit., p. 72 ». Dans son école, beaucoup d’ateliers différents sont proposés aux enfants et chacun mène à des réalisations concrètes et utiles à la collectivitéOn peut citer l’agriculture, le jardinage, la couture, la cordonnerie, le blanchissage, la cuisine, la boulangerie, le travail du bois, des métaux, de la peinture, la lithographie, etc. Nathalie Bremand, Cempuis, op. cit.. D’autres exemples pourraient être développés, ceux de Léon Tolstoï ou de František Bakule, qui utilisa l’imprimerie et le journal scolaire dès 1898 en Tchécoslovaquie, ou encore celui de Janusz Korczak à partir de 1926 au sein des écoles libertaires de Hambourg qui avaient, elles aussi, leur journal scolaire, que Freinet connaissait.
Le journal scolaire sur lequel je me suis concentrée est donc celui de l’école des Charmes de la Villeneuve de GrenobleCette école a fonctionné de 1973 à 2006.. Cette école s’organisait autour de nombreuses activités parmi lesquelles une radio qui émettait chaque matin un bulletin d’information, les cahiers de vie, le journal de classe, les classes vertes autogérées, les conseils d’enfants et le journal de l’école, intitulé Des Enfants s’en Mêlent. Publié pendant douze ans, entre mai 1989 et mai 2001, il compte trente-neuf numéros. Sous-titré Journal d’opinion, il paraissait environ toutes les six semaines, tiré à trois ou quatre cents exemplaires grâce à des subventions de l’Éducation nationale et de la ville de Grenoble. Il comprenait quatre pages au format A4 (A3 plié en deux), en noir et blanc, qui s’organisaient autour d’un dossier sur les deux pages centrales, d’un éditorial du comité de rédaction et de « brèves » liées au quartier. Sa mise en œuvre était coordonnée par un comité de rédaction composé d’élèves, d’un·e instituteur·trice responsable et d’un journaliste habitant du quartier, Denis Requillart. Le comité, qui changeait à chaque numéro, se réunissait deux fois par semaine et centralisait les productions de toutes les classes auxquelles il passait commande en fonction du thème choisi. Le comité se réservait le droit de critiquer ce qui était apporté, voire de réécrire certains articles qui étaient ensuite amendés par les auteur·ice·s initiaux·ales. Une maquettiste, Béatrix BurletJusqu’au numéro 35., intervenait ensuite quand le travail de rédaction était fini. Chaque numéro était illustré par des photographies, des illustrations extraites d’ouvrages ou des dessins au trait, le plus souvent réalisés par la maquettiste. La nature des différents textes se distinguait par un jeu graphique consistant à créer des encarts noirs ou gris. Les rapports entre fond et forme étaient travaillés collectivement et la mise en page pouvait faire l’objet d’ajustements par le comité de rédaction. Le journal était ensuite vendu à la criée, déposé dans des dépôts-vente du quartier ou envoyé à ses abonné·es. L’importance de l’adresse du journal était essentielle car à l’origine de la motivation des élèves : « On n’écrit que pour être lu (hormis sous la contrainte)Christian Bizieau (coord.), dossier « Rendre le journal scolaire aux enfants », Le Nouvel Éducateur, op. cit.. » Comme à l’école Jacques-Prévert, le journal faisait partie des « situations fonctionnelles de production écrite, c’est-à-dire […] où l’écrit réalisé a un enjeu social et un ou des lecteurs véritables et intéressésExtrait d’un document non publié transmis par André Virengue. ». Emmanuelle Buffin, une ancienne institutrice de l’école, insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une « pédagogie baba coolLes citations qui suivent sont extraites d’un entretien mené le 21 septembre 2017, au Barathym, à la Villeneuve de Grenoble, avec Marie-Charlotte Allam, André Béranger et Emmanuelle Buffin. », qu’il était très important pour elle « de ne pas considérer que cette pédagogie libertaire était une pédagogie du laisser-aller » mais qu’il·elle·s faisaient preuve d’une grande exigence. André Béranger, lui aussi ancien instituteur, ajoute qu’il·elle·s considéraient et considèrent toujours que le journal comme les créations artistiques sont « à travailler », « à questionner », « peuvent être améliorées », jusqu’à « essayer d’aller vers la production d’un chef-d’œuvre ». La réécriture occupait donc une place importante, ce qui fait dire à Emmanuelle Buffin : « C’est pas respecter les enfants que de dire “ t’as écrit ton petit texte de deux lignes qui ne tient pas debout mais on n’y touche plus parce qu’on le respecte, ça vient de toi, c’est superbe. »
Un autre ancien enseignant de l’école des Charmes, Albert Sousbie, a effectué une étude à partir des vingt-quatre premiers numéros de Des enfants s’en MêlentÀ partir de laquelle il a écrit l’article « N’isolons plus la presse enfantine », publié dans la revue de l’Association française pour la lecture, Les Actes de lecture, n° 57, mars 1997.. Il place le journal du côté « des journaux bénévoles ou militants : organes politiques, syndicaux, associatifs », c’est-à-dire « d’une minorité — qu’il espère contribuer à rendre plus active et plus écoutée ». La minorité dont il est question ici, ce sont les enfants qui se mêlent de la vie de la cité, de l’Arlequin (leur quartier), et de la vie de cette utopie urbaine devenue une réalité plus complexe que la brochure et les discours initiaux ne le faisaient entendre. Ainsi les thèmes traités sont très divers, on peut relever la lecture, la télévision, la peur, la violence, les fêtes, la solidarité, les publicités, les travaux dans le quartier, la prise de parole, les ascenseurs, le foot, la paix, les jeux vidéo ou le journal lui-même. Lors de mon entretien avec Emmanuelle Buffin et André Béranger, plusieurs numéros ont été évoqués. L’un d’eux, le numéro 5, leur semblait particulièrement important car révélant l’expression du désir des enfants de s’exprimer à propos d’un événement qui les avait particulièrement touchés : un caddie avait été lancé depuis la coursive d’un immeuble sur une voiture de police et son conducteur. Dans ce numéro, différents témoignages sont rapportés et les points de vue ne concordent pas toujours… La violence qui est en jeu marque profondément les enfants. Le journal leur permet d’essayer de comprendre ce qui s’est passé et surtout ce qu’ils ressentent sur fond de conflit entre policiers et jeunes du quartier, racisme et déformation médiatique. L’acte d’écriture implique ensuite de réellement « théoriser le vécu » et de « communiquer son point de vue, en l’argumentant et en l’expliquantNotice non publiée, transmise par André Virengue, à propos de la rubrique « Chronique » du journal de l’école Jacques-Prévert Le Nouvel Écho. ». Avec l’aide des enseignant·es, les élèves s’attellent à une lecture comparée des différents articles de presse, critiquent Le Dauphiné libéré, condamnent l’acte mais s’interrogent aussi sur la violence des paroles entendues à propos de ce quartier qu’ils et elles aiment et protestent contre « ceux qui dégradent » et « contre ceux qui disent du mal ». Dans l’avertissement de ce numéro, les instituteur·trice·s de l’école des Charmes mentionnent : « Les enseignants les ont aidés à confronter tous les points de vue : presse, témoignages, rumeurs… Les enfants ont pu construire leur propre appréciation des faits. Ils peuvent ainsi apporter à tous un regard neuf et enrichissant pour l’avenir du quartier. » Avec le numéro sur la drogue, celui sur le caddie a été leur préféré.
Que ce soit Albert Sousbie ou les ancien·nes instituteur·trice·s de l’école que j’ai rencontré·es, toutes et tous insistent sur le fait que la Villeneuve était un lieu déjà très dense en production d’écrits. Il y avait des journaux d’adultes, des journaux d’immeubles, les brèves des associations et, du point de vue de la circulation de l’information, l’expérience de la télévision locale Vidéogazette. L’intérêt du journal n’était donc pas seulement d’être écrit par des enfants mais aussi de témoigner de leur point de vue et de leur opinion. La prise en considération publique de leur parole participait à la transformation de leur place dans la société« On assiste bien à une tentative pour caractériser et différencier une couche de la population. Il paraît clair, à lire DESM, qu’il se trouve là une vacance à combler, des territoires à explorer et baliser. » Albert Sousbie, « N’isolons plus la presse enfantine », in Les Actes de lecture, op. cit.. Le journal permettait qu’il·elle·s accompagnent et réfléchissent leur nouveau statut. Dans ce sens, le numéro 16 de Des Enfants s’en Mêlent me semble fondamental et participe d’une forme de praxis, de réflexion en acte. Pour les enfants, ce numéro existe « parce que c’est utile pour nous et pour nos lecteurs, de comprendre pourquoi et comment on fait ce journal ». Ce numéro rend compte de l’analyse de la cogestion, de l’implication dans le milieu social et du désir d’impact sur les institutions externes à l’école. À sa lecture nous comprenons que sa réalisation est un moment d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté, ces enseignements transitant par la prise de parole, auquel un autre numéro est dédiéNous pouvons par exemple y lire la description du fonctionnement du conseil d’enfants et du conseil de vie coopérative.. Le journal était donc élaboré par un groupe coordinateur, comité de rédaction renouvelé à chaque numéro, qui mettait en œuvre, du début à la fin, un objet médiateur. Cet objet remettait en jeu les situations duelles, notamment la relation maître·sse/élèveOu encore le rapport soignant·e/soigné·e tel qu’il a été réfléchi dans la psychiatrie institutionnelle depuis François Tosquelles.. Les chercheur·euse·s en pédagogie institutionnelle qui étudient les effets psychanalytiques en jeu dans les classes utilisant les techniques Freinet ont largement travaillé sur le rôle de ces objets en situation groupale. Grâce au journal, les relations sont complexifiées et analysées, et ont un effet sur le réel. Cette activité de production est créatrice de nouvelles sociabilités. C’est une des hypothèses soumises au·à la lecteur·trice par Albert Sousbie : « [B]ien avant de produire des informations, ce petit organe de presse participe à la structuration des nouveaux liens sociaux. » C’est aussi la manière dont Michel Lobrot définira l’expérience de la pédagogie autogestionnaire de Fonvieille : selon lui, Fonvieille « prétend établir entre [les gens] de nouveaux rapports sociaux, une nouvelle relationnalitéMichel Lobrot, « Préface », in Raymond Fonvieille, Naissance de la pédagogie autogestionnaire, Paris, Anthropos, 1998, p. 9. ». La pédagogie institutionnelle autogestionnaire est une des références du groupe de la Villeneuve, bien qu’ils et elles insistent sur le fait d’avoir pioché çà et là des méthodes et de les avoir ensuite adaptées. Or il est indéniable ici que le journal est un moyen recouvrant plusieurs fins : pédagogiques, littéraires, informationnelles, démocratiques. Il vise également une réelle transformation sociale : application des droits de l’enfant, mise en œuvre de la coéducation en impliquant les parents, ou aussi très simplement réparation d’équipements publics. André Virengue demandait aux jeunes journalistes de se poser cette question : « Qu’est-ce que je transforme par mon écritureNotice sur les objectifs transmise par André Virengue. ? »
Tout ce dont on parle est bizarre —
Un début
J’avais l’impression que je perdais ma Maman, alors qu’en vérité c’était plutôt un changement de peau, comme un serpent qui mue. Ce n’était pas ma Maman qui faisait ses bagages et qui se cassait par la fenêtre. Mais je pense que j’ai eu la sensation que ma Maman m’abandonnait, qu’elle s’était fait tuer par Paman ; que Paman et Maman étaient deux personnes différentes et que je devais redécouvrir une autre personne.
J’ai vécu la séparation de mes parents, la transidentité, l’arrivée d’un·e autre parent. Si tu avais un·e enfant aujourd’hui, iel naîtrait avec le fait que tu es trans. Iel aurait peut-être moins le choc du changement, de la « perte » [mets « perte » entre guillemets]. Iel vivrait d’emblée la transidentité, la coparentalité à deux ou trois, tu lea genrerais au neutre.
Le prisme (de la transidentité) et le j’aime
Un prisme, c’est un diamant. C’est différent de l’emprise sur quelqu’un : c’est quelque chose qui transforme, qui filtre, qui ouvre sur. Un peu comme la transidentité. Au début, le diamant peut être brut, puis poli. Alors il se met à briller trans parent, avec des paillettes. Quand on le tourne, ça fait plein de petites étoiles sur la mer au soleil. On peut aussi se voir dedans et alors il déforme ton visage — pas besoin d’avoir un vrai diamant d’ailleurs, un faux marche aussi.
Alors si on regarde les relations parent/enfant au prisme de la transidentité, cela veut dire que la transidentité fait des relations parents/enfants un diamant ?! Shine bright like a diamond!
Si tu étais resté·e ma Maman, peut-être que tu aurais été moins trans parent·e. Peut-être que tu aurais été un autre diamant. Et peut-être que tu aurais été moins heureux·se aussi, en tout cas moins épanoui·e, moins toi-même.
Et moi, blblblblblblbl, je recommence : et moi, j’aurais eu moins d’ouverture d’esprit. J’aurais peut-être été moins dans un espace hyper hyper dans l’accueil de qui je suis en terme de genre, d’expression de genre, de sexualité… Si je me sens garçon et que j’aimerais qu’on me dise « il », je ne vais pas monter un coming out pas possible : je vais juste dire à table, « Vous pouvez me dire ‘“il” ! » et ce sera, « Ok ! ». Si je me sens lesbienne, je sais que ce ne sera pas, « Je suis lesbienne », mais plutôt : je te présente ma copine.
C’est un peu comme les blazes. Si je te dis, « Aujourd’hui je m’appelle Arsène », tu m’appelles Arsène. Tu t’appelles comment aujourd’hui ? Charlie. C’est quoi ton pronom ? Elle. Et toi ? Aurel et iel. Stylé. On est stylé·es.
Il n’y a jamais de diamants dans mes dessins. Je dessine souvent des personnages à l’expression de genre féminin. Là, je dessine un blob rose au nez en forme de patate qui est lui-même une sorte de patate avec des yeux en demi-ovales. Avec un petit chapeau, parce qu’il aime les petits chapeaux.
C’est fatigant et un peu absurde, les coming out : « Hm, regarde, je vais te présenter qui je suis… » Ça ne devrait pas exister ! Ça devrait être évident que tu peux être qui tu veux et aimer qui tu veux. Et je trouve bizarre de dire que parce qu’un corps a un sexe comme ci ou comme ça, ce sera une fille ou un garçon, qu’on transformera son sexe si besoin pour qu’il respecte une des deux cases du genre et que tout ça définira son expression de genre.
Souligner l’assignation des objets à une fonction remettait tout en mouvement, d’un coup : peut-être que l’assiette se sent plat après tout, qu’elle préfère être bassine ou qu’elle rêve d’être paillasson. Et là soudain, on lui laisse la possibilité d’être tout ça aussi ! On se met au service de son mouvement potentiel, de sa danse.
Le prisme aussi, selon les moments, peut être un diamant kitsch ou princier, une paillette ou un diadème — et parfois tout à la fois ou rien de tout ça. C’est son droit d’être changeant.
Peut-être que le prisme de la transidentité nous apporte de l’éclairage, des outils, de la marge de manœuvre face au système et aux oppressions, qu’il crée davantage de conscience. Ça serait un peu l’inverse du point aveugle ou de l’angle mort : une forme de conscience des privilèges, des oppressions, des (inter) relations et des rôles dont nous héritons dans le système qui est le nôtre pour l’instant. Il nous mettrait en meilleure (inter) relation. Il créerait la possibilité de danses un peu plus ajustées, de vivacités, au sens de capacités de rebond et d’élans de vie.
Les genres forment un spectre, une sorte de fantôme. Ce sont des représentations, des filtres bénéfiques ou maléfiques. Créer de meilleures inter (relations), c’est essayer d’apprivoiser ces fantômes, d’identifier ces filtres. Et peut-être parvenir à se prendre, soi et l’autre, davantage tel·les qu’on est, s’écouter et faire confiance en la réalité à laquelle on se donne accès et dont on se fait le cadeau.
Le kaléidoscope
Et le kaléidoscope, lui, est en modifications perpétuelles. On ne peut pas l’agripper. Au moindre mouvement, c’est toute la réalité qui se transforme. Je dis « meuf », et hop l’instant d’après je ne sais déjà plus trop si je me sens vraiment si « meuf » que ça, ça s’est déjà complexifié. Le kaléidoscope ouvre sur des couches de vécus et de récits qui se renouvellent sans cesse.
Ça fait de l’autre (et de soi-même) des univers changeants, avec beaucoup d’infini et de mouvement, avec des trames multiples, des récits complexes.
Si je crois détenir le récit et que j’essaie de te l’imposer, il y a de fortes chances que cela représente un effort incroyable et une lutte quotidienne. Et, même si j’en ai le pouvoir grâce à mon privilège d’adulte et grâce aux institutions qui sous-tendent ce privilège, il y a de fortes chances pour que notre lien en pâtisse — parce qu’alors on n’est plus très loin du dressage et c’est pas hyper empuissantant.
La lumière (des j’aime et du consentement)
C’est important de nous demander ce que ça fait sur nous ces récits de l’obligation : le genrage obligatoire, l’école obligatoire, les apprentissages obligatoires, la citoyenneté obligatoire, le métier obligatoire…
J’ai l’impression que l’obligation est une des stratégies que les adultes ont trouvé pour projeter sur les enfants leurs vécus et leurs récits catastrophiques. Comme s’iels étaient prêt·es à risquer ce qui brille en l’enfant pour que l’enfant vienne entretenir leurs récits, reconduire leurs vécus. Comme si faire subir à l’enfant les oppressions qu’iels ont subi leur permettait de se convaincre elleux-mêmes de la solidité de l’édifice, du bien-fondé de la baraque et de ce qu’iels ont vécu (et souvent haï) jusque-là. Les agressions, les incestes, les viols des plus jeunes, c’est possible parce qu’il y a de la domination adulte, de l’emprise, de l’oppression de genre.
Pourtant, à un moment donné, c’est la responsabilité de l’adulte d’arrêter de reproduire le système, d’arrêter de le valider et d’en entretenir les histoires mortifères. C’est un boulot énorme, parce que le système a la capacité d’envahir chaque interstice, de ne rien laisser lui échapper. Alors il faut se ménager des espaces, les défendre en permanence, y vivre aussi, et réinventer les récits afin que ça se mette à pousser autrement.
Et c’est là que le j’aime est important, parce qu’il est source infinie de chaleur, de feu, d’énergie.
Toi qui viens de sortir de l’enfance, tu la vois comme le deuxième temps après la vie de bébé, un temps d’insouciance et de liberté, de curiosité et d’exploration, où tu étais concentré·e sur apprendre et découvrir et où tu ne te préoccupais pas de savoir si tu étais heureux·se.
Je trouve que les enfants sont porteureuses d’un grand j’aime, d’un mouvement de vie qui embarque et soutient. Et j’ai conscience que c’est un récit que je me fais de l’enfance et qui m’appartient ; il puise dans l’expérience que j’ai faite de la perte de ma lumière, de mes mots, de mon mouvement — du froid et de la rigidité qui vont avec et qui m’ont longtemps suivi·e. C’est une forme de prisme, un biais : celui de l’enfance comme j’aime, comme flamme que je me dois de préserver et d’entretenir en tant qu’accompagnant·e, et celui du danger de la perte du j’aime.
L’infantilisation et la biscornuité
Sofiane-Akim KounkouSofiane-Akim Kounkou, « Comment on fait ? », in Michaëla Danjé (éd.), Afrotrans, Paris, Cases rebelles, 2021. Cf. https://www.cases-rebelles.org/comment-on-fait-sofiane-akim-kounkou/ parle de l’infantilisation comme d’une des manifestations du racisme — mais aussi du validisme, du classisme, de l’âgisme… C’est « pipipipipipipipipi », comme les adultes qui croient que tu as toujours huit ans alors que tu en as treize et qui te parlent comme si tu étais idiot·e. Même pour les tout-petits, le côté « pipipipipipipipi », ça va si c’est un jeu, si ça ne dure pas et qu’on revient vite à la normale.
(« Normal », ça serait se parler comme on se parle actuellement et pas en super-articulant avec des intonations gênantes. Un·e enfant, c’est autant un·e individu·e qu’un·e adulte : « J’ai treize ans, merci, vous pouvez arrêter. »)
Infantiliser rend moins effrayant — mais attention, pas comme de chanter fort dans la forêt la nuit : ça, ça fait peur, je me dis qu’on va attirer les esprits. L’autre devient plus petit·e, plus vulnérable — j’émets des hypothèses, hein. Infantiliser les aîné·es, les personnes autrement valides, les personnes qui subissent le racisme, ça permet de faire disparaître ce qui fait différence, inconnu ; ça permet d’éradiquer ce qui m’est incompréhensible pour le moment et de ne pas me confronter. Ça ramène à moi et sous moi, ça me protège.
Quand j’infantilise l’autre, je peux me raconter que je débranche mon agressivité, que je dépasse ma peur envers iel, ça me soulage et me donne bonne conscience. Mais en vérité ça permet à la persécution et à la domination de se perpétuer — avec le sourire. Et ce faisant, je perds le contact avec l’autre, je perds ce que l’autre pourrait avoir à me partager, sa vérité et sa puissance : je perds l’autre, pour faire court.
Tu penses quoi de ce mot d’ « infantilisation » d’ailleurs : on dirait que ça va de soi que revenir à l’état d’enfant est un retour en arrière, à l’inférieur. Je préfère parler de rabaissement, de silenciation ou d’annihilation de l’autre.
Souvent les adultes annihilent les enfants, parce que sinon ça devient complexe : ça prend du temps, la relation. Et on est dans un monde où il n’y a pas le temps. Si on choisit de répondre à l’urgence, il y a de grandes chances qu’on choisisse l’annihilation répétée de l’autre.
— Est-ce que c’est vraiment normal ? Parce que l’ouïe, c’est pas trop ton fort, quand même. Alors si, toi, tu trouves qu’iels te parlent fort, ça doit vraiment être très fort… »]
En même temps, on est d’accord que, la plupart du temps, je ne me dis pas : « Tiens, aujourd’hui, je vais t’annihiler. » Mais c’est comme si le système patriarcal dans lequel je baigne induisait en moi ces pensées et ces fonctionnements si bien que je ne me voyais pas répéter ça aveuglément, encore et encore : c’est tragique. Jusqu’au moment où je décide de prendre mes responsabilités et de faire autrement.
Ce n’est pas mon intention à la base, mais j’assiège mon pouvoir sur l’autre… Hm, j’assoie mon pouvoir sur l’autre, plutôt. Mais il faut aussi assiéger le pouvoir, assiéger la société comme on avait fait, là, en mille-sept-cents machin. On envoie un SMS à tout le monde et on dit : « Révolution ». Bon, y’aura douze personnes à notre Révolution — en plus, la Révolution de mille-sept-cents machin n’a pas changé le système des oppressions, qui était déjà en place depuis au moins deux cents ans. Bon (re).
Tout ce dont on parle est bizarre ! Rien de tout ça ne devrait exister. Un peu comme : « Tu es transphobe ? Arrête. »
Quand j’ai commencé à être perçu comme un père, et non plus comme une mère, d’un coup, j’étais vraiment trop mignon de me promener au parc avec toi.
Aujourd’hui, entre mon corps non-binaire, N. qui a l’air d’une femme à barbe et toi en mode ado, les personnes ne savent plus trop quoi faire de nous. Parfois, je vois de la gender terrorTerreur de genre. dans leurs yeux, comme cette dame qui nous observait dans le RER, presque outrée qu’on existe. Des fois, j’ai envie de leur dire : « Là, là, ça va aller. » Et des fois, je suis plus dans la haine et ça m’indigne — ce jour-là, je lui ai fait des mimiques moches.
Alors que je suis sûr·e qu’iels aussi ont des corps biscornus (je ne regarde pas le corps des personnes, j’écoute plutôt leur tête et ce qu’iels racontent). N. regarde toujours le corps des personnes et iel les trouve incroyables, avec leurs biscornuités. Ça me touche, cette perception qu’iel a, ce regard sincèrement curieux. Et la conscience que nous avons toustes nos biscornuités.
Les mouvements antagonistes de politisation de la question des mineur·es trans et non-binaires —
Peut-on faire se rencontrer les questions LGBTIQ et les « enfantsCe terme parapluie recouvre en réalité de nombreuses autres appellations : adolescent·es, mineur·es, jeunes… Le choix du terme « enfant » renvoie ici à la thématique de l’ouvrage. » ? Telle est la question qui anime, depuis longtemps, un certain nombre de polémiques.
En décembre 2010, Christine Boutin, alors présidente du Parti chrétien démocrate, est invitée au journal de TF1. Elle y évoque un court métrage que des associations LGBT diffusent lors de leurs interventions en milieu scolaire (IMS). Intitulé Le Baiser de la lune, ce court métrage animé raconte la tendre histoire de deux poissons-lunes (mâles) qui s’aiment. Rien d’autre. Il n’est nulle part question d’identité sexuelle (le mot « homosexuel » n’est pas prononcé) ni même de pratique sexuelle entre ces deux poissons. Juste d’amour. Sur le plateau télévisé, Christine Boutin s’oppose ouvertement à la diffusion de ce support et justifie sa prise de position de la sorte : « Il faut laisser l’enfance à l’enfance. » Dans une tribune publiée dans Le Parisien en date du 26 décembre 2010, l’élue indique que ce court métrage « prive les enfants des repères les plus fondamentaux que sont la différence des sexes et la dimension structurante pour chacun de l’altérité ».
En janvier 2022, le candidat à l’élection présidentielle Éric Zemmour s’oppose au « lobby LGBT » qui entrerait à l’école par le biais des associations et de leurs IMS. Plus précisément, le candidat dénonce « l’endoctrinement » des élèves et la « théorie du genre » qui serait enseignée à l’école.
En décembre 2022, à Bordeaux, un établissement culturel privé organise une « lecture de contes » par une « drag queen » à destination des 0-3 ans. L’événement est alors menacé par une manifestation d’opposants qui dénoncent « l’influence du lobby LGBT » et le « conditionnement » de ces enfants.
Dans ces trois événements, l’enfant est présenté comme un être neutre, supposément hétérosexuel et cisgenre et ces dispositifs ludiques comme des parasitages du développement psychosexuel et psychoaffectif de l’enfant. C’est ce raisonnement qui réapparaît autour d’une dernière polémique : celle portant sur les mineur·es trans. L’objet de ce chapitre sera d’éclairer les différents éléments qui façonnent la politisation de cette question, en insistant sur les lignes de tension qui la traversent. D’un côté, des collectifs et associations se réclamant du « droit de l’enfant » et appelant à la prudence (voire à la non-intervention) dans les demandes de mineur·es trans, et, de l’autre, des recherches et des pratiques cliniques qui tendent, au contraire, à accompagner ces demandes de prise en charge.
Éléments de vocabulaire
Débutons peut-être par cela : qu’est-ce qu’un·e mineur·e trans ? Cette terminologie désigne l’ensemble des mineur·es dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance, sans pour autant qu’une demande d’intervention chirurgicale soit au cœur de la démarche de l’enfant. Le terme de « mineur·e trans » est un terme parapluie, car il renvoie à une multitude d’autres expériences de genre ainsi qu’à de nombreuses autres terminologies. On assiste par exemple depuis quelques années à l’émergence de la notion de « non-binarité » qui permet de traduire le sentiment de n’appartenir ni totalement au genre masculin ni totalement au genre féminin. Des identités comme « gender fluid » participent du même phénomène : l’expression d’identités de genre nouvelles.
Très longtemps, la définition de la transidentité s’est limitée aux âges adultesArnaud Alessandrin, Sociologie des transidentités, Paris, Le Cavalier Bleu, 2018.. L’enfance et l’adolescence des personnes trans étaient envisagées rétrospectivement comme des preuves irréfutables de la persistance de la demande de changement de genre chez l’adulte. Or, les étapes du développement psychosexuel de l’enfant permettent de constater que l’identité de genre d’une personne se manifeste bien avant la majorité. Pour le dire autrement, « se sentir fille » ou bien « garçon » est une expérience qui trouve ses premières affirmations dès l’enfance. Il n’est donc pas étonnant que des personnes mineures expriment des identifications variées, parfois éloignées de leur assignation de sexe de naissance.
Enfin, selon les dernières études disponibles, la prévalence de la transidentité chez les mineurs s’établit aux alentours de 1 %Agnès Condat et al., « La prise en charge des enfants, adolescentes et adolescents transgenres en France : controverses récentes et enjeux éthiques », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 1/18, 2022.. Il ne s’agit pas ici de « personnes opérées » mais bel et bien de mineurs qui expriment une identité de genre différente de celle attendue. Cette affirmation peut prendre des formes nombreuses, et s’appuyer sur un lexique qui s’enrichit d’année en année : gender fluid, queer, non-binaire. Si l’objet de cet article n’est pas de définir chacun de ces termes, retenons juste qu’ils évoquent tous une distance plus ou moins grande vis-à-vis des assignations de genre de naissance.
La transidentité des mineurs : un fait nouveau ?
Alors que les demandes de prise en charge semblent augmenter, dans les établissements tant médicaux que scolairesArnaud Alessandrin, « La prise en compte des élèves trans à l’école en France », La Nouvelle Revue — Éducation et société inclusives, vol. 93, n° 1, 2022., peut-on pour autant en conclure que nous soyons face à un phénomène entièrement nouveau ? Les témoignages de personnes trans nous donnent à voir des souvenirs d’enfance dans lesquels apparaissent déjà des questionnements sur leur genre. En somme, l’existence des préoccupations liées à l’identité de genre de personnes mineures n’est pas nouvelle, mais c’est l’expression de ces situations qui l’est indubitablement. Dans cette perspective, l’énoncé même d’une possibilité d’interroger son genre dès l’enfance se manifeste par l’apparition d’une terminologie nouvelle, inédite jusqu’alors. Le terme de « non-binaire », par exemple, renvoie au fait de ne se sentir « ni » homme « ni » femme, ou bien « parfois » homme, « parfois » femme, ou bien encore « et » homme « et » femme. Cette identification de genre est très employée par les mineurs dont il est question ici, puisqu’ils voient en elle une possibilité d’exprimer leur genre de façon nouvelle, réappropriée. De la même façon, ceci permet la création et la reconnaissance de communautés. À l’image de l’homosexualité, les mots et les expériences comparées favorisent nettement l’expression et l’affirmation de soi.
Il n’y a pas d’épidémie, comme l’affirment des psychanalystes comme Elisabeth RoudinescoPropos exprimés le 10 mars 2022 dans l’émission Quotidien sur TMC., mais plutôt une lente reconnaissance de ces existences. L’école est à cet égard un bon étalon pour rendre compte de cette progression en matière de visibilité et de prise de conscience de la présence des mineurs trans. Dès 2014, des publications insistent sur les expériences scolaires des mineurs trans. À la suite des ABCD de l’égalité, le concept de transphobie fait même timidement son entrée dans les politiques de lutte contre le harcèlement scolaireJohanna Dagorn et Éric Debarbieux, « Les transidentités et l’école : une volonté politique », Les cahiers de la transidentité, n° 4, 2014.. Mais il faut néanmoins attendre la médiatisation du suicide d’une élève trans en 2020 pour que l’Éducation nationale s’empare plus volontairement de la question.
Politiser la question des mineurs trans : le principe de précaution au service de la « non-action »
Cette nouvelle thématique qui s’impose dans l’institution scolaire s’impose également dans les médias et les débats scientifiques comme un sujet très controversé. Ces enfants sont-ils soumis à une influence parentale ? N’est-ce pas plutôt un phénomène de mode ? Ces jeunes ne confondent-ils pas leur identité de genre et leur orientation sexuelle ? Des collectifs comme Ypomoni, l’Observatoire de la petite sirène ou SOS éducation se sont alors engagés contre toute reconnaissance de ces mineur·es trans. À la façon de la Manif pour tous durant les débats sur le mariage pour les personnes de même sexe, de nombreuses représentations sont brandies : ces jeunes ne sont-ils trop jeunes pour savoir ? Ne vont-ils pas regretter leur choix ?
Dès 2021, le collectif Ypomoni s’oppose à ce qu’il nomme « l’explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultes ». Pour ce collectif, les changements de genre chez les mineurs (qu’il s’agisse de vêtement, de prénom ou d’hormones) conduisent à une cristallisation de l’identité de genre « trans » chez les enfants. Outre le fait que les chiffres ne révèlent pas d’explosion (du moins, que cette tendance est très difficilement mesurable car la mesure de cette population est très récente et les effectifs étudiés très réduits), le collectif Ypomoni défend l’idée que les jeunes personnes trans ou non-binaires seraient influencées alternativement ou simultanément par la société, les médias, leurs parents ou les militant·es LGBT elleux-mêmes.
La même année, L’Observatoire de la petite sirène se constitue autour des pédopsychiatres et psychanalystes Caroline Eliacheff et Céline Masson, autrices de La Fabrique de l’enfant transgenreCaroline Eliacheff et Céline Masson,La Fabrique de l’enfant transgenre, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022.. Pour ce collectif, comme pour Ypomoni, les jeunes trans sont trop jeunes pour consentir à un suivi, notamment du fait des influences extérieures qu’ils et elles subissent, comme les « réseaux sociaux, témoignant de véritables processus d’emprise sur le corps et la sexualité des enfants ». Enfin, pour ces militant·es, les jeunes trans présentent pour beaucoup une « vulnérabilité psychopathologique » qui prend la forme d’une transidentité, sans que cette dernière puisse donc être réellement diagnostiquée sérieusement. C’est pourquoi les membres de l’Observatoire de la petite sirène préconisent un moratoire sur la prise en charge des mineurs trans.
Une perspective « trans-affirmative » pour lutter contrE les errances thérapeutiques et les exclusions
À l’opposé de ces collectifs réticents, voire frontalement opposés au suivi et à la prise en charge des mineurs trans, les données scientifiques disponibles vont, dans une majorité écrasante, dans le sens d’un accompagnement de ces mineurs, qu’il s’agisse des espaces scolairesGabrielle Richard et Clément Reversé, « La vulnérabilité scolaire des jeunes LGBTQI en France. Penser la marginalisation accrue des élèves trans, non binaires et intersexes », Agora débats/jeunesses, vol. 91, n° 2, 2022., médicauxA. Condat et al., « La prise en charge des enfants, adolescentes et adolescents transgenres en France : controverses récentes et enjeux éthiques », op. cit. ou parentauxAnnie Pullen Sansfaçon et Denise Médico, Jeunes trans et non binaires : de l’accompagnement à l’affirmation, Montréal, Remue-Ménage, 2021.. Diminution des pratiques à risque, baisse des déscolarisations, augmentation de l’intégration sociale : faire place aux demandes des mineurs trans leur assure une meilleure qualité de vieIbid.]. Quant au fait qu’ils puissent se tromper ou regretter, la littérature internationale sur cette question estime que seuls 1 à 2 % des personnes opérées regrettent leur transitionArnaud Alessandrin, « La notion de regret dans la clinique de changement de genre », L’Évolution psychiatrique, vol. 84, n° 2, 277-284, 2019 ; A. Condat et al., « La prise en charge des enfants, adolescentes et adolescents transgenres en France : controverses récentes et enjeux éthiques », op. cit.. Au-delà des préjugés stigmatisants qui fleurissent dans les médias, des preuves scientifiques nombreuses concourent aujourd’hui à une prise en charge globale et réelle de ces mineurs.
Les protocoles français de prise en charge de ces mineurs (Paris et Lille pour les plus expérimentés) donnent à voir des prises en charge (publiées et librement accessibles) conduites en plusieurs étapes : un accueil des personnes et de leurs parents, des suivis psychologiques afin d’accompagner les personnes dans la stabilisation de leur demande et des propositions de protocoles endocriniens adaptés. Loin d’une hormonothérapie sauvage ou d’un endiguement des demandes jusqu’à une opération génitale (qui est réservée aux personnes majeures en France), ces protocoles de soin s’appuient sur une méthode dite « trans-affirmative » qui accompagne les personnes concernées à pouvoir exprimer leur identité de genre de façon bienveillante et non-excluanteLire par exemple : Danika Sharek, « A Mixed-Methods Evaluation of a Gender Affirmative Education Program for Families of Trans Young People », Journal of LGBT Studies, 16/2, 2020 ; ou bien encore Pablo Expósito-Campos, « Empirically Supported Affirmative Psychological Interventions for Transgender and Non-Binary Youth and Adults: A systematic Review », Clinical Psychology Review, n° 100, 2023.. Toutefois cette méthode n’engendre pas d’adhésion totale aux suivis hormonaux car une partie des jeunes venant consulter ces équipes hospitalières finissent, à la suite des entretiens préalables menés par ces mêmes équipes, par réévaluer leur demande et s’éloigner des prises d’hormones, des demandes de changements de prénoms ou de pronom.
Des situations et des recherches internationales controversées
Deux points de tension semblent à ce stade irrésolubles. Le premier porte sur le jeune âge des personnes suivies. Du côté des associations comme Ypomoni ou l’Observatoire de la petite sirène, ces demandes sont la preuve que l’identité de genre « trans » ou « non-binaire » peut rapidement se sédimenter chez l’enfant, et qu’il s’agit d’être prudent quant à l’énoncé même d’un diagnostic. Cette théorie s’appuie sur les travaux de Lisa Littman, médecin et chercheuse américaine, qui a inventé le terme de « dysphorie de genre à apparition rapideL’article originel est le suivant : Littman, Lisa « Rapid-Onset Gender Dysphoria in Adolescents and Young Adults: A study of Parental Reports », PLoS ONE, 13 (8), 2018. ». Très vite critiqué dans sa méthode et ses résultats, l’article de Littman sera republié avec des modifications importantes dès 2019, invalidant les résultats de la première publication. À ce jour, il n’existe donc aucune publication venant attester que l’identité de genre de l’enfant pourrait être conditionnée par un environnement favorable aux expressions de genre alternatives et à la prise en charge médicale des personnes concernées.
Pourtant, et là se situe le second point de tension, de nombreux pays sont présentés par le collectif Ypomoni ou l’Observatoire de la petite sirène comme ayant fait « marche arrière » sur le suivi des mineur·es trans : le Royaume-Uni notamment. Mais, là encore, les récupérations politiques sont nombreuses et le traitement militant et médiatique des cas n’éclaire que partiellement le débat. Le centre Gender Identity Development Service (GIDS) à Londres était le seul à proposer un accompagnement des jeunes trans. Sa fréquentation a crû de façon exponentielle : entre 2011 et 2021 le nombre de mineurs suivis est multiplié par vingt. En conséquence, les services proposés par le centre se sont détériorés. En parallèle, en 2019, la médiatisation d’une plainte met un coup de projecteur inattendu sur la clinique de Londres. La plaignante, Keira Bell, accuse alors le service de lui avoir donné des bloqueurs de puberté trop précocement, et gagne en première instance. Cette dénonciation s’inscrit dans une mise en accusation plus large. La critique émanant des milieux conservateurs britanniques insiste alors sur les difficultés d’appréciation des conséquences d’une hormonothérapie ou d’un blocage des hormones de la part des personnes mineures. Les critiques stipulent en même temps que ce qui est exprimé par les jeunes constitue un événement passager dans la vie de l’enfant, un sentiment superficiel que le genre assigné ne correspond pas à l’identité de la personne, dû à l’influence sociale d’un groupe ou à des troubles psychiques. En 2021, la cour d’appel de Londres finit par donner raison à la clinique Tavistock contre Keira Bell. Selon les juges, les actes médicaux prodigués ne contrevenaient pas au droit et les juges n’étaient pas compétents pour juger ce cas.
La clinique devra toutefois fermer ses portes en 2023. Le système de santé publique du Royaume-Uni a pris cette décision guidée notamment par un rapport rédigé par la pédiatre Hilary Cass, qui confirme que le service est sous « pression insoutenable », que les attentes des patient·es ne peuvent pas être satisfaites, et que l’atmosphère autour de la clinique créée par certains médias fait que le personnel ne reste pas, ce qui détériore davantage la qualité des soins.
Et pourtant, iEls existent : l’exemple de l’école
La santé, la famille ou l’école sont des institutions tiraillées sur ce sujet. À l’école, par exemple, entre les parents, les habitudes de professionnel·les et les identités assumées par les jeunes trans, créer un cadre générique d’accueil des élèves trans devenait une urgence. Si l’Éducation nationale connaissait déjà des textes et des dispositifs de sensibilisation contre les discriminations et le harcèlement (notamment transphobe), les réalités sur le terrain semblent indiquer, à l’inverse, que l’expérience de la transphobie se banalise. En 2020, l’enquête « Santé LGBT » souligne que 82 % des élèves trans considèrent leur expérience scolaire comme ayant été marquée par la transphobieJohanna Dagorn et Arnaud Alessandrin. « La santé des élèves LGBTI », L’école des parents, n° 2, vol. 627, 2018..
Une circulaire d’octobre 2021 intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire » vient combler une demande des associations trans et des professionnels en matière d’accueil de ces mineurs. Elle autorise les établissements à prendre en compte le genre choisi par l’élève à la condition que les deux parents donnent leur accord (ce qui n’est pas sans poser un grand nombre de soucis, notamment en cas de désaccord des parents à ce sujet). De plus, la circulaire rappelle le cadre règlementaire de lutte contre les discriminations et propose une somme de « bonnes pratiques » aux établissements. Parmi elles, le fait de changer l’ensemble des papiers scolaires au nom de l’élève (cartes de CDI, cantine, listes d’appel) mais aussi de favoriser l’accès aux lieux clos (toilettes, vestiaires) à ce public spécifique.
Au-delà des controverses sur le suivi médical des mineurs trans et non-binaires, leur existence demeure et les institutions de prise en charge sont confrontées à leurs demandes de façon bien plus régulière qu’avant. Le débat ainsi posé n’est pas sans rappeler celui qui a traversé la société française autour de l’homosexualité. L’histoire se rejoue-t-elle avec une nouvelle figure de l’enfance : celle des mineurs trans ?
Un « Je » d’enfant sur scène —
Rien de plus efficace que de recourir à un jeune interprète pour donner un coup de fraîcheur à un spectacle. Mais lorsqu’ils sont convoqués sur scène, les enfants sont trop souvent cantonnés à une image angélique de bambin docile. Quand ils sortent de ce rôle, c’est le scandale. Si ce phénomène trahit les impensés de la société adulte à leur égard, certains artistes tentent d’écouter le monde à leur hauteur.
Un écrivain multiprimé, un plasticien collectionné par les plus grandes institutions internationales, un cinéaste quasi-sacré : les accusations de pédocriminalité entachent le monde de l’art. Dans les médias, on se demande s’il faut « dissocier l’homme de l’artiste ». On s’interroge moins sur la présence et la place des enfants dans les cercles de la création. Ni sur le regard que les adultes portent sur eux : dominant et objectivant. Des biais que l’on retrouve sur les scènes de théâtre et de danse, où la reconnaissance des interprètes mineurs est encore difficile, quand leurs droits ne sont pas tout simplement bafoués. La chorégraphe Josette Baïz a dû attendre dix ans pour que le travail de sa compagnie, exclusivement composée d’enfants et d’adolescents professionnels, soit reconnu par le milieu. Lorsqu’elle fonde le Groupe Grenade en 1992, après une expérience menée pendant un an avec les élèves d’une école des quartiers Nord de Marseille, c’est plutôt la condescendance qui prime : « Au début, on était étiquetés “socioculturel”. Les gens se disaient que je “réduisais la fracture sociale. » Il faut attendre 2003 pour que six des petits danseurs formés par Josette savourent le succès, avec la pièce Trois Générations, cocréée par la figure de la nouvelle danse française Jean-Claude Gallotta. « Ça a provoqué un choc ! », s’amuse-t-elle encore, « personne n’arrivait à croire que des enfants puissent danser aussi bien. » Elle ne s’en émeut pas plus que ça. Depuis, sa compagnie enchaîne les créations avec les chorégraphes les plus réputés de la scène mondiale, de la postmoderne Lucinda Childs au contemporain Boris Charmatz.
Si la fondatrice de Grenade reste modeste quant au succès de son entreprise, elle comprend pleinement l’engouement du public : « Les enfants sont hyper ouverts, ils prennent les choses à bras-le-corps et avec sincérité. C’est un sacré coup de fraîcheur pour les œuvres ! » Typiquement le genre de propos qui agace Marion Siéfert. La jeune metteure en scène regrette que les enfants soient seulement instrumentalisés pour « leur côté mignon, comme des petits chats ». « Il manque au théâtre des œuvres vraiment centrées sur l’enfance, comme le film Fanny et Alexandre de Bergman. Il existe peu de pièces où les enfants s’amusent sur scène et jouent un vrai rôle. » Pour sa seconde création, Le Grand Sommeil, qui a reçu un accueil critique enthousiaste en 2018, elle voulait confier le rôle principal à Jeanne, sa nièce de dix ans. La professionnalisation du projet s’accompagne d’une visite médicale obligatoire pour l’interprète mineure. Sans s’inquiéter de l’état de santé de la petite fille, la médecin s’indigne de son implication dans le processus créatif. « Pour la docteure, la référence, c’était le spectacle du Roi Lion », soupire Marion Siéfert. « Les enfants font trois pas à gauche, trois à droite, et c’est tout. » Or ce qui intéresse la metteure en scène qui tisse une réflexion sur la jeunesse — parfois dans ce qu’elle a de plus dérangeant, comme dans _jeanne_dark_ (2020), qui mettait en scène le pétage de câble d’une ado sur Instagram — c’est précisément d’exposer l’enfance dans ce qu’elle peut avoir de plus insupportable, de plus anarchique et irrévérencieux. La démarche n’est pas au goût de la praticienne : elle crie au scandale, convoque les parents et leur suggère de retirer leur fille du projet « hors des clous » qu’elle juge trop éprouvant pour une enfant. Le Grand Sommeil verra finalement le jour sans Jeanne, la comédienne Helena de Laurens endosse en plus de son propre rôle celui de Jeanne, et restitue au rictus près les réactions de la petite fille face aux grimaces déployées par son aînée lors des premières répétitions.
Cachez ce môme
Chargées du bien-être des mineurs et d’empêcher toute dérive d’exploitation, l’Inspection du travail comme la commission des enfants du spectacle veillent au bon traitement de ces derniers, à leur sécurité morale et même à leur juste rémunération. Mais en appréciant la conformité des projets artistiques par le prisme des cachets ou des horaires de travail, ces instances de contrôle participent, malgré elles, à entretenir une vision ultranormée des enfants sur les plateaux, qui semble correspondre aux attentes du public. Sur les scènes contemporaines, un enfant s’exprimant librement, étrangement, c’est too much. La nudité des adultes, la cruauté envers les animaux, l’autoflagellation et la violence physique, par contre, ne sont plus que des faux tabous. Thierry Micouin, danseur interprète pour des chorégraphes contemporains influents dès les années 1980, l’a appris à ses dépens. Jeune papa, il entreprend en 2006 de créer une pièce autobiographique, W.h.o., dans laquelle il revient sur sa construction de petit garçon. Pour éviter de faire appel à un enfant extérieur, il se tourne vers sa fille de huit ans. Dans le spectacle, Ilana Micouin apparaît sur un écran pendant une courte séquence filmée, vêtue d’une robe, d’une perruque et maladroitement maquillée. Cette parfaite illustration d’une virée dans le placard de Maman, naïve en apparence, vaut à Thierry Micouin l’insulte suprême : dans une lettre, une spectatrice n’hésite pas à taxer la pièce « d’obscène » et son auteur de « pédophile, pervers, criminel ». L’extrait vidéo, pourtant, ne montre rien de plus qu’un instant de jeu spontané, improvisé librement par la petite fille. Aujourd’hui jeune vingtenaire, Ilana s’étonne encore de la lettre assassine : « J’avais choisi la robe et la perruque et je m’étais maquillée toute seule. Ce n’était pas mon père qui m’avait imposé ça ! » Ce dernier n’hésite pas à parler d’un relent puritain, logé dans l’œil du spectateur bien plus que dans l’esprit du chorégraphe. « Dès qu’un enfant sort des postures policées, on s’imagine qu’il a été forcé ! » Avec le bad buzz provoqué par le film Mignonnes, accusé d’indécence à sa sortie en 2019 pour avoir fait voir des adolescentes amatrices de danses lascives, le cinéma nous en donnait une illustration encore récemment.
Pour déboulonner l’autorité toute puissante de l’adulte sur l’enfant, la performeuse Francesca Grilli a choisi d’opérer une opposition plus radicale. Dans sa pièce Sparks, créée en 2015 et reprise en 2021, une distribution exclusivement composée d’enfants, coiffés de casques sertis d’un croissant de lune, endosse la fonction d’oracle et descend de scène pour venir lire l’avenir dans la main des spectateurs adultes. « L’adulte est habituellement dans une position d’autorité vis-à-vis de l’enfant, et ce culte de l’autorité est central dans notre société. Il me semblait urgent de donner aux plus jeunes le pouvoir et l’espace de parler, ainsi que le silence pour être écoutés. » Les jeunes interprètes, chaque fois recrutés sur les lieux de représentation par un appel à participation, sont invités à suivre un atelier de pratique théâtrale et rhétorique. Du côté des enfants, l’attention est portée à leur fournir les outils pour s’affirmer et prendre confiance en eux. Pour les adultes, en revanche, l’enjeu de la performance est plutôt qu’ils s’interrogent sur le crédit qu’ils accordent aux plus jeunes. Mais derrière la redistribution symbolique des positions de pouvoir, l’enfant-interprète — réduit à son seul âge — s’efface une fois encore derrière la voix de l’artiste aux commandes.
Or, c’est bien pour protéger ses complices enfants et la sincérité de leurs propos que Mohamed El Khatib est intervenu dans l’écriture de La Dispute (2019), une pièce sur la séparation conjugale composée à partir d’entretiens menés avec ses jeunes acteurs, « témoins privilégiés lorsqu’il s’agit de faire voir aux adultes d’autres points de vue sur le monde ». Pour ce projet, le metteur en scène n’est pas arrivé avec un thème dans ses valises. C’est au cours des discussions organisées dans les écoles par petits groupes avec les enfants, déchargés de la présence des parents, que les échanges collectifs ont permis à Mohamed El Khatib de relever la récurrence de la séparation, thématique doublement intéressante dans le processus de travail de l’artiste. « L’espace du théâtre est habituellement dévolu aux adultes. Avec La Dispute, l’idée était de donner les clefs aux enfants, par le biais d’un sujet que je ne maîtrise pas moi-même et dans lequel les enfants ont une position d’experts. » Au même titre que les authentiques supporters du RC Lens convoqués sur scène dans Stadium (2017), les collectionneurs interviewés pour Boule à neige (2020) ou les parents de jeunes acteurs invités à monter sur scène dans Mes Parents (2021), les jeunes sujets sollicités dans La Dispute incarnent pour Mohamed El Khatib une altérité, dont la rencontre est centre et moteur de son processus créatif. Mais pour celui qui fait de l’intime un terrain d’analyse politique par excellence, le point de vue de ses jeunes collaborateurs offre un matériau exceptionnel : « Quand vous entendez parler les enfants, vous voyez les adultes en filigrane. Non seulement les enfants s’exposent, mais ils exposent aussi leur vie familiale et donc leurs parents. Cette parole très libre, on l’a seulement chez les enfants et chez les vieux. » Là où le metteur en scène se réjouit d’observer une libération de la parole, favorisée par la discussion entre pairs, l’Inspection du travail s’alarme et oppose son refus, motivé par la crainte de « réveiller des traumas ». « On est encore dans la politique de cacher les choses sous le tapis, constate Mohamed El Khatib. C’est comme ça que l’on se retrouve avec des fantômes familiaux parce que les choses n’ont pas pu être dites. » S’il revendique un enjeu de réparation — au prix parfois d’une réception violente pour le public adulte —, pas question pour le metteur en scène d’exposer les enfants au moindre risque de gêne ou d’hostilité, à un âge où le sentiment de honte peut être dévastateur. Alors, pour éviter de mettre ses petits collaborateurs en porte-à-faux, notamment vis-à-vis de leur famille, Mohamed El Khatib a opéré une redistribution des textes, injectant une part de fiction et de jeu. « Tout ce qui est dit dans la pièce est vrai, mais ce que dit un enfant peut être arrivé à un autre. De cette façon, les enfants sont protégés mais les choses sont énoncées. »
Un loup, des chaperons rouges
Depuis la propagande ethnocide pendant la guerre civile au Rwanda (Hate Radio, 2011), jusqu’à la fin de vie assistée documentée en caméra embarquée dans Grief & Beauty (2021), le metteur en scène et ancien journaliste Milo Rau a fait du reenactment cathartique le cœur de sa démarche artistique. Et ce travail de déminage traumatique n’épargne pas la place sociale assignée aux plus jeunes. Pour l’artiste, aujourd’hui parmi les metteurs en scène les plus suivis de la scène contemporaine européenne, penser les enfants uniquement comme des êtres vulnérables est une manière d’asseoir et de légitimer ces rapports de domination, sur scène comme dans la vie. Exaspéré de les voir toujours réduits à de petites choses « faibles et naïves », il décide de se saisir de l’espace du théâtre pour les confronter aux faits divers les plus sordides. Dans Five Easy Pieces, créée en 2016, il sollicite huit acteurs de 8 à 13 ans pour relater l’affaire du pédocriminel Marc Dutroux. Entre deux intermèdes aux allures de cours de récré, les petits comédiens se glissent dans la peau des enfants séquestrées, et même du bourreau. Comble de l’obscène ? Le metteur en scène affirme tout le contraire : « Pour les enfants, l’histoire de Dutroux, c’est comme Richard III : une sorte de vieux conte fantastique. » Même s’il confie avoir potassé des ouvrages pédagogiques et fait appel à des psychologues, Milo Rau entend avec ce projet démontrer la capacité des enfants à interpréter des émotions et des événements dont ils n’ont pas fait l’expérience et que la société juge trop lourds à porter pour eux. En se retrouvant en position de magiciens, capables de provoquer avec détachement les pleurs et l’effroi du public adulte, il leur permet aussi de reprendre le pouvoir. Mais plus qu’une fantaisie cathartique, le metteur en scène tient à rendre visible la vertu de l’espace théâtral, « seul endroit où les enfants et les adultes peuvent parfois réussir à se parler d’humain à humain ».
Derrière la victimisation et l’hyperprotection dont les enfants font l’objet, la metteure en scène Léa Drouet voit quant à elle une ultime facette : le déchaînement répressif. Un rapide détour par les événements qui ont suivi l’assassinat de Samuel Paty, professeur de collège accusé par des élèves de propos islamophobes, offre un exemple effarant : plusieurs enfants, parfois très jeunes, sont arrêtés chez eux au petit jour et traînés en garde à vue pour ne pas avoir respecté la minute de silence. « Notre imaginaire est occupé par deux figures : l’enfant-victime à protéger, et l’enfant à redresser et corriger. Dans ces deux cas, notre rapport à l’enfance est impérialiste et colonial. » Depuis l’école républicaine jusqu’à la protection de l’enfance, les dits « mineurs » sont pris dans des structures qui vont contre leur autonomisation. Alors pour le projet théâtral J’ai une épée (2023) qu’elle a engagé sur le sujet avec la dramaturge Camille Louis, pas question de rejouer une énième fois le rapport d’autorité entre l’adulte docte et l’enfant scruté. Dès les premières étapes de travail, Léa Drouet était au moins sûre d’une chose : il n’y aura pas d’enfants au casting de leur spectacle. « De cette façon, on ne les dépossède plus de leur expérience et de leur parole. On rend simplement compte des représentations qui sont véhiculées par les institutions en charge de l’enfance. » Moins qu’une place faite ou non dans le casting, l’enjeu pour le spectacle vivant, s’il tient à rester contemporain, sera plutôt d’accorder aux enfants le traitement dû à chaque individu, situé, mouvant et irréductible à une assignation prédéterminée par celles et ceux qui n’en ont pas ou plus l’expérience directe.
« Revolting children »? Les enfants acteurs de comédies musicales à Paris, Londres et New-York —
Lorsqu’en 2013 l’acteur Neil Patrick Harris mène le numéro d’ouverture des Tony Awards, l’équivalent américain des Molières, la salle est médusée : partout sur scène, des enfants issus des spectacles de la saison chantent et dansent, et ils sont anormalement nombreux. En même temps qu’il leur offrait une place, le numéro coécrit par Lin-Manuel Miranda égrenait les clichés par la voix de Harris, lui-même célèbre depuis l’adolescence : ces enfants qu’on adulait mais qu’on renverrait sitôt la puberté arrivée, quelles substances consommaient-ils pour tenir, poussés par des parents qui dépensaient leur argent ?
Les dernières décennies ont vu se multiplier les comédies musicales à gros budget portées par des enfants généralement âgés de sept à quatorze ans, capables de jouer, de chanter et de danser. Ils y interprètent quasi-exclusivement des rôles d’enfants, et plus exceptionnellement des rôles d’adultes (Bugsy Malone, 1983). Il s’agit très souvent d’œuvres tirées de livres, de bandes dessinées ou de films (par exemple The Secret Garden en 1989, Billy Elliot en 2005, A Christmas story en 2012), qui peuvent être à leur tour adaptées pour le grand écran (Annie, créée en 1976, adaptée en 1982, 1999 et 2014, Matilda, créée en 2010, adaptée en 2022). Ces spectacles à gros budget et de plus en plus exigeants pour les enfants ont été créés dans plusieurs pays, mais très rarement en France, où le genre connaît pourtant un succès public notable. Ils font désormais l’objet de recherches interdisciplinaires dans le monde anglo-saxon, où le travail émotionnel est l’un des concepts mobilisés pour comprendre le succès des enfants acteursLe travail émotionnel, un concept développé par la sociologue Arlie R. Hochschild, englobe tout ce qui consiste à maîtriser l’expression de ses émotions et celles d’autrui, notamment dans les métiers du service : cela implique pour le travailleur d’être en contact avec le public, de devoir produire un état émotionnel chez l’autre, et d’être incité par un employeur à contrôler ses émotions, par exemple en souriant au client indépendamment de ses propres émotions. On le trouvera appliqué aux enfants acteurs dans l’article de John F. Kasson « Behind Shirley Temple’s Smile: Children, Emotional Labor, and the Great Depression » dans James W. Cook, Lawrence B. Glickman et Michael O’Malley, The Cultural Turn in U. S. History: Past, Present, and Future, Chicago, University of Chicago Press, 2008.. En France, leur disparition progressive du spectacle vivant, en particulier du théâtre pour la jeunesse, est plutôt associée par les chercheurs à la modernité d’un art de dramaturges éducateurs, qui excluent les enfants de la scène parce qu’ils refusent de les exploiter, et parce qu’à leurs yeux un enfant ne peut pas être un véritable acteurLe refus d’avoir recours à des enfants acteurs pour des spectacles professionnels est ainsi mentionné en toutes lettres dans la Charte du Théâtre pour le jeune public (1967). Cet extrait d’un article de 1973 donne un bon aperçu de ce que pouvait être la perception des artistes de l’époque, appuyés par des psychologues : « Cette participation de l’enfant en qualité d’acteur [professionnel] est aujourd’hui rejetée par la quasi-totalité des spécialistes […] Cependant tenir un rôle reste possible à l’enfant dans le cadre du jeu dramatique [dans un cadre pédagogique]. À cette occasion, en effet, l’enfant ne joue pas pour le public mais pour lui-même dans une relation dynamique à d’autres participants. Cette forme dramatique, excluant le cabotinage et l’imitation servile des adultes, faciliterait au contraire une libération de l’expression spontanée des enfants. » Hélène Gratiot-Alphandery, Fulvia Rosenberg, Elizabeth Chapuis, « Le théâtre pour enfants » in Enfance, numéro spécial, 1973..
Les raisons de ce décalage sont d’abord d’ordre historique. La France du xixe siècle est l’un des premiers pays à avoir interdit la présence d’enfants sur scène pour des raisons d’ordre essentiellement moral, réservant à l’État le droit de délivrer des autorisations. Cela entraîna le déclin des troupes d’enfants, où de jeunes comédiens interprétaient des rôles de tous les âges et parfois d’un autre sexe. Au Royaume-Uni, malgré de nombreuses exceptions, les femmes n’ont eu le droit de se produire sur scène qu’en 1660, leurs rôles étant jusqu’alors interprétés par des garçons ou des hommes dont c’était la spécialité. Cette interdiction est l’un des facteurs à l’origine d’une tradition changeante mais ininterrompue d’enfants acteurs.
Il existe également des différences notables dans la formation des enfants : l’économie des comédies musicales, que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, repose en partie sur l’achat de licences pour leur réadaptation en milieu scolaire, tandis qu’en France la formation artistique se fait essentiellement hors de l’école. À Paris, les conservatoires séparent encore strictement le théâtre, la musique et la danse, avec des âges d’initiation qui varient du simple au double : on y commence la danse vers l’âge de cinq ans, mais le théâtre à onze. Cette spécificité génère des difficultés de recrutement pour les comédies musicales jusque chez les adultes. Enfin, les raisons de l’absence de grandes productions mettant en scène des enfants sont d’ordre économique : les lois sur le travail des enfants du spectacle étant plus restrictives en France que dans d’autres pays, les coûts de production d’une comédie musicale comme Billy Elliot ou Matilda y seraient plus élevés qu’à Londres ou New-York. Les principales différences portent sur la rémunération, les conditions d’éducation, mais aussi sur le volume et les plages horaires de travail autorisées, qui nécessitent de recruter trois à quatre enfants alternant pour un même rôle à Londres ou à Paris, contre un enfant par rôle à New-York. Cela n’empêche pas pour autant des enfants de se produire professionnellement sur scène en France, mais davantage dans des chorales, des groupes musicaux ou à l’opéra qu’au théâtre. En outre, le succès des deux côtés de l’Atlantique d’émissions télévisées visant à révéler ou sélectionner des enfants dont les réalisations sont présentées comme extraordinaires, montre que les attentes du public ne sont pas radicalement différentes d’un pays à l’autre.
Le parcours des enfants du spectacle s’écarte de la voie généralement imposée aux mineurs, entre vie familiale et instruction obligatoire, et il suscite donc des réponses et des attentes de la part des productions, des pouvoirs publics et des spectateurs. Leur existence même impose de repenser ce qui distinguerait l’incompétence enfantine de la compétence adulte, la formation et le loisir du travail, l’exposition médiatique de la célébrité, l’authenticité de la performance. On pourrait se borner à comparer les expériences de ces acteurs avec celles d’autres enfants, à expliciter les différences induites par le genre, la racialisation ou la classe sociale, et militer pour davantage d’égalité entre les mineurs. C’est un travail indispensable pour permettre à tous ceux qui souhaitent recevoir une formation artistique de qualité de pouvoir le faire, mais aussi renouveler les informations dont nous disposons sur les enfants, diversifier les méthodes, et offrir d’autres points de vue sur eux que ceux offerts par la biologie et la psychologie. Cependant, il présenterait absolument les mêmes limites qu’un travail consacré aux femmes comédiennes qui ne s’interrogerait jamais — et ne les interrogerait jamais — sur la manière dont leur expérience peut différer de celle des hommes, sur les éventuelles inégalités qui peuvent exister, et sur la manière dont ces différences impactent également les hommes. Constater, lorsque c’est le cas, qu’il existe des différences biologiques entre les membres de différentes classes d’âge ne doit pas empêcher d’observer les différentes manières dont ces âges se performent, au sens où l’entend Judith Butler pour le genreJudith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. Cynthia Kraus. Paris, La Découverte, 2005. « Il ne faudrait pas concevoir le genre comme une identité stable ou lieu de la capacité d’agir à l’origine des différents actes ; le genre consiste davantage en une identité tissée avec le temps par des fils ténus, posée dans un espace extérieur par une répétition stylisée d’actes. L’effet du genre est produit par la stylisation du corps et doit donc être compris comme la façon banale dont toutes sortes de gestes, de mouvements et de styles corporels donnent l’illusion d’un soi genré durable. ». De même que l’injonction à répondre aux critères d’une masculinité idéale peut être contraignante pour les hommes, la domination des adultes sur les enfants impacte bien évidemment les enfants, mais aussi les adultes eux-mêmes. Ainsi, l’âgisme peut être utilisé pour limiter les solidarités entre êtres humains, par exemple en défendant l’idée qu’un adulte est, contrairement à un enfant, nécessairement capable d’être autonome et devrait donc se suffire à lui-même. Travailler sur les enfants en faisant abstraction des autres classes d’âge, et sans comprendre que les stéréotypes qui leur sont associés sont interdépendants, c’est se priver de perspectives d’analyse. Pour qui s’intéresse aux jeunes acteurs de comédie musicale, comparer, c’est se demander dans quelle mesure leurs expériences se rapprochent de celles d’autres acteurs de tous les âges, ou au contraire en quoi elles sont spécifiques à leur classe d’âge, et comment ces spécificités évoluent au fil du temps. C’est aussi s’interroger sur ce qu’elles doivent à l’action réfléchie des productions, des autorités ou du public pour modifier ces expériences, afin de les rendre plus compatibles avec l’idée qu’ils se font de l’enfance, et surtout des prérogatives des adultes. Qu’est-ce qui, dans la vie de ces enfants, dérange les adultes ? Qu’est-ce qui les laisse absolument indifférents, et pourquoi ?
Comme on ne naît pas enfant acteur, nous allons d’abord nous demander comment ces enfants peuvent le devenir, en particulier lorsque les sociétés dans lesquelles ils vivent sont réticentes à les voir travailler. Nous allons ensuite analyser comment les productions communiquent auprès des autorités et du public pour montrer qu’elles s’adaptent aux spécificités biologiques des enfants, mais aussi qu’elles participent au maintien des normes qui définissent leur rôle social, afin qu’ils restent « des enfants comme les autres ». Nous allons enfin montrer comment, pour des raisons structurelles, les carrières professionnelles des enfants s’arrêtent souvent à la puberté, et comment la solidarité émergente offerte aux adultes issus de minorités peine encore à les atteindre.
On ne naît pas acteur, on le devient : entre incroyable talent, formation et reproduction sociale
À mesure que les adultes ont réduit les inégalités entre eux, notamment avec l’abolition de l’esclavage et l’accès de tous les adultes au droit de vote, ils se sont construits et continuent de construire une identité commune, fondée notamment sur la croyance que leurs compétences intellectuelles et émotionnelles seraient meilleures que celles des enfants. Dès lors, le succès d’enfants sur scène a pris des allures de paradoxe. Pourquoi des agents économiques aussi rationnels que des adultes dépensent-ils de l’argent pour voir performer des enfants acteurs, puisque les comédiens adultes sont forcément meilleurs ? C’est un sujet sur lequel le monde du théâtre s’interrogeait déjà au xixe siècle, et l’émergence des lois pour limiter la présence des enfants est liée non seulement au désir de les protéger de l’exploitation, mais aussi à celui de limiter la concurrence entre acteurs, en particulier lors des périodes de crise économique. Et si ce que le public venait chercher, ce n’était pas au contraire quelque chose qu’il associe à l’enfance, comme l’innocence, l’imperfection, l’imprévisibilité, et le sentiment de proximité amusée qui en découle ? Cette quête d’authenticité sur scène s’appliquait davantage à d’autres époques qu’à la nôtre, tant les vidéos de jeunes enfants filmés dans leur quotidien circulent aujourd’hui facilement, et répondent à cette demande. Les enfants acteurs de comédies musicales sont au contraire sélectionnés pour leurs compétences, leur capacité à suivre les ordres de la production, et leur apparence : ils sont souvent recrutés pour interpréter des enfants plus jeunes. Ces derniers sont écartés comme acteurs, et parfois aussi comme spectateurs, précisément parce que les productions craignent qu’ils ne perturbent le déroulement de la représentation. Ainsi, les représentations de Matilda, dont l’héroïne entre à l’école primaire, sont interdites au moins de quatre ans, et un numéro entier de Mary Poppins a dû être réécrit parce que des enfants colériques y étaient condamnés à mort par leurs jouets, suscitant la terreur de jeunes spectateurs.
Ce sont donc des enfants compétents, des professionnels, que le public vient voir se produire. Mais d’où viennent ces compétences ? Si bien des questions liées à l’enfance sont dépolitisées au profit d’une analyse exclusivement psychologique, celle de l’origine des différences entre les compétences des enfants, fruits de dons exceptionnels, d’un travail acharné ou d’un milieu social particulier, fait régulièrement l’objet de travaux dans d’autres disciplines. Dans le milieu du spectacle, la notion de talent reste primordiale : elle fait partie de la manière dont les productions communiquent sur les artistes, et elle est à l’origine d’une partie de la fascination que les jeunes acteurs exercent sur les adultes. Dans le même temps, il peut être très important de maintenir l’illusion qu’il faut avoir du talent, mais pas de formation ou d’expérience particulière pour se présenter à un casting : celui-ci devient alors un événement en soi, destiné à faire parler de l’œuvre et à impliquer les futurs jeunes spectateurs. Ainsi, la recherche des interprètes des deux premières adaptations cinématographiques d’Annie parmi plusieurs milliers de fillettes a débouché sur le recrutement de deux jeunes actrices qui avaient déjà joué à Broadway, et disposaient donc déjà d’une première expérience professionnelle en lien avec le projet.
Que l’on croie ou non à l’existence du talent, qu’on le pense indispensable ou qu’on estime au contraire que le travail et le réseau professionnel suffisent à la réussite, il n’en reste pas moins que tous les acteurs ont des compétences à acquérir pour pouvoir se produire dans un spectacle, et cette acquisition a un coût, à la fois en temps et en argent. Il peut être financé par la collectivité, avec ou sans sélection des enfants qui participent aux spectacles. Soucieux de démocratiser l’accès à leurs cours, les conservatoires parisiens choisissent désormais leurs élèves débutants sur tirage au sort, mais interdisent l’inscription dans plusieurs disciplines à la fois. Les maîtrises d’Île-de-France, quant à elles, pratiquent en règle générale une sélection à l’entrée, mais d’autres structures font exception. C’est notamment le cas du Créa, à Aulnay-sous-Bois, qui ne sélectionne pas les enfants qui participent à ses comédies musicales : son rôle est d’offrir une formation et un objectif commun à tous ceux qui ont le désir de se produire sur scène. Les productions du Créa, même adoubées par des artistes de grand talent — par exemple Les Indiens sont à l’Ouest, joué au théâtre du Châtelet — sont d’excellente qualité, mais ne sauraient être comparées aux productions professionnelles anglo-saxonnes. De même, à Londres, la production de Billy Elliot, par le biais de son Billy Youth Theatre program, a proposé des versions de la comédie musicale adaptées aux jeunes amateurs, et invité certains des groupes à se produire à Londres lors de galasHelen Freshwater, « Consuming Authenticities: Billy Elliot the Musical and the Performing Child », The Lion and The Unicorn, 2012, 36, p. 154-173.. La formation des enfants peut aussi être financée par les familles elles-mêmes, dans des structures spécialisées, soit parce qu’elles sont renommées, soit parce qu’une telle formation n’existe pas dans les structures publiques : c’est par exemple le cas à l’Aicom en France, et surtout dans des écoles comme le National Youth Theatre ou la Sylvia Young Theatre School et ses 5 000 livres de frais de scolarité annuels, dont sont issus une part conséquente des enfants des planches du West End.
Depuis quelques années, plutôt que de risquer de rechercher en vain des enfants déjà formés, certaines productions ont créé leurs propres écoles, notamment à Paris, Vantage Prod avec la « Fletcher Academy » pour Bodyguard et Stage Entertainment avec « l’école du Roi Lion », en partenariat avec le cours Florent. Les enfants sont alors entraînés, en général gratuitement, pour acquérir les compétences associées à un rôle, qu’ils obtiendront ou non après un casting final. Le vocabulaire utilisé par les productions est celui de la formation et du loisir. Cela leur permet de s’affranchir des législations sur le travail des enfants, de l’aval de la commission des enfants du spectacle, mais aussi de limiter les risques de voir muer ou grandir les enfants entre le casting et la première. Ceux-ci ne sont donc ni rémunérés ni défrayés pour ces heures qui ne sont officiellement pas des répétitions.
Rassurant pour les autorités comme pour le public, le lexique de la formation permet, dans le monde du spectacle comme ailleurs, de normaliser le travail gratuit des enfants. La France ne produit guère de comédies musicales dont les personnages principaux sont des enfants malgré son goût pour les contes musicaux (Émilie Jolie, Le Soldat rose), mais l’un des phénomènes les plus comparables qu’elle ait pu connaître en la matière est le succès du film Les Choristes, en 2004. L’association des Petits Chanteurs de Saint-Marc, à l’origine de la bande originale du film, a ensuite donné des concerts dans le monde entier. Au-delà de leur performance vocale, leur succès s’explique parce que les spectateurs n’allaient pas seulement écouter un programme. Ils allaient voir des enfants — et en particulier un soliste, Jean-Baptiste Maunier, également présent dans le film — qu’ils pouvaient associer à une histoire. Les producteurs du film avaient passé un partenariat avec l’association, sans engager les artistes individuellement. Il s’en était suivi un procès opposant l’association à la Direction départementale du travail, au cours duquel il avait été jugé que, les spectacles entrant dans un cadre pédagogique, le droit du travail n’avait pas à s’appliquer aux chanteurs. Le succès des Choristes a attiré l’attention du public sur l’association, mais sa situation était en réalité assez commune : selon un rapport de 2005, sur 24 maîtrises contactées au cours de la rédaction, 22 ne rémunéraient jamais les enfants et une seule réalisait des bulletins de salaire à leur intentionOlivier Enguerard, Les maîtrises, forme d’avenir d’enseignement musical ?, rapport de 2005 pour l’Institut français d’art choral, https://artchoral.org/wp-content/uploads/2010/02/RapportMaitrise2.pdf.. Si certains chœurs et maîtrises ont une vocation essentiellement religieuse, d’autres, laïcs, sont en résidence ou attachés à des institutions prestigieuses, où les enfants se produisent (opéras de Paris, de Lyon, de Marseille, Philharmonie de Paris, théâtre du Châtelet, etc.). Lorsque Les Choristes ont été adaptés en comédie musicale en 2017, les producteurs devaient trouver trois groupes de quinze enfants, et craignaient de ne pas recevoir l’indispensable autorisation de la préfecture : ils ont renoncé à auditionner les enfants séparément, et ont préféré faire appel à ceux de la maîtrise des Hauts-de-Seine.
Au cours des dernières années, quelques préfectures ont souhaité faire appliquer plus strictement la loi, et plusieurs structures produisant plus de six spectacles payants par an ont été invitées à demander des licences d’entrepreneurs de spectacle. Cela a eu pour effet de mettre en difficulté des institutions comme les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, dont les responsables s’estiment relever davantage de l’éducation populaire que de l’entrepreneuriat. Ils avaient expliqué que leur modèle économique ne permettait pas de pouvoir respecter les jours de repos des jeunes chanteurs en tournée, ou de leur verser des cachets pour chaque prestation : ce sont au contraire les revenus des concerts qui permettaient de diminuer les frais de scolarité des enfants. Dans le cas de ces institutions, la formation n’était pas le prétexte à une première sélection avant des répétitions rémunérées et des concerts payants, mais bien un mode de fonctionnement qui n’est rien d’autre aux yeux de ses promoteurs qu’une forme d’éducation.
Pour pouvoir s’implanter en France et répondre à des besoins de formation auxquels les institutions publiques ne peuvent pas s’attaquer, certains producteurs de comédie musicale ont donc réemployé le vocabulaire de la formation et de l’expérience personnelle, déjà mobilisé par les chorales et les maîtrises. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas créé ces éléments de langage : ils sont mobilisés de longue date pour légitimer une scolarité obligatoire des enfants sans contrepartie, et depuis plus récemment pour moins payer les jeunes adultes en formation, transformant l’acquisition réelle ou supposée de compétences en substitut de rémunération. Dans le même temps, laisser la formation des jeunes acteurs à la seule initiative privée, c’est la conditionner aux ressources familiales, la participation d’enfants à des spectacles vivants ne devenant ainsi qu’une expérience parmi d’autres, un loisir onéreux, accessible aux classes favorisées. En définitive, dans le milieu du spectacle comme ailleurs, la distinction entre formation et travail, éducation et exploitation, ne dépend pas tant des caractéristiques de la pratique artistique des enfants que de la perception qu’en ont les autorités, le monde du spectacle et le public. Si leur soutien est plus facilement acquis lorsque la formation est mise au premier plan et que le succès public reste modeste, d’autres facettes des expériences des jeunes acteurs suscitent la critique, parce qu’elles sont réputées anormales ou trop difficiles à vivre pour des enfants.
Des enfants dans un « monde d’adultes » ? Repenser les spécificités enfantines
Une fois le recrutement des enfants contrôlé et validé par l’administration publique, les productions vont devoir s’adapter. D’une part, les particularités biologiques des enfants doivent être prises en compte. D’autre part, la fascination exercée par les enfants sur le public doit être pondérée : pour pouvoir être exceptionnels, il faut qu’ils restent « des enfants comme les autres ».
Si les règles qui régissent le travail artistique des enfants sont différentes de celles des adultes, c’est en partie parce qu’il existe entre eux des différences objectivables, à commencer par leurs voix. La voix qui apparaît après la mue est plus grave et plus puissante que celle de l’enfant. Pour compenser cet écart, de nombreuses institutions musicales de l’époque moderne, chapelles princières ou chœurs de cathédrales, employaient simplement davantage d’enfants chanteurs que d’adultes, dans un contexte où le chant spirituel, comme parfois le théâtre, pouvait être interdit aux femmes. Pour beaucoup de leurs chefs de chœur, leurs voix étaient éphémères, mais pas inachevées : elles avaient atteint un niveau d’excellence, ou au contraire conservé une forme de complétude originelle qui les rapprochait de la virginité, comme en témoigne encore le terme anglais unbroken voice pour désigner une voix qui n’a pas mué. Au demeurant, dans les sociétés préindustrielles, la puberté était pour des raisons environnementales plus tardive qu’elle ne l’est aujourd’hui et la mue n’arrivait parfois qu’à dix-sept ou dix-huit ans, si bien que les voix de ces jeunes chanteurs les plus experts ne sont pas comparables à celles des enfants d’aujourd’hui. L’emploi d’enfants plus nombreux ou de chanteurs plus âgés existait également au théâtre avant la sonorisation, avec des renforts chantant depuis les coulisses. On en trouve encore des traces aujourd’hui. Plutôt que d’employer de très nombreux enfants comme cela peut être le cas dans Oliver, les créateurs de Matilda ont par exemple choisi d’employer de jeunes adultes pour interpréter une partie des écoliers.
Les producteurs doivent donc veiller à ne pas altérer, parfois définitivement, les capacités vocales ou physiques des enfants. Ainsi, lors de sa création, Annie provoqua une petite révolution en mettant en scène un rôle-titre pratiquant le belting, une technique vocale désormais répandue dans la pop, qui donne davantage de puissance à la voix de poitrine. Alors inhabituelle dans le domaine de la comédie musicale pour des enfants, elle a été accusée d’abîmer leur voix davantage que la technique lyrique, et les avis divergent toujours à ce sujet. Elle est de ce point de vue très différente de la tradition chorale anglo-saxonne et son goût pour la voix de tête, que l’on pouvait par exemple trouver dans Oliver, où elle est utilisée pour mettre en valeur la pureté, l’impuissance et l’espoir des jeunes personnages. Plus de vingt ans après, de l’autre côté de l’Atlantique, les producteurs de Billy Elliot, un spectacle particulièrement exigeant sur le plan chorégraphique, puisqu’il raconte l’histoire d’un fils d’ouvriers passionné de danse classique qui finit par entrer au Royal Ballet, ont au contraire communiqué sur leurs efforts d’adaptation aux différents jeunes interprètes. Ils ont modifié, en particulier pour la première génération d’acteurs, âgés de treize à quinze ans, les chorégraphies, selon qu’ils soient issus du monde de la danse classique ou de celui de la gymnastique, ainsi que certaines notes afin de préserver leur voix. Cela n’a pas empêché l’un des créateurs du rôle de vomir en coulisses lors du premier filage, ou d’abandonner le Royal Ballet, où il étudiait, faute de pouvoir concilier cette formation de danseur classique énergivore et peu compatible avec sa participation à Billy Elliot.
Un autre risque concerne les violences physiques ou sexuelles dont les jeunes acteurs peuvent être victimes. Il s’agit d’un sujet en soi, dont les problématiques sont à rapprocher de celles d’autres univers extra-familiaux (école, sport, etc.), mais qui a ceci de particulier qu’historiquement le théâtre a longtemps été associé à un lieu de débauche et de prostitution. Il serait trop long à aborder ici. Indiquons seulement que cela touche aussi massivement les jeunes femmes et que, comme dans d’autres secteurs professionnels, les langues se délient : à l’heure où ces lignes sont écrites, l’un des anciens professeurs de chant d’une des principales écoles de comédie musicale de France est accusé d’avoir abusé de plusieurs adolescents.
Face à ces craintes, il s’agit donc de donner à voir des enfants dont, à bien des égards, la vie n’aurait pas changé. Qu’ils soient ou non sur les planches, ils doivent poursuivre leur instruction, ce qui peut leur imposer des journées de travail plus importantes qu’à des acteurs adultes. Selon qu’il s’agisse ou non de tournées, du nombre d’enfants concernés, et de l’obligation ou non pour les parents des enfants d’être présents, les productions peuvent engager des tuteurs ou travailler en partenariat avec les écoles d’origine. Pour les enfants qui partagent un rôle, et qui sont alors au théâtre deux à quatre soirs par semaine, il est plus fréquent de continuer une scolarité classique, ce qui impose de les recruter ou de les loger dans un périmètre proche de celui du lieu de représentation. De plus en plus souvent, les enfants doivent théoriquement maintenir un bon niveau scolaire pour pouvoir se produire. Le maintien de la scolarité dans l’école d’origine peut avoir des avantages en matière de sociabilisation, mais pas toujours, le succès des enfants ou leur simple intérêt pour les arts pouvant en faire des cibles de harcèlement. L’intérêt d’une scolarité dans un établissement spécifique, outre les moyens de formation artistique, repose aussi sur les échanges entre enfants, qui vivent des expériences professionnelles similaires. Au-delà de leur rôle dans l’instruction, les écoles peuvent aussi avoir un rôle de validation ou de prévention : le système d’autorisation préalable, qui existe aussi bien en France qu’au Royaume-Uni ou à New-York, comporte un volet pédagogique obligatoire. L’école et l’administration éducative peuvent donc s’opposer à l’embauche d’un enfant si elles n’ont pas de temps à consacrer aux formalités ou à l’aménagement de sa scolarité. En France, le ministère autorise l’existence de classes à horaires aménagés accessibles sur sélection, mais uniquement pour les élèves attachés à une institution partenaire. L’État reconnaît donc qu’il est possible de réaliser une scolarité accomplie avec un volume horaire d’enseignement inférieur à celui qu’il impose ordinairement, mais qu’il n’offre cette possibilité qu’à des élèves qui utilisent le temps ainsi libéré pour pratiquer des activités approuvées par lui.
Lorsque des enfants participent à un spectacle à gros budget, à plus forte raison lorsqu’ils interprètent le rôle principal, ils sont très sollicités par le public et les médias, signant des autographes, donnant des interviews et se produisant lors de manifestations extérieures au spectacle, par exemple à la Maison-Blanche ou lors d’émissions télévisées caritatives. La médiatisation peut commencer dès le casting lorsque celui-ci fait l’objet de reportages, ou même d’une télé-réalité. Ainsi, à Londres, en 2008, les producteurs d’Oliver ont créé I’d do anything, du nom d’un des titres de la comédie musicale, pour trouver non seulement le rôle principal féminin, tenu par une jeune adulte, mais aussi les trois enfants qui se partageraient le rôle-titre. Chaque semaine, la candidate la moins plébiscitée par le public était éliminée. Les producteurs ont expliqué avoir voulu protéger les enfants en se chargeant de leur sélection : au lieu de les éliminer un par un, ils choisissaient chaque semaine celui qu’ils voulaient voir accéder à la demi-finale, puis les trois vainqueurs. À bien y regarder, le sort des enfants n’était pas pour autant enviable : certes, aucun d’entre eux n’a vécu dans la crainte d’être désigné comme étant le moins apprécié des candidats, mais leur seule manière de passer à l’étape suivante était d’être le meilleur. Cependant, le spectacle nécessitant un grand nombre de jeunes garçons, tous les candidats étaient assurés d’y participer au moins comme figurants : c’est surtout sur ce point que différait le traitement des adultes et des enfants.
La médiatisation ne sert pas qu’à faire de la publicité : en montrant les jeunes acteurs dans leur quotidien d’artistes, mais aussi à l’école ou en famille, elle participe à rassurer les adultes en replaçant les enfants dans un cadre normatif commun à tous les membres de leur classe d’âge. Interviewer les parents, c’est leur donner la possibilité de renvoyer une autre image que celle de l’artiste raté poussant son enfant, un cliché qui existait déjà au xixe siècle, et de montrer qu’ils travaillent main dans la main avec les productions. Paradoxalement, si la médiatisation sépare plus encore le quotidien de ces enfants de celui de leurs pairs, elle est indispensable pour les présenter comme « des enfants comme les autres ». Matilda, adaptée du livre éponyme de Roald Dahl par Tim Minchin et Dennis Kelly, a ceci de particulier qu’elle émane d’une institution britannique majeure, la Royal Shakespeare Company, dont la célébrité en tant que corps dépasse, à la manière de la Comédie-Française, celle des comédiens qui s’y produisent. La production a révolutionné la communication autour des enfants acteurs, imposant que les quatre actrices qui se partagent le rôle-titre apparaissent le plus souvent possible ensemble pour la promotion de l’œuvre, et soient systématiquement interviewées simultanément. Elles ont également l’interdiction formelle de signer des autographes ou d’être prises en photo avec des fans. Si la Matilda qu’elles incarnaient a une intelligence supérieure, des pouvoirs télékinétiques et surtout l’intention très ferme de prendre son destin en main, les actrices n’ont pas eu leur mot à dire sur la manière dont la production a communiqué sur l’interdiction qui leur était faite de vivre certaines expériences associées à la célébrité. Dans le même temps, celles qui ont créé le rôle à Londres et New-York ont reçu respectivement un Olivier et un Tony Award commun, hors-catégorie, témoignant du respect de la profession pour leur travail autant que du désir de ne les mettre en concurrence ni avec des adultes ni entre elles. Sur le site de la production britannique, tous les jeunes acteurs, y compris celles qui interprètent Matilda, sont regroupés dans une catégorie intitulée « les enfants » à l’écart du reste de la distribution, et n’ont aucune photographie associée à leur nom. La protection des enfants est mise en avant par la production, mais ces choix lui permettent aussi de se poser en garant de la normalité de l’enfance des actrices, et donc de leurs intérêts. Loin de devenir une faiblesse, la loi britannique qui impose de recruter plusieurs enfants pour un même rôle, avec le risque que les journalistes et le public n’en préfèrent un devient une force. Elle limite drastiquement la capacité des actrices à avoir une notoriété à opposer à la production. Des précédents ont vraisemblablement inspiré les producteurs. Lors de la création d’Annie en 1977, dans un contexte où conformément au droit américain le rôle principal était assumé par une seule actrice, son remplacement in extremis avant l’arrivée à Broadway était passé relativement inaperçu. Le spectacle connut un succès fulgurant. Vingt ans plus tard, les producteurs remontant leur œuvre, et conscients de ce que son succès devait au désir de très nombreuses fillettes d’y participer, ont transformé en événement national le casting du rôle-titre, notamment par le biais d’émissions de télévision et d’un partenariat avec les magasins Macy’s, connus pour être à l’origine d’une parade de Thanksgiving qui sert de vitrine à différents spectacles. Là encore, juste avant d’atteindre New-York, ils ont remplacé l’actrice principale, atteinte de bronchite, par l’une des actrices secondaires qu’ils avaient entraînée. Mais la notoriété de l’enfant évincée, la publicité de la sélection dont elle avait fait l’objet lui ont permis de faire reconnaître le préjudice qu’elle avait subi : pour éviter un procès en appel, l’affaire s’est réglée en dehors des tribunaux.
« Je ne pensais pas atteindre le sommet de ma carrière à dix ansExtrait du témoignage de Kristi Coombs tiré du documentaire Life after Tomorrow. Sa réalisatrice, Julie Stevens, actrice de la première génération d’enfants d’Annie, interviewe plusieurs dizaines d’anciennes participantes de ses différentes versions. Parmi les plus marquées par leur licenciement figurent en particulier celles qui partaient en tournée à travers l’Amérique, accompagnées par l’un de leurs parents, qui pouvait avoir été engagé comme figurant pour l’occasion. C’était donc l’ensemble de leur quotidien qui avait été bouleversé, et ne tournait plus qu’autour du spectacle. » : où grandir n’est pas une bonne nouvelle.
Dans une société aussi centrée sur les adultes que la nôtre, les discours produits à l’attention des jeunes enfants associent la croissance physique et l’acquisition de compétences à un verbe très utilisé et très valorisé : grandir. Que ce soit en français ou en anglais, les enfants sont incités à se conduire « comme des grands » et non « comme des bébés ». Un adulte faisant preuve d’un comportement indésiré pourra, lui, être accusé de « faire l’enfant », achevant ainsi d’essentialiser l’une et l’autre catégorie. Ces formulations comparatives, si elles ont le don de normaliser l’âgisme chez les plus jeunes, les informent aussi que le meilleur des comportements ne les fera pas changer de statut. Celui-ci dépend avant tout d’une date de naissance, sur laquelle ils n’ont aucun contrôle, bien qu’elle détermine l’ensemble de leurs droits ainsi qu’un certain nombre d’attentes sociales. Ces discours ont un impact sur la formation et l’expérience des jeunes acteurs. Tout d’abord, ceux qui sont sélectionnés pour interpréter des enfants plus jeunes sont en général plus petits que les enfants de leur âge, et tous ont une excellente mémoire : sur les planches ou non, leur expérience de l’enfance revêt déjà une forme de singularité. Dans un milieu où leur succès peut susciter des jalousies auprès des autres comédiens, ils sont également formés à réprimer des comportements associés à l’enfance, et donc au manque de professionnalisme. « What don’t we want to be? » demande Sylvia Young, faisant visiter à un journaliste son école spécialisée. « Stage brats« Qu’est-ce que nous ne voulons pas être ? » « Des sales gosses des planches ! »! » répondent les élèves en chœur. Surtout, grandir physiquement, muer, est associé pour beaucoup d’entre eux à la fin de l’activité professionnelle : tandis que des enfants prépubères viennent les remplacer, de jeunes adultes aux conditions de travail plus favorables pour les producteurs interprètent les adolescents de l’âge qu’ils vont atteindre. Leur date de naissance détermine le début de leur employabilité, mais c’est la transformation de leur corps qui déterminera leur date de sortie. Selon l’entourage dans lequel ils grandissent, ils peuvent avoir des croyances plus ou moins marquées sur le talent, ou la juste récompense qui viendra couronner le travail et l’obstination, et une pression liée aux éventuels sacrifices consentis par leur famille. Mais contrairement aux jeunes sportifs, qui doivent produire des résultats objectivables et savent qu’ils auront plusieurs vies professionnelles, de jeunes comédiens qui doivent plaire pour être employés et se produisent aux côtés d’acteurs de tous âges qui pratiquent le même métier, s’ils ne sont pas correctement informés, n’ont aucune raison de penser, d’une part, qu’ils sont en réalité des acteurs spécialisés dans les rôles d’enfants, avec un corps qui se prête particulièrement bien à leur interprétation, et, d’autre part, que leur carrière ne dépassera peut-être pas l’enfance. Contrairement à tous ceux de leurs pairs à qui on demande « ce qu’ils veulent faire quand ils seront grands », ils font déjà ce qu’ils ne voudront peut-être jamais cesser de faire par la suite, ou ce sur quoi, quoi qu’ils fassent plus tard, on n’aura de cesse de les interroger toute leur vie. L’adolescence arrivée, commence alors pour une partie d’entre eux un no man’s land professionnel plus ou moins long, qui n’en empêche pas certains de poursuivre leur carrière à l’âge adulte.
Les difficultés psychologiques ou addictologiques auxquelles peuvent être confrontés les jeunes acteurs après la fin de leur carrière sont souvent expliquées par un jeune âge qui les rendrait inaptes à vivre les contraintes de la célébrité autant qu’à en supporter la fin. C’est invisibiliser les facteurs extrinsèques qui causent ces situations, en particulier ceux liés à l’âgisme des sociétés dans lesquelles ils vivent. D’autres groupes d’acteurs, notamment les femmes au-dessus de quarante ans, vivent des situations similaires. À notre connaissance, personne n’a encore attribué à la ménopause la colère ou les dépressions qu’elles peuvent traverser, estimé qu’on n’a pas vraiment mené une carrière d’actrice si on n’est pas sur les planches jusqu’à soixante-dix ans, ou encore proposé de les empêcher de se produire pour qu’elles n’aient pas à vivre ce moment traumatique. Quant aux minorités racisées, les initiatives développées en particulier aux États-Unis pour éviter leur discrimination, que ce soit via un blind cast ou en assurant à ces acteurs le monopole de certains rôles, ne semblent pas devoir pour l’instant s’étendre à l’âge. À l’opposé, les événements dont le principe est de permettre à des artistes de chanter des rôles qui ne leur seraient traditionnellement pas accessibles, comme le Miscast gala à New-York, permettent le temps d’une soirée à des enfants d’interpréter des rôles d’un autre âge ou d’un autre sexe, et avec eux un éventail d’émotions qui n’existe pas toujours dans les rôles qui leur sont proposés.
La meilleure manière de s’assurer que ces enfants puissent se remettre des aspects les plus difficiles de leur métier, c’est de leur offrir un soutien psychologique tout au long de cette expérience et de les rémunérer suffisamment, toutes choses bénéfiques aux acteurs et aux célébrités tous âges confondus. Là encore, la solidarité des adultes fait parfois défaut. Si l’on exclut le cas des artistes qui, comme on l’a vu plus haut, sont susceptibles de se produire gratuitement dès lors que le spectacle fait partie de leur formation, la rémunération des enfants du West End est particulièrement problématique, comme celle de tous les jeunes acteurs du Royaume-Uni. Déjà en 2009, la British Actors’ Equity, le principal syndicat d’acteurs, dénonçait le cachet dérisoire des 150 enfants qui jouaient de petits rôles dans Oliver : 20 livres par représentation, pour un spectacle qui en a rapporté 15 millions. Contrairement à la France, qui impose le paiement du smic horaire minoré jusqu’à 20 % ou de la somme prévue par la convention collective, la loi britannique exclut les moins de seize ans de l’accès au National Minimum WageNotons que le smic ne devrait par définition pas être minorable, et que le National Minimum Wage devrait désigner le salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. Le fait que ce ne soit pas le salaire minimum qui soit appelé salaire minimum, mais le salaire minimum applicable aux adultes, fait partie de ces impensés lexicaux qui témoignent de la difficulté du législateur à concevoir la loi en prenant en compte l’existence de l’ensemble de la population.. Cette situation est en partie liée au poids économique de certains employeurs — Cameron Mackintosh, producteur d’Oliver, et propriétaire de différents théâtres dont celui où se joue Matilda, est aujourd’hui milliardaire — mais aussi à l’absence d’interlocuteur légitime pour défendre les intérêts des enfants acteurs. La British Actors’ Equity estime qu’un salaire juste devrait être au minimum équivalent à 50 % de celui d’un adulte, ce qu’elle a réussi à imposer en 2021 pour la télévision. Présentant sur son site quelques points-clés sur la situation des acteurs en Grande-Bretagne, elle précise : « Women, black, South Asian, East Asian and minority ethnic, [LGBT], Deaf and Disabled and older artists continue to experience discrimination across the industry. » Contrairement aux personnes âgées, les enfants, même si leurs intérêts sont mieux pris en compte, ne sont pas considérés par le syndicat comme les victimes d’une discrimination âgiste, et pour cause : il refuse l’adhésion des moins de dix ans. L’impact que peuvent avoir les négociations syndicales sur le salaire et l’employabilité des jeunes acteurs est devenu encore plus flagrant pour le public britannique lorsque, quelques années après son triomphe à Londres, Matilda s’est exportée aux États-Unis : tandis que les actrices principales, qui doivent loger à moins d’une heure du centre de Londres, gagnaient 250 livres par semaine, leurs homologues new-yorkaises en recevaient 1 095. Côté américain, l’adhésion des enfants à l’AEA est possible, mais pas recommandée avant quatorze ans, en raison des restrictions qui s’imposent aux membres : s’ils bénéficient de privilèges en matière d’auditions, ils ne peuvent se produire que dans les spectacles dont les contrats répondent aux exigences du syndicat, et risqueraient de se fermer les portes d’une grande partie des productions susceptibles de les employer. Le revenu des actrices britanniques, bien loin de leur faire gagner de l’argent, ne suffit vraisemblablement pas à compenser les frais engagés par leurs familles, ce qui n’est qu’une facette de la fermeture progressive du secteur artistique aux classes populaires du pays. Pas toujours enclins ou en mesure de défendre les intérêts des jeunes artistes, les syndicats sont donc généralement impuissants face à la constante macabre qui les frappe à la puberté.
« There’s a kid in the middle of nowhere who’s […] singing and flipping along […] so we might reassure that kid, and do something to spur that kid, ’cause I promise you all of us up here tonight, we were that kid! » Le numéro d’ouverture des Tony Awards 2013 se termine par la promesse d’un métier accessible à ceux qui croient en leurs rêves, même s’ils doivent attendre l’âge adulte pour les réaliser. Pendant que des enfants s’agitent devant leur télévision, d’autres sont déjà sur les planches, cultivant l’espoir de ne pas voir leur carrière s’arrêter lorsque changera leur corps. Leurs conditions de formation, leurs rémunérations, leurs scolarités sont différentes selon les pays dont ils viennent, mais une chose ne change pas : ces jeunes acteurs, par leur existence même, transgressent des tabous adultes, en même temps qu’ils vivent des expériences tantôt spécifiques, tantôt communes à d’autres catégories de comédiens. Les écarter des chemins de plus en plus balisés de l’enfance impose à ceux qui les regardent se produire, les emploient et les protègent de se donner les uns aux autres des gages de bonne foi. Pour convaincre et se convaincre qu’ils n’exploitent pas des enfants dont ils ne sauraient se passer, les adultes s’adaptent : ils transforment les conditions de travail des acteurs, mais aussi et surtout leur communication. Tandis qu’il y a dix ans déjà les producteurs de Matilda en venaient à la conclusion que la meilleure manière de protéger un enfant célèbre était de faire comme s’il ne l’était pas, le succès des plateformes de partage de vidéos en ligne a depuis largement transformé l’économie de la célébrité : jadis cantonnée au théâtre, la scène peut désormais se trouver partout… et le travail des enfants aussi.
-
Gillian Arrighi, Victor Emeljanow (éds.), Entertaining Children: The Participation of Youth in the Entertainment Industry, New York, Palgrave MacMillan, 2014.
-
Donelle Rae Ruwe, James Leve (éds.), Children, Childhood, and Musical Theater, vol. 1, Studies in Childhood, 1700 to the Present, Milton, Routledge, 2020.
-
Laura MacDonald, Ryan Donovan (éds.), The Routledge Companion to Musical Theatre, Londres, Routledge, 2022.
-
Rekha S. Rajan, From Backpacks to Broadway: Children’s Experiences in Musical Theatre, Lanham, Rowman & Littlefield, 2016.
Pourquoi politiser l’enfance ? —
Suite aux accusations de pédocriminalité lancées par l’artiste Laurent Faulon à l’encontre de l’artiste Claude Lévêque, plusieurs œuvres lumineuses de ce dernier, installées dans l’espace publicAinsi Modern Dance (2015) à Montreuil, Illumination (2020) à Montrouge., sont éteintes. La philosophe de l’art Carole Talon-Hugon est invitée sur France Culture à réagir à ces initiatives et à répondre à la question de savoir s’il est « moralement admis de [les] regarderÉmission radiophonique « Est-il moralement admis de regarder une œuvre de Claude Lévêque ? », Affaire en cours, France Culture, 27 janvier 2021, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/ est-il-moralement-admisde-regarder-une-oeuvre-de-claude-leveque-6965467. Dans cet article, « l’enfant » sera genré au masculin car, outre qu’il s’agit moins d’enfants réels que de leurs représentations, dans les œuvres dont il sera ici question, il s’agit exclusivement de garçons. ». Elle rappelle d’une part la place de la transgression dans l’art contemporain (le monde de l’art s’est longtemps considéré en « extraterritorialité morale ») et historicise d’autre part la perception de la pédophilieL’usage du terme « pédophilie » a été remis en cause par des associations de protection de l’enfance et des organisations féministes au profit du terme de « pédocriminalité » car le premier élude le caractère criminel de l’acte. On le reprend ici car il s’agit de revenir sur la question du sens et de la valeur donnée à l’attirance sexuelle pour les enfants qu’il désigne étymologiquement. On le reprend également car il était employé dans les débats intellectuels par celles et ceux qui l’ont défendu comme par celles et ceux qui ont argumenté pour sa condamnation. dans la société qui, de « tolérée voire encouragée », est devenue « à raison insupportable ». Elle se demande ainsi à partir de quel moment l’œuvre d’un artiste accusé de pédocriminalité est « porteuse de cette charge négative ». Elle regrette qu’une « chaîne de contamination » ne communique la « malignité supposée de l’artiste » à l’œuvre puis à « ce qui permet l’exposition de l’œuvre » et qu’à la fin soient condamné·es celles et ceux qui regardent l’œuvre — démarche qui selon elle relève de la cancel culture et d’une « relecture intégriste de l’histoire de l’art ». On peut opposer à cette approche le texte puissant intitulé « Du ClaudeGwyneth Bison, « Du Claude », https://constantinalexandrakis.blogspot.com/2021/02/du-claude.html. » que Gwyneth Bison publie sur son blog et qui nomme la négativité dont il pourrait être question dans toute l’œuvre de Lévêque : la pédophilie. Il explique comment ce dernier était un de ses « artistes préférés quand [il] étai[t] aux Beaux-ArtsIbid. », parce qu’en son œuvre infuse « une vieille ambiance de vicelard, de dégoûté de la vie » qui l’a touché au point qu’il l’a alors contacté puis rencontré. Il aurait immédiatement reconnu de quoi il pourrait y être question, lui qui a été victime de pédocriminalité entre ses neuf et quatorze ans. Il explique que le pédophile, « exploit[ant] la sexualité naissante de sa proie », empêche la victime de se considérer comme telle. Bison interdit les postures de surprise et invite à considérer l’œuvre de Claude Lévêque comme intégralement marquée du sceau de la négativité : « Le type t’a dit en pleine face : je suis bad, vraiment vraiment vraiment bad, et toi, au mieux, tu n’as pas voulu le croire. Il faut assumer ça, dès maintenant, dès le départ. C’est très importantIbid.. »
Ces deux approches considèrent différemment l’œuvre de Lévêque. Talon-Hugon s’interroge sur la contamination dont souffre l’œuvre du fait de la personne de l’artiste et des doutes que la plainte déposée par Faulon soulève à son encontre. Elle sépare l’œuvre de l’artiste et semble distinguer différents types d’œuvres. La philosophe distingue les œuvres dont le contenu est répréhensible et celles pour lesquelles ce n’est pas le cas. Mais elle n’indique pas quelles œuvres relèvent d’une catégorie répréhensible. La qualification d’œuvres d’art contemporain de « pédophiles » voire de « pédopornographiques » est loin d’être évidente et elle peut être l’occasion d’une instrumentalisation politiqueComme nous le rappelle l’instrumentalisation par l’extrême droite de la peinture Fuck Abstraction de Miriam Cahn, exposée au Palais de Tokyo en avril 2023. Cf. Véronique Campion-Vincent, Comme un abus d’enfance, Le Seuil, 2008.. S’agirait-il alors de distinguer des œuvres pouvant être interprétées comme manifestant un tel penchant d’autres œuvres — qui alors ne présentent pas d’images d’enfants ou d’adolescentsCe type de distinction est sujet à débat et on ne se posera pas ici la question de savoir quel type d’œuvre non pédopornographique est ou serait « pédophile ». Certaines œuvres de Lévêque peuvent toutefois poser question, ainsi The Secret Life of Arabia (1976), Grand Hôtel (1982) ou d’autres encore qui impliquent des images d’enfants et/ou adolescents nus. L’œuvre Voyage au Cambodge de 2004, acquise par le FNAC en 2006, consiste en photographies en contre-plongée d’un enfant torse nu en différentes positions sur une table dont le plateau est une plaque de verre. Elle évoque la pédophilie par son titre, l’Asie du Sud-Est étant connue comme une des destinations prisées des pédocriminels. ? L’exercice n’est pas des plus évidents. Pour sa part, Bison lie l’œuvre et l’artiste et voit dans toutes les œuvres la manifestation d’une même intention. L’ancien étudiant en art rappelle qu’une œuvre vaut par les motivations qui la rendent possible et par les regards qu’elle appelle alors. Pour le dire en d’autres termes : par les valeurs qu’elle manifeste, que par conséquent elle transmet. Il s’agira dans ce texte de mettre en doute le bien-fondé des distinctions invoquées par la philosophe entre des œuvres qui seraient porteuses de ces charges négatives et d’autres qui ne le seraient pas. Comment d’ailleurs considérer que certaines auraient des charges « positives » ? La perception de la pédophilie par la société ayant changé, cette modification n’aurait-elle pas incité des auteurs (artistes, écrivains, photographes) la défendant à masquer leurs penchants ? N’auraient-ils pas joué avec leur aspect pour déformer non pas leur contenu expressif mais bien plutôt la perception qu’il est possible d’en avoir ? La présence de ce sens serait alors inaperçue, loin qu’il soit absent, au point que l’on pourrait doctement séparer certaines œuvres des accusations portées à l’encontre de leur auteur. Ce type de mécanisme permettrait d’expliquer que le contenu de l’œuvre de Lévêque n’aurait jamais varié et que nous n’aurions jamais saisi ce qu’elle aurait toujours formulé sous nos yeux, à la manière de la lettre « volée » de la nouvelle éponyme d’Edgar Poe. On se propose alors non pas d’effectuer une « relecture intégriste » de l’œuvre de Lévêque, mais de se demander ce qui y est représentéCette interrogation porte ainsi sur le sens de l’œuvre de Lévêque, et non pas sur la question de sa culpabilité face aux accusations lancées à son encontre. Alors que cet ouvrage est mis en page (août 2023), Claude Lévêque est mis en examen. L’enquête est toujours en cours. Claude Lévêque est présumé innocent. Cf. Roxana Azimi, « L’artiste Claude Lévêque mis en examen pour viols sur des mineurs », Le Monde, 23 juin 2023..
Après un retour sur la chronologie de « l’affaire Lévêque », nous concentrerons notre attention sur les figures de l’enfance que cet œuvre façonne et les valeurs qu’il incarne et transmet. Il s’agit de déjouer son inoffensivité de façade et de s’interroger sur les représentations alors produites, celles-là même qui l’ont motivé et qu’il défend. Nous envisagerons ces figures comme autant de mythes, compris à la suite de Roland Barthes comme l’union univoque d’un sens et d’une forme, pour autant que « le mythe ne cache rien et il n’affche rien : il déforme ; le mythe n’est ni un mensonge ni un aveu : c’est une inflexionR. Barthes, Mythologies, op. cit, p. 202. ». Nous nous interrogerons alors sur leur sens et leur fonction : dépolitiser l’enfance, c’est-à-dire à masquer les rapports de pouvoir dans lesquels elle est prise dans la société. Nous montrerons que les mythes de l’enfance à l’œuvre dans l’œuvre de Lévêque peuvent être compris comme ayant pour corollaire une tentative précise de politisation, celle défendue par des auteurs propédophiles. Nous expliciterons cette position à partir des écrits de René Schérer. À ce type de politisation de l’enfance qui domine l’enfant sous couvert de l’émanciper, nous opposerons l’approche défendue par Tal Piterbraut-MerxIl s’agit ici de poursuivre des réflexions commencées avec l’invitation faite à Tal Piterbraut-Merx d’intervenir dans mon cours d’esthétique dédié à la question des liens entre art et enfance, précisément en préambule à un cours sur l’œuvre de Claude Lévêque (Tal Piterbraut-Merx, « Politiser l’enfance », conférence donnée à l’ENSBA Lyon le 28 avril 2021, https://www.youtube.com/watch?v=xF6gSxKU7Zg)..
Accusation, soutiens
Publié le 10 janvier 2021, un article corédigé par Yann Bouchez et Emmanuelle Lequeux dans le journal Le Monde et intitulé « Le plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs » informe que le parquet de Bobigny a ouvert en 2019 une enquête judiciaire sur Claude Lévêque pour « viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans » suite aux accusations de Laurent Faulon, également artiste. L’article occupe une pleine page car en France l’artiste bénéficie d’une reconnaissance impressionnante, établie au fil d’une carrière de presque quarante ans. Il est largement soutenu par les institutions publiques de l’art contemporain françaises (il représente la France à la biennale de Venise en 2009) ainsi que par le marché de l’art (il fut représenté par les galeries françaises les plus importantes, notamment celles d’Yvon Lambert et de Kamel Mennour). Regrettant le peu d’empressement de la justice à ouvrir l’enquête, Faulon espérait que la révélation des faits accélérerait le traitement du dossier et que d’autres victimes prendraient également la parole. En effet, Lévêque a été très souvent vu en compagnie de jeunes garçons sur lesquels il semblait avoir un fort ascendant et dont il a éventuellement utilisé les images dans certaines de ses œuvres comme ce fut le cas pour Laurent Faulon et ses frères. L’article explique l’emprise que l’artiste a eu sur sa famille et les abus sexuels dont il a été victime entre ses dix et dix-sept ans. Dans un autre article, Faulon explique : « J’ai grandi dans un système de valeurs morales faussé, parce que les valeurs qui m’étaient offertes par Lévêque avaient pour but seulement de légitimiser ses actes. Depuis tout petit, il m’a fait croire que c’était ça l’amour, que c’était normal…Cité in Jean-Mathias Joly, « Le témoignage qui accuse Claude Lévêque de viols sur mineur : “Il faut parler pour qu’il y ait un procès », Le Journal du Centre, 21 janvier 2021. ». L’asymétrie de la relation enfant-adulte était alors notamment renforcée par le prestige de l’artiste contestataire, les opportunités d’ouverture culturelle et artistique qu’il offrait à Faulon et les promesses d’émancipation en lui faisant découvrir par l’art, la musique et les contre-cultures, des perspectives que son milieu ne lui aurait jamais permis de découvrir et pour lesquelles il se sentait redevable au point de devoir « payer de sa personne ». Faulon décrit une situation de prédation et une ascendance qui l’a conduit à associer « la pédophilie à une sorte de résistance à la sociétéYann Bouchez et Emmanuelle Lequeux, « Le plasticien Claude Lévêque accusé de viols sur mineurs », Le Monde, 10 janvier 2021. ». En dépit des menaces de l’avocat de Claude Lévêque « d’intenter toute action à l’encontre de toute personne lui portant directement ou indirectement atteinteRafael Pic, « Le Monde accuse Claude Lévêque, réponse exclusive de son avocat », Le Quotidien de l’art, 11 janvier 2021. », de nombreux autres articles sont publiés dans les jours et semaines qui suivent la parution du premier article. Ils révèlent l’ampleur des agissements délictueux de l’artiste (notamment par d’autres récits similairesMichel Deléan et Magali Lesauvage, « Pédocriminalité : plusieurs témoins accablent l’artiste Claude Lévêque », Médiapart, 13 janvier 2021.), le fait qu’il n’ait « jamais niéElizabeth Franck-Dumas, « Claude Lévêque “n’a jamais nié, il a été assez clair sur ce qui s’est passé », Libération, 13 janvier 2021. » ce qui lui était reproché, mais également l’aveuglement du monde de l’art tant nombre de personnes auraient pu relever le comportement trouble de l’artiste. Ses penchants pédophiles étaient également connus par nombre de personnesEmmanuelle Lequeux, « Tout le monde savait : Claude Lévêque, une omerta au nom de l’art », Le Monde, 16 janvier 2021.. Enfin, d’autres articles révèlent encore comment l’artiste, en contact avec des groupes d’enfants à l’occasion de résidences artistiques, tenta d’entrer en relations avec certains d’entre eux en dehors de ce cadre organisé, notamment par les contacts que son succès lui avait permis d’établirIl s’agit de résidences menées en 2005 et 2006 dans un hôpital psychiatrique des Yvelines organisées par le CNEAI, centre d’art contemporain alors à Chatou et, en 2012, dans une école du 20e arrondissement, organisées par l’association Reg’art. Elisabeth Franck-Dumas, « Affaire Claude Lévêque : les résidences de l’artiste sous un nouveau jour », Libération, 5 février 2021..
La question du maintien par des mairies commanditaires de ses installations lumineuses dans l’espace public se posa alors rapidement et elles furent d’abord éteintes. Ces mesures motivèrent la publication d’une tribune sur le site de la revue Artpress intitulée « Présomption d’innocence. Claude Lévêque » :
Les décisions arbitraires de certaines collectivités territoriales de décrocher ou d’éteindre les œuvres de Claude Lévêque sont, d’une part, des négations graves du principe fondamental de la présomption d’innocence et, d’autre part, des atteintes manifestes au droit moral de l’auteur, un droit pourtant absolu, inaliénable et imprescriptible. Claude Lévêque est un artiste. Les artistes ne sont pas à l’abri de la loi, mais pas, non plus, voués à être détruits sans preuves avéréesTribune « Présomption d’innocence. Claude Lévêque », 23 février 2021. https://www.artpress.com/2021/02/23/presomption-dinnocence-claude-leveque/. On se rappelle que Catherine Millet est qualifiée par Gabriel Matzneff comme l’une de ses « soutiens indéfectibles »..
On verra dans cette déclaration un véritable bréviaire de l’art comme moyen de domination. Le premier argument invoqué est celui d’un indéniable acquis démocratique, la présomption d’innocence. Mais quel rôle joue-t-elle dans le cas de crimes sans témoins ? Comme l’indique Irène Théry, « selon la formule bien connue, c’est “parole contre parole”. Cela veut dire que la vérité ne sera jamais établie au plan judiciaire. Et c’est là que la présomption d’innocence joue en faveur du mis en cause : faute de preuves, il sera réputé non coupable et relaxé au bénéfice du douteIrène Théry, propos recueillis par Octave Larmagnac-Matheron, « Crimes sexuels : pour une présomption de véracité ? », Philosophie Magazine, n° 147, février 2021. https://www.philomag.com/articles/crimes-sexuels-pour-une-presomption-de-veracite. ». On peut se demander si l’invocation du « droit moral de l’auteur, un droit pourtant absolu, inaliénable et imprescriptible », en plus de transformer le présumé innocent en victime, ne sert pas plutôt à pallier l’insuffisance de l’invocation à la présomption d’innocence et à étouffer toute velléité de remise en cause de l’artiste, du fait même de son statut. En effet, le rappel selon lequel « les artistes ne sont pas à l’abri de la loi » ne sera pas vérifié du fait de l’impossibilité de fournir des « preuves avérées ». On risque de voir vérifié alors ce qu’indique Théry : « Dans ces crimes sans témoins, [la présomption d’innocence] est largement utilisée de manière machiste et dévoyée comme un blanc-seing donné aux agresseurs, qui alimente la mentalité du “pas vu, pas pris”. Et comme un soupçon porté a priori sur les plaignant·es, comme si le simple fait de dénoncer sans pouvoir prouver en faisait des personnes qui ne respectent pas le droitIbid. ». Le droit invoqué dans cette tribune n’est peut-être pas tant le droit à la présomption d’innocence que la reconnaissance du statut de l’artiste affirmé comme une statue dont la tribune s’inquiète qu’on ose la déboulonner« Il faut croire que l’artiste appartient à une caste à part, auquel nous offrons un mandat de toute-puissance, sans autre contrepartie que la production d’une œuvre originale et subversive, une sorte d’aristocrate détenteur de privilèges exceptionnels devant lequel notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s’effacer. » Vanessa Springora, Le Consentement, Paris, Grasset, 2020. L’ouvrage est paru presque un an avant le premier article du journal Le Monde consacré à l’affaire Lévêque.. Les considérations esthétiques ont ici une fonction politique : elles exemptent l’artiste de devoir rendre le moindre compte sur son comportement en vertu d’une supposée autonomie de l’art et du champ artistique par rapport au monde social. L’invocation d’un art supposément « politique » et « critique » diffère la reconnaissance des violences. Ces considérations anesthésient.
Matthieu Potte-Bonneville répond à la tribune d’Artpress dans un texte intitulé « Points aveugles — À propos des soutiens apportés à Claude Lévêque » en se demandant si « le rappel du principe juridique de la présomption d’innocence suffit à régler la question de savoir s’il faut, ou non, continuer ces temps-ci d’exposer [c]es œuvresMattieu Potte-Bonneville, « Points aveugles — À propos des soutiens apportés à Claude Lévêque ». mathieupottebonneville.fr/2021/02/25/points-aveugles/. ». En invoquant trois « motifs de vigilance », il rappelle les implications politiques de tout geste d’exposition. Quand la tribune s’inquiète du sort de l’auteur des œuvres, il s’interroge d’abord sur la réception de l’œuvre : « Le choix d’exposer une installation de Claude Lévêque ne peut éviter d’adresser un message aux protagonistes de cette histoireIbid.. » Le premier motif concerne donc leur effet d’adresse : « On ne peut choisir d’exposer, sans s’inquiéter de savoir à qui l’on s’adresse, qui croisera ces œuvres et quelles violences possibles sont encore au travail dans ce que l’on fait.Ibid. » Le deuxième motif repose sur les effets sociaux de l’exposition, laquelle confère à leur auteur une indéniable autorité symbolique, le statut de l’œuvre invisibilisant des actes délictueux : « On ne peut choisir d’exposer sans se demander à quoi cela conduit ou reconduit, sans s’inquiéter à l’idée de l’usage qui pourrait être fait de cette légitimation ou, en l’espèce, du rôle qu’elle a joué dans le parcours de C[laude] LévêqueIbid.. » Le troisième motif repose sur le contenu expressif des œuvres qui rend vaine l’invocation d’une supposée autonomie de l’œuvre d’art et du champ artistique, puisque précisément l’artiste lui-même a « utilisé son œuvre comme pièce et instrument pour adopter dans sa vie et vis-à-vis d’enfants des comportements intolérablesIbid. ». De fait, la question du statut des œuvres de Lévêque dépasse la seule question de l’acceptabilité de la subversion, dans un cadre artistique, de codes moraux et symboliques. Ou, plutôt, elle interdit qu’on y réponde trop rapidement et que l’on invoque le principe selon lequel on ne saurait confondre représentation et apologie puisque que, précisément, il s’agit d’abord de savoir ce qui est donné à voir. Or, comme l’indique Potte-Bonneville, « dans ce contexte, renoncer à exposer, ce n’est pas interdire de voir, c’est reconnaître que l’on ne sait plus au juste ce que l’on regarde : une œuvre, un appât, un leurre ou un tableau de chasseIbid. ». Et on peut se demander si concentrer l’attention sur les installations publiques lumineuses ne sert pas avant tout à faire diversion et à ne pas regarder d’un œil moins naïf les autres œuvres de l’artiste et en particulier celles qui portent sur l’enfance. En deçà des questions de la défense de l’autonomie de l’art et de la liberté d’expression de l’artiste, il s’agit de voir dans quelle mesure, comme l’indique Gisèle Sapiro, « les représentations ne sont jamais neutresLa sociologue précise : « Elles s’inscrivent dans une vision du monde qui repose sur des valeurs et des principes de hiérarchisation. » Gisèle Sapiro, « L’autonomie littéraire, une tradition dévoyée », Mouvements, 2022/4, n° 112, p. 60. ». Une telle vérification est d’autant plus impérative que l’œuvre de Lévêque a toujours été perçue comme progressiste, comme défendant une certaine idée de l’émancipation, notamment par la valorisation des cultures populaires et de la contre-culture, dans un « régime d’innovation esthétique socialement contestatairePierre-Michel Menger, « Art, politisation et action publique », Sociétés et représentations, février 2001, p. 192. ».
Les mythes de l’enfance comme innocence et comme force de destruction
L’autonomie de l’œuvre d’un artiste, la distance supposément « critique » qu’elle instaure vis-à-vis de son objet de référence n’interdisent pas que soit interrogée la façon dont cet objet est reconstruit et donné à voir. Il s’agit ici de considérer les représentations qu’ensemble elles produisent. La sociologue Marie-José Chombart de Lauwe, dans Un monde autre : l’enfance, montre comment les représentations de l’enfance, qu’elle étudie pour sa part dans la littérature, conduisent à « la création d’un langage mythiqueMarie-José Chombart de Lauwe, Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à son mythe, Paris, Payot, 1979, p. 10. ». Elle met en évidence « la fixation en “nature” de traits de l’enfance, spécifiques mais transitoires et les mécanismes psychosociologiques de ce processusIbid. ». Dans les œuvres qui abordent l’enfance, les images d’enfant « servent de support à [d]es représentations et les fixent. [Elles] sont créées par des adultes qui observent la réalité, mais aussi recueillent, transforment ou inventent des images, des thèmes et surtout projettent leurs propres fantasmesIbid. ». En l’occurrence, on peut identifier dans l’œuvre de Lévêque au moins deux mythes de l’enfance.
Le premier mythe est celui de l’innocence de l’enfant. Le dictionnaire historique de la langue française le précise : « Comme le latin chrétien Innocentes, le mot désigne d’abord au pluriel (1080) les enfants en bas âge qui furent mis à mort sur l’ordre d’Hérode ; en ce sens le mot reste surtout dans “massacre des Innocents” et dans des noms de lieux. De là innocent s’est dit pour “très jeune enfant”Alain Rey (éd.), « Innocent », Dictionnaire historique de la langue française, tome 2 : Fo-Pr, Paris, Le Robert, 2012, p. 1732. ». Dans nombre d’œuvres de Lévêque, l’innocence, « qui ne produit aucun dommage », « état de pureté« Innocence », Centre national des ressources textuelles, https://www.cnrtl.fr/definition/innocence. », est moins une des qualités secondaires de l’enfance qu’une de ses qualités premières, si ce n’est son synonyme. Ces œuvres exemplifient l’enfance comme le moment des traumatismes sur lesquels elles ne renseignent que par ellipses : lieux (dortoir, ramassage scolaire, hôpital — des cadres de vie collectifs ou familiauxOn peut citer Le Grand sommeil (2006), Rendez-vous d’automne (2008).), éléments textuels ou métaphoriques qui annoncent qu’un traumatisme va survenir, mais dont on ne sait pas en quoi il consiste, atmosphère dramatique (noir, nuit, etc.). Cette condition se caractérise par l’absence de toute référence au monde social et par des évocations et connotations visuelles et sonores renvoyant à un moment révolu, qu’il n’est plus possible de faire advenir à nouveauCes œuvres relèvent d’une poésie que Friedrich Schiller qualifie de « naïve » et dont il montre qu’elle repose sur une représentation de l’enfance « comme une nature en contraste avec l’art et [qui] l’offusque ». Friedrich Schiller, De la poésie naïve et sentimentale, trad. Sylvain Fort, Paris, L’Arche, 2002, p. 9.. Ces œuvres sont produites avec des objets décontextualisés et qui renvoient à l’enfance : lit d’enfant, bureau d’écolier, tricycle, etc.On peut citer Le Trou dans la tête (1986), La Nuit du chasseur (2016), Go Mental II (2011), Pente (2012). L’innocence, « état de celui qui ne se rend pas compte des choses, qui manifeste une trop grande ignorance des réalitésIbid. Compris comme « état de celui qui n’est pas souillé par le mal, le péché, qui ne pense pas à mal », le terme a une connotation morale qui renvoie implicitement à la définition de l’enfance comme moment précédant la puberté en vertu de l’analogie entre genre humain et individu. », fonde l’état d’exception de l’enfance, son isolement, sa mise à distance de la société. Quand l’image de l’enfant apparaît, c’est comme une icône, entourée d’un halo de lumière. La vulnérabilité est son corollaire immédiat et immanquable — que signifient ses très nombreux néons, écrits de mains d’enfants ou de vieillards (la vieillesse est comprise comme un moment de retour à l’enfance). L’enfant manifeste alors autant « la nostalgie de l’origine perdue » que « le désir d’une régénération par la naïvetéGeorges Canguilhem, « La décadence de l’idée de progrès », in Œuvres complètes, Tome V, Histoire des sciences, épistémologie, commémorations (1966-1995), Paris, Vrin, 2018, p. 1077. ». On comprend qu’une telle représentation émeuve : elle s’adresse au spectateur adulte et lui signifie la distance qui le sépare de ce moment inaugural.
Une autre série d’œuvres formalise un mythe distinct, celui de l’enfance comme force de destruction. L’enfant n’est plus innocence ni vulnérabilité, mais, au contraire, menace et danger. L’enfance exemplifie une régression qui pourrait mettre à mal l’édifice social. Quand l’enfant apparaît comme une figure réelle, c’est sous les traits de jeunes adolescents affublés des marques de la contre-culture : leur crâne rasé est signe de leur radicalité, de leur détestation du monde social. Ces enfants se dirigent vers l’âge adulte mais le refusent, ayant juré fidélité au credo punk No Future. Ils semblent décidés à ne jamais céder à l’échéance de l’âge adulte réservé aux lâches. Nombre des néons de Lévêque, écrits par des mains d’enfants ou de jeunes adolescents, formalisent le désenchantement radical qui les animent : « Amertume », « Ta gueule », etc. On comprend qu’une telle représentation séduise : elle s’adresse à l’adulte et lui fait mesurer la perte de ces idéaux de jeunesse autant qu’elle en réaffirme le pouvoir destructeur.
Ces deux représentations mythiques de l’enfance ont chacune une historicité propre dans l’art du xxe siècle. Le mythe de l’innocence accompagne l’idée de l’enfance comme facteur d’identification artistique univoque à son début, c’est l’Enfance de l’art. L’enfant est alors, à l’instar du fou et du sauvage, une des figures du primitivisme artistique qui voit dans leurs productions plastiques l’expression d’une humanité épargnée par la corruption du progrès technologique du fait de leur stade supposé de développement intellectuelPhilippe Dagen, Primitivismes. Une invention moderne, Paris, Gallimard, 2019.. C’est là un topos que l’art contemporain, à partir des années 1970, s’est largement chargé de remettre en question. La contestation de ce « fantasme d’un état primitif de l’homme, de sa mentalité et, par extension, de l’artBaptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l’art brut. Critique du primitivisme, Les presses du réel, 2019, p. 16. » donne lieu, à la fin du xxe siècle, à son retournement. La valeur artistique de l’enfance s’inverse. L’enfance représente la régression, l’incapacité et donc le refus d’intégrer la société capitaliste. D’où le recours à la figure de l’adolescent compris comme prolongement du caractère inachevé de l’enfant et valorisation de la régression comme moyen de résistance face à une société consumériste. Lévêque réhabilite la figure de l’enfance comme icône de la fragilité dans certaines de ses œuvres tout en promouvant dans d’autres une destructivité tout aussi fondamentale. La figure de l’enfant récalcitrant permet d’éviter le reproche de naïveté qui colle à l’Enfance de l’art, la figure de l’enfant innocent permet de réactiver les affects positifs qui accompagnent la nostalgie.
Pour différents qu’ils soient, ces mythes s’opposent tous deux à la même approche selon laquelle l’enfance est un moment de passage. Ils sont l’occasion de l’affirmation de valeurs spécifiques et ils sont l’indice de normativités propres, hétérogènes et irréconciliables que l’on peut mettre en évidence notamment avec les distinctions opérées par Georges Canguilhem qui montre que l’enfance vaut comme « réserve de valeursIbid. » et que « le cas de l’enfant est singulier et éminent pour une élucidation philosophique de la fonction de normeGeorges Canguilhem, « Fin des normes ou crise des régulations ? — II L’anormal et l’anti-normal », ENS, CAPHES, Fonds Georges Canguilhem, G.C. 25.17, feuillet 67. ». Loin d’appréhender l’enfance par rapport à l’adulte, ce qui en ferait une figure du manque, ces mythes construisent l’image de l’enfance comme un écart radical avec l’adulte : l’enfant est considéré indépendamment de l’adulte, il n’est pas inachèvement mais complétude contrecarrée par les projets pédagogiques de l’adulte. Ces images de l’enfance visent chacune à substituer l’enfant au concept régulateur d’adulte. L’enfant innocent, sorti de l’Histoire et du social, perd son caractère transitoire. Il n’est plus dénuement mais richesse. Son inachèvement n’est pas un retard. La prématuration qui le caractérise le rend d’autant plus apte à inventer de nouvelles formes de vie du fait qu’ « un retard de croissance, par anticipation du temps de naissance, constitue une chance d’avantage et d’avance pour l’invention de nouvelles formes et nouvelles normes de cultureIbid., feuillet 64. ». C’est un être sans commune mesure, qui relève d’une forme essentialisée de primitivité, une Nature. Cette enfance est celle de l’âge d’orL’enfant apparaît précisément le corps couvert de dorures dans Grand Hôtel, l’installation photographique inaugurale de l’artiste.. Ce type de « séparation est une purification. La pureté a une valeur normative avant d’avoir une réalité physiqueG. Canguilhem, « Les normes et le normal », « De la priorité normale de l’infraction et de l’interdiction », op. cit., feuillet 9. ».
Cet enfant fantasmatique n’est en interaction avec aucun milieu, il incarne une figure impossible, qui précède l’établissement des normes, et qui donc les contiendrait toutes. En comparaison avec cet enfant anténormatif, origine inexpliquée de toutes les valeurs, l’enfant récalcitrant est antinormatif. Loin de dépasser qualitativement l’adulte comme le fait l’enfant innocent, cette figure le met en danger, nie sa valeur en détruisant sa personne et son monde. L’enfant destructeur renvoie à des valeurs négatives, non pas des « négations de grandeur […], mais quelque chose de vraiment positif en soi qui est simplement opposé à l’autre grandeur positiveEmmanuel Kant, Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, trad. Roger Kempf, Paris, Vrin, 1949, p. 76 ; cité in Pierre Macherey, « Canguilhem et l’idée de milieu », exposé présenté au colloque « Georges Canguilhem. Science, technique, politique : perspectives actuelles » (Liège, 22 avril 2016). https://philolarge.hypotheses.org/1737. ». Aussi on comprend qu’il soit potentiellement létal pour la société comme le rappellent les néons faisant vibrer dans la pénombre d’une écriture manuscrite tremblée Le Réveil de la jeunesse empoisonnée (2009) ou La Nuit, pendant que vous dormez, je détruis le monde (2007). Ce n’est plus l’enfant de l’âge d’or mais celui du chaos, « à la fois indétermination et possibilité, et aussi du même coup angoisse et impuissanceG. Canguilhem, « Les normes et le normal », « De la priorité normale de l’infraction et de l’interdiction », op. cit., feuillet 10. ». Les deux mythes sont liés mais de façon disjonctive : « Le chaos est irrégularité intégrale, l’âge d’or est régularité initialeIbid., feuillet 9.. » De même, « l’image d’un chaos, c’est celle d’un ordre normatif supprimé, comme celle d’un âge d’or, c’est celle d’un chaos définitivement dépasséIbid., feuillet 10. ». Les deux représentations ne sont pas congruentes, elles s’excluent, mais elles sont complémentaires : elles semblent couvrir l’ensemble des représentations qu’il est possible de se faire de l’enfance. Pour recourir aux termes de Roland Barthes, leurs différentes « formes » remplissent à chaque fois le « concept » enfant : le monde « sort du mythe comme un tableau harmonieux d’essences. Une prestidigitation s’est opérée, qui a retourné le réel, l’a vidé d’histoire et l’a rempli de natureRoland Barthes, Mythologies, Paris, Le Seuil, 1970, p. 216. ».
Affiché soit comme antésocialité (dans le cas de l’enfant innocent) ou comme antisocialité (dans le cas de l’enfant destructeur), l’enfant devient une nature, sans histoireLe mythe « abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradictions parce que sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence, il fonde une clarté heureuse ; les choses ont l’air de signifier toutes seules ». R. Barthes, Mythologies, op. cit., p. 217.. Ces deux mythes présentent l’enfant comme condition de l’avènement de futurs désirables, la condition ultime du renversement des oppressions, le ferment de toutes les contestations. C’est pourtant là l’expression d’une chose impossible dans les faits et même peu souhaitable, une projection établie à partir d’un « objet dont l’importance idéale supplante l’importance empiriqueF. Schiller, De la poésie naïve et sentimentale, op. cit., p. 13. ». Comment l’innocence, vertu morale, pourrait-elle avoir des applications et incidences politiques et sociales ? Quant au mythe de l’enfant comme force destructrice, il met en scène un jeune adolescent dont la révolte n’a aucune finalité, elle est un but en soi. Elle est finalement vaine et contribue à sa domination. Soit l’enfant n’apparaît pas comme étant dominé — l’aliénation devient cosubstantielle à sa personne, elle n’a pas d’origine ni de commencement, elle est inéluctable. Pourquoi alors en chercher les causes ? Soit l’enfant semble un individu toujours déjà émancipé et ingouvernable. Pourquoi alors l’imaginer aliéné ? Envisager les représentations de l’enfance dans l’œuvre de Lévêque comme autant de mythes permet de comprendre qu’elles sont incapacitantes quand elles semblent élogieuses. Elles suppriment la puissance d’agir de l’enfance en prétendant la favoriser : l’enfant n’est-il pas, dans les deux cas, rendu vulnérable ? On vérifie finalement, à chaque fois différemment, que « le mythe est une parole dépolitisée« Il faut naturellement entendre : politique au sens profond, comme ensemble des rapports humains dans leur structure réelle, sociale, dans leur pouvoir de fabrication du monde ; il faut surtout donner une valeur active au suffixe dé : il représente ici un mouvement opératoire, il actualise sans cesse une défection. » R. Barthes, « La littérature selon Minou Drouet », in Mythologies, op. cit., p. 217. » :il a « pour charge de fonder une intention historique en nature, une contingence en éternitéIbid., p. 216. ». Les mythes de l’enfance (ici innocence et destructivité) sont d’ailleurs construits chacun à partir de caractéristiques qui semblent différencier l’enfance de l’âge adulte : la déterminabilité de la jeune enfance (par opposition à la plus grande fixité des plus âgés) et le refus des normes de l’âge adulte. L’enfant devient « une altérité profonde posée par la nature elle-même entre l’âge enfantin et l’âge mûr », soit « un être asocialIbid., p. 145. ». C’est à cette condition que l’enfant est radicalement « autre » et qu’il devient surface de projection. Mais dans quel but ?
L’enfant selon les arguments propédophiles
Comme Barthes l’explique : « Les hommes ne sont pas avec le mythe dans un rapport de vérité, mais d’usage : ils dépolitisent selon leurs besoinsIbid., p. 218.. » Il faut ici considérer les effets du mythe. Jean-Pierre Vernant montre que le « dispositif mythique joue le rôle d’un cadre formel utilisé pour exprimer et transmettre, dans une forme narrative, différente des énoncés abstraits du philosophe ou du savant, un savoir concernant la réalité, une vision du mondeVernant continue : « Le langage dont se sert le mythe est lui-même, par son organisation, syntaxique et sémantique, un découpage du réel, une forme de classification et de mise en ordre du monde, une première règlementation logique, bref un instrument de pensée. Il n’en est pas moins utilisé, dans la communication, pour transmettre des messages et dire quelque chose à autrui. » Jean-Pierre Vernant, Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, François Maspero, 1982, p. 245-246. ». De même, dans ses notes inédites, Canguilhem relève que le mythe « n’est pas une explication, il est une position d’existenceGeorges Canguilhem, « Le mythe », in Sujets divers. 1931-1943, GC.II.2.3, feuillet 4. Canguilhem note une citation de Georges Sorel, selon laquelle le mythe est comme « une représentation qui anticipe la fin d’une action comme réalisée afin de lui assurer le climat psychologique rendant possible le succès (Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Introduction, 1907) » (ibid., feuillet 3). ». Les mythes de l’innocence et de la destructivité de l’enfance ont la même fonction : orienter l’agentivité des représentations qu’ils véhiculent en supprimant la différence entre l’adulte et l’enfant.
La commensurabilité de l’adulte et de l’enfant a été notamment invoquée pour justifier l’initiation sexuelle des enfants, cette dernière étant considérée comme un levier pour la libération de l’enfant que les institutions pédagogiques comme l’école diffèrent. Cet argumentaire propédophile est invoqué pour dénoncer des institutions dédiées à l’enfance aliénantes (par opposition à son innocence) et répressives (par rapport à sa destructivité). Il s’oppose à une approche protectionniste et paternaliste qui considère que l’innocence et la destructivité des enfants les exposent au danger et que la fonction de la famille et des institutions pédagogiques est de les protégerOn verra en quoi s’y oppose une approche de l’enfance comme catégorie dominée par les adultes.. Dans Émile perverti, René Schérer dénonce un « dispositif pédagogique de l’enfance » ou un processus de « pédagogisation », dont l’Émile de Jean-Jacques Rousseau est le parangonRené Schérer, Émile perverti ou des rapports entre l’éducation et la sexualité, Paris, Robert Laffont, coll. « Libertés 2000 », 1974.. Le philosophe y voit l’origine d’un « système de l’enfance » dont la fonction est de maintenir l’enfant dans un état de dépendance afin que sa force normative ne contrecarre pas les projets délétères de conformité sociale que lui réserve la sociétéOn se souvient que dans ce traité de pédagogie, d’un nouveau genre pour son époque, Rousseau imagine un élève dont l’éducation est prise en charge par un précepteur à distance de la société afin d’éviter la dénaturation qu’immanquablement elle lui aurait imposé. L’action pédagogiqueest censée accompagner harmonieusement son développement naturel au moyen d’une éducation négative, dans laquelle il importe moins de faire que d’empêcher de mal faire. Schérer voit dans cette démarche une bonne intention : Rousseau « a prévu que de l’enfant libéré viendrait le bouleversement de l’ordre social ». Mais elle ne tient pas ses promesses. Ibid. p. 20.. Le potentiel révolutionnaire de l’enfant est ainsi perverti, dans un premier sens, non sexuel : l’éducation diffère la réalisation des promesses de changement dont il est porteur, le condamnant à devenir « un adulte infantilisé, rapetisséIbid., p. 57. ». Pourtant, parce qu’il « connaît davantage [et] possède même plus de forcesIbid., p. 56. » que les adultes, l’enfant est déjà perverti, dans un sens sexuel, « revendiquant pour lui-même autre chose que l’innocence […], émettant la prétention scandaleuse de posséder déjà, et dès l’enfance, ce qui constitue la prérogative adulte par excellence : le sexe et son usage — ou plutôt les limites strictement codifiées de cet usageIbid., p. 55-56. ». L’éducation « induite par le désir » du pédéraste « fournit l’impulsion et l’attraction passionnelle, sans laquelle l’enfant ne serait qu’un adulte plus faibleLe terme euphémise alors celui de « pédophile » en ce qu’il renvoie à une tradition antique. Cf. Pierre Verdrager, L’Enfant interdit. De la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité, Paris, Armand Colin, p. 36. ». Une éducation n’est « perverse » que lorsqu’elle « dénie » et « exclut » « les rapports pédérastiques entre maîtres et élèvesIbid., p. 192. ». C’est là le projet proprement pédophile de l’auteur, « la revendication du sexe pour l’enfant [en tant qu’elle] apporte sa contribution de taille » à la « débâcle » d’un « discours [pédagogique] embrassant la vie entière de l’enfantIbid., p. 19. Ailleurs : « Il n’y a pas deux sexualités, celle de l’enfant et celle de l’adulte, mais une seule, non celle de l’adulte, certes, mais la sexualité prise dans un réseau de tensions qui, hors de l’adulte, commence à “projeter” l’enfant et à le constituer. » Ibid., p. 35. Daniel Liotta propose une réfutation philosophique de l’approche de Schérer dans l’article « Les relations charnelles entre l’adulte et l’enfant sont-elles légitimes ? “Sexualité”, consentement et éducation », Le Philosophoire, n° 56, 2021. ». Si dans Émile perverti Schérer condamne l’innocence de l’enfant comme un mythe que l’éducation contribue à entretenir et « qui ne se maintient qu’au prix du renoncement à la spontanéité du désirIbid., p. 58. L’innocence est seulement « prétendue », ce que permet une lecture biaisée des Trois Essais sur la théorie sexuelle de Sigmund Freud. Ibid., p. 60. », cette innocence est considérée comme un appel au « raptRené Schérer, Guy Hocquenghem, Recherches « Co-Ire. Album systématique de l’enfance », n° 22, mai 1976. » dans le numéro 22 de la revue Recherches intitulé « Co-Ire. Album systématique de l’enfance » et coécrit avec Guy Hocquenghem en 1976. Loin d’être contradictoire avec l’idée d’innocence, c’en est là la conséquence immédiate. Canguilhem met en évidence que l’âge d’or, dans lequel, du fait de sa pureté, « la règle est suivie sans la conscience d’une infraction possible, ce qui est proprement l’état d’innocence, toute jouissance est simple. Et c’est pourquoi l’âge d’or est un état dans lequel il n’est pas possible de demeurer. Du moment que c’est un état contradictoire, il contient une force de propulsion interne de dépassement, une obligation de culpabilité par infractionGeorges Canguilhem, « Les normes et le normal », « De la priorité normale de l’infraction et de l’interdiction », op. cit., feuillet 9.. » De ce point de vue, le mythe de l’innocence justifie l’infraction, d’où un doute persistant : ne serait-ce pas la raison même de son invocation ?
Pour des approches propédophiles, la question de l’impossibilité du non-consentement chez l’enfant ne se pose pas : le pédophile ne heurte pas l’enfant, il se contente de devancer et de réaliser son souhait. L’enseigné, enfant ou adolescent, peut tout à fait souhaiter spontanément avoir des relations sexuelles avec « les éducateurs ou parents plutôt qu’avec d’autres adultes », d’où la « force particulièrement excusable des passions que développe le contact professionnel des adultes avec les enfantsRené Schérer « La vertu d’un amendement. Réflexions sur les nouvelles propositions de mise à jour du Code pénal en matière de mœurs », Recherches, « Fous d’enfance. Qui a peur des pédophiles ? », n° 37, avril 1979, p. 103. ». Schérer reprend à Charles Fourier la transposition que ce dernier opère entre la gravitation universelle de Newton et « l’attraction passionnée » qui doit organiser les relations humainesNathalie Brémand, « Fourier et son projet de phalanstère enfantin (1833-1834) : entre optimisme et opportunisme », in Sophie Audidière et Antoine Janvier (éds.), « Il faut éduquer les enfants… » L’idéologie de l’éducation en question, Lyon, ENS éditions, 2022.. Il en infléchit toutefois le sens. Par opposition à une approche de l’enfant comme manque et comme transitionDans l’« arrière-propos » de Une Érotique puérile, il regrette que la « transition » ne permette pas de ménager une « place » à l’enfant. René Schérer, Une érotique puérile, Paris, éditions Galilée, p. 181., il emprunte à Fourier le syntagme d’ « écart absoluR. Schérer, Émile perverti, op. cit., p. 90 et 251. » pour désigner l’exceptionnelle réserve de valeurs spécifique de l’enfant, qui relève alors d’une paradoxale force que seule une éducation « pédérastique » peut révéler à elle-même. Mais si le philosophe bisontin désigne là un « système méthodologique […] qui consiste à douter et à prendre le contre-pied de tout ce que les connaissances passées de son époque ont établi jusque-làNathalie Brémand, « Fourier et son projet de phalanstère enfantin… », op. cit., p. 63. David Liotta montre qu’en qualifiant non pas de négative mais d’absolue la différence entre enfant et adulte, Schérer fait de la pédophilie une « pratique positive de l’éducation ». David Liotta, art. op. cit., p. 198. », Schérer l’utilise pour signifier que l’enfance relève du « non-normé », qui dépasse « une conception progressive de l’éducation ». Il regrette d’ailleurs que la théorie de Fourier « repose sur la négation de la sexualitéR. Schérer, Émile perverti, op. cit., p. 106, 109. Il voit là un « problème ». ».
Cette approche est comparable à celles d’autres auteurs propédophiles des années 1970 et 1980, principalement Tony Duvert, Gabriel Matzneff et Guy Hocquenghem (avec lequel Schérer coécrit nombre d’articles). Elle est formulée à l’occasion de prises de parole parfois communes, de positions politiques pas forcément similairesSchérer et Hocquenghem s’inscrivent dans une pensée de gauche radicale et Gabriel Matzneff dans un conservatisme esthète., d’argumentations parfois différentes et d’agissements dont les défenseurs des deux derniers avancent qu’ils sont vraisemblablement sans comparaison avec ceux des deux premiers. Autant de prises de position toutefois convergentes en ce qu’elles défendent la possibilité de relations sexuelles entre adultes et enfants. Elles ont lieu dans plusieurs perspectives, qui ne sont pas exclusives : la lutte contre une majorité sexuelle homosexuelle fixée à 15 ans et une majorité sexuelle hétérosexuelle fixée à 21 ans, la remise en cause de l’autorité de la familleDu patriarcat ou d’un matriarcat fantasmé comme lui étant équivalent.. Mais la défense des rapports sexuels entre adultes et jeunes ou moins jeunes enfants n’en fut pas moins une véritable cause, alors intégrée aux appels à la libération sexuelle« Il est nécessaire de distinguer le cadrage du débat public contemporain et les tentatives militantes pour faire valoir d’autres problématisations des enjeux liés à la sexualité des mineurs, notamment autour de la critique de l’autorité familiale, de la dénonciation des violences subies dans le cadre domestique et de l’arbitraire de la majorité sexuelle. » Jean Bérard, « De la libération des enfants à la violence des pédophiles. La sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 1970 »,Genre, sexualité & société, n° 11, printemps 2014. https://journals.openedition.org/gss/3134.. Ces différentes approches donnent au terme « enfant » des sens distincts qui alors n’étaient pas du tout systématiquement distingués, qu’il s’agisse du jeune enfant, de l’enfant prépubèrePour lesquels Tony Duvert et Gabriel Matzneff ne cachaient pas leur attirance ni qu’ils avaient des relations sexuelles avec certains d’entre eux et dont René Schérer et Guy Hocquenghem reproduiront des photographies de nu dans l’album Co-Ire., de l’enfant de 12-13 ansC’est l’explication que Schérer donne quand il justifie rétrospectivement ses prises de position communes avec Hocquenghem : « Nous demandions que soit pris en compte le consentement, même s’agissant d’enfants de moins de 15 ans — qui dès 12 ou 13 ans nous semblaient parfaitement pourvus de la faculté de décision et de la capacité de choix — et que, d’autre part, toutes les relations n’impliquant aucune violence relèvent du tribunal correctionnel et non des assises. » René Schérer, Geoffroy de Lagasnerie, Après tout. Entretiens sur une vie intellectuelle, Paris, Éditions Cartouche, 2007, p. 172., de l’enfant de moins de 15 ans ou de personnes mineures (alors de moins de 21 ans). Ces approches ont en commun de considérer que le consentement de l’enfant est possible (et même qu’il est demandeur de « gratification sexuelleRené Schérer, « À propos de la pédophilie », in Robert Gellman, Actualités sexologiques. Deuxième série. Conduites sexuelles, Paris, Masson, 1981, p. 63. ») et que le refus de sa prise en compte est le signe d’une infantilisation et la marque d’une oppressionCf. Paul Clinton, « The Trouble with Not Normal. French Boys Lovers and the Limits of Queer », Paris Ass Book Fair 2019, Palais de Tokyo, 6 avril 2019. https://www.youtube.com/watch?v=a1FvrYnC0-Q..
Le mythe sert à oblitérer la politique de la sexualité entre enfants et adultes à laquelle la représentation de l’enfant est une propédeutique. Lévêque débute sa carrière d’artiste contemporain en 1982 à l’occasion de l’exposition collective Une autre photographie (Maison des Arts de Créteil) dans laquelle il présente l’installation Grand Hôtel comprenant des photographies d’adolescents nus et au corps couvert de dorures (dont Laurent Faulon et ses frères). Soit au moment où, pour reprendre les termes de Philippe Artières, la pédophilie commence à ne plus être acceptée comme auparavant : de « contre-culturelle », elle devient « criminellePhilippe Artières, « Les révolutionnaires seront des enfants ou ne seront pas. Éléments pour une histoire politique de la sexualité des mineurs dans l’après-68 français », in Guillaume Désanges, François Piron (éds.), Contre-cultures 1969-1989. L’Esprit français, Paris, La Découverte/Maison Rouge, 2017, p. 96. Jean Bérard montre que la rupture en quoi consiste le début des années 1980 ne « réside peut-être pas dans l’expression des pédophiles eux-mêmes, dont des organes demeurent actifs, mais dans la position politique de leurs revendications : à ce moment se ferment sans retour les espaces d’expression que les pédophiles avaient jusque-là trouvés dans certains médias et partis politiques ». Pierre Verdrager considère que ce tournant doit être placé dans les années 1990 car des militants propédophiles s’expriment jusqu’à ce moment-là. Jean Bérard, « De la libération des enfants à la violence des pédophiles. La sexualité des mineurs dans les discours politiques des années 1970 », art. cit. ; Pierre Verdrager, L’Enfant interdit. De la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité, Paris, Armand Colin, 2021. ». En quoi l’on peut supposer que Lévêque a pris des précautions pour ne pas dépasser certaines limites, même si dans certaines œuvres il les franchit et que dans d’autres il en joue. Même si l’on s’est tenu ici plus particulièrement à un ouvrage de Schérer en ce qu’il y développe le pendant des mythes que véhicule l’œuvre de Lévêque, les approches de ces auteurs permettent de saisir un possible sens de la mythologie qui s’y déploie. Elles l’inscrivent dans un cadre intellectuel et politique plus explicite que celui que fournit immédiatement leur configuration esthétique. Se pose la question de savoir si cette dernière n’y préparerait pas. La prise en compte de ces approches théoriques permet surtout d’expliciter le type de politisation dont ces œuvres sont porteuses.
Démasquer une émancipation fallacieuse
Ce type d’approche a alors été dénoncé par nombre d’autricesNancy Huston, Jouer au papa et à l’amant. De l’amour des petites filles, Paris, Ramsay, 1979 ; Leïla Sebbar, Le Pédophile et la maman, Paris, Stock, 1980. et auteurs et notamment Jean-Luc Pinard-Legry et Benoît LapougeJean-Luc Pinard-Legry, Benoît Lapouge, L’Enfant et le pédéraste, Paris, Seuil, 1980. Deux chapitres sont repris dans cette anthologie. Cf. p. .. En réponse aux nombreuses attaques qu’a suscité en 1980 la publication de leur ouvrage L’Enfant et le pédéraste, ces derniers contribuent au dossier « Aimer les enfants ? » de la revue Masques avec un article intitulé « En réponse à nos contradicteurs »Jean-Luc Pinard-Legry, Benoît Lapouge, « En réponse à nos contradicteurs », Masques. Revue des homosexualités, n° 5, 1980. Ces critiques étaient celles de René Schérer dans Gai Pied et de Tony Duvert dans Libération du 28 mars (« Lorsque l’enfant paraît. La mère et le pédophile » — le texte était également une réponse à la publication de Leïla Sebbar) et des 29-30 mars 1980 (« Lorsque l’enfant paraît. Les puritains homosexuels »). Xavière Gauthier répond à ces articles dans Libération le 8 avril. Le numéro de Gai Pied d’avril 1980 contient un dossier « Le débat sur la pédophilie » avec un texte de Gabriel Matzneff et une « Lettre ouverte » de René Schérer., dont il importe ici de citer entièrement un extrait, car il explicite les implications politiques d’une approche mythique de l’enfance en dehors du monde social et aborde la question des séquelles de la pédocriminalité :
Nous ne reconstruisons aucun mythe de l’Enfance, nous n’avons pas l’idée d’un enfant libre de tout contact avec l’adulte, en vue d’une éducation aseptique qui irait emprunter ses idées à Rousseau. Nous n’avons pas cette naïveté car nous savons bien qu’il n’y a pas d’individu qui échappe à la socialité dans laquelle il se trouve pris d’emblée. Partant du constat de l’oppression générale dont les enfants sont l’objet, nous avons voulu imaginer que l’être humain pourrait échapper un jour à un univers qui pense tout en termes de manipulation, d’instrumentation. L’homme (l’enfant) n’est le bien de personne, ni de la famille, ni de l’école, ni du pédéraste et, faut-il le préciser, ni de la mère… Alors pourquoi faudrait-il s’interdire de penser une socialité autre, qui fasse un autre sort à l’enfant ? Est-ce parce que quelques adolescents prennent la parole qu’on peut faire comme si la majorité d’entre eux n’était pas réduite au silence ? L’invraisemblable sophisme qu’on nous oppose aujourd’hui est que les transformations escomptées vont venir d’un nouveau rapport à l’enfance (mais de quel plaisir ?), d’une négation volontariste des institutions. C’est faire un peu vite l’économie du marquage impitoyable des corps auquel, dans cette société, personne ne peut prétendre échapper. Il faut manquer singulièrement de sens politique pour se dérober ainsi aux responsabilités que ce monde d’exploitation, d’instrumentation, dans lequel nous vivons, nous crée. Car enfin si les hommes qui ont le pouvoir (y compris les homosexuels) n’acceptent pas de remettre en cause radicalement ce qui conditionne leurs pratiques, si leur critique ne prend pas aussi le chemin d’une autocritique, s’ils ne savent pas démasquer en eux-mêmes le conformisme, quel changement pourrait bien advenir ?Ibid., p. 110.
Comme le montrent Pinard-Legry et Lapouge, le pédophile réitère et décuple les violences du patriarcat et les oblitère en construisant l’image d’un enfant surnormatif dont l’adulte empêcherait le déploiement au moyen de l’éducation.
Contre ce type de politisation de l’enfance, Tal Piterbraut-Merx tâche de saisir les différentes façons dont le pouvoir d’agir de l’enfance est réduit dans les faits et sapé par les représentations qu’elle inspire (ce que vérifie l’expérience). Il ne s’agit alors pas de considérer l’enfance comme achevée et porteuse d’une force qui la rendrait axiologiquement équivalente à l’âge adulte (ce que contredit l’expérience). L’enjeu consiste ici à ne pas considérer l’enfant comme déficitaire mais à ne pas l’hypostatiser pour autant comme « écart absolu ». Il s’agit au contraire de saisir comment l’enfance est « écartéeT. Piterbraut-Merx, « Politiser l’enfance », conférence op. cit. », notamment de l’apprentissage du consentement ou de l’existence des violences. Piterbraut-Merx réduit cette impuissance de l’enfant en montrant d’abord qu’elle est fantasmée et construite par les institutions mêmes censées le protéger, loin de revendiquer une réciprocation des rapports entre adulte et enfant. Les auteurs propédophiles, pour leur part, pensent l’enfance comme une phase achevée et non plus comme une phase transitoire ou préparatoire, remettant alors en cause la catégorie de minorité comme artificielle et sapant son caractère protecteur premier. La minorité réduirait une supposée puissance intrinsèque à l’enfance. Ce faisant, l’enfant perdure dans une immaturité qui le rend d’autant plus manipulableGwyneth Bison explique que, loin que l’on « continue à défendre l’idée qu’un enfant ne puisse pas consentir, [un] enfant très souvent consent [et que] le problème c’est qu’on exploite son consentement, je ne sais pas en quelle langue il va falloir le répéter ». G. Bison, « Du Claude », art. op. cit. De même, Laurent Faulon insiste sur le fait que les ouvrages d’auteurs propédophiles sont des « armes redoutables » quand ils sont mis dans les mains de victimes qui y trouvent des arguments pour envisager les relations sexuelles avec adulte comme autant de pieds de nez à la société (e-mail à l’auteur du 29 janvier 2023). Comme l’indique Liotta : « L’enfant est victime d’un agresseur, mais il est aussi — par la médiation de son agresseur — victime de sa sexualité et ainsi soumis à la dimension peut-être la plus vulnérable de son être. » D. Liotta, « Les relations charnelles entre l’adulte et l’enfant sont-elles légitimes ? », art. cit., p. 196..
À l’inverse de ce type d’approche, Tal Piterbraut-Merx cherche à remettre en cause la minorité parce qu’elle contribue à vulnérabiliser et à infantiliser l’enfant. Son refus de la minorisation de l’enfance s’oppose à la glorification d’un fantasme d’adulte, celui d’une « enfance majeureRené Schérer « L’échec d’une mainmise », in Charles Fourier, Vers une enfance majeure, Paris, La Fabrique, 2006, p. 18. ». Il lui importe alors de visibiliser les facteurs qui contribuent à produire l’état de dépendance et de faiblesse dans lequel l’adulte maintient l’enfant. Parmi ces facteurs, on compte le droit et les institutions de « protection de l’enfance » ainsi que les représentations incapacitantes de l’enfance, dont un certain nombre de mythes de l’enfance qui relèvent de la métaphore. Le philosophe montre que la métaphore enfantine repose sur une vue partielle de l’enfant réel, elle en considère un aspect qui le détermine en intégralité, masquant ses autres caractéristiques. Dans l’article « Des dérives d’un usage métaphorique de l’enfance », Piterbraut-Merx en dévoile le mécanisme. Les métaphores de l’enfance reposent sur une compréhension univoque de l’enfance définie
comme état de manque par rapport à l’état final qu’est l’adulte, et s’adosse donc à une structure téléologique. L’aspect transitoire de l’enfance est ainsi mis en avant, alors que cela constitue une caractéristique de tous les âges humains. L’enfant serait particulièrement incomplet, dès lors qu’on le considère à l’aune de l’âge adulte. Celui-ci constitue la référence ultime du raisonnement, et c’est toujours de lui que l’on part pour comprendre, en négatif, les structures enfantinesTal Piterbraut-Merx, « Des dérives d’un usage métaphorique de l’enfance », Le Télémaque, 2019/2, n° 56, p. 58. C’est une idée que formule également Canguilhem quand il analyse le concept de développement, qui, « supporté par une métaphore d’ordre biologique, n’est pas axiologiquement neutre, puisqu’il contient la référence explicite d’une succession de phases à un pôle d’achèvement, la forme adulte spécifique. Se tenir pour développé, c’est s’autoriser à caractériser toute différence comme retard ». Georges Canguilhem, « Retour et promotion du sauvage », ENS, CAPHES, fonds Georges Canguilhem, GC. 25.17 (1), feuillet 9..
C’est là un effet de l’adultocentrisme, terme qui désigne l’incapacité à saisir la figure de l’enfant indépendamment de celle de l’adulte qui lui donne ses caractéristiquesL’adultocentrisme désigne « cette incapacité à caractériser en propre les activités de l’enfant sans les comparer à celles de l’adulte, démarche corollaire d’un modèle génétique, qui emprunte son vocabulaire à la pensée des stades. L’accent est mis sur l’intégration de l’objet à une suite de transformations, plutôt que sur sa caractérisation propre. L’enfance ne peut donc être saisie que comme une préparation à un état futur, chaque étape de développement constituant une forme de progrès ». Ibid., p. 59. Cf. Jean-Claude Quentel, L’Enfant. Problèmes de genèse et d’histoire, Bruxelles, De Boeck Université, 1997.. Ce type de différentiation qualitative de l’adulte et de l’enfant est téléologique : l’adulte est considéré comme la forme achevée par rapport à laquelle l’enfance prend sens comme manque. Piterbraut-Merx le précise :
Cette utilisation de la figure de l’enfance par les adultes pourrait être jugée comme sans danger, au service d’un simple jeu de l’imagination et du langage. Cependant, il nous semble qu’elle pose problème, et ceci pour deux raisons : tout d’abord, elle participe d’une essentialisation de l’enfance qui institue celle-ci comme un autre. De plus, et cette conséquence renforce la première, elle occulte le rapport de pouvoir qui structure la relation adulte-enfant, et la manière dont ces deux pôles sont socialement construits comme opposésTal Piterbraut-Merx, art. cit., p. 62..
Une analogie avec les rapports sociaux de genre permet d’expliciter la façon spécifique dont les représentations de l’enfant et de l’adulte sont organisées. Les femmes n’ont-elles pas été cantonnées au statut de la minorité autant que louées pour leurs qualités « naturelles » ? On comprend ainsi que « les métaphores enfantines reflètent ces rapports de pouvoir adulte-enfantIbid., p. 64. » : c’est là un « système de bicatégorisation hiérarchiséeLaure. Bereni, Sébastien Chauvin,Alexandre. Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2012, p. 10, cité in ibid., p. 63. » et les études féministes, notamment les recherches de Colette Guillaumin, ont montré combien « le fait de célébrer un trait spécifique chez une classe dominée conduit à naturaliser celle-ci, et à entériner le rapport de pouvoirIbid., p. 64. Cf. Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de Nature (2) Le discours de la Nature », Questions féministes, n° 3, mai 1978. ». Pour expliquer le besoin de mythification de l’enfance, Piterbraut-Merx cite Shulamith Firestone, féministe radicale états-unienne, qui explique qu’il « répond aux besoins non des enfants, mais des adultesShulamith Firestone, La Dialectique du sexe. Le dossier de la révolution féministe, Paris, Stock, 1972. Cf. infra p. . ». La métaphore enfantine sert à étendre la différence entre l’enfant et l’adulte à d’autres groupes sociaux, ainsi les femmes et les personnes colonisées. Tout acte de domination est une forme d’infantilisation et l’enfant en fournit alors la métaphore principiellePiterbraut-Merx invite alors à « une réflexion sur les conditions politiques qui doivent guider le recours à la métaphore, afin que celle-ci ne se fasse pas le véhicule d’usages idéologiques » : la métaphore peut également être le moyen de signifier l’artificialité de la distinction entre l’enfant et l’adulte, notamment en manifestant le « caractère introuvable de l’enfance naturelle ». T. Piterbraut-Merx, « Des dérives d’un usage métaphorique de l’enfance », art. cit., p. 47 et 49.. D’où l’hypothèse selon laquelle « les métaphores enfantines pourraient alors bien jouer la fonction de justification d’une structuration politique et sociale, en allégeant certaines souffrances des adultes par le souvenir d’une ère plus joyeuse. Elles occultent également la domination subie par les enfants, en substituant à leur expérience vécue un mythe commodeIbid., p. 65. ».
Cette remise en cause d’une approche métaphorique de l’enfance s’inscrit dans une démarche de réévaluation du sens de la minorité qui entérine une relation asymétrique avec l’adulte. À la suite de Christine Delphy, Tal Piterbraut-Merx invite à remettre en cause l’approche paternaliste qui naturalise la fragilité de l’enfant et à « analyser les rapports adulte-enfant non plus à partir d’un prétendu socle naturel, mais comme des rapports sociaux de pouvoirTal Piterbraut-Merx, « L’émancipation des mineur·es, une prise en main ? », Délibérée, 2-13, 2021, p. 54. Christine Delphy, « L’État d’exception : la dérogation au droit commun comme fondation de la sphère privée », in L’Ennemi principal.Tome 2. Penser le genre, Paris, Syllepses, 2001. ». La minorité doit être conçue comme l’effet d’une minorisation, à quoi participent activement les métaphores de l’enfance. Car, précisément, le statut de minorité, « en plaçant les mineur·es sous la dépendance matérielle, économique et symbolique des représentant·es légaux·ales, est producteur d’une vulnérabilité sociale et politiqueT. Piterbraut-Merx, « L’émancipation des mineur·es, une prise en main ? », art. cit., p. 55. ». Piterbraut-Merx invite ainsi à interroger les raisons véritables de la perception de l’enfance à l’aune des catégories de faiblesse et d’incapacité et dans quelle mesure il est possible « d’envisager une dépendance qui n’ait pas pour conséquence une incapacité civileIbid., p. 56. ». Outre des pistes envisageant la remise en cause des institutions sociales dont la famille, cadre faussement protecteur où les violences sexuelles se perpétuentDorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste, Paris, Pocket, 2021. Sur la mise en cause de la famille : M. E. O’Brien, « Abolir la famille en six étapes », http://trounoir.org/?Abolir-la-famille-en-six-etapes, « Abolir la famille — Acte 1 », http://trounoir.org/?Abolir-la-famille-Acte-I ; Sophie Lewis, Full Surrogacy Now. Feminism Against Family, New York, Verso Books, 2019., Tal voyait dans l’inversion des classes d’âge (tout enfant devenant adulte, à la différences des transfuges de classe sociale ou de sexe « qui ne sont pas inévitablesTal Piterbraut-Merx, « Penser les rapports de pouvoir adulte-enfants. “C’est tout l’imaginaire vis-à-vis de la famille et du statut de l’enfance qu’il importe de transformer », entretien mené par Rachel Colombe, https://dieses.fr/penser-les-rapportsde-pouvoir-adulte-enfant. ») un puissant levier pour « renouveler les pensées du pouvoir et de la dominationIbid. Le philosophe y voit un moyen de dépasser l’opposition entre des approches matérialistes et queer de la domination. » et appelait à la création d’images puissantes de l’enfance — pourrait-on parler de contre-mythe ? — qui en libèrent les puissances d’agir propres. En bref, à politiser l’enfance.
L’œuvre de Claude Lévêque produit une confusion au niveau des relations possibles entre art et éthique auxquelles nous recourons de nos jours pour juger du caractère esthétique d’une œuvre quand nous considérons qu’il est de son ressort d’accompagner un mouvement d’émancipation ou qu’il en relève. Les éventuels soupçons qu’elle a pu inspirer ont vite été balayés par l’invocation d’un art transgressif (l’image de l’enfant comme destructivité est invoquée dans les deux cas). La question à laquelle j’ai ici tenté de répondre n’est pas celle de savoir s’il aurait été possible de percevoir ce sens de l’œuvre de Lévêque avant que n’éclate l’ « affaire », en dépit des confirmations de nombre de personnes qui savaient et de nombre d’autres (dont je suis) qui ont « tiqué », sans parvenir (par faiblesse et naïveté) à saisir ce qui se jouait. Il s’agissait de voir ce que ces révélations rendent manifeste à même l’œuvre. Mon hypothèse est que son possible contenu expressif pédophile est manifesté au moyen de mythes qui en « déforment » non pas le sens mais la perception qu’il est possible d’en avoir. Le caractère artistique de mise en forme de ce contenu expressif permet de rendre indécidable la question de savoir si c’est là un sens réel ou un sens possible. Le fort coefficient de nostalgie et de naïveté que cette œuvre prête aux représentations de l’enfance masque le fait qu’elle peut être comprise comme prenant pleinement appui sur une politisation de la pédophilie, comme tâchant de rendre possible les relations sexuelles entre adulte et enfant en construisant une certaine image de l’enfance.
Si l’on s’accorde avec Marcel Duchamp à considérer que « l’artiste n’est pas seul à accomplir l’acte de création car le spectateur établit le contact de l’œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution au processus créatifMarcel Duchamp, « Le processus créatif », in Duchamp du signe, Paris, Flammarion, 1994, p. 189. », il faut alors tirer un certain nombre de conséquences quant à la façon dont il est maintenant possible de percevoir ces œuvres. Notre regard sur elles a changé, donc elles ont changé quand bien même elles n’ont pas été modifiées. En perdent-elles pour autant leur caractère artistique ? Duchamp considère que « l’art peut être bon, mauvais ou indifférent mais que, quelle que soit l’épithète employée, nous devons l’appeler art : un mauvais art est quand même de l’art comme une mauvaise émotion est encore une émotionIbid., p. 188 ». Nous pouvons ne pas le suivre sur ce point et considérer, notamment avec Michel Thévoz, que « l’art n’est pas une qualité absolue essentielle à un objet comme le poids l’est au plomb » mais que c’est là la variable « d’une fonction de nature socialeSi Duchamp défend un art des plus conscients de son contexte culturel, Thévoz, dont l’intérêt se porte sur des productions non conscientisées comme artistiques, montre que l’art, à l’instar de « la folie, n’est pas davantage une affection circonscrite à un individu, contractée et indexable comme une arthrose ou un cancer ; l’un et l’autre sont relatifs à l’attitude du milieu, leur définition comporte un paramètre culturel, ce sont les variables d’une fonction de nature sociale ». Michel Thévoz, L’Art comme malentendu, Paris, Éditions de Minuit, 2017, p. 26. ». Le statut artistique des moyens d’énonciation ne saurait masquer totalement qu’ils correspondent à une intention dont on a essayé ici de tracer les possibles contours. Faut-il alors continuer à les considérer comme des objets dignes de contemplation ? Nous émettrons l’hypothèse qu’ils peuvent être considérés comme des documents, dans un sens non-artistique, qui ont valeur de prises de position des plus dangereuses et dont les conséquences sont dévastatrices.
Il faut avant tout remettre en cause l’idée selon laquelle une œuvre d’art, a fortiori une œuvre d’art contemporain, serait forcément « critique », « engagée », etc., en bref : qu’elle serait émancipatrice. Cette illusion exonère de se demander à quelles conditions elle le serait en droit et de vérifier si elle l’est dans les faits. L’affaire Lévêque met ainsi au jour ce préjugé qui accompagne l’œuvre d’art à l’époque contemporaine : l’idée selon laquelle par sa seule nature (on se demande pourtant laquelle), son seul statut (on se demande pourtant lequel), l’œuvre d’art serait nécessairement « critique », facteur d’émancipation et moyen de contestation des dominations établies. Il se peut qu’elle les favorise et les perpétue plus souvent que nous n’étions (ne sommes ?) prêt·es à le considérer. Il n’est pas certain que cet effet de domination relève de sa seule instrumentalisation. Ce doute devrait recevoir l’attention qu’il mérite. L’examen du mythe de l’enfance dans l’œuvre de Claude Lévêque doit enfin nous conduire à remettre en cause un autre mythe, qui l’a rendu possible et qui a permis qu’il se déploie sur plusieurs décennies, celui de l’artiste comme source d’autorité exclusive et comme force d’expression absolue. C’est la source de bien des dominations.
Les faux paradis de l’errance suivi de Le rapt ou petit propos sur un archaïsme —
Chapitres extraits de L’Enfant et le pédéraste, Jean-Luc Pinard-Legry & Benoît Lapouge, Seuil, 1980.
Les faux paradis de l’errance
Se déplaçant sans but, au hasard, au gré de sa fantaisie, l’adolescence vagabonde dont rêvent les pédérastes a pour état l’errance. Elle ne va nulle partC. Rochefort, Printemps au parking, Paris, Grasset, 1969, p. 7, elle ne veut pas s’arrêter aux choses, mais seulement en traverser l’épaisseur. Pour faire échec à l’enfermement familial, il faut en effet imaginer un enfant qui file sur son erre, en vadrouille, sans feu ni lieu : « Il avait quinze ans. Il allait à pied, le long d’une route nationale qui traversait une grande forêt, ou sur un chemin vicinal qui menait à un bosquet planté dans la campagne. Mais plutôt une routeTony Duvert, Récidive, Paris, Éditions de Minuit, 1967, p. 11.… ». Cette vision nostalgique est bien compréhensible : la rue a toujours été présentée par les éducateurs, depuis le xviie siècle, comme le risque majeur, qui pourrait mettre, comme on le dit encore, « l’enfant en danger moral ». Les précepteurs d’autrefois apprenaient aux petits garçons à se tenir dans la rue avec « modestie » et en baissant les yeux, pour éviter les tentationsL’idée vient d’Érasme dans sa Civilité puérile. Les « civilités honnestes pour l’instruction des enfants » l’ont constamment reprise. ; on réclame aujourd’hui, à juste titre, que les enfants puissent enfin sortir, échapper à la surveillance que parents et pédagogues installent comme des pièges autour d’eux.
La réaction aux enfermements « pédagogiques » fait donc de la rue son argument majeur. À l’enfant du dedans, interdit de commerce, « dépouillé progressivement de ce qui lui permet d’exister comme être social, pour devenir bien privéRené Schérer et Guy Hocquenghem, « Co-ire. Album systématique de l’enfance », Recherches, n° 22, mai 1976, mai, Fontenay-sous-Bois, CERFI, p. 28. », propriété des parents qui n’hésitent pas à user sur lui de leur droit de vie et de mortLes enfants le subissent quotidiennement, on s’en convainc à la lecture du livre de Pierre Leuliette, Les Enfants martyrs, Paris, Seuil, 1978., répond l’enfant du « dehors », dont la liberté enfin reconquise passe par la rue. C’est au cœur de la ville moderne que l’émancipation de l’enfance va trouver son théâtre. Non que la « triangulation œdipienne » qui réduit l’enfant, ainsi que le disait Antonin Artaud, à n’être « qu’un angle, un angle à venirCité par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans L’Anti-Œdipe, Paris, Éditions de Minuit, 1973, p. 145. » soit épargnée aux enfants de la campagne, mais il leur manque la possibilité de fuir dès le coin de la rue, en direction de l’inconnu, d’échapper aux règles qui font « qu’il n’y a pas de relations concevables ni licites avec un enfant, hors les cas prévus et codésR. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 45. ». Jacobine à sa manière, la « révolution pédérastique » trouve dans la ville le seul cadre où l’enfant peut conquérir un espace où vivre. Singularité sur laquelle il y aura, naturellement, à revenir.
D’un côté donc le dedans, car « quoi qu’il fasse, l’enfant est dedans. Être enfant, c’est inévitablement « être au-dedans » et se définir par là : maison familiale, école, patronage quelconque pour les loisirsIbid., p. 46. », de l’autre « le dehors », c’est-à-dire la ville, les terrains vagues, la rue. D’un côté une enfance « protégée », élevée dans le coton familial, de l’autre des gamins rendus aux risques de l’aventure. La logique de la privatisation de l’enfant, de son interdiction de séjour au milieu des adultes qui ne sont pas investis d’une autorité déléguée par les « pérémères », a été fort bien décrite par des auteurs dont nous contestons parfois les positions. Sur ce point, leurs analyses sont tout à fait convaincantesEn particulier René Schérer, Émile perverti, Paris, Laffont, 1974, et Tony Duvert, Le Bon Sexe illustré, Paris, Éditions de Minuit, 1973, mais aussi son dernier roman, L’Île atlantique, Paris, Éditions de Minuit, 1979. : nul doute qu’aujourd’hui encore l’enfance est « bouclée ». Le problème n’est pas que l’enfant soit, en conséquence, inaccessible — ce dont bon nombre de pédérastes se plaignentGabriel Matzneff bat tristement le pavé parisien, « les gamins […] sont soit invisibles, soit pressés de prendre le bus pour rentrer chez eux, soit escortés de leurs parents… Les séducteurs font souvent buisson creux… » Gabriel Matzneff, Les Moins de seize ans, Paris, Julliard, 1974, p. 92., comme ils se plaindraient de n’avoir plus accès à une marchandise sur laquelle on aurait mis l’embargo —, mais plutôt qu’il ne s’appartient pas, qu’il ne peut pas disposer de soi-même, et se déterminer librement par rapport aux adultes que la famille lui impose.
Qu’importe pour le moment ; contraint de poser ses relations avec l’enfance dans une fiction puisque « un enfant hors de l’école c’est un pur rêveC. Rochefort, Encore heureux qu’on va vers l’été, op. cit. », le pédéraste n’a que la rue pour entrer en contact avec un adolescent. Il y cherche « le garçon de treize ans qui flâne, disponible, dragable […], l’oiseau rareG. Matzneff, Les Moins de seize ans, op. cit., p. 92. ». Il lui faut profiter des écarts que le garçon s’autorise sur les trajets toujours balisés qui le mènent d’un lieu à un autre. C’est dans la rue qu’il lui faut se tenir, le goût de l’enfant pour les incartades et l’école buissonnière finira bien par devancer ses désirs. C’est ainsi que la rue devient le théâtre imaginaire d’une rencontre à laquelle, aujourd’hui, tout est en principe contraire. Les images « schismatiques » de l’enfance qui y triomphent empruntent beaucoup à une tradition issue du Moyen Âge et revue par le xixe siècle.
Jusqu’à la fin du xvie siècle, les bandes d’enfants ont en effet sans cesse parcouru villes et campagnes, élisant partout leur domicile, mettant même en péril l’ordre social. Enfance misérable, « Chevaliers et Chevalières, déjà bien avant la Grande ErranceC. Rochefort, Encore heureux qu’on va vers l’été, op. cit., p. 172. », ne craignant pas les « coups de mainCe que rappelle Marie-France Morel dans « L’enfant dans la ville (xvie-xixe siècle) », in catalogue de l’exposition La Ville et l’Enfant, Paris Centre Georges Pompidou, 1977, p. 12. Même idée dans Tony Duvert, L’Île atlantique, op. cit., où l’économie enfantine opère par le vol. », « tellement livrés à eux-mêmes qu’ils finissent par perdre toute trace de leurs parentsM.-F. Morel, ibid., p. 19. ». Dans les décombres du Paris de Hugo, gothique à souhait, Gavroche se félicite aussi d’avoir perdu ses parents : « Des fois cela vaut mieux que de les avoir, dit Gavroche qui était penseur […]. Ah ! nous avons perdu nos auteurs, nous ne savons plus ce que nous en avons faitR. Schérer et G. Hocquenghem, « L’éléphant de la Bastille », La Ville et l’Enfant, op. cit., p. 280.. »
Dans le jeu des oppositions que la pensée pédérastique ne cesse de proposer aux enfants, la ville et ses voies ouvertes à la dissolution doivent mettre un terme à la filiation/filature des parents : « Non, ce n’est pas, entonne alors Schérer, un malheur absolu d’être de la rue, non, on n’est pas condamné à mourir de faim, Petit Poucet citadin, dès qu’on coupe le lien avec ses géniteurs. On peut s’en sortirIbid.. »
S’en sortir, c’est d’abord décamper, pour planter son bivouac au hasard des rencontres. L’enfant, dont la superbe liberté attise les enthousiasmes romantiques, est toujours en train de prendre la tangente, il n’est là que de passage, transitoire. La route est son domaine, le vagabondage ce qui le définit et le monde que ses divers parcours dessinent une « anti-société marginale ». Vision idyllique du déracinement, dont on veut bien croire qu’elle correspond en partie à certaines des aspirations de l’enfance, mais qui est peut-être aussi son triste lot, comme l’impuissance (les juristes disent l’incapacité) par laquelle on la définit. La rue où l’enfant « circule » est aussi, dans cette fiction, un lieu de subversion. Traversée par des « flux » incontrôlables dont la description théorique veut faire pièce au familialismeL’Anti-Œdipe, de G. Deleuze et F. Guattari, est plein de carrefours… :« Toujours une connexion s’établit avec une autre machine, dans une transversale où la première coupe le flux de l’autre […] », op. cit., p. 12., elle est l’espace où se dressent les barricades, où le peuple manifeste. C’est le lieu « populaire » par excellence, une scène régénératrice. Par opposition à la famille et à l’école, solidement protégées derrière grilles et portails, la rue est le terrain d’une éducation « nouvelle » (encore et toujours l’école, dans la rue cette fois !) qui va ouvrir l’enfant à la bonne sociabilité, par opposition à la mauvaise socialisation « pédagogique ». Imagerie qui ne va pas sans une certaine naïveté, car la rue n’est pas à proprement parler un lieu « sauvage ». Aussi fascinantes que soient les hordes dont parle William Burroughs et même si « la légende des garçons sauvages se répand de par le monde » et que « les mômes fuguent pour rejoindre leurs rangsLes Garçons sauvages, trad. Mary Beach et Claude Pélieu, Paris, 10/18, 1973, p. 206. », la rue de nos villes n’est peut-être pas le territoire de liberté qu’on veut bien dire. « La voiture a tué dans les rues ce qui restait de l’enfance, imposé la contrainte des feux rouges et des parcs réservésJean Duvignaud, « Dans la ruine des villes, les enfants jouent », La Ville et l’Enfant, op. cit., p. 94.… » Il ne suffit pas de renverser le rapport du dedans (la famille) au-dehors (la rue) pour échapper à l’ordre social qu’on conteste, car la marge étroite dans laquelle on installe à bon compte l’enfance, en lui laissant pour toute pâture les miettes d’un espace urbain qui n’a pas été conçu pour elle, dépend aussi de l’institution. Ce qui n’empêche pas de belles pétitions de principe : « Tout autre, bien sûr, […] la mouvance des gamins dans un espace non spécialement prévu pour eux, […] leur manière de détourner les espaces urbains de leur destination fonctionnelle, […] de faire d’un banc une balançoire, d’un poteau de signalisation un mât de cocagneRené. Schérer, Une Érotique puérile, Paris, Galilée, 1978, p. 13.… » Chapeau bas devant le statu quo ! Banalité à répéter : le dehors est étroitement dépendant du dedans, il obéit à son contrôle. En d’autres termes, les robinsonnades qu’on attend de l’enfant dans les espaces morts de nos villes ne peuvent être que des fictions. Il s’agit toujours, pour lui, de faire « comme si » la ville n’était pas là, comme si elle était « le plus réel de tous les jouets de grande tailleR. Schérer et G. Hocquenghem, « L’éléphant de la Bastille », art. cit., p. 283. », comme si la famille avait disparu du circuit, comme si le capitalisme n’investissait pas aussi la rue. Pour émancipé qu’il soit, l’enfant est toujours de société ; sa place « lui est solidement assignée par et dans les rapports sociaux qui s’incrustent dans sa personnalité et sa corporéité même, dès la plus tendre enfance qui n’est pas — loin de là — “tendre” pour tousJean-Pierre Garnier et Denis Goldschmidt, « La mélodie infantile de l’urbanisme », La Ville et l’Enfant, ibid., p. 103. ». On veut bien croire par ailleurs que le Paris d’avant le baron Haussmann laissait à la rue une certaine initiative, mais ce n’est un mystère pour personne que les mégalopoles modernes sont maintenant entièrement policées. Les « zones » où peut s’exercer, par exemple, la « délinquance » ont elles-mêmes une histoire et témoignent par leur ancienneté de leur caractère institutionnel. Il y a un véritable « repérage » des marges, et leur réglementation fait partie de l’organisation de la cité. Autant chercher un grain de sable dans le désert : la cité contemporaine n’offre plus un seul espace résiduel dont l’enfant pourrait effectivement disposer, où il pourrait jouer librement : « On peut mettre au défi, dit en ce sens Jean Duvignaud, quiconque de trouver dans cet univers rationalisé […] un seul lieu neutre, un seul espace où l’enfance puisse loger ses jeux. Nos “espaces verts” sont d’immondes îlots où pourrissent quelques peupliers grisâtresIbid., p. 95.. » Certains ne manquent pourtant pas de décrire l’asphalte avec des accents lyriques ou d’assurer que les enfants « rêveraient d’une ville décombreR. Schérer et G. Hocquenghem, ibid., p. 282. ». Pas de risque en tout cas que les chers petits s’y perdent : la rue est désormais un des lieux privilégiés de la surveillance où le « système panoptique » est invisible, mais d’autant plus efficace que de multiples regards anonymes suivent l’enfant qui s’y hasarde encore. Les premiers lieutenants généraux de police, comme d’Argenson, se félicitaient autrefois que les homosexuels aient été repérables dans les jardins publics où ils avaient élu domicile ; les commissaires de police peuvent en dire aujourd’hui autant de l’enfance « marginale ». Ils savent toujours où la retrouver, ne serait-ce qu’à l’université de VincennesCf. Le Monde, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 27 février 1979. Les mineurs en lutte qui s’étaient réfugiés à Vincennes avaient choisi cette université parce qu’elle « était le seul lieu de Paris où les flics n’arriveraient pas trop vite » (Le Monde, 10 février 1979).. L’errance ne fait pas de l’enfant un « hors-la-loi », elle ne l’installe pas hors du réseau urbain organisé et planifié : cette évasion-là est une pure vue de l’esprit. Ceux qui la prônent (mais pour eux-mêmes, ils ne font qu’en rêver) oublient un peu rapidement de critiquer la ville dont le capitalisme est producteur. Si bien que « la finalité de la réintroduction de l’enfant dans la ville semble ainsi à mettre au compte des grandes manœuvres idéologiques qui ont pour propos d’inciter tout un chacun à penser la ville comme extérieure aux rapports de production et de faire croire à la possibilité d’une renaissance de tout ce qui est nié par le capitalisme, sans mise à mort de ce dernierJ.-P. Garnier et O. Goldschmidt, op. cit. p. 104. ».
On pourrait ajouter qu’il n’y a pas deux enfances, dont l’une serait bonne et l’autre mauvaise selon qu’elles échapperaient ou non à l’enfermement familialG. Matzneff, comme T. Duvert et bien d’autres, pratique ce manichéisme : « Un gosse de treize ou quatorze ans qui aime ses parents, qui se plaît en famille, qui préfère la compagnie de ses frères à celle de ses copains est […] de la graine de médiocre. Je n’ai pas de temps à perdre avec lui. » G. Matzneff, Les Passions schismatiques, Paris, Stock, 1977, p. 132.. Obligés de se rabattre sur les enfants de prolétaires — relégués dans la rue, en attendant que la collectivité se rappelle qu’ils existent —, les pédérastes n’épargnent pas les « enfants de bourgeois »… comme si on était responsable des parents dont le hasard vous a affublés ! Pour que l’enfance soit rédemptrice, il lui faut être démunie, pareille aux mendiants du Journal du voleur de Jean Genet. Astuce idéale qui laisse à la pauvreté des autres le soin de contester l’ordre établi et aux pédérastes celui de jouer les bons Samaritains et les protecteurs généreux. Quant aux « fils de famille », pour Tony Duvert, ils s’économisent déjà : « Quand on a une jolie figure, de beaux vêtements, une famille bourgeoise, un grand appartement, on sait qu’on vaut cher et on ne se commet pas avec les inférieurs qui ont, comme par hasard, le corps plus dégagéT. Duvert, Le Bon Sexe illustré, op. cit., p. 91.… » Discrimination révoltante, tant il est vrai que ce n’est pas en rejetant aux enfers l’enfance la plus surveillée qu’on fera « voler en éclats les barreaux de la cage familialeG. Matzneff, Les Moins de seize ans, op. cit., p. 65. ». Pour le coup, les pédérastes avouent eux-mêmes les partages sociaux qui traversent une enfance qu’ils voudraient pourtant libre de toute détermination.
Cette ville « dont le prince est un enfant » est trop belle à nos yeux. Elle a les traits de l’utopie, fût-elle aussi séduisante que celle imaginée par Fourier. Ses rues ne sont pas les nôtres, qui n’ont rien des grands chemins de l’aventure. À tous les carrefours il y a un adulte, dont il faut déjouer la surveillance, ou éviter les questions imbéciles. Même les « mineurs en lutteCf. Le Monde, 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24 et 27 février 1979. » à la recherche d’une solution « qui éviterait aux fugueurs l’angoisse de l’inconnu et de la rueLe Monde du 10 février 1979, Pierre Boggio, « Fuguer ensemble ». » dénoncent la vision paradisiaque de l’errance tant exaltée par les pédérastes. Ces rêveurs le savent d’ailleurs fort bien : « L’enfant dehors, c’est-à-dire vivant hors de quelque réseau familial, scolaire, de surveillance en général, est proprement inimaginable, parce qu’irrepérableR. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 46.. » En fait, prisonniers des oppositions les plus banales de la logique, les nouveaux libérateurs de l’enfance ne voient pas d’autre issue à l’enfermement que la sortie, à la fixité des relations familiales que l’instabilité, à la singularité des échanges affectifs que la multiplicité des contacts furtifs, dont la rue est le cadre privilégié.
De tels renversements ne changent rien à l’environnement social et politique de l’enfance, ils ne bouleversent en rien non plus le système économique dont la ville est le lieu symbolique et pratique. On se contente de déplacer l’enfant, de le mettre en circulation sur les lieux de l’échange, de le rendre au commerce public. La rue est avant tout porteuse des échanges économiques, et le gamin errant, privé de tout pouvoir, n’aura souvent pour solution que de s’y vendre aux adultes. La tentative de sauvetage du rapport aux adolescents s’avère alors dérisoire : il ne s’agit que d’un peu de « fric » à récupérer. Ajoutons en passant que les organisations utopiques dont on s’inspire généralement pour rendre l’enfant à la rue, quand ce n’est pas au trottoir, constituent un autre encadrement de l’enfance, le libre usage de l’espace n’ayant jamais été le point fort des phalanstères, familistères et autres colonies de l’avenir. Il n’est pas sûr non plus qu’à favoriser les passions de l’enfance Fourier ait souhaité pour elle le commerce sexuel précoce avec les adultes que les admirateurs de son Nouveau Monde amoureux n’ont de cesse de revendiquer. On va même jusqu’à dire« Or Fourier ne laisse aucune place reconnue à l’activité sexuelle avant la puberté et il maintient les enfants harmoniens non seulement à l’écart de tout spectacle sexuel, mais sans images ou concepts, sans mots (ni défense ou interdiction par là même, d’ailleurs, contre l’auto-érotisme par exemple) pour désigner ce qui se forme en eux obscurément, tant il craint d’incliner avant l’heure ce qui n’a pas encore, selon lui, une forme définie. » Simone Debout, L‘Utopie de Charles Fourier, Paris, Payot, 1978, p. 108. qu’il aurait préféré négliger le désir de savoir sexuel de l’enfant. En faisant de l’errance son thème majeur, l’utopie pédérastique voudrait opposer à la sédentarité des villes occidentales le nomadisme qu’on connaît encore dans le tiers-monde maghrébin. Marrakech, Tunis ou Fez sont plus propices aux révolutions du désir que les espaces bétonnés des villes de la métropole. L’enfant y est paraît-il roi : « Dans les rues, les cafés, les cinémas, on traite les petits en égal. Ils vont sans qu’on les accompagne, prennent place où ils veulent, comme chacun. Ils goûtent ensemble leurs moments d’oisiveté, se retrouvent, rient, courent, se chamaillent, se racontent leurs affaires, étudient à plusieursT. Duvert, Journal d’un innocent, Paris, Éditions de Minuit, 1976, p. 70.. » Pays de rêve s’il en est, où l’on ne saurait oublier toutefois que la liberté apparente des enfants vient du fait que très tôt ils travaillent. Tony Duvert est d’ailleurs le premier à le souligner : « Leur mise au travail précoce les mêle à la vie adulte, ils y répandent leur vivacité, leur nonchalance, leur malice, font briller des lumières et éclater des rires dans les pires mouroirs d’artisansIbid. G. Matzneff, autre habitué du Maghreb, partage le même enthousiasme : « Les rues, les boutiques, les plages grouillent de mômes — et de mômes déjà indépendants, livrés à eux-mêmes, débarrassés de la surveillance de leurs parents. Depuis le gamin grec ou espagnol qui fait fonction d’ouvreuse de cinéma, jusqu’au petit garçon arabe, qui remplace la femme de chambre ou la cuisinière, les enfants et les adolescents jouent dans la vie du Mare Nostrum le rôle économique, social qui au nord de la Loire est le privilège de leurs grandes sœurs et de leurs mères. ». G. Matzneff, Les Moins de seize ans, op. cit., p. 90.. » Dès lors, on comprend mieux que l’attachement jamais démenti des pédérastes pour la ville vient de ce qu’elle est le lieu privilégié des échanges économiques, dont l’enfant est à son tour partie prenante ou plutôt partie prise. Peu importe alors qu’il soit manipulé ou objet d’un trafic, puisque dans la rue on peut se l’approprier. C’est même cela qui séduit le pédéraste dans la fugue. L’adolescent y définirait « son être propre en tant que “pour autrui”R. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 30. », ouvert à d’autres investissements que ceux autorisés dans le carcan familial. C’est pourquoi « la fugue solitaire, entre enfants ou pour elle-mêmeIbid., p. 11. » a mauvaise presse chez les pédérastes. Elle est en effet un refus global des adultes, même de ceux qui ne seraient plus « dans la position parentale ni pédagogiqueIbid., p. 30. » : « Ils sont ternes, ennuyeux ; ils ressemblent tous à mon pèreG. Matzneff, Les Passions schismatiques, op. cit., p. 141. », dit Nicolas. Singulier rapport à la filiation, que la pédérastie ne cesse de récuser, mais dont elle est bien souvent obligée de faire l’aveu : « La pédérastie, seule forme possible de la paternité pour celui qui répugne à fonder une famille. Paternité spéciale, mais paternité tout de mêmeG. Matzneff, Les Moins de seize ans, op. cit., p. 73.. » Qu’on ne s’y trompe pas : l’ailleurs dans lequel on veut faire divaguer l’enfance n’existe pas. Il y a toujours un obstacle à la fugue, remise alors aux calendes grecques. Le fugueur est coincé entre le retour au bercail et le détour du rapt. Autant dire que pour les séducteurs il ne saurait y avoir de fugue qui n’aboutisse à un rapt.
Les enfants fugitifs, échoués dans la rue, faute d’avoir trouvé la « planète des jeunes », ne manquent pourtant pas. Vouée par avance à un échec que l’on a beau jeu de dénoncer, la fugue est cependant le seul acte concret, réel, tangible, par lequel l’enfant manifeste sa rébellion. Aussi limitée soit-elle, même si elle s’achève avec la reprise en main de la situation par les adultes, la fugue a une valeur de témoignage indéniable. Inefficace comme le sont les cris devant l’horreur, elle est porteuse d’une incontestable vérité. Parcours désespéré, où l’enfant prend la mesure de son réel isolement, de la nécessité absolue de se ménager les faveurs d’un adulte philanthrope ou pédéraste s’il veut se maintenir dans les marges de la famille, dont il n’est pas le maître. À travers la fugue, l’enfance découvre immédiatement l’obligation de donner une forme organisée à sa contestation globale de l’ordre établi, auquel on voudrait qu’elle acquiesce. Résistant désarmé face au monde prêt à le soumettre, l’enfant est bien vite contraint d’abdiquer, ce dont on ne saurait lui tenir rigueur, puisqu’il y va de sa survie. En attendant, l’enfant est contraint d’errer : on se demande d’ailleurs où il pourrait, « lassé d’un long voyage », enfin se poser. L’errance et la fugue sont un triste sort, et il faut la sécurité des intellectuels qui ont investi des lieux où ils sont reconnus et installés pour dire le contraire. L’adolescent vit dans une perpétuelle transhumance, parce qu’il n’y a pas de place pour lui, ici-bas. À l’aube de son histoire, il est obligé de répéter nos racines — le nomadisme avant l’apparition des villes. C’est même la seule issue qu’on lui laisse. Aucun lieu n’existe pour lui : du berceau au tas de sable, du jardin public aux terrains vagues, il ne lui reste que des bribes trop misérables pour aiguiser la convoitise. Incarcérer ainsi l’enfance dans le monde de la fugue — sous prétexte d’une soi-disant subversion de l’ordre — voilà bien la politique du pire.
Le rapt ou petit propos sur un archaïsme
Pour accéder à l’enfance, protégée aujourd’hui comme un des biens les plus précieux, le pédéraste souhaite un événement qui vienne bouleverser l’ordre des interdits. Puisque l’enfant est inaccessible, il faut donc l’enlever : « La loi parle de détournement de mineur. C’est un terme faible. C’est ici désir et volonté d’évasion, de rapt, d’enlèvement complice, de voyage hors du temps et de l’espace socialJean-Yves Guiomar, La Muraille ou l’exercice de la parole, Paris, Éditions du Sagittaire, 1978, p. 110.. » Les enjeux concernant l’enfance sont d’une violence dont on ne finit pas de s’étonner. Dernier objet interdit du désir de l’adulte, sanctuaire intouchable, elle demeure un de ces territoires inconnus (autre continent noir) dont on ne cesse de rêver. On sait que l’interdit, loin d’anéantir le désir d’aller voir ce qui se passe du côté de ce qu’il circonscrit, ne fait que renforcer l’attrait pour la transgression. En pédérastie, comme chez saint Paul, c’est la Loi qui fait le péché. Sur ce point, même s’il ne voyait, sous l’effet d’une singulière myopie, dans l’homosexualité, qu’une « bizarre varianteGeorges Bataille, Histoire de l’érotisme, in Œuvres complètes, tome VIII, Paris, Gallimard, 1976, p. 144. » de l’hétérosexualité, Georges Bataille n’a cessé de répéter que « d’une manière fondamentale, ce qui est sacré est précisément ce qui est interditIbid., p. 80. », ajoutant même que « l’érotisme avait fort à voir avec l’unité dans l’agitation violente de l’interdit et de la transgressionIbid., p. 82. » (les pédérastes seraient-ils, en ce sens précisément, de violents agitateurs ?). Placée sous l’injonction du « ne pas toucher », du « corps interdit », l’enfance excite, comme une zone obscure dont on veut percer le secret, bien des convoitises. Elle est en effet pour l’adulte un mystère, dont la clé lui échappe, elle demeure un monde étrange dont la connaissance a presque la valeur d’une révélation religieuse. Il suffirait pour s’en convaincre de voir à quel point les pédérastes empruntent au vocabulaire mystique. Il s’agit donc (même symboliquement) de passer « de l’autre côté du miroir », pour abolir ce qui contraint l’adulte à ne rester qu’en compagnie de lui-même ; il faut accomplir l’acte essentiel, irrémédiable, qui rétablira un contact entre l’adulte et l’enfant que l’institution sociale avait au départ séparés. Seul le rapt, pourtant redouté et redoutable, pourrait être en mesure d’accomplir cette fracture qui ouvrira à l’enfant les portes de la liberté et le fera tomber dans les bras du protecteur qui l’attend au détour du chemin. Il n’y a pas de pédérastie (il faudrait plutôt dire : d’imaginaire pédérastique) sans cette violence fondatrice, qui exige un acte irréparable, mais consenti par tous ceux qui sont en présence. On ne saurait que trop souligner l’ambiguïté de l’attitude de l’enfant : il approuve la violence du rapt, parfois même il la réclame, comme Morgan dans L’Élève de Henry James : « Emmenez-moi…, emmenez-moi, reprit Morgan dont le pâle visage souriait à PembertonHenri James, L’Élève, trad. Pierre Leyris, Lausanne, Mermod, 1958, p. 125. Ce très beau petit livre se déroule dans un paysage qui simule le rapt. Il s’articule autour de deux scènes. Dans la première, l’enfant demande à son précepteur de l’enlever, mais celui-ci, surpris, ne sait que répondre. La seconde, sur laquelle s’achève le livre, signe l’impossibilité de ce rapt ; au moment où les parents (en fait la mère) acceptent l’enlèvement, Morgan, terrassé par l’émotion, meurt.. » Il ne semble pas qu’il y ait pour lui d’accès possible à l’univers adulte, de passage hors de la clôture de l’enfantin, sans une blessure, un meurtre symbolique, auquel en tout état de cause il lui faut se soumettre.
René Schérer et Guy Hocquenghem peuvent donc dire, sans risque d’être contredits, que, « toujours, à l’arrière-fond des rêves d’enfance, scintille l’idée fascinante du raptR. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 9. ». En plaçant ainsi l’érotisme sous le signe de cette violence primordiale, pour laquelle ils trouvent les plus beaux accents, les pédérastes perpétuent en la renforçant, une tradition qui lie la sexualité à l’interdit et à sa transgression et fait de la scène du désir le lieu d’un règlement de compte où l’être désiré n’est là qu’à titre de symptôme. À cet égard, l’enfant, dont on veut s’emparer pour avoir accès à son corps, partage le lot qui reste souvent celui des femmes : objet désiré dans une terreur sacrée, mais qui n’a pour issue que de se soumettre au scénario que son maître en libertinage est prêt à lui imposer. La pédérastie répète ainsi, en le déplaçant, le rapport à la femme : il ne saurait y avoir pour le séducteur qu’une enfance offerte ; quoi qu’il fasse, sa seule présence transforme l’enfant en un « allumeurG. Matzneff, Les Passions schismatiques, op. cit., p. 147. On a trop souvent entendu dire que les femmes violées avaient provoqué l’agression, sauf à penser qu’effectivement la présence de l’Autre absolu (la femme, l’enfant) est insupportable aux hommes et provoque cette réaction. Invoquer l’innocence ou la non-innocence pour dire que l’enfant, comme la femme, est complice du séducteur n’est peut-être pas aussi décisif qu’il y paraît. L’enfant lui-même, quoi qu’il fasse, attiserait le désir ! ». Ce n’est pas à nos yeux le moindre des archaïsmes que de revendiquer une sexualité qui, sous le couvert de l’esprit libre, marque en fait une telle fascination pour la loi. Que saute la barrière entre les âges, que disparaissent effectivement l’adulte et l’enfant et sombrera probablement aussi cette dynamique de la transgression qui trouve dans la pédérastie son dernier refuge…
Les pédérastes n’ont le plus souvent rien du « voleur d’enfants » de Jules Supervielle, et les enlèvements sont de nos jours plus que rares. Nous parlons évidemment du rapt et non du kidnapping que définissent si bien René Schérer et Guy Hocquenghem : « Dans le kidnapping, au contraire du rapt, ce n’est pas l’enfant qui est enlevé pour lui-même, parce qu’il vaut la peine de l’être, objet de désir. Le kidnapping est une relation entre adultes où l’enfant intervient seulement, en tant qu’objet précieux pour les parents, comme monnaie d’échangeR. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 11.. » Le désir de rapt qui traverse constamment le discours des pédérastes tient davantage de la stratégie, il est une sorte de polyorcétique amoureuse, puisqu’il vise à faire tomber, après un long siège, le corps désiré. « Tomber » amoureux de l’enfant c’est, tout d’abord, faire céder ses défenses. On pense à Roland Barthes : « Chaque fois qu’un sujet tombe amoureux, il reconduit un peu du temps archaïque, où les hommes devaient enlever les femmes (pour assurer l’exogamie) ; tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d’une SabineR. Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, p. 223.. » Parlant de l’enfant, on reconduira donc le langage de la capture, de la conquête, où les métaphores empruntées à la chasse dominent et qui placent la séduction sous le signe des activités masculines traditionnelles. La Sabine, on le sait, s’illustre finalement par sa passivité, par sa faiblesse aussi. En fait, en expulsant l’enfant de la gangue dans laquelle la famille le retient, le rapt substitue à la paternité l’ordre de la fraternité, il permet au garçon d’entrer dans le cercle des hommes. Prenant « le parti des enfants contre le despotisme paternelNorman Brown, Le Corps d’amour, trad. Roger Dadoun, Paris, Denoël, coll. « Lettres nouvelles », 1968, p. 12. », visant à instituer une génération de fils « sans père, sans mère, sans généalogie, ne connaissant dans leur existence ni commencement ni finIbid., p. 15.57 », le rapt, pour ce qu’il veut être à la fois un acte d’abolition et le symbole d’une renaissance, s’apparente à tous les rites qui traditionnellement marquent l’entrée des garçons pubères dans la société des hommes. Au cœur même de la socialisation, il a donc pour but d’assurer à l’enfant la formation que la fugue est impuissante à lui donner. Le rapt est alors « l’événement qui rend la fugue irréversible et qui fait que le coup de tête se change en affirmation de soiR. Schérer et G. Hocquenghem, « Co-ire », op. cit., p. 10. ». Curieuse affirmation de soi, pourrait-on dire, puisqu’elle commence avec l’entrée en scène du séducteur, le « malin génie » dont l’enfant a, assure-t-on, « besoin pour exister » et qui lui propose l’ « épreuve dévoratrice ».
Mythologie d’une nouveauté quelque peu réchauffée, l’épreuve du rapt n’est pas, dans le langage des pédérastes les plus militants, sans rappeler ce que l’on peut observer dans les sociétés sans écriture ou dans la Grèce antique : pour soustraire l’enfant à l’influence des mères et lui permettre d’entrer dans une société où il n’aura plus avec les femmes que des rapports « accessoires », il faut une cérémonie de passage, au cours de laquelle les hommes initiateurs l’accueilleront parmi eux. Le thème persistant du rapt est davantage l’arrachement au monde maternel que le retrait de la famille patriarcale. C’est le sens de la séparation des novices chez les Murring : « Les mères, cachées sous les couvertures, s’assoient à même le sol avec leurs garçons devant elles. À un certain moment, les novices sont saisis par les hommes qui arrivent en courant et ils s’enfuient tousMircea Eliade, Initiations, Rites, Sociétés secrètes, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1976, p. 35. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres des multiples simulacres de rapt qui accompagnent l’initiation dans la plupart des civilisations.. »
On pourrait rappeler également que les relations amoureuses dans la Grèce antique étaient coutumières de ces rapts, effectués avec le consentement des pères : « Ce qui est particulier (aux Crétois) ce sont les coutumes réglant les relations amoureuses ; ce n’est pas en courtisant le garçon qu’ils recherchent, c’est par un enlèvement, qu’ils s’en assurent la possessionErich Bethe, Die Dorische Knabenliebe, cité dans Henri Jeanmaire, Couroi et Courètes, Lille, Bibliothèque universitaire, 1939, p. 450. » ; on peut en conclure, avec Henri Jeanmaire que « l’acte d’enlèvement consiste à conduire le jeune garçon dans l’andreion, la maison des hommesIbid., p. 452. », ce qui fait penser à l’existence d’une confrérie aristocratique et militaire exigeant de tels rites d’initiation. Plus près de nous, Gabriel Matzneff reconnaît ce que la pédérastie doit encore aux confréries antiques : « Nous sommes, dit-il, une société secrète, la dernière des sociétés secrètes et nous n’avons pas fini de l’être. Nous sommes les carbonari de l’amourG. Matznetf, Les Passions schismatiques, op. cit., p. 145.. »
On ne peut donc mettre entre parenthèses l’archéologie du raptPour ce qu’il appartient au mythe, le rapt est sédimenté dans la culture, il a un caractère profondément immuable. Mais ses expressions, diverses selon les époques, sont plus ou moins accentuées. Ce que le xviie siècle dit par exemple du « ravissement » n’en est qu’une figure affaiblie., faire comme si celui-ci était de l’ordre de la génération spontanée. Le scénario originel du rapt, inscrit selon nous dans un temps mythique, subit l’érosion du temps, mais il réapparaît sans cesse : de tous les archétypes il est de ceux qui résistent le mieux. C’est sans doute pourquoi un auteur pourtant aussi perspicace que Tony Duvert fonde son « désir d’enfant » sur une indéracinable misogynie. Jonathan, personnage principal de l’un de ses derniers romans, voue par exemple une haine absolue à Barbara, la mère du petit Serge, dont il est amoureux. L’enfant est ici l’enjeu d’une rivalité entre Jonathan et Barbara : mais à travers celle-ci, Tony Duvert vise toutes les femmes, qu’il réduit à leur seul rôle maternel, « une bonne femme qui nous tombe dessus et qui nous fait son numéro parce que son gosse n’est pas chez ellepass:c,q[footnote:[T. Duvert, _Quand mourut Jonathan_, Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 78. ». Ne craignant pas la caricature, il s’obstine à dépeindre les femmes sous les jours les plus futiles ; il les crétinise à plaisir. On a souvent l’impression que l’adulte continue à poser ses rapports avec l’enfant en termes de paternité, et peut-être même de « maternité » qu’il faut dérober à la mère, plus que l’enfant lui-même. Nous dirions volontiers qu’il s’agit d’un texte sur le maternage vu du côté des hommes. Jonathan remplit son rôle de mère en jouant les « pères nourriciers », pour lui encore la cuisine reste le lieu d’un investissement affectif :
En quelque sorte, l’itinéraire initiatique chez Tony Duvert — les questions de nourriture en sont le symptôme — consiste à faire passer l’enfant des bras de sa mère réelle à ceux d’une mère symbolique. En effet, la mère de famille ne fait jamais ce qu’il faudrait, et seul un homme assurant ce modèle semble en être capable. Tony Duvert veut d’ailleurs nous en convaincre quand il décrit minutieusement les préparatifs pleins de sollicitude dans lesquels Jonathan se perd en attendant l’arrivée de SergeIbid., p.17-18.. On ne peut manquer de faire le rapprochement avec l’idée, qui revient constamment dans la tradition initiatique, d’un règne des « mères mâlesN. Brown, Le Corps d’amour, op. cit., p. 48. » sous les auspices duquel l’enfant renaît. Tandis que les pères sont, on sait trop pourquoi, passés sous silence, les pédérastes trouvent dans la mère leur principale rivale, ils lui sont liés par une jalousie féroce pour la jouissance des enfants. Les mères, toujours les mères… celle des « trois locomotivesT. Duvert, Quand mourut Jonathan, op. cit., p. 77-79. » de Quand mourut Jonathan, mais aussi celle du Journal d’un innocentT. Duvert, Journal d’un innocent, op. cit., surtout le début du roman. : la famille de Pablos et de Francesco vit sous la puissance maternelle. Pour prendre un autre exemple, dans L’Élève de Henry James, c’est Mrs Moreen qui mène le jeu et le père, diplomate affairé, est assez insignifiant. On ne peut donc que souligner l’importance de cette rivalité, attestée d’ailleurs dans toutes les civilisations. Les hommes, incapables de procréer, font appel, pour conjurer ce triste sort, à des métaphores de la naissance : la couvade par exempleVoir Claude Boukobza-Haljblum, « La couvade », in Sorcières, n° 4, p. 21., ou à des rites qui privilégient, à l’encontre de la naissance physique, la naissance selon l’esprit. Les pédérastes reprennent à leur compte une mise au monde intellectualisée, semblable à celle d’Athéna, née de la tête de Zeus.
En fait à travers le rapt, le pédéraste dit à la femme qu’elle « doit apprendre que l’homme a besoin de l’enfant et l’enfant de l’homme, avec la même passion qu’est pour elle la violente jouissance de l’accouchementJ.-Y. Guiomar, La Muraille ou L’exercice de la parole, op. cit., p.112. » ; la possibilité de la relation de l’homme à l’enfant doit faire ainsi la preuve que la femme n’est plus nécessaire, qu’elle est même néfaste, elle doit assurer le monopole hommosexuel, si bien que le motif de l’enlèvement n’est pas contemporain de la constitution de la famille capitaliste, il ne cherche pas à rendre public ce qui était privé, mais il reconduit une fois encore le vieux partage du masculin et du féminin, où l’Un ne cesse de s’approprier l’Autre, de le réduire. C’est sans doute pourquoi les pédérastes sont fascinés par la société maghrébine, où l’homme règne sans partage, tandis que la femme est enfermée dans le silence[N.D.É.] Le rapprochement avec la « société maghrébine » repose sur la mise en évidence de la dimension patriarcale de la pédophilie, loin que ce soit là une spécificité « maghrébine ». Il s’agit également d’une condamnation de la fétichisation du monde arabe par une certaine frange du mouvement de libération homosexuelle. Cf. Todd Shepard, Mâle décolonisation : l’homme arabe et la France, de l’indépendance algérienne à la révolution iranienne, 1962-1979, trad. Clément Baude, Paris, Payot, 2017. On peut ici interroger la validité du syntagme « société maghrébine ».…
Les enfants : une oppression très spécifique —
L’enfance est une institution, non un fait
Comme fait, l’enfance (première partie de la vie humaine, dit prudemment le dictionnaire Le Robert) est un état mouvant aux limites imprécises. Comme institution, elle va de la naissance à un âge fixé par décret. On dit « enfants », « adolescents », ou « jeunes » selon les besoins de la cause. La Loi dit « mineurs », et c’est la seule expression claire.
Les sociétés modernes ont légalisé une discrimination fondée sur une différence de force musculaire. Mineur signifie : moindre. Plus petit. Inférieur. Lesdits « enfants » sont un ensemble d’humains plus faibles au combat au corps à corps, constitué par les plus forts en catégorie, et soumis à un statut et à un traitement spéciaux.
Le traitement, appliqué par l’autorité adulte, à laquelle les mineurs ne peuvent se soustraire, consiste à éliminer du potentiel inné les éléments indésirables, incontrôlables, ou simplement superflus, pour ne conserver et développer que ceux utiles à l’exploitation. C’est proprement une mutilation. Une mutilation corporelle, pas seulement un conditionnement mental. Les mutilations corporelles tombent sous le coup des lois dans nos sociétés mais pas celle-là, qui n’est pas avouée comme telle. Elle est dite formation, éducation.
Mesures
Pour estimer à peu près ce qui a été retranché au niveau corporel il n’est que de comparer l’acuité des sens d’un enfant de trois ans, sa vitalité permanente, l’intensité de ses désirs, son regard, son émerveillement, sa tendresse, sa souplesse de chat et jusqu’à son sommeil avec ceux d’un adulte moyen. C’est comme une lampe qui s’est éteinte. On voit à l’œil nu sur quels points cet adulte réussi modèle conforme, se rendant à son bureau par exemple, a été opéré : il n’utilise qu’une faible partie de son équipement sensoriel ; sa musculature est plus ou moins atrophiée, sa colonne vertébrale est soudée ou menacée d’effondrement, sa capacité respiratoire est réduite, son système nerveux autonome est bloqué, ses plexus sont noués, son énergie ne circule pas, il est dérythmé, son corps en est au point qu’il doit le préparer dans un « club » avant d’aller en vacances (s’il peut lui payer ça) ; sa sexualité est misérable, il est plein de maladies psychosomatiques et de dépressions ainsi que de drogues diverses, son cerveau est un magnétophone, ses récepteurs sont saturés, il n’a pas de regard, il dort mal. Ses émotions négatives le dominent ; quant aux positives : il ne connaît pratiquement plus la JOIE. Ne parlons pas de l’émerveillement ce serait trop triste. Sa faculté de relation est rabattue jusqu’à la rétractation totale : l’Autre lui fait peur ! Et tout ça, qu’il n’a pas, il redoute de le perdre. Lampe éteinte qui craint le moindre souffle. Les adultes ont fini par croire que c’est « naturel » de dégringoler à ce point-là. Sinon ils se flingueraient. Mais ça ne l’est pas : c’est une mutilation. Accomplie durant les cinq premières années de la vie. Et si profonde qu’ils aspirent encore à la transmettre. Le mort tire le vif.
L’oppression des enfants est première, et fondamentale. Elle est le moule de toutes les autresEt il n’y a ni hiérarchie ni priorité dans les oppressions. On peut en souffrir plusieurs à la fois (petite fille noire pauvre). Les luttes convergent vers le même ennemi. Les groupes opprimés sont objectivement alliés. Il ne leur manque que de s’en rendre compte..
Universalité
Seule la forme varie. Le découpage ne suit pas le même pointillé selon la classe, d’ordre économique, sexuel, racial-culturel, dans laquelle on naît. On ne coupe pas la même chose chez tous, mais chez tous on coupe quelque chose. Exemple : les petites filles sont privées de force musculaire, leur besoin d’action est retourné contre elles-mêmes ; les petits garçons sont coupés de leurs émotions, sciés en deux. Et pas plus qu’on ne devient un exploité en restant entier, on ne devient un exploiteur sans être rendu infirme. La dévastation est universelle.
On notera aussi que le groupe « enfants » ne souffre aucune exception à la condition d’infériorité : la classe dominante est composée presque en totalité d’adultes possédants mâles de culture occidentale majoritairement blancs. On y trouve exceptionnellement quelques individus provenant de cultures différentes, et quelques femmes, encore que pas dans les vraiment hautes sphères. Mais jamais un seul « enfant ». Jamais. Pas un. Un seul titre : gosse de riches.
Spécificité
Elle commence à la première minute (fessée), et elle ne cesse plus. Elle n’a pas d’horaires. Pas de pause casse-croûte : repas en famille ou à la cantine, surveillée. « Récréations » surveillées, et minutées. Temps de parcours de l’école au domicile généralement contrôlé, surtout les filles. Pas de soirées libres, ou sorties sur autorisation, avec heures de retour prévues. Pas de dimanches, famille, ni de fêtes, famille. Ou groupes avec moniteurs. Pas de vacances libres, famille, ou colonie avec moniteurs (même si les moniteurs sont permissifs, c’est une tutelle). Les garçons qui peuvent aller jouer avec leurs copains en dehors des heures de classe le doivent à la pauvreté de leur famille, ou à son libéralisme, c’est de toute façon une permission octroyée, non un droit. Pas de refuge nocturne, sommeil même sous contrôle. La surveillance est à temps complet. Et pour l’espace : à la maison à l’école dans la rue sur la plage et quasiment aux chiottes.
Champ illimité
Pas de refuge. La chambre (en cas) est entrée libre, les grandes personnes peuvent même ne pas frapper (« tu n’as rien à me cacher »). Les tiroirs peuvent être visités, les cahiers « intimes » lus, le courrier peut être ouvert, voire détourné, ou bien on en demandera l’origine et le contenu : ne pas le faire est considéré comme du libéralisme. Quelle que soit la doctrine adoptée, la marge de vie privée est à la discrétion des parents. On peut surprendre les enfants. Les questionner jusqu’à ce que ça sorte. Où es-tu allé ?
Qu’est-ce que tu étais en train de faire dans ton coin ? Montre tes mains ! Que caches-tu sous ton cahier ? Cacher est une faute : c’est mal, puisque tu caches.
Quand on est petit, on ne trouve vraiment la paix que sous la table. L’interprétation adoptée de ce phénomène universel étant : sous la table, c’est le retour au ventre de maman (les interprétations concernant les enfants vont toujours dans ce sens-là c’est drôle, vers le passé fermé, jamais vers l’espace libre c’est curieux). Ils ont dû oublier, les interprétateurs, qu’ils furent eux-mêmes des enfants et se fourrèrent sous la table pour, tout bêtement, ne pas être en pleine vue. Le temps des tables hélas ne dure guère, on devient trop grand, et super-visible. Un enfant est en permanence sous le regard des adultes. Il n’y a que le taulard qui en soit au même point. Lui, c’est pour le punir. Les enfants, c’est pour les « protéger ».
Les enfants non. À quoi penses-tu ? Je sais ce que tu as dans le crâne. On se trouble, ça se voit, il y a même encore des enfants qui rougissent. On apprend à mentir, mais moins vite à se faire un masque. Certains croient que leurs parents lisent leurs pensées, est-ce faux ? Les enfants sont exposés. Certains deviennent ce qu’on appelle « psychotiques ». Et les doctes matons (pas les gens honnêtes tels Bettelheim) disent que la psychose est organique.
L’expérience des enfants est visitée comme leurs tiroirs, leur façon de ressentir est mise en question, et, si non conforme à l’attente, invalidée, au besoin reconstruite, et à eux resservie comme leur seule vraie vérité propre : Tu n’aimes pas vraiment cette musique Tu veux seulement faire comme tes copains, Tu affiches ces idées pour, Tu es sous l’influence de, etc. Et l’ensemble des enfants est officiellement réinterprété par les experts en enfants. La vraie jeunesse ce n’est pas, c’est.
Les mouvements des enfants sont limités à l’intérieur de ce complexe temps-espace contrôlé. Pas de mobilité sans autorisation jusqu’à au moins 16 ans. Aller se promener s’appelle fuguer, si tu es mineur.
Les mouvements intérieurs sont également réglementés : tu n’as pas de désirs sexuels avant le moment prescrit par tes adultes, ni vers qui tu veux (sens obligatoire vers sexe opposé), sauf permissivité (blâmable et rare). Ils n’aiment pas qui ils veulent hors de la famille. Je ne veux pas que tu vois A., — et dans la famille ils aiment, cela va de soi (les parents n’étant, sur ce dernier point, pas plus libres).
Ils sont toujours disponibles, à la merci des interventions : apporte-moi le journal, un cendrier, va me chercher les pinces qui sont dans le deuxième tiroir en bas du placard de l’entrée, mais non pas ça voyons je t’ai dit les pinces c’est une tenaille que tu m’apportes tu n’as plus qu’à retourner, quand on n’a pas de tête il faut avoir des jambes. À la maison l’enfant est souvent le boy, l’adulte le colonial. On peut interrompre ses activitésLes exceptions savent sûrement qu’elles sont des exceptions..
Un, surtout s’ils jouent : le jeu équivaut à ne rien faire. Le jeu ce n’est pas sérieux. C’est que, le jeu, c’est du plaisir, le jeu ce n’est pas du Travail : si encore on faisait ses devoirs ! La vie n’est pas faite pour s’amuser tu verras plus tard. Les adultes, condamnés au travail, sont jaloux de qui peut encore s’amuser (le mort tire le vif). Et de jeu coupé et recoupé, de rappels répétés à la « réalité », l’imagination finit par en mourir (qui ne se souvient de la mort lente de son imagination).
Deux, surtout si ce sont des filles. On tolère que les garçons refusent de se déranger, spécialement à la demande des mères. Souvent celles-ci, découragées, ou complaisantes, laissent les petits mâles en paix avec les détails triviaux — et ainsi, rendus sourds aux bruits de vaisselle, aveugles aux éviers sales, insensibles aux effluves de poubelles, ils deviennent dans une maison des impotents, conformes à l’image « les hommes ne savent rien faire », donnée comme une nature innée, et répercutée dès l’école par les petites filles déjà résignées à servir ces enfants 365 fois infirmes. Aux garçons est reconnu le droit à des moments de loisir — comme papa. Quant aux filles on sait qu’elles n’en auront pas, autant les habituer tout de suite. Ainsi, automatiquement, on transmet, on imprime dans le corps, au niveau sensoriel et moteur, un destin, une « nature ». Et, très tôt, très insidieusement s’accomplit le découpage spécifique mutilant des deux sexesVoir l’admirable travail de Elena Giannini Bellotti, Du côté des petites filles, Paris, Édition Des femmes, 1974..
Ces interventions, ordres, enquêtes, variables selon la condition des parents, leur caractère, voire leur humeur, sont de pur arbitraire, puisque les enfants n’ont pas de droits définis…
Elles vont de soi quand il s’agit des enfants. On n’a pas le même regard sur eux, d’évidence. Qu’on nomme « oppression » le fait de déranger un gosse, qu’on parle de « droits », étonne.
Objets
On dispose d’eux. C’est sur eux que le trop-plein de tendresse déborde, et aussi de mauvaise humeur. On les pare, dans leurs premières années, non pour eux mais pour des raisons mêlées (sur ce terrain émotionnel-social prospère l’industrie du vêtement). Ils sont aimés, comme des objets, objets précieux, objets trésors. Ou objets tyrans. Ou objets encombrants. Ce n’est pas une relation d’échangeDes familles libérales feront exception sur certains de ces points. Les familles libérales sont une minorité, y compris aux États-Unis, pays de l’Enfant-roi..
On les tient par la main même s’ils marchent et même s’ils n’ont pas envie, on les emmène, en visite, aux enterrements, dans les magasins, chez le docteur, à l’école — que faire d’eux il est vrai, puisqu’ils sont censés ne pas savoir s’arranger tout seuls.
Les décisions familialesDes familles libérales feront exception sur certains de ces points. Les familles libérales sont une minorité, y compris aux États-Unis, pays de l’Enfant-roi. ou légales, les concernant, sont prises sans eux. SouventDes familles libérales feront exception sur certains de ces points. Les familles libérales sont une minorité, y compris aux États-Unis, pays de l’Enfant-roi. ils ne sont pas informés des événements familiaux importants (hors de leur portée, ou traumatisants, décide-t-on). Les occupations des grandes personnes sont plus importantes que celles des enfants qui viennent les solliciter (pas maintenant, je suis occupée). Les enfants dérangent.
Les adultes ne jugent pas nécessaire de s’excuser, s’ils commettent un impair à l’égard d’un enfantDes familles libérales feront exception sur certains de ces points. Les familles libérales sont une minorité, y compris aux États-Unis, pays de l’Enfant-roi.. Ils s’adressent aux enfants sur un registre spécial : plus impérieux, à moins que, désirant se mettre à leur portée, ils ne bêtifient. La raison des adultes est la meilleure, même s’ils disent des bêtises. Le respect se perd, c’est entendu. Tout comme les motifs de respecter. Mais le principe demeure. L’idée d’être courtois envers un enfant ne vient pas. Le monde adulte vit ingénument, sans songer à la remettre en question, dans l’idée d’une différence d’importance entre adultes et enfants.
Inconnus, et pourtant définis — épistémologie
Or, les adultes ne connaissent pas les enfants, et ils ne peuvent les connaître : car ils ne les voient que sous leur regard (forcément).
L’observateur modifie l’observé. Cette loi est spécialement valable en sciences humaines, et dans le cas d’une relation de pouvoir l’indétermination peut aller chercher dans les 100 %. Cela veut dire : l’observation est impossible.
On ne connaît que les enfants-des-adultes, comme on ne connut longtemps que les nègres-des-blancs. Oui missié. Tu n’es qu’une vieille bête de nègre, hein ? Oui missié. Le comportement du dominé est induit : voir les changements spectaculaires et soudains qui affectent un groupe entier, quand il cesse d’accepter sa condition. Black is beautiful.
Pour qu’une observation soit valable, sur les enfants, il faudrait que l’autorité soit définitivement levée et n’existe sous aucune forme.
D’ici là, les enfants sont inconnaissables par les adultes. Le témoignage des adultes sur les enfants est scientifiquement nul. Comment des « esprits scientifiques » se dispensent-ils de poser, dans leur discipline, la question de méthode ?
Parce que l’oppresseur jamais ne la pose à propos de son opprimé. Ce sont pourtant les adultes seuls qui établissent la science des enfants, et donnent de ceux-ci, dans des ouvrages nombreux, les définitions accréditées. Auxquelles les enfants eux-mêmes ont à se conformer. Seuls les adultes savent ce que sont les enfants, et ce qui est bon pour eux.
Non-identité
Si les enfants ne ressemblent pas à l’image accréditée, ce sont eux qui se trompent. Ne se connaissent pas, sont déviants, ne sont pas des « vrais » enfants.
Le portrait de l’enfant-des-adultes est répandu partout, en images publi-propagandes, en mots dans toute une littérature « pour » enfants faite par les adultes, dans une littérature initiatique pour adultes, et dans la tête d’à peu près tout le monde.
Les enfants, tels que vus dans la lumière aveuglante de l’autorité, sont des humains inachevés physiquement et mentalement. Maladroits (longtemps après que leur coordination est assurée), inattentifs, étourdis, fragiles, dispersés, changeants, pas sérieux, ne pensant qu’à jouer, incapables de se débrouiller tout seuls — donc ils ont besoin de protection et de maîtres. Ils restent comme ça inachevés et incapables jusqu’à 18 ans (sauf sur quelques points tels travailler sans salaire ou répondre de ses méfaits devant la loi), puis brusquement, ils s’achèvent. Ils sont attendrissants, adorables, charmants — jusqu’au moment où ils essayent d’échapper au contrôle, où ils deviennent impossibles. Ils ne pensent pas encore, aussi leur opinion n’est pas sollicitéeVoir note précédente., on l’écoute parfois pour leur faire plaisir mais on n’en tient pas compteVoir note précédente.. Ils ne doivent pas être pris au sérieux puisqu’ils ne le sont pas. Respecter un enfant, c’est ne pas être « indécent » devant lui/elle : c’est respecter la morale adulte. Les enfants sont escamotés de l’opération respect.
Ce ne sont que quelques indications parmi des centaines, chaque enfant et ancien enfant peut compléter.
L’image adulte de « l’Enfant » est si profondément imprimée que personne ne sait plus regarder ce qui est sous le nez. Pour nettoyer les yeux adultes, il faudrait prendre à peu près le contre-pied de l’idée reçue : les enfants sont plus complets, ils sont solides, héroïques (voir à quoi ils résistent !), adroits, capables, graves, profonds, leur intelligence est vaste et déliée, ils sont subtils et malins, ils savent se débrouiller, surtout seuls, etc. Cette description est-elle tellement plus fausse que l’autre ?
Évidemment, le manque de confiance dans les capacités en empêche le développement (touche pas tu vas le casser, bang, ça y est c’est cassé qu’est-ce que je disais), et voilà confirmé l’a priori d’incompétence.
Évidemment le maintien en dépendance rend dépendant, et voilà confirmé. Les esclaves non plus « ne savaient pas vivre autonomes ».
La non-considération invalide l’expérience, les sentiments, la pensée, fait douter de soi, et dénie l’identité. On ne sait plus qui on est.
Comme il faut vivre, comme il faut être aimé, on intériorise cette définition par l’autre, cette inexistence, on s’invalide soi-même, et on imite l’image donnée pour vraie. On apprend très vite, étant intelligent, à recueillir les avantages de ce jeu. On donne aux adultes charmés et gratifiants les réponses qu’ils attendent (sinon de toute façon c’est des avanies). On finit par vraiment les croire siennes. C’est ainsi qu’on devient un « enfant ». Que ce rêve adulte devient réalité. C’est ainsi que les adultes produisent l’Enfance, « différente », d’une autre nature.
Temporaire éternel
Il est vrai — elle ne couvre que 18 ans (ou 21, selon la raison d’État). Ça ne fait que le quart de la vie, contre les deux tiers aux travailleurs, et la totalité aux femmes et aux races opprimées, qui ont gagné.
Malheureusement et surtout ce quart, par lequel tout le monde passe, et durant lequel on est à la merci de toutes les manipulations, prépare et permet la suite, c’est-à-dire la soumission aux autres formes d’oppression. C’est un quart totalisant. On n’en guérit pas souvent, et jamais complètement.
La minorité ne finit pas à la majorité, elle se prolonge toute la vie, en infantilisme. Sans parler des parents qui gardent ingénument et à jamais le « droit » d’intervenir dans la vie de leurs grands rejetons culpabilisés, tout est fait, durant le quart totalisant, pour que la dépendance soit chérie, et sous une forme intériorisée comme une seconde nature s’éternise, en besoin de pères, de chefs, de patrons, d’époux, d’experts, de docteurs, d’analystes, de gouvernements, d’instances suprêmes, s’éternise, jusqu’à la mort si possible. Et en vérité au-delà puisqu’entre-temps elle aura été transmise aux suivants. De sorte qu’elle est en fait éternelle.
Régime
Au cœur des « démocraties » modernes, les enfants vivent sous le régime de la tyrannie — avec ses variantes connues, de l’autocrate abusif au despote éclairé et même démissionnaire, qui ne modifient pas le principe.
Bases réelles, analyse de classes
Les enfants, en tant que groupe discriminé par la Loi, sont, dans leur totalité, traités, modelés, corporellement et mentalement, en vue de l’exploitation.
Ils sont toujours la classe inférieure dans celle inférieure ou supérieure (d’ordre économique, sexuel, racial-culturel) où ils sont tombés.
Cette oppression spécifique, inhérente au système patriarcal, a été longtemps vécue dans l’isolement. Aujourd’hui, par suite de l’évolution du capitalisme (explosion démographique, expansion scolaire et des médias, accession des jeunes au statut de consommateurs, etc.), cette classe est actualisée. Ce qui est appelé « crise de la jeunesse » selon la technique conjuratoire (« crise », ça ne dure pas).
Mais quelle que soit la manipulation sémantique il y a constitution en classe, et début d’une longue marche.
Les exécutants du traitement réducteur sont tous les adultes ayant avec les enfants une relation institutionnelle. Parmi eux, les parents occupent une position-clé : à moins d’avoir une perception claire de la politique de l’éducation, ils servent « machinalement » les intérêts de la classe dominante, et dès lors, quelque idée qu’ils aient de la chose, parents et enfants sont dans une relation d’antagonisme.
« Quoi, quelle horreur, comment peut-on parler en ces termes de la plus pure et naturelle des relations humaines ! » Ce sont les adultes qui s’expriment ainsi, on les aura reconnusCeux qui ne s’expriment pas ainsi ne peuvent pas oublier une minute qu’ils sont l’exception si pas la rareté..
Réponse à ces grands sentimentaux : faire accroire que la relation parents-enfants est tissée chaîne et trame uniquement d’amour mutuel et réciproque, c’est hypocrisie et camouflage. Si la fonction réelle, sociale, de cette relation, est tenue cachée, parler du seul sentiment d’amour est une insulte à l’amour. L’amour ne peut que gagner à être débarrassé d’usurpateurs qui utilisent son nom pour leurs propres fins, qui n’ont rien d’amoureuses. L’amour n’a rien à craindre de l’examen, il sera beaucoup plus beau une fois lavé. Seuls les mystificateurs redoutent l’analyse.
Et justement, l’oppresseur a horreur qu’on rappelle les basses réalités matérielles, lui-même plane très haut dans l’idéal, où tout est merveilleux comme c’est. (À part des petits détails si vous y tenez, qui feront l’objet de réformes en temps voulu, quand ce ne sera plus dangereux.)
C’est toujours pareil : il n’y a que l’opprimé qui ressent son oppression. L’oppresseur, lui, est content comme ça, ne souffre aucunement, trouve ça très bien, juste, normal, bon pour l’autre (qu’est-ce qu’il ferait sans nous ?), et « naturel ». « Opprimé » d’ailleurs est un gros mot, qui choque l’oppresseur (autre gros mot) — au fait on le reconnaît à cette réaction, essayez, ça ne loupe jamais.
L’autre (l’opprimé) n’a rien à dire, d’abord parce qu’il n’a pas la parole. Essayer de la prendre pourrait lui coûter chaud, il le sait : en régime de tyrannie, le tyran peut être permissif, il n’en a pas moins le pouvoir absolu, même lorsqu’il octroie la liberté d’expression, il est prudent de ne pas lui dire ce qu’il ne veut pas entendre, voilà pourquoi vos fils-et-filles sont muets.
Le rapport de classes est toujours formulé premièrement dans les termes de l’oppresseur : bien, juste, normal, bon pour l’autre, NATUREL. Et c’est ainsi qu’il doit être ressenti par tous. Surtout l’opprimé. Sinon on entend les clameurs : c’est l’oppresseur bien sûr qui crie au scandale, au sacrilège, à la vulgarité, au ridicule, au de quoi vous mêlez-vous, au dénaturé, au démodé, au meurtre. Et comme c’est lui qui a la sono, sa voix couvre tout. On l’entend d’ici.
Dictionnaire du Maître, ou génie sémantique de la bourgeoisie
Dans l’Entreprise, les choses sont appelées autrement, afin qu’elles ne soient pas vues comme elles sont. Cette ruse de guerre fonctionne très bien, chacun est pris en apprenant à parler dans le piège de son propre langage, et s’aliène soi-même dans la pensée dominante.
Le maître fut jadis le protecteur de l’esclave, le mari l’est encore de sa femme, le patron est, encore de nos jours, le généreux donateur de travail à l’ouvrier, qui sans lui mourrait. Le travail est bon. Le colonisateur apporta aux peuplades arriérées les bienfaits de la civilisation, et depuis que ces peuplades l’ont viré, il leur apporte encore, il n’a pas de rancune, son aide aux sous-développés. Sur ces terrains les luttes ont décodé une partie de la parole dominante. Pas tout, et pas pour tout le monde : les gens parlent encore une langue qui les condamne. Et pour chaque mise au jour d’une oppression spécifique, le décodage est à recommencer de zéro. Avec du coton dans les oreilles pour ne pas entendre les cris d’écorché de l’oppresseur pour qui chaque mot rétabli dans sa signification est une banderille.
Il faudrait un dictionnaire complet, travail de chartreux. En attendant, on va décoder une parcelle, ayant plus ou moins trait au sujet.
Amour familial : bannière bleue et rose sous laquelle est présenté au public le rapport parents-enfants, quel qu’en soit le vécu réel.
Amour maternel : au premier plan. Le plus ancien historiquement. Solidement ancré sur la « biologie » (voir plus haut) et le « destin » (idem) féminins. Exalté par une campagne séculaire d’affiches artistico-religieuses. Complexe socio-émotionnel manipulé aux fins de tenir les femmes à l’écart de la vie publique.
Amour paternel : un peu en retrait sur la photo. D’invention récente. Sa force tranquille est appelée à soutenir l’édifice, qui donne des signes d’affaissementAmour maternel surtout a pris récemment quelques accrocs, de la part des psychiatres surtout. C’est elle qui prend naturellement. Naturellement puisqu’elle apparaît plus, est plus compromise, étant l’exécuteur, et plus vulnérable étant une femme. C’est plus facile d’attaquer la mère. Le père est moins mouillé, bien que de lui tout émane. Mais l’attaquer, c’est s’en prendre au patriarcat. Une offensive est déclenchée d’autre part, contre l’usage millénaire de leur « biologie » à des fins politiques, par les femmes elles-mêmes, en vue de reprendre le contrôle de la procréation.. (Pour plus de détails sur les deux derniers points : analyse éventuelle de la condition parentale.)
Amour filial : récent. Également ancré sur la « biologie ». Sacré : au plus léger doute émis à son endroit, des cris de douleur s’élèvent, poussés par les adultes. Amour filial a pour fonction de graisser les rouages de transmission de la loi du Maître, et d’anesthésier la conscience durant les opérations mutilantes.
Enveloppée dans les plis de ces drapeaux sacrés, l’image sainte de la famille unie et des enfants aimants poursuit sereinement sa carrière d’intouchable, soutenue au besoin par le bras séculier.
Les attaques contre la famille ont toujours été considérées comme démodées, dépassées, sans objet. Moyennant quoi, la famille tient toujours.
« Courroie de transmission de l’idéologie dominante » (Reich) et même productrice d’une morphologie, d’un soma, elle a permis le maintien d’un type coercitif de sociétés — tout en offrant à ses membres des compensations remarquables, tel l’exercice du pouvoir, pour les hommes qui n’en ont pas ailleurs, et pour les femmes qui n’en ont aucun autre ; tels d’autre part les joies de la dépendance, de la fœtalité prolongée, et le moyen d’échapper à la liberté. La famille est un complexe létal, mais sécurisant. Elle aide à supporter l’insupportable, ce qui dispense d’essayer de le changer.
La parole au foyer —
Cendre Valente Rodrigues ~ Merci d’avoir été d’accord pour répondre à mes questions. On peut commencer par ta présentation, qui es-tu ? Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
L’éducatrice ~ Ça fait bientôt quinze ans que je travaille en tant qu’éducatrice spécialisée dans une maison d’enfants à caractère social.
Valente Rodrigues ~ Qu’est-ce qui t’a donné envie d’être éducatrice, et comment tu en es arrivée là ?
l’éducatrice ~ Quand j’étais petite j’étais déjà attirée par le social, surtout par le côté handicap. Lorsque j’étais à l’école je me rappelle que dans ma classe il y avait une petite fille qui était atteinte de trisomie et c’était toujours moi qui allais jouer avec elle. Le fait de ne pas se moquer, d’intégrer les personnes a toujours été dans mes valeurs. À la base, je voulais être juge pour enfants ou assistante sociale, puis finalement je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout ce qui m’intéressait. Au début, j’étais un peu perdue. J’ai d’abord fait un diplôme d’études universitaires générales en psychologie à Lyon. Maintenant ça n’existe plus mais c’était en deux ans. Et en parallèle de ce DEUG de psycho, j’ai fait un an à mi-temps en bénévolat en tant que AESHAccompagnant·e des élèves en situation de handicap. dans une classe de CP. J’accompagnais un enfant atteint de trisomie, je m’occupais de lui tous les après-midis en classe pour qu’il puisse suivre comme les autres. Lors d’un job d’été, j’avais aussi emmené en vacances deux personnes qui étaient infirmes moteurs cérébrales, j’avais dix-huit ans, je n’y connaissais rien, et ça m’a permis de voir que c’était quelque chose qui m’intéressait. J’ai donc fait une formation pour préparer l’entrée à l’école d’éducateur·ices et puis je suis rentrée à l’école. Voilà ce qui m’a donné envie, je n’étais pas forcément dédiée à la base à la protection de l’enfance, et puis c’est la formation qui a un peu changé les choses on va dire.
Valente Rodrigues ~ D’accord, et donc pour rentrer dans une maison d’enfants à caractère social, tu as besoin de cette formation d’éducateur·ice spécialisé·e ?
l’éducatrice ~ Personnellement j’ai fait cette formation en trois ans, mais dans un foyer de ce type, on retrouve un panel de professionnel·les, il y a des moniteur·ices éducateur·ices, d’autres salarié·es qui ont un an de formation, on retrouve aussi des éducateur·ices sportif·ves. Il y a également des personnes qui viennent d’un environnement complètement différent et qui ont cette sensibilité au social, qui ont envie de travailler dans une maison d’enfants. On a quand même une grosse pénurie d’éducateur·ices spécialisé·es aujourd’hui. Quand je suis arrivée ici, on était cinq éducateur·ices spécialisé·es sur mon équipe, aujourd’hui on est plus que deux, dont une qui va partir, il y a un manque de vocation lié aux contraintes du métier et au manque de valorisation.
Valente Rodrigues ~ Tu pourrais présenter ce qu’est une maison d’enfants à caractère social ? De qui elle se compose ? Et quel est ton rôle ici ?
l’éducatrice ~ C’est un lieu où résident une cinquantaine d’enfants de quatre ans et demi à seize ans (avec une possibilité de placement jusqu’à vingt-et-un ans pour les enfants en situation de handicap). Les jeunes sont accueilli·es après décision d’un·e juge pour enfants dans le cadre de la protection de l’enfance donc avec des parcours de vie compliqués et des problématiques toutes différentes. On est scindé·es en quatre groupes de vie par âge, un groupe de petit·es, d’un peu plus grand·es, de préados et d’ados. On est organisé·es en interne, on a une infirmière, une éducatrice scolaire, on a un chef de service, des psychologues, des cuisiner·ères. Cette organisation permet d’accompagner au mieux les enfants accueilli·es. Certain·es enfants n’ont pas de parents ou rentrent très peu chez elles·eux, alors on travaille trois-cent-soixante-cinq jours et nuits sur trois-cent-soixante-cinq, on a aussi des veilleur·euses qui prennent la relève des éducateur·ices la nuit.
Valente Rodrigues ~ Alors, en tant qu’éducatrice, tu fais partie d’une équipe éducative. Quels sont pour toi les points positifs et négatifs dans le fait de travailler de manière collective ?
l’éducatrice ~ L’un des points forts, pour moi, c’est la complémentarité, c’est-à-dire que, pour qu’une équipe fonctionne bien, le fait d’être complémentaire c’est enrichissant, ça permet d’avoir des postures différentes. Ça pose un équilibre entre nos qualités et nos défauts, quand il y a un·e éducateur·ice qui est plus à l’aise pour faire quelque chose et l’autre moins, on sollicite plus les qualités de l’un·e. Ça permet aussi de faire tiers, parce que dans notre métier, on a besoin des fois de se passer le relais. Travailler en équipe c’est beaucoup de soutiens, de solidarité, de bienveillance, on cultive toutes ces choses-là, c’est un peu comme un couple, ça s’entretient. Au niveau des côtés moins simples, je dirais qu’il faut s’adapter parce qu’on a tous·tes des caractères différents. Il faut donc être capable d’écouter les autres, de faire des concessions pour que ça fonctionne parce que des fois on n’est pas d’accord. Ces capacités sont nécessaires pour que le travail en commun fonctionne, encore plus au sein d’un foyer, pour nous ce serait impossible de ne pas travailler en équipe, c’est juste primordial.
Valente Rodrigues ~ Qu’est-ce que tu retiens, ce que tu préfères dans tes moments passés au sein du foyer ?
l’éducatrice ~ Ce que je préfère, c’est les petites victoires de tous les jours. On a l’impression que c’est très compliqué mais en fait c’est aussi beaucoup d’émotions et beaucoup de fierté, quand par exemple un·e enfant va mieux, quand un·e enfant réussit quelque chose qu’iel n’arrivait pas jusqu’à maintenant. Des jeunes qui rentrent chez elles·eux, ou pas, mais qui arrivent à se projeter et à être autonomes dans la vie. La vie collective c’est aussi plein de bons moments au quotidien, de la complicité, de la rigolade. Et puis, ça j’en suis un peu garante du fait d’être là depuis quinze ans, mais tous les retours des ancien·nes parce que ça fait toujours plaisir de voir ce qu’iels deviennent, que pour certain·es, tout se passe bien. Et qu’iels soient capable de nous dire, après coup, ce que le foyer leur a apporté et ça fait du bien. Je suis un peu la gardienne du phare au final.
l’éducatrice ~ Oui, parfois je croise des ancien·nes placé·es qui me disent qu’iels n’osent pas forcément repasser au foyer. Je pense que c’est important qu’il y ait au moins une ou deux personnes qui puissent les accueillir pour discuter du temps où iels étaient placé·es.
Valente Rodrigues ~ Puis ça permet aux enfants placé·es actuellement de voir que la réussite est possible.
l’éducatrice ~ C’est ça, celles·eux qui sont placé·es actuellement prennent aussi conscience que quand les ancien·nes repassent au foyer, l’équipe éducative est disponible et que la porte est toujours ouverte. C’est vrai que ça leur redonne de l’espoir parce que la grande angoisse des enfants accueilli·es, c’est d’être tous·tes seul·es à dix-huit ans, d’être à la rue. Ça leur permet de comprendre que même en ayant une situation compliquée et des difficultés à l’école, on peut avoir plein d’autres compétences et on peut s’en sortir.
Valente Rodrigues ~ Concernant le projet que j’envisage d’organiser dans le cadre de ma troisième année de licence en graphisme, j’aimerais beaucoup intervenir ici avec les enfants. J’aimerais que tu me dises si, selon toi, il y aurait des choses à changer, à mettre en place au foyer, à tous les niveaux.
l’éducatrice ~ Alors si on parle de manière générale, je dirais le taux d’encadrement. On voudrait que les enfants ne soient plus autant par groupes parce qu’on est actuellement cinq éducateur·ices pour encadrer une quinzaine d’enfants au quotidien et cette situation est frustrante aussi bien pour nous que pour elles·eux. On n’a pas assez de temps à leur accorder, donc on ne fait pas le travail qu’on aimerait faire pour les accompagner. Baisser les effectifs pour n’être plus que des groupes de dix enfants ce serait génial, on le réclame depuis longtemps mais on n’a pas forcément les moyens et l’État qui suit. La seconde chose, après il y a plein de choses qui doivent changer, mais ce serait l’accès aux soins. On sait qu’on a des enfants qui ont énormément besoin de soins et aujourd’hui on est dans un territoire dans lequel on a très peu d’accès à tout ce qui est psychiatrie et psychologie. On est confronté·es à des jeunes qui ont du mal à aller voir des psychologues, c’est compliqué parce qu’iels pensent que se confier à un·e psy c’est être folle·fou. Être en face d’un adulte et parler de son histoire c’est assez violent pour certain·es, on voudrait avoir plus d’interventions de l’ordre de la psychologie « plus douce » comme l’art thérapieForme de psychothérapie qui utilise la création artistique., tout ce qui est médiation par les animaux, espace SnoezelenPratique de stimulation multisensorielle accompagnée et contrôlée, visant à éveiller et à canaliser la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante.. Des choses qui permettraient aux enfants de travailler sur leurs histoires et problématiques de manière plus ludique et plus valorisante. Voilà ce qu’on aimerait mais pour l’instant on n’y est pas, on n’a pas les moyens.
Valente Rodrigues ~ Est-ce qu’il y a déjà eu des interventions à destination des jeunes au sein du foyer ? Des ateliers, que ce soit artistique, pédagogique ou autre ?
l’éducatrice ~ En termes d’atelier, on a un partenariat avec Lions ClubsService international de bénévoles. Il s’agit de la plus grande et importante organisation de clubs philanthropiques, caritatifs et humanitaires au monde. qui est un club de personnes bénévoles qui s’engagent à mener des actions dans un esprit humaniste, iels collectent des fonds via des campagnes. Ces personnes nous proposent différentes interventions, je sais qu’il y a un groupe qui était allé faire un atelier avec l’équipe d’une maison d’éditionUne maison d’édition spécialisée dans la bande dessinée d’humour., au musée de la villeUn musée d’art et d’archéologie.. On a aussi un partenariat avec l’école d’art locale, je crois que les petit·es de l’unité 1 s’y rendent tous les mercredis. Le théâtre de la ville nous propose également d’assister à des spectacles artistiques plusieurs fois dans l’année. Au niveau des ateliers pédagogiques, on essaie de mettre en place des choses. Avec la psychologue, un éducateur et quelques jeunes, on a pu travailler notamment avec un jeu qui s’appelle le Qu’en dit-on ?Jeu de cartes et support d’expression.. C’est un jeu qui nous a été présenté par une association d’aide aux victimes, le CRIAVSCentre ressource pour intervenant·es auprès d’auteur·es de violence sexuelles.. Il était beaucoup utilisé en prison pour débattre sur des sujets de société avec des exemples de situations. Dans ce jeu il n’y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse mais ça permet aux enfants de débattre sur un sujet précis, par exemple le harcèlement. C’est un bon exercice mais si on arrive à le faire déjà une fois dans l’année c’est incroyable… Autrement les ateliers c’est surtout en externe, avec la Maison des adosLieu d’écoute et d’accompagnement lié aux souffrances adolescentes pour les jeunes de onze ans à vingt-cinq ans (décrochage scolaire, questionnements liés à la sexualité, aux addictions…). ou le CMPLe centre médico-psychologique est un lieu de soins public offrant des consultations médico-psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. qui proposent des groupes de parole. Idéalement on aimerait organiser ça au sein du foyer mais on n’a pas forcément le temps, l’encadrement, ni les moyens de faire venir quelqu’un·e de l’extérieur. En fait, en réfléchissant, il y a un groupe qui a été monté et qui n’existait pas à ton époque, c’est le groupe des droits de l’enfant. Il a été créé par le Placement familialStructure s’occupant de faire le lien entre les enfants placé·es en famille d’accueil, la famille d’accueil et les parents.. Dans ce groupe il y a des enfants du foyer, des enfants du placement familial et deux éducateur·ices, iels travaillent tous les ans sur un thème qui concerne les droits des enfants placé·es. Cette année, iels travaillent sur l’accès au sport, au divertissement et à la culture. L’année dernière, à la suite de leur projet, iels avaient fait une édition et iels étaient allé·es à Paris rencontrer le défenseur des droits de l’enfant. C’était une rencontre intéressante, les jeunes ont eu l’occasion de discuter avec lui de leur condition d’enfants placé·es, de ce qu’il faudrait changer, iels ont pu avoir la parole et c’était assez valorisant.
Valente Rodrigues ~ Et ce n’est pas du tout médiatisé ? Personne n’en entend parler ? Dans tous les cas, les enfants placé·es sont continuellement invisibilisé·es, personne ne nous voit, personne ne veut nous voir.
l’éducatrice ~ Oui c’est un fait. Pour ce qui est du projet des droits de l’enfant, peut-être qu’il a eu des articles dans le journal local, mais c’est vrai que ce n’est pas vraiment médiatisé. En tous les cas ça permet quand même de rencontrer le défenseur des droits. On sait que ces dernières années l’Aide sociale à l’enfance a été un peu représentée notamment à travers des reportages à la télé, ça donnait un peu plus de visibilité aux maisons d’enfants et on espère que ça fasse un peu bouger les choses.
Valente Rodrigues ~ Concernant le mémoire que j’ai rédigé au cours de ma troisième année de licence, j’ai porté mes réflexions sur des propositions collectives et sociales dans le domaine du graphisme. Notamment le travail de Formes Vives, un collectif de graphistes qui est intervenu dans la ville de Chaumont avec comme proposition de créer avec les habitant·es un journal de ville permettant de donner la parole à chacun·eJournal de ville développé par le collectif Formes Vives dans le cadre du 21e festival de l’affiche et du graphisme de Chaumont, 2010.. Je me suis intéressée à travers ce mémoire aux questions organisationnelles que pose la création collective, ainsi qu’à la notion de hiérarchie à travers le collectif. Je voulais savoir si selon toi, la hiérarchie est indispensable pour le bon fonctionnement de la vie en collectivité ?
l’éducatrice ~ Oui pour moi la hiérarchie est indispensable, je pense que les enfants qui arrivent chez nous sont tous·tes insécurisé·es. Notre mission première c’est donc de les mettre en sécurité et pour moi, l’organisation et la hiérarchie viennent justement sécuriser l’environnement. Le fait de hiérarchiser donne une place et des rôles à chacun·e, ça simplifie le travail et ça donne aussi une valeur aux compétences et aux formations de chacun·e, ça pose un cadre et c’est ce dont on a besoin.
Valente Rodrigues ~ J’aimerais beaucoup proposer aux enfants du foyer un atelier qui aurait pour thématique la vie en collectivité puisque c’est leur quotidien, mais j’ai encore des questionnements sur la manière de le mettre en place. Est-ce que tu aurais des idées de sujets, de formes adaptées aux jeunes du foyer ?
l’éducatrice ~ Je pensais à la bande dessinée parce que c’est quelque chose qui leur parle et qui pourrait être simple pour elles·eux. Après, comme je disais, iels avaient fait une édition pour le projet des droits de l’enfant donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose en lien à ce projet. On est toujours en recherche de formes ludiques à éditer. En ce moment on travaille autour de la sanction avec les enfants, notre chef de service nous a demandé de trouver des formes pour matérialiser nos réflexions. On n’avait pas envie de faire un simple traitement de texte parce que ça ne rend pas les enfants acteur·ices de ce travail, alors on essaye de trouver des formes mais ça n’a pas vraiment avancé. Je pense qu’il serait intéressant d’aborder le sujet en réunion d’équipes pour avoir l’avis de mes collègues sur ce qui pourrait être envisageable, en tenant compte de ce sur quoi iels travaillent en ce moment avec les enfants.
Valente Rodrigues ~ J’avais réfléchi à une proposition mais il faut encore en discuter avec les autres éducateur·ices et avec mes professeur pour voir ce qui est possible avec le temps et les moyens qu’on a. Peut-être que faire un atelier un peu anecdotique tourné autour de la vie en collectivité, collecter des objets, des lieux, des mots en lien avec le fait de vivre ensemble et faire de toute cette collecte un objet graphique.
l’éducatrice ~ Oui, un recueil de souvenirs, qui pourrait permettre qu’iels retiennent quelque chose de positif de leur placement, au même titre que les albums photos qu’on crée pour chaque départ. On essaie toujours de prendre un maximum de photos des moments importants de leurs enfances. Oui, c’est une bonne idée, j’avais aussi pensé au fait de monter avec elles·eux une histoire dans laquelle il y aurait des héro·ïnes qui leur ressemblent. Qu’iels puissent dire ce par quoi iels sont passé·es. Il faudrait qu’on s’organise. Ce serait un groupe d’enfants qui serait ciblé ou tu préfèrerais quelque chose de plus collectif, est ce qu’on ferait ça à distance ou est-ce qu’on pourrait trouver un moment où tu pourrais venir ?
Valente Rodrigues ~ Si on réussit à mettre en place quelque chose, le but c’est que je me déplace jusqu’ici, que je sois au foyer avec vous pour animer l’atelier.
l’éducatrice ~ C’est vrai qu’un livret d’anecdotes sur leurs souvenirs au sein du foyer, ça peut être assez « facile » parce que si on imagine que tu ne réussis pas à te déplacer, on peut le faire à notre niveau avec les enfants et travailler à distance avec toi. Mais dans l’idéal, ce serait bien que tu sois avec nous, même pour les enfants, le fait que tu sois une ancienne d’ici, c’est très intéressant.
Valente Rodrigues ~ Au niveau de l’organisation, je me suis pas mal questionnée sur l’endroit dans lequel faire cette rencontre. Si on le faisait plutôt au foyer dans une pièce, dans la cour ou alors justement à l’extérieur du foyer pour sortir un peu du cadre parce que parfois, on a besoin de prendre du recul pour mieux réfléchir ? J’imaginais ça en me disant qu’une poignée d’enfants accompagné·es d’un·e ou deux éducateur·ices avec moi serait une organisation envisageable. Je pense qu’il faudrait commencer par discuter avec le groupe concerné pour savoir ce qu’iels auraient envie de faire, de quoi iels auraient envie de parler aussi. Je ne sais pas si ça intéresserait tous·tes les enfants, je me dis que faire une sélection en prenant uniquement des jeunes vraiment intéressé·es serait peut-être la configuration idéale. Mais au final est-ce que prendre juste une poignée de personnes, ça représenterait vraiment le collectif ? Et en même temps, c’est compliqué de faire quelque chose qui prendrait en compte tout le monde.
l’éducatrice ~ Oui, c’est compliqué, il faut que tout le monde puisse prendre la parole, parce qu’il y a des enfants qui prennent plus de place que d’autres, certain·es qui, au contraire, n’osent pas parler. C’est pour ça qu’il faut penser le format, mais si on part sur ce qu’on a évoqué, les souvenirs, je pense que ça pourrait les animer, surtout si toi, d’abord, tu arrives avec les tiens. Les enfants se diront forcément « Déjà, on parle à quelqu’un qui connaît ce qu’on a vécu » et ça rend l’échange plus facile. En ce qui concerne le lieu, le faire ailleurs ça pourrait être bien, on pourrait aussi dire qu’on se déplace dans un endroit inhabituel.
Valente Rodrigues ~ C’est une bonne idée. Si on sort du projet, est ce que tu penses qu’il y aurait des formes éditoriales à recréer pour ici ? Des chartes par exemple ?
l’éducatrice ~ Oui, il y en a beaucoup. Aujourd’hui on peine déjà à faire notre travail d’accompagnement au quotidien, alors concernant l’administratif, c’est assez compliqué. On est pourtant dans l’obligation légale de fournir des documents, comme le livret d’accueil par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens l’avoir lu, mais il n’est pas vraiment ludique et accessible, on essaie de travailler sur ces choses-là mais on n’a pas forcément les compétences et le temps pour le faire. Le livret d’accueil c’est censé être la première chose qu’on donne à l’enfant quand iel arrive alors il se doit d’être accueillant et on n’est pas encore au point. En réalité, il y a plein de formes à revoir, on sait que ce n’est pas intéressant si les outils à destination des enfants sont juste des pages de texte parce qu’il faut que ce soit accessible, il y a du travail. En parallèle du livret d’accueil, on avait pensé à créer des carnets individuels permettant aux enfants de recenser leurs premières fois en tout genre, leur parcours de vie au foyer avec les choses marquantes. Là aussi, c’est une forme qui pourrait manquer, d’ailleurs si tu prends du recul, en tant qu’ancienne du foyer, tu es la première à savoir quels documents tu aurais aimé avoir pendant ton long séjour ici.
Valente Rodrigues ~ C’est aussi ça qui m’a convaincue dans l’idée de travailler avec vous. Je me mets à la place des enfants placé·es au foyer puisque je l’ai été et que légalement je suis encore placée en appartement éducatifLe service Placement éducatif prend en charge des jeunes âgé·es de seize ans à vingt-et-un ans accueilli·es en appartements indépendants sur la commune.Iels sont accompagné·es vers une sortie du dispositif de la protection de l’enfance. jusqu’à mes vingt-et-un ans. Je te remercie pour cet échange.
Déjouer la minorité, retrouver l’enfance —
Le premier contrôle nécessaire à l’officialisation de la présence du jeune Ashkan est sans cesse retardé, sans aucun terme. Le mineur subit une séquestration qui à la fois l’arrête dans son mouvement et empêche le mouvement de s’arrêter. Lui aussi, il ne peut que zoner au sein d’une attente sans contour, ni destination. Peut-être finira-t-on par l’oublier, par le faire entrer dans la case des « oubliables » qui n’ont pas de nom, de lieu ou d’autre temps que celui où le toujours et le jamais se confondent. […] Lui, comme tous ceux qui ne peuvent jamais s’installer mais seulement traverser sans se fixer, il devient un sujet traversé, troué, spectralisé. Rien n’en est vu, rien n’en est su, rien ne peut être demandé ou reproché aux instances qui devraient, surtout celle supposée en charge des enfants, les protéger et les assurer dans leurs droits. Car, ici, il n’y a plus d’enfant. Il n’y a qu’un « illégal sur le territoire » ; un élément qui fuit la légalité instaurée par la Politique et la Poétique d’une forme de communauté qui l’a depuis toujours effacé. Il disparaît comme sont forcés de le faire tous ceux que nos narrations parquent dans les cases vides de leurs inscriptionsCamille Louis, La Conspiration des enfants, Paris, Presses universitaires de France, 2021..
Il y a l’enfance et ses voyages — dont les récits peuplent les imaginaires des grands attendris —, il y a les incessants mouvements des enfants qui tantôt fascinent, tantôt terrifient ou insupportent, il y a toute une sédimentation sensible et affective de cette association entre enfance et déplacement… puis il y a des enfants qui, parce que voyageant, parce que circulant au-dehors comme au-dedans, ne sont plus des enfants mais sont surtout et seulement des « migrants ». Sujets à parquer, à « retenir » dans des centres adaptés, ou à expulser… les mineurs non accompagnés (MNA) posent problème à « l’enfance » telle qu’elle est gérée et fabriquée par des agents et institutions dédiées (l’Aide sociale à l’enfance notamment) mais aussi telle qu’elle est conçue, fantasmée ou jugée normale à l’intérieur de nos sociétés. L’enfance légitimée se façonne à l’inverse des contes de voyage comme des gestes des enfants turbulents : elle doit être sédentaire, protégée dans le foyer de la famille « nucléaire » dont, pourtant, la terreur potentielle se lit à même le nom. Les jeunes qui sont sortis des maisons, partis du nid et du « natal » de leur pays d’origine sont donc perçus, « ici », dans les pays d’arrivée (souhaités ou imposés) tantôt comme des « enfants à sauver » c’est-à-dire à réintégrer dans les formes de « l’enfance » acceptable et acceptée, tantôt comme des dangers à repousser hors des frontières des pays mais aussi hors de l’enfance idéalisée qu’on refuse de leur attribuer. « Déboutés de la minorité », voilà le nom barbare donné souvent à des enfants transformés en sujets barrés du fait d’un âge jugé au-dessus de la barre de « minorité ». Ces reconnus non-mineurs comme ces « mineurs isolés », défaits des liens qui tissent l’assurance du foyer, en effet ne sont plus juste ce que l’on dirait de tout individu de 11, 15 ou même 19 ans : ils ne sont plus des enfants. Et, aux bords des enceintes pré-posées pour clore, cerner et surveiller « l’enfance », ils errent…
Si nombre de contributions constituant cette nécessaire anthologie tentent, en la « politisant », de remettre en question les procédés politiques et logiques qui font de l’enfance une « nature » (c’est notamment ce que défendent les précieux travaux de Tal Piterbraut-Merx dont nous avons été privés trop tôt) ; si plusieurs cherchent à sortir les enfants de la catégorie essentialisante de l’ « enfance », que faire quand on souhaite s’approcher de celles et ceux qui en ont déjà été extirpés, chassés, expulsés ? Comment retrouver, sous l’imposition ou l’exclusion de la « minorité étrangère » fabriquée en identité, la part d’enfance revendiquée par certains jeunes catégorisés « mineurs isolés étrangers » puis « mineurs non accompagnés » ? Sous la difficulté logique, se tient peut-être un défi esthétique et surtout une chance politique : celle de s’approcher non pas des « mineurs migrants » mais de jeunes gens qui, circulant entre les bords des nominations qu’on leur donne arbitrairement, trouvent aussi les armes pour sortir (plus ou moins symboliquement) des institutions trop souvent pensées pour mais sans les enfants. Ce qu’ils trouvent alors en jouant — comme je tenterai de l’exposer — avec les cadres et structures prévus « pour mais sans », ce n’est justement pas « l’enfance » mais ce qui fait de chacun d’eux, de manière singulière, d’une part, des témoins de ce que notre monde fait à l’enfance et, d’autre part, des porteurs d’enfances de mondes possibles, de monde commun qui résiste à la violence des frontières comme à la criminalisation des solidarités en se façonnant le long de relations improbables maintenues entre personnes, histoires, paysages… Dans ces trajets de jeunes gens partis de leur foyer et de leur pays, l’enfance n’est pas un acquis mais se vit comme un combat, un conflit générateur de devenirs et potentiellement capable de restituer aux jeunes souvent victimes de violences policières leur statut d’acteurs et actrices politiques à part entière.
J’insiste sur le registre que je viens d’utiliser : le potentiel et le pluriel. Car je n’entends pas ici analyser, en l’isolant une nouvelle fois, « le cas du mineur isolé » : cela équivaudrait à une reproduction de la police identitaire qui parque ces jeunes plus ou moins grands en annulant tout autant leurs espoirs de déplacements que les devenirs qu’ils contiennent. Je souhaite, à l’inverse, à partir de l’observation « des politiques de l’enfance » — qui, dans leur mode d’activation auprès de ce « public cible » des MNA, devraient être nommées « polices de l’enfance »Je ne peux partager ici qu’une dimension condensée de ces réflexions plus poussées et développées dans La Conspiration des enfants. En plus de ce dernier, je souhaite renvoyer aux excellents travaux de Cléo Marmié, en particulier à cette analyse publiée sous le titre « Devenir “mineur non accompagné”. Enjeux épistémologiques et effets pratiques d’une catégorie d’intervention publique », in Migrations Société, n° 3, vol. 189, 2022, p. 41-57. — m’approcher des stratégies de détournement et d’évitement choisies par ces identifiés « mineurs non accompagnés », ou mineurs déboutés de la minorité, pour tout simplement exister.
Ex-istere : sortir du lieu assigné, se déplacer, s’extirper d’un point d’origine qui, pour des raisons diverses, nous a étouffés. La lutte pour l’existence est un élan commun qui nous rapproche de ces jeunes sans cesse « encampés » (symboliquement, conceptuellement ou très concrètement) et qui nous rapproche de l’enfance conçue non plus comme stade « primaire », première nature et immaturité, mais comme puissance et dynamique partagée. Il s’agit moins là de « politiques de l’enfance » que, en effet, d’une politisation de l’enfance qui la « délisse » et la laisse apparaître comme conflictualisée, divisée, perdue-regagnée et comme pouvant nous offrir ainsi des outils pour, au cœur de notre perte de monde sans cesse plus affirmée, se remettre à l’inventer.
C’est en tant que philosophe, que dramaturge mais surtout que personne engagée auprès des personnes en exil que j’écris ici, au croisement de l’expérience, de l’espérance et de mes tentatives d’enfant, gardées dans mon présent de « grande », de toujours me déplacer, me rapprocher des déplacements et des déplaçants comme une manière de tenir au monde, à ce qui fait monde et non sinistre globe homogénéisé : l’alliance des altérités.
La fabrique du mineur non accompagné
Depuis plusieurs années, la présence et surtout la gestion des « mineurs non accompagnés » est devenue une « réalité » à laquelle, en France, sont confrontés en premier lieu les départements puisque ce sont ces derniers qui, depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, sont compétents en matière de protection de l’enfance. Celles et ceux dont la nomination insiste sur l’isolement et la privation de structures de protection (« la famille » dont les « isolés » puis « non-accompagnés » sont donc dépourvus ce qui, dans la conception occidentale, les présente de fait comme « en danger ») devraient donc être immédiatement pris en charge dès qu’ils arrivent sur le territoire. Et pourtant, ce que vivent alors la majorité des jeunes exilés ressemble moins à une arrivée qu’à un nouveau parcours du combattant, donnant l’impression que leur voyage, ses embûches, ses violences, ne s’est jamais arrêté et ne s’arrêtera jamais. La « réalité » d’une jeunesse en danger est rapidement transformée en fantasme d’une jeunesse dangereuse dont chaque élément serait inévitablement porteur de perturbation. Nombre de départements se disent en être « débordés », voire leurs services « saturés » par ce « public » particulier que, quand ils ne peuvent l’ « intégrer », ils craignent de voir tout saccager : les infrastructures comme le calme préservé des habitants locaux qui se verrait menacé par la présence errante de ces gamins des rues, de ces graines de délinquants.
En amont du tri entre les bons mineurs et les potentiels délinquantsTri que la circulaire de Darmanin du 17 novembre 2022 portant sur l’exécution des ordres de quitter le territoire français (OQTF) et le renforcement des rétentions vient explicitement et sans honte aucune reconnaître et renforcer. qui va s’opérer dans un second temps, lorsque les jeunes auront réussi à rester un certain temps dans tel ou tel département, s’active dès la première prise de contact qu’ils font avec ce dernier toute une procédure de contrôle qui ne fait plus de leur « enfance » une donnée à considérer dans sa vulnérabilité, mais le lieu d’un soupçon. Si celui-ci a toujours accompagné, de manière plus ou moins ostentatoire, la procédure d’accueil des jeunes se déclarant MNA, il s’affirme et fait loi, en France, depuis un décret du 30 janvier 2019, issu de la loi asile et immigration de 2018. Avant celui-ci, tout jeune arrivant sur le territoire et demandant sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance voyait son dossier examiné par le conseil départemental de son lieu de résidence puis s’entretenait avec un travailleur social afin que soient confirmés sa minorité et son isolement. Depuis, la première modalité de réception à laquelle est confronté le jeune n’est plus placée sous le prisme de l’assistance à donner à des enfants mais du contrôle à imposer à des « entrants ». Les départements ont la possibilité de l’envoyer directement en préfecture où il ne trouve ni « entretien social » ni entretien de rien : aucun soin n’est donné à ces personnes apeurées, fragilisées à qui l’on va donc demander tous les papiers, le dépôt des empreintes et la prise de photographie. Les informations collectées sont croisées avec les bases de données relatives aux personnes étrangères, Visabio et AGDREF2 puis centralisées dans le nouveau fichier biométrique national, dit « d’appui à l’évaluation de la minorité » (AEM).
L’argument répété par le gouvernement pour défendre l’AEM est celui du « nomadisme » des jeunes migrants. À savoir, le fait de retenter sa chance dans un second département si l’on a été évalué majeur une première fois. Un phénomène qu’aucun ministère, depuis 2018, n’est pourtant capable d’étayer. « Nous n’avons pas de chiffres précis ; ce qui est sûr, c’est que cela existe », nous assure ainsi le cabinet d’Adrien TaquetMaïa Courtois, « Comment le gouvernement impose le fichage biométrique aux enfants étrangers isolés », Bastamag, 22 juillet 2021. https://basta.media/fichage-biometrique-mineurs-isoles-AEM-prefectures-migrants-proetction-de-l-enfance.
Si, selon le gouvernement, ce qui est vu, ce qui manifeste son existence est à prendre comme « réalité » certaine, comment se fait-il que la présence attestée de ces mineurs en danger que tant de journaux, de représentants politiques, disent être une « réalité », soit à ce point déréalisée ? Comment peut-elle être si facilement transformée, par ce retournement du « en danger » à « dangereux », et constamment niée puisque ces enfants que tout indique comme devant être aidés ne le sont quasi pas et seront, pour la majorité, violentés : traumatisme de ce soupçon réitéré et cruauté de ce tri qui pour certains aboutit à l’exclusion radicale de ce qu’ils vivaient comme leur réalité, c’est-à-dire d’être un jeune homme ou une jeune femme isolé·e sur un territoire étranger ? Comment peut-on arriver à la création d’un statut aussi fou et rendant folle la réalité qui se voit ici façonnée non par des vérités de fait, des vérités de droit, mais par des fantasmes et des peurs de l’étranger : statut de « débouté de sa minorité » ?
La réponse est finalement assez simple : la « minorité » et particulièrement celle du MNA, n’est pas une réalité, pas une vérité, mais une construction dépendant non pas de « politiques de l’enfance », ni même de « politiques de la migration », mais bien de polices anti-migratoires. Ces polices ne sont pas propres à la France, elles sont ce qui régit le traitement que fait l’Europe des « migrants » et plus spécifiquement de ce « public cible » des mineurs sur le sort desquels le Parlement européen prend des décisions comme il le ferait sur un stock de marchandises à transférer, répartir d’un pays à l’autre. Preuve en est notamment la manière dont, de temps en temps, sont lancés des programmes de « relocalisation » des MNA, sans cohérence ni logique autre que celle de faire un coup d’éclat masquant de quelques paillettes l’ignominie du traitement imposé par l’Union européenne aux personnes en situation de migration. Ces programmes sont censés « soulager » tel ou tel pays d’entrée (Grèce ou Italie majoritairement) et, du même coup, redorer l’image de tel ou tel autre qui apparaît pour un temps comme, pour reprendre cette cynique formule du président Macron, « prenant sa part dans la solidarité » comme on la prendrait dans un gâteau dégoulinant de produits artificiels. Ce qui se perd de soulagement et de « solidarité », pour les reconnus mineurs en question, n’est évidemment pas nommé, pas considéré du haut du Parlement qui statue sur un tout. Les liens que se sont créés certains jeunes dans leur pays d’arrivée n’existent pas pour les autorités qui les lisent en « mineurs isolés » à déplacer. Les alliances, les compagnies improbables au sein desquels des enfants se refont des familles, sans obligation de sang (partagé ou à verser…) n’existent pas. Les pleurs de certains jeunes qui, bien que « la Grèce ne soit pas une destination stratégique » voulaient rester dans telle structure de solidarité athénienne, n’existent pas. Car ici les enfants n’existent pas. Il n’y a pas de singularités, il n’y a pas de collectifs hétérogènes composés avec le temps, il n’y a qu’un bloc identifié et traité comme matière première, comme matière primaire à s’échanger pour s’en enrichir ou s’en déchargerLa dimension financière de ce ballotage des mineurs en Europe et à ses frontières est abordé dans l’article de Marmié cité plus haut. Une note de bas de page, terrifiante, dit beaucoup de la situation : « Lors du Trust Fund (fonds fiduciaire) européende 2018 sur les migrations, de nombreuses ONG ont ainsi été incitées à cibler les “MNA” pour capter des financements du programme migration lancé par l’Union européenne au Maroc, dans le sillage du Pacte des migrations qui s’est tenuà Marrakech la même année. ».
Il y aurait tant à dire sur les étapes de ce parcours du combattant dans lequel les jeunes exilés se trouvent pris quand ils cherchent à se faire « reconnaître » : de la préfecture au foyer « pour migrants » pour les uns, à la rue pour les autres, qui y échouent en nombre après leur déboutement et s’ils ne sont pas « repêchés » par telle ou telle asso qui, pour certaines, l’accompagneront véritablement, sans soupçon, pour les autres le feront en tant que sous-traitant de l’État (cas de la Croix-Rouge notamment), obligeant le jeune à la « preuve » par des séries d’examens aussi violents que peuvent l’être les tests osseux… Tant à dire et tant de difficultés à dire ce que l’on sait déjà être un dire partiel car tant de jeunes aujourd’hui échappent, ne se voient ni dans les structures dédiées, ni dans la rue après que le jour se soit levé : enfants errants la nuit, victimes des trafics d’êtres humains et des travaux forcés — du sexe, de la drogue… — et surtout enfants spectres d’eux-mêmes puisque le « même » d’une subjectivité leur est ôtée. En réalité il y a tant à laisser être dit par elles et eux et donc tant d’espaces à coconstruire pour qu’une telle parole se déploie, trouve sa place en refusant d’être assignée à celle du « MNA », du « débouté » mais en devenant une parole d’enfant singulier qui a le droit de l’être, y compris s’il a plus de 18 ans. Et d’autant plus si, jusqu’à ses 18 ans, il n’a vécu son « enfance » qu’à distance, comme s’il s’agissait d’une fonction ayant pour effet une éventuelle protection et pouvant rejeter ce qu’il sait qu’il redeviendra sans échappatoire une fois atteinte la majorité : un migrant. C’est-à-dire un individu condamné à se vivre en inadapté, non-accepté, inacceptable. Que devient l’enfance quand elle se vit comme sursis avant condamnation ? Comme délai avant disparition ?
Regagner l’enfance
Puisqu’il y a tant à dire, que l’espace de cette contribution ne permet pas de tout déployer (d’où l’invitation à suivre, pour prolonger, les indications en note de bas de page) et puisque, surtout, il y a tellement plus d’intérêt à laisser parler qu’à « parler pour mais sans les concernés », je voudrais consacrer la fin de ce texte à présenter la manière dont certains jeunes s’organisent pour regagner leur enfance. Que ce soit pour être traités comme tels ou parce qu’ils font de tout le potentiel de cette dernière autre chose que ce à quoi la réduisent les autorités et administrations qui la désignent en « cible » et ne cessent de réaffirmer les frontières de « l’enfance » en la bornant à une seule et unique conception. Ces jeunes qui, parce qu’ils débordent, ne sont pas reconnus enfants ne sont-ils pas, au final, la chance conservée pour l’enfance d’ex-ister ? L’audace qui se lit dans les yeux de certains et surtout l’immense force qu’on ne peut que reconnaître à ces jeunes qui ne s’effondrent pas (ou du moins pas immédiatement) face aux rejets qu’on ne cesse de leur imposer, donnent en effet à penser que quelque chose de cet incontrôlable mouvement et élan de l’enfance ne leur a pas été ôté. Et que c’est grâce à celui-ci que cette « non-arrivée » peut se vivre autrement que comme obligation au voyage infini mais comme capacité à circuler entre les identités.
Certains, et en réalité, beaucoup d’entre les jeunes que j’ai pu rencontrer ne me semblent pas dupes de cette artificialité de l’enfance façonnée selon des choix politiques et/ou des présupposés moraux liés notamment à la sacralisée structure de la « famille » sédentarisée, prise comme seul modèle valable pour l’éducationOn sait que le placement en famille, proposé comme solution par certains agents de l’ASE, peut être vécu comme violent et destructeur par les jeunes, y compris les non qualifiés MNA. Malgré toutes les révélations et ce que l’on sait, en vérité, depuis tant d’années concernant les abus qui se vivent « en famille », il est surprenant (ou tellement cohérent quant à l’esprit conservateur de nos pays dits « ouverts d’esprit » et terres d’accueil…) que ce modèle continue d’être pris comme le plus idéal…. On a vu plus haut que le « nomadisme » est d’ailleurs ce contre quoi s’est créé le fichier AME cité plus haut : il faut éviter qu’un jeune « débouté » ici retente sa chance ailleurs. On ne veut pas garder les jeunes qui « saturent » les services ; on ne veut pas laisser partir ces jeunes. Le paradoxe de la double injonction trouve une solution, pratiquée sans être ni légale ni clairement nommée : on demande aux jeunes de quitter le territoire ou on les place en centre de rétention (traitement « normalement » réservé aux majeurs). Entre forçage à rester et forçage à décamper, des jeunes partent pour se faire ex-ister. Ils partent, s’arrêtent un temps, repartent pour rejouer, non leur enfance, mais grâce à leur enfance, la lutte confiante et convaincue pour le droit d’exister. Dans leur combat pour la reconnaissance de « minorité », celle-ci est clairement perçue comme un statut juridique permettant protection. Elle ne se confond pas avec leur réalité de jeune et ne porte pas la décision sur la véracité de cette dernière. Ils sont des jeunes gens devenant et, oui, en tant que tels, ils jouent et ne se trompent pas de jeu : ils ne jouent pas leur enfance mais, plutôt, ils savent par leur enfance, grâce à cet élan de l’enfance que les violences n’ont pas réussi à totalement écraser, qu’ils peuvent se jouer des institutions en jouant au « jeune » ou au plus vieux.
« Je sais que je vais être aimé et aidé si je joue le bon MNA : gentil, vulnérable et mignon. » C’est ainsi que peuvent s’exprimer certains des jeunes avec lesquels sont en liens quotidiens certains de mes collègues au sein de l’association La CasaLa Casa est une association parisienne de soutien aux exilé·es et plus spécifiquement aux mineurs étrangers. Elle lutte et agit en premier lieu pour l’obtention d’un espace de vie digne pour les personnes en exil et la reconnaissance des droits à l’habitation des plus jeunes. https://www.facebook.com/lacasaparis.asso, ou ceux avec lesquels je suis plus en interaction à présent, en Grèce, entre Athènes et Lesbos. Ils savent très bien à quelle image ils sont associés pour certains (les dangers) et pour d’autres (les pauvres petits) et ils circulent entre elles avec, pour certain, une incroyable agilité. S’il y a là une puissance d’agir tout comme une manière de faire résister l’enfance vécue, l’enfance-existence, sous les recouvrements morbides que lui donnent les polices de la minorité mais aussi certaines des associations de bons bénévoles charitables, il faut aussi nommer toute la fragilité que ces jeux de rôle peuvent renforcer. Il y a une portée performative du terme MNA et de l’imaginaire auquel il s’associe et cette portée se lit tant dans la création de dispositifs d’aide ou de contrôle spécialisés que dans les subjectivations politiques possibles ou empêchées des jeunes concernés. Pour certains, en effet, elle permet de remettre du jeu au sein d’une identité et d’ouvrir à une construction de soi bien plus étendue qu’elle ne l’est pour nombre d’enfants en rien isolés, en rien remis ou remettant en cause leur enfance et sa normalité, mais se trouvant eux, non expulsés mais bien enfermés dans la norme « enfance » que rien ne leur permet de remettre en question. Tout est fait — on le sait — pour que, dans l’école républicaine chère à la France, l’enfance « formée » devienne terrain de formation de sujets dociles et disciplinés, disciplinables. Et certains, de plus en plus nombreux, ne verront d’autre issue que celle d’échapper…
Pour d’autres « mineurs étrangers » — et ils sont malheureusement nombreux—, ce travestissement permanent, ce tourbillon qui force au passage d’une identité à l’autre, crée une fissure dans la subjectivité qui n’équivaut pas à la division propre à la subjectivation politique (cet écart entre identité et subjectivité construite), mais à une perte de soi et de ses capacités. Les dégâts psychiques causés par cette permanente mise en doute comme par le forçage identitaire sont de plus en plus nombreux en France et en Europe. Et ils sont d’autant plus inquiétants que les soins sont difficiles voire impossibles d’accès pour « ces jeunes-là »Voire notamment sur ce point comme sur plusieurs que je ne peux ici détailler, le texte de mon collègue de La Casa Quentin Griehaut, « Les mineurs isolés étrangers n’existent pas » dans Le Club de Médiapart (3 mai 2020) : https://blogs.mediapart.fr/edition/la-jungle-et-la-ville/article/030520/les-mineurs-isoles-etrangers-nexistent-pas-quentin-griehaut.. La non-prise en compte et en charge de cette jeunesse et de ses maux divers ne peut être compensée par l’accompagnement que leur donnent les diverses associations existantes. Et ce d’autant moins que la majorité d’entre elles se placent plus du côté « humanitaire » que de la lutte politique. L’aide donnée n’est pas suffisamment discutée, remise en question en collectif et surtout en incluant les concernés dans les discussions. Trop nombreuses sont les situations d’abus ou d’incompréhensions dans lesquelles, par exemple, prétendant aider un jeune à l’intégration, des familles le forcent aux usages (alimentaires, sédentaires) qui ne lui vont pas. Soit il se forcera, s’en voulant de devoir se forcer et de ne pas totalement parvenir à se montrer, comme on le lui demande, reconnaissant ; soit il tordra la force par la reprise de puissance propre et, alors, il partira.
Mais où partira-t-il quand les portes des maisons « dérangées » et les frontières des pays apeurés se sont toutes fermées ? N’y a-t-il que les no man’s land ou la rue comme issue pour ces jeunes qui ne parviennent plus à jouer cette « fuite du dedans » — telle qu’elle s’incarne, comme rappelé plus haut, dans les jeux identitaires que certains arrivent à mener — et qui fuient radicalement les structures, les foyers d’accueil et les maisonnées aimantes qui veulent faire goûter la bonne choucroute familiale à un jeune qui voudrait juste un bon poulet pimenté ? Non, il y a des alternatives mais elles demandent à ce que soit considérés autrement ces jeunes gens, ni comme pures victimes à sauver ni comme délinquants à surveiller, mais comme enfants et acteurs de leur existence. La création d’institutions alternatives me semble reposer sur la capacité des associations ou collectifs à parler, avec les concernés, moins d’adulte à enfant, moins d’installé à nomade que d’enfances à enfances et en tant que tous embarqués dans la possibilité de pas de côté, de la prise de distance avec les structures légitimées en société pour faire politique autrement. Faire monde autrement.
Dans le champ associatif, il est vrai que La Casa m’est chère pour cela : je nous vois toutes et tous comme des enfants fâchés contre les cadres « pensés pour mais sans » et qui se sentent dans une évidente proximité avec ces enfants et jeunes plus ou moins grands qui sont là sans foyer. Je ne dis pas et nous ne disons pas que nous sommes les mêmes. AUCUNEMENT. Nous sommes différents, comme ils le sont entre eux et ne sont pas juste l’identité bloc MNA et c’est par cela que nous pouvons inventer des manières d’être ensemble qui ne prennent pas comme modèle la « famille » ou la structure d’hébergement. La Casa a entendu ce que coûtait aux jeunes la logique des hébergements solidaires, elle sait ce que ça coûte, aux accueillis comme aux accueillants, d’être hôte pour un temps seulement, sans s’attacher ou en ne parvenant pas à ne pas s’attacher trop et se laissant déborder par tout ce que cela crée des deux côtés de l’accueil. De ce fait, elle loue des appartements au sein desquels quatre ou cinq jeunes gens vivent en autonomie. Les membres de l’association viennent passer du temps, une soirée pour dîner et rire, une aide au devoir… Ils subviennent aux besoins basiques mais laissent aussi les jeunes se débrouiller, reprendre ou trouver leur autonomie dans les démarches et l’installation. Depuis que cette formule existe, j’ai perçu des jeunes reprendre leur joie et leur motivation, chose qui très souvent est la plus abîmée, dans ce périple de l’arrivée qui n’arrive jamais.
Dans le champ de la lutte politique et de l’invention artistique, le collectif que j’admire et avec lequel j’agis dans mes présences à Bruxelles et à distance est celui de la Voix des Sans-Papiers. L’histoire de sa création, des occupations de bâtiments dont il est spécialiste peut se lire en différents lieux et s’entendre notamment dans le podcast que nous avons réalisé avec eux (ce dans le cadre de notre « école expérimentale » cocréée avec Léa DrouetPlus d’informations à lire ici : https://atelier210.be/saisons/saison-2021/ecole-experimentale-decembre/ et à entendre ici : https://open.spotify.com/episode/76vZxWCRxBeVZiSvdThcik?si=4c7645712ebf4a31&nd=1 et là : https://open.spotify.com/episode/5UAxqwUrOAgAwpsqcpkHj0.). Mais je souhaite terminer en parlant d’un de leurs projets qui implique notamment des « jeunes », sans et avec papiers : le collectif Baraka Grafica. Là, ce ne sont pas seulement des « jeunes exilés » qui s’expriment grâce à un « workshop » que serait venu leur donner tel ou tel artiste répondant ainsi aux missions de « démocratisation » et action culturelle qui semblent choisies trop souvent du fait qu’elles rapportent des subventions… Ce sont des jeunes gens, avec et sans papiers, qui ensemble travaillent et inventent les formes d’une parole commune et non comme UNE, qui puisse témoigner de ce que ça fait de grandir, de voyager entre les âges et les pays, de croiser les identités… ce que ça fait aux « réalités » véritablement vécues mais surtout à celles que nous voulons générer. Non plus une fiction meurtrière dont on fait une réalité, ni une réalité qu’on agite comme une fiction aux effets performatifs, mais une réalité composée au croisement des gestes concrets, des corps impliqués et des désirs de devenirs qui ne doivent plus jamais être « minorisés ».
Je termine ce texte long et pourtant trop court pour tout ce qui mérite d’être dit ici en laissant tout simplement la place aux mots de Baraka Grafika.
Le studio Baraka est un collectif fondé lors de rencontres entre La Voix des Sans-Papiers et des jeunes auteurices sortant de l’ESA Saint-Luc. Après plusieurs mois ensemble, à décomplexifier le dessin, et à chercher comment nous pourrions mêler nos traits, nous avons décidé de nous lancer dans la fabrication de BD à huit mains. D’un travail laborieux individuel nous avons choisi d’aborder le support BD comme un espace à entrelacer nos univers. Chacun·e traitant la planche par un bout en laissant l’espace pour ajouter, modifier, accompagner, (re)construire pour l’autre. Nous voulions créer une unicité dans la pluralité.
L’enfant à problèmes. Provocations en vue du démantèlement de l’État carcéral —
« Qu’y a-t-il de si détestable chez les adultes ? Quand tu vois un*e enfant en bas de chez toi, tu sais bien que t’es censé*e læ nourrir ? Et lorsque cet*te même enfant atteint dix-huit ans, alors, tout à coup, tu dis, “Je ne te nourrirai pas”. Qu’y a-t-il de si vulgaire et puant et dégoûtant et détestable chez l’adulte moyen*ne qui ne nous fait pas penser qu’iel devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent ? Il faut être dingue pour avoir une telle idée. »
La nation la plus emprisonnée et la plus policée du monde — un élément de ce que l’historienne Saidiya Hartman a appelé « la vie après la mort de l’esclavage », consistant en « chances de vie inégales, un accès limité à la santé et à l’éducation, une mort prématurée, l’incarcération et l’appauvrissementSaisiya Hartman, Lose your Mother: A Journey along the Atlantic Slave Route, New York, Farrar, Straus & Giroux, 2007, p. 6. » — se trouve à nouveau à un moment critique. Bien que l’élection de [Donald Trump en] 2016 puisse compromettre ce moment de réforme, les débats sur la fermeture des prisons, la surveillance civile du maintien de l’ordre et les alternatives à l’incarcération — impensables il y a dix ans — sont alimentés par des organisations aussi diverses que les soulèvements #BlackLivesMatter et le groupe de conservateurs Right on CrimePour plus d’informations sur Right on Crime et ses objectifs politiques, voir , ; pour plus de détails sur #BlackLivesMatter, voir la plateforme politique de mobilisation Movement for Black Lives: ..
La question de la réforme de la justice pénale s’est également infiltrée dans les écoles. Au cours des quinze dernières années, du fait de l’engagement de jeunes activistes, les mouvements contre le school-to-prison pipeline[N.D.T] Au États-Unis, le school-to-prison pipeline (SPP) désigne le fait que les mineur·es et jeunes adultes de minorités précaires et racisées ont beaucoup plus de chances d’être incarcéré·es que d’autres du fait des politiques de tolérance zéro et des inégalités d’accès à une éducation de qualité, au point que l’école puisse sembler, sinon une portée d’entrée, du moins un canal d’accès direct à la prison. se sont régulièrement regroupésGarret Albert Duncan, « Urban Pedagogies and the Celling of Adolescents of Color », Social Justice, 27(3), 29–42, 2000 ; Catherine Y. Kim, Daniel J. Losen, Damon T. Hewitt, D, The School to Prison Pipeline: Structuring Legal Reform, New York, New York University Press, 2010 ; Crystal T. Laura, Being bad: My Baby Brother and the School-to-Prison Pipeline, New York, Teachers College Press, 2014 ; Damien M. Sojoyner, « Black Radicals Make for Bad Citizens: Undoing the Myth of the School to Prison Pipeline », Berkeley Review of Education, 4(2), 241–263, 2013 ; Maisha T. Winn, Girl Time: Literacy, Justice, and the School-to-Prison Pipeline, New York, Teachers College Press, 2010., influençant les décideurs politiques. Une audience du Congrès en décembre 2012 sur la fin du school-to-prison pipeline a réuni des intervenant·es de tous les États-UnisDonna St. George, « School-to-Prison Pipeline" Hearing Puts Spotlight on Student Discipline ». The Washington Post, 13/12/2012., incitant les districts scolaires urbains à réévaluer les pratiques disciplinaires, dont les politiques de « tolérance zéroLe retrait des élèves de couleur d’un cadre éducatif commence dès l’école maternelle. Les filles noires connaissent des taux disproportionnés de sanctions disciplinaires à l’école. Les jeunes queers, en particulier celleux qui ne sont pas blanc·hes, sont plus susceptibles que leurs pair·es hétéros d’être puni·es par les tribunaux et les écoles (Diaz et Kosciw, 2009 ; Himmelstein et Bruckner, 2011). Alors que la recherche sur la disproportionnalité disciplinaire scolaire progresse également sur la façon dont les étudiant·es handicapé·es sont sanctionné·es, elle est rarement intersectionnelle. ». Début 2014, l’administration Obama a publié un rapport de trente-cinq pages exhortant les écoles à utiliser les forces de l’ordre en « dernier recours » dans le cadre de la discipline scolaireMotoko Rich, “Administration Urges Restraint in Using Arrest or Expulsion to Discipline students”, The New York Times, 8 janvier 2014. Cf. ? ++_++r=0. N’étant pas financées, ces directives reproduisent également l’ignorance institutionnelle persistante autour des expériences des jeunes femmes et/ou des jeunes queers.. Avec des pratiques comprenant des cercles de rétablissement de la paix, des conférences réparatrices, des jurys de pairs, la médiation et d’autres processus consistant à rendre des comptes, la justice réparatrice, une réponse prétendument non punitive à des préjudices, s’est avérée être une pratique disciplinaire alternative qui circule désormais dans les écoles, depuis Oakland jusqu’au Bronx.
Ce moment politique génère de nouvelles opportunités pour celles et ceux qui travaillent pour la justice dans les communautés et dans les écoles, mais il faut être prudent. Non seulement cette vague actuelle de réformes se passe souvent d’une analyse rigoureuse et transparente des investissements clés qui ont naturalisé la montée en puissance des systèmes américains de maintien de l’ordre et d’incarcération, de la suprématie blanche, du colonialisme, du capitalisme et de l’hétéropatriarcat, mais les réformes proposées par les parties prenantes de tout l’éventail politique, loin de réduire l’empreinte et la logique sous-jacente de notre État carcéral ou punitifL’État carcéral désigne les multiples agences nationales, institutions et organisations à but non lucratif qui ont des fonctions de maintien de l’ordre et de punition et qui, dans les faits, règlementent les communautés pauvres, y compris celles qui se trouvent au-delà du site physique de la prison ou de l’établissement pénitentiaire : services à l’enfance et à la famille, agences d’aide sociale et d’aide par le travail, agences d’immigration, de santé et services sociaux., les ont souvent élargies. Comme l’écrit Angela Davis : « Le paradoxe, c’est que la prison est le fruit d’efforts concertés de la part de réformateurs soucieux de créer un meilleur système punitif. Si l’expression “réforme des prisons” nous vient spontanément à l’esprit, c’est parce que les mots “prison” et “réforme” sont inextricablement liés depuis que l’incarcération est apparue comme principal moyen de châtiment envers les contrevenants à la loiAngela Davis, La Prison est-elle obsolète ?, trad. Nathalie Peronny, Paris, 2021, Le Diable Vauvert, p. 47. Selon Murakawa, les réformes avancées par les démocrates, particulièrement celles visant à réduire les préjugés raciaux dans le maintien de l’ordre et l’emprisonnement, ont également contribué à la croissance de la plus grande population carcérale de la planète. Par exemple, dans les années 1980, des directives sur la détermination de la peine ont été défendues par une série de démocrates, dont le sénateur Edward Kennedy, afin de supprimer les préjugés dans le processus de détermination de la peine. Ces directives sont rapidement devenues rigides, comme en témoigne l’adoption de la loi de 1984 sur le contrôle de la criminalité, et ont supprimé le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de condamnation, contribuant ainsi à un allongement des peines qui a accru la population carcérale à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Cf. Naomi Murakawa, The First Civil Right: How Liberals Built Prison America. Oxford, Oxford University Press, 2014.. »
L’histoire de l’incarcération a toujours été une histoire de réformes qui élargissent fréquemment la portée et l’étendue de la punition. Au cours des deux derniers siècles, la création de pénitenciers, de maisons de correction pour les jeunes et les femmes, et même de quartiers de haute sécurité, a été défendue par celles et ceux qui avaient de « bonnes intentions » et qui voulaient améliorer les anciennes formes de punition. Pourtant, chacun de ces développements a étendu et naturalisé un État carcéral. Notre débat national actuel sur la justice pénale ouvre à nouveau des perspectives de réforme, mais l’histoire devrait nous inciter à la prudence : « Quelles sont les possibilités de réformes non réformistes, de changements qui, en fin de compte, dénouent plutôt qu’elles n’élargissent le filet du contrôle social par la criminalisationStefano Harney et Fred Moten, Les sous-communs, planification fugitive et étude noire, trad. collective, Montreuil, Brook, 2022.Stefano Harney et Fred Moten, Les sous-communs, planification fugitive et étude noire, trad. collective, Montreuil, Brook, 2022. ? »
Les possibilités et les écueils de la réforme sont particulièrement flagrants pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l’éducation car un élément clé de notre « nation carcérale » racialisée, pour reprendre un terme de l’activiste et universitaire Beth RichieBeth E. Richie, Arrested Justice: Black Women, Male Violence, and the Build-up of a Prison Nation, New York, New York University Press, 2012., repose sur les lois qui prétendent protéger l’enfant. Notre État carcéral a été construit par une matrice de systèmes punitifs et de lois qui semblent protéger les enfants — y compris les zones scolaires sans drogue, les ordonnances sur la « qualité de vie » (par exemple, les lois contre la délinquance), les registres publics de délinquant·es sexuel·les et les projets de loi sur la question de la mixité ou non des toilettesEn date du 23 janvier 2017, au début de la nouvelle session législative, huit États ont déjà « préfiguré ou introduit une législation » exigeant que les personnes utilisent des vestiaires et des sanitaires correspondant à leur genre et au sexe qui leur a été assigné à la naissance : il s’agit des « projets de loi sur les sanitaires » (Kralik, 2017). — et il continue de criminaliser, en particulier les plus vulnérables, sans réellement améliorer la sécurité publique. Non seulement ces lois naturalisent et renforcent la surveillance, les pratiques de maintien de l’ordre, de punition et les lois qui sont enracinées dans l’hétéropatriarcat racialisé (et la sécurisation des droits de propriété privée), mais beaucoup d’entre elles criminalisent de manière disproportionnée les populations qu’elles sont censées protéger — les jeunes. Pour démanteler l’État carcéral dans nos salles de classe et dans nos communautés, il faut non seulement réduire l’empreinte du maintien de l’ordre, mais également prendre du recul pour théoriser à nouveaux frais l’artefact de l’enfant et des catégories associées (adolescent·e, mineur·e, jeune[N.D.T] L’autrice indique « adolescent, juvenile, minor, youth ». Le terme « juvénile » n’étant pas un substantif en français, nous l’avons systématiquement traduit par « mineur·e ».). Comme le poète et universitaire Fred Moten le demande dans l’épigraphe de cet article, comment pouvons-nous rendre visible les logiques qui donnent de la valeur à des enfants, au détriment de nombreux autresStephano Harney, Fred Moten, Les sous-communs, op. cit. ? Comment ces postulats sont-ils naturalisés, ou transformés en une sorte de « sens commun » propre à un point de vue blanc, et quelles en sont les conséquences collatérales ?
Les jeunes personnes sont vulnérables. Cela ne peut pas être remis en question. La jeunesse subit la violence. Les mineur·es ont besoin de soutien. Les enfants sont dépendant·es. Pourtant, s’il est « pire qu’erroné de parler d’enfants très dépendants, tels que les nourrissons et les tout·e-petit·es, comme ayant besoin ou manquant de “liberté », comme l’écrit le juriste Martin GuggenheimMartin Guggenheim, What’s Wrong with Children’s Rights, Cambridge, Harvard University Press, 2005, p. 10. dans son réquisitoire contre les services de protection de l’enfance, la précarité des mineur·es n’en est pas moins partiellement fabriquée. L’impossibilité de voter, de consentir à une activité sexuelle, de signer un contrat légal, de travailler (ou, lorsqu’iels sont employé·es, d’être exempté·es du droit de gagner un salaire minimum ou égal à celui des adultes), de boire de l’alcool — ces lois qui visent à les protéger rendent celles et ceux qui sont catégorisé·es comme mineur·es dépendant·es et augmentent leur instabilité. De nouvelles catégories de délinquance et de crime sont nécessaires pour modeler l’enfant en un·e adulte convenable ou pour indiquer son intouchabilité. Cette précarité efface l’agentivité des jeunes personnes, mais, ce qui est peut-être plus important, la matrice punitive, loin de les protéger, discrimine et invalide beaucoup de personnes, y compris les jeunes — « absentéistes », « délinquant·es », « incorrigibles », « fugueur·euses », « débauché·es » — particulièrement celles et ceux marqué·es par la suprématie blanche. Au-delà de la régulation des mineur·es, la surveillance et la punition avancées pour protéger l’enfant façonnent la vie des adultes.
Aux États-Unis, alors même que certain·es acteurices cherchent à repenser cet investissement national dans les prisons et dans la punition inaugurée il y a plusieurs décennies, ce moment politique de réforme risque simplement de réinstaller les anciennes idéologies carcérales dans de nouveaux dispositifs punitifs s’il fait l’économie d’un examen critique de l’artefact hétéropatriarcal et racialisé qu’est l’enfant ainsi que celui des cadres de protection qui lui sont associés. Pour entamer ce dialogue nécessaire, cet articleCet article reprend les thèses développées dans For the Children? Protecting Innocence in a Carceral State. Cf. Erica R. Meiners, For the Children? Protecting Innocence in a Carceral State, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2016. commence par une vue d’ensemble du concept d’enfant et des domaines qu’il recoupe. Tout en étant attentif au pouvoir figuratif[N.D.T] Le terme « figurative » renvoie à l’idée de représentation. Il est synonyme de « mythique ». de l’enfant, cet essai refuse de perdre de vue la manière dont cette catégorie façonne les expériences vécues par de nombreuses personnes et reconnaît la constitution réciproque du concept et de la matérialité. L’historienne Anita Casavantes Bradford suggère que la distinction ténue entre « les enfants en chair et en os et les représentations symboliques de l’enfantAnita Casavantes Bradford, The Revolutionis for the Children: The Politics of Childhood in Havana and Miami, 1959–1962, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2014, p. 2. » est une tension utile et inhérente à toute recherche sur l’enfant. Comment distinguons-nous l’idée de l’enfant — cette figure labile et construite qui n’a jamais été neutre — de la façon dont cette catégorie est vécue, résistée, habitée, déformée, usée ? Malgré le caractère incertain de la différence entre la chair et sa figurabilité, cette « distinction heuristique hypothétiqueIbid., p. 2. » écrit-elle, « nous permet tout de même de poser des questions plus précises sur pourquoi et comment les connaissances sur les enfants sont produites, contestées et naturaliséesIbid., p. 11. ».
Pour illustrer la façon dont les lois et les systèmes élaborés pour la protection de l’enfance façonnent des jeunes personnes « en chair et en os », la deuxième partie de cet essai présente des exemples tirés de la justice des mineur·es et des services de protection de l’enfance. La troisième partie va au-delà de la figure de l’enfant pour décrire comment les lois et les politiques créées pour lae protéger sont préjudiciables aux adultes, et en particulier aux plus marginaux·ales. Pour finir et faire bouger tout cela, loin de présenter des solutions, je propose des provocations pour que cela change. Affirmer que quelque chose est injuste n’implique pas que nous proposions une issue, ou, comme l’écrit l’anthropologue Elizabeth Povinelli, « [dire] “pas ceci” fait une différence même si cela ne présente pas immédiatement une proposition alternativeElizabeth A. Povinelli, Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in Late Liberalism. Durham, Duke University Press, 2011, p. 191. ». Même s’il est possible de l’envisager, je ne propose pas d’en finir avec l’enfance. Au lieu de cela, je propose plutôt des ouvertures et des provocations sur la façon dont celles et ceux qui travaillent dans le domaine des sciences de l’éducation pourraient reprendre cette analyse pour construire des communautés et des écoles plus justes.
Problèmes (de) mineur·es[N.D.T] La langue française ne peut traduire le double sens ironique de minor problems, qui désigne tout autant les « problèmes mineures » que les « problèmes des mineur·es », qui ne sont précisément pas moindres que les problèmes d’autres catégories de la population du fait de la minorisation qu’ils subissent.
Bien que cet essai s’intitule « L’enfant à problèmes », le problème réside plutôt dans la façon dont l’enfant circule au sein des différents domaines, qui se recoupent tant ils sont « tressésKathryn Stockton, The Queer Child: or Growing Sideways in the Twentieth Century, Durham, Duke University Press, 2009. », et dans la façon dont l’enfant est relié·e à nombreux problèmes (de) mineur·es, tous également liés entre eux. Le problème ne vient pas de l’enfant, mais de l’ensemble des significations, métaphores et mouvements attachés à cette figure dynamique et mineure qui suscite des troubles, des problèmes. Aux États-Unis, l’enfance est comprise comme une étape du développement biologique et du cycle de la vie, une classe ou un groupe social informel, un trope figuratif ou littéraire, un artefact historique, ou encore comme une catégorie de science sociale. Ces domaines sont souvent en tension. Des significations contradictoires sont rattachées à l’enfant et des projets politiques contradictoires sont reliés aux différentes représentations de l’enfance. La catégorie en elle-même est également glissante. Qui est pris·e en compte en tant qu’enfant ? À quelles conditionsBien que cette analyse soit ancrée aux États-Unis, la plasticité de ces catégories développementales est également illustrée, peut-être de manière plus spectaculaire, en comparant, par exemple, les âges de consentement à l’emploi, à l’activité sexuelle et au mariage à travers le monde. ? En brouillant délibérément les catégories — « enfant », « jeune personne », « mineur·e » — pour accentuer la malléabilité de ces classifications, les nombreux pouvoirs figuratifs de l’enfant et l’ « étrangeté juridique » de ces catégoriesCf. Kathryn Stockton, The Queer Child, op. cit., p. 16 et Anthony M. Platt, The Child Savers: The Invention of Delinquency, Chicago, University of Chicago Press, 1969., je suggère ici que l’enfant et les catégories qui lui sont associées soient définies collectivement par ce qu’iels ne sont pas — des adultes — et par la concomitance de la perte de l’innocence et de l’acquisition de la raison, deux caractéristiques éloquentes qui sont au mieux éphémères.
L’enfance, en tant que stade de développement situé après la petite enfance et avant l’adolescence, a été produite par de nombreux domaines et institutions comprenant la psychologie, le travail social, la justice pour mineur·es, la médecine et l’éducation. Pourtant, l’âge n’a pas toujours eu des pouvoirs magiques, comme le souligne méticuleusement l’historienne Holly BrewerHolly Brewer, Birth or Consent: Children, Law, and the Anglo-American Revolution in Authority, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2005.. Par exemple, dans l’Angleterre du xvie siècle, « des adolescents étaient couramment élus au ParlementIbid., p. 1. ». En Virginie, en 1689, Mary Hathaway, âgée de neuf ans, a épousé Williams ; deux ans plus tard, elle a réussi à demander au tribunal du comté de la libérer de ce mariage. « Au début du xviie siècle, en Angleterre comme en Amérique, les jeunes enfants témoignaient souvent, apparemment sans même que l’on puisse douter de la véracité de leurs proposIbid., p. 155.. » En 1641, un apprenti apothicaire, Peter Moore, est exécuté à Exeter, en Angleterre, pour avoir empoisonné son maître. Les historiens « supposent » qu’il avait quatorze ans, mais « l’âge, même sous la forme causale d’appeler “garçon” ou “fille”, était rarement enregistré », puisque « la loi faisait peu de distinction entre les enfants et les adultes, l’âge n’était pas pertinentIbid., p. 182. ». Avec le déclin de la mortalité infantile et l’augmentation des taux d’alphabétisation, des discours sur le développement humain ont émergé et les enfants ont commencé à être compris·es non pas comme des versions plus petites des adultes mais comme de futurs adultes. Pour certains, l’âge a commencé à prendre une signification juridique et sociale.
L’enfance est également définie par rapport à ce qu’elle n’est pas — l’âge adulte. Pourtant, il n’y a pas de clarté ou de consensus sur les limites légales ou sociales de cette transition et de tous les stades intermédiaires — jeune mineur·e, adolescent·e, ado, gamin·e, mineur·e, jeune adulte — et ces catégorisations bloquent l’entrée dans les institutions clés produisant le capital qui définit l’âge adulte : la force de travail, la politique, le mariage, l’armée. La recherche académique sur ces catégories intermédiaires est apparue aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 1950 et 1960, « marquée par une préoccupation pour la délinquance » et née « au sein de la criminologie, nourrie par des paniques morales concernant la nuisance imputée aux jeunes dans les voies urbaines des sociétés occidentalesGill Valentine, Tracey Skelton et D. Chambers, « An introduction to youth and youth culture », Tracey Skelton et Gill Valentine (éds.), Cool Places: Geographies of Youth Cultures, Londres, Routledge, 1998, p. 10. ». Leur statut étant construit comme un problème effectif ou potentiel, ces catégories intermédiaires requièrent études, gestion, réglementation, ainsi que les expert·es et institutions qui leur correspondent.
En outre, aucune de ces catégories de stades de la vie n’est neutre sur le plan racial. Les constructions de l’enfance du xixe siècle étaient exclusivement blanchesSignifier l’identité est toujours une démarche provisoire et politique. À moins que l’auteurice, le mouvement ou une autre source n’utilise un terme différent, j’utilise généralement dans cet article les termes suivants pour désigner les catégories raciales : Noir·e, Premières Nations, Latino·a, non-blanc·he, personnes/jeunes de couleur, blanche. Je reconnais toutefois que ces termes ne sont pas adéquats — ils ne reflètent pas la façon dont les personnes et les communautés choisissent (ou sont tenues) de s’identifier. Ils ne sont pas non plus exhaustifs — ils ne reflètent pas le large éventail de façons dont la suprématie blanche, le colonialisme et d’autres idéologies sont vécus, combattus et refusés. J’utilise également queer comme terme de substitution pour LGBTQ — lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et non-conformistes de genre — un terme encore une fois inadéquat pour représenter un éventail de sexualités et d’identités de genre.. L’historienne Robin Bernstein suggère que la catégorie du pickaninny, un·e « mineur·e noir·e sous-humain·e imaginaireRobert Bernstein, Racial Innocence: Performing Childhood from Slavery to Civil Rights. New York, New York University Press, 2011, p. 34. [N.D.T] On n’a pas trouvé d’équivalent dans la langue française, mais ce serait une version enfantine du très raciste « bamboula ». » inventé précisément au moment où l’enfance américaine blanche commençait à apparaître, circulait au travers d’une série de médias et de domaines, répondant à des objectifs variés. Cette caricature raciste était définie par son manque de sensibilité : « animale ou adorable, en haillons ou soignée, effrayée ou heureuse, américaine ou britannique, la figure est toujours juvénile, toujours de couleur, et toujours résistante, si ce n’est immunisée, à la douleurIbid., p. 35. ». Les enfants blanc·hes étaient innocent·es et sensibles et donc pleinement humain·es, alors que l’enfant non blanc·he était exclu·e de l’innocence et de l’accès à la sensibilité, non pas pleinement humain·e et ne relevant donc pas de l’enfance.
La régulation et la racialisation de l’enfance perdurent, reproduites et naturalisées dans la culture populaire, les lois et la tradition. « Les enfants noir·es bénéficient du privilège de l’innocence dans une moindre mesure que les enfants d’autres racesPhilipp Atiba Goff, Matthew Christian Jackson, Brooke Allison Lewis Di Leone, Carmen Marie Culotta et DiTomasso, Natalie Ann, « The Essence of Innocence: Consequences of Dehumanizing Black Children », Journal of Personality and Social Psychology, 106(4), 52–545, 2014. », concluent des psychologues qui ont examiné si les garçons noirs se voyaient offrir les mêmes « protections de l’enfance que leurs pairsIbid., p. 256. ». Dans cette étude, les participant·es, principalement des personnes blanches, étaient systématiquement moins susceptibles de voir les jeunes garçons noirs comme des garçons : « Les suspects noirs étaient considérés comme ayant 4,53 ans de plus qu’en réalité, cela signifie que les garçons étaient perçus à tort comme des adultes légaux à l’âge de 13 ans et demi environIbid., p. 532.. »
La plasticité de ces catégories développementales[N.D.T] Le terme désigne que ces catégories sont issues de la psychologie du développement, qui postule que la maturation de l’individu passe nécessairement par des étapes identifiées scientifiquement., en lien avec leurs histoires racialisées, continue de façonner la vie des individus, souvent avec des conséquences fatales. Michael Brown, dix-huit ans, qualifié par le policier blanc Darryl Wilson de « démon » et comparé à Hulk Hogan [un catcheur professionnel], a été tué le 9 août 2014Josh Sanburn, « All the Ways Darren Wilson Described Being Afraid of Michael Brown », Time, 25 novembre 2014.. Tamir Rice, âgé de douze ans, décrit par un appel au 911 comme « un “gars” dans un parc pointant une arme à feu qui était “probablement fausse », a été supposé jouer avec une vraie arme, non pas avec un jouet, et a été mortellement abattu par l’officier de police blanc Timothy Loehmann le 22 novembre 2015Charles M. Blow, « Tamir Rice and the Value of Life ». The New York Time, 11 janvier 2015. Cf. https://charles-mblow-tamir-rice-and-the-value-of-life.html?_r=0.. En janvier 2017, Bresha Meadows est en prison, accusée à l’âge de quatorze ans de meurtre aggravé (ou prémédité) pour avoir tué son père, qui, selon de nombreuses preuves, la battait et la maltraitait régulièrement, ainsi que sa sœur et sa mèreChristina Cauterucci, « Will the System Fail Bresha Meadows, a Teen who Killed her Allegedly Abusive Father? », 9 septembre 2016.. En tant que jeunes Noir·es, aucun·e d’elle et eux n’est autorisé·e, même dans la mort, à occuper pleinement l’enfance ou l’adolescence.
Pourtant, pour d’autres, ces mêmes catégories s’étendent, englobent et fournissent davantage de moyens. L’ « économie fragile » qui a poussé des jeunes (blanc·hes) de vingt-deux ans ayant fait des études supérieures à retourner chez leurs parents s’est transformée en « report du début de l’âge adulte de plus en plus tard », peut-être jusqu’à l’âge de vingt-six ans, ce qui a incité les psychologues à créer la catégorie d’ « adulte émergent·e »Martha Irvine, « Adult at 18? Who Are You Kidding? The Age Is Now 26 », The Los Angeles Times, 26 octobre 2003. Cf. pour prolonger les avantages liés au statut de mineur·e (y compris l’accès à la couverture médicale des parents). De nouvelles catégories développementales sont créées pour certaines jeunes personnes, en particulier la jeunesse blanche, afin de repousser la perte de l’innocence et de tâcher de faciliter leur entrée dans le monde douloureux et inéquitable de l’âge adulte. Si le terme pickanniny est peut-être démodé, ceux de « superprédateur », « voyou », « thug », « membre de gang » et « démon » ne le sont pas et ils véhiculent les opinions qui leurs sont liées : un manque d’innocence, de sensibilité ainsi qu’une raison qui n’est pas celle d’un·e enfant, impliquant la culpabilité.
L’enfant circule également comme un trope, ou « enfant-comme-idéeCf. Kathryn Stockton, The Queer Child, op. cit., p. 3. », et iel représente une série d’idées potentiellement contradictoires comprenant l’avenir, la pureté, un potentiel révolutionnaire, l’incapacité, l’inaptitude, le devenir et, peut-être la plus éloquente, l’innocence. Robin Bernstein décrit l’association sans faille de l’enfance, une catégorie qu’elle établit comme n’étant accessible qu’aux Blanc·hes, et de l’innocence : « Au xixe siècle, la culture des sentiments avait totalement tissé ensemble l’enfance et l’innocence. L’enfance n’était alors pas comprise comme innocente mais comme l’innocence elle-même ; non pas comme un symbole de l’innocence mais comme son incarnationRobert Bernstein, Racial Innocence, op. cit., p. 4.. » En plus d’une forme racialisée d’innocence, l’enfance a été associée à cette époque à un manque de raison et donc à une incapacité à consentir. L’universitaire Anna Mae Duane, spécialiste de littérature, suggère que, puisqu’iel est dépourvu de raison, « l’enfant en est effectivement venu·e à représenter tout ce qui devrait exclure un sujet de la citoyennetéAnna Mae Duane, Suffering Childhood in Early America: Violence, Race, and the Making of the Child Victim, Athens, University of Georgia Press, 2010, p.6. ». Pourtant, du fait de sa catégorisation orientée vers le futur, cette figure recèle également un potentiel révolutionnaire. En contradiction apparente avec les tropes de l’innocence et de l’incohérence, puisque certain·es enfants peuvent devenir des adultes à part entière (contrairement à d’autres, comme les personnes souffrant de handicaps spécifiques qui continuent souvent à être considérées comme des enfants, quel que soit leur âge), puisqu’iels sont capables de consentir et d’être indépendant·es, l’enfant peut représenter des futurs radicalement libérateurs. Dans les mouvements révolutionnaires, les images et les représentations de l’enfant sont « non pas un appel inéluctable à la pitié, mais une demande inconditionnelle de liberté Ibid., p. 118. ».
Cette capacité métaphorique de l’enfant et « l’espace social commode et indiscriminéNancy Lesko, Act your Age! A Cultural Construction of Adolescence, New York, Routledge, 2001. » de l’adolescent·e qui lui est associé ancrent leur déploiement dans les luttes sociétales qui traversent tout le spectre politique. Les campagnes visant à légaliser le mariage homosexuel et celles visant à le contester ont tout autant invoqué la nécessité de « sauver les enfants ». La protection de l’enfance continue d’être utilisée pour priver les femmes de leurs droits reproductifs et parentaux, en particulier les femmes pauvres, handicapées, jeunes et/ou non-blanches. La protection des jeunes filles contre la violence sexuelle sert de justification pour restreindre l’accès à des toilettes non-genrées, notamment dans les écoles et autres espaces publics. Au-delà de l’invocation de la sauvegarde ou de la protection de l’enfance pour faire avancer des campagnes politiques ou sociales, quand certaines communautés sont rapprochées de la figure de l’enfant, les conséquences sont tout aussi complexes, souvent accablantes. Les personnes handicapées, les femmes et/ou les communautés des Premières Nations ne sont que quelques exemples de populations qui continuent d’être considérées comme infantiles, donc dépourvues de raison et pour cela considérées comme incapables de s’autogouverner. Loin d’être libératrice, l’infantilisation peut mettre en évidence la violence de l’État et aussi souvent servir à la masquer soigneusement.
Les problèmes (de) mineur·es encourus par l’enfant se recoupent et ils perdurent. Puisque l’enfance est une catégorie dotée d’une histoire continue et racialisée et que ses frontières sont souples, il n’est pas surprenant que les images et associations qui lui sont liées surgissent dans de multiples mouvements politiques et sociaux souvent contradictoires. Bien qu’il s’agisse d’histoires déjà connues — la flexibilité des catégories développementales, leur histoire raciale et leur invocation en fonction de nombreux objectifs politiques — le fait de retracer ces contours dans les composantes de l’État carcéral contemporain met en lumière de nouvelles manifestations de problèmes qui peuvent permettre l’émergence de lignes cruciales de critique, de résistance et de libération.
Vulnérabilités précaires
Les problèmes catégoriels du système de justice pour mineur·es
En dépit de la perception de « lignes nettes » entre des catégories comme celles d’ « adulte », de « jeune » et d’ « enfant », la fluidité entre ces catégories et même à l’intérieur de celles-ci se vérifie de plusieurs façons : en examinant de plus près comment et pourquoi les jeunes se retrouvent dans le système de justice pénale, quels jeunes sont les plus susceptibles d’être ciblé·es et détenu·es par les lois et un système qui prétend les protéger et en relevant le résultat final en temps passé en prison, qu’elle soit pour mineur·es ou pour adultes. De nombreux·es jeunes sont notamment soumis·es à la justice pénale non pas parce qu’iels ont commis des actes de violence, mais parce que, en tant que non-adultes, iels sont exposé·es à une multitude de formes de maintien de l’ordre et de réglementation. Il n’est sans doute pas surprenant que les jeunes les plus marginaux et les plus marginales soient disproportionnellement touché·es. La sexualité et le genre, en particulier pour les jeunes non-blanc·hes, sont des cibles de la réglementation.
De nombreux jeunes sont conduit·es dans le système de justice pénale pour des infractions de statut[N.D.T] On traduit ici « status offenses » par « infraction de statut » : il s’agit de des délits qui n’en sont que pour une fraction de la population, en l’occurrence les personnes mineures : boire de l’alcool, fuguer, etc.. Les mineur·es sont soumis·es à un ensemble de lois qui ne s’appliquent pas aux adultes. Les lois conçues pour les protéger — contre le vagabondage, le fait de traîner dans les rues la nuit, les fugues, la consommation d’alcool ou de stupéfiants, l’activité sexuelle et le manquement à l’obligation scolaire — toutes augmentent le risque de la criminalisation de jeunes personnes. En d’autres termes, en réglementant la mobilité et le comportement, ces lois criminalisent également les jeunes personnes. Dans certains États, 40 % des mineur·es qui se trouvent derrière les barreaux sont incarcéré·es pour des violations de la probation, possession de drogues, des délits mineurs contre les biens, des infractions à l’ordre public et des infractions de statutAnnie E. Casey Foundation, « Reducing Youth Incarceration in the United States: A KIDS COUNT data snapshot », 2013, p. 2.. Alors que les adultes sont également enfermé·es pour avoir enfreint nombre de ces mêmes lois (par exemple, la possession de drogue), les mineur·es sont soumis·es à nombre d’autres formes de maintien de l’ordre et leur statut même de non-adulte, loin de leur conférer davantage de protection en vertu de la loi, peut justifier une surveillance et un enfermement supplémentaires.
Les infractions de statut ou violations apparaissent souvent en résonnance avec les inquiétudes publiques qui prévalent ; et même lorsque ces lois sont présentées comme étant « neutres », leur application ne l’est pas. Dans les années 1960, Brenda Travis, une adolescente noire, leader active dans le mouvement des droits civiques, a été « étiquetée comme délinquante et internée dans un centre de redressement pour la dissuader, elle et d’autres jeunes, de s’engager dans le mouvement des droits civiques du MississippiGeoff K. Ward, The Black Child-Savers: Racial Democracy and Juvenile Justice, Chicago, University of Chicago Press, 2012, p. 205. ». Bien que Travis ait finalement été libérée, il est possible d’identifier « des centaines de cas de jeunes noir·es arrêté·es, déclaré·es délinquant·es et placé·es en institution pour avoir participé à des manifestations pour les droits civiquesIbid., p. 207. » par des tribunaux et des forces de l’ordre contrôlés par les Blanc·hes, qui ont pu criminaliser leur liberté d’expression et de réunion. La panique fabriquée à propos des adolescent·es non-blanc·hes « superprédateur·ices » et de l’activité incontrôlée des gangs urbains a alimenté l’adoption de lois sur le renforcement de peine pour les membres de gangs dans les années 1980 et 1990, notamment la loi californienne de 1988 sur l’application et la prévention du terrorisme de rue (STEP Act). Les renforcements de peine pour les gangs rallongent la peine des adultes et des jeunes personnes perçues comme des adultes. Comme la race d’un·e jeune, ses vêtements et sa localisation peuvent légalement être identifiés comme une affiliation à un gang, les jeunes personnes non-blanc·ches sont disproportionnellement ciblées par le STEP Act et perçues comme des adultes en dépit du fait que la recherche montre à quel point les jeunes blanc·hes sont plus susceptibles d’en être membresNisha Ajmani, « California Must Reform its Gang Sentencing Laws », Center on Juvenile and Criminal Justice, 26 mars 2016..
La régulation de la sexualité émergente des jeunes, en particulier des filles, est une préoccupation publique permanente. Dès sa création au début du xxe siècle, le système des tribunaux pour mineur·es a créé une double norme de genre, identifiant les filles comme autant de délinquantes pour leur « incorrigibilité », l’utilisation d’un « langage profane », des « contacts débauchés » et des « associations avec des personnes immoralesLisa Pasko, « Damaged Daughters: The History of Girls’ Sexuality and the Juvenile Justice System », Journal of Criminal Law & Criminology, 100(3), p. 1100. ». Dans son résumé des recherches existantes sur les filles dans les systèmes de justice juvénile, Lisa Pasko met en évidence la réglementation des formes de sexualité pour les filles blanches :
Anne Knupfer a constaté dans son analyse des premiers tribunaux pour mineur·es de Chicago qu’entre 1904 et 1927, 60 à 70 % des filles délinquantes placées en probation ou en institution étaient accusées d’incorrigibilité. Les juges plaçaient plus fréquemment les filles en institution pour délinquance ou immoralité sexuelle que les garçons, considérant qu’il s’agissait d’un délit sexuel « plus dangereux »… Par conséquent, presque toutes les filles qui avaient des relations sexuelles avec plus d’un partenaire étaient institutionnaliséesIbid., p. 1102..
Les réformateurices du xxe siècle ont cherché à recruter des employées pour contrôler l’hétérosexualité féminine : « Toujours selon ces réformateurices, l’emploi d’un personnel de surveillance féminin devait permettre d’éviter les tentations sexuelles, qui, à les en croire, étaient souvent la cause de la criminalitéA. Davis, La prison est-elle obsolète ?, op. cit., p. 87.. » Cette préoccupation pour une sexualité incontrôlée a façonné l’enfermement des jeunes femmes tout au long du xxe siècle. Pasko cite l’exemple d’une étude menée dans les années 1960 sur les filles dans les écoles de formation : « Bien que les délinquantes juvéniles de l’échantillon aient été incarcérées pour fugue, incorrigibilité, violation de la probation et école buissonnière, la veine sous-jacente de nombre de ces délits est leur mauvaise conduite sexuelleLisa Pasko, art. cit., p. 1107.. » Cependant, les femmes et les filles non-blanches, en particulier les filles noires, échappaient souvent à ce double standard sexué. Et alors même que les réformes de l’ère progressiste[N.D.T] « Ère progressiste » est le nom donné à la période de l’histoire des États-Unis qui va des années 1890 aux années 1920. telles que les tribunaux pour femmes et le système de justice juvénile débutaient, pour garantir que l’État agisse comme un patriarche, les filles non-blanches « délinquantes » avaient moins accès à ces réformesGeoff K. Ward, The Black Child-Savers: Racial Democracy and Juvenile Justice., op. cit.. […]
Alors que les filles sont toujours ciblées de manière disproportionnée pour les infractions de statut, une matrice de lois de plus en plus punitive réglemente la sexualité de tous·tes les non-adultes. Un·e mineur·e qui envoie un selfie de nu, un acte qui est commis par un·e adolescent·e sur cinq, crée et fait circuler de la pornographie infantileJoshua D. Herman, « Sexting: It’s no joke, it’s a crime », Illinois Bar Journal, 98(4), 192, 2010.. Un·e adulte adoptant ce comportement (avec d’autres adultes) ne commettrait pas de crime. Les préadolescent·es sont de plus en plus souvent accusé·es et condamné·es pour des crimes à caractère sexuel, une catégorie large et en expansion qui peut englober des actes tels que la miction sur la voie publique, l’exhibition sexuelle et l’agression sexuelle. Selon un rapport de recherche publié en 2009 par le ministère américain de la Justice, « les mineur·es représentent plus d’un tiers des personnes connues de la police pour avoir commis des délits sexuelsDavid Finkelhor, Rochard Ormrod, et Mark Chaffin, « Juveniles who Commit Sex Offenses Against Minors », Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2009. ». Dans l’Illinois, « une bonne moitié » des mineur·es arrêté·es pour des délits sexuels en 2004, 2006, 2008 et 2010 avaient quatorze ans ou moins. Cette augmentation a créé une industrie du redressement sexuel des mineur·es : « Les programmes de traitement de la délinquance sexuelle des mineur·es ont été multipliés par quarante entre 1982 et 1992Ibid., p. 2.. »
Avec une telle surveillance des pratiques sexuelles et genrées des non-adultes, il n’est pas surprenant que les jeunes personnes queers et transgenres, en particulier celles qui ne sont pas blanches, soient surreprésentées dans les systèmes de justice pour mineur·esAngela Irvine, « We’ve Had Three of Them”: Addressing the Invisibility of Lesbian, Gay, Bisexual and Gender Nonconforming Youths in the Juvenile Justice System », Columbia Journal of Gender and Law, 19(3), 675–701, 2010 ; Joey L. Mogul, Andrea J. Ritchie, Kay Whitlock, Queer (In) Justice: The Criminalization of LGBT People in the United States. Boston, Beacon Press, 2011.. Beaucoup d’entre elles sont contraintes de quitter leur foyer et leur école à cause de la violence, participent à l’économie de la rue, souvent le seul secteur d’emploi disponible, ce qui les soumet à une forte surveillance policière. Et les jeunes queers de la rue, en particulier celles et ceux qui ne sont pas blanc·hes, bénéficient rarement de la présomption d’innocence. Selon des jeunes (et des travailleureuses du sexe) de New York, la police interprétait la possession d’un préservatif par certain·es, en particulier les jeunes de couleur, comme une preuve de travail sexuel jusqu’à ce que des militant·es commencent à contester cette pratique en 2013 dans la ville de New York. Comme l’indique l’activiste Andrea Ritchie, la possession de préservatifs n’est pas un marqueur universel du travail du sexe : « Si vous êtes un·e étudiant·e qui a des préservatifs, vous pratiquez la bonne santé publique ; si vous êtes une personne transgenre de couleur, vous vous prostituezGinia Bellafante, « Arrests by the Fashion Police », The New York Times, 15 avril 2013.. » Les jeunes queer et trans sont particulièrement vulnérables car les services de soutien offerts par l’État (foyers de groupe, placement familial) ne tiennent pas compte du genre, séparent en fonction du sexe et exigent souvent que les jeunes s’identifient comme hétérosexuel·lesDean Spade, Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of Law, Brooklyn, South End Press, 2011..
Au sein du système de justice pénale, les frontières poreuses entre enfant, mineur·e et adulte deviennent manifestes au travers des pratiques de traitement différentielles. Aux États-Unis, environ deux cent cinquante mille mineur·es sont perçu·es comme des adultes chaque annéeJuvenile Law Center, « Reducing Transfer to the Adult System », 2015.. Les États ont déterminé différents âges à partir desquels un·e enfant peut être tenu·e pour responsable et jugé·e par un tribunal pour mineur·es, et de nombreux jeunes de moins de dix-huit ans sont détenu·es dans des prisons pour adultes : « Lors d’une journée moyenne en 2010, quelque 7 560 jeunes de moins de 18 ans étaient détenus dans des centres de détention pour adultes, et 2 295 autres dans des prisons pour adultesAnnie E. Casey Foundation, art. cit., p. 1-2.. » Les jeunes de couleur sont transféré·es dans les tribunaux pour adultes de manière disproportionnée. À tous les niveaux du système de justice pénale, les jeunes de couleur sont beaucoup plus susceptibles que les jeunes blanc·hes d’être retiré·es de leur foyer, transféré·es devant un tribunal pour adultes et envoyé·es dans une prison pour adultesIbid..
Le système de justice juvénile ne facilite ni la réhabilitation ni la libération des jeunes qui ne sont pas transféré·es devant les tribunaux pour adultes. Historiquement, la justice des mineur·es, un « projet racial » dès sa conceptionGeoff K. Ward, The Black Child-Savers:Racial Democracy and Juvenile Justice, op. cit., p. 33., a désigné les jeunes Blanc·hes auxquel·les elle aurait affaire comme potentiellement innocent·es. Aujourd’hui, en conformité avec des vieux schémas issus de l’esclavage, le système de justice pénale continue de négocier et de racialiser les frontières entre l’enfance et l’âge adulte. Par exemple, les jeunes Afro-Américain·es ont toujours cinq fois plus de chances que les jeunes Blanc·hes de se retrouver derrière les barreaux, alors que le nombre total de mineur·es enfermé·es a continué à diminuer au cours des trente-cinq dernières annéesAnnie E. Casey Foundation, art. cit., p. 2.. Comme l’affirme Nell Bernstein (2014), chercheuse et journaliste de longue date dans le domaine de la justice des mineur·es, l’indicateur numéro un de l’incarcération des adultes est l’incarcération des mineur·esNeil Bernstein, Burning Down the House: The End of Juvenile Prison, New York, New Press, 2014..
Dans l’ensemble du système de justice pour mineur·es, non seulement les frontières entre enfant, mineur·e et adulte sont loin d’être statiques, mais la recherche montre à maintes reprises que les jeunes les plus marginaux et marginales — non-blanc·hes, pauvres, queer — sont les moins susceptibles d’être associé·es à cette caractéristique clé de l’enfance : l’innocence. Le statut des jeunes en tant que non-adultes détermine souvent leur entrée forcée dans l’État carcéral et, loin de ses objectifs déclarés d’être un « parent aimable et juste » comme l’explique Ayers (1998) dans son livre du même nom, le système de justice des mineur·es concourt à certaines des pires conséquences dans la vie d’un individuWilliam Ayers, A Kind and Just Parent: The Children of Juvenile Court. Boston, Beacon Press, 1998..
Les services de protection de l’enfance
L’échec de la promesse de la protection de l’enfance est peut-être le plus manifeste au sein des services de protection de l’enfance [Child Protection Services, CPS], des systèmes qui, comme l’indique l’universitaire et activiste Dorothy RobertsDorothy Roberts, Shattered Bonds: The Color of Child Welfare, New York, Basic Civitas Books, 2002., n’ont ni protégé les enfants ni traité les facteurs systémiques qui les rendent plus vulnérables. De nombreuses études, y compris des rapports produits par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États, montrent que les enfants placé·es dans les CPS, dans lesquels les enfants noir·es sont représenté·es de manière disproportionnée, ne s’épanouissent pas, qu’iels sont les moins susceptibles d’obtenir un diplôme d’études secondaires et les plus susceptibles de finir incarcéré·es. Loin d’être un billet pour la réussite universitaire ou la mobilité économique, les CPS facilitent la mort prématurée de nombreux jeunes.
Là encore, les tentatives de définition et de protection des enfants se traduisent par des résultats étonnamment disparates pour certains groupes sociaux. Au niveau national, en 2014, « les enfants noir·es, qui représentaient environ 14 % de tous les enfants, représentaient 24 % des enfants placé·es en famille d’accueil cette année-làChild Trends, « Foster Care: Indicators on Children and Youth », Child Trends Data Bank, 2015, p. 5. ». La surreprésentation est souvent plus flagrante au niveau de l’État : en Californie, alors que les Afro-Américain·es constituaient 5,7 % de la population de l’État en 2013, les enfants afro-américain·es représentaient 24,3 % de la population totale des familles d’accueil de l’ÉtatMac Taylor, « Protecting Children from Abuse and Neglect: Trends and issues », LAO Report, 8 août 2013, p. 33.. Même lorsque les familles blanches et noires entrent dans le système de protection de l’enfance pour les mêmes raisons, les familles noires sont traitées différemment.
La plupart des enfants blanc·hes qui entrent dans le système sont autorisé·es à rester avec leur famille, évitant ainsi les dommages émotionnels et les risques physiques du placement en famille d’accueil, alors que la plupart des enfants noir·es sont retiré·es de la leur. Et une fois retiré·es de leur foyer, les enfants noir·es restent plus longtemps en famille d’accueil, sont déplacé·es plus souvent, reçoivent moins de services et ont moins de chances que les autres enfants d’être renvoyé·es chez elles et chez eux ou adopté·esD. Roberts, « Race and Class in the Child Welfare System. PBS Frontline: Failure to Protect », janvier 2003..
Les jeunes queers, en particulier celles et ceux qui ne sont pas blanc·hes, décrivent certaines des pires expériences vécues au sein des CPS. Un rapport de 2014 du Williams Institute a révélé que les jeunes queers sont plus susceptibles que les jeunes non queers de déclarer avoir été maltraité·es lors de leur prise en charge, d’avoir été placé·es plusieurs fois dans des familles d’accueil et de vivre dans des foyers collectifs. Une étude antérieure, menée dans la ville de New York en 2001, a révélé qu’un
pourcentage stupéfiant de 78 % des jeunes LGBT ont été retiré·es ou se sont enfuis d’un placement en famille d’accueil parce que ces placements n’étaient pas accueillants, voire même hostiles à l’égard de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 100 % des jeunes LGBT placé·es dans des foyers de groupe de l’ACS [Administration for Children’s Services] ont déclaré avoir été harcelé·es verbalement pendant leur séjour dans un foyer, et 70 % ont déclaré avoir été victimes de violences physiques en raison de leur identité sexuelleRandi Feinstein, Andrea Greenblatt, Lauren Hass, Sally Kohn, Julianne Rana, « Justice for All? A Report on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Youth in the New York Juvenile Justice System Angeles », New York, Urban Justice Center, 2015..
On peut soutenir que les objectifs des CPS n’ont jamais vraiment consisté à protéger les enfants. Le juriste Martin GuggenheimMartin Guggenheim, What’s Wrong with Children’s Rights, op. cit. et la politologue Barbara NelsonBarbara Nelson, Making an Issue of out Child Abuse: Political Agenda Setting for Social Problems, Chicago, University of Chicago Press, 1984. soutiennent que leur état actuel est en partie le résultat d’un compromis politique. Le début des années 1970 a été caractérisé par un recul systémique et racialisé face aux acquis limités du mouvement des droits civiques des années 1960 et à la « guerre contre la pauvreté[N.D.T] La War on Poverty désigne un ensemble de mesures législatives pour lutter contre la pauvreté, lancées par le président Johnson, proclamé lors de son discours sur l’état de l’Union le 8 janvier 1964. » de l’administration Johnson. Alors que le financement de la lutte contre la pauvreté avait été directement lié à la protection de l’enfance en 1967 par le biais de programmes fédéraux tels que l’Aide aux familles avec enfants à charge (AFDC), dans les années 1970, les enfants étaient toujours soutenu·es, mais pas les adultes pauvres, en particulier des adultes non-blanc·hes. Les conservateurs ont effectivement fait valoir que « les programmes libéraux de lutte contre la pauvreté avaient exacerbé les problèmes des pauvresMartin Guggenheim, What’s Wrong with Children’s Rights, op. cit., p. 184. ». Les faibles acquis des années 1960 furent remis en cause et notamment les programmes d’aide sociale et d’assistance publique. Ne voulant ni ne pouvant dénoncer ou s’opposer au racisme anti-noir au cœur de la réaction contre le soutien gouvernemental aux programmes d’aide sociale, les progressistes ont battu en retraite. Il était possible de contrôler les mauvaises familles (en particulier les mères non-blanches) pour sauver les enfants, mais il était impossible de mettre fin à la pauvreté et de promouvoir l’égalité des chances. En 1973, « le mouvement pour les droits à l’aide sociale était effectivement mortKaarin S. Gustafson, Cheating Welfare: Public Assistance and the Criminalization of Poverty. New York, New York University Press, 2011, p. 31. ». En 1974, la loi fédérale Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA) a séparé la protection des enfants des programmes de lutte contre la pauvreté. Avec la CAPTA, le bien-être des enfants était contrôlé mais pas financé et tous les facteurs structurels qui façonnent la protection de l’enfance, y compris, par exemple, le revenu des parents, n’étaient pas pris en compte. Le Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996 en a considérablement réduit le programme, tout comme il a mis en place des interdictions pour les personnes ayant des condamnations liées à la drogue, établi une limite à vie de cinq ans pour accéder aux allocations (les États pouvaient choisir de réduire cette limite extérieure), et plus encoreIbid.. Alors que les ressources pour soutenir les familles et lutter contre la pauvreté s’amenuisent, en 2012, les sources fédérales, étatiques et locales ont dépensé plus de 28,2 milliards de dollars pour les activités de protection de l’enfance, notamment le placement en famille d’accueil, l’adoption, les enquêtes du CPS et la gestion de casKerry DeVooght, Megan Fletcher, Hope Cooper, Federal, State, and Local Spending to Address Child Abuse and Neglect in SFY 2012, Child Trends..
Bien qu’ils prétendent protéger l’enfant, ces systèmes ne remplissent cruellement pas le mandat qui leur a été confié et, loin de cela, ils sont liés à notre État carcéral. L’idée de la protection de l’enfance donne un vernis de bien-être et de soins à ces organismes, mais, dans la pratique, le résultat est souvent grotesque, et ces systèmes sont davantage punitifs et coercitifs. Ayant un impact disproportionné et négatif sur les communautés non-blanches et/ou pauvres, ce pouvoir de figuration de l’enfant innocent — qui pourrait être contre les services de protection de l’enfance ? — masque souvent le rôle central que jouent les CPS dans la reproduction d’un État carcéral racialisé et hétéropatriarcal.
Conséquences collatérales : Comment la protection de l’enfance façonne les adultes et sape la sécurité publique
La protection de l’enfant nécessite également de réglementer la vie des non-mineur·es. Si la recherche démontre que la diabolisation de ses bénéficiaires peut déstabiliser la légitimité d’une institution ou d’un programme public et faire valoir la place prise par une réglementation basée sur le marchéLisa Duggan, The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy, Boston, Beacon Press, 2003 ; Ange-Marie Hancock, The Politics of Disgust: The Public Identity of the Welfare Queen. New York, New York University Press, 2004., le simple fait de suggérer la nécessité de protéger l’enfant peut aussi être utilisé pour reconfigurer efficacement la sphère publique. Selon cette logique, les parcs, les écoles, les transports en commun et Internet sont trop dangereux pour nos enfants. Seule une surveillance continue peut garantir leur bien-être de façon adéquate. Les zones de sanctions pénales renforcées autour des écoles et des aires de jeux, les registres publics de délinquant·es sexuel·les et les vérifications des antécédents criminels des candidat·es à l’embauche sont autant de mesures qui visent à assurer la sécurité des enfants, mais qui ont également pour fonction d’étendre et de naturaliser notre État carcéral et de réglementer la vie des adultes. La préservation de l’innocence, un concept au mieux ténu, et qui n’est accessible qu’à un petit nombre de Blanc·hes, crée donc sa propre violence. Comme le demande Stockton, « comment l’innocence, la façon dont nous désignons les enfants par défaut, provoque-t-elle sa propre violenceKathryn Stockton, The Queer Child, op. cit., p. 9. ? » Bien qu’ils ne soient pas représentatifs de toutes les façons dont la protection de l’enfance est incorporée dans l’État carcéral et façonne la vie des adultes, trois exemples permettent d’en avoir un aperçu.
Tout d’abord, les espaces physiques associés à l’enfance continuent de justifier une surveillance et un maintien de l’ordre accrus et sont également marqués comme des lieux où les peines sont plus lourdes en cas d’infraction à la loi, même si aucun enfant n’a été blessé ou n’y a participé. Par exemple, tous les États ont des zones sans drogue autour des écoles et d’autres espaces publics associés aux enfants. Selon Drug-Free Zone Laws: An Overview of State Policies, un rapport de 2013 du Sentencing Project Report, ces lois ont été établies pour « protéger les enfants des activités liées à la drogue », et celles et ceux qui sont pris en train de vendre ou de consommer dans ces zones s’exposent à des « peines considérablement plus élevéesNicole D. Porter, Tyler Clemons, Drug-Free Zone Laws: An Overview of State Policies. Sentencing Project Report, 2013, p. 1. ». La taille des zones varie et inclut les espaces scolaires, mais les dépasse également souvent :
Bien que l’intention déclarée des lois sur les zones sans drogue était de protéger les écoles, trente-et-un États ont étendu la portée de leurs politiques à des zones allant au-delà des écoles primaires et secondaires et à bord des bus scolaires. Par exemple, plusieurs États ont établi des zones autour des logements publics, des parcs publics, des églises et des garderies. D’autres, dont le Missouri et la Virginie-Occidentale, incluent les collèges et les universités dans leur définition du terme « école ». L’Utah ajoute à la liste des zones couvertes les centres commerciaux, les parcs de loisirs et les parkings de ces lieuxIbid., p. 2..
Le coût de ces sanctions renforcées est élevé et varie d’un État à l’autre, il peut inclure le doublement de peine, le transfert immédiat d’un·e mineur·e vers un tribunal pour adultes (puis sa condamnation dans une prison pour adultes) et une peine minimale obligatoire ou un renforcement de la peine qui va de un à huit ans, élevant automatiquement ce qui serait une infraction moins grave si elle était commise ailleurs. « En Alabama, par exemple, une vente de drogue qui a lieu à 5 kilomètres d’une école, d’un collège ou d’un projet de logement public est soumise à une peine de prison de cinq ans sans sursisIbid., p. 1.. »
Aucune étude n’a démontré que ces zones décourageraient les activités criminelles (ce qui, bien sûr, n’est pas la même chose que de prévenir leurs dommagesJamais neutre, la notion de crime renvoie à un ensemble de lois et de règlements formulés : « Les actes ne sont pas, ils adviennent. Il en va de même pour le crime. Le crime n’existe pas. Le crime est créé. Il y a d’abord des actes. Puis suit un long processus qui consiste à donner un sens à ces actes. La distance sociale revêt une importance particulière. La distance augmente la tendance à donner à certains actes le sens de crimes et aux personnes le sens simplifié de criminel·es » (Christie, 2000, p. 22).) impliquant des mineur·es ou qu’elles protègeraient les jeunes contre la drogueJudith A. Greene, Kevin Pranis, Jason Ziedenberg, Disparity by Design: How Drug-Free Zone Laws Impact Racial Disparity — and Fail to Protect Youth. Justice Policy Institute, 2006. Cf. ; Alex Kajstura, Peter Wagner, William Goldberg, The Geography of Punishment: How Huge Sentencing Enhancement Zones Harm Communities, Fail to Protect Children, Prison Policy Initiative, 2008. Cf. ; Nicole D. Porter, Tyler Clemons, Drug-Free Zone Laws: An Overview of State Policies. Sentencing Project Report, 2013. Retrieved from .. En outre, bien qu’elles semblent ne pas tenir compte de la couleur de peau, ces zones de signalisation participent à la privatisation ou à la diabolisation des espaces publics, limitant celles et ceux qui n’ont pas accès aux ressources privées et qui doivent compter sur les espaces et les institutions publics. L’analyse de la loi sur les zones du Massachusetts effectuée par Prison Policy Initiatives conclut que leur mise en place « se traduit directement par des taux d’incarcération plus élevés pour les accusé·es noir·es, latinos·as, urbain·es et pauvres, sans améliorer la sécurité des enfantsWilliam Goldberg, The Geography of Punishment: How Huge Sentencing Enhancement Zones Harm Communities, Fail to Protect Children, op. cit. ». Même si le débat national sur la réforme des prisons et de la police évolue timidement, les législatures des États et le Congrès semblent moins disposés à éliminer complètement ces zones d’amélioration des peines présentées comme protégeant les enfantsChristie Thompson, Connecticut Votes to Keep “Urban Penalties” for Drug Offenders who Live in Cities. Think Progress, 2015.. En publiant son Report on Sentencing and Corrections Reform [rapport sur la réforme des peines et des services correctionnels], le Pew Charitable Trusts a annoncé « des révisions des peines minimales obligatoires, des zones scolaires sans drogue parmi une foule de changementsThe Pew Charitable Trusts, Justice Reinvestment Initiative Brings Sentencing Reforms in 21 States, 22 janvier 2016. ». Cependant, le dossier indique que seuls trois des trente-quatre États analysés ont « révisé » leurs zones scolaires sans drogue, et aucun n’en a éliminé les dispositions.
Deuxièmement, l’une des formes de la protection carcérale contemporaine de l’enfant les plus difficiles à aborder, et encore plus à critiquer, est le registre des délinquant·es sexuel·les. Apparus dans les années 1980 dans le but louable de protéger les enfants contre la violence sexuelle, les registres se sont avérés peu efficaces pour réduire la violence sexuelle à l’égard des enfants ou pour empêcher de leur nuireLes données disponibles indiquent clairement que les étranger·ères sont systématiquement les moins susceptibles d’être les auteurices d’une agression sexuelle. Selon une étude marquante du Bureau of Justice Statistics, qui a utilisé des données sur les victimes d’agressions sexuelles provenant d’une nouvelle base de données, le National Incident-Based Reporting System, les étranger·ères ne représentent que 7 % des agressions sexuelles contre les enfants (Howard N. Snyder, Sexual Assault of Young Children as Reported to Law Enforcement: Victim, Incident, and Offender Characteristics, Bureau of Justice Statistics, 2000. Cf. ). Roger N. Lancaster, Sex Panic and the Punitive State. Berkeley, University of California Press, 2011 ; Wayne A. Logan, Knowledge as Power: Criminal Registration and Community Notification Laws in America. Palo Alto, Stanford University Press, 2009 ; Richard G. Wright, R. « Sex Offender Registration and Notification: Public Attention, Political Emphasis, and Fear », Criminology and Public Policy, 3(1), 97–104.. Les registres publics restreignent la vie des personnes condamnées pour des infractions sexuelles, une forme de punition après la libération à laquelle n’est confrontée aucune autre personne ayant un casier judiciaire. Avec plus de 850 000 personnes inscrites dans les registres des délinquant·es sexuel·les aux États-Unis, dont beaucoup ont été condamnées alors qu’elles étaient mineures, les personnes condamnées pour des crimes sexuels constituent « le segment de la population carcérale des États et des prisons fédérales qui connaît la croissance la plus rapide » en raison du « durcissement des sanctionsMarie Gottschalk, Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics, Princeton, Princeton University Press, 2015, p. 199. ». Pourtant, ces registres ne parviennent pas à véritablement protéger les enfants. Selon la politologue Marie GottschalkSteve Mills, « Inmate Held on 1974 Parole Violation Even Though Officials Want him Freed », The Chicago Tribune, 3 décembre 2016. Cf. https://www.chicagotribune.com/2016/12/03/inmate-held-on-1974-parole-violation-even-though-officials-want-him-freed/., qui résume les recherches disponibles, « les ami·es, les connaissances et les membres de la famille sont responsables de plus de 90 % de tous les abus sexuels sur les enfants ».
Cette promesse ratée de protection de l’enfance est récurrente dans les études sur la question. En 2014 à New York, alors que l’État incitait à la fermeture des prisons, le Washington Post a rapporté que des dizaines de personnes condamnées pour des délits sexuels étaient détenues après leur date de libération en raison de leur incapacité à trouver un logement en raison de lois qui exigent de vivre à plus de trois cents mètres d’une écoleAssociated Press, « Housing Rules Keep NY Sex Offenders Behind Bars », The Washington Post, 22 août 2014. Cf. http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/22/housing-rules-keep-ny-sex-offenders-behind-bars/#ixzz3QK6DIbFY.. De même, en 2016, le Chicago Tribune a rapporté que, malgré l’engagement du gouverneur républicain de réduire la population carcérale, le département correctionnel de l’Illinois détient régulièrement « parfois plus de mille » personnes condamnées pour des délits sexuels après leur date de libération en raison des difficultés à trouver un logement pour cette population{fn-26_l_enfant_a_problemes-99}. Et les sanctions s’accumulent : début 2016, le président Obama a signé une loi exigeant que les passeports des citoyen·nes condamné·es pour des délits sexuels portent la mention « délinquant·es sexuel·les »David Post, « The Yellow Star, the Scarlet Letter, and “International Megan’s Law », The Washington Post, 6 janvier 2016. (Post, 2016). Dans l’Illinois, les législateurices ont interdit l’accès aux restaurants dotés d’aires de jeux aux délinquant·es sexuel·les (Fowler, 2014). Les exigences en matière d’enregistrement continuent de s’intensifier avec des conséquences prévisibles : si environ 98 % des personnes inscrites sur ce registre sont des hommes, les Afro-Américain·es sont représenté·es de manière disproportionnée, soit 22 % des personnes condamnées pour des délits sexuels alors qu’iels représentent 13 % de la population américaine totale (Ackerman, Harris, Levenson, et Zgoba, 2011). Les non-adultes, celles et ceux qui sont théoriquement nimbé·es d’innocence sexuelle, sont accusé·es de délits sexuels de manière disproportionnée et tenu·es de se signaler, parfois pour toute leur vie. Bien que l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des enfants soit essentielle, malgré leur inefficacité, les registres sont remarquablement résistants à toute critique publique, et donc à tout changement de politique, et continuent de donner l’impression de protéger les enfants sans vraiment le faire.
Pour finir, l’accès à l’emploi est également de plus en plus réglementé pour assurer la sécurité publique. Les vérifications des antécédents judiciaires, y compris les données biométriques, sont obligatoires pour la quasi-totalité des emplois officiels et des postes bénévoles auprès de mineur·es, ce qui empêche souvent les personnes ayant un casier judiciaire d’accéder à l’emploi et aux stages non rémunérés, que leur condamnation ait porté préjudice à un·e enfant ou non. Si le fait d’exiger des vérifications générales ou obligatoires des antécédents judiciaires, ou d’interdire aux personnes ayant commis des crimes ou des délits (ou même des arrestations) de postuler à un emploi peut sembler garantir que les employeurs réduisent les risques associés à un·e employé·e, la recherche montre clairement que ces pratiques sont défectueuses et coûteuses, qu’elles réduisent les bassins d’emploi et contribuent à des formes plus larges d’insécurité communautaire :
L’ironie repose sur le fait que les tentatives des employeureuses pour protéger le lieu de travail excluent non seulement de nombreuses personnes qui ne présentent que peu ou pas de risques, mais qu’elles compromettent également la sécurité publique. Comme l’ont montré des études, le fait d’offrir aux individus la possibilité d’avoir un emploi stable fait baisser les taux de récidive et augmente donc la sécurité publiqueMichelle N. Rodriguez, Maurice Emsellem, 65 Million “Need not Apply”: The Case for Reforming Criminal Background Checks for Employment. National Employment Law Project, 2011..
Le National Employment Law Project a estimé qu’en octobre 2016 environ soixante-dix millions de personnes anciennement incarcérées étaient à la recherche d’un emploi, et que seulement cent cinquante villes et comtés avaient institué des formes de législation de type « Ban the Box[N.D.T] La campagne « Ban the Box » vise à supprimer, dans les formulaires de dépôt de candidature, l’interface graphique laissant un choix binaire concernant la mention d’antécédents judiciaires. Cf. » pour s’assurer que les employé·es potentiel·les puissent démontrer qu’iels sont qualifié·es avant que employeureuse ne puisse examiner leur casier judiciaireMichelle N. Rodriguez, Beth Avery, « Ban the Box: US Cities, Counties, and States Adopt Fair Hiring Policies », National Employment Law Project, 2011, p. 3.. Dans la plupart des administrations, la discrimination à l’emploi, formelle et informelle, poursuit les personnes ayant un casier judiciaire. La protection des enfants nécessite-t-elle vraiment des pratiques et des politiques qui stigmatisent et limitent les parcours de vie des adultes, y compris de leurs propres éducateurices et des membres de leur famille qui ont un casier judiciaire ?
Les vérifications des antécédents sont particulièrement visibles et institutionnalisées dans le domaine de l’éducation, où, là encore, elles sont naturalisées par l’hypothèse implicite selon laquelle ces vérifications protégeraient les enfants. De nombreux États, tels que l’Illinois, exigent que les futur·es étudiant·es se soumettent à une vérification des antécédents judiciaires dans le cadre de leur processus de candidature, ne serait-ce que pour être admis·es dans un programme de formation d’enseignant·es. En 2016, USA Today a classé les États selon la rigueur de la vérification des antécédents des aspirant·es enseignant·es (et selon que les États signalent ou non les « mauvais·es enseignant·es » à une base de données nationale)John Kelly, « How we Graded the States on Teacher Background Checks. » USA Today, 14 février 2016.. Le Center for Community Alternatives (CCA) indique qu’avant même de lancer un programme de certification, 66 % des collèges et universités interrogent les candidat·es potentiel·les sur leurs antécédents judiciaires, et certains demandent même s’iels ont été arrêté·es et s’iels ont un casier judiciaire vierge. L’argument avancé pour ces vérifications d’antécédents est la sécurité publique. Pour autant, selon le rapport du CCA, « aucun lien n’a été établi entre le fait d’avoir un casier judiciaire et le fait de poser un risque pour la sécurité du campus » et, en fait, l’enseignement supérieur « réduit la récidive » et favorise donc la sécurité publiqueMarsha Weissman, Alan Rosenthal, Patricia Warth, Elaine Wolf, Michael Messina-Yauchzy, (2015). The Use of Criminal History Records in College Admission. Center for Community Alternatives, 2015, p. ii.. De la même manière que le profilage racial est présent dans nos communautés et nos écoles, la vérification obligatoire des antécédents judiciaires peut avoir pour fonction d’écarter les communautés latinos et noires de l’enseignement supérieur, en particulier de la qualification d’enseignant·e.
La demande de vérification des antécédents judiciaires a également renforcé le pouvoir d’industries soumises à une faible réglementation gouvernementale : il ne s’agit pas seulement de contrôler la production et la circulation d’informations judiciaires mais également d’écarter de toute opportunité d’emploi des candidat·es qualifié·es, y compris dans l’enseignement, mais aussi pour renforcer les mythologies préjudiciables sur les liens entre race et criminalité. En 2012, la Commission américaine de l’égalité des chances en matière d’emploi a découvert que les vérifications des antécédents judiciaires par Pepsi avaient été discriminatoires à l’égard de plus de trois cents Afro-Américain·es, car, parce qu’iels avaient été arrêté·es mais pas condamné·es, iels n’avaient pas été recruté·esUS Equal Employment Opportunity Commission, Pepsi to Pay $3.13 Million and Made Major Policy Changes to Resolve EEOC Finding of Nationwide Hiring Discrimination Against African Americans, 1er janvier 2012..
Les aménagements de peine, les registres de délinquant·es sexuel·les et les vérifications biométriques des antécédents participent à offrir l’illusion de la sécurité publique et de la protection des enfants. Ils approfondissent une logique carcérale, ils font peu pour les enfants et en outre ils ciblent ou criminalisent les adultes, en particulier les plus marginaux·ales. Notre État carcéral propose des mesures de surveillance et de maintien de l’ordre pour assurer la sécurité publique et protéger l’enfant, mais les mécanismes qui sont développés et perfectionnés n’aident que peu les enfants en chair et en os.
VERS DES CHANGEMENTS ?
En ce moment de réforme, déconstruire le pouvoir figuratif de l’enfant et la rhétorique de la protection de l’enfance met en lumière certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confronté·es celles et ceux qui travaillent à démanteler notre État carcéral, y compris les tensions entre un travail de réforme et des changements structurels et systématiques. Cette analyse n’est pas nouvelle. Les chercheurs en sciences de l’éducation ont interrogé de manière critique les conceptions de l’enfance et de l’adolescence et/ou la manière dont ces catégories labiles reproduisent et masquent les injustices au sein des systèmes éducatifs (et au-delà). Pourtant, malgré ces travaux, les childhood studies, ou critical childhood studies, sont sur une voie parallèle à celle des études sur l’éducation, et, curieusement, elles n’en constituent pas un fondement essentiel. L’enfant à problèmes semble intéresser les historien·nes, les spécialistes des études littéraires et certain·es anthropologues, mais iel semble moins pertinent pour celles et ceux qui travaillent dans la recherche et la pratique de la maternelle au secondaire. La façon dont les enfants en chair et en os saturent notre domaine rend peut-être plus difficile encore la perception des structures et des systèmes qui sont inscrits dans ces corps et peut-être façonne-t-elle également les perspectives plus larges que nous pouvons avoir sur elles et eux.
Il n’y a pas de réponses évidentes à apporter aux tensions et aux questions que soulève cet essai. Comme l’écrit l’abolitionniste Angela Davis, peut-être que poser de nouvelles questions fait partie du travail de construction de futurs plus justes : « Comment pouvons-nous imaginer un monde meilleur et nous poser des questions nous permettant de voir au-delà de ce qui est donnéAngela Davis, Les Goulags de la démocratie, trad. Louis de Bellefeuille, Paris, Au Diable Vauvert, 2018, p. 24. ? » Dans cet état d’esprit, je propose des provocations finales, pas plus exhaustives que prescriptives pour notre travail en educational studies, afin de démanteler l’État carcéral et de construire des vies florissantes pour toustes.
-
La vulnérabilité peut être envisagée par des mécanismes autres que ceux relevant du maintien de l’ordre, de l’incarcération et de la surveillance. Théoriser à nouveaux frais la vulnérabilité en dehors d’une logique carcérale, ou d’un « État-papa » coercitifIris Marion Young, The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the Current Security State, in Marylin. Friedman (éd.), Women and Citizenship, New York, Oxford University Press, 2005, p. 15-34. est une tâche essentielle et permanente dans nos écoles et nos communautés. Par exemple, la construction d’écoles plus sûres pour les jeunes (et le personnel) LGBTQ ne peut pas reposer sur la criminalisation ou des pratiques qui sont toujours racialisées et hétérogenrées. Les jeunes personnes, et celleux qui travaillent à leurs côtés, doivent être des leadereuses dans le travail visant à concevoir la sécurité de manière transformative, en dehors de logiques carcérales.
-
Construire des mouvements pour l’accès à l’éducation et la justice qui ne laissent personne de côté. Par exemple, les mobilisations actuelles contre la fermeture des écoles publiques de la maternelle au secondaire avancent souvent des arguments centrés sur l’innocence et la bonté des enfants, renforçant ainsi une logique qui garantit que les personnes de plus de dix-huit ans (leurs parents, leurs enseignant·es, leurs frères et sœurs plus âgé·es, par exemple) ne méritent pas d’être soutenues et d’avoir accès à une éducation publique gratuite et de qualité. Par nécessité, les mouvements de justice pour les personnes handicapées semblent montrer la voie pour développer des stratégies de mouvement radicalement inclusives qui ne laissent personne de côté.
-
Une analyse solide du travail figuratif de l’enfance dans ce moment politique nécessite une analyse et des outils issus des arts et des sciences humaines. La recherche en sciences sociales qui se concentre sur les enfants ou sur l’enfant en tant que sujet d’enquête suppose souvent que les catégories de développement sont fixes et naturelles plutôt que mouvantes et inventées. Il ne s’agit pas d’un appel à l’abandon des sciences sociales. Cependant, la prédominance de la psychologie, des méthodes et outils des sciences sociales dans les sciences de l’éducation peut faire écran à notre capacité à explorer des questions fondamentales : quelles sont les significations attachées à l’enfance ? Quel travail politique l’enfant accomplit-iel dans une mobilisation ou un mouvement spécifique ?
-
Les lois et les pratiques sans fondement qui professent la protection de l’enfant sont souvent construites sur des peurs enracinées dans des systèmes idéologiques. La transphobie et la misogynie sont à l’origine du projet de loi sur les toilettes non-mixtes, tout comme les craintes de la suprématie blanche concernant le « superprédateur » juvénile et les « bébés crack » ont précédemment alimenté une série de lois punitives. Relever ces faits ne suffira pas à les démanteler. Comment notre travail au sein d’une justice soucieuse d’éducation[N.D.T] L’educational justice vise à favoriser l’égalité dans l’accès à l’éducation, notamment par le tutorat. permet-il d’amplifier ou de remettre en question les logiques qui sous-tendent la vague actuelle de lois sur la protection de l’enfance ? Comment pouvons-nous continuer à ébrécher et à ne pas renforcer les idéologies superposées — le capacitisme, le colonialisme — qui sous-tendent ces lois ?
-
L’innocence et le manque de raison, deux caractéristiques attribuées à l’enfant et pourtant souvent occultées, sont à la base de notre appareil démocratique et des institutions qui y sont associées, y compris notre système juridique pénal. Dans notre travail dans les écoles, comment aborder les différences liées à l’âge sans naturaliser l’innocence, un artefact fluide et dangereux que certains et certaines possèdent naturellement, que d’autres se voient refuser, et que toutes et tous, inévitablement, perdent ?
-
Étant donné que la protection de l’innocence sexuelle des enfants blanc·hes est une facette récurrente de l’expansion carcérale, parlons (davantage) de sexualité. En même temps, convenons que travailler pour mettre fin aux violences sexuelles vis-à-vis des enfants n’est pas incompatible avec la reconnaissance des complexités entourant les sexualités (enfantines) émergentes. En d’autres termes, reconnaissons que notre État carcéral n’est pas en mesure de mettre fin à la violence sexuelle contre les enfants, mais, en même temps, que les préjudices subis par les enfants ne devraient pas légitimer les systèmes qui ne s’attaquent pas à ces préjudices.
Kiss & Cry —
Le monde de mon enfance c’est le monde du patinage artistique
des lames fines vissées à des bottines trop serrées
une surface glacée
de la musique
de la lumière, beaucoup
puis plus tard, des clubs, des fédérations, trop de drapeaux et de juges.
À six ans, ma mère me met sur la glace pour la première fois pour calmer mon hyperactivité, le sport sera un exutoire. C’est la séance publique de la patinoire de Colmar, je crois qu’il est aux alentours de dix-huit heures, la musique bruyante fait vibrer la piste. Dans le bâtiment de béton aux allures brutalistes résonnent tous les succès musicaux français du moment : la compil’ de la Star Academy 1, Jennifer, Garou, les L5, Lorie et Shakira. Il fait déjà nuit et seuls les projecteurs colorés éclairent celles et ceux qui, en dessinant de grands cercles, se bousculent sur la surface glissante.
Je me tiens à la barrière pour Ne pas tomber : une injonction permanente qui pendant vingt ans sera ma ligne d’horizon. Surtout ne pas tomber, rester debout, répété chaque jour avant et pendant les entraînements le soir, une fois par semaine, puis deux fois par jour six jours sur sept
chute = un point en moins
c’est-à-dire ta note baisse
c’est-à-dire tu ne seras pas premier
c’est-à-dire tu chutes dans le classement
c’est-à-dire tu risques de finir dernier, tu as raté, tu es un raté.
Je reste debout et ma performance c’est moi et surtout il faut sourire et je montre mes dents.
Sur la glace, souriant je reste debout, j’attire l’attention parce que je tiens debout d’une manière plutôt belle et quand je tombe je me relève très vite pour que personne ne me voie. Ma mère m’inscrit au CPARC (Club de patinage artistique de Colmar). Dans le groupe d’enfants qui s’élancent sur la glace, je me distingue, j’aime que les coachs m’aiment et j’aime rentrer à la maison pour dire à ma mère que je suis resté debout. Elle se rapproche des coachs et toustes finissent par s’apprécier.
Premier objectif :
elle [ma mère] doit faire de moi un bon garçon,
c’est-à-dire, sage, disposé à l’écoute, attentif, rigoureux, concentré.
Deuxième objectif (qui dépend forcément du premier) :
elleux [les coachs] doivent faire de moi un bon patineur,
c’est-à-dire, déterminé, discipliné, prêt à l’abnégation, assidu, fiable.
Au centre, silencieux, je me réjouis de toute cette attention et me fantasme champion du monde.
Ma mère sacrifie tout à sa tâche, elle me soutient inconditionnellement. Quand on me propose de rejoindre le groupe des compétiteurices et que mon activité s’intensifie, elle aménage sa vie en fonction. Tous les matins, elle se lève à quatre heures quarante-cinq pour me réveiller à cinq heures et m’amener à l’entraînement (de six heures à sept heures et demi), elle m’accompagne à l’école avant d’aller au travail, puis revient me chercher pour aller au second entraînement (de midi à treize heures trente), puis elle me dépose à nouveau à l’école avant de retourner au travail, enfin, le lundi, le mercredi et le jeudi, elle m’amène à la séance de off-ice (de dix-huit heures à dix-neuf heures).
En dehors de ce circuit, mon père. Toutes les deux semaines, le week-end, il me demande : Pourquoi tu fais ça ? Ta mère te force ! puis il dit : C’est un sport de pédé. Me questionne : Tu es pédé ?
Ma performance c’est moi et je crois
que j’aime les derniers conseils du coach avant de me présenter
que j’aime entendre mon nom vibrer sur la scène,
le nom de mon père sur ma scène
que j’aime les yeux rivés vers moi seul sur la glace avant que la musique ne démarre, quand je pense, à chaque fois, qu’il n’y aura pas de moment plus important dans ma vie, que je pourrais tout aussi bien mourir après, moi je veux mourir sur scène, sourire aux lèvres et surtout sans tomber
que j’aime les projecteurs qui éclairent ma tunique moulante et pailletée, elle brille de mille feux lorsque je bouge sur la musique qui m’accompagne
ce que j’aime par-dessus tout, c’est le moment d’après : lorsque la musique s’arrête, que je ne suis pas tombé et que les gens applaudissent, que je salue les juges en souriant. Je cherche le sourire de ma mère quelque part dans les gradins et le visage de mon père que je regarde d’un air vengeur, puis celui de mon coach, fier de son élève. Il me prend dans les bras et m’accompagne au Kiss & Cry. C’est là qu’on attend les résultats, déjà l’air victorieux pour forcer ce destin maintenant entre les mains de celles et ceux qui me jugent et m’attribuent une note.
Dans le Kiss & Cry : un canapé ou des chaises en plastique, un paquet de mouchoirs pas trop loin et en fond un décor aux couleurs de la ville qui accueille la compétition. Je m’assois à côté de mon coach, en face de la caméra, encore à bout de souffle.
On ne se parle pas trop fort pour que le peu de spectateurices devant la retransmission n’entendent pas ce qu’on se dit : des retours sur la performance et quand ça se passe mal des engueulades silencieuses. La caméra toujours présente, enregistre chacune des émotions.Kiss & Cry but smile, pour que personne ne voie rien de mon angoisse dans l’attente des notes. Kiss & Cry but smile and keep quiet. Je me demande : Est-ce que c’est la dernière ? pendant que mon coach me chuchote son plan infaillible sur les quatre prochaines années pour améliorer mes performances. Je montre mes dents. Ma performance, c’est moi et je fais semblant de l’écouter pendant que je déroule le fil de la question : Et si c’était la dernière ? Cette question me tient debout sur la scène. Le jugement tombe et nous nous prenons dans les bras
ou pas.
La famille du patinage devient ma famille élective et l’autorité de mes coachs se substitue à celle de mes parents, qui, de toute manière, est éclatée par un divorce. Mes camarades d’entraînements sont mes frères et mes sœurs. Nous faisons mine de nous soutenir, en réalité nous nous battons pour l’amour de celles et ceux qui nous dressent à la réussite : chaque sourire d’un·e président·e de club, d’un·e juge, d’un·e membre dirigeant·e de la Fédération française, de mes entraîneureuses, me réchauffe le cœur. Je ne veux que ça, qu’iels me scrutent, sourire aux lèvres, en se disant « on a fait du bon travail », alors je me moule à leurs attentes, encore jeune, totalement plastique.
Mon corps dit : remplissez-moi, je vous contenterai et vous rendrai fièrs·es de vous car ma performance est, par extension, votre travail et regardez
je montre si bien mes dents.
Mon coach est clair : il faut tout savoir faire avant la puberté, la suite de la carrière n’est qu’une conservation de ces acquis. Il me dit aussi que c’est encore plus vrai pour les filles. Après la puberté c’est un marathon, avant, un sprint. Alors je prie pour qu’elle tarde, et chaque poil qui apparaît, chaque octave de la voix en moins, chaque bouton sur le visage est le signe annonciateur d’une fin de carrière prématurée. Je joue contre le temps, contre la nature qui, d’après mon coach ne m’a pas gâté, en me faisant remarquer la largesse des hanches de ma mère, la bedaine de mon père et mes fesses déjà bien rondes. Secrètement, je maudis mon arbre généalogique et ne souhaite qu’une chose : garder ce corps d’enfant le plus longtemps possible puis devenir comme mon coach, rachitique. Je ne m’aime que comme ça, maigre, musculature en développement (pas trop pour ne pas être trop lourd), dynamique.
Je dresse mon corps contre ce qui me semble être une fatalité
compte la nourriture
et les calories
ingurgitées et brûlées
me passe du prochain repas s’il le faut
me regarde dans le miroir, de profil, inspire puissamment
regarde mes côtes transparaître
apprends à aimer la sensation de vide au creux du ventre
et la sueur qui perle le long de la colonne vertébrale
le corps endolori après des heures de sport, trop d’abdos
puis le sillon qui se creuse dans le ventre, le muscle qui apparaît sous la peau.
Mon rapport au corps devient moral
et ma perception du monde est médiée par ce rapport :
est bien et beau
tout ce qui s’apparente à ce corps que le sport me fait idéaliser,
préservé de la graisse, sans forme si ce n’est celle que dessinent ses muscles,
qui a l’apparence de cette jeunesse qu’on m’a appris à chérir
qui sait glisser et danser sans tomber — surtout ne pas tomber —
qui à table mange avec retenue, sans se goinfrer,
modéré en tout point, les lèvres relevées pour découvrir mes dents,
tout ce qui, demain, me permettra de me sentir léger au réveil.
Est mal et laid
tout ce qui diffère de ce corps idéal,
épais et gras,
dont on dit qu’il est maladroit, ne peut donc glisser et danser, tombe, s’effondre,
qui, à table, se goinfre, la bouche grande ouverte prête à recevoir les calories superflues
tout ce qui demain, au réveil, m’empêchera de me sentir léger.
Pourtant j’aime absolument le mal et développe avec lui un rapport coupable qui plus tard me fera plonger la tête dans les toilettes après chaque repas, en y prenant du plaisir.
Avec mes camarades, on se raconte en rigolant les comportements de nos coachs ou des dirigeant·es de la fédération — main qui glisse en bas du dos, caresses sur les fesses, claque-au-cul, derniers conseils avant la performance, rendez-vous dans les vestiaires qui s’éternisent, engueulade violente ou
on blague, et pour nous, qui ne souhaitons que réussir, et plaire, qui ne désirons profondément que ces deux choses inscrites dans nos corps, ces gestes se sont indistinctement mêlés
— la claque comme la caresse — et ce sont ceux de l’affection, voire de l’amour. Dans le vestiaire nous nous autoproclamons sémioticien·nes, nous traquons les signes de notre réussite
indistinctement mêlés, eux aussi, au désir que nous suscitons chez les spectateurices, aux premiers rangs desquelles nos coachs. Illusion maintenue par ma mère qui me répète, lorsqu’elle me voit revenir de l’entraînement, les yeux encore humides d’une engueulade, qu’iels me veulent du bien. Mâchoire serrée, à la prochaine séance je montrerai les dents. Pourvu que je provoque à nouveau chez elleux l’envie de jeter, même furtivement, un œil sur ma performance, sur moi.
Et si c’était la dernière ? Et si c’était le dernier regard, après ?
Pendant les jours de compétition, une foule d’enfants et de jeunes adultes errent dans la patinoire. Celles et ceux qui dirigent leurs vies sont partout, en bord de piste ou dans les gradins, partout dans les couloirs qui mènent aux vestiaires. La patinoire devient un espace propice à une certaine forme, faussement innocente, de speed-dating entre jeunes gens affamés d’attention et professionnel·les qui, je l’apprendrai plus tard, le sont tout autant (ne jouent-iels pas leurs carrières sur nos vies ?). Après ma performance, ouvert à toutes et tous, je regarde d’un œil mauvais mes concurrent·es directs, mes frères et sœurs, qui iels aussi paradent en montrant leurs dents devenues des crocs.
J’admire profondément les patineureuses qui, plus âgé·es et expérimenté·es, plus proches de la réussite, partagent quelque chose de l’ordre de l’intimité avec celles et ceux dont je traque le regard. Je me glisse dans leur entourage qui me rassure, j’aime être pendu à leur langue, certain que cette réussite est due, aussi, à une manière de s’exprimer, à une science du discours. Je fais mine de m’abandonner totalement aux regards et à la parole des adultes qui en tout point me dominent. Nous faisons ce commun accord : nous partageons un monde particulier avec ses codes, sa langue, ses corps, ses modes de sociabilisation et ma légitimité à appartenir à ce monde est le fruit de validations répétées de toustes ses acteurices. Ma performance c’est moi, et les quatre minutes de présentation du programme long deviennent ma vie entière.
Pourtant, trop tôt, c’est-à-dire avant que je ne sache « tout faire », mon corps me lâche. Les chocs répétés dus à la réception des sauts provoquent un effritement de l’astragale. Si je veux guérir, je dois rester six mois à l’arrêt. Six mois de repos qui me mettent inéluctablement en retard dans la course à la montre contre la nature — j’ai treize ans et le temps est compté. Contre l’avis du médecin, l’un de mes coachs veut que je continue le sport à un rythme soutenu.
À contre-cœur, je le quitte,
reste sur le pas de la porte de son vestiaire,
accompagné de ma mère, il demande : Qu’est ce qui ne va pas avec toi ?
Elle, ça lui fait mal de savoir que je tombe, elle connaît l’injonction
surtout ne pas tomber, rester debout, elle sait aussi
que j’ai honte et que c’est pour ça que je me tais, que je pleure à chaudes larmes en déchiquetant un mouchoir
elle répond à ma place pour m’alléger : Ce qui ne va pas, c’est que son corps ne tient plus, à tout moment il peut s’écrouler.
Il détourne le regard et
je me décompose, la vérité c’est que
mon corps fuit.
Je m’acharne. De toute manière, ma mère le dit et tous les projets d’aide à la réinsertion des sportifs de haut niveau le disent avec elle, le sportif est le modèle même du citoyen parfait : persévérant, empli d’abnégation, passionné, qui ne compte pas ses heures, respecte ses supérieurs, etc. Le sport est une école de la vie et en m’acharnant je développe à merveille mon potentiel d’intégration dans la société néolibérale, puis au pire, je serai coach.
Pendant six mois, je prépare mon retour sur la glace en m’entourant de spécialistes : un kiné qui s’occupe de ma jambe malade et un préparateur physique qui m’aide à garder en forme les muscles sur lesquels je peux encore travailler. J’angoisse à l’idée de voir mon corps changer alors je m’abstiens de manger et ce qui me tient, lorsque l’envie est trop grande de tout foutre en l’air, c’est le désir de voir le coach qui m’a jeté s’émerveiller devant une performance préparée avec un·e autre.
Puis, je trouve cet autre coach et espère, grâce à lui, retrouver mon niveau d’avant blessure mais je suis rouillé et cela m’épuise. À partir de ce moment-là et jusqu’à l’âge de vingt-six ans, j’apprends à revoir mes ambitions à la baisse. Je me contente,
une place de troisième catégorie « Junior deuxième division » me procure autant de plaisir que mes vieux titres de champion de France catégorie « Avenir première division ».
La joie d’une participation aux championnats du monde ressemble à celle que je m’imaginais ressentir en étant champion du monde.
Ni très bon ni très mauvais, je suis parfaitement moyen. Mais pendant quelques minutes, à chaque compétition, les yeux d’un nombre croissant de spectateurices sont rivés sur ma performance, sur moi.
Et même moyen, il y a toujours cette scène sur laquelle je peux continuer d’espérer et
cet instant d’avant, celui qui succède à l’invocation de mon nom et de mon prénom dans les enceintes de la patinoire, qui précède le début de la musique, pendant lequel je vibre parce que tout est possible
puis, plus tard, aux côtés d’une partenaire en nous convaincant que nous sommes les plus beaux·belles, les meilleur·es, parce qu’on nous a dit que nous l’étions
demeure cette question qui me tient debout jusqu’au Kiss & Cry que je retrouve toujours pareil, toujours différent, et si c’était la dernière, après ?
et même s’il ne devait plus y avoir d’espoir
au regard de ce corps qui n’est plus celui d’un enfant
cela ne changerait rien aux espérances
et je ne montre plus mes dents
je mords l’intérieur de mes joues,
creuse mon visage.
L’« enfant-potentiel », un modèle en crise —
1. Depuis le début des années 1980 au moins, la rationalité néolibéralePierre Dardot et Christian Laval, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009-2010 ; Wendy Brown, Défaire le Dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, trad. Jérôme Vidal, Paris, Amsterdam, 2018 et In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West, New York, Columbia University Press, 2019. constitue, à bien des égards, le vecteur principal de normalisation de nos existences. Elle s’incarne en politiques diverses mais cohérentes, et se déploie en dispositifs, au sens où Michel Foucault parlait de « réseau » reliant les éléments d’un « ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-ditMichel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », in Dits et écrits (1954-1988), tome II : 1976-1988, Daniel Defert, François Ewald et Jacques Lagrange (éds.), Paris, Gallimard, 2001, p. 299. ». Ces dispositifs tirent une partie de leur efficacité de leur capacité à configurer nos subjectivités, cherchant sinon à les produire entièrement, tout au moins à les influencer de manière intensive et constante.
Les enfants« Enfant » désigne ici tout individu ayant un âge biologique compris entre zéro et dix ou onze ans environ — l’enfance renvoyant autant à des considérations physiologiques, neurologiques ou psychologiques qu’à des faits sociaux, culturels et historiques. n’échappent pas à ces modalités de normalisation. Au contraire, iels sont, d’emblée, aux prises avec elles, précédé·es et acceuilli·es par des normes spécifiques, qui incitent, voire contraignent, les parents, puis les systèmes éducatifs, à leur prodiguer certaines formes de soins ou à leur délivrer certains types d’enseignement, afin de produire certains effets — ceux que je vais tâcher d’exposer.
Depuis quatre décennies environ, et la généralisation de l’application des politiques néolibérales, les enfants élaborent donc leurs premières expériences sensibles, affectives, intellectuelles au sein des dispositifs du néolibéralisme. Elles prennent ainsi place dans le cadre de structures sociales réglées par un principe général d’économisation, la contamination par une logique économique de toutes les sphères d’activité, qui érige la compétition généralisée et l’obligation de performance en valeurs cardinales, caractéristiques de tels dispositifs. Pour autant, la rationalité économiciste ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble de ceux-ci, notamment dans leur version ultracontemporaine. Il faut y ajouter un versant que, faute de mieux, je qualifierai d’autoritaireGrégoire Chamayou, La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique, 2018. Voir également, à titre d’exemple symptomatique, la manière dont la droite américaine se régénère en mettant en avant des principes politiques autoritaires, réactionnaires et religieux. À ce sujet, Melinda Cooper parle d’alliance entre le néolibéralisme et ce qu’elle nomme New Social Conservatism. Melinda Cooper, Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism, New York, Zone Books, 2019., le projet global reposant dès lors sur l’action conjointe du marché et des valeurs moralesW. Brown, In the Ruins of Neoliberalism, op. cit., notamment le premier chapitre : « Society must be dismantled ».. Cette configuration duelle est par exemple exposée par Hayek, penseur de référence du néolibéralisme, qui théorise la dangerosité des concepts de société et de justice sociale, qui menaceraient les deux piliers de la civilisation que sont selon lui la morale traditionnelle et les marchés compétitifsIbid.. On repère aussi, dans cette double qualification, les deux orientations principales des normes éducatives des dernières décennies : un projet de reconduction violente des inégalités sociales et des effets de domination qui les imposent, et la mise en place de politiques visant à produire un sujet adapté aux exigences du capitalisme contemporain, responsable de ses succès comme de ses échecs.
Faire apparaître, de manière critique, les normes qui ambitionnent de façonner, dès l’enfance, des expériences et des subjectivités « économisées », dans un contexte inégalitaire, revient à rendre visible la manière dont les enfances sont en ce sens immédiatement investies par des principes et une rationalité politiques historiquement situés.
2. Il existe diverses façons d’analyser la nature et le fonctionnement des normes. Judith Butler dit de la norme qu’elle est à comprendre comme un principe d’intelligibilité par lequel le sujet perçoit le réel, y est perçu, et en fait l’expérienceJudith Butler, Défaire le genre, trad. Maxime Cervulle, Paris, Amsterdam, 2012, p. 69.. La norme n’est par ailleurs ni une loi ni une prescription. Elle agit en orientant les conduites individuelles, mettant en place des régularités qui deviennent des évidences, imposant alors chez les sujets une « seconde naturePierre Macherey, Le Sujet des normes, Paris, Amsterdam, 2014. » qui les incite à adapter leurs attitudes et leurs pensées aux dispositifs qu’ils habitent.
C’est en tant que les normes prennent la forme de politiques de subjectivation que je m’y intéresserai ici. Celles-ci s’apparentent à des opérations de pouvoir normalisantes, qui cherchent à activer, susciter, implanter chez les individus certaines formes d’attitude ou certains modes de pensée conformes, caractéristiques autant comportementales que psychiques : produisant alors un certain type d’être ou de sujet, reconnaissant comme siennes certaines formes d’expériences qui, en retour, le constituent.
Dès la fin du xxe siècle et de manière encore plus nette à partir du xxie siècle, les politiques de subjectivation qui ciblent les enfants peuvent être analysées en tant qu’elles sont recodées par le concept de potentiel. L’assimilation des existences enfantines à des potentiels dans lesquels il s’agirait d’investir débouche sur les promesses d’un développement physique et psychologique tout entiers gouvernés par des enjeux économiques — développement plus ou moins prometteur selon les coordonnées de l’espace social qui voient naître celles et ceux que je désigne désormais comme « enfants-potentiels ».
Si certains individus développent, mieux que d’autres, leur potentiel initial, l’optimisation elle-même est envisagée, dans le meilleur des cas, comme illimitée, à la condition que cette illimitation puisse être mise au service de l’accroissement des richesses. De nombreux énoncés, caractéristiques de l’économie discursive du néolibéralisme — et dont voilà un exemple naviguant entre récit neuroscientifique vulgarisé, développement personnel, et promotion de normes en même temps éducatives et managériales — entretiennent alors de telles promesses : « Les nouvelles technologies de l’intelligence émotionnelle laissent espérer que les limites des capacités que chacun peut développer soient repoussées bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd’hui » : il « existe des milliers de manière d’augmenter ce qu’un homme peut faire, ce qu’il peut apprendre ou même penser en vingt-quatre heures, et ces techniques seront à l’avenir créatrices d’emploiIdriss Aberkane, Libérez votre cerveau ! Traité de neurosagesse pour changer l’école et la société, Paris, Robert Laffont, 2016, p. 231, p. 333. ». L’illimitation des potentialités individuelles, érigée en modèle de subjectivation, accompagne ainsi la dynamique expansive propre au capitalisme.
3. Avec le triomphe quasi-généralisé, au sein de l’espace euro-atlantique, des dispositifs de pouvoir néolibéraux dans les années 1980, les normes éducatives changent de nature, en lien avec le bouleversement des grands modes d’organisation économique, marqués par la financiarisation et la croissance d’un néomanagement. Ces normes renouvelées sont chargées de susciter chez les sujets en devenir l’émergence des qualités d’individus « économisés », ajustés aux exigences de performance d’un tel modèle d’organisation sociale. L’objectif fixé au terme d’une bonne éducation se redéfinit donc autour des notions de créativité productive, de réussite ou de responsabilité — celles qui, dans le même temps, sont réclamées aux travailleur·euses par les nouvelles normes managériales. Dans un tel cadre normatif, les enfants sont de plus en plus perçu·es comme des portefeuilles de compétences à enrichir et élargir indéfiniment — la question étant de savoir comment capitaliser, très vite, sur le potentiel qu’iels incorporent, et qui se matérialise sous la forme de divers traits de personnalité : autonomie, productivité, prise d’initiative, flexibilité.
Ces politiques de subjectivation sont soutenues, dans le champ éducatif et psychologique, par la croissance considérable des sciences cognitives et des neurosciences et leur quasi-hégémonie explicative, depuis le début des années 1990 au moins, dans le domaine des « sciences de l’enfance« Je parle de sciences dominantes de l’enfance à propos de la pédiatrie, de la psychologie et des neurosciences pour signifier le monopole relatif qu’ont les praticiens de ces disciplines sur le jeune âge », Wilfried Lignier, Prendre. Naissance d’une pratique sociale élémentaire, Paris, Seuil, 2019, p. 8. ». Tout autant que les adultes, l’ « enfantpotentiel » a tendance à être assimilé·e à son cerveau, à des capacités neuronales « naturellement » prêtes à se développer, devenues l’objet de toutes les attentions et de toutes les convoitises. Ces représentations anthropologiques ont l’avantage, pour les dispositifs néolibéraux, d’invisibiliser les facteurs sociaux (origines culturelles et de classe, conditions d’existence, genre), qui déterminent pourtant pour une large part les capacités et les existences des enfants, ce qui permet de ne pas avoir à justifier l’aggravation des politiques inégalitaires qui, dans le même temps, accompagnent le projet néolibéral. Les approches historiques, sociologiques ou philosophiques à propos de l’enfance sont marginalisées par les savoirs psychologiques ou biologiques — ce réductionnisme explicatif commandant en retour l’urgence de réhabiliter la prise en compte politique des enfances.
Le potentiel auquel les enfants sont identifié·es est donc individuel et inné. Sa définition même repose sur l’image d’un·e enfant débarrassé·e de toute négativité, transposition au jeune âge du modèle d’un sujet singulier : celui que qualifient désormais la culture du bien-être et du développement personnel et, à travers elle, un certain type de managementV. Brunel, Les Managers de l’âme : le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique du pouvoir ?, Paris, La Découverte, 2004 ; Edgar Cabanas et Eva Illouz, Happycratie, Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, trad. Frédéric Joly, Paris, Premier Parallèle, 2018.. L’enfance demeure certes un moment de grande vulnérabilité, mais le risque encouru semble d’un type nouveau, qui confirme son statut inédit. Ce qui est redouté désormais est un gâchis des capacités enfantines, notamment par un système scolaire objectivement de plus en plus défaillant à mesure que les politiques néolibérales poursuivent leurs objectifs de démantèlement des services publics, empêchant ainsi les potentiels enfantins d’atteindre leurs rendements optimaux — qui doivent, dans les théories néolibérales, bénéficier au bout du compte à l’ensemble de la société, en permettant à la croissance économique de poursuivre son expansion indéfinie. Là encore, les enjeux d’une éducation idéale se déplacent : d’une conception, héritée des Lumières, ambitionnant de transmettre une culture dotant les enfants des qualités d’un sujet politique raisonnable et éclairé — modèle prôné jusque dans les dernières années du xxe siècle — à celle, qui s’impose alors, qui postule la prise en charge d’un « capital humainVoir notamment les analyses de Foucault, à propos des théoriciens du « capital humain », les économistes Gary S. Becker et Theodor W. Schultz, in Naissance de la biopolitique, cours au Collège de France (1978-1979), Michel Senellart (éd.), Paris, Seuil/Gallimard, 2004. W. Brown parle de « reconfiguration de l’être humain en capital humain par la rationalité néolibérale », W. Brown,Défaire le Dèmos, op. cit., p. 37. » dans lequel investir de la manière la plus précoce et la plus efficace possible.
4. Dans le système éducatif, les compétences, immédiatement transférables en contexte professionnel, et en cela monétisables, ont remplacé le savoir ou la cultureAngélique del Rey, À l’École des compétences. De l’éducation à la fabrique de l’élève performant, Paris, La Découverte, 2010.. A travers celles qu’iel acquiert, l’ « enfant-potentiel » fonde une aptitude singulière : son employabilitéL’employabilité est « l’aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle », Organisation internationale du travail, Rapport de la Commission de mise en valeur des ressources humaines, 2000. Elle fonde également le projet éducatif forgé par l’Union européenne en mars 2000, au sommet de Lisbonne, qui se fixait comme objectif de « devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale », Conseil de l’Union européenne, « document COM (2001) 501 final », février 2002, p. 2.. Lui permettant de s’adapter sans cesse aux bouleversements économiques en cours et à venir, elle permet dans le même temps de muer en matière économique ce que l’être humain possède en propre, « le langage, la capacité relationnelle, la motilité, la perception sensorielle, les émotionsChristian Marazzi, Le Socialisme du capital, trad. Jeanne Revel et Judith Revel, Zurich-Berlin, Diaphanes, 2017, p. 15. » — phénomènes immatériels, affectifs, cognitifs ou sociaux, qu’il s’agit autant de contenir que de solliciter, puisque c’est sur eux que se fonde en partie la croissance économique de ce début de xxie siècle. Cette promotion de l’employabilité comme enjeu central des processus éducatifs favorise l’encastrement total de la formation des éléments subjectifs des jeunes individus à l’intérieur de mécanismes économiques.
Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiqueL’OCDE, dont l’objet premier est de renforcer l’économie de ses pays membres, a acquis une influence considérable sur la définition des normes et politiques éducatives depuis le début des années 1980, notamment à travers son outil d’évaluation PISA. De fait, la plupart des politiques éducatives des pays membres reviennent désormais à appliquer peu ou prou les recommandations de l’institution, transformant définitivement la question éducative en une problématique avant tout économique., daté de 2015, permet d’entrevoir la formalisation de telles orientations :
Là où le système éducatif et le marché du travail coexistent séparément, il s’avère particulièrement ardu pour les jeunes de réussir le passage de l’un à l’autre. L’insertion dans le monde du travail se fait d’autant mieux que les systèmes éducatifs sont souples et à même de s’adapter aux besoins du marché du travail, que les employeurs interviennent tant dans la conception que dans l’application des programmes d’enseignement, que les jeunes ont accès à des services d’orientation et à une formation continue de qualité qui les aident à mettre leurs compétences en adéquation avec les emplois qui s’offrent à eux […]. Il est donc de l’intérêt de chacun de collaborer pour faire en sorte que le trajet qui conduit de l’école à l’emploi soit plus direct et plus facile à parcourirOCDE, Perspectives de l’OCDE sur les compétences 2015 : les jeunes, les compétences et l’employabilité, Paris, OCDE, 2015, p. 3..
Les éléments de rationalité qui guident les politiques éducatives néolibérales apparaissent clairement : demande d’une meilleure prise en compte des exigences du marché du travail adressée aux systèmes scolaires, intervention souhaitée des employeurs dans les contenus d’enseignement, réaffirmation de l’importance de l’orientation et de la formation continue dans le renforcement de l’employabilité des élèves. La logique est de réduire l’écart, à la fois idéologique et organisationnel, entre la forme scolaire et la forme entreprise. Les parcours scolaires s’apparentent dès lors à de véritables flux, que les structures éducatives, sous leur forme scolaire ou familiale, sont chargées de gérer efficacement, en poursuivant l’objectif double de construire les employabilités tout en sécurisant les parcours. En ce sens, les trajectoires éducatives doivent sceller des destins, et s’assimilent à des mécanismes stricts de reproduction des hiérarchies sociales.
L’exemple français de la récente réforme du lycée, de la loi d’ « orientation et de réussite des étudiants » (ORE), et de l’application ParcoursupMarie Duru-Bellat, « Parcoursup et sa cruelle méritocratie », Alternatives Économiques, vol. 381, 2018. se révèle être un précipité emblématique de ces conceptions. L’objectif de ces réformes, échelonnées entre 2017 et 2019, est en effet d’adapter profondément, et sans retour en arrière possible, le système scolaire français aux exigences de mise en concurrence généralisée, entre les établissements comme entre les élèves. Il met également en place une gestion autoritaire et partiellement opaque des parcours scolaires, contribuant à geler les possibilités de mobilité sociale des jeunes individus. Si, au moins depuis Bourdieu et PasseronPierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964 ; La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970, on connaît la manière dont l’école met en place des procédures de réassignation sociale, la loi ORE aggrave la situation et vient, en outre, renforcer la transformation de la scolarité en processus plus ou moins long de valorisation des compétences des élèves, étape initiale d’une existence tout entière constituée en matière brute pour la production économiqueJe me permets de renvoyer à mon essai, Arnaud Teillet, L’Éducation à l’épreuve du néolibéralisme, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2022..
5. Les normes éducatives qui influencent les pratiques des classes sociales les plus aisées du monde euro-atlantique s’appuient également sur un modèle anthropologique qui conçoit les enfants comme des êtres mus par un insatiable appétit de connaissance, et bons par nature — modèle qui permet l’édification de la fiction d’un·e « enfant-potentiel » qui, si iel était délié·e de toute entrave, serait capable de développer indéfiniment ses talents : cet enfant « actif, comme il l’est naturellement », agira en effet « librement en fonction de ses besoinsMaud Besançon et Todd Lubbart, La Créativité de l’enfant, Évaluation et développement, Bruxelles, Mardaga, 2015, p. 86. ». Immédiatement branchée sur les enjeux économiques, notamment à travers la valorisation de capacités créatives innées, sa silhouette se dessine ainsi :
Chaque enfant vient au monde avec un potentiel qui lui est propre mais qui n’est pas toujours valorisé par notre société. Bien que l’objectif de l’école soit de développer le potentiel de chacun de ces enfants, il semble […] que le système éducatif a de plus en plus tendance à niveler par le bas, sans toujours prendre en considération les différentes compétences particulières des élèves. Or, chercher à ne former que des individus semblables les uns aux autres ne permettra pas à notre société de se développer de manière optimale. […] Il paraît également important, pour développer les compétences créatives des enfants, de prendre appui sur leurs qualités naturelles. En effet, petits, tous les enfants sont très ouverts, avides de découvrir leur environnement, ce qui les entoure ; ils ont également une grande capacité à innover […]Ibid., p. 128-129..
Toutefois, les bases argumentatives sur lesquelles repose la démonstration fondant ces normes potentialistes s’effritent rapidement, dès lors qu’on s’extrait d’une structure explicative se contentant d’éléments psychologiques individualisants. En effet, comment expliquer que les comportements d’enfants avides d’apprendre et de découvrir leur environnement ne correspondent pas à nombres de phénomènes observables ? Pourquoi ce modèle psychologique positif ne s’ajuste-t-il pas parfaitement aux situations les plus ordinaires ?
La violence ou l’agressivité, largement repérables chez les enfants, et induites par l’articulation complexe entre éléments subjectifs pulsionnels et configurations spécifiques de rapports sociaux de pouvoir, sont ainsi invisibilisées dans ce type de discours, alors même que les dispositifs néolibéraux font de la concurrence un principe structurant, et durcissent les dominations multiples dont de nombreux sujets sont les victimes — les enfants en premier lieu. Ainsi, bien qu’incapable de rendre compte de multiples expériences inscrites d’emblée dans des coordonnées sociales inégalitaires, l’anthropologie positivée, postulant un·e enfant nécessairement autonome, épanoui·e, apprenant librement et prêt·e à réussir tout ce qu’iel entreprend, revêt une autre fonction que celle de décrire le réel : elle certifie les représentations idéalisées d’un être naturellement positif et créatif, un capital humain au potentiel indéfini, que définissent les politiques de subjectivation du néolibéralisme. Ce qui demeure problématique n’est pas de tâcher d’élever des enfants avec bienveillance ou en estimant qu’iels sont capables d’apprendre et de réussir, mais bien d’instrumentaliser un modèle anthropologique figé et naturaliste afin de passer sous silence de nombreuses expériences situées socialement et marquées du sceau de la négativité. Politiser l’enfance, c’est donc aussi, sans doute, se doter des outils susceptibles de faire apparaître ces violences, ces dominations, ces inégalités.
6. Ces politiques de subjectivation et leurs représentations singulières contraignent tout autant les systèmes éducatifs à se rénover qu’elles incitent les parents à adopter certains choix, certaines attitudes ou certaines idées. Elles sont une manière d’adapter des subjectivités en construction à des dispositifs situés historiquement, ceux du néolibéralisme. Pour autant, ce modèle de subjectivation indexé sur les objectifs économiques de croissance indéfinie est obsolète — et c’est une chance, sans doute. Le néolibéralisme, en effet, malgré sa gestion de plus en plus autoritaire des conflits sociaux, n’apparaît plus aujourd’hui capable de réguler les crises qu’il engendre et aggrave, qu’elles soient politiques, économiques ou environnementales. Alors que le désastre écologique est de plus en plus perceptible, et que le modèle expansionniste et extractiviste du capitalisme apparaît insoutenable, la question est désormais de (ré)adapter les sujets à ce contexte en mutation, ce qui commande d’interroger politiques de subjectivation et normes éducatives.
En effet, alors que devrait s’imposer une série de limites drastiques aux activités humaines, les logiques qui instruisent les subjectivations dans le néolibéralisme travaillent à habituer les individus, et notamment les enfants, à une compétition étendue et à l’illimitation des performances. Tandis qu’une forme de décroissance ou de décélération généralisée paraît nécessaire, c’est au contraire le modèle d’une sur-activité et d’une sur-sollicitation que continuent à promouvoir certaines normes éducatives — modèle qui se projette sur celui des dispositifs du capitalisme contemporain, qui tendent à prendre en charge les sujets « 24h sur 24 et 7 jours sur 7 »Jonathan Crary, 24/7, Le Capitalisme à l’assaut du sommeil, trad. Grégoire Chamayou, Paris, La Découverte, 2014..
Exposer la nature politique des enfances dans une perspective critique suppose de se demander pourquoi cet·te « enfant-potentiel » existe, pourquoi iel existe dans ces conditions, à ce moment de l’histoire, sous cette forme-ci, précaire et contingente, amenée à être transformée. Mais aussi de s’interroger sur la voie qui permettrait de modifier les pratiques éducatives, dans les familles comme à l’école, afin de déprogrammer les normes économicistes, imprégnées de la culture managériale de la réussite et de la responsabilité individuelle portées par le projet néolibéral, qui prolongent implicitement un modèle d’illimitation économique et trompeusement dépolitiséeQui postule l’accroissement indéfinie des richesses et non celle des droits. qui ne peut qu’amplifier les dérèglements sociaux et environnementaux en cours — l’enjeu pouvant être d’ailleurs de décorréler l’expansion économique indéfinie de celle de la croissance des droits politiques, en promouvant la seconde afin de contrôler la première.
Par ailleurs, une telle approche critique pourrait amener à élaborer des politiques de subjectivation alternatives, prenant en compte la vulnérabilité des individus, faisant écho à celle de leur environnement — ce qui aurait comme conséquence d’admettre qu’ils ne peuvent pas tout : ni reconduire les mêmes modalités de production et de consommation, ni reproduire les mêmes structures sociales inégalitaires, et les dominations qui leur donnent consistance. Si le modèle de l’ « enfant-potentiel » était ajusté à la logique expansionniste du capitalisme et aux principes concurrentialistes du néolibéralisme, il est temps, désormais, d’inventer de nouveaux modes de politisation des enfances. Sinon, le risque est grand, afin d’affronter les obstacles qui se présentent à nous, de laisser la voie autoritaire contenue dès l’origine dans le néolibéralisme prendre de l’ampleur, en s’associant définitivement aux politiques réactionnaires, souvent empreintes de religion, déjà à l’œuvre dans de nombreux États — il n’est qu’à constater la manière dont les extrêmes droites américaines prospèrent, et celle dont elles considèrent prioritairement les politiques éducatives critiques et égalitaires comme des cibles à abattre.
Pédagogie critique à destination des enfants —
La pédagogie critiqueIrène Pereira, « Connaissez-vous les pédagogies critiques ? », The Conversation, 8 avril 2019. https://theconversation.com/connaissez-vous-les-pedagogies-critiques-114771. n’est pas en premier lieu une pédagogie centrée sur l’enfant. Paulo Freire a d’abord développé son action auprès de l’alphabétisation des adultes. Dans un second temps, la pédagogie critique s’est orientée vers le milieu universitaire. Paulo Freire a été lui-même enseignant en université. Ira Shor, lorsqu’il propose d’appliquer la pédagogie critique à la salle de classe, le fait auprès d’étudiant·es à l’universitéIra Shor (éd.), Freire for the Classroom: A Sourcebook for Liberatory Teaching, Portsmouth, Heinemann Educational Books, 1987.. En ce qui concerne bell hooks, qui est connue en France entre autres pour son travail sur la pédagogie critique féministe, il s’agit d’une pédagogie au niveau universitaire. Elle s’appuie elle aussi sur son expérience d’enseignante en université. Néanmoins, entre 1989 et 1991, Paulo Freire a été secrétaire de l’éducation de la ville de São Paulo et sa mission concernait la réorganisation de l’enseignement élémentaire. Néanmoins, les écrits de Paulo Freire traitant de cette tranche d’âge d’enseignement ne portent pas sur les enfants, mais sur la formation éthique des enseignants et enseignantes. C’est le cas par exemple dans le dernier ouvrage qu’il a publié de son vivant, Pédagogie de l’autonomiePaolo Freire, Pédagogie de l’autonomie, trad. Jean-Claude Régnier, Toulouse, éditions Erès, 2013.. Les courants de la pédagogie critique ont cependant donné lieu à des applications en pédagogie avec des enfants. Ces applications ont suscité des discussions de fond. Pour aborder ces controverses, nous utiliserons une approche philosophique centrée sur les positions et les arguments, plus que sur la discussion érudite des auteurs et des autrices.
La pédagogie critique endoctrine-t-elle les enfants ?
Au Brésil, il existe un mouvement d’extrême droite appelé École sans parti. Cette organisation est proche de Jair Bolsonaro, l’ancien président du Brésil. Elle a deux cibles en particulier. La première, ce sont les études de genre. La seconde, c’est la pédagogie de Paulo Freire. Selon une thèse complotiste de l’extrême droite, il existerait une guerre idéologique au sein de l’école menée par les « marxistes culturelsCette dénomination, comme celle d’« islamogauchiste », est une appellation polémique qui n’est pas revendiquée par des personnes elles-mêmes. ». Or Paulo Freire est pour l’extrême droite au Brésil le symbole du marxisme culturel. Cela d’autant plus que dans Pédagogie de l’autonomie, il avance l’idée que l’enseignement ne peut pas être neutre et ne doit pas l’être. Il met en avant la directivité de l’enseignement qui doit pour lui prendre la forme d’une politisation.
L’École sans parti a pour projet entre autres de faire passer une loi imposant la « neutralité de l’enseignement ». Il est tout à fait remarquable que l’obligation de neutralité, qui est en France associée à la république, est au Brésil considérée comme relevant d’une idéologie d’extrême droite. Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir à ce qui différencie une dictature d’une démocratie. Le Brésil a été jusqu’en 1985 sous le joug d’un régime politique autoritaire. La constitution démocratique actuelle a donc été pensée en réaction avec le régime dictatorial. Or une caractéristique des régimes autoritaires est de ne pas admettre l’expression publique de la diversité des opinions. Le pluralisme des idées dans l’espace public, des partis politiques est censé caractériser les démocraties libérales. De ce fait, ce qui doit garantir le caractère libéral de l’enseignement au Brésil n’est pas la neutralité des enseignants et enseignantes, mais le fait que puisse être exprimée la pluralité des idées y compris dans la salle de classe.
Néanmoins, il est possible de se demander si le fait de pouvoir défendre des idées politiques et/ou religieuses devant des enfants ne comporte pas un risque d’endoctrinement. En réalité, lorsqu’on regarde plus précisément ce que vise l’extrême droite au Brésil, ce sont, d’une part, les enseignements qui abordent des questions économiques et socialesL’équivalent en France des sciences économiques et sociales par exemple. et, d’autre part, les programmes qui ont pour objectif de lutter contre les discriminations de genre en particulier relatives aux personnes LGBTI.
L’interprétation que nous formulons est la suivante. Les déclarations concernant les droits humains ont, sous l’effet de mouvements sociaux émancipateurs, intégré des avancées au cours du xxe siècle comme par exemple le respect des droits des personnes LGBTI. Or une partie conservatrice de la société est fondamentalement en désaccord avec des idées telles que l’égalité femmes/hommes, les droits des personnes LGBTI, voire l’égalité entre les êtres humains quelle que soit leur couleur de peau. Au Brésil, cela se traduit publiquement par des critiques adressées aux déclarations des droits humains accusés d’être un droit qui protège les mafieux.
Il en résulte que dans un État démocratique, indépendamment des orientations politiques du gouvernement qu’il soit de droite ou de gauche, les chartes des droits humains doivent être respectées. Or les enseignants et les enseignantes ont de plus en plus souvent un rôle à jouer sur ce plan à travers l’éducation à la non-discrimination et aux droits humains. La pédagogie de Paulo Freire est d’ailleurs une référence en ce qui concerne l’éducation aux droits humains.
De ce fait, même en France, où il existe une obligation de neutralité des fonctionnaires, il s’agit d’une neutralité qui touche seulement quatre points : politique, religieux, philosophique et économique« Économique » voulant dire que les enseignants et les enseignantes ne doivent pas faire de publicité pour une marque dans le cadre de leurs cours.. Donc cela ne veut pas dire qu’il est interdit aux enseignants et enseignantes de donner des cours qui font la promotion des droits humains et de la lutte contre les discriminations. Bien au contraire. De ce fait, la pédagogie critique se réfère à un cadre qui dépasse les enjeux politiques partisans, qui est la défense des droits fondamentaux des groupes socialement discriminés.
Il existe une approche de l’enseignement qui est centrée sur l’instruction. Elle est souvent référée au philosophe Condorcet. Dans cette conception, l’école doit instruire et non pas éduquer. La transmission de valeurs doit être laissée à la famille qui peut élever ses enfants selon ses conceptions personnelles concernant les questions politiques, religieuses ou philosophiques. L’idée d’une éducation à la citoyenneté entre en contradiction avec une telle conception. En effet, elle suppose que l’État peut également inculquer, via ses enseignants et enseignantes, des valeurs aux enfants de manière à assurer les cadres de base d’un régime démocratique. Cette conception est par exemple présente en France avec en particulier l’idée qu’il s’agit pour l’école de « transmettre les valeurs de la république ».
Néanmoins, cette idée de transmission de valeurs de la république ne va pas sans poser au moins deux problèmes. Le premier, c’est le fait de savoir si ces valeurs sont propres à la République française. En effet, on ne peut pas dire que l’égalité femme/homme serait une valeur propre à la France. Elle est une valeur que l’on retrouve promue dans tous les pays démocratiques. Le second problème, c’est le fait de savoir ce qu’il arriverait si en France un régime politique d’extrême droite prenait le pouvoir et modifiait les valeurs de la république.
Cela explique pourquoi, de notre point de vue, l’école française devrait non pas se référer aux valeurs de la république, mais aux conventions internationales des droits humains dont la France est signataire. En effet, il est plus facile à une dictature de changer la législation interne d’un pays et de proclamer d’autres valeurs que de changer le cadre des conventions internationales. Ainsi, comme l’avait souligné Cornelius Castoriadis, les droits humains, contrairement à ce qu’avait affirmé Marx au xixe siècle, ne sont pas que des droits bourgeois. Ils ont été, pendant le dernier quart du xxe siècle, des droits qui ont été revendiqués par des dissidents pour s’opposer aux dictatures mises en place dans les régimes soviétiques.
Néanmoins, il est certes possible de craindre l’endoctrinement des enfants par une propagande d’État. C’est ce qu’ont tenté, entre autres, les régimes totalitaires, par exemple le régime nazi avec les Jeunesses hitlériennes. En réalité, de manière générale, tout État tend à essayer de promouvoir, auprès de la jeunesse, dans son système d’enseignement, des valeurs. L’école publique française depuis la iiie République a été un vecteur de promotion du régime républicain, cela après la chute de la iie République et l’arrivée au pouvoir de Napoléon iii qui avait été analysées par les républicains comme liées à un manque d’instruction de la population ne permettant pas de garantir la pérennité du fonctionnement des institutions républicaines.
Cependant, il est possible, à notre avis, de proposer deux règles concernant le rôle idéologique de l’école publique. La première, c’est que l’école publique doit apparaître comme au-dessus des querelles partisanes et politiciennes entre partis politiques. Mais, en même temps, il est attendu qu’elle aide à garantir la stabilité des régimes démocratiques par une éducation civique des citoyens et des citoyennes. C’est pourquoi le cadre qui devrait être celui de l’école publique devrait être l’éducation aux droits humains. La seconde règle, c’est qu’une école qui garantit la liberté de conscience des élèves est une école qui repose sur une formation à l’esprit critique mettant en œuvre une discussion de la pluralité des idées. C’est cette dimension dialogique de la pédagogie critique qui garantit son caractère critique et évite le dogmatisme. Cela suppose du côté des enseignants et des enseignantes de développer certaines vertus comme l’ouverture à la discussion.
Peut-on aborder les questions sociales et politiques avec les enfants ?
Certaines personnes, y compris des enseignants et des enseignantes, affirment qu’il n’est pas possible d’aborder les questions sociales et politiques avec de jeunes enfants. Il ne s’agit pas seulement d’un problème qui a trait à leur niveau de compréhension de ces sujets, mais également à l’idée que l’enfance devrait être un moment protégé. Il faudrait maintenir les enfants loin de ces questions en ne les abordant pas avec eux.
Cette thèse n’est pas partagée par les pédagogues critiques. Ainsi, le pédagogue critique catalan Jurjo Torres Santomé fait remarquer qu’il est paradoxal d’éloigner les enfants de problèmes auxquels en réalité ils sont confrontés sous prétexte de les protégerAna López, entretien avec Jurjo Torres Santomé, « Los profesores tenemos que aprender que todos somos racistas, sexistas, homófobos… », Escuela, n° 3.914 (1.232), 15 septembre 2011, p. 32-33.. En effet, les enfants peuvent vivre directement la pauvreté, le mal-logement, la violence…
En soi, les pédagogues critiques n’ont pas de théorie spécifique de l’enfance. En effet, cette théorisation de l’enfance comme une période de l’existence particulière se trouve plutôt chez les psychopédagogues. On trouve par exemple chez Jean Piaget l’idée que les enfants passent par des stades de développement intellectuel propres à chaque âge. Il n’y a rien de tel en pédagogie critique. De fait, comme la pédagogie critique a été pensée à partir d’adultes, on peut se demander si l’enfant en pédagogie critique n’est pas en fait considéré comme un adulte miniature.
Cette question se pose d’autant plus que la pédagogie critique prétend lutter contre les oppressions. Or il existe une oppression dont seraient spécifiquement victimes les enfants, à savoir l’adultisme. Dans un ouvrageOn peut se référer entre autres au livre de Yves Bonnardel, La Domination adulte, Forge-les-Bains, Myriadis, 2015., Yves Bonnardel pense l’enfant à partir de la conception du sujet autonome majeur. L’enfant, comme la femme autrefois, serait considéré comme un mineur. De ce fait, il est soumis à l’autorité et à la protection de ses parents. Ce régime de suggestion le soumet à l’arbitraire et aux abus de pouvoir des adultes. Bonnardel montre ainsi que l’on interdit aux enfants de travailler alors que certains au contraire souhaiteraient pouvoir travailler. Comme pour les femmes où il fut une époque où elles ne pouvaient pas travailler sans l’autorisation de leur mari, les enfants sont également soumis à l’autorisation de leurs parents pour pouvoir prendre de multiples décisions relatives à leurs choix de vie.
Pourtant, peut-on penser l’enfant sur le modèle de l’adulte ? Il est intéressant de remarquer que l’ouvrage pourtant très complet de Bonnardel fait l’impasse sur une thématique, celle de la sexualité. Il n’y a pas de chapitre visant à se demander si un enfant peut consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Or les mouvements féministes ont au contraire revendiqué l’existence d’une présomption de non- consentement des enfants de moins de quinze ans à des relations sexuelles avec des adultesIl semble que par ailleurs cette idée de domination adulte crée une confusion avec le titre de l’ouvrage de Dorothée Dussy,Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste (Pocket, 2021). En effet, l’autrice ne vise pas à dénoncer l’adultisme en tant qu’il s’agirait d’une domination qui maintiendrait les enfants à l’état de mineurs, mais son objectif porte sur la protection des enfants relativement à des pédocriminels. Or, la lutte contre l’adultisme (ou domination adulte) semble même entrer en contradiction avec cette finalité. En effet, lorsqu’on analyse de manière cohérente la lutte anti-adultisme, elle aboutit logiquement à revendiquer qu’un enfant doit être considéré autonome comme l’adulte et donc qu’il ou elle peut consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Ainsi dans les ouvrages de Bonnardel et de Dussy, il s’agit de domination de l’enfant par l’adulte, mais l’ouvrage de Dussy ne parle pas de l’adultisme qui renvoie à l’idée de considérer l’enfant comme l’adulte majeur.. De ce fait, cela conduirait à affirmer que l’adultisme n’est pas un rapport social de même nature que le sexisme ou le racismeJuliette Rennes, « Conceptualiser l’âgisme à partir du sexisme et du racisme. Le caractère heuristique d’un cadre d’analyse commun et ses limites », Revue française de science politique, n° 6, vol. 70, 2020, p. 725-745.. En effet, nul ne songe — à juste titre — à appliquer une telle règle à une femme adulte.
À l’inverse, il est alors nécessaire de se demander s’il n’existe pas un statut spécifique de l’enfance. L’enfance semble être un âge ambivalent qui relève à la fois de la protection et donc qui fait appel à des éthiques féministes du care (protection des personnes vulnérables) et de l’aspiration à l’autonomie (adultes en devenir). C’est cette ambivalence qui semble faire la spécificité de l’enfance. Il ne semble pas seulement possible de considérer l’enfant comme un être à protéger dont on ferait le bien malgré lui en décidant sans lui de son avenir, par exemple de ses orientations d’études et professionnelles. L’enfant a à devenir un sujet adulte autonome. Pour cela, il s’agit de l’aider à exercer son autonomie. C’est par l’exercice réel de cette autonomie qu’il est susceptible d’apprendre à l’exercer : « C’est en marchant que l’on apprend à marcher. »
Cette ambivalence du statut de l’enfance est présente dans la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989Juliette Rennes, « Conceptualiser l’âgisme à partir du sexisme et du racisme. Le caractère heuristique d’un cadre d’analyse commun et ses limites », Revue française de science politique, n° 6, vol. 70, 2020, p. 725-745.. Beaucoup d’articles font référence à la nécessité de protéger l’enfant : par exemple « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » (article 2), mais, en même temps, il est affirmé : « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (article 12). Ces deux exemples d’articles montrent ainsi comment le statut de l’enfant oscille entre devoir de protection des adultes relativement aux enfants et autonomie de l’enfant quant à sa liberté d’opinion.
Conclusion
La pédagogie critique n’est pas centrée sur une pensée de l’enfance, ce qui conduit à des problèmes et des discussions lorsqu’il s’agit de la mettre en œuvre avec des enfants. Nous avons été conduis à traiter deux problèmes spécifiques : le risque d’endoctrinement et la spécificité du temps de l’enfance. Dans les deux cas, la question de la liberté d’expression des opinions de l’enfant apparaît comme un élément important pour garantir les dérives d’endoctrinement dogmatique et le risque d’un paternalisme excessif. Dans les deux cas, nous avons également souligné la nécessité d’un cadre qui sécurise les échanges. Dans le premier cas, il s’agit du cadre normatif des droits humains et de la non-discrimination. Dans le second, il s’agit de la nécessaire protection que les adultes doivent aux enfants.
L’enfant, l’alphabet, l’abolition —
Si l’on se souvient que la pédagogie était l’art d’enseigner relatif au savoir, tandis que l’éducation était attenante à l’ethos ou à la morale, on peut dire qu’aujourd’hui leur amalgame a produit le discours de la « compétence » et de « l’adaptation », termes qui véhiculent autant de syntagmes qu’il le faudra pour aplatir la rationalité, la rabattre sur des finalisations, la priver tant de ses désarrois que de ses découvertes. À naviguer entre le savoir-être, l’efficience, la flexibilité, on ne distingue plus entre le réquisit entrepreneurial et celui de la table de multiplication, la contractualisation de la réussite scolaire et la pratique de la grammaire, la temporalité de la recherche et la présentation d’une thèse en 180 secondes, etc.
Cette indistinction ne cesse de s’étendre : de Parcoursup à Trouve mon master, des plateformes plagiat et antiplagiat à la correction des copies informatisée, les formalisations algorithmiques contribuent à « professionnaliser », non pas seulement les finalités de l’enseignement, mais sa pratique elle-même. Dans ce contexte, l’échelle des âges se monte et se descend par les deux bouts. Tandis que chacun est censé se former tout au long de sa vie, jusque dans sa tombe de postretraité, il n’est jamais trop tôt pour finaliser économiquement et socialement les apprentissages, ainsi de l’opération « j’aime mes agriculteurs » en collège, censée « sensibiliser » les élèves sur les métiers de la transition écologique.
Comment dégager l’apprentissage de cette gangue ? En repartant de l’autre extrême, à savoir de la rationalité en tant qu’y participe la révolte. Ce point de départ rompt y compris avec le tropisme anthropologique qui règne aujourd’hui, et qui a accaparé les pensées dites « antihumanistes », le poststructuralisme, la psychanalyse. Que l’on parte du parlêtre, du non-humain, de la relation, de quoi que ce soit, c’est de plus en plus fréquemment d’une qualification anthropologique qu’il semble désormais être question.
Partir, non d’une telle prémisse anthropologique, mais d’une affirmation logique : dès lors qu’il y a domination, il y a, il y a eu, il y aura des révoltes. La révolte n’est pas l’essence de l’homme, ni sa condition, ni aucune des pluralisations de la dimension anthropologique. La révolte est logique en ceci qu’elle divise la rationalité elle-même, qu’elle rend manifeste l’écart entre la raison en tant qu’elle est universelle et la raison en tant qu’elle est ordre de la domination. C’est seulement depuis la résistance à un ordre de domination que la rationalité de celle-ci peut apparaître comme une représentation fallacieuse, justificatrice de cette domination, qu’elle s’atteste comme « idéologie dominante » pour utiliser un lexique ancien. S’il n’y avait pas une telle résistance, l’arbitraire de la rationalité régnante ne pourrait même pas apparaître comme tel, son omniprésence serait le seul réel. Ainsi, la logique de la révolte n’est ni simplement extérieure à la raison dominante, puisqu’elle surgit en la divisant, ni intérieure à elle, puisqu’elle lui est hétérogène et véhicule, au moins potentiellement, sa destruction.
Le nouage entre apprentissage et révolte se précise dès lors que l’on resserre le propos sur un moment spécifique de celle-ci, à savoir son rapport au mutisme. Il est frappant que, de manière récurrente, la révolte est disqualifiée comme étant sans langage, irrationnelle par là-même, une violence immédiate, sauvage, en rupture avec toute médiation. Cette caractérisation ne manque pas d’être reprise par ceux-là mêmes qui pourtant la valorisent ou la célèbrent. Pour beaucoup, la même détermination prévaut : spontanéité de la révolte, caractère immédiat et absolu, violence explosive, etc.
D’où vient que la révolte est désignée comme extérieure au langage ? Les choses marchent sur la tête, il faut donc les remettre sur leurs pieds. Ce ne sont pas les révoltes qui sont muettes, ce sont ceux auxquels on a imposé le mutisme qui se révoltent. Rappelons les considérations d’Aristote dans la Politique concernant les esclaves. Ils sont ceux qui ne possèdent pas le langage, qui ne peuvent comprendre de celui-ci que les ordres à suivre, en tirer leur obéissance, mais qui ne peuvent participer au logos en tant que modalité rationnelle. Si la parole est déniée aux esclaves, alors poser que la révolte ne parle pas, c’est tout simplement adopter le point de vue de l’ordre qui la réprime.
À cet égard, une révolte d’esclaves est la manifestation du refus de l’oppression de la part de ceux qui ne sont même pas considérés comme pouvant en subir une. Elle éclate chez ceux qui, selon la distribution ordonnée du logos, ne possèdent à proprement parler aucune rationalité. On peut bien sûr penser à la révolte d’esclaves de Spartacus. Mais ce qui importe ici est de souligner l’arrachement au mutisme imposé que charrient ces irruptions violentes, et qui opère également dans des contextes moins directement antagoniques. La révolte fait certainement plus, mais elle ne peut en aucun cas faire moins que désincarner l’idiome du pouvoir par le commun du langage, contrer et dérègler son accaparement hiérarchique, en élargir les limites.
C’est cette matrice que l’on retrouve dans les divisions qui traversent l’apprentissage, lequel peut, selon les termes consacrés par Jacques Rancière, procéder à l’abrutissement quand il soumet une intelligence à une autre, ou émanciper quand une intelligence est contrainte à chercher pour son propre compte, à formuler ce qu’elle voit, ce qu’elle en pense, ce qu’elle en fait, etc. S’agissant de l’apprentissage, le dérèglement de la capture hiérarchique touche directement à la méthode. L’intelligence qui cherche pour elle-même part de quelque chose de connu pour aller vers l’inconnu, celle que l’on soumet est tenue de suivre un ordre préétabli. Ainsi de l’ouvrier qui apprend à lire par lui-même ; il prend son équerre, en extrait la forme graphique, y discerne la ressemblance avec la lettre L : la méthode n’est pas un préalable, elle s’invente à même le processus.
Si l’ouvrage Le Maître ignorantJacques Rancière, Le Maître ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 10-18, 2004. maintient néanmoins une figure du maître, celle-ci a désormais pour fonction de barrer la route à l’impuissance. Le maître ignorant ne transmet pas un savoir — le sien ou celui des autres. Il matérialise une « opinion » — que tous sont également intelligents — dans le dispositif d’une contrainte, qu’il assume à son propre compte, et non au compte d’une institution. Encore qu’ici cette confiance semble avoir une fonction différente de sa figure familière. Elle n’est justement pas un affect ou une attente suspendue à une confirmation, dépendante de celle-ci. Bien plutôt, on est en présence d’une confiance qui n’attend rien ni ne promet rien, mais qui sert, pratiquement, à fermer une issue : de tout ce qui concerne l’opinion d’inégalité de l’individu, le maître ignorant ne veut rien savoir. Le maître ignorant suscite simplement l’effort solitaire de l’enfant en lui commandant de parler : devine, et raconte ce que tu devines. Tout comme le psychanalyste dans l’analyse, le maître quitte l’élève comme interlocuteur, en le maintenant néanmoins comme parlant. Il enferme l’individu dans le cercle d’une tâche, dont son intelligence ne pourra sortir qu’à se rendre à elle-même nécessaire.
Le livre montre bien cette position, il montre aussi comment ce sont les étudiants hollandais eux-mêmes qui mettent l’ingénieur Joseph Jacotot dans une telle position, mais il est peu disert sur ce qui les motive. Pour ce qui est de l’enfant, on comprend que le maître ignorant vient répondre à un symptôme universel, récurrent, celui de l’absence d’attention chez l’enfant, l’envers de son incroyable puissance cognitive sans cesse déployée. Le propos se laisse pourtant aisément retourner. Pour élucider en quoi c’est aussi bien l’enfant lui-même qui met l’autre en cette position, il suffit de se tourner vers un enfant à qui cette sollicitation adulte fait intégralement défaut, et qui parvient néanmoins à obtenir de son entourage une attention pour ses avancées intellectuelles.
Cet enfant est Frederick Douglass, un enfant né esclave aux alentours de 1818 aux États-Unis. Il peut être utile de rappeler qu’il était légalement interdit que d’apprendre à lire et à écrire aux esclaves, les anti-literacy laws des États du Sud des États-Unis, et que ces lois deviennent plus nombreuses à partir de 1830, après un certain nombre de révoltes d’esclaves. Dans ce contexte, Douglass, qui a alors entre dix ou onze ans, s’apprend à écrire : il en conçoit le désir, il trouve des lettres, enfin il met les autres en position de vérifier la justesse de ses leçons.
Dans ses Mémoires d’un esclave, Frederick Douglass raconte qu’il commence par recevoir un enseignement de l’alphabet par sa maîtresse (sa propriétaire), enseignement auquel le mari met aussitôt fin : apprendre à lire à un esclave, cela peut mener loin. Cela mène loin, en effet. Douglass trouve une autre manière d’apprendre ; loué pour travailler sur un chantier naval, il échange du pain avec les apprentis blancs contre des leçons de lecture. Lire le conduit d’abord au désespoir, à envisager le suicide. Mais la rencontre avec un mot transforme sa trajectoire. On lit ceci :
De temps à autre, j’entendais parler des abolitionnistes. Il me fallut quelque temps pour apprendre ce que ce mot voulait dire. Il était toujours utilisé dans des contextes qui me le rendaient intéressant. Si un esclave était parvenu à s’enfuir, si un autre avait tué son maître, mis le feu aux étables ou fait quoi que ce soit de terriblement mal aux yeux d’un propriétaire d’esclave, on parlait de ça comme des effets de l’abolition. Après avoir patiemment attendu, je mis la main sur un journal de notre ville qui évoque les pétitions circulant dans le nord et réclamant l’abolition de l’esclavage dans le district de Columbia ainsi que celle du commerce des esclaves entre les États. À partir de ce jour je connus la signification du mot abolition, abolitionniste, et je m’approchais toujours du lieu où on les prononçait, espérant apprendre quelque chose d’important pour moi et mes frères esclaves. […] Je résolus de m’enfuir. J’attendais le moment propice. J’étais trop jeune pour songer à le faire immédiatement ; et puis je voulais apprendre à écrire dans l’éventualité où je pourrais rédiger mon propre laisser-passer. Je me consolais en me disant que j’aurais ma chance. En attendant, j’apprendrais à écrire.
Comment faire pour apprendre à écrire ? L’idée me vint alors que j’étais sur le chantier naval Durgin and Bailey et que je voyais souvent le charpentier, après avoir équarré et préparé un madrier, écrire dessus le nom de la partie du navire auquel il était destiné. Quand une pièce devait être utilisée côté bâbord du navire, on inscrivait : DB. Sur une pièce destinée au-devant du côté tribord, on écrivait dessus DT. Pour bâbord arrière on écrivait AB et pour tribord arrière AT. Bientôt je sus ce que ces lettres voulaient dire. Je commençai aussitôt à les copier et en peu de temps je fus capable de former ces quatre lettres. Après cela, à chaque fois que je rencontrais un garçon qui savait écrire, je lui disais que je savais aussi bien écrire que lui. Aussitôt il me lançait : « Je ne te crois pas, fais voir. » Je formais alors les lettres que j’avais eu la bonne fortune d’apprendre et je lui demandais de faire mieux. Je reçus de cette manière de nombreuses leçons d’écriture qu’il est probable que je n’aurais pu obtenir autrement. Mon cahier d’écriture, à cette époque, c’était la clôture des planches, le mur de briques, le pavé ; mon crayon et mon encre, un bout de craie. Avec eux, j’appris à écrire. Ensuite, je copiais les mots en italique du spelling book Webster, jusqu’à ce que je sois capable de les reproduire sans regarder le livre. À ce moment-là mon petit maître Thomas allait à l’école, avait appris à écrire et avait noirci plusieurs cahiers d’écriture. Ceux-ci avaient été ramenés à la maison, montré à quelques voisins, puis oubliés. Ma maîtresse allait tous les lundis aux réunions de l’école, qui avaient lieu dans une salle située sur Silk street, et je restais alors seul à la maison. Je passais tout ce temps à écrire dans les espaces laissés vides des cahiers de maître Thomas, recopiant ce qu’il avait écrit. Je m’y appliquais jusqu’à ce que mon écriture soit semblable à l’écriture de maître Thomas. Et c’est de cette manière, que, après de longues années d’efforts soutenus, je réussis à apprendre à écrireFrederick Douglass, Mémoires d’un esclave, trad. Normand Baillargeon et Chantal Santerre, Québec, Lux éditions, 2004, p.48..
L’apprentissage enfantin se débrouille. Au besoin il se débrouille alors même que tout chemin lui est barré, qu’apprendre à écrire peut valoir la vente, la main coupée, la mort. Il y a le clignotement auratique d’un mot qui concentre en lui un monde inexistant, « abolition, abolitionniste », un fragment d’avenir venu d’ailleurs. Sa marque inscrite dans le journal accroche et consolide le désir d’apprendre à écrire. Il y a les moyens du bord, DT, DB, AT, AB, un abécédaire restreint avec lequel commencer, il y a l’émulation rivale avec les autres enfants pour obtenir d’eux leçons et corrections, les matériaux complices, notamment la craie, qui tout à la fois inscrit et peut s’effacer, les surfaces planes pouvant accueillir les signes, et enfin la simulation graphique qui procure un camouflage à la répétition de l’exercice.
Cette scène d’apprentissage est sans aucun adulte, elle se déroule entre enfants. Ses procédures combinent la confiance sous les espèces de la ruse et de l’effronterie, sa méthode s’allie le concours des choses, de l’environnement pour venir à bout de son impuissance. Il y a là tous les ingrédients d’un conte, mais d’un conte étranger à toute tradition, puisque, ne disposant strictement d’aucun enchaînement générationnel, l’apprentissage se porte à lui-même secours en se branchant directement sur l’errance de la lettre et, avec elle, sur le monde de l’écriture, en lequel il y a déjà un nom pour la ruine de l’esclavage.
Réflexions sur la question enfantine —
Parce que l’enfance nous manque, nous manquons l’enfance, c’est-à-dire la puissance d’interprétation et d’action dont elle dispose. Nous ne voyons pas que l’irrégularité élève les enfants et décide, évidemment sans règles, de leur relation aux autres. Variation d’hypothèses visant à réorienter l’énergie qui nous reste, d’une manière suspecte, pour éduquer les moins éducables.
L’enfance absente d’elle-même
Raisonner sur l’enfance, ce n’est sans doute qu’une manie d’adulte. Les enfants pensent-ils à l’enfance ? Sans doute pas. Ils sont hors du temps. Ou alors ils rêvent de devenir grands et de pouvoir prendre la route. L’enfance est absente à elle-même, sans souci de soi, en échappement perpétuel, inassignable. Il y a donc toujours quelque chose de suspect et de dangereux à réfléchir dessus, même seulement à la nommer. La nommer c’est déjà la perdre : c’est sans doute vrai pour toute chose, mais c’est plus vrai que jamais pour l’enfance. En ce sens, parler d’ « enfance irrégulière » apparaît à la fois comme un pléonasme et une contradiction dans les termes. Pléonasme, parce que toute enfance est hors norme, mue par un désir sans règles. Et contradiction parce que dire seulement « enfance » c’est déjà chercher à la normer, ne serait-ce qu’en tant qu’absence de normes. L’enfance ne se nomme pas elle-même. Et l’on aimerait donc souvent que tous ses spécialistes se taisent pour laisser la parole aux seuls romanciers, cinéastes, artistes qui ne parlent que d’enfants, comme toutes ces merveilleuses petites et jeunes filles des Enfantines de Larbaud, ou d’une enfance qui remonte en eux et dont ils ne sont jamais très sûrs qu’elle soit leur, mais jamais de l’enfance.
L’ontologie pathétique de l’enfance
Les enfants changent tout le temps. Ils ne se contentent pas de grandir, ils changent. Et dans toutes les dimensions. Tantôt incroyablement subtils, tantôt parfaitement sots, obtus, bons à rien. Tantôt belles et rebelles, tantôt moches et remoches. Rapides puis lents, courageux et peureux, gentils et méchants et gentils dans leur méchanceté même puis méchants dans leur gentillesse même. Sur le long terme, peut-être alors que ça progresse, que ça grandit, que ça « prend de la graine ». Au moins parfois. Mais dans les temps courts, tout tourne, se tord, virevolte, spirale, rien n’est fixe. Comment dès lors comprendre que les enfants semblent ne pas le voir et vivent si souvent dans une forme absolument pathétique (d’abord au sens propre : qui les fait souffrir) d’éléatisme : pas de mouvement, pas de devenir, pas de changement ? Car dès qu’ils raisonnent, ils semblent si souvent, pas toujours, mais si souvent englués dans l’être le plus immuable et le plus clos : je suis fort ou faible, intelligent ou idiot, bon ou mauvais, mais je ne peux pas être les deux, ni être d’abord l’un puis l’autre, ou tantôt l’un et tantôt l’autre ; et si parfois j’hésite, c’est seulement parce que je ne sais pas encore, mais plus tard je saurai : j’étais un fort ou j’étais un faible. La plupart des enfants semblent avoir résolu d’avance le paradoxe de Zénon : évidemment qu’Achille ne rattrapera jamais la tortue. Autrement dit, ce n’est pas seulement « l’art de la nuance » qui manque à la jeunesse, comme dit Nietzsche, mais au moins autant le sens du temps. Alors quoi ? Est-ce nous qui les rendons ainsi avec l’école, le sport, et tous nos systèmes d’évaluation qu’ils ne peuvent lire que métaphysiquement, comme des assignations de l’être des hommes et des choses ? Ou est-ce qu’ils se mettent à penser ainsi dans le libre commerce avec leurs semblables — violence des cours de récréation qui distribuent pour toujours les valeurs et les places ? Ou est-ce un simple mécanisme de défense ordinaire qui veut que quand tout bouge on cherche des repères fixes ? Dans tous les cas, il est certain que les enfants sont des métaphysiciens, mais ne sont pas toujours de grands métaphysiciens. Il faudrait enseigner la métaphysique dès la maternelle, notamment les grandes philosophies du temps.
Enfance et politique — hypothèse I
Il faut protéger les enfants de la politique, c’est le nouveau mot d’ordre. En un sens, y adhèrent aujourd’hui presque tous ceux qui reconnaissent la valeur de nos mondes libéraux détachés de tout impératif de transmission. D’une part, parce qu’éduquer c’est alors éduquer à la liberté, ce n’est pas dresser, endoctriner, conditionner, l’horizon d’une éducation libre étant de faire autant que possible que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents et les disciples à leurs maîtres. D’autre part, parce qu’il est tout de même sage de protéger les enfants des divisions et des luttes de la politique : éduquer c’est apprendre à vivre ensemble et non contre. Et pourtant il y a toujours quelque chose de curieux dans un tel mot d’ordre. D’abord parce que la pensée politique naît en un sens conjointement à la pensée pédagogique. Ce n’est pas par hasard que toute la République de Platon est construite sur une vaste analogie entre l’éducation des enfants et la construction de la cité idéale. Ensuite parce qu’éduquer des enfants c’est au sens propre les politiser, les préparer à la vie dans la cité, loin des protections du foyer. Et enfin parce que protéger les enfants de la politique est encore un slogan politique : celui justement de sociétés libérales où nul n’a à se soucier de l’éducation de tous mais seulement de la « réussite » de ses propres enfants (ou de ses propres élèves quand on est enseignant) dans un système de concurrence généralisée.
Est-ce alors à dire qu’il faille regretter les vieux enseignements religieux ou idéologiques ? En un sens oui, parce que l’enseignement c’est quand même la politique : enseigner à chacun ce qui doit ou devrait être enseigné à tous. Il y a ainsi un impératif splendide du Talmud qui est aussi bien celui des mondes chrétien et musulman et que nous sommes malheureusement en train de perdre : « L’homme est le père de tous les enfants. » Et en un autre sens non, car une politique de la liberté est toujours à ce prix : laisser à nos enfants tout le loisir d’en perdre le sens. Toutefois, même dans cette dernière perspective, sans doute faudrait-il au moins faire de la réussite individuelle un point de butée de toute pensée pédagogique : éduquer hors politique ce ne peut pas être faire réussir les uns contre les autres, ce qui est non seulement encore une transmission politique, mais la pire. Autrement dit, il faudrait être cohérent : en matière d’éducation, si l’on veut être libéral, force est d’accepter qu’il n’y a jamais assez de dérégulation, que l’enfance ne sera jamais assez irrégulière. Autrement dit encore, le paradoxe veut que face à nos sociétés pseudo-libérales, vrais traditionalistes comme vrais libéraux devraient pouvoir s’entendre sur au moins un point : transmettre ses valeurs comme ne rien transmettre, politiser ses enfants comme les protéger de la politique, les discipliner en vue d’une vie sociale disciplinaire comme les libérer de toute entrave, vaut toujours mieux que leur enseigner la seule et calamiteuse règle de la réussite individuelle. Règle exclusive, sans politisation idéologique et sans dépolitisation réelle, sans loi et sans liberté, bref règle d’airain et pourtant jamais pensée, règle absolument barbare.
Enfantin et infantile
Quand on aime ce qui a trait à l’enfance, on parle d’enfantin, quand on le déteste on parle d’infantile ou de puéril. « L’enfantin », c’est l’origine, le point de départ, riche de promesses, de possibles, ou de suspens : la vie sans règles et sans horizon, l’enfance irrégulière comprise comme tout ce que le chaos comprend en puissance de cosmogénésies nouvelles. Le « puéril », c’est la régression, le mouvement exactement inverse, l’arrêt de la promesse, et la certitude de l’échec : le retour aux règles infernales de la compulsion de répétition, du « toujours plus » qui au final exprime toujours un « toujours moins ». Ainsi Marx de se ressaisir après un court moment de nostalgie face à l’art des Grecs, ce « peuple d’enfants » qui croyait en l’harmonie du monde et en la beauté des formes : « On ne peut pas redevenir enfant sans être puéril. » Ainsi, bien qu’en un autre sens, Deleuze et Guattari en opposant « blocs d’enfance » à « souvenirs d’enfance » : quand remonte à la surface un bloc d’enfance, c’est la vie elle-même qui se manifeste dans sa puissance, son anonymat, et sa charge de possible — splendeur de l’enfantin où l’on est libre parce qu’on n’est encore personne ; au contraire, le souvenir d’enfance, c’est ce qui bloque, narcissise, engage irrésistiblement dans une conspiration cosmique pour faire chier le monde — j’ai vécu ça, on m’a battu, on ne m’a pas assez aimé, on m’a trop aimé et embrassé, j’ai eu une enfance si heureuse : dans tous les cas misère, misère puérile des souvenirs d’enfance. Qu’est-ce qui fonde alors en vérité la pertinence si communément expérimentale d’une telle distinction ? Sûrement pas l’opposition vaine entre la règle et l’absence de règles — les Grecs n’étaient sûrement pas sans règles, et les « blocs d’enfance » ne laissent sûrement pas remonter un pur chaos. Mais la transcendance temporelle. Ce qui est puéril, c’est de vouloir importer des formes de règles d’une époque à une autre — vouloir régir les règles des enfants par celles des adultes et inversement. Ce qui est en revanche enfantin, c’est de laisser chaque âge de la vie à sa régulation immanente. Autrement dit, il n’y a pas en vérité d’enfance irrégulière. Il y a une enfance régulière qui connaît ses propres règles face à son propre chaos et de même pour l’âge adulte. L’idée d’enfance irrégulière est une idée d’adultes qui ont cherché à transcender la barrière des âges pour y imposer leur loi. Ce qui ne peut signifier qu’une chose : les législateurs de l’enfance sont des âmes encore puériles.
L’infans adultus — hypothèse II
On trouve chez Spinoza une expression intéressante et commune, celle de l’infans adultus, de l’enfant adulte. Elle désigne tous ceux qui, bien qu’adultes, continuent à raisonner dans les termes de l’enfance, c’est-à-dire qui vivent d’espoir et de crainte au lieu de vérité et de fausseté. L’enfant adulte, c’est éthiquement celui qui est incapable de comprendre combien il n’est qu’un mode de l’immensité de la Nature, entièrement et nécessairement causé par elle, et cherche sans cesse à ressaisir sa toute-puissance illusoire : « Moi, je… », « Moi, je… » Et politiquement, c’est celui qui au contraire est incapable de se prendre en charge lui-même et s’avère la proie de tous les théologiens, démagogues, Führers charismatiques. Une telle description, si juste empiriquement (chacun pourrait multiplier sans fin les exemples qu’il connaît de tous ces petits-moi si tyranniques dans leur vie privée et si happés par l’Autre dans leur vie publique), a l’immense défaut de se construire sur une détestation de l’enfance et de sa dialectique funeste entre toute-puissance et abandon. Car à raisonner ainsi on ne comprend en vérité rien aux enfants et on leur fait porter des fautes qu’ils n’ont jamais commises puisque leur beauté est justement d’interdire toute dialectique entre toute-puissance et abandon, ceux-ci se dressant souvent dans leur toute-puissance face à l’autorité imposante et s’abandonnant uniquement quand il n’y en a plus. En revanche, à l’interpréter autrement, de manière bien plus profondément politique, une telle formule exprime peut-être une vérité plus essentielle : celle de nommer exactement le chiasme qui caractérise politiquement toute société quant à son traitement des adultes et des enfants. Par un tel chiasme, nous entendons ceci : plus une société traite ses adultes comme des enfants, plus elle aura tendance à traiter ses enfants comme des adultes, et réciproquement. C’est là en tout cas tout le sens de notre seconde hypothèse : on ne peut pas traiter le monde de l’enfance comme un monde à part dans des sociétés où les exigences dévolues aux enfants apparaissent aussi inversement proportionnelles à celles dévolues aux adultes. De telles sociétés semblent plutôt conduire d’un même geste à l’infantilisation des grands et à la criminalisation des petits. Car n’est-ce pas d’un même mouvement que l’on enjoint aujourd’hui aux enfants de travailler, d’être disciplinés, sages, respectueux des autorités et aux adultes de consommer et de jouir de tout ? En bref, cette seconde hypothèse est la suivante : seules l’idée et la possibilité d’ « enfants adultes » ouvrent à la possibilité de traiter les enfants comme des adultes moralement ou pénalement et inversement. Et si on la suit, il faut alors reconnaître ceci : pour combattre le sort réservé aujourd’hui aux enfants, il faut combattre dans le même temps le sort réservé aux adultes ; sans cela, on ne trouvera aucun soutien chez des adultes qui n’auront de cesse d’empêcher les enfants de devenir leur propre miroir.
Innocence
L’innocence de l’enfance devient une tarte à la crème aussi fausse qu’insupportable dès qu’on cherche à qualifier moralement cette innocence comme bonté, grâce, douceur, et autres parfums d’Épinal. Mais à la prendre à la lettre, c’est une vérité indépassable : l’enfance est innocence, c’est-à-dire vie avant la faute, c’est-à-dire vie avant la loi (loi de la langue d’abord, puis loi domestique et loi divine, puis loi de la cité). Pour le meilleur et pour le pire puisque ce qui nous fait aimer l’enfance est cela même qui nous fait la craindre. Dans cette optique, on pourrait lire toute la seconde dissertation de la Généalogie de la morale comme une généalogie de l’enfance. Nos « chères têtes blondes » ressemblent tant à ces « blondes bêtes de proie des forêts teutoniques » que décrit Nietzsche : animaux sans mémoire, donc sans ressentiment et sans mauvaise conscience, qui ne sont pas encore malades de leur mémoire, qui possèdent encore intacte cette formidable « puissance active d’oubli ». Capables de s’entredéchirer sans scrupule, puis de rejouer ensemble cinq minutes plus tard non pas comme si rien n’avait eu lieu, mais parce que rien n’a eu lieu : le passé n’est pas et ce qui n’est pas n’a pas été. Donc pas besoin de pardon, de réconciliation, ou de juste partage des torts : juste la splendeur vitale de l’oubli. Le problème est que des animaux sans mémoire ou à mémoire courte sont des animaux incapables de promettre puisqu’ils oublient tout. Il faut donc leur créer une mémoire, les intoxiquer avec cela. Et comment ? Par l’effroyable spectacle de la cruauté : tortures, châtiments, exécutions et humiliations publiques. Ce n’est pas une histoire ancienne, les sous-sols de notre culture et de notre morale. C’est ce qu’expérimente encore tout enfant : en famille, à l’école, ou plus tard au travail s’il met du temps à grandir. Devenir capable de promettre, perdre son innocence, vivre dans la possibilité constante de la faute : tout cela a un coût affreux. Comment atténuer tant de cruauté, en un sens d’autant plus terrible qu’elle est plus raffinée, plus invisible, plus imprégnée du souci du bien de l’enfant ? Il ne peut pas y avoir d’autre question. Parce que s’il y a une splendeur de l’innocence, il y a une plus grande splendeur encore de la promesse : faire des hommes et des femmes capables de promettre, c’est une trop belle invention, on ne peut revenir en arrière. Donc ne rien chercher à sauvegarder, mais ne pas être trop fier non plus de ce que l’on fait. Atténuer au mieux la perte de l’innocence, on ne peut pas mieux. Et espérer seulement qu’il s’en préserve quand même quelque chose, comme par surcroît ou par reste.
Éduquer sans violence et sans torture ?
C’est notre rêve pédagogique de modernes. Un rêve impossible ? Dont la reconnaissance de l’impossibilité exigerait à rebours de reconnaître que les Anciens avaient au moins le mérite de ne pas se payer de mots ? Platon était favorable à l’exposition des enfants, comme à Sparte : on les expose deux, trois jours en plein vent à leur naissance, et on voit lesquels résistent pour sélectionner les « bonnes natures ». Les Guayaki, comme nombre de tribus dites « primitives », eux, torturaient leurs adolescents. Clastres décrit cela sans trembler : pour les garçons, d’abord un jeûne prolongé puis une perforation de la lèvre pour y introduire le labret, et quelques années plus tard la scarification du dos, entièrement labouré par une pierre tranchante de l’épaule aux fesses, le sang coulant à flot ; pour les filles, tout se passe en même temps au jour des premières menstrues : jeûne, puis flagellation (assez douce) avec un pénis de tapir « pour qu’elles désirent bien les hommes », puis scarification (cette fois violente) du ventre, des seins jusqu’au pubis. Tout cela semble peu chrétien, peu digne d’un Jésus qui voulait laisser venir à lui tous les petits enfants, certes. Mais les laisser venir pour quoi faire ? Les catholiques considéraient les enfants comme des animaux que leur père peut donc traiter comme tels : à coups de fouet, de rudes travaux et plus généralement « comme il veut ». C’est saint Thomas qui s’exprime ainsi : « De même qu’un bœuf ou un cheval appartient en droit civil à quelqu’un qui s’en sert comme il veut, de même est-il de droit naturel que le fils avant d’avoir l’usage de la raison demeure sous la tutelle de son père. » Quant aux protestants calvinistes, ils considéraient que le principe fondamental de toute pédagogie était de « tuer l’enfant que chacun porte en soi ». Se tournera-t-on vers les déistes ? Rousseau proposait que l’enfant qui a cassé la fenêtre de sa chambre en plein hiver, on le laisse dans le froid, « pour qu’il comprenne de lui-même sa faute », et Nietzsche était adepte du fouet et des disciplines les plus sévères. Mais ces modernes, dès qu’ils pensaient à la paideia, ne raisonnaient peut-être en vérité que comme des anciens. Dans tous les cas, il semble qu’il y ait peu de choses à retenir du passé, quelle que soit l’époque, pour savoir comment s’en sortir aujourd’hui avec l’enfance. Car s’il est possible que notre rêve moderne d’identifier éducation et heureux épanouissement ne soit qu’un rêve, il est certain que les rêves d’éducation des Anciens ressemblaient à de purs cauchemars. Cela dit, évidemment, contre tous les nostalgiques du bon vieux temps en matière d’éducation.
Mais il y a une réserve. Là où les Anciens, les primitifs et les modernes nous impressionnent encore c’est que, lorsqu’ils concevaient une violence, voire une torture, jugées nécessaires à tout processus d’éducation, ils la concevaient soit pour tous, soit pour les meilleurs. Ce qu’invente en revanche notre hypermodernité, c’est peut-être un usage de la violence au bout du rêve, quand tout semble avoir échoué, et donc réservé aux seuls « mauvais » : aux indociles, aux prédélinquants, aux hyperactifs. Or, à cette aune, les vrais monstres, ne serait-ce pas nous ?
Trilogies — hypothèse III
Il est possible que l’enfance ne puisse jamais être pensée seule. En tout cas, historiquement, force est de constater qu’elle se présente sans cesse sous forme de trilogies : « l’enfant, l’animal, la plante » dans une perspective aristotélicienne biologico-métaphysique, « l’enfant, la femme, l’esclave », dans le versant plus politique de cette même tradition aristotélicienne, « l’enfant, le sauvage, le fou » dans une perspective classique, « l’enfant, l’étranger, le criminel » dans une perspective plus moderne. Il serait toutefois idiot de voir dans ces trilogies des dévalorisations univoques de l’enfance. Car elles sont peut-être toujours à entendre dans les deux sens, pouvant autant servir à stigmatiser l’enfance qu’à l’inventer ou à la laisser vivre. N’est-ce pas l’un des charmes inépuisables de l’enfance que de pouvoir entraîner sans cesse notre humanité normée hors de ses gonds : dans des devenirs animaux inédits, des traversées des genres sexués, des noces contre nature entre faune et flore, des folies créatrices et des sauvageries bienheureuses, des crimes innocents et un étrangement de la langue sans pareil ? Il y a même peut-être là les linéaments d’une phénoménologie de l’enfance plus sérieuse que les principes modernes posant abstraitement que « le bébé est une personne » ou que « l’enfant est un sujet de droit ». Ainsi Érasme de remarquer dans son Éloge de la folie : « Si nous aimons les enfants, les baisons, les caressons, si un ennemi même leur porte secours, n’est-ce pas parce qu’il y a en eux la séduction de la Folie ? […] N’est-il pas un monstre détestable, l’enfant qui raisonne comme un homme fait ? » De ce point de vue, on peut hasarder l’ultime hypothèse suivante : les anciennes trilogies qui excluaient l’enfant du règne de la rationalité adulte au milieu d’autres parias avaient au moins le mérite de souligner cette vérité profonde qui veut qu’on ne peut jamais comprendre l’enfance ni comme un monde à part, ni comme la vérité profonde du monde (la vérité sort de la bouche des enfants), parce que c’est toujours un « monde-avec » — avec les femmes, avec les serviteurs, avec les fleurs, les arbres et les animaux, avec les fous, avec les étrangers, avec les criminels et les bandits. Dans cette perspective, toute juste politique de l’enfance ne peut jamais être ni entièrement autochtone ni entièrement dissoute dans des principes universels : elle devrait plutôt examiner avec quels mondes, à une époque donnée, l’enfance se retrouve en voisinage. Aujourd’hui, nous l’avons dit, l’enfance est peut-être en voisinage comme jamais avec les étrangers et avec les criminels. Et en ce sens, se battre pour les droits de l’enfance oblige à se battre conjointement pour les droits des étrangers et pour la réforme du système pénitentiaire ?
Remerciements
Les éditeurices remercient très chaleureusement les auteurices ainsi que Florence Aknin, Claude Aubart, François Aubart, Florence Bonnefous, Emanuèle Buffin, Elsa Boyer, Ned Burgess, Derek Byrne, CBC, Aïnhoa Jean-Calmettes, Thierry Chancogne, Clara et Julie (Collectif Matsuda), Laurent Faulon, Marotte et Cie, Mio Koivisto, Jeanne Lefèvre, Emmanuelle Lequeux, Magali Lesauvage, Marotte et Compagnie, Raymond Millot, Guilhem Monceaux, Pierre Niedergang, Camille Pageard, Chloé Pathé (Anamosa), Vincent T. Pauval, Hellali Penanguer, Léa Petitdemange (éditions Casterman), Rosanna Puyol, Nicolas Romarie, Julien Sirjacq, Albert Sousbie, éditions les vilains, Christine Villeneuve (Des Femmes).
Colophon
Relecture par Claire Bleux.
Illustré par Claude Aubart.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Politiser l’enfance, mise en page avec InDesign et imprimée en Offset sur Munken Print White 300 g/m² et 90 g/m² en 1 500 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en cahier cousu collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en novembre 2023 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-403-3.
Cette version a été composée par Burn~Août en Alegreya (Juan Pablo del Peral) et Karla (Jonny Pinhorn).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.