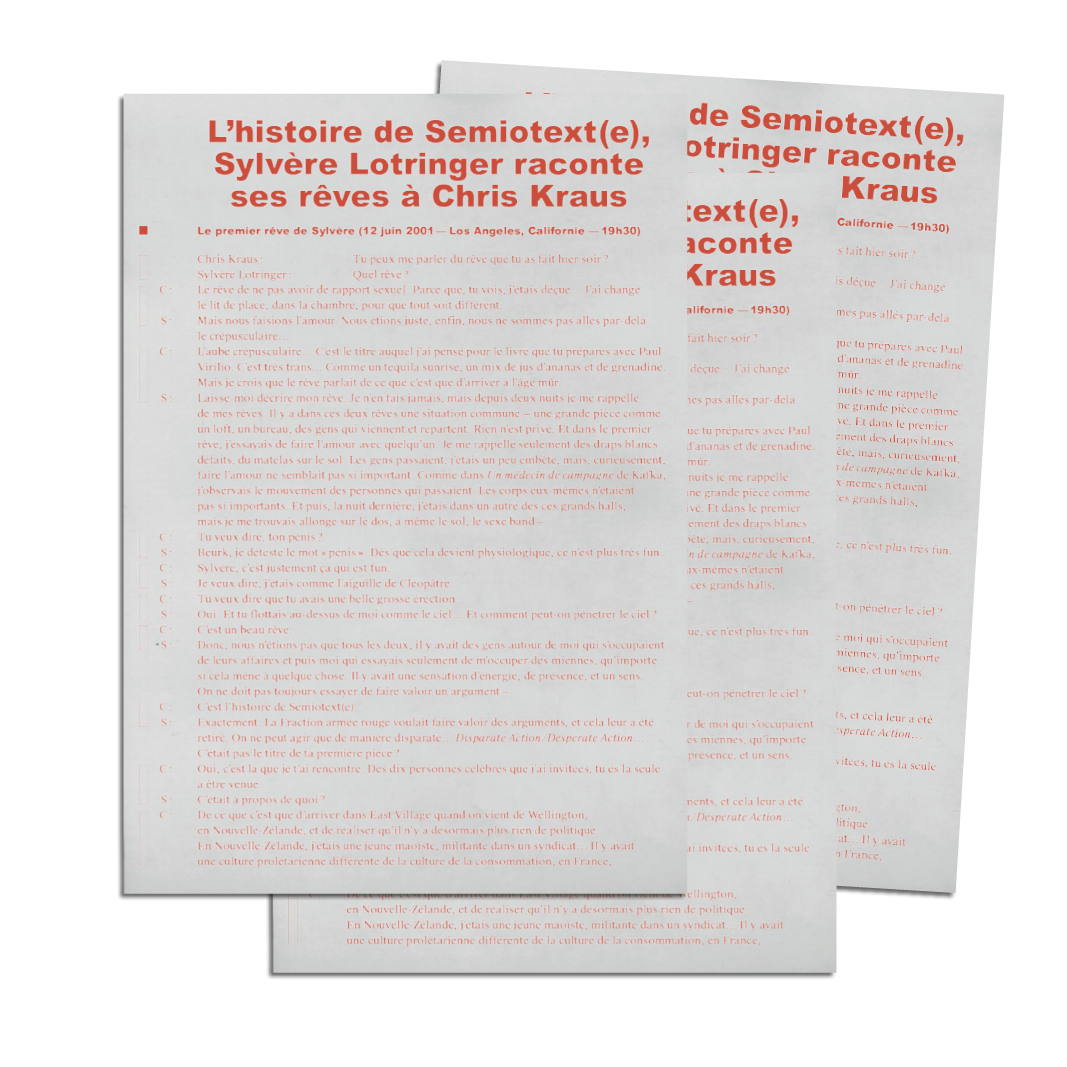
Base de données ()
L_histoire_de_Semiotexte_Sylvère_Lotringer_raconte_ses_rêves_à_Chris_Kraus .tract 12/05/22
SEMIO.package
Table des matières
Corps du texte
Longueur de ligne
Interlignage
L’histoire de Semiotext(e), Sylvère Lotringer raconte ses rêves à Chris Kraus
Chris Kraus, Sylvère Lotringer
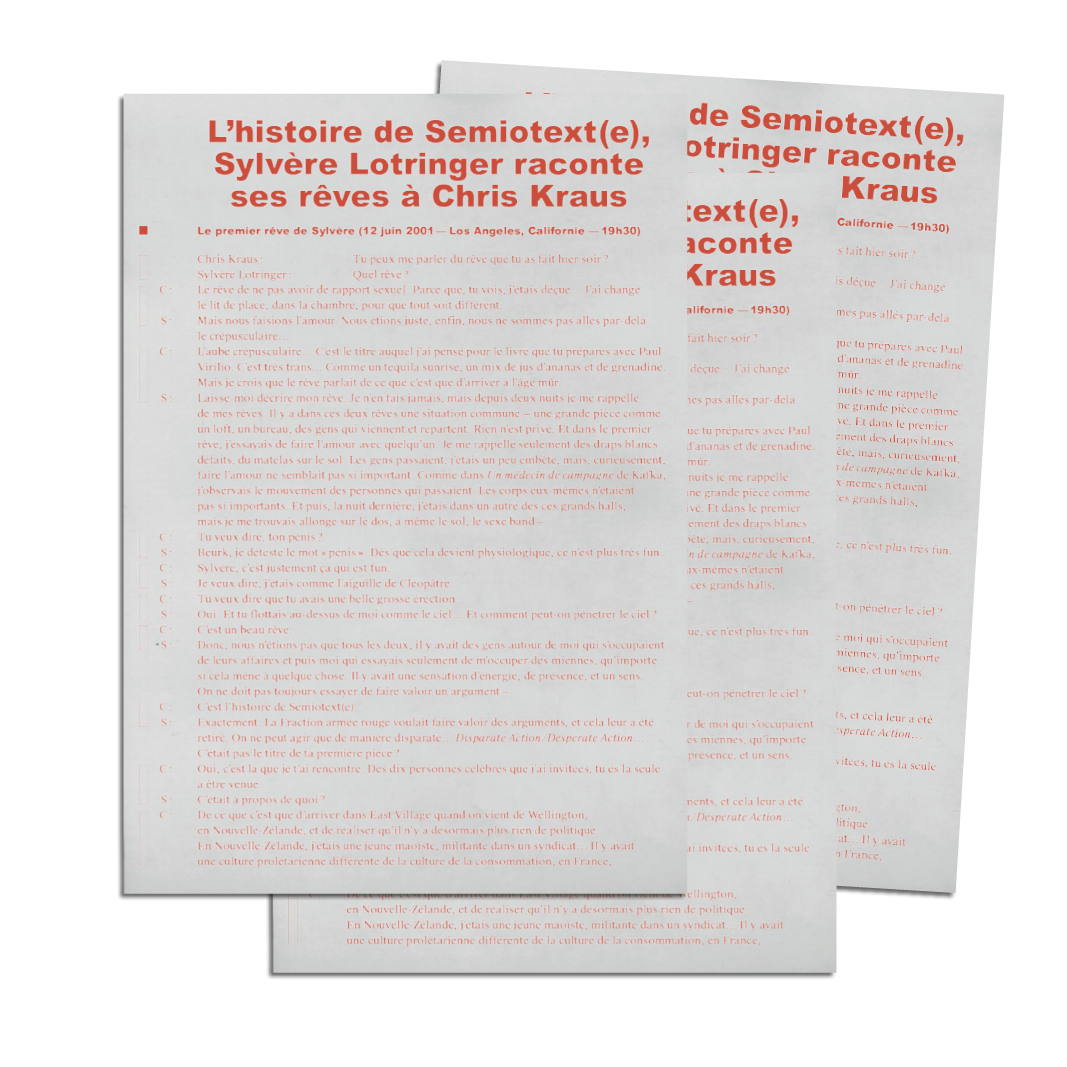
Traduction : Mio Koivisto
Graphisme : Roméo Abergel
Publié en mai 2022
Collection Positions d’éditeurices
Essais
4 pages
148 × 210 mm
Publié sous licence CC BY-NC-SA
Français
Originellement publié en 2002 par Semiotext(e). (Californie)
Titre original : Hatred of Capitalism (introduction)
Ce texte de Chris Kraus et Sylvère Lotringer est l’introduction de Hatred of Capitalism (Semiotext(e), 2002). Nous avons découvert ce texte aux États-Unis, en 2020, pendant les révoltes qui ont suivi l’assassinat de Georges Floyd. Depuis lors, il nous accompagne lorsque nous faisons des livres. À travers lui, nous parlons de cette pratique qui consiste à faire tomber les frontières entre théorie et praxis, entre genres – si on peut encore parler de ça —, et entre les différentes modalités du travail du texte, qu’il soit issu d’affiches, de tracts revendicatifs ou de livres.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 07/01/26 à 13 h 07.
Le premier rêve de Sylvère (12 juin 2001 — Los Angeles, Californie — 19h30)
C : Le rêve de ne pas avoir de rapport sexuel. Parce que, tu vois, j’étais déçue… J’ai changé le lit de place, dans la chambre, pour que tout soit différent.
S : Mais nous faisions l’amour. Nous étions juste, enfin, nous ne sommes pas allés par-delà le crépusculaire…
C : L’aube crépusculaire… C’est le titre auquel j’ai pensé pour le livre que tu prépares avec Paul Virilio. C’est très trans… Comme un tequila sunrise, un mix de jus d’ananas et de grenadine. Mais je crois que le rêve parlait de ce que c’est que d’arriver à l’âge mûr.
S : Laisse-moi décrire mon rêve. Je n’en fais jamais, mais depuis deux nuits je me rappelle de mes rêves. Il y a dans ces deux rêves une situation commune — une grande pièce comme un loft, un bureau, des gens qui viennent et repartent. Rien n’est privé. Et dans le premier rêve, j’essayais de faire l’amour avec quelqu’un. Je me rappelle seulement des draps blancs défaits, du matelas sur le sol. Les gens passaient, j’étais un peu embêté, mais curieusement, faire l’amour ne semblait pas si important. Comme dans Un médecin de campagne de Kafka, j’observais le mouvement des personnes qui passaient. Les corps eux-mêmes n’étaient pas si importants. Et puis, la nuit dernière, j’étais dans un autre des ces grands halls, mais je me trouvais allongé sur le dos, à même le sol, le sexe band —
S : Donc, nous n’étions pas que tous les deux, il y avait des gens autour de moi qui s’occupaient de leurs affaires et puis moi qui essayais seulement de m’occuper des miennes, qu’importe si cela mène à quelque chose. Il y avait une sensation d’énergie, de présence, et un sens. On ne doit pas toujours essayer de faire valoir un argument —
S : Exactement. La Fraction armée rouge voulait faire valoir des arguments, et cela leur a été retiré. On ne peut agir que de manière disparate… Disparate Action/Desperate Action… C’était pas le titre de ta première pièce ?
C : Oui, c’est là que je t’ai rencontré. Des dix personnes célèbres que j’ai invitées, tu es la seule à être venue.
C : De ce que c’est que d’arriver dans East Village quand on vient de Wellington, en Nouvelle-Zélande, et de réaliser qu’il n’y a désormais plus rien de politique. En Nouvelle-Zélande, j’étais une jeune maoïste, militante dans un syndicat… Il y avait une culture prolétarienne différente de la culture de la consommation, en France, vous la qualifieriez de « populaire »… Nous avions donc ça en commun, bien que nous étions d’une génération différente. Je me demandais comment faire sens, ou comment conserver un sens du politique dans une situation intrinsèquement chaotique et apolitique. Je regrettais l’histoire. Bien sûr, maintenant, ce n’est plus le sujet. Mais c’était l’un des grands objets de réflexion de Semiotext(e). C’est la raison pour laquelle je pense qu’on était destinés à se rencontrer.
C : Oui, mais moi, j’aime la bite, tu sais ? [Rires.] Qu’as-tu pensé en parcourant le livre aujourd’hui ?
S : J’ai eu l’impression que tout était de la théorie, même quand ça n’en n’était pas. C’était si fort. La lecture de l’interview d’Assata, Prisoner in the United StatesSHAKUR Assata, « Prisoner in United State » dans DHORUBA Bin Wahad, SHAKUR Assata, MUMIA Abu-Jamal, Still Black, Still Strong, Survivors of the U.S. War Against Black Revolutionaries, Semiotext(e) / Active Agents, 1993., m’a fait penser que cette vie si privilégiée que nous sommes censés vivre dans notre vide glamour n’est possible que parce que 1,3 millions de personnes dans ce pays en ont été exclues. Et que des millions de personnes dans le monde et en Amérique paient pour ce paradis technologique. C’est révoltant. J’avais également un sentiment de puissance — celui d’être connecté à quelque chose de très important et qui ne disparait pas. Au début de Semiotext(e), en 1974, c’étaient les derniers souffles du marxisme, je savais que les terroristes avaient raison mais je ne pouvais pas cautionner leurs actions. Aujourd’hui, j’ai la même sensation. Ce qui se passe, c’est qu’on a oublié l’existence même du capitalisme. Il est devenu invisible parce qu’il n’y a rien d’autre à voir. Lorsque j’ai parlé de ce livre à Baudrillard, il m’a dit que le titre faisait trop démodé.
S : Mais le capitalisme n’a pas disparu. J’ai essayé de disparaitre pendant des années en faisant des interviews, mais le capitalisme n’a pas disparu. Ses répercussions sont encore plus considérables qu’avant, et pourtant personne ne semble pouvoir les saisir. [Le téléphone sonne. C’est Mark von Shlegell, qui a édité des sections de ce livre.]
C : Mark, que penses-tu du livre ? M : Je trouve que c’est bien. J’ai aimé les parties que j’ai lues. J’ai vraiment aimé.
C : Penses-tu que c’est historique ou spéculatif ? M : Probablement un peu des deux. J’ai le sentiment que c’est hystérique. Que veux-tu qu’il soit ?
C : Je veux qu’il soit beau. [Mark raccroche.] Sylvère, et si nous changions de sujet ? Je voulais dire quelque chose à propos des tonalités directes, immédiates, des voix que nous publions dans Native Agents. De comment cela fait écho à l’entièreté du projet.
S : Je faisais beaucoup d’entretiens parce que je voulais que la théorie devienne des idées qui auraient un impact immédiat. Qui pourraient être pensées aussi naturellement que l’on respire.
S : Oui. Les entretiens étaient une manière de faire. Un moyen différent consistait à envelopper la théorie d’autres choses, jusqu’à ce qu’elle devienne un élément qui ne peut être isolé d’un ensemble plus fluide. Des documents, des images, des citations, des idées faisant partie d’une sorte de mouvement qui emmène d’une chose à l’autre, et qui change tout sur le monde.
C : Il y a des choses qui doivent être martelées pour être entendues. Cette après-midi, je lisais un essai de Jill Johnston à propos de sa rencontre avec Ronald Laing. Elle avait remarqué l’énorme bond qui sépare The Divided Self LAING Ronald, The Divided Self : An Existential Study in Sanity and Madness, Pelican Books, 1960., écrit à la fin des années 1950, de The Politics of Experience LAING Ronald, The Politics of Experience and The Bird of Paradise, Penguin Books, 1967., paru autour de 1965, et voulait savoir comment c’était arrivé. Elle écrit : « J’en ai conclu que Laing devait se protéger professionnellement en se donnant à voir comme le grand prêtre de la folie sans partager aucune information personnelle sur son cheminement. J’ai décidé de lui demander pourquoi. » Elle a écrit ça en 1972, pensant que l’exposition totale de chacun est la seule façon de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Trente ans plus tard, c’est toujours aussi radical : s’exposer a été confondu avec se confesser… La confession peut être ridiculisée, mais on la tolère parce qu’elle implique une culpabilité individuelle, premier pas vers le retour au bercail, une sorte de catharsis bon marché. L’exposition, en tant que pure déclaration factuelle, fragmente la réalité en causes et effets. C’est beaucoup plus dérangeant. Mais la culture continue de considérer que le « sérieux » est à l’abri de toute forme d’exposition. Laing, ou tout autre grand homme, perdrait le pouvoir du mythe si nous en comprenions la construction.
S : L’avant-garde française était à la recherche de choses extrêmes. Le capitalisme ne tend jamais vers l’extrême, et c’est de là qu’on peut le contrer. Est-il possible de donner à la folie une valeur d’usage ? La haine du capitalisme est une vraie folie.
C : Eh bien, Jill était folle, comme beaucoup de personnes que nous publions. Mais cette idée d’exposition totale me semble incroyablement évidente, factuelle et bénigne. Le manifeste d’Ulrike Meinhof, ça c’était de la folie. Elle était si sensible à des choses que l’on a tant de mal à percevoir maintenant. L’effet paralysant de la culture de la consommation — ici, elle parlait des masses — et de la compétition professionnelle — là, elle parlait évidement d’elle-même et de son monde. La notion de carrière est si enracinée que nous ne la questionnons même plus. Bien sûr, Meinhof était folle. Mais Fanny Howe l’est aussi.
Le second rêve de Sylvère (Le matin suivant — los Angeles, Californie — 10h45)
S : Dans le rêve que j’ai fait la nuit dernière, j’essayais de dissimuler un morceau de papier à des gens qui me pourchassaient. Il était fait de plusieurs couches, comme du parchemin. Un épais morceau de texte que je portais sur moi et que j’essayais de protéger face aux personnes qui tentaient de s’en emparer. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à le faire disparaitre — il était rouge vif. Mes assaillants finissaient toujours par le trouver et je devais les repousser. Puis, le papier s’est transformé en une sorte de matière vivante. Pas exactement de la viande, ni de la matière entomique, mais faite elle aussi de plusieurs couches. Et ça m’attaquait, j’essayais de me débattre, de la déchiqueter pour m’en débarrasser, mais les parties que je parvenais à en détacher finissaient toujours par repousser, c’était épais et visqueux. Je n’avais pas de sang sur les mains, mais une impression de chair crue, comme si je tapais sur un morceau de viande qui ne voulait pas se laisser arracher. Tu as assemblé ce livre ; de quoi parle-t-il selon toi ?
C : Ce que j’aime dans ce livre, c’est son indivisibilité — que chacune de ses parties soit un fragment d’un même organisme. En ce sens, l’hystérie de Baudrillard à propos de la fin de la politique, les prophéties numériques de Louis Wolfson, les descriptions de Michelle Tea des jeunes gothiques aux visages blêmes de Copley Square et la mémoire hallucinée d’Ann Rower se souvenant de Tim Leary autour de 1961 sont toutes des parties d’un même ensemble. Eileen Myles demande si elle est la seule, dans la pièce, à ne pas pouvoir se permettre de soigner ses dents, et Alain Joxe explique que les escarmouches génocidaires sont structurellement inhérentes au capitalisme global. Chacune des parties de ce livre est fortement polémique. C’est de l’écriture en action, totalement consciente d’être paradigmatique. En ce sens, tous les écrits de ce livre embrassent la philosophie du terrorisme.
S : Au début, je ne voulais pas faire ce livre, cela me semblait être des funérailles de première classe. Semiotext(e) n’a jamais publié de manifeste ; donc il est absurde de penser qu’il pourrait y avoir un commencement ou une fin.
C : Là où j’ai grandi, il y avait ces deux vieilles femmes qui vivaient un peu plus loin dans la rue. Claire et sa tante. Je les voyais toujours qui travaillaient dans le jardin. La tante de Claire était très vieille. Elle s’habillait seulement de noir, à l’exception d’un chapeau de paille, qui avait un voile noir. Ça lui donnait l’air d’une ancienne apicultrice.
S : Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions un long jardin étroit dans la banlieue éloignée de Paris. Nous y faisions pousser des rutabagas — c’était le seul légume permis, et toutes les feuilles étaient recouvertes de bestioles marron que nous n’avions jamais vues auparavant — elles étaient venues avec l’armée allemande et dévoraient tout notre stock de nourriture. Mais nous avions six beaux lapins — je te raconte toute l’histoire ? — nous étions fascinés par leurs dents. Je glissais mes doigts à travers les grilles de la cage. Ils étaient comme des lions. Ils ont arraché le doigt de la fille des voisins. Tu sais ce qu’ils sont devenus ? L’un d’eux, que j’aimais beaucoup, s’appelait Blackie… Il était noir, doux au toucher et je trouvais le tremblement de son nez plein de sagesse. Les lapins étaient notre réserve de nourriture. On n’en laissait rien, mon père les écorchait, leur chair redevenait noire dans la sauce préparée par ma mère. Nous savions que c’était ce qui attendait Blackie.
S : Non, on ne pouvait pas. Il n’y avait rien d’autre à manger. Alors, un jour, mes parents l’ont tué, mais ma soeur et moi avons refusé de le toucher.
C : C’est une triste histoire. Comme celle de Nina Živančević à propos de la guerre en Yougoslavie. [Pause.] Je sens qu’on approche d’une californisation de Semiotext(e). Ce qu’il y a de mieux en étant à L.A., c’est le moment où l’on entre dans cette sorte de temps suspendu — d’embrasser le vide, simplement, de flotter à travers la journée. Les textes sont moins importants que les maillages qu’ils produisent ensemble.
C : Oui, il s’agit plus d’une atmosphère de sens que d’une signification particulière. Même si à l’époque il y avait cette esthétique de la guérilla. Quand on lisait le magazine, il y avait toujours un moment où l’on se demandait où l’on se situait par rapport aux gens branchés. Maintenant c’est beaucoup plus ouvert.
Ce texte de Chris Kraus et Sylvère Lotringer est l’introduction de Hatred of Capitalism, un recueil d’archives des textes marquants publiés par Semiotext(e), monter ensembles ils témoignent du passage d’une époque à une autre, des fictions et espoirs qui l’accompagnaient et de leur transformation. J’ai découvert ce texte aux États-Unis, en 2020, pendant les révoltes qui ont suivi l’assassinat de Georges Floyd et il m’accompagne depuis dans ma pratique éditoriale aux éditions Burn~Août. À travers lui nous parlons de cette pratique qui consiste à faire les tomber les frontières entre théorie et praxis, entre genres, si on peut encore parler de ça, et entre les différentes modalités du travail du texte, qu’il soit issu d’affiches, de tracts revendicatif ou de livres.
Remerciements
Merci à Mathilde Koivisto (traductrice), à Roméo Abergel (conception graphique) et à Yann Trividic (relecture) d’avoir travaillé bénévolement à la production de ce tract. Merci d’avance à celles et ceux qui le diffuseront.
(contacter) burnaout@riseup.net
À propos de la collection Positions d’éditeurices
La collection Positions d’éditeur·ices a pour objectif de visibiliser les pratiques éditoriales que nous estimons et dont nous nous sentons proches. Chaque numéro constitue une prise de position, un outil théorique et critique tant sur la production et la circulation des formes imprimées que sur leur appréhension par les communautés dont elles sont issues.
Nous cherchons ainsi à dresser le paysage des pratiques qui nous entourent et à nous y insérer par la mise en acte de ce qu’elles proposent.
La collection Positions d’éditeur·ices représente pour nous un espace persistant de construction et d’expérimentation entretenant des liens ténus avec le reste de la structure. Cet espace, libre des contraintes économiques et logistiques régissant habituellement l’édition traditionnelle, est un laboratoire dont les tentatives et recherches infusent dans nos autres projets éditoriaux. Cette édition en est l’un des témoignages.
Déjà publiés dans la collection
-
1# Vers un modèle rentable pour une maison d’édition autonome, Marc Fischer (trad. Ab’cassis), 2021
-
1.2# ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΤΗΡΟΎΜΕΝΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΕΚΔΌΣΕΩΝ, Marc Fischer (trad. Evdokia Noula), 2022
-
2# L’histoire de Semiotext(e), Sylvère Lotringer raconte ses rêves à Chris Kraus, Chris Kraus & Sylvère Lotringer (trad. Mathilde Koivisto), 2022
-
3# filouteries, romain pereira, 2022
-
4# Équilibrer la balance, Felipe Ehrenberg et la pédagogie de la coopération, Nicolás Pradilla (trad. Eli Abenhag), 2022
-
5# Quels problèmes les artistes éditeurices peuvent-iels résoudre ?, Josh MacPhee, Eric Von Haynes, Tim Devin Journal of Aesthetics and Protes, Booklyn Press Press, Llano del Rio Collective Thick Press, Alex Arzt, AND Publishing, Jan Steinbach : Edition Taube, MATERIAL, antoine lefebvre editions, Simon Worthington Onomatopee, Hardworking Goodlooking, Nina Prader, Lady Liberty Press, Eleanor Vonne Brown (dir. Public collector library & Printroom, trad. Yann Trividic), 2022
-
6# La morale de la Xerox, Florian Cramer & Clara Lobregat Balaguer (trad. collective par Julien, Caroline D., Yaëlle, France, Patrice, Palmyre, Nathalie, Taton, Agathe, Signe, Laetitia, Mathilde, Richard, Lucie, Anne et Caroline R.), 2023
-
7# Au commencement – Vers une écologie du livre de papier, Lalie Thébault Maviel, 2025
Colophon
Traduction : Mio Koivisto.
Titre original : Hatred of Capitalism (introduction).
Publication originale en 2002 par Semiotext(e)., Los Angeles.
Paru dans la collection Positions d’éditeurices.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de L'histoire de Semiotext(e), Sylvère Lotringer raconte ses rêves à Chris Kraus, mise en page avec InDesign et imprimée en Risographie sur cyclus offset 170 g/m² par Burn~Août sur la risographie des Beaux-Arts de Paris (14, rue Bonaparte, Paris 75006), reliée en un pli, et distribuée par Paon Serendip est parue en mai 2022.
Cette version a été composée par Roméo Abergel en Arial Black et Suisse Work.
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc par Laura Amazo.