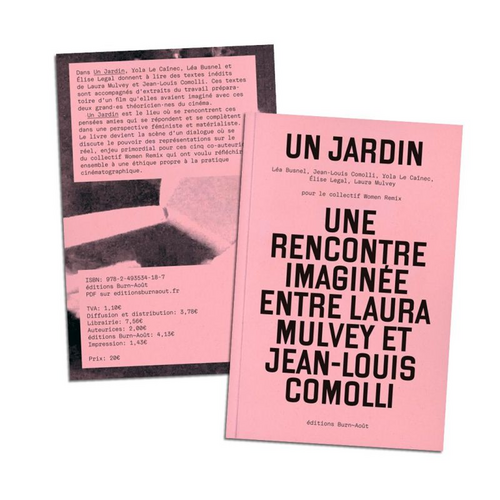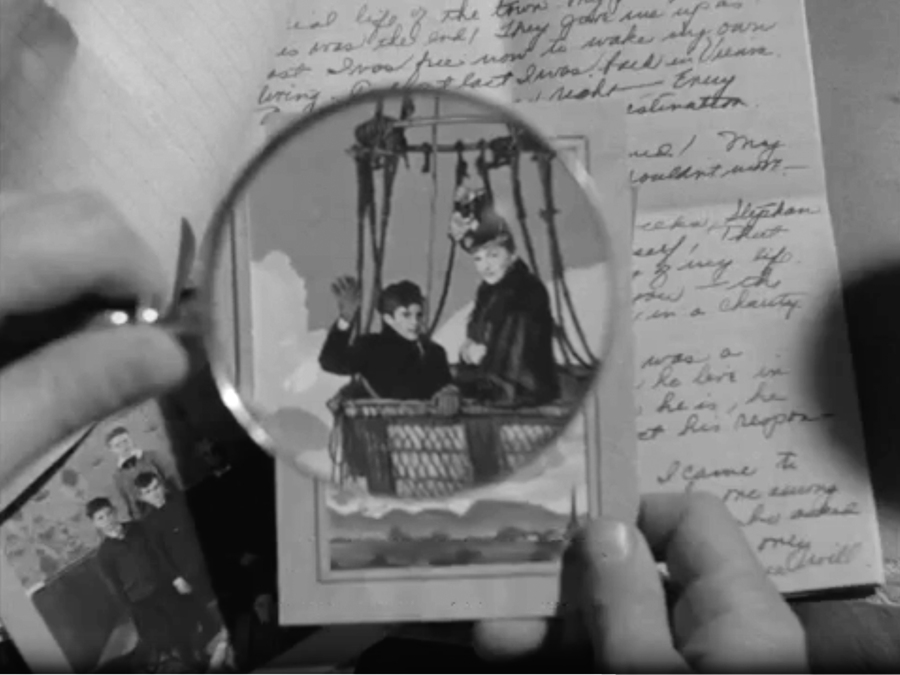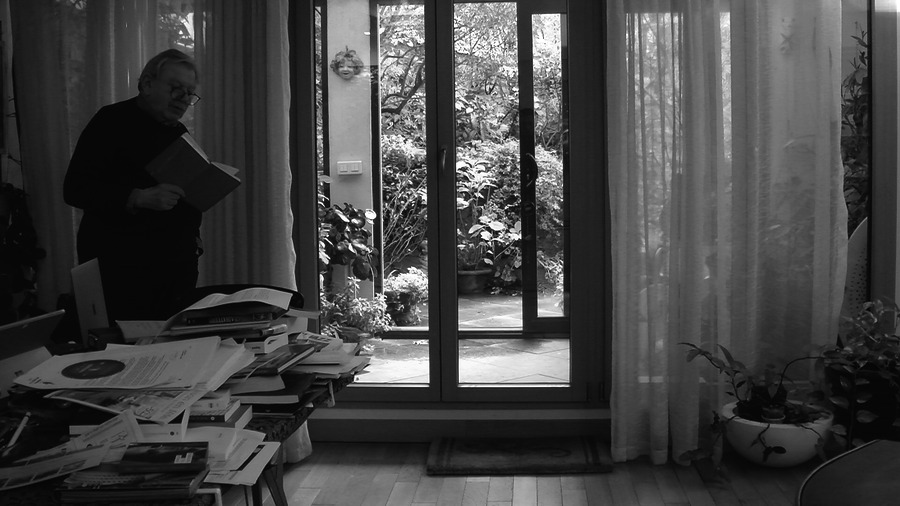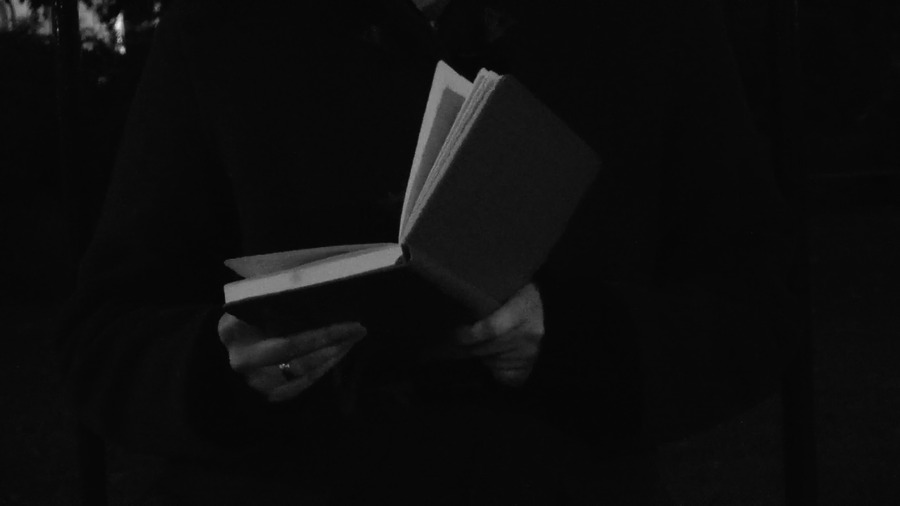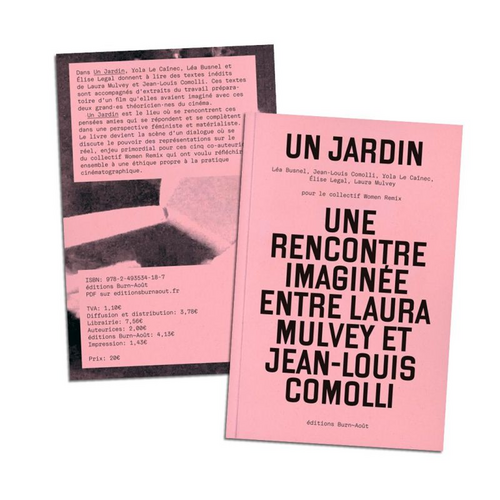
Table des matières
Un jardin, une rencontre imaginée entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli
Un jardin est un livre en trois parties, qui mêle images, textes et documents d’archives autour des pensées des cinéastes et théoriciens Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. La première et la troisième partie sont des textes inédits du collectif Women Remix (Yola Le Caïnec, Léa Busnel, Élise Legal) tandis que la partie centrale réunit des textes de Laura Mulvey inédits en français (trad. Women Remix) et des textes de Jean-Louis Comolli publiés pour la première fois dans un livre. Ce livre est l’endroit d’une rencontre inédite entre des figures majeures de la pensée critique du cinéma.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 22/01/26 à 10 h 25.
Note sur la graphie des genres
Dans les textes et notes écrites par Élise Legal, Léa Busnel et Yola Le Caïnec, le point médian est utilisé pour les noms, adjectifs et participes passés dont les formes féminines et masculines ne diffèrent que par la présence ou l’absence d’un -e final (par exemple: les habitant·es sont parti·es); la contraction est utilisée pour les noms et adjectifs ayant des suffixes différents au masculin et au féminin (par exemple: auteurice, acteurice); la troisième personne du pluriel est écrite « iels » lorsqu’elle fait référence à un groupe de personnes ou d’objets dont les genres diffèrent entre les sujets qui le composent.
Pour la traduction des textes de Laura Mulvey, la question de la graphie des genres s’est posée, non pas au moment de les traduire de l’anglais au français mais pour la présente édition. Si les traducteurices ont décidé de garder la forme qu’iels avaient choisie au moment de la traduction, c’est qu’il leur semblait que l’expression pluralisée transparaissait au sein de l’argumentation mulveyienne élaborée poétiquement au début des années 2000, dans une pensée inclusive sans l’usage de sa formalisation au niveau de l’écriture.
Préface
Yola, Élise, Léa arrivent à l’arrêt de bus d’un pas rapide. Élise et Léa ont chacune une valise. Il pleut et d’autres personnes viennent se regrouper sous l’abribus pour attendre le bus ou la fin de la pluie. Certaines portent des écouteurs, d’autres entendent en arrière-plan la conversation en cours menée par les trois protagonistes.
Pour une oreille attentive, des personnages se dessinent depuis la discussion: premier personnage, un certain Jean-Louis Comolli, avec lequel les trois amies viennent d’avoir une conversation téléphonique et à qui elles ont partagé une envie de réalisation d’un film avec lui et — deuxième personnage — Laura Mulvey, cinéaste et théoricienne britannique.
La curiosité a piqué l’un·e des patient·es usager·es des bus rennais, qui entame discrètement une recherche internet sur son téléphone. Elle tape d’abord « Laura Mulvey » et jette un coup d’œil rapide à sa page WikipédiaLaura Mulvey, née le 15 août 1941 en Angleterre, est une critique de cinéma, réalisatrice et une féministe britannique. Elle interroge la notion de genre dans les productions audiovisuelles. Elle est notamment à l’origine du concept de male gaze (regard masculin)., avant de googler à son tour Jean-Louis ComolliJean-Louis Comolli, né le 30 juillet 1941 à Philippeville (aujourd’hui Skikda, Algérie) est un réalisateur, scénariste et écrivain français..
Le bus arrive, Yola, Élise et Léa montent dedans, et s’installent sur les sièges à l’avant du véhicule, en continuant leur conversation. Elle s’interrompent un instant pour parler de l’heure affichée sur l’écran STAR (qui rappelle de composter son ticket car des contrôleurs sont présents à bord des bus), car le temps a filé et les trains vont peut-être être manqués si la circulation n’est pas à leur avantage. Dehors, il pleut des cordes.
L’air de rien, l’oreille curieuse qui s’était renseignée sur les protagonistes s’installe sur un siège de la rangée opposée, et se glisse à nouveau dans la discussion. Élise, Yola et Léa ne se rendent pas compte qu’elles sont écoutées, ou bien cela leur est égal, elles ont l’air de toute façon préoccupées par l’appel qu’elles viennent d’avoir. L’oreille attentive comprend que la discussion a dérivé sur un projet de film de ce fameux Jean-Louis, un projet de film sur Louise Michel, ce qui a éveillé une certaine perplexité chez ses interlocutrices.
YOLA : C’est tout de même étrange, nous proposons à Jean-Louis ce projet de film avec Laura, et il nous amène sur Louise Michel. Qu’est-ce qu’il faut en comprendre?
ÉLISE : Est-ce qu’il veut nous faire passer un message? Est-ce une manière délicate de nous dire qu’il ne veut pas faire le film avec nous? Ou bien veut-il l’emmener ailleurs?
YOLA : Il dit que ça fait des années qu’il veut faire un film sur Louise Michel, que parmi les femmes qu’il a filmées dans ses films, il a toujours cherché Louise…
LÉA : Peut-être que notre projet lui évoque sa propre recherche. Il y a peut-être des liens à trouver entre Laura et Louise.
YOLA : Entre Jean-Louis et Laura aussi il y a beaucoup de liens… Pour moi ce sont des jumelleaux, iels sont né·es à quinze jours d’intervalle en plein été 1941. Leurs pensées se répondent d’un côté à l’autre de la Manche.
ÉLISE : Louise Michel a vécu à Paris comme Jean-Louis, et à Londres comme Laura, quelque part elle les réunit, comme une sorte d’interprète.
À ce moment-là l’oreille attentive sursaute, car Yola se met à parler assez fort et d’une voix excitée:
De là, Yola ne s’arrête plus, elle regarde des images de Louise Michel sur son téléphone, et trouve une ressemblance fortuite entre Louise et Laura, ou bien, à bien y regarder, en plus de rimer, entre Louise et Élise… Peut-être Élise pourrait-elle incarner Louise dans le film?
LÉA : Tout cela devient bien étrange. Louise et Laura pourraient représenter dans l’esprit de Jean-Louis la même personne, ou incarner la même idée? Cela fait beaucoup de jumelleaux, moi j’ai longtemps pensé que Jean-Louis n’existait pas et que c’était un avatar que tu t’étais créé, Yola.
ÉLISE : So Louise Michel is Laura Mulvey and Jean-Louise Michel-Comolli is Yola… Et la boucle est bouclée.
Le bus arrive à la gare. Les passagères en sortent, rapidement, tirant précipitamment leurs valises, Léa part à Marseille, Élise à Paris, Yola reste à Rennes. Elles s’embrassent et se quittent en se promettant de prolonger leur discussion au plus vite.
L’oreille curieuse et attentive reprend elle aussi son chemin en se demandant si elle entendra un jour, à nouveau, parler de cette drôle d’histoire.
Ce livre est un film, Women Remix, qui n’a pas eu lieu. Il est la retranscription d’une mise en scène avortée, qui espérait la rencontre entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. Traversé par des enjeux de traduction d’une langue à une autre — de l’anglais au français (et vice-versa) — il cherche à lier deux pensées de cinéma. À l’image du montage cinématographique, ces documents textuels sont assemblés dans un livre pour faire exister le film d’une autre manière. Ils sont le résultat du travail préparatoire d’un film collectif qui se joue sur plusieurs années. Pour diverses raisons et ce malgré des images, des rushes, des rendez-vous et des discussions, le film n’a pas vu le jour. Lors de la préparation du film Women Remix qui demeure inachevé, un travail d’édition avait déjà débuté. Il prenait diverses formes: une traduction collective, un blog dédié au cinéma, un échange interposé de mails entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli, une sélection et découpe de textes de Louise Michel qui seraient lus par Laura Mulvey devant notre caméra, la rédaction d’un dossier de demande de subvention à l’attention de la Région Bretagne. C’est en Bretagne que nous nous sommes toutes trois rencontrées, là où Laura Mulvey avait l’habitude de passer ses vacances et là où s’est créé le blog Ces films à part qu’on nomme « documentaires », correspondance entre Jean-Louis Comolli et des étudiant·es en option Études cinématographiques à Rennes.
Nous présentons ces textes et échanges pour qu’une rencontre puisse apparaître malgré tout. Certains documents administratifs présentent le film en négatif, comme la trace de ce qu’il aurait pu être. Ils rendent visibles une forme d’échec matérialisée notamment par un refus de subvention qui a entravé notre projet cinématographique. Peut-être serviront-ils d’outils ou de repères pour celles et ceux qui cherchent à faire exister des films féministes. Ce livre met en scène le travail souterrain d’un film qui cherchait aussi à faire circuler des textes. Dans un même lieu, qu’il soit film, livre ou jardin, il propose la contiguïté entre deux œuvres qui ne s’étaient pas tout à fait rencontrées jusqu’alors.
Le montage de ce livre reprend le découpage en trois parties prévues pour le film Women Remix. Nous avons voulu présenter dans ce livre les choses temporellement. Nous avons transposé la chronologie du projet cinématographique, qui s’étend de 2014 à 2020, à celle de la pensée qui s’est acheminée de Laura Mulvey à Jean-Louis Comolli jusqu’à nous. La dernière partie du livre correspond à ce que nous avions écrit pour être la première partie du film.
Laura Mulvey a écrit en 2006, Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image. Nous la connaissions par son texte « Plaisir visuel et cinéma narratif » de 1975, traduit sur le site Débordements, puis édité par Mimésis. Le désir de traduire Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image est né après sa participation à un colloque où elle a expliqué son travail d’analyse par le remontage de la séquence d’ouverture de Les hommes préfèrent les blondes (H. Hawks, 1953). Elle a appelé ce travail d’analyse le Monroe Remix, ce qui a inspiré le titre Women Remix. Ce remontage est au centre des trois derniers chapitres de Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image consacrés au « Delaying Cinema », au « spectateur possessif » et au « spectateur pensif ». Ces trois concepts mulveyiens nous ont tout de suite fait penser aux théories comolliennes, et aux images de son film avec Sylvie Lindeperg, Face aux fantômes en 2009. On a commencé à traduire entre nous des passages pour Jean-Louis, puis, durant le confinement, une traduction collective a été engagée avec les étudiant·es de l’option cinéma du lycée Chateaubriand, pour être placée ensuite sur un blog, afin que Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey puissent communiquer à distance entre elleux et avec les traducteurices. C’est cette traduction qui est présentée dans cet ouvrage en première partie.
Le blog Ces films à part qu’on nomme « documentaires » a accueilli temporairement la traduction. Il a été créé en 2012 après une première rencontre entre Jean-Louis Comolli et les étudiant·es de Yola Le Caïnec, qui venait d’ouvrir une option Études cinématographiques à Rennes, option où se sont d’ailleurs rencontrées Léa Busnel et Élise Legal. Le blog était une façon de garder du lien, de créer des liens, autour du cinéma soi-disant nommé « documentaire ». « Espace de jeu où l’on prend le jeu au sérieux, ce qui veut dire qu’on joue vraiment, qu’on s’expose, qu’on prend parti publiquement », a commenté Jean-Louis Comolli quand il a lu la présentation rédigée par les jeunes. Le blog n’a pas attendu longtemps pour publier le premier texte de Jean-Louis Comolli, qui voulait s’adresser aux étudiant·es, et les inviter à poursuivre le travail d’analyse critique des épisodes de l’émission Strip-Tease. Pas une année, ensuite, jusqu’en 2021 quand la maladie de notre ami Jean-Louis s’est faite plus coriace, sans voir fleurir de nouveaux écrits, de nouveaux défis ou découvertes critiques, partagés par les étudiant·es et Jean-Louis Comolli qui invitait aussi parfois ses ami·es, mort·es ou vivant·es, à se joindre à nous. Ce blog continue à vivre aujourd’hui et nous l’y convions à notre tour. Ce sont quelques textes inédits de Jean-Louis Comolli publiés sur ce blog que nous avons choisis pour la deuxième partie de cet ouvrage, afin qu’ils rencontrent a posteriori la pensée de Laura Mulvey, pensée que Jean-Louis Comolli avait intégrée dans son champ citationnel dès 2019, avec Cinéma, Numérique, Survie.
Le film que nous avions rêvé aussi avec lui au sein du collectif Women Remix, lui ressemble un peu. Le scénario commençait avec Jean-Louis et Laura, deux personnages qui devisaient ensemble dans un jardin autour du cinéma, du monde et de Louise Michel. Iels devisaient dans les pensées de la réalité documentaire et sociale qu’iels incarnaient, à savoir celles de Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli. Le jardin accueillait leur gémellité symbolique comme une grâce. C’était le jardin de Jean-Louis, et Laura venait lui rendre visite d’Angleterre, il était aussi question d’aller à Londres. Mais la maladie de Jean-Louis Comolli a vite transformé l’idée du voyage en idée d’échange épistolaire, de lettres filmées, mais pas seulement. L’écriture de cette première partie, intitulée « Un Jardin », s’est faite avec leurs deux voix qui se répondaient par mél, ou qui prolongeaient des échanges que nous avions eus avec elleux, de façon individuelle. Une version finale initiale a abouti début 2019, puis a été développée au printemps 2020 à la demande de la Région Bretagne. Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey avaient accepté d’être co-auteurices pour la partie qui les concernait uniquement. À l’automne 2019, iels ont accepté de commencer les premiers tournages de répétitions et de repérages. Laura était à Paris, mais Jean-Louis, souffrant, dut repousser la rencontre. Nous avons fait le lien entre elle et lui avec la caméra. Le montage s’est fait en 2020, iels ont aimé, et nous avons déposé à nouveau le dossier en juin avec Les Films du Plessis et Sonia Buchman de Gladys Glover Productions, peu après le confinement. La solution d’un film à distance devenait peu à peu évidente et fut confirmée par l’impossibilité, à défaut de subventions, de financer des déplacements. La rencontre entre Jean-Louis et Laura ne serait pas physique, mais pouvait être imaginée différemment. C’est aussi notre réponse, par ce livre, au cancer qui a emporté notre ami en 2022.
Laura Mulvey
Présentation
Les trois derniers chapitres de Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image publié en 2006 forment une trilogie autour de ce que Laura Mulvey appelle le « delayed cinema ».
Le premier volet, intitulé « Delaying Cinema », embraye l’argument de l’étude précédente sur Abbas Kiarostami pour introduire le « delayed cinema », ou « cinéma ralenti ». Un tel cinéma est défini comme se manifestant dans un registre plutôt narratif où « le ralenti est essentiel pour désirer la fin »Laura Mulvey, Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image, Reaktion Books, London, 2006, p.144., écrit Mulvey. Selon la théoricienne, le ralenti ouvre un champ d’analyse pour les études cinématographiques; il correspond par exemple à l’esthétique développée par le star-système hollywoodien. Conçu comme une modification formelle de la narration pour que l’idole puisse être contemplée, il déplie une visibilité de la mécanique du désir dans sa suspension en révélant à l’image ses combinatoires de mise en scène invisible où tout devient possible. Le ralenti permet par exemple de considérer une scène dans sa spécificité relativement à la globalité du film. « Le flux d’une scène est arrêté et extrait du flux global du développement narratif; la scène est morcelée en plans puis en cadres sélectionnés et ensuite soumise au ralenti, à la répétition et au retour en arrière. »Ibid., p.144. La proposition de Mulvey, à l’ouverture de ce premier chapitre de la trilogie, est que ce ralentissement va aussi, justement, (re)construire une conscience spectatorielle.
Si nous avons choisi de traduire seulement les deux derniers chapitres, « Le spectateur possessif » et « Le spectateur pensif », c’est parce qu’ils placent dans une perspective dialectique deux enjeux majeurs du « delayed cinema » face à « l’avènement du visionnage digital ou électronique »Ibid., p.161. qui est aussi au centre de la pensée comollienne. Le premier enjeu serait d’approfondir la déconstruction du désir et du plaisir au cinéma dans la continuité de l’essai « Plaisir visuel et cinéma narratif » (Laura Mulvey, 1975), et le second de faire émerger la possibilité d’un·e spectateurice alternatif·ve, curieux·se, pensif·ve, qui réfléchit l’image en lieu d’un spectateur possessif qui ne vise que sa fétichisation.
La traduction proposée est issue d’un travail solidaire pendant le confinement en 2020. Lisa Adams-Aumeregie, Ambre Argney, Léa Busnel, Jeanne Danigo, Louis Dumont, Eva-Rose Duvivier, Amalia Fernandez, Lucy Frémont, Mathilde Gaudfroy, Enora Gourmelon, Elias Hérody, Malou Lebellour-Chatellier, Damien Ledélézir, Élise Legal, Louise Pichon, Anaëlle Previtali, Héloïse Rannou, Eva Ripoteau, Lucille Salaun, Emma Serrano: elles et ils, étudiant·es ou ayant étudié au lycée Chateaubriand, ont élaboré collectivement une traduction qui voulait favoriser la diffusion de textes de Laura Mulvey auprès du plus grand nombre. L’ensemble du travail a été plus particulièrement coordonné par Ambre Argney, puis la traduction a été harmonisée par Yola Le Caïnec ainsi que Léa Busnel et Élise Legal avec la complicité de Laura Mulvey. Aussi, quand nous indiquons les mots anglais originaux entre crochets, nous indiquons le fruit d’une réflexion collective autour des limites de la traduction.
La majorité des images qui accompagnent cette traduction ne proviennent pas de la version originale du texte. Nous les avons proposées pour éclairer certains aspects de la théorie de Laura Mulvey qui nous semblaient particulièrement intéressants en regard des articles de Comolli écrits de 2012 à 2021, postérieurs donc à ces deux chapitres écrits en 2006. L’aspect principal concerne la réforme spécifique des regards (regards situés dans ou devant l’écran, aux frontières de la fiction et du documentaire) à entreprendre face aux technologies du vingt et unième siècle, comme le numérique binaire et son industrie capitaliste, qui ont eu cette tendance, très astucieuse, à masquer une partie de ce que nos regards avaient déjà acquis de conscience transsubstantielle à partir du cinéma celluloïdal.
Le spectateur possessif
Puisque l’expérience cinématographique est si éphémère, il a toujours été difficile de retenir ses précieux moments, ses images et plus particulièrement, ses idoles. Pour pallier à ce problème, l’industrie du film a produit, depuis les débuts du star-système, une panoplie d’images fixes capables de suppléer au film lui-même: des photographies de tournage, des affiches et surtout des pin-ups. Toutes ces images secondaires sont créées afin de donner aux fans du film une illusion de possession, de créer un lien entre le spectacle inaccessible [irretrievable] et l’imagination individuelle. Sans cela, le désir de posséder et de retenir l’image éphémère conduit à un visionnage multiple, à retourner au cinéma voir le même film encore et encore, ce qui fait écho à l’analyse de Freud sur le plaisir enfantin de répétition, par exemple concernant les jeux ou les histoires. Avec l’avènement du visionnage digital ou électronique, la nature de la compulsion de répétition cinématique change. Comme le film est ralenti et ainsi fragmenté, passant d’une narration linéaire à des moments ou des scènes favorites, le spectateur est capable de retenir, de posséder l’image auparavant insaisissable. À travers ce cinéma ralenti, le spectateur obtient une relation renforcée avec le corps humain, en particulier avec celui de la star. Arrêter le cours du film permet d’extraire facilement des images de stars de leur contexte narratif pour une sorte de contemplation prolongée qui était auparavant seulement possible avec les photogrammes. D’un point de vue théorique, cette nouvelle immobilité exacerbe le statut emblématique de la star.
L’image d’une star est, en premier lieu, un signe indiciel comme toute autre image photographique, et un signe iconique comme toute autre image représentative; c’est aussi une icône complexe à l’existence ambivalente, à la fois au sein et en dehors de la performance fictionnelle. Le terme d’« icône », dans cette situation, va au-delà du signe de similitude dans la sémiologie de C.S. PeirceNDT. Charles Sanders Peirce a classifié en 1903, dans Éléments de logique, la relation d’un signe avec l’Objet qu’il dénote selon trois modalités contenues dans les notions d’Icône, d’Indice et de Symbole. Laura Mulvey définit les notions dans la continuité de son texte., c’est-à-dire qu’il va vers la signification iconographique accrue et l’iconophilie fondamentale qui définissent la façon dont Hollywood, et les autres cinémas de masse, ont travaillé à produire des images de star. Le cinéma exploite la silhouette humaine dans les mondes imaginaires de la fiction, mais l’industrie cinématographique a été encore plus loin, en rattachant ses fictions à un star-système. Créer une star signifie créer un nom, parfois en utilisant un nom de scène dont le film A Star Is Born (George Cukor, 1954) propose une caricature; en tout cas, un nom qui peut toujours être reconnu ou cité. La capacité de la star à être nommée introduit la troisième dimension de la trichotomie des signes de Peirce, la dimension symbolique. Le symbole dépend de l’esprit humain pour être interprété, qui dépend lui-même de ses connaissances culturelles préexistantes et imposées, de telle sorte que la capacité de reconnaissance immédiate de Amitabh Bachchan et de Sean Connery, par exemple, ou de Ingrid Bergman et de Nargis, varierait nécessairement selon la culture cinématographique générale du spectateur. En ce sens, la star est reconnue et nommée au sein de la diffusion de son fandom, ainsi qu’un saint chrétien serait reconnu et nommé au sein de la diffusion de l’art chrétien.
Lorsqu’une industrie cinématographique rationalise son star-système, les acteurs iconiques de cinéma immédiatement reconnaissables produisent une performance très stylisée, mise en évidence par un cinéma également stylisé qui se concentre sur les stars. La performance d’une star est, peut-être pas de manière inévitable mais très souvent, la source du mouvement de l’écran sur laquelle l’œil du spectateur se concentre, canalisant le développement de l’histoire et offrant son énergie latente. Mais le véritable exploit de la performance d’une star consiste en sa capacité à maintenir en équilibre deux éléments fondamentalement contradictoires: la fusion de l’énergie et de l’immobilité à l’écran. Bien que le mouvement d’une star puisse paraître énergétique, ce qui le sous-tend est en réalité une immobilité intensément contrôlée et une capacité à poser pour la caméra. Réminiscence, de manière figurative, de la façon dont l’illusion du mouvement dérive de multiples images immobiles, de même la performance d’une star dépend de poses, de moments d’immobilité presque invisibles, lors desquels le corps est exposé pour le plaisir visuel du spectateur, à travers la médiation de la caméra. Dans le film What Price Hollywood? (George Cukor, 1932), Constance Bennett, en tant qu’actrice ambitieuse, démontre le processus de l’apprentissage de « l’immobilité » à l’écran. Après qu’elle ne réussit pas son premier essai à l’écran à cause d’une performance trop empressée, précipitée, elle intériorise progressivement les instructions du réalisateur et, dans les escaliers de sa pension, elle s’entraîne à marcher doucement, presque au ralenti, avec précision de haut en bas des marches pour finir par une pose et une réplique accomplie de nonchalance. Les performances féminines à l’écran ont toujours inclus assez ouvertement cette sorte de jeu exhibitionniste. Mais, concernant la star masculine, le cinéma ralenti révèle que l’immobilité et la pose pourraient être davantage dissimulées, tout en restant pourtant un attribut essentiel de son jeu à l’écran.
La préférence de Roland Barthes pour la photographie par rapport au cinéma inclut un plaisir esthétique de la pose:
« La pose est ce qui se rapproche le plus de la nature de la Photographie… lorsque je regarde une photographie, j’inclus inévitablement dans mes considérations la pensée de cet instant, pourtant bref, dans lequel une chose réelle s’est retrouvée immobile face au regard. Je projette l’immobilité de cette même photographie sur la prise précédente, et la pose consiste dans cet arrêt. Cela explique pourquoi le noème de la Photographie se détériore quand cette photographie est animée et devient cinéma: dans la Photographie, quelque chose a pris la pose en face de la petite ouverture et est resté là pour toujours… mais dans le cinéma, quelque chose est passé devant cette même petite ouverture: la pose est balayée et niée par la série continue d’images. »Roland Barthes, Camera Lucida (trad. Richard Howard), Vintage Classics, London, 1993, p.78 (ouvrage original publié en français en 1980).
Le cinéma ralenti révèle le sens de la pose même quand le « quelque chose est passé ». La fixation du cadre, l’arrêt sur image, font apparaître le moment d’immobilité qui est le propre du cadre et rendent possible une contemplation qui ramène l’image au bref instant de l’enregistrement de la « chose réelle ». Comme le dispositif affirme sa présence et l’indexicalité originale de ses images, la pose n’est alors plus « balayée et niée », mais il se pourrait plutôt qu’elle soit mise en valeur par la performance de la célébrité. La pose donne le temps au cinéma de dénaturer le corps humain. Bien qu’elle continue d’être « la chose réelle », la figure iconique de la star est toujours exposée aux regards, véhiculant les attributs esthétiques du cinéma, point de convergence entre lumière et ombre, cadrage et mouvement de caméra. Le gros plan a toujours entraîné un processus de retardement, en ralentissant le cinéma dans la contemplation du visage humain, permettant un moment de possession pendant lequel l’image est extraite, quelle que soit la rationalisation narrative, du fil d’un récit. En outre, le gros plan limite le mouvement, non seulement à cause du resserrement du cadre mais aussi à cause de l’éclairage privilégié avec lequel le visage de la star est communément mis en valeur. Mary Ann Doane a montré que le gros plan est un motif essentiel de la photogénie, la contemplation esthétique du cinéma dans toute son unicité, et que le goût pour les gros plans est caractérisé traditionnellement par un rejet de la structure diachronique propre au narratif au profit du moment synchronique lui-même. Le gros plan est ainsi identifié:
« […] comme une stasis, une résistance à la linéarité narrative, comme une passerelle verticale vers une profondeur presque irrémédiable derrière les images. Le discours semble illustrer un désir d’arrêter le film, de saisir quelque chose qui peut être emporté au loin, de transférer la temporalité implacable du déroulement narratif à une temporalité plus maîtrisable de contemplation. »Mary Ann Doane, « The Close-Up: Scale and Detail in the Cinema », dans Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, XIV/3, 2003, p.97.
L’apothéose visuelle de la star n’est pas plus matérielle que la lumière et l’ombre qui la mettent en valeur de telle sorte que la figure humaine [human figure] considérée comme un fétiche fusionne avec le cinéma, identifié lui aussi à un fétiche, fusion du fétichisme et de l’esthétique qui caractérise la photogénie. Ici, la qualité symbolique de l’esthétique cinématographique, et même « la temporalité plus maîtrisable de contemplation » mènent à son ombre éternelle et inévitable, la psychodynamique du plaisir visuel. La signification extraordinaire de la figure humaine au cinéma, la star, sa sexualité iconique, fait émerger la question des modalités de la reconfiguration du désir et du plaisir au sein du cinéma ralenti, comme l’absence de mouvement à la fois à l’intérieur de l’image animée et à l’intérieur de la transformation d’une relation de pouvoir du spectateur.
Dans « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. 1975., j’ai démontré que le cinéma, considéré comme le moyen du spectacle, codait la différence sexuelle selon le regard, tout en créant une esthétique d’extrême anthropocentrisme, de fascination pour le visage et le corps humain. Ce code était particulièrement visible dans les films hollywoodiens, si profondément investis dans ce culte de la star. J’ai également avancé que la star féminine était pensée comme un spectacle érotique là où la star masculine, dont les attributs sont la puissance et le dynamisme, compensait sa propre représentation en tant qu’objet potentiellement passif du regard spectatoriel. Cette passivité de la figure féminine, et ce rôle de conduite du récit donné à la figure masculine, étaient en conflit et se voyaient difficiles à réconcilier. En tant qu’image spectaculaire la star féminine tend, en effet, à stopper la narration et à capturer le regard du spectateur à l’excès. « La présence d’une femme est un élément spectaculaire indispensable dans un film narratif normal, cependant leur présence visuelle tend à nuire au développement du scénario, à ralentir le flux de l’action dans des moments de contemplation érotique. »Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », dans Visual and Other Pleasures, London, 1989, p.19.
Regarder des films hollywoodiens ralentis renforce et contredit à la fois ces oppositions. Le cours de la narration tend en effet à se fragiliser si le spectateur peut en contrôler le flux, revenir à certaines séquences et les re-regarder, tout en en sautant d’autres. Le bon fonctionnement de la linéarité et la progression du récit sont éclatés ou accidentés, diminuant le contrôle du protagoniste masculin sur l’action. Le processus d’identification habituellement mis en place par la relation entre l’intrigue et les personnages, le suspense et la transcendance, perd son emprise sur le spectateur. De même la perte du moi et de la conscience de soi, qui a si longtemps été un des plaisirs que les films offraient, a cédé à un examen vigilant et un parcours de l’écran, en embuscade, pour ainsi dire, pour capturer un détail préféré, ou jusqu’à présent passé inaperçu. Avec la minimisation de la narration et de ses effets, l’esthétique des films tend à devenir « féminisée » avec le déplacement des relations de pouvoir spectatorielles, demeurant désormais dans la pose, l’immobilité, l’éclairage et la chorégraphie du personnage et de la caméra. Ou plutôt, pour parler dans les termes du modèle donné par « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. « Visual pleasure and narrative cinema », dans Screen n° 16, 1975., le plaisir esthétique du cinéma ralenti se déplace vers la fétichisation scopophileNDT. Du simple « plaisir de regarder », la Schaulust freudienne, la scopophilie peut mener jusqu’à la pulsion scopique, qui nomme l’investissement libidinal dans l’acte de regarder un film, le plaisir d’utiliser une autre personne comme objet de stimulation sexuelle par la vision. John Frow, « Le lieu sémiotique du spectateur dans le discours de l’amour contemporain », dans Le Récit amoureux (colloque « Raisons du cœur, raison du récit » au Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, 12—22 juillet 1982), dir. Didier Coste et Michel Zéraffa, Champ Vallon, coll. « L’Or d’Atalante », 1984, p.315. qui, comme je l’ai suggéré, caractérise, par exemple, les films de Josef von Sternberg. Ses films, et plus particulièrement le cycle DietrichNDT. Marlene Dietrich (1901—1992) est une actrice allemande et américaine. Elle a tourné sept films avec Josef von Sternberg entre 1930 et 1935., élève le regard du spectateur par-delà le protagoniste masculin et privilégie la beauté de l’écran et le mystère de la situation au suspense, au conflit péripétiel, ou même au développement linéaire. Le « spectateur fétichiste », plus fasciné par les images que par l’intrigue, retourne compulsivement sur les moments qu’il préfère, investissant émotion et « plaisir visuel » dans le plus léger mouvement, regard ou dialogue spécifique se produisant à l’écran. Avant tout, alors que ces moments privilégiés sont arrêtés ou répétés, le cinéma lui-même leur donne une nouvelle visibilité qui les rend spéciaux, éloquents et agréables, associant encore une fois photogénie et fétichisme.
Dans cette reconfiguration du « spectateur fétichiste », la figure masculine est soustraite à la maîtrise de l’action et se fond dans l’image. Par là même, elle aussi immobilise plutôt que conduit la narration, devenant inévitablement un objet manifeste du regard spectatoriel, ce contre quoi cette figure avait été jusqu’à présent défendue. Dépouillée de son pouvoir de mise en relation entre mouvement, action et dynamique de l’intrigue, duquel dépend toute la culture cinématographique catégorisée par Gilles Deleuze comme « l’image-action »NDT. Gilles Deleuze, L’Image-mouvement, Les Éditions de Minuit, Paris, 1983., la star hollywoodienne masculine est dévoilée au regard spectatoriel qui se « féminise ». Tandis que la masculinité d’un film se risque à l’effet castrateur de la fragmentation et du ralenti, cette forme de regard spectatoriel peut œuvrer de façon perverse contre le grain du film, mais peut également fonctionner comme un processus de découverte, une forme fétichiste d’analyse textuelle. Quand les fragments de la fiction et ses personnages deviennent immobiles, en poses suspendues auxquelles le mouvement peut être rétabli, alors le rythme du film change. Les lois supposées de répartition homogène et linéaire des causes et des conséquences ne sont qu’une esthétique mineure comparée à un autre rythme filmique, davantage tableau-orientated. Howard Hawks remarquait qu’un réalisateur tend à se concentrer sur le drame et le spectacle au sein de scènes privilégiées afin que la fragmentation de la continuité narrative devienne la découverte d’un motif alors brouillé derrière l’identification, l’action ou le suspense. Mais le corps humain est essentiel au « spectateur fétichiste ». La performance et la précision du geste l’emportent en importance sur leur rôle, et ce pas seulement pour les grandes stars, mais aussi pour les acteurs des rôles secondaires. Le mouvement qui semble naturel, même s’il est chaotique, à la vitesse normale d’un film, se révèle être aussi minutieusement chorégraphié qu’un ballet et tout aussi ponctué par (l’art de) la pose.
Dans son essai vidéo Negative SpaceNDT. Le film est de 1999, il emprunte son titre à un livre de Manny Farber édité en 1971, et publié en français: Espace négatif, P.O.L, Paris, 2004., Chris Petit commente la capacité intrinsèque du cinéma hollywoodien, à son apogée, à produire une sorte de cinéma « silencieux », un système créateur de sens et d’émotion étranger au langage lui-même. Il y a, dit-il, « des moments définis qui restent dans l’esprit longtemps après que le reste du film a été oublié ». Il s’appuie particulièrement sur le geste et la posture de Robert Mitchum dans La Griffe du passé (Jacques Tourneur, 1947), illustrant la façon dont sa silhouette est mise en valeur par l’éclairage et l’ombre du film noir. Dans Ça commence à Vera Cruz (Don Siegel, 1949), la première apparition de Mitchum illustre à la fois l’importance du moment de pause pendant lequel la star est introduite à la caméra et l’importance de « masculiniser » ce moment. William Bendix mène le film par sa séquence d’ouverture, durant laquelle il marque occasionnellement des pauses, fortement éclairé de profil afin que son image de « gros dur » soit réfléchie dans son ombre. Alors que ce dernier enfonce la porte de la cabine de Mitchum, la star opère une rotation pour faire face à la caméra, figé dans un moment prolongé de choc, et reflété dans un miroir à l’arrière-plan. C’est le moment de la star exposée, exhibitionniste. Mais le risque de féminiser la star masculine comme spectacle est neutralisé par la violence, par le revolver dans la main de Bendix et son agression. Pendant le film, cependant, des plans de Mitchum reviennent dans lesquels ses mouvements sont arrêtés de façon similaire, ouvertement pour des buts narratifs mais produisant aussi une pause caractéristique pour la caméra. Comme des objets trouvésNDT. En français dans le texte. intimes, de telles scènes peuvent être jouées et rejouées, au seuil entre cinéphilie et fantasme. Mais dans le processus d’immobiliser une figure favorite, la transformant en une pin-up et ensuite la réanimant en la ramenant au mouvement, le spectateur pourrait bien trouver, comme dans le cas de Ça commence à Vera Cruz que le rythme est déjà inscrit dans le style du film lui-même.
Le spectateur fétichiste contrôle l’image pour dissoudre le voyeurisme et reconfigurer la relation de pouvoir entre spectateur, caméra et écran, et aussi entre masculin et féminin. La question qui est alors soulevée est: est-ce que ces nouvelles pratiques spectatorielles ont effectivement effacé la difficulté de différence sexuelle et la représentation du genre dans le cinéma hollywoodien? Quel pourrait être l’investissement inconscient dans le contrôle nouvellement acquis du spectateur sur l’image cinématique? Dans « Plaisir visuel et cinéma narratif »NDT. Laura Mulvey, op. cit., je suggérais que le voyeurisme, en tant que pulsion active, trouvait son pendant narratif dans le sadisme. « Le sadisme exige une histoire, il dépend de sa capacité à faire advenir quelque chose, à induire un changement chez une personne, une bataille entre force et volonté, entre victoire et défaite, tous ces éléments suivant un schéma linéaire incluant un début et une fin. »NDT. Nous vous renvoyons également à la traduction de Florent Lahache et Marlène Monteiro, Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel, Éditions Mimésis, 2017, p.45. Cette prémisse a été directement tirée de l’équation freudienne entre la pulsion masculine active, et son opposé, celle, passive, de la femme. Même si dans sa théorie, il était central que les deux pulsions soient réversibles, le cinéma hollywoodien, tel que je l’ai compris, a en grande partie gravé de façon littérale cette opposition binaire au sein des codes narratifs et visuels qui structuraient le plaisir visuel du spectateur.
Parmi toutes les critiques qu’a engendrées cette hypothèse, une correction importante a été apportée par des analyses cinématographiques visant l’audience féminine. Dans son étude sur Rudolph Valentino, Miriam Hansen analyse l’ambivalence de son personnage qui menaça la masculinité conventionnelle mais permit de gigantesques avantages commerciaux pour une industrie courtisant une large audience féminine. Valentino, tout comme les autres idoles du public féminin [matinée-idol-type stars] des années 1920, contrarie mon hypothèse de 1975 concernant la genrification du plaisir visuel. Hansen montre que, en tant que premier objet de spectacle pour l’audience féminine, le personnage de Valentino subit une « féminisation » systématique, néanmoins elle rectifie finalement l’irréfutable binarité de l’opposition freudienne entre passif et actif. Dans ce processus de révision, elle élabore le concept de « spectatorité » féminine qui est, dans un premier temps, exclusivement réservé à l’anomalie Valentino, mais projette à terme une lumière théorique sur les plaisirs visuels du cinéma ralenti. Elle commence par suggérer que la vision de la femme tire des avantages de son incomplétude, à la différence du « regard cyclopéen masculin, soumis à une discipline utilitaire »Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991, p.278.. De même:
« Au niveau de l’énonciation filmique, les connotations féminines de l’“appel-au-regard”NDT. Dans la traduction initiale (Mulvey, [1975] 1993), le « to-be-looked-at-ness » est traduit par le terme « le-fait-d’être-regardé ». Dans la traduction intégrale plus récente (Mulvey, [1975] 2012a et [1975] 2012b), le terme est plutôt traduit par « l’appel au regard ». Nous privilégions ici la seconde traduction puisqu’elle transmet de façon plus efficace la position érotisée de la femme qui n’est pas uniquement regardée, mais est également représentée pour être regardée. Louis-Paul Willis, « Laura Mulvey, quarante ans plus tard. Repenser le plaisir visuel dans la théorie féministe du cinéma », Génération(s) au féminin et nouvelles perspectives féministes, Codicile, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 2018, pp.57—86. de Valentino déstabilisent son regard [glance] dans son origine même, le rendent vulnérable aux tentations qui menacent la souveraineté du sujet mâle… L’appel érotique du regard [gaze] de Valentino, mis en scène dans sa réflexivité [look within the look], est un appel à la réciprocité et à l’ambivalence plutôt qu’à la maîtrise et à l’objectivation. »Miriam Hansen, op. cit., p.279.
Elle poursuit son analyse en montrant en différents points que les films de Valentino échouent à se conformer aux normes soit visuelles soit narratives de l’ancien Hollywood, tandis que la présence du fort regard féminin à l’intérieur de la diégèse accorde une légitimité à celui de la spectatrice. L’attention scopique inhabituelle investie dans la présence de cette vedette à la fois à l’écran et dans la vie est la source initiale de cette déstabilisation. En l’absence de tout suspense narratif, l’activité, les mouvements et les gestes physiques acquièrent une signification supplémentaire, et « la fermeture à l’iris tend à résider dans les unités plus petites, coupant à travers plusieurs registres visuels et narratifs ». Pour finir, Hansen souligne les thèmes sado-masochistes associés à Valentino, l’« interchangeabilité des positions sadiques et masochistes à l’intérieur de la diégèse… La vulnérabilité que Valentino montre dans ses films, les traces de masochisme féminin dans sa persona », qui indiquent une déviance du contrôle du plaisir et la maîtrise sexuelle du sujet masculin.
L’analyse de Hansen préfigure, sur beaucoup de points, le mode spectatoriel du cinéma ralenti, l’affaiblissement de la narration, ainsi que le transfert de l’attention vers le détail et le geste, et pour finir l’importance de la présence d’une star pour une sensation d’oscillation entre l’indice et l’icône (cf. Peirce). La persona de Valentino, sa féminisation, son association avec les lesbiennes, sa possible homosexualité, le fait qu’il soit étranger, tout cela ajoute à l’incertitude des deux types de signes. En relation avec le sadisme et le masochisme, en revanche, peut-être l’image est-elle plutôt différente. Avec l’affaiblissement de l’identification du personnage, le contrôle par procuration sur le déroulement de l’intrigue est remplacé par une autre forme de pouvoir au fur et à mesure que le spectateur gagne le contrôle immédiat sur l’image. Déchue de son rôle de force conductrice du film, la star succombe à l’immobilité et à la répétition. Le désir de possession, réalisé auparavant seulement en dehors du film, à travers les photos et affiches, peut maintenant être accompli non seulement dans l’immobilité mais aussi dans la répétition des mouvements, des gestes, des regards, des actions. Dans le même processus, l’illusion de la vie, si essentielle à l’effet de réalité que produit le cinéma, s’affaiblit, et l’apparatus s’approprie les mouvements de la silhouette à mesure qu’ils sont répétés inévitablement avec une exactitude mécanique. La silhouette humaine devient une extension de la machine, invoquant le fantôme pré-cinématique de l’automate.
La fragmentation du flux narratif, la fétichisation de la silhouette humaine, la prépondérance recherchée de certaines séquences, toutes renvoient la question du sadisme au concept freudien de compulsion de répétition. De plus, l’économie psychique du sadisme change dans le contexte d’Au-delà du principe de plaisirNDT. Au-delà du principe de plaisir est publié en 1920. Son titre trouve un écho dans Au-delà du plaisir visuel: féminisme, énigmes, cinéphilie (Mimésis, 2017) où Laura Mulvey compile différents textes écrits entre 1975 et 2011. de Freud et de son concept de pulsion de mort. Son attention était initialement attirée sur la pulsion de mort par l’anomalie compulsive de répéter des expériences dénuées de plaisir, cela entre apparemment en contradiction avec la dominance du principe de plaisir dans la vie mentale. Freud a reconfiguré ses théories les plus anciennes sur l’instinct dans Au-delà du principe de plaisir, de manière à ce que les oppositions précédentes n’en fassent plus qu’une entre les instincts de vie et les instincts de mort. Dans un autre essai, il résume sa démarche:
« La libido a pour tâche de rendre l’instinct destructeur inoffensif, et elle accomplit cette tâche en le projetant largement vers l’extérieur. L’instinct est donc appelé un instinct destructeur, l’instinct de maîtrise, ou la volonté de pouvoir. Une part de l’instinct est mise directement au service de la fonction sexuelle, où elle a un grand rôle à jouer. C’est, à proprement parler, du sadisme. »Sigmund Freud, « The Economic Problem of Masochism », The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, James Strachey, London, 1953–74, vol. XIX, pp.159–70.
Le spectateur possessif commet un acte de violence envers la cohésion de l’histoire, l’intégrité esthétique qui maintient son unité et la vision de son créateur ou sa créatrice. Mais, plus précisément, l’instinct sadique s’exprime à travers le désir de maîtrise et la volonté de pouvoir du spectateur possessif. Dans l’inversion des rôles entre le regard du spectateur et le regard diégétique du protagoniste masculin, la figure, qui était toute-puissante, à la fois dans et hors de l’écran, est désormais subordonnée à la manipulation et à la possession. La performance filmique est modifiée par la répétition, et les actions commencent à ressembler à des gestes mécaniques, compulsifs. Les mécanismes du cinéma prennent possession de l’acteur ou de la star et, au fur et à mesure que leurs gestes précis et répétés deviennent ceux d’un automate, l’étrange fusion du cinéma entre les morts et les vivants se joint à l’étrange fusion entre l’organique et le non organique, le corps humain et la machine.
Martin Arnold, réalisateur expérimental viennois influencé par le travail de Peter Kubelka, remonte des fragments de films hollywoodiens, et ce faisant, transforme les mouvements des figures celluloïdales en gestes vides, dénués de commencement, de fin ou de but. Dans Pièce touchée (1989), il prolonge l’entrée d’un homme dans une pièce, dans laquelle une femme attend, en redoublant des photogrammes en séries, à l’effet semblable à celui des flicker filmsNDT. « Les cinéastes qui travaillent sur le flicker sont enchâssés dans un réseau d’histoires entrecoupées, et tissées par divers historiens aux partis pris affirmés. Il en ressort que le flicker n’est pas forcément un genre, mais aussi bien un procédé technique qu’un phénomène visuel exacerbé propre au dispositif cinématographique, ou même un fait visuel qu’on peut noter dans n’importe quel film. C’est un terme un peu fourre-tout, donc, que se sont appropriés les historiens en fonction de leurs découpages théoriques et de l’importance qu’ils accordent à tel ou tel cinéaste au sein de l’histoire du cinéma expérimental. » Fleur Chevalier, Cinéma argentique et « flicker »: le cas particulier des films dits d’avant-garde ou expérimentaux, C2RMF, 2011..
Alors que l’homme franchit la porte encore et encore, alors que la femme lève les yeux de son magazine, encore et encore, quelques secondes à l’écran sont étirées sur plusieurs minutes. En même temps, le rythme des gestes répétés commence à ressembler à des mouvements mécaniques. Ces expérimentations accentuent la vulnérabilité du vieux cinéma et de ses figures iconiques. Sujettes à la répétition, au point de devenir absurdes, ces dernières perdent la protection de leurs mondes fictionnels. De plus, les photogrammes répétés qui allongent chaque mouvement et chaque geste confirment la présence de la pellicule [filmstrip] où chaque photogramme individuel, successivement, s’étire à l’infini. La répétition et la variation des flicker films, comme dans les films de Peter Kubelka, n’ont aucune limite nécessaire mais évoluent autour d’un motif abstrait. Quand Arnold allie le temps distendu et la manipulation de la gestuelle humaine, il allie la référence à la bande de celluloïd à la présence de la machine du cinéma, à l’étrangeté de l’inorganique et de l’automate.
Il y a quelques années, j’ai remonté numériquement une séquence de 30 secondes de « Two Little Girls from Little Rock » (« Deux petites filles de Little Rock »), le numéro d’ouverture de Les hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953), pour analyser la précision des pas de danse de Marilyn Monroe, et pour en faire un hommage à la perfection de sa performance. En plus de la persona artificielle et stylisée, évoquant un bel automate, ses gestes sont orchestrés autour de moments au cours desquels elle pose. Sur ce fragment particulier de pellicule, joué pour la caméra, elle remonte la bretelle sur son épaule dans un jeu affecté proche de celui d’une fille légère en robe débraillée, ce qui rentre en complète contradiction avec la précision mécanique de ce geste et de tous les autres. La pleine conscience du geste est telle qu’il a, pour moi, quelque chose du punctum de Barthes, et je me suis retrouvée à revenir encore et encore sur ces quelques secondes du film. Dans le nouveau montage, j’ai répété le fragment trois fois, en faisant un arrêt sur image aux moments où Marilyn marque une pause entre ses mouvements. En plus de son propre jeu précis et contrôlé, la danse elle-même nécessite un contrôle du corps qui pousse son être naturel à ses limites, alternant aussi entre immobilité et mouvement. Le geste développé se déploie jusqu’à ce qu’il trouve un point de pose, tout comme le cinéma ralenti trouve des moments identiques à travers la répétition et le retour. La séquence de 30 secondes finit lorsque Marilyn s’avance en gros plan, rejetant la tête en arrière, adoptant la pose et l’expression de la photographie type de Marilyn en pin-up. Cette image arrêtée rappelle les Marilyns qu’Andy Warhol a réalisées après sa mort, dans l’hommage sérigraphique au masque mortuaire. La superposition imaginaire de l’image de Warhol sur la trace de la Marilyn vivante contient l’idée d’une signification différée, comme si sa mort était déjà préfigurée dans cette pose. Une conscience aigüe d’elle « alors », avant sa mort, se condense avec l’image comme masque mortuaire et la présence poignante de cet indice comme le « c’était maintenant ».
Le spectateur fétichiste, mu par un désir d’arrêter, de retenir et de répéter ces images iconiques, d’autant plus perfectionnées dans le cinéma hautement stylisé, peut soudainement, de façon inattendue, rencontrer l’indice. Le temps de la caméra, son temps embaumé, vient à la surface, basculant d’un récit du « maintenant » à l’« alors ». Le temps de la caméra apporte avec lui un « imaginaire » du tournage au sein de l’œil de l’esprit, l’espace hors-champ de l’équipe et du matériel, de sorte que le monde fictif se transforme en conscience de l’événement pro-filmique. Alors que la crédibilité fictive décline, que l’incrédulité n’est plus suspendue, la « réalité » envahit la scène, affectant la présence iconique de la star de cinéma. En raison du statut iconique de la star, il ou elle ne peut être greffé que tangentiellement sur un personnage fictif. Si le temps de l’indice déplace le temps de la fiction, l’image de la star bascule non seulement entre ces deux registres mais également pour inclure l’iconographie construite par le studio et toute autre information qui pourrait circuler sur sa vie. De ce genre de fusion et de confusion, les rumeurs et les scandales tirent leur fascination et tendent à s’attacher à l’iconographie extra-diégétique de la star. Même la performance la plus réussie est suivie, parfois dans un éclair inattendu, de cette présence extra-diégétique qui s’invite de l’extérieur de la scène et du hors-champ, donnant une vulnérabilité inattendue à la performance d’une star à l’écran.
Cette sorte de connaissance supplémentaire, combinée au temps qui passe, apporte le « frémissement à la catastrophe qui a déjà eu lieu » que Barthes mentionne à propos de Lewis Payne, le jeune homme photographié juste avant son exécution. « J’ai lu en même temps: cela sera et cela a été; j’observe avec horreur ce futur antérieur dont l’enjeu est la mort. » À regarder James Dean, Natalie Wood et Sal Mineo, les trois adolescents de Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955), ce frisson en entraîne un autre. Le fait de savoir qu’ils sont tous les trois morts, d’une mort qui sera et qui a déjà été, éveille le sens du destin irrationnel que Freud cite comme l’un des exemples de l’étrangeté. On trouve également, recouvrant l’étrangeté indiciaire qui dérive de l’appareil photographique lui-même, dans le monde d’Hollywood, ou effectivement dans n’importe quel autre star-système, cet autre type d’étrangeté, le sens d’une vie déterminée par quelque chose qui la dépasse, sujette à un ordre et une force qui vont au-delà de l’ordinaire. Mais ce type de rêverie, en s’éloignant comme il le fait de l’image pour aller vers la semi-réalité de la biographie, de l’anecdote et du commérage, finit par céder la place et retourner à l’espace diégétique de l’histoire. L’image de la star sur l’écran est liée de manière inextricable à l’histoire grâce au jeu, par le biais du geste et de l’action. En dernier recours, la star arrive à l’écran grâce à la seule fiction, et l’iconicité du jeu et de l’acteur et de l’actrice [performer] se fonde de nouveau dans la temporalité de l’histoire. Et au moment précis où le cadre immobile coexiste avec le cadre en mouvement, et où le temps de l’enregistrement de l’image par la caméra coexiste avec le temps de la fiction, c’est là que l’iconographie symbolique de la star est imprimée de manière indélébile sur sa présence à la fois en tant que « personnage » et en tant qu’indice. Ces différents types de signification oscillent et échangent leur rôle.
C’est peut-être pour cette raison que les scènes dans lesquelles la star passe de l’iconicité de sa présence extra-diégétique à la diégèse ont un impact particulier. Hitchcock utilisait souvent ces moments pour créer un effet spectaculaire. Par exemple, lors de sa première apparition dans Fenêtre sur cour (Alfred Hitchcock, 1954), Grace Kelly pose pour la caméra et, tout en allumant une à une les lampes, crée sa propre mise en scène en se présentant ironiquement en tant que « Lisa Carol Fremont » à James Stewart, tout en en établissant en même temps son identité fictionnelle vis-à-vis du public. De la même manière, dans Vertigo (1958), Kim Novak s’arrête pendant un moment, de profil, pour que James Stewart la regarde attentivement, l’identifie à « Madeleine », et les inclue toutes les deux dans le monde fascinant de son obsession. Ces plans introducteurs sont comme de nouveaux baptêmes, lorsque le nom et l’image d’une star, que le public reconnaît instantanément, sont remplacés par un autre nom dans le cadre de la fiction.
Une sorte de processus de remplacement a lieu. Roman Jakobson a démontré que ces embrayeursNDT. Il s’agit du terme « shifters »., dans le langage, combinent une signification à la fois symbolique et indicielle: un mot est nécessairement symbolique alors que l’indice a une relation existentielle à l’objet qu’il représente. Par conséquent, si les embrayeurs dans le langage sont des « symboles indiciels », l’image d’une star à l’écran devrait être une « icône indicielle », mais, par son intégration dans la fiction, sous un nouveau nom, c’est pourtant une autre dimension « symbolique » qui s’ouvre à nous. La « dénomination » qui accompagne la première apparition de la star à l’écran est suivie par le baptême fictionnel, mais la puissance de l’iconographie de la star rend souvent ce second processus partial et incomplet. Ces trois formes de la signification fusionnent dans le star-système, tout en changeant en permanence de registre, indéterminé et irrésolu. La représentation iconique fusionne avec son iconographie symbolique. En tant qu’icône indicielle cependant, la star est finalement une partie indifférenciée de l’image photographique, elle en est un équipement et une trace fantomatique de la réalité.
Dans son essai de 1946, L’Intelligence d’une machine, Jean Epstein démontre que la fusion dans le cinéma entre le statique et le mobile, le discontinu et le continu, semble aller à l’encontre de la nature, « une transformation aussi extraordinaire que la création de la vie à partir de choses inanimées ».Jean Epstein, « L’Intelligence de la machine », Écrits sur le cinéma, Seghers, Paris, 1974, p.259. La conservation des formes humaines dans le film incarne ces oppositions d’une manière plus complète et plus frappante que n’importe quel autre phénomène de représentation. L’illusion cinématographique réunit en une seule deux façons d’être incompatibles, de sorte que l’exclusivité mutuelle du continu et du discontinu, démontrée par Epstein, est littéralement personnifiée à travers la forme humaine, trace de vie inorganique, sur la pellicule. Transformer l’image fixe en mouvement revient à voir la nature troublante de la photographie passée d’un paradigme émotionnel et esthétique à un autre. Le troublant de l’inscription indicielle de la vie, comme dans la photographie, se fond avec le troublant du mouvement humain mécanisé qui appartient à la longue chaîne des répliques et automates. Quel que soit l’entremêlement de ces phénomènes, l’indice est un rappel qu’au cœur du support, ces images celluloïdales ne sont pas des répliques mais de réelles et littérales inscriptions du mouvement d’une figure vivante.
De plus, le cinéma a toujours, au cours de son histoire, tiré profit de ses atouts fantomatiques, de sa capacité à produire des peurs et des croyances irrationnelles même à partir de la forme la plus rationnelle et matérielle, poursuivant dans le sens de Freud l’idée selon laquelle la croyance en l’au-delà éloigne la peur de la mort. Par exemple, quand Rossellini, dans Voyage en Italie (1954), a filmé la longue histoire étrangement inquiétante du fait populaire semi-chrétien semi-animiste, il a aussi montré que l’inquiétante étrangeté du cinéma repose sur sa matérialisation contradictoire de la vie et la mort par le film, une trace de l’organique dans l’inorganique. Pour Rossellini, plus l’image était réaliste, plus elle rendait compte de la réalité qu’il filmait, et plus il pouvait saisir avec précision la confusion de l’esprit humain face à ces contradictions. C’est seulement une fois que la lutte pour concilier et réprimer ces contradictions échoue et que l’incertitude submerge le spectateur que la réalisation du punctum au cinéma peut se faire.
Cette contradiction est dramatisée dans la séquence finale de Prix de beauté (Augusto Genina, 1930). Alors que Louise Brooks regarde, fascinée, sa performance à l’écran lors de l’audition qui devrait faire d’elle une star, son mari jaloux s’introduit discrètement au fond de la pièce et lui tire dessus. Alors qu’elle agonise, l’enregistrement de son audition continue d’être diffusé à l’écran dans une condensation ironique de mouvements et de stases superposés, mais aussi de la vie et de la mort, et encore d’une perfection mécanique de l’image à l’écran. De la même façon, les grandes icônes de cinéma continuent de performer et de re-performer leurs propres mouvements parfaitement, même après leur mort. Dans l’acte d’interrompre le flux du film, puis d’y remettre le mouvement et la vitalité, le spectateur possessif hérite de la fascination de longue date pour la mutation du corps humain d’animé en inanimé, et vice versa. Ce spectateur a le pouvoir du regard de Médusa au bout de ses doigts, transformant, d’une certaine façon, en pierre la figure en mouvement. Après avoir manipulé le mouvement et maintenu la figure dans une pose sculpturale et parfaite, le processus peut être inversé et ainsi l’effet Méduse se transforme en plaisir de Pygmalion. Cette maîtrise de la figure humaine trouve une existence pré-cinématique dans les automates, célébrés depuis l’Olympia d’Hoffmann jusqu’aux figures mécaniques que le marquis collectionne dans La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939).
Pour Epstein et ses contemporains, la mécanisation facile de la figure humaine par le cinéma était un signe crucial de sa modernité, dont Chaplin était l’emblème suprême. Tout au long des années 1920, intellectuels et cinéphiles avaient commenté la façon dont la performance propre au style de Chaplin capturait l’esprit de la modernité et sa relation à la machine. Victor Chklovski pensait que l’essence du comique chez Chaplin reposait sur son mouvement mécanique, son développement en une série de mouvements successifs s’achevant par un arrêt complet, une pose. De façon similaire, Walter Benjamin écrit:
« Chacun de ses gestes est composé de fragments de mouvement découpés. Que l’on se concentre sur sa démarche, ou sur la manière qu’il a de manier sa petite canne ou de tirer son chapeau — c’est toujours la même succession saccadée de tout petits gestes, qui applique la loi de la séquence filmique à celle de la motricité humaine. »Cité d’après des notes préparatoires de Benjamin pour the Art Work Essay, dans Miriam Hansen, « Room for Play: Benjamin’s Gamble with Cinema », dans Canadian Revue of Film Studies / Revue Canadienne d’Etudes Cinématographique, XIII/1, The Martin Walsh Memorial Lecture, 2003, p.5.
L’hommage de Fernand Léger dans Ballet mécanique (1924) s’adresse à « Charlot » en tant que film, animé et intégré dans la substance celluloïdale elle-même. Dans son film de 1928, The Circus, Chaplin donne directement à la confusion entre l’animé et l’inanimé la forme d’un numéro comique. D’abord, il exploite la réduplication sans fin d’images dans un palais des glaces, dans lequel les reflets singent et miment les tentatives du Vagabond pour s’échapper, et où la frontière entre représentation et réalité se dissout. Ensuite, il se réfugie sur une façade de fête foraine, où un certain nombre de figures d’automates à taille humaine interprètent répétitivement des gestes mécaniques. S’intégrant lui-même au sein du rythme des automates, tant et si bien qu’un policier perplexe ne parvient pas à le repérer, Chaplin caricature l’accointance entre le mécanique et le mode de performance du Vagabond, ainsi que ses fréquentes rencontres avec des « choses » qui ont leur vie propre. Passant des automates au mouvement et à la pose rythmiques de danseurs, jouant l’ambivalence entre l’animé et l’inanimé, la persona de Chaplin à l’écran célèbre le cinéma comme une apothéose de l’humain-machine, et réalise cette ancienne, fascinante, ambivalence entre le mouvement et l’immobilité. Chaplin démontre que l’inquiétante étrangeté du nouveau et de l’inhabituel avancée par Wilhelm Jentsch, et si critiquée par Freud, appartient à une tradition archaïque qui remonte à la mythologie classique. En tant que personnification de la fusion opérée par le cinéma entre humain et machine, il indique aussi constamment sa vulnérabilité, la menace de rupture, une éphémérité ultime, ce qui est plus habituellement associé à la menace de castration représentée par la belle mais déceptive féminité de l’automate. Cette ambivalence vaut pour un spectateur possessif qui entrave l’objet-film dans le processus d’amour (adoration?) et de fascination: un tel spectateur ralentit l’objet-film tout en réinventant aussi ses rapports de désir et de découverte.
Dans « “…rait”, signe d’utopie », Raymond Bellour attire l’attention sur ce qu’on pourrait appeler le « punctum théorique », en référence aux observations de Barthes sur le cinéma. Vers la fin de La Chambre claireRoland Barthes, op. cit., Barthes décrit la manière dont il a été touché, soudainement et de manière inattendue, par une scène de Casanova (Fellini, 1976).
En observant la danse de Casanova avec une jeune automate, il se retrouva submergé par une intense émotion éveillée par les détails de sa figure, ses vêtements, son visage maquillé mais tout aussi innocent, son corps raide mais accessible. Il se retrouva à commencer à penser à la photographie car ce genre d’émotion était aussi déclenché par les photographies qu’il aimait.
Bellour observe: « Les mouvements de la figure, légèrement saccadés et inachevés additionnés à une posture rigide, faisaient fusionner son corps et le mouvement du film, sur lequel cela laissait une sorte de blessure [wound]NDT. Il nous intéresse de repartir du terme anglais afin de percevoir aussi le chemin de traduction de Laura Mulvey.. »Raymond Bellour, « “…rait”, signe d’utopie », dans Roland Barthes après Roland Barthes, Rue Descartes, 34, décembre 2001, p.43. C’est comme si le mouvement de la figure mécanique suggérait celui de l’autre, le projecteur, qui aurait dû rester caché. Barthes préface ses réflexions sur l’automate dans Casanova en disant qu’il vit le film le jour où il regarda les photographies de sa mère qui l’avaient tant ému. Bellour voit dans la description de l’automate le punctum associé non seulement avec la photographie « Jardin d’Hiver » de la mère de Barthes petite fille, mais aussi avec le corps de la très vieille dame, vivante mais proche de la mort. Il lie la relation entre la mère et son fils au cinéma lui-même: « C’est peut-être que le corps artificiel est toujours trop proche du corps de la mère. »Ibid., p.43.
Bellour suggère qu’« un genre de blessure » ouverte par l’automate conduit au mécanisme du film, à « l’intérieur », qui, comme l’intérieur d’une jolie poupée, a besoin d’être déguisé pour maintenir sa crédibilité. Le film sujet à la répétition et au retour en arrière, une fois visionné par les nouvelles technologies, souffre de la violence causée par l’extraction d’un fragment de son tout qui, comme dans un corps, « blesse » son intégrité. Mais sous une autre métaphore, ce processus « libère » le fragment de film et l’ouvre à de nouvelles relations et révélations. Sous cette perspective, le staccato de l’automate, les mouvements mécaniques préfigurent le déplacement entre le mouvement et l’immobilité qui caractérise l’analyse textuelle et le propre travail pionnier de Bellour sur les fragments de film. Et cette automate agit aussi comme figure pour « l’hésitation et la confusion entre mouvement et immobilité » qui caractérise l’interactivité du spectateur rendue possible par les nouvelles technologies. Comme elle pénètre le film, cette nouvelle manière de regarder émascule l’entière et cohérente structure narrative, « blessant » la surface. La figure de l’automate revient dans un double sens, premièrement comme lieu de l’angoisse de la castration, menaçant cette fois le « corps » du film lui-même, et deuxièmement comme métaphore d’une esthétique du cinéma fragmentée, voire féminisée. À travers la perception par Barthes de l’automate de Casanova et à travers son interprétation par Bellour, l’étrangeté freudienne du corps maternel fusionne désormais avec le corps vieillissant du film.
Le spectateur pensif
Dans les années 1920, pour des cinéastes tels que Jean Epstein, René Clair et Dziga Vertov, le cinéma ouvrit un œil révolutionnaire, mécanique qui transforma la vision humaine. Il ouvrit de nouvelles possibilités de perception, accentuant les modifications dans les manières de voir un monde extérieur familier, déjà affecté par l’immobilité de la photographie et la vitesse du transport mécanisé. Vertov décrit une simple expérimentation quand il
« fit un bond risqué pour le choix de la caméra slow-motion. Je n’ai pas reconnu mon visage à l’écran. Mes pensées étaient révélées sur mon visage — irrésolution, indécision et fermeté (un combat à l’intérieur de moi-même) et de nouveau la joie de la victoire. Première pensée pour le Kino-Œil comme un monde perçu sans masque, comme un monde de la vérité nue (qui ne peut être cachée). »Dziga Vertov, « Kino-Eye », Film Makers on Film Making, Harry Maurice Geduld, Indiana University Press, Bloomington, IN, and London, 1967, p.91.
À la fin du vingtième siècle les nouvelles technologies ouvrirent de nouvelles possibilités de perception, de nouvelles manières de regarder, non pas le monde, mais le monde interne du cinéma. Le siècle avait accumulé un monde-film enregistré, comme un univers parallèle, qui peut maintenant être ou stoppé ou freiné ou fragmenté. Les nouvelles technologies travaillent le corps du film comme mécaniques de ralentissement, retardant le mouvement en avant du médium lui-même, fragmentant le mouvement en avant de la narration et emmenant le spectateur dans le passé. Peu importe sa volonté ou son désir, ce regard transforme la perception du cinéma tout comme la caméra a transformé le regard humain sur le monde. Dans le premier cas, il s’agit d’un retard littéral du déroulé du cinéma, retenant sa séquence temporelle, à travers la répétition et le retour. Mais cet acte de ralentissement [act of delay] révèle la relation entre mouvement et immobilité comme un lieu où la temporalité variable du cinéma devient visible. Là encore, il existe une affinité entre l’avant-garde et l’exploration esthétique du mouvement ainsi que l’immobilité comme qualité privilégiée du cinéma. Annette Michelson décrit le cinéma de Vertov et René Clair dans les termes suivants:
« C’est dans la mesure où Clair et Vertov sont engagés dans la manipulation directe du processus filmique que leur travail le plus abouti résiste à la description. Décrire un mouvement est difficile, décrire l’instant de l’arrêt, du relâchement, du renversement, du mouvement, est encore autre chose; il s’agit de faire face à ce frisson au niveau le plus profond de l’entreprise filmique, pour reconnaître le caractère privilégié du medium comme étant en lui-même la promesse d’une saisie incomparable et inespérée de la nature de la causalité. »Annette Michelson, « From Magician to Epistomologist: Vertov’s The Man with a Movie Camera », The Essential Cinema, P. Adams Sitney, New York University Press, New York, 1975, p.104.
La description de Michelson évoque la difficulté qu’il y a à articuler la relation variée du cinéma au temps, l’impression d’être au-delà du langage verbal, le frisson que Barthes a associé à la photographie immobile seule. L’« au-delà » de la description verbale renvoie à la relation qu’il y a entre l’indice [index] photographique et l’étrange, soit l’inscription d’un moment de temps alors suspendu. Le cinéma ralenti, à la suite du cinéma de l’avant-garde, prend la temporalité de l’indice et ses incertitudes, dans les mots d’Epstein ses « conditionnels instables », pour le sortir de l’immobilité vers la complexité la plus poussée du mouvement, et vice versa.
Pour Roland Barthes, le cinéma a été incapable de déclencher le punctum qu’il trouvait si bouleversant dans la photographie immobile, c’est-à-dire la présence de la réalité, de la mort, du détail négligé par le photographe et visible par le spectateur. Il dit:
« Dans le cinéma, dont le matériau brut est la photographie, l’image ne possède cependant pas cette complétude (ce qui est heureux pour le cinéma). Pourquoi? Parce que la photographie, prise dans le flux, est entraînée, sans cesse attirée vers d’autres vues; dans le cinéma, sans aucun doute, il y a toujours un référent photographique, mais ce référent change, il ne plaide pas en faveur de sa réalité, il ne réclame pas son existence première; il ne s’accroche pas à moi: ce n’est pas un spectre. »Roland Barthes, Camera Lucida (trad. Richard Howard), Vintage Classics, London, 1993, p.89.
« Le cinéma participe à la domestication de la Photographie – du moins le cinéma de fiction, précisément celui qu’on appelle le septième art, un film peut être fou par artifice, il peut présenter les signes d’une folie culturelle, mais il n’est jamais fou par nature (par son statut iconique); c’est tout à fait le contraire d’une hallucination; c’est une simple illusion; sa vision est onirique et non pas ecmnésique. »Ibid., p.117.
Ces qualités manquantes pourraient être rendues au cinéma par l’acte de ralentissement [delay] de l’image, en revenant à certains moments, en les répétant et en brisant la linéarité de la continuité narrative. Suspendre le flux du film scinde les différents niveaux du temps qui sont habituellement fusionnés ensemble. En détachant le temps de l’indice [index] du temps de la fiction, le cinéma ralenti dissout le pouvoir d’imagination de la fiction tout comme la propulsion vers l’avant qui, argumente Barthes, dissimule un punctum cinématographique.
Barthes souligne que tout au long de l’histoire du film de fiction, le temps du récit tendait à masquer le principal, le moment d’enregistrement cinématographique et à subordonner la fascination du mouvement, identifié au temps enregistré, à l’action dramatique narrative. Pour que le monde diégétique de la fiction revendique sa validité et pour que le cinéma tisse sa magie qui fait fonctionner son processus narratif, le cinéma comme indice a dû endosser le rôle secondaire « d’accessoire » en vue de la vraisemblance narrative. Tout comme le cadre immobile est absorbé dans l’illusion du mouvement, ce qui est « alors » [thenness], à savoir la présence du moment d’enregistrement, doit se perdre lui-même dans la temporalité de la narration, l’iconicité de ses protagonistes et leur monde fictif. La narration affirme sa propre temporalité. Il y a un « être-ici-et-maintenant » que le cinéma affirme à travers son affinité avec l’art du récit. L’image animée tend à avoir une difficulté avec les nuances du temps grammatical et peut revenir à une narration parlée pour manipuler le changement dans une direction temporelle et pour éviter tout un dispositif de retour en arrière [flashback] maladroit. Ou bien ses ambiguïtés temporelles peuvent être exploitées à des fins esthétiques. Mais toutes ces techniques tendent à rester au sein de la temporalité générale de l’histoire; elles portent une réflexion sur la question du temps en tant que problème à l’intérieur même de la narration, si maladroite ou compliquée soit-elle, et « l’ici » et « l’alors » du moment original du film, son moment d’inscription, tend à rester caché.
Reporter le flux entier d’une fiction permet aux mécanismes désormais changés du spectateur d’entrer en jeu et, avec eux, des déclencheurs de conscience entre les différentes temporalités. En stoppant l’image ou en répétant les séquences, le spectateur peut dissoudre la fiction afin que le temps d’enregistrement puisse passer au premier plan. Par exemple, retourner et répéter la prise de vue prolongée qui introduit Lana Turner au début de Mirage de la vie (Douglas Sirk, 1959) crée graduellement la conscience d’une scène pro-filmique, la chorégraphie complexe entre le mouvement de la grue et le mouvement de la star et des figurants, qui a tout de la qualité d’une danse. Elle semble aussi précaire, presque fragile dans sa durée, son enregistrement du passé, et le monde imaginaire de l’histoire prend forme de manière ténue, sorti tout droit d’un document de tournage de plateau du studio hollywoodien Universal. Arrêter le temps de la prise de vue prolongée, briser son élégante continuité, révèle des détails plus précis qui ne pourraient pas être approchés dans le mouvement du plan. L’arrêt du plan sur la dernière rampe qui était occupée auparavant par Lana Turner, quand la jeune femme noire descend les marches, produit comme une sensation de punctum au moment de la découverte de ce moment qui était perdu.
Au plaisir ressenti dans la durée prolongée du plan se substitue la fascination apportée par la pause prolongée du cadre immobile. Le sentiment d’émerveillement face au tempo du plan, face au moment fragile situé entre l’apparition de la jeune femme et la coupe, donne alors lieu à une réflexion sur sa signification. La presque invisibilité des dernières secondes du plan préfigure la question de la visibilité et de l’invisibilité raciale qui court tout au long du film. Et la subliminale « représentation de l’invisibilité » amène, au-delà des contraintes du seul cadre du film, jusqu’à la société depuis laquelle elle est issue. Alors que le temps de cette image est inextricablement lié à son lieu qui est celui du plan vu comme un tout, ce n’est que lorsqu’elle est figée qu’elle peut être attrapée par la pensée et conduite à la réflexion. Mais le processus du ralenti donne aussi une visibilité au plan comme un morceau de temps en mouvement, le mouvement de la caméra et son enregistrement du mouvement. Cette oscillation entre les temporalités varie en fonction du style. À rebours de la chorégraphie complexe en studio, le fossé entre la présence du temps fictionnel et celle du temps enregistré est plus directement accessible à la conscience quand le tournage se déroule en décor naturel et a recours à des gens ordinaires comme acteurs. Rossellini exploite ces marges par l’usage de ses stars dans Voyage en Italie. Quand Katherine Joyce brosse ses cheveux, nous voyons Ingrid Bergman brosser ses cheveux; quand Alex Joyce fume une cigarette, nous voyons George Sanders fumer. Ici, un ralenti dans le film crée une oscillation dans le conflit de temporalités, non seulement entre l’enregistrement et la fiction, mais aussi entre la performance et la présence. Il y a une forme d’intimité dans certains plans de Rossellini sur Bergman et Sanders qui ne peut que faire apparaître leurs propres histoires et relations extra-diégétiques sur l’écran.
Le processus de ralentissement [delaying] d’un film met inévitablement en lumière son esthétique et l’illusion du mouvement, ainsi que la présence cachée de la pellicule dont cette illusion dépend. Dans sa réflexion presciente sur l’importance de la pause dans les films, Raymond Bellour fait remarquer son effet sur le spectateur. Il décrit les conséquences esthétiques d’une séquence de Lettre d’une inconnue (Max Ophüls, 1948), dans laquelle Stefan regarde les photographies que Lisa a glissées dans sa lettre.
« Qu’arrive-t-il quand le spectateur d’un film est confronté à une photographie? La photo devient d’abord un objet parmi d’autres; comme tous les autres éléments d’un film, la photographie se laisse entraîner par le déploiement du film. Pourtant, la présence d’une photo sur l’écran apporte un trouble très particulier. Sans cesser de progresser à son propre rythme, le film semble se figer, se suspendre; voilà qui incite le spectateur à prendre du recul par rapport à l’image et qui va de pair avec une fascination grandissante… Par la création d’une distance et d’une temporalité différentes, la photo me permet de réfléchir au cinéma. »Raymond Bellour, « The Pensive Spectator », dans Wide Angle, vol. IX/1, 1984, pp.6—7.
« Dès que vous stoppez le film, vous commencez à trouver du temps à ajouter à l’image. Vous commencez à réfléchir différemment au film, au cinéma. Vous êtes dirigé vers le photogramme — qui est lui-même un pas plus loin vers la photographie. Dans le film figé (ou photogramme), la présence de la photographie jaillit, tandis que les autres moyens exploités par la mise en scène pour travailler contre le temps tendent à disparaître. La photographie devient ainsi un arrêt dans l’arrêt, un cadre figé dans un cadre figé; entre lui et le film duquel il émerge, deux sortes de temps se mélangent, toujours inextricables, mais sans devenir confus. En cela la photographie savoure le privilège sur tous les autres effets qui font du spectateur — ce spectateur pressé, aussi un spectateur pensif. »Ibid., p.10.
Bellour établit le fait crucial qu’un moment d’immobilité dans l’image en mouvement et sa narration créent un « spectateur pensif » qui peut réfléchir « sur le cinéma ». Non seulement le spectateur « pensif » expérimente la forme de rêverie que Barthes associait à la seule photographie, mais cette rêverie atteint la nature du cinéma lui-même. Cette pause pour le spectateur, généralement « pressé » par le mouvement à la fois du film et de la narration, ouvre un espace pour la conscience de l’image fixe dans l’image en mouvement. De même, le spectateur pensif qui arrête l’image grâce aux nouvelles technologies pourrait amener au cinéma la résonance de la photographie immobile, l’association avec la mort étant habituellement dissimulée par le mouvement du film et son inscription particulièrement forte en tant qu’indice. Ces réflexions ne sont pas perdues lorsque le film revient au mouvement. Au contraire, elles se poursuivent et infléchissent le sens de « ce qui a passé » du film. Et le spectateur « pensif » revient finalement à l’inséparabilité de l’immobilité au mouvement et flux, dans les mots de Bellour: « deux sortes de temps mélangés ensemble ».
Le spectateur pensif tente de traduire ces différentes expériences de temps en mots au fil des lignes suggérées par Barthes en relation à la photographie fixe: la persistance d’un présent désormais passé, « c’était maintenant ». Alors que la même combinaison d’« embrayeurs » évoque la temporalité de l’immobilisme du cinéma révélant par leur inscription et leur préservation des moments suspendus du temps, ces moments qui se déploient dans la durée du cinéma sont perpétuellement dans un continuum en relation les uns avec les autres, tout comme en relation avec l’instant isolé. Ces niveaux de temps sont encore davantage compliqués par la fiction, considérée par Barthes pour être la « domestication » du cinéma. Plutôt que d’être un camouflage de l’essence du cinéma, la fiction peut introduire le niveau de temps qui le dote d’une fonctionnalité imaginaire permettant, qu’une fois ralenti, il contribue à l’esthétique du cinéma au lieu de la diminuer. Quand la présence du passé — le temps de l’enregistrement —, émerge à la surface, il semble qu’il annule le flux narratif. Dans presque chaque interruption occasionnée au sein d’un film, une impression d’image comme document se fait elle-même sentir de la même manière que la fascination d’un temps fossilisé submerge la fascination de la progression narrative. Mais une fois que le film recommence à défiler et que l’action reprend le contrôle, l’inscription temporelle change à nouveau et son présent fictionnel se réaffirme. Alors que ces différents niveaux de temps atteignent la conscience, ils demandent une traduction dans le vocabulaire du temps — « alors » et « maintenant » et « était » et « est » — qui décrit la relation entre le passé et le présent. Émile Benveniste le formule ainsi:
« La chose essentielle, alors, est la relation entre l’indicateur (personne, temps, place, objet montré, etc.) et l’instance présente du discours. À partir du moment où celui-ci ne se réfère plus, par l’expression elle-même, à cette relation de l’indicateur à l’unique instance qui le manifeste, le langage a recours à une série de termes distincts qui ont chacun une correspondance particulière avec le premier et qui réfèrent, non pas à l’instance du discours, mais à de “vrais” objets, à des temps et endroits “historiques”. D’où des corrélations telles que: Je: il: — ici: là — maintenant: alors — … »Émile Benveniste, Problems in General Linguistics (trad. Mary Elizabeth Meek), University of Miami Press, Coral Gables, FL, 1971, p.219 (ouvrage original français publié en 1966).
Dans la photographie « l’instant présent du discours » est préservé, comme si un moment d’énonciation avait été figé dans le temps, destiné à toujours parler, non comme une répétition mais comme la phrase originale elle-même. Avec l’image photographique, l’embrayeur n’a pas la sophistication du langage verbal, et sa signification repose sur une forme iconique plutôt que symbolique. Il doit par conséquent être renégocié à travers l’énonciation interne du spectateur, qui nécessairement, appelle à l’embrayeur. L’image réfère à un objet « réel », « historique », situé dans un passé qui n’existe plus. Le fossé entre l’indiciel « alors » et la perception du spectateur de sa persistance dans « maintenant » acquiert une dimension plus profonde avec la fiction. Plus encore, l’illusion du mouvement du cinéma est difficile à séparer de l’expérience du temps qui passe, parce que le cinéma est le seul médium qui a été capable de préserver ce signe particulier de « sentiment présent » [now-ness] dans le futur. Dans le cas de la narration cinématique, la simplicité et la contingence du mouvement à l’intérieur d’un seul plan — « alors » dans la durée — muent pour être intégrées dans une séquence montée et une part du temps vaste, symbolique, englobant, de l’histoire. Alors avec un moment de ralenti la fiction disparaît à nouveau sous la réalité de l’indice qui la maintient. Ces niveaux de temps variés sont encore davantage compliqués par la présence de la voix. Une voice-over ou des voix doublées ajoutent une temporalité qui brouille le moment d’enregistrement.
Nostalgia (Hollis Frampton, 1971) exploite l’instabilité de l’embrayeur comme « symbole indiciel », renvoyant aussi à l’immobilité et au mouvement du cinéma en termes « d’icône indicielle ». Dans le film, un certain nombre de photographies fixes sont filmées en plein écran accompagnées par un commentaire en voice-over. Graduellement, comme si elles étaient placées sur une plaque chauffante, chacune d’entre elles commence à prendre feu.
Non seulement l’immobilité se transforme en mouvement mais la présence des photographies dans le passé donne aussi priorité et sens à un « sentiment de présent » [present-ness] de l’image mouvante. Comme Rachel Moore commente:
« La méthode de Frampton jette le doute sur ce qui était là, détache l’image de son histoire et place l’histoire — qui est, après tout, une forme narrative dans le présent — en un péril constant d’être englouti par l’image en feu (c’est, le passé). En cela le film ne fait pas que jouer la nostalgie et la mélancolie, il joue aussi le choc. »Rachel O. Moore, Savage Theory: Cinema as Modern Magic, Duke University Press, Durham, NC, and London, 2000, p.150.
Frampton ne fait pas que transformer magiquement l’image fixe en un objet en mouvement, mais complique aussi la relation au temps exprimée par les embrayeurs. Le « c’était maintenant » du moment originel de l’enregistrement de la photographie se transforme littéralement en un plus récent « maintenant » superposé au moment d’enregistrement du film, au moment où le mouvement du papier brûlé sur la plaque chauffante remplace la photographie. Une autre strate de temps ajoute une autre désignation, « c’était maintenant ». Frampton attire l’attention sur ces dispositifs en mettant au premier plan l’instabilité et la richesse des mots embrayeurs. Michael Snow lit le commentaire en voice-over comme s’il s’agissait d’une narration selon le point de vue interne de Frampton et chaque photographie est décrite sur celle qui la précède. La voix décrit « cette photographie-ci », mais ce n’est pas « cette photographie-ci » qui est vue par le spectateur. Le temps grammatical et l’embrayeur « cette », le « symbole indiciel » sont surimprimés sur « l’image indicielle ». La nature essentiellement séquentielle du film est inscrite là où le spectateur essaye de démêler « cette photographie-ci » (« ceci ») de « cette photographie-là » (« cela ») tout au long de la série des images successives.
Au cinéma, le temps qui passe devient palpable, non par l’éphémérité d’une seconde arrêtée mais par l’éphémérité d’une séquence en cours, un temps présent amorphe et insaisissable, l’immédiat mais illusoire « maintenant » qui semble toujours appréhendé comme se fondant dans le « alors ». Le temps propre caractérisant la photographie fixe s’étend dans les transformations continues de « maintenant » en « alors », tandis que sur l’écran les images avancent. Au fur et à mesure que la représentation du temps dans un film se « déplace », l’immobilité de l’image devient moins intéressante que la succession de 24 images par seconde. L’indice « ceci était maintenant » fusionne avec le temps qui passe, avec le « maintenant » de la séquence cinématographique qui sans cesse redevient un « alors » en l’espace d’un seul plan. La nature protéiforme du cinéma, son affinité avec la métamorphose, ses transformations d’un plan sur l’autre, apparaissent dans le film de Frampton. La photographie inanimée devient la braise dansant sur l’écran, parodiant l’immobilité et le mouvement propres au cinéma, sa transformation de l’inanimé à l’animé. C’est la présence du changement, « momifié en quelque sorte » selon les mots de Bazin. Plus une séquence est visionnée, plus elle devient une « émanation d’une incontrôlable réalité » étendue. Le temps photographique — déjà incertain, rencontre la relation incertaine du film entre l’immobilité et le mouvement, le mouvement et le changement, ainsi que le temps arrêté et le temps qui passe ostensiblement. Ces relations, magnifiquement mises en images par Hollis Frampton dans Nostalgia, sont désormais plus aisément accessibles pour le spectateur pensif par processus du cinéma ralenti, capturant le moment de mutation dans l’acte et réfléchissant sur la représentation du temps.
Il y a presque trente ans, dans mon article « Plaisir visuel et cinéma narratif », j’ai décrit trois « regards » qui sont inscrits dans le film de fiction. Tout d’abord, le regard de la caméra filme le seul et unique moment d’enregistrement. Ensuite, les regards des personnages sont inscrits dans le temps fictif de leur monde diégétique. Enfin, il y a le regard du spectateur dirigé vers l’écran, reproductible à travers l’histoire du cinéma. Pour que le monde diégétique reste crédible, et pour que les dynamiques psycho-sexuelles voulues par les politiques du genre du cinéma hollywoodien se maintiennent, j’ai soutenu que, de manière générale, le premier et le troisième regard doivent être intégrés dans le second. J’ai écrit:
« Cette interaction complexe des regards est spécifique aux films. Le premier coup porté à l’accumulation monolithique des conventions cinématographiques traditionnelles (un coup déjà porté par des cinéastes radicaux) est de libérer le regard de la caméra au sein de la matérialité du temps et de l’espace, ainsi que le regard de l’audience pénétré de dialectiques et de détachement passionné. »Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », dans Visual and Other Pleasures, London, 1989, p.26.
Quelque chose qui ressemble à cette transformation du pouvoir du spectateur s’est installé. Le regard du spectateur, désormais interactif et détaché d’un spectatorat collectif, peut chercher le regard de la caméra tout en affirmant son contrôle sur le regard dans la fiction. Même si cela est rendu possible par l’évolution technologique, c’est une forme de pouvoir du spectateur qui est consciemment produite et activement imaginée, et qui amène des processus psychiques et des plaisirs qui sont liés, bien que différents. Le cinéma à 24 images par seconde produisait un regard voyeuriste sur l’image érotisée de la femme comme une défense contre une double vulnérabilité. La vulnérabilité masculine devant un regard castrateur pouvait être déviée vers un corps de femme, stylisé à en devenir artificiel, comme le bel automate représentant la castration par le processus même de sa répression. Mais le spectacle de la beauté féminine érotisée a aussi affiné la crédibilité narrative de la fiction, et a distrait de toute visibilité fâcheuse des mécanismes du cinéma. Maintenant, l’arrêt du flux et l’éruption de l’immobilité sont des lieux communs dans la consommation du film, et la fascination pour la fiction n’en est qu’une parmi d’autres. Tandis que la femme comme spectacle érotique pouvait souvent créer une pause dans le flux de l’action, ces moments peuvent être utilisés comme des tableaux aux côtés d’autres pauses et gestes, qui étaient jusqu’ici à peine visibles. De plus, le temps qui passe affecte lui-même le corps du film.
Le processus de vieillissement du film et sa collision critique mais bienveillante avec les nouvelles technologies se conjuguent pour donner une nouvelle signification à la représentation du temps, toujours présent dans et sur le film. La dimension psycho-sexuelle du plaisir visuel rencontre l’angoisse du psychisme humain à l’ombre du temps qui passe et de l’inévitabilité de la mort. Les trois différents regards que j’ai identifiés dans « Plaisir visuel et cinéma narratif » correspondent également à trois différentes sortes de temps cinématique: le passé de l’enregistrement, le temps fictionnel de l’histoire, et le temps présent, ou remémoré, du visionnage. Lorsque le cinéma celluloïdal, visionné sur vidéo ou DVD, est retardé par le spectateur pensif, la présence du passé (le regard et le temps de la caméra) trouve conscience dans le présent (le regard et le temps du spectateur), à travers le temps de la fiction (le regard et le temps du protagoniste). La place du regard dans le cinéma gagne une nouvelle dimension, non dénuée du psychanalytique mais menant vers d’autres sortes de plaisir, de fascination et de réflexion. Hors d’une pause ou d’un retard dans un temps cinématique normal, le corps du film narratif peut trouver de nouveaux modes spectatoriels.
Quelques temps après avoir écrit « Plaisir visuel et cinéma narratif », j’ai essayé de faire naître un spectateur alternatif, conduit non par voyeurisme, mais par la curiosité et le désir de déchiffrer l’écran, informé par le féminisme et répondant au nouveau cinéma d’avant-garde. La curiosité — une envie de voir, mais aussi de savoir — a toujours marqué un espace utopique pour une culture visuelle politique et exigeante, mais également un espace où le processus de déchiffrement pourrait répondre à l’intérêt et au plaisir de longue date de l’esprit humain à résoudre des mystères et des énigmes. Ce spectateur curieux pourrait être l’ancêtre du spectateur pensif, et le cinéma ralenti libère le plaisir du déchiffrement, non seulement pour une élite mais aussi pour quiconque a accès aux nouvelles technologies de consommation. La relation entre l’ancien et le nouveau, c’est-à-dire l’effet des nouvelles technologies sur le cinéma aujourd’hui vieilli, est particulièrement intéressante. La conscience du passage du temps affecte ce qui est vu à l’écran: cette impression de « changement radical », alors que la mort envahit le sujet photographié, affecte l’image en mouvement aussi bien que l’image immobile. Il y a, peut-être, un genre différent de voyeurisme en jeu lorsque le futur regarde en arrière vers le passé avec une fascination cupide et que les détails perdent soudainement leur statut marginal et acquièrent l’aura que le temps qui passe lègue aux objets même les plus ordinaires.
« L’esthétique du ralenti » tourne autour du processus d’arrêt du film mais aussi de la répétition, du retour à certains moments ou certaines séquences, tout autant que du ralentissement de l’illusion du mouvement naturel. Le cinéma ralenti rend visible sa matérialité et ses attributs esthétiques, mais implique également un élément de jeu et de répétition compulsive. Lors de la lecture d’une version ancienne — 1936 —, de l’ouvrage de Walter Benjamin L’Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, Miriam Hansen a redécouvert l’importance du « jeu » dans l’évolution de ses idées, en particulier celles en lien avec le film. Elle note que l’idée de jeu permet à Benjamin d’imaginer et de conceptualiser une relation entre le moderne, le collectif, l’expérience et la technologie qui dépassait la relation d’exploitation inhérente au capitalisme. Il retrace les mécanismes du jeu jusqu’à la relation imaginaire des enfants avec les jouets, avec la curiosité et, en fin de compte, avec l’obsession de la répétition. Comme Hansen l’écrit:
« Benjamin complique la dimension mimétique, fictionnelle, du jeu (“faire comme si”) par un intérêt, suivant la vision de Freud, pour “l’obscure obsession de la répétition”, le désir insatiable de “faire la même chose encore et encore”. Se référant explicitement à une impulsion “allant au-delà du principe de plaisir”, Benjamin attribue à la répétition dans le jeu une fonction à la fois thérapeutique et pédagogique: “la transformation d’une expérience bouleversante en une habitude”. Il modifie ainsi dans une certaine mesure l’angle pessimiste de Freud en attribuant à la répétition dans le jeu une quête quasi-utopique de recherche du bonheur et… concernant le cinéma, une fonction libératrice et apotropaïqueNDT. Du grec apotrópaios, « protecteur, qui détourne les maux », se dit d’un objet qui éloigne le mauvais sort.. »Miriam Hansen, « Room for Play: Benjamin’s Gamble with Cinema », dans Canadian Revue of Film Studies/Revue Canadienne d’Etudes Cinématographique, XIII/1, The Martin Walsh Memorial Lecture, 2003, p.5.
Il y a quelque chose qui tient des deux aspects de cette compulsion de répétition dans le désir du spectateur pensif de retourner à ces mêmes films préférés, à ces mêmes séquences en particulier, à ces mêmes moments privilégiés. Le côté obscur de la compulsion de répétition est présent dans son inévitable confrontation avec le passage du temps objectif que le vieux cinéma apporte au spectateur contemporain et avec la nouvelle nature fantomatique de l’image, transformée en un report de la finalité de la fin. Mais il y a aussi un retour compulsif au passé du cinéma, à la fois en tant qu’acceptation et échappatoire de son déclin physique et de son remplacement technologique. Cela peut être un retour à l’histoire, par exemple aux moments utopiques de l’avant 1929 qui marquaient la fin d’une période, alors que les expérimentations sur le temps de film préfiguraient celles désormais rendues possibles avec le cinéma ralenti. Ou il pourrait représenter le pur plaisir de la relation entre le mouvement, l’immobilité et leurs modifications inhérentes à l’expérience du cinéma, mais bien souvent rendues invisibles. Trouver la présence de ces formes esthétiques dans des films apparemment conventionnels et commerciaux a tout du plaisir enfantin et ludique de la chasse au trésor. Finalement, bien sûr, il y a ici une psycho-dynamique plus poussée, décrite de manière perspicace par Annette Michelson:
« Les plaisirs grisants de la table de montage (et la distribution croissante du magnétoscope, qui les a maintenant mis entre les mains d’une large partie de notre population) offrent une sensation de contrôle à travers la répétition, l’accélération, le ralenti, l’arrêt sur image, le déclenchement et le retournement du mouvement, qui est inséparable de l’excitation du pouvoir. […] L’euphorie que l’on peut sentir à la table de montage est une sorte de focalisation cognitive précise et de souveraineté ludique, fondées sur cette profonde gratification d’un fantasme d’une omnipotence infantile ouvert à ceux qui, depuis 1896, ont joué, comme jamais auparavant dans l’histoire du monde, avec l’évolution continue de la temporalité et la logique de la causalité. »Annette Michelson, « The Kinetic Icon in the Work of Mourning », dans October, 52, Spring 1990, pp.22–23.
En dehors de cette sensation d’euphorie, même si ce n’est que celle de l’expérience déplacée du celluloïd sur la vidéo, l’aura rattachée à l’œuvre d’art, — que Benjamin considérait bannie par le film et la photographie — revient à ces supports reproductibles mécaniquement au travers du besoin compulsif de répétition.
Dans sa vidéo Negative Space (1999), Chris Petit enregistre sa rencontre avec le critique américain Manny Farber, qu’il admirait pour sa capacité à découvrir les détails et événements à la marge du schéma narratif principal d’un film. L’enregistrement crée un dialogue entre le cinéma du passé et la vidéo, entre la vision spéciale d’un critique des années 1960 et la nouvelle technologie qui nous fait tous devenir des critiques. Cet échange crée une relation dialectique entre l’ancien et le nouveau, faisant s’effondrer la séparation avec le passé dont dérive la nostalgie. Mais en même temps, c’est élégiaque: il n’y a d’échappatoire ni au temps qui passe ni à la mort elle-même. Vers la fin de la vidéo, Petit revient sur des commentaires que Farber avait fait sur un extrait de Le Grand Sommeil (Howard Hawks, 1946). Bogart est en train de traverser la rue et — sans motivation pour l’intrigue — il jette un coup d’œil vers le ciel puis touche la borne à incendie en arrivant de l’autre côté de la rue. Plusieurs figurants, dont une jeune fille, passent devant lui. Petit montre une prise de vue en plein écran, ralentie et presque décomposée, de sorte que les pixels agissent comme un rappel du processus de déplacement du celluloïd vers l’électronique qui rend le détail visible. Il dit sur l’enregistrement:
« […] alors que l’image s’aplatit et se détache progressivement de l’histoire, ce n’est finalement rien d’autre qu’un bref plan de liaison qui se dote d’une existence propre. Et on se demande ce que quelqu’un d’une civilisation future ferait de ce fragment… surtout de la jeune femme en socquettes. S’interrogerait-il sur ce qu’elle est devenue? Et se demanderait-il s’il est en train de regarder quelque chose de réel plutôt qu’un simple film? »
Mais le futur spectateur imaginé est, en fait, le spectateur réel, présent. Quand le commentaire attire l’attention vers la jeune femme qui passe à l’arrière-plan, à ce moment-là, la présence de la femme devient subitement plus importante que celle de la star.
Après tout, Bogart est connu, familier. La hiérarchie de la star et des figurants se déplace. La jeune femme, un document cinématique aussi mystérieux qu’une photographie anonyme, a une présence qui serait imperceptible à une fréquence de 24 images par seconde, et ne peut être découverte que dans le processus « ludique » de répétition et de retour. Negative Space montre comment la fiction peut être retardée et comment certains détails mineurs peuvent prendre ce genre de signification inattendue. Malgré le contexte mis en scène, la jeune femme en socquettes permet aussi au temps de l’enregistrement de faire surface. Ce moment fugace montre comment les détails, en se libérant, peuvent aussi activer chez le spectateur la troublante sensation de réalité, qui appartient au concept de Roland Barthes du punctum.
Dans son roman AusterlitzW.G. Sebald, Austerlitz (trad. Anthea Bell), Random House, New York, 2001., W.G. Sebald décrit une découverte similaire — dans ce cas fictionnelle — d’un punctum cinématographique. Austerlitz, le protagoniste du livre, parle au narrateur de sa recherche de traces de sa mère, disparue dans le camp de concentration de Theresienstadt, et de sa tentative de trouver des images d’elle dans les fragments d’un film de propagande nazie:
« À la fin, l’impossibilité de voir les choses de plus près dans ces images, qui semblaient se dissoudre alors qu’elles apparaissaient, dit Austerlitz, me donna l’idée de faire développer une copie au ralenti de ce fragment de Theresienstadt, laquelle s’étirerait sur une heure, et effectivement une fois que le fragment eut été allongé jusqu’à durer quatre fois plus de temps que l’original, il révéla des objets et des gens auparavant invisibles et créa, par défaut pour ainsi dire, une autre sorte de film, que je n’ai eu de cesse de regarder depuis. »
Dans le livre, une illustration sur deux pages montre comment les parties endommagées du film deviennent des morceaux illisibles et pixélisés; un plus petit « arrêt sur image » révèle:
Le concept du « spectateur pensif » chez Raymond Bellour anticipait la réflexion profonde sur l’image filmique qui est aujourd’hui possible, un moyen de regarder à l’intérieur même des images au sein de l’écran, les transformant et les étirant vers de nouvelles dimensions de temps et d’espace. Le plaisir ou la poignance, qui vient avec l’arrêt sur image, amène ensuite au plaisir ou à la poignance qui vient du fragment. Le spectateur pensif vient à la rescousse du cinéma sur ces aspects dont Roland Barthes trouvait qu’ils lui manquaient en comparaison à la complexité de la photographie. Désormais, il est possible pour le cinéma, selon ses mots, de « plaider en faveur de sa réalité », de « réclamer son existence première » et de « s’accrocher à moi » par son engagement dans des détails émouvants. Le cinéma est, sans aucun doute, de plus en plus habité par des spectres. De la même manière, les oppositions relevées par Raymond Bellour, qui évoquent les différents attributs du film et de la photographie, produisent désormais entre elles de nouvelles relations et connexions, successivement ou simultanément, à partir desquelles de nouvelles représentations oscillatoires et changeantes du temps pourraient être expérimentées. L’immobilité se transforme en mouvement qui se fond dans le registre du temps narratif, mais seulement pour se fragmenter à nouveau par un retour à la fixité et au registre de l’indice. Non seulement les qualités d’inquiétante étrangeté au sein de l’indice photographique persistent, mais il y a aussi un sentiment plus aigu encore, que le temps ne peut être saisi, et que, dans le cinéma, « le temps qui duplique la vie » revient d’autant plus clairement « frôlé par la mort ».
Jean-Louis Comolli
Présentation
Tout comme les textes traduits de Laura Mulvey dans le chapitre précédent, les textes de Jean-Louis Comolli n’ont pas été publiés dans un livre. L’idée de rendre accessibles au plus grand nombre ces articles, « papiers » disait Comolli, préside à cette compilation, laquelle s’appuie avant tout sur l’idée que les deux auteurices s’y éclairent l’un, l’une l’autre.
L’intitulé complet du blog, Ces films à part qu’on nomme « documentaires », s’inspire d’une formule de Jean-Louis Comolli. Né d’une volonté commune du cinéaste et des étudiant·es de l’option cinéma (coordonnée par Yola Le Caïnec) au lycée Chateaubriand de Rennes, le blog a été créé en 2012 par l’une d’elleux, Anne Juin, qui a été aussi administratrice, jusqu’à ce qu’elle passe le flambeau à Yola Le Caïnec, la reprise estudiantine n’ayant pas fonctionné.
Publiés parmi ceux rédigés par les étudiant·es, les textes de Jean-Louis Comolli s’adressaient parfois directement à ces jeunes correspondant·es rennais·es, comme des leçons de cinéma par billets de blogs. Ils répondaient aussi à l’actualité cinématographique comme les feuillets d’un cahier critique, rendaient parfois hommage à des cinéastes ami·es ou admiré·es, ou bien encore portaient un regard sur des faits d’actualité depuis le prisme d’une éthique cinématographique exigeante.
La présence de Comolli sur le blog se mesure au premier mois d’activité de celui-ci, en juillet 2012: la vivacité de ses échanges textuels avec les étudiant·es se conclut sur un essai d’analyse filmique politique, « La Bergère ne répond pas ». Nous avons choisi ce texte pour ouvrir ce chapitre consacré à Jean-Louis Comolli: ce dernier y énonce la nécessité de dissocier le cinéma « dit » documentaire de certaines pratiques télévisuelles ou écraniques, prétendument documentaires, qui stigmatisent les êtres au sein de représentations sociales réduites et les instrumentalisent par le genre.
Pour Comolli, écrire sur les flux incessants d’images, flux accélérés par l’ère numérique, était primordial et vital pour nos sociétés, et ce blog était pour lui l’expression vivante de cette idée. Nous retrouvons aussi dans certains textes les premiers jets de ce qui deviendront parfois des ouvrages publiés (par exemple: Daech, le cinéma et la mort, Verdier, 2016; Une certaine tendance du cinéma documentaire, Verdier, 2021).
Pour faire ce livre, nous avons eu à cœur, en choisissant les textes qui en feraient partie, de garder cette diversité formelle et la pluralité d’adresses qui témoignent de la grande liberté de pensée à laquelle s’exerçait Jean-Louis Comolli sur ce blog. Quelques notes de bas de page présentes dans ce livre ont été ajoutées par nos soins pour contextualiser ou préciser certaines références.
La bergère ne répond pas
Tout film a deux faces. Objet audiovisuel quelconque, téléfilm, série, émission, film dit de « cinéma », chef-d’œuvre, etc. Tout film a deux faces: l’une, tournée vers celles et ceux qui sont filmés, comédiens de métier ou non, amateurs, profanes, professionnels, quels qu’ils soient. Et l’autre face évidemment tournée vers les spectateurs qui verront cet objet, où qu’ils soient, où que ce soit, téléviseur, salle de cinéma, festival, Youtube, etc. J’ai donc vu sur Youtube l’un des derniers numéros de la célèbre collection Strip-Tease, diffusée notamment sur France 3, depuis des années, en raison de son succès. J’avais vu déjà en d’autres occasions d’autres numéros de Strip-Tease, et déjà, je m’en étais alarmé. Nous allons voir pourquoi. Il se trouve que ce numéro de juillet 2012, « Berger cherche bergère », a provoqué un peu d’émoi chez les plus blasés: la famille filmée, fils, père, mère, tante, amies, a protesté contre ce qu’ils ont considéré comme un abus, une opération malhonnête, les tournant en ridicule.
Bon. Les filmés n’ont rien à dire sauf à se reprocher d’avoir accepté de l’être. Comme disait mon ex-ami et fin humoriste Jean-André Fieschi, « les moutons sont les moins à même de juger le goût du méchoui ». Puissance du signifiant: il s’agit ici d’éleveurs de moutons. Avec un sens particulier du minable, l’équipe de Strip-Tease a déniché un éleveur de moutons célibataire et désirant prendre femme, tout aussitôt tombé dans les douces griffes d’une entremetteuse comme on en trouve dans les MémoiresNote des autrices. Histoire de ma vie, Giacomo Casanova, 1822. de Casanova. (Par parenthèse: Strip-Tease, quel titre! et comme il en dit long sur les intentions des auteurs, dont on aimerait qu’ils aient l’audace de s’en prendre aux princes de la finance plutôt qu’aux victimes de la société. Mais le numéro de Strip-Tease sur Bernard Arnault est toujours en préparation. Dommage.) Bref, une famille d’éleveurs très campagne, un jeune homme désirant comme un fou s’unir à une jeune femme, une mère maquerelle qui manie tout ce petit monde avec maestria, et, pour couronner le tout, la jeune recrue roumaine, Roxanna, dont l’entremetteuse promet (Roxanna ne parle que le roumain) qu’elle cherche elle aussi l’âme sœur pour un mariage aussi loin que possible de chez elle. Tout cela sent l’arrangement, voire le scénario. Coup monté dont pâtit la famille et le jeune éleveur; coup monté dont pâtit évidemment le spectateur, trompé sur la marchandise, qu’il prend pour une entourloupe à destination des personnages alors qu’il en est la première victime. Il y a « mise en scène ». Et cette mise en scène est en quelque sorte signifiée, assumée, signée par l’entremetteuse qui tire tous les fils. Et dont « l’honnêteté » est mise en doute en cours de route, mais non pas le fait qu’elle organise moins le mariage que le scénario du film. Comme la famille a l’air de croire à ce personnage d’entremetteuse, comme le jeune promis semble lui aussi y croire, tout cela se joue dans un malaise général que le spectateur, du coup, est enclin à reverser au compte de la bizarrerie de la situation pour en faire un pas de plus dans la fiction. Mais à voir les regards des fermiers à la table de la ferme, les silences, les moues, le silence même de Roxanna, son air contrit, on flotte entre le quiproquo, le piège, la méprise, la maladresse liée au filmage lui-même. Un air de niaiserie rend les scènes de famille pénibles. La seule à s’en tirer avec brio restant l’entremetteuse: normal, elle met en scène.
Revenons donc un instant sur cette question de la « mise en scène » de ce qui se présente comme un « documentaire ». Précisons aussitôt que, dès que dans l’air il y a cinéma, mise en scène suit automatiquement. Poser une caméra dans une salle de classe ou une salle de rédaction, voire une salle de ferme, c’est immédiatement et comme par un coup de baguette magique changer ces salles en studios de cinéma, en plateaux, en sets. Bref, le cinéma arrive et tout devient cinéma. Les êtres se changent en êtres filmés, mais les animaux aussi, les murs, les linoléums. C’est ne rien comprendre au cinéma, c’est en refouler les puissances, que de croire qu’il y a la moindre relation d’équivalence entre monde filmé et monde non filmé. Disons, pour aller vite, que d’une part (cinéma) tout est cadré, que d’autre part (monde visible), rien n’est cadré. Autrement dit, par le cadre, le cinéma apporte une part d’invisibilité dans le monde visible. Disons que c’est tant mieux.
Bref, la famille Bergère, avant même l’entrée en scène de l’entremetteuse, personnage ô combien classique, est déjà une famille filmée, en attente, en instance d’être filmée, c’est-à-dire déjà très concrètement redécoupée en fragments alors qu’elle se croit un « tout », un « ensemble », une suite cohérente de personnes représentées par des corps. Le cinéma taille et détaille dans tout cela et fait de tout ce qui s’offre à la vue du caméraman l’occasion de dépecer et rapiécer les corps, les regards, les visages… Le cinéma filmant délivre la famille Bergère de son « quant à soi ». Il fait des fragments qu’il compose à partir de la scène d’ensemble des ailleurs où couve quelque chose d’autre, que cette famille ne dira pas, qu’elle soustrait à toute confidence, que le scalpel du cadre décharne et désosse. Le cinéma dit documentaire ne fait que porter les personnes filmées à l’intense de la fiction. Mais ici, pour dire le vrai, ça ne marche qu’à moitié. Pourquoi? Les cinéastes ne s’intéressent pas du tout aux personnes qu’ils filment, il ne leur viendrait même pas à l’idée que de ces personnes filmées puisse naître, en les filmant, une dimension imaginaire, une fiction, une histoire, une parole. Non. Les Bergère sont filmés comme des animaux, comme ces animaux qui sont dans leur étable. Ils sont filmés bêtement. Personne n’attend rien d’eux que de se conformer plus ou moins vaguement au scénario de l’entremetteuse qui, je le rappelle, est le scénario du film qui veut se faire passer pour « documentaire ». Pardon, Mesdames et Messieurs de Strip-Tease, mais le cinéma documentaire accorde aux personnes qu’il filme toutes les libertés, y compris celle, majeure, de ne pas correspondre au scénario implicite ou explicite qui meut les filmeurs. Ici, le scénario surplombe, et l’on voit ces malheureux père et mère Bergère, ainsi que leur fils, amis, tante et oncle, peiner, ramer, faire semblant pour paraître ce que le scénario leur demande. Revoyez le film, s’il vous plaît, à la lumière de ces quelques lignes. Et nous en reparlerons.
Bref, il y a arnaque. Les Bergère sont grugés, à la fois par l’entremetteuse agile et par la réalisatrice trop contente d’avoir une déléguée pour diriger la scène de l’intérieur. Quant au spectateur, il est lui-même trompé, et plus il y croit, plus il est trompé. Augustin, qu’on a dit saint, avait distingué subtilement deux sortes de tromperies: tromper parce qu’on ne peut pas faire autrement: un acteur, disons, qui veut jouer le rôle d’Hercule, n’est pas Hercule; il le sait, tout le monde le sait. Mais il faut bien qu’il le prétende pour que la pièce ait lieu. Tromperie par nécessité. Tout autre est la tromperie qui pourrait ne pas tromper mais le fait quand même. Par choix. Exemple, cet épisode de Strip-Tease que notre Augustin aurait pu décrire comme porté par la volonté manifeste de tromper le spectateur. L’entremetteuse n’est pas là par hasard. La famille sait bien qu’elle est filmée. Le fils transi sait bien que ses larmes vont être filmées (abondamment). On est donc dans une mise en scène, ce qui n’a rien de dérangeant, sauf qu’on ne nous le dit pas, qu’on ne nous donne pas non plus les codes qui aideraient à le percevoir (noms des acteurs, par exemple).
Strip-Tease se caractérise par l’exploitation qu’elle fait de la frontière poreuse et mouvante entre fiction ( = organisation complète de la scène) et documentaire ( = des situations vraies engageant de vraies personnes). Or, on ne passe pas d’un régime à l’autre sans prévenir le spectateur, ou sans lui donner les codes lui permettant de comprendre ce saut de genre. Car la question du spectateur, honnête entre toutes, légitime, nécessaire, impliquée dans le procès de la croyance et du doute, cette question a été et reste aujourd’hui: « Est-ce que c’est vrai? Est-ce que c’est arrangé? Est-ce de la vie? Est-ce du scénario? » La question du spectateur — c’est-à-dire la vérité de sa place — est au cinéma toujours la même: est-ce qu’on me ment, est-ce qu’on me dit la vérité? Question même de l’enfant à l’écoute du récit qu’on lui fait. Question évidemment sans réponse. Et qui doit le rester pour travailler conscient et inconscient du spectateur. C’est bien pourquoi il faut nommer « salauds » ceux qui, comme les producteurs de Strip-Tease, s’acharnent à faire passer la fausse monnaie pour de la vraie. En fiction, une telle histoire pourrait sembler assez élémentaire, assez nulle. En documentaire, elle revêt le poids du vécu, elle se couvre de la projection par le spectateur de ses propres angoisses (être aimé, ne pas être méprisé par la femme désirée, ne pas être manipulé par la marieuse de service, échapper à la tutelle des parents, etc. — je remarque qu’il s’agit là d’une trame fictionnelle destinée à la partie mâle des spectateurs). L’affichage documentaire est bien là ce qui trompe le spectateur, tout dans cet épisode comme dans beaucoup d’autres étant inévitablement « arrangé », non seulement comme c’est ici le cas par un scénario mis en scène, mais dans tous les cas par ce que les anthropologues ont nommé « auto-mise en scène », ce qui signifie, dans le cas du cinéma, que les sujets et les corps exposés au dispositif cinématographique l’acceptent, le relaient, le réfractent chacun à sa façon, et donc qu’il n’y a jamais de « naturel » ni de « spontané » sauf dans la tête du spectateur resté enfant — et qui fait bien de croire encore au Père Noël.
Comment voir ce film autrement? (C’est une question que toujours je me pose: et si c’était autre chose que ce que je crois?) Il est de fait que le cours du film repose essentiellement sur les agissements et interventions de l’entremetteuse, qui, d’abord, promet, qui offre la jeune fille en pâture à cette famille vaguement roublarde — mais pas assez, pas au point de défaire le tissu de mensonges de l’entremetteuse et moins encore sa connivence avec l’équipe du film; qui retire ensuite la promise au sacrifice en invoquant une « mère » restée là-bas, jalouse et qu’il faut aller calmer… Roxanna disparaît donc du film. Mais non du désir du fils, qui s’est mis à la chérir très platoniquement. À la maquerelle de gérer l’absence douloureuse de la promise en préparant d’autres candidates à l’imposture. Un ami bien intentionné avertit la famille: attention, les Roumains sont passés maîtres en ce genre de « coup monté »: après le mariage, la jeune mariée réclame « une pension » et disparaît… Telle est la trame. On en goûte l’invraisemblable. « Plus c’est gros, plus ça marche », dit la sagesse populaire.
Mais telles sont les contraintes de ce qu’on s’obstine encore à nommer « documentaire » que ce scénario, suivi à la lettre, à la fois se déroule comme prévu et à la fois se fissure en plus d’un point.
Je disais en commençant « tout film a deux faces ». La face A de celui-ci est évidemment tournée vers les personnes qui sont filmées, qui ont accepté d’être filmées et qui peut-être en ont espéré quelque bénéfice symbolique. Je n’oublie jamais qu’aujourd’hui aucun être vivant et parlant à la surface de cette sphère terrestre ne peut plus ignorer qu’être filmé revient à entrer dans une sorte d’éternité, le corps disparaissant, oui, mais l’image de ce corps survivant aussi longtemps qu’il y aura des regards d’êtres parlants pour la voir. La famille Bergère n’en pense pas moins. Il y a certes le mariage du petit (qui fait tout le travail de l’exploitation!), il y a surtout cette caméra qui est là, qui nous filme, qui enregistre à jamais l’image de ce que nous sommes, pauvres mortels. C’est la clé. Le mariage du jeune berger, le recours à Internet ou à une entremetteuse genre XVIIIe, tout cela pouvait se réaliser, et se réalise, sans caméra aucune. Si la famille accepte que son problème matrimonial soit filmé, c’est qu’elle le veut. Le désir est là. C’est évidemment ce que savent les producteurs de Strip-Tease, forbans fort avisés, et l’entremetteuse elle-même qui voit là carte blanche. Le piège est tendu. Il fonctionne. Toutefois plus malaisément que dans une fiction que nous conteraient Musset, Marivaux, Maupassant.
L’invention vraie de cet épisode est que Roxanna ne comprend pas le français. Une interprète intervient, certes, en même temps que l’entremetteuse. Mais elle disparaît de la scène. Et voilà Roxanna, belle jeune femme d’autant plus mystérieuse qu’elle ne parle ni n’entend, seule avec cette famille paysanne à la fois bienveillante et maladroite. Pour l’analyse de la face A de l’émission, on peut noter que les femmes et hommes filmés, Roxanna comprise, manifestent une certaine gêne. Cette gêne générale est immédiatement reversée au profit du récit qui s’esquisse, comme un effet de sens allant nourrir la diégèse, et s’offrant au spectateur (face B) comme une occasion de jouir de la niaiserie des personnages filmés. Mais n’allons pas trop vite. Restons en A. Toutes celles et tous ceux qui nous sont montrés le sont dans leurs limites. Avec un malin pervers plaisir à multiplier les plans sur des visages fermés, des airs absents, ou niais, ou béats. Le filmeur prend son plaisir à traquer l’expression la moins noble, le rictus le plus vile, le regard le plus torve. Vous me direz: mais ces gens-là, la famille Bergère, sont comme ça, on ne peut les filmer que comme ça. Eh bien, non! cher lecteur. Nous sommes tous comme ça et nous pouvons, nous devons tous être filmés autrement. Les penseurs au physique le plus avenant, le rayonnant Michel Serres, par exemple, si on lui fermait la bouche, si on l’empêchait de parler, si on le filmait en train de manger un bout de fromage, serait lui aussi un condensé de fausses mines, de rictus, de grimaces. À nous, filmeurs, de savoir ce que nous voulons: avilir l’autre (ou le laisser dans son apparent avilissement), ou bien en faire, par la puissance du cinéma, notre alter ego, avec qui on serait heureux de manger un bout de fromage en buvant un coup de rouge. Ce souci n’est pas celui des producteurs/réalisateurs/filmeurs de Strip-Tease. Leur désir est exactement contraire: l’autre filmé est un objet de risée, de mépris, il est médiocre, laid, maladroit et même muet. Imaginons un instant, chers lecteurs, un monde qui serait à l’image de ce que fabrique et diffuse semaine après semaine Strip-Tease. Vous n’aimeriez pas y vivre? Moi non plus. Or, cette émission a du succès. Un nombre important de nos contemporains se délecte, semble-t-il, de la mise à mal ou de la tournure en ridicule des pauvres diables, manants de l’ère du spectacle, sots au point d’avoir voulu être filmés. À mon avis, c’est grave. J’aime mes contemporains, je ne les méprise pas, je veux qu’ils sortent de l’ornière sorcière où ils sont tombés, là où quelque puissance démoniaque leur fait prendre des êtres humains, parlant et pissant, leurs semblables, pour des grenouilles ou des crapauds. Il est temps de sortir du mauvais enchantement des médias. Voyants, voyeurs, visionnaires, réveillez-vous! Il y a autre chose à déguster que la mauvaise tambouille de cette télévision excrémentielle et pestilentielle.
Le moment est venu, donc, de parler de la face B. Non point celles ou ceux qui sont filmés, mais celles et ceux qui regardent Strip-Tease. Bien, l’émission marche, on l’a dit. Mais sur quoi exactement marche-t-elle? Sur quels charbons ardents? Sur quels verres pilés? Le téléspectateur, on suppose, calé dans son fauteuil ou son canapé, est invité, glorieux dessert, à déguster l’imbécilité filmée de son prochain. Que risque-t-il? De s’ennuyer. Il changera de chaîne. S’il ne zappe pas, c’est qu’une certaine jouissance le retient devant cet écran. Laquelle? Celle de découvrir un monde merveilleux conté par de grands narrateurs? Non pas. Celle d’entendre l’explication du monde par un fabuliste? Ni même. La chose immonde qui me fait jouir quand je regarde Strip-Tease, c’est le spectacle, en effet fascinant, de la bêtise de tels ou tels de mes contemporains. Nous ne sommes cependant pas dans Bouvard et PécuchetNote des autrices. Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert, 1881.. Flaubert ne manquait pas de fatiguer ses héros sous le poids de leur bêtise. Mais ils n’étaient pas filmés. Tel est le point. L’autre filmé m’est livré, livré à ma jouissance scopophile. Sa niaiserie m’amuse: c’est la sienne — comme son nez, comme son corps. Et moi qui regarde, séparé de lui par un écran qui à la fois le montre et l’escamote (il a été filmé avant-hier ou plus tôt encore), je peux jouir, dans le sens psychiatrique du terme, je peux jouir de son abêtissement. On me dira: pourquoi pas? Je réponds: peut-être, mais pas au cinéma. À la terrasse d’un café, dans un cocktail, une soirée quelconque, chez moi peut-être aussi, la bêtise de mon voisin (ma voisine) peut m’être livrée prête à déguster. Mais au cinéma, elle ou lui et moi ne sommes pas au même endroit. Si je ris, elle ou lui ne m’entend pas. Je suis par l’écoute et le regard le maître de l’image qui m’est proposée, maître en ce sens précis que rien ni personne ne peut m’empêcher d’en jouir. Or cette image n’est qu’une image. C’est-à-dire qu’elle me parle et me regarde en tant qu’image. Rien d’aucune relation intersubjective, rien d’un duel, rien d’une séduction, rien d’un coup de foudre, rien de partagé ne peut advenir entre l’image livrée à mon regard et celui-ci. Sauf hallucination, bien sûr, laquelle n’est possible qu’au cinéma, avec des films complexes et ambitieux, en tout cas non sommaires (disons Le Carrosse d’or de Jean Renoir, ou La Nuit d’en face de Raoul Ruiz) — films dont nous sommes, en ce cas, fort éloignés. Le spectateur en son fauteuil jouit de la déréliction de l’autre impunément. C’est, certes, toujours le cas. Mais au cinéma, il s’agit d’une véritable transgression du principe fondateur, qui veut que de sa place le spectateur se projette sur l’écran et se retrouve dans la peau des uns et des autres, participe de leur souffrance ou même de leur infamie (Les Raisins de la colère, John Ford). Ici, rien de pareil: il y a nous, devant notre poste, et eux, sur l’écran. Ils nous font rire, ils nous font pitié, ils nous paraissent ridicules. Mais nous n’y sommes pour rien, nous ne sommes pas avec eux, mais contre eux.
On voit bien que ce type de programme a pour objet de séparer les vivants et les parlants en deux ordres: celui de maîtres qui peuvent jouir de la misère de leurs inférieurs, et ceux-ci, abusés par les outils de la puissance cinématographique, capturés par un miroir aux alouettes, et qui sont les victimes expiatoires du nouveau royaume du Spectacle qui est en train de conquérir le monde.
Envoi. On m’a demandé: mais qu’auriez-vous fait, avec cette histoire et ces personnages? J’ai répondu: mais j’aurais fait de Roxanna le vrai personnage du film. Je lui aurais rendu la parole en priant la traductrice (qui ne fait qu’une apparition, pas par hasard), de rester, de traduire en français ce que Roxanna, si elle est une vraie Roxanna, a dans la tête! Il est quand même étonnant que l’objet du désir, la cause de l’histoire et peut-être sa victime aussi soit précisément celle qui ne peut rien comprendre ni rien dire. Voici qui en dit long, pardon, sur ce que l’équipe de Strip-Tease pense des femmes, désire d’elles, leur prête et leur donne: rien.
Mutation inactuelle
Que s’est-il passé depuis la mise au point du cinéma léger synchrone (16mm), dit cinéma direct? Pour la première fois les femmes et les hommes ordinaires qui fréquentent les salles de cinéma peuvent se voir sur les écrans de ces salles. Cette autoréférence que la télévision va répandre et généraliser commence en 1960: Marceline Loridan est à la fois sur l’écran et dans la salle. Le cinéma devient une dimension de l’espace-temps commune à toute une humanité. Tout un ensemble de mailles serrées se tisse entre ce que je suis et ce que je vois, d’autant mieux que je vois à l’écran mes égaux, mes frères. La dimension démocratique du cinéma s’arrime à ce socle d’une égalité entre celles et ceux qui sont filmés et les spectatrices ou spectateurs qui leur font face. Cela n’a l’air de rien, c’est énorme, c’est surtout la clé de notre actuelle condition. Il apparaît de plus en plus clairement qu’une part importante des relations entre les uns et les autres (nous) est filtrée, transmise, modulée, réinterprétée par les images et les sons que nous fabriquons les uns des autres. Depuis quelque temps, ma foi, et sans vouloir jouer au prophète, j’ai été amené à imaginer que le cinéma devenait de fait une réalité hors des salles (et si tant que l’on puisse encore dire « cinéma » et non « images et sons »). Ce monde entre les mondes, ici et ailleurs à la fois, hier et aujourd’hui à la fois, était en passe de devenir le seul non-lieu de notre présent. Sans que nul, je crois, ne s’en soit aperçu, le cinéma est devenu lien, vecteur, acteur de nos présents. Tout à l’envers de ce qui se dit et se croit encore « art » — avec sa dimension ségrégative: cinéma au sens très large est une sorte de milieu, écologique et logique, d’air qu’on respire ensemble, où chacun est à peu près assuré d’entrer en contact, visuel et sonore, avec l’autre, quel qu’il soit, qu’il soit tel les forbans buveurs et fouteurs de La Forêt interdite, film prémonitoire (Nicholas Ray, 1958), le cinéma est au fond ce qui fait agir le langage de l’être parlant (le parlêtre) en proposant à cet être de parole à la fois l’écoute narcissique de ce que l’autre dit et qu’il aurait pu/dû dire à sa place, et l’écoute exotique d’une parole non encore domestiquée. Dans les années 50 et 60, nous découvrions le monde à la Cinémathèque. Aujourd’hui, le cinéma est devenu le monde et la Cinémathèque un musée qui nous raconte l’histoire de notre mutation en ciné-êtres.
Mais ce que le cinéma direct recrée — logiquement — c’est la condition même de transmission de la parole: l’écoute. Le magnétophone est l’élément essentiel du couple qui tourne. La caméra elle-même est une oreille. Les très mauvaises habitudes héritées de l’école nous font tenir la prise de parole pour un acte, un agir, un être-là. Mais l’écoute? Comment ne le serait-elle pas bien davantage? Comme Gilles Deleuze le notait dans les années 70, ce n’est pas la parole qui manque (à la radio, à la télé, dans les relations intersubjectives), non, pas la parole mais l’écoute. Qui écoute qui? Le cinéma direct tient toute sa puissance d’écouter effectivement celles et ceux qu’il filme et de leur faire percevoir et sentir que cette écoute réelle est réellement un acte, une action, un faire, un engagement de l’être et non point un semblant. C’est donc en ce sens que la médiation cinématographique est appelée à prendre la place des échanges intersubjectifs de la vie ordinaire. Dans « la vie », qui écoute qui? Qui regarde qui? Qui voit qui? Question non rhétorique. Dans un monde que le marché tend irrésistiblement à désincarner, où la recherche tend non moins irrésistiblement à s’éloigner des corps référentiels: ceux des vivants qui sont là, le cinéma vient à propos pour redonner aux absents présence, aux présents redonner prise sur leur proche prochain. Étrangement, cet art naît d’une opération quasi-magique de survivance des morts dans leurs images, de la virtualisation des charges de la vie dans leur version burlesque (l’appartement, la voiture, le costume, le corps: ces ennemis), vient aujourd’hui à notre rencontre comme un commun que nous partageons parfois dans les œuvres aimées, mais toujours dans le jeu des films qui finit par obséder nos vies puisque nous sommes insensiblement passés de la place du spectateur à celle de l’acteur, ou du cadreur, ou du réalisateur, ou du filmeur… et que, rencontrer l’autre, c’est le filmer. Peut-être s’agit-il du point inatteignable où rêve et réalité coïncident? Où la vie réelle des gens réels est déjà tellement modélisée par la publicité, les films, les émissions de télévision, les magazines, etc., que très spontanément chacun s’accroche à cette part d’irréel qui caractérise obstinément le présent. Est-ce que Bernard Arnault (par exemple) est un rêve, un mythe, un homme réel, un fantasme? Mais… la plupart des sans nom que nous entretenons jour après jour dans nos relations sont-ils des êtres réels? Des apparitions? Des rêves que nous aurions? La vie dite « réelle » n’est-elle pas « réellement » un roman, une série télé? Je n’en suis pas sûr et je ne me désole pas de la chose si elle s’avère. Peut-être que la poussée insupportable — et odieuse — du capital, peut-être que les conditions de vie effrayantes qui nous sont faites, trouvent déjà leur issue dans la construction d’un autre monde, fantasmatique si l’on veut, imaginaire, soit, mais qui finit par compter plus pour nous que l’autre, qui nous occupe davantage, qui implique de notre part plus de désir. Le capital a cru et croit encore manipuler les libidos, les organiser, les diriger vers les objets (marchands) désirables. Mais peut-être en va-t-il autrement. Peut-être qu’au cœur du système psychique humain un désir de désobéir à la règle, à la norme, à la loi, à la violence mercantile, peut-être que ce désir « pervers » est plus fort, et qu’il nous entraîne par mille chemins de traverse vers un très simple but: faire nous-mêmes ce qui nous plaît. Le cinéma, il me semble, nous offre ce suspens des contraintes ordinaires, ces places de liberté, ces marges de flottaison. Nous avons pu être ce que nous n’étions pas, cowboy, gangster, vamp, nous avons pu être à la fois Karl Malden et Marlon Brando dans Sur les quais. La vie ordinaire telle que le capital la veut ne nous offre rien de ces possibles. Le cinéma, c’est-à-dire la fiction incarnée dans des corps parlants, et qu’ils soient joués par des comédiens ou des non-comédiens (Riboulet ou Portal dans mes films), nous ouvre la possibilité d’œuvrer à notre transsubstantiation: non pas devenir autre que ce que nous sommes, mais devenir ce que nous sommes en tant qu’autre. Voilà ce que redoute la domination qui nous opprime, c’est le mot, voilà ce dont elle ne veut pas. Que le sujet, pour aliéné qu’il soit, en vienne à bâtir son petit monde, moins grand que celui d’Arnault (par exemple) mais d’autant plus satisfaisant.
La cinématographisation du monde n’est pas sa spectacularisation. Dans le spectacle, personne (ne) s’adresse à tous. Au cinéma, chaque spectateur est convoqué en être singulier, non échangeable, non remplaçable, donc mortel absolument — à l’exception de son image et du son de sa voix, filmés, enregistrés. C’est ce qui n’intéresse pas le spectacle. C’est en même temps ce qui fait qu’à travers cette mise du monde en cinéma, c’est-à-dire en singularité (chacun filme ses objets à sa façon), nous entrons dans un monde de singularités égales, si j’ose écrire. Égalité veut dire qu’il n’y a plus de capitalisme. Permettez-moi d’œuvrer à cette autre version du monde.
Kiarostami ou le cinéma d’aujourd’hui
Abbas Kiarostami était l’un des rares cinéastes — après et avec Fritz Lang et Roberto Rossellini — à avoir pris acte de ce que le temps du cinéma était arrivé, une bonne fois, qu’il était là avec nous, autour de nous et en nous, qu’il était devenu notre temps — l’axe, l’astre plutôt autour duquel tournaient les films à nous destinés, parlant de nous, d’ici et d’ailleurs, et nous faisant comprendre de plus en plus nettement qu’ils s’adressaient à nous moins en tant que consommateurs ou citoyens, qu’en tant que personnages de cinéma, réels ou virtuels. Nous étions des spectateurs, sommes devenus des acteurs et souvent des personnages. La grande question à nous imposée dans les vingt dernières années est bien celle de la mise en spectacle généralisée du monde au travers du contrôle des médias audiovisuels par le Capital. Cette mise en spectacle signifie avant tout la fin de ce qu’on a appelé cinéma, et qui se caractérise par un souci du cadre autant qu’un souci de l’autre, à commencer par le cinéspectateur. La prolifération des images et le gouvernement qu’elles s’arrogent de toute chose signifient d’abord le rétrécissement de la responsabilité des spectateurs. Chez Kiarostami, voir un film, en parler, y jouer, refuser d’y jouer, refuser de reprendre son ancien travail pour le jouer au cinéma, changer de robe pour le film, ou pas, attendre un appel téléphonique pour filmer un enterrement, attendre une réponse d’une jeune femme sans savoir si son silence est un jeu imposé par le scénario ou s’il vient d’elle-même, choisir de jouer un metteur en scène parce que c’est plus difficile que de jouer un acteur… Tels sont les thèmes traités par Kiarostami. La vie n’est pas un jeu, le jeu n’est pas une vie, il est une passion. C’est comme si, hors du cinéma, je veux dire de ce cinéma qui prend soin du cadre, de la lumière, des corps et du monde, il n’y avait plus rien à vivre. Ce qu’on nomme encore par faiblesse la « réalité » a pris chez Kiarostami un air d’énigme. Où donc finit le théâtre, où commence la vie? se demandait, émue, la Magnani du Carrosse d’or (Jean Renoir, 1953). Les films de Kiarostami sont une réponse à cette éternelle question des arts de représentation: il n’y a plus de réalité que celle du film immense, géant, universel, dans lequel tous nous jouons, il n’y a plus d’autre « réel » que celui que les épisodes de ce « film » suscitent. Ainsi, à la fin du sublime Au travers des oliviers, le spectateur, devant un plan infiniment large et profond, n’aura qu’à deviner la réponse, invisible, inaudible, oui ou non, ou peut-être, qui réconcilie le spectateur d’aujourd’hui avec le tremblement du monde.
Bien avant ses dernières années, dès Close-up (1990), je n’ai pu me figurer le cinéma qui venait que dans le souffle de l’œuvre de Kiarostami. Quelque chose qui ne finirait jamais: l’opération cinématographique comme un jeu de miroirs où les reflets s’encastrent éperdument les uns dans les autres afin de faire disparaître un monde trop laid pour que le cinéma s’en contente.
Fiction et Cie
Tous les films, disait Christian Metz, sont des films de fiction. Il n’y a pas que les films. Ou plutôt les fictions sont partout, et tout aussi bien hors des romans et des films narratifs, dans les listes de course ou, autrefois, les annuaires téléphoniques, dans les objets et les rôles usuels, dans l’ordinaire des êtres, des situations, des choses. Je le dis à ma façon: tous les êtres parlants sont des êtres de fiction, la fiction travaille le langage, elle forge l’écoute et l’entendement. Fiction se dit de ce qui est fabriqué, « fait » de tête et de main d’homme. C’est-à-dire à peu près tout ce qui nous entoure, y compris désormais une bonne part de ce que les Anciens appelaient « nature ». Je prétends donc, passant du « cinéma (dit) de fiction » au « cinéma (dit) documentaire », ne pas avoir quitté la fiction, m’y être tout au contraire désespérément adonné. Pourquoi ce « désespérément »? Il faut une certaine dose de foi, et solide, dans l’humaine condition, pour supposer qu’en chacune ou chacun des passagers du temps que nous sommes puissent naître et se développer de singulières fictions mettant à mal les ordres établis. L’hypothèse que toutes et tous nous sommes porteurs de fiction, et pas seulement acteurs, bien que nous le soyons aussi, dans les fictions des maîtres, est une hypothèse renversante. À tout le moins rebelle.
Et si tout cela est bien tel que je l’écris, la question se pose toujours: pourquoi être passé du cinéma dit de fiction au cinéma dit documentaire, puisque fiction il y a dans les deux catégories? Autrement dit, qu’est-ce qui définit le cinéma dit documentaire par rapport à l’autre? C’est bien simple pour moi: le recours à des êtres réels, vivant leur vie de tous les jours, celle que je souhaite filmer, justement. Les comédiens (de métier) peuvent parfaitement faire « comme si » ils étaient employés de bureau ou architectes (après une légère formation). Mais pour les « personnes réelles » comme vous et moi, c’est une performance inédite et le plus souvent non rééditable que de jouer dans un film leur propre rôle. Se produit dans leur vie une sorte de crise, telle qu’elles ou qu’ils investissent dans leur collaboration au film une part, ou des parts d’elles-mêmes ou d’eux-mêmes qui les surprennent, les font se découvrir davantage, se révéler. Cette part de fiction, précisément, que la vie sociale ordinaire masque ou étouffe, peut apparaître dans cette circonstance extraordinaire. Cette révélation d’elles-mêmes ou d’eux-mêmes au travers d’un film est un bouleversement qui démontre que chaque être parlant est à sa façon créateur. Voilà qui me touche plus que les performances souvent admirables d’une ou d’un comédien. Ce n’est pas de la même eau. Pour le non-comédien, il en va d’une certaine forme de rupture avec le monde ordinaire, d’une liberté nouvelle, d’une désaliénation. C’est ce qui est donné à voir et à entendre aux spectatrices et spectateurs. L’insistance, toujours difficile, souvent contrariée, de cette liberté sur l’écran est ce qui se transmet dans la salle. Les spectatrices, les spectateurs sont eux aussi des amateurs. Elles, ils assistent à une série de passages à l’acte qui ne sont ni feints ni virtuels. Dans notre moment historique où le faux se fait passer pour vrai, il n’est pas vain de se référer à cette sorte d’épreuve du feu. Le passage à l’acte de jouer emporte avec lui — arrache — quelque chose de réel qui peut devenir un fait d’expérience.
C’est bien la question de la croyance du spectateur dans les fictions cinématographiques qui est en jeu: cette nécessaire croyance s’appuie ici sur une évidence, que celle ou celui qui joue son propre rôle n’est pas dans le semblant. Je crois à la fois à ce que raconte d’elle ou de lui celle ou celui qui est filmé, mais je crois absolument qu’elle ou il existe hors du film, dans le monde que nous pensons réel parce qu’il est celui de notre soumission et de nos révoltes. La fiction cinématographique ne se substitue pas au monde, elle en fait valoir, tout au contraire, l’étrangeté, l’autonomie, l’indiscipline, la non-malléabilité. Nous trouvons là, cinéastes, la butée de réel qui nous évite de basculer dans l’illusion des illusions que le monde serait pliable et adaptable à merci.
Quelques notes sur Propagande et cinéma
[À la suite de la signature d’une convention-cadre entre le ministère des Armées et la Guilde des scénaristes, qui suggère une meilleure information des scénaristes de fiction français sur la chose militaire (et donc en rideau de fond le recours à « l’information embarquée »), l’émission d’Hervé Gardette, Du Grain à moudre, m’a invité à débattre le 4 octobre 2017. Pour l’occasion, j’ai pris quelques notes.]
Pourquoi inciter les scénaristes français de fiction à écrire des projets de films donnant de l’armée française une image plus précise, mieux documentée, plus juste? Et surtout, pourquoi aujourd’hui? Quel sens a cet effort pour une « meilleure propagande »?
1• L’une des réponses possibles est que les réalités des guerres aujourd’hui, telles que les relatent les journalistes de presse écrite ou que les filment les reporters de télévision, n’ont plus rien d’exaltant. Tout l’attirail romanesque/romantique, toute la « gloire » attachés aux guerres par le passé n’ont plus cours ou bien apparaissent comme « bidon » face à ce qu’on peut voir et comprendre des guerres totales en cours ici et là. Parler à des spectateurs civils de guerres et de missions militaires, si nationales-centrées qu’elles soient, ne peut occulter le fait que dans les guerres actuelles ce sont les civils qui sont visés et victimes, et que tout est bon pour détruire l’adversaire, civil et militaire, indifféremment, et avec lui ses femmes, ses enfants, ses demeures, ses rues, son quartier, ses références, rasées. Bref: l’horreur. Comment séduire alors que l’horreur baigne tout? Le mensonge est-il encore possible devant des atrocités indiscutables? Comment donner une image plus juste (= plus positive) des valeurs et servitudes militaires alors que nous savons bien les réalités de la guerre honteuses et inavouables?
2• Toute propagande avouée ou devinée comme telle perd son efficacité. Le spectateur n’est aveuglé ou berné qu’à un certain degré. Au-delà, il n’y croit plus. Or, le cinéma ne peut fonctionner qu’à la croyance. Une croyance faible ne suffit pas. Comment soulever cette croyance? Par le contexte (autrefois: une mobilisation en vue d’une guerre), sans doute; par les rapports de force idéologiques: un ennemi désignable et identifiable; et tout simplement par le besoin-désir de croire de tout être parlant…
Cependant: les publicités sont affichées comme telles et rien ne prouve qu’elles perdent toute force d’impact (ni le contraire). C’est que le spectateur, étant rassuré par l’annonce « ceci est une pub », sait qu’il n’est pas dupe et qu’on n’essaie pas de le duper (le produit promu serait-il en dessous de sa promesse). Donc, il y a une contradiction: la propagande ne doit pas s’avouer comme telle elle-même, elle peut être dénoncée par « l’autre » comme propagande, mais doit rester masquée pour fonctionner. Le « message » doit passer inaperçu ou paraître aussi anodin qu’un autre. La propagande, tant qu’elle n’est pas dénoncée, soit par « l’ennemi », soit par l’histoire elle-même (cas de Staline), reste implicite et subreptice. C’est sa condition.
3• Tout film, en tant qu’ensemble d’énoncés et de formes, transmet des éléments idéologiques, depuis les conditions de sa production et de sa réalisation jusqu’à sa diffusion et sa réception. Il n’y a pas de naissance innocente, pas de rencontre avec des spectateurs qui soit « neutre » ou « indifférente », le spectateur étant lui-même pris dans les rapports de force en cours. Ce principe général joue toujours et même d’autant mieux quand le projet est dénoncé comme clairement propagandiste: là encore, il faut interroger les circonstances et conditions du projet d’abord, de la mise en œuvre du tournage et du montage, ensuite, de la diffusion, enfin. Par un bout comme par l’autre, le film est idéologique, c’est-à-dire qu’il participe sinon d’une propagande déclarée, du moins d’une propagande par l’exemple. Les films deviennent vite et sans que l’on s’en aperçoive des modèles qui poussent à l’imitation. Les spectateurs sont supposés devoir imiter plus qu’inventer.
En tant que système de transmission d’ « informations », le cinéma est doublement acteur idéologique: par les énoncés explicites d’une part; par les expressions choisies, par les mots, les tournures de phrases, la sophistication syntaxique ou non, un film narratif (et tous les films ne le sont-ils pas, de même que « tous les films sont des films de fiction » — Christian Metz) passe à ses spectateurs des nappes d’informations, sur les significations des énoncés, mais aussi sur leurs formes, toute parole étant à la fois active (délivrant des éléments de sens) et observable, donc imitable (portant un sens par les formes qu’elle met en jeu). D’autre part, toutes les « informations » portées par un film ne sont pas de nature langagière: climats, ambiances, décors, lumières, sons, corps eux-mêmes, costumes, etc. L’insinuation idéologique passe par toutes sortes de chemins.
Reste à citer le cas paroxystique de la propagande par la terreur qui définit les films de Daech. Il ne s’agit plus de convaincre par persuasion, sous-entendus, connivences, mais au contraire de frapper de terreur le spectateur pour lui faire reconnaître la force et la puissance de l’entité qui produit et diffuse le film: tel était le cas, jadis, du grand film de propagande nazi, modèle des modèles, Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl (1935). Frapper l’imagination, couper la pensée, sidérer, abrutir, épater. Le spectateur est supposé être « ennemi », à effrayer pour le retourner. Un grand nombre de succès commerciaux hollywoodiens marchent à l’impression de terreur (tout comme les jeux vidéo), par l’abondance et la percussion des effets visuels et sonores. Ce n’est évidemment pas ce qui est souhaité par les services de communication de l’armée. Montrer le « quotidien » des militaires de façon plus précise, mieux informée, etc., c’est se débarrasser de ce qui fait encore rêver, jusque dans la peur, nombre de nos contemporains, fascinés par le bruit et la fureur, désireux d’une violence débridée.
4• Une remarque plus générale: il y a une ambiguïté fondamentale et irréductible dans la représentation filmée (« le réel n’est pas le représenté » — Barthes). Tout ce qui est filmé est potentiellement réversible. Les significations ne sont pas stables et peuvent être renversées. Une suite d’images reste ouverte à des interprétations divergentes. Le fonctionnement du hors-champ est un appel à l’imaginaire du spectateur. Une suite d’images ne peut avoir sens toute seule: il y a le contexte, le sous-texte, le savoir préalable du spectateur, etc. C’est une grande naïveté de croire que l’on peut maîtriser le sens d’une séquence de film. Tout ce qui est filmé puis projeté déborde plus ou moins la conscience que nous en avons. Une ambiguïté sera toujours là. Une image n’est ni vraie ni fausse: elle n’est qu’une image. Le spectateur sait que dans une fiction tout procède de l’artifice, du faux, pour en arriver à des effets de vérité; donc… il est possible de « rétablir » le faux dans son principe puisqu’il est partie prenante dans la genèse du film. Le spectateur de cinéma est l’être du doute, du « je sais bien mais quand même »; c’est-à-dire d’une adhésion partielle, non totalement aveuglée par ce qu’on lui montre. Il peut y avoir des combattants fanatiques sur l’écran, pas dans la salle.
5• À vrai dire, pour être fonctionnelle et éventuellement efficace, une propagande doit être portée par une vague idéologique d’ensemble. Une cohérence avec les médias, l’opinion publique, etc. C’était le cas des films de propagande nazis et staliniens, dépendants de leur moment historique. Entre l’écran et la salle, il pouvait y avoir concordance dans la croyance. Aujourd’hui, du côté des « grands » films, des « actus », des journaux, c’est la mort qui rayonne au centre des images et des sons de la violence. La pulsion de mort prend peu à peu en charge les pensées, les cauchemars, les désirs et les fantasmes de millions d’êtres parlants. Depuis bien longtemps, et en tous cas, pour rester contemporain, depuis les « kamikazes » japonais en 1941, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, les différentes formes de la Shoah, les camps de la mort en 42—45, les bombardements massifs des villes allemandes en 1944, la bombe A à Hiroshima et Nagasaki en 45, et toutes les guerres qui ont suivi, de plus en plus atroces, et encore davantage depuis les dictatures du Nord au Sud, depuis les attentats ou les « bombes humaines » terroristes et djihadistes, la mort est partout au rendez-vous. Elle occupe les écrans, petits et grands, elle construit les utopies qui tournent désormais autour d’elle, elle conduit les fanatiques à l’autosacrifice suicidaire, etc. Une contrepropagande vantant la vie ordinaire d’une caserne, d’une troupe ou d’un simple soldat me paraît faible au regard de la puissance d’attraction de la pulsion de mort (Malaise dans la civilisation, Freud, 1929).
Du réel au cinéma
Commençons par supposer qu’il y a « du » réel. Et partons du fait que la représentation du réel et le réel de la représentation ne sont pas la même chose. En toute représentation, dans le cours même du travail, à tout moment, pendant le spectacle et devant les spectateurs comme devant les acteurs (il n’y a dès lors plus de différence entre les uns et les autres) cette dimension de « réel » vient éclabousser les situations créées par la représentation.
Au théâtre, chaque représentation s’offre comme en holocauste à cette puissance du réel capable de l’interrompre et d’en changer la nature, d’en changer le sens. Un acteur se trompe en disant son texte, cas répertorié d’une intrusion non désirée d’un fragment de réel dans le spectacle: quelque chose de l’inconscient du comédien vient brouiller la séparation entre « réel et représenté ». L’accident prend une dimension de réel au sens où il est plus fort que la représentation.
L’exemple canonique en est l’attentat perpétré pendant la représentation d’une comédie musicale destinée à la jeunesse au théâtre Doubrovka de Moscou, le 23 octobre 2002. Une cinquantaine de terroristes tchétchènes prennent en otage huit cent cinquante spectateurs pendant trois joursNote des autrices. La prise d’otages du théâtre de Moscou est effectuée par un commando tchétchène qui retient 912 spectateurs pendant la comédie musicale destinée à la jeunesse Nord-Ost, du 23 au 26 octobre 2002 au théâtre Doubrovka de Moscou, à environ quatre kilomètres au sud-est du Kremlin. Ils réclament le départ des troupes russes de Tchétchénie et la fin de la seconde guerre de Tchétchénie.. Cet exemple de sinistre mémoire nous dit trois choses: 1/ que l’attentat (le passage à l’acte terroriste) interrompt brutalement la représentation et parfois, comme ici, l’arrête définitivement; 2/ qu’acteurs et spectateurs se retrouvent pendant la prise d’otages du même côté, confondus par une puissance plus forte qu’eux: l’irruption du réel de la guerre redistribue les places et les rôles, reconfigure les situations, exactement comme si une nouvelle représentation se greffait sur la première, la vidant de sa substance dans une sorte de geste vampirique; 3/ qu’au moment de la résolution (des gaz mortels sont diffusés dans la salle par les forces spéciales russes) tous les présents, spectateurs, acteurs, terroristes sont tués ou auraient pu l’être. Il n’y a plus qu’une seule catégorie de vivants: otages et preneurs d’otages sont confondus, tous destinés à une mort violente. Il n’est plus question de spectateurs ou d’acteurs. Double coup du réel: briser la représentation, abolir les frontières.
L’irruption d’un fragment de réel (la guerre, l’attentat) dans le temps suspendu de la représentation provoque d’abord un redoublement du spectaculaire: il y avait un spectacle sur la scène, il y en a maintenant un second; et les spectateurs restent spectateurs de ce second spectacle, mais pour un temps bref, instantanément ou presque ils sont transformés en prisonniers, en otages, en victimes. Dans ce qui va devenir au bout de quelques dizaines d’heures un face-à-face avec la mort, les êtres vivants perdent leur liberté et leurs qualités (les spectateurs sont censés être libres d’assister ou non à une représentation: ici, ce n’est plus le cas, ils ne peuvent plus sortir de la salle). Quand les gaz tuent tous les présents, ou presque, le réel en quelque sorte persiste et s’aggrave, la mort devenant l’une des figures de ce réel — dont nous persistons à penser, ne serait-ce que par cette inscription de la mort, qu’il est plus fort que tout spectacle, que la vie elle-même comme spectacle. Les spectateurs sont devenus acteurs et les acteurs meurent comme tous les mortels. On est sorti violemment, irrévocablement, de l’illusion spectaculaire: qui est avant tout celle d’une réversibilité de la mort. Tous les spectacles, théâtre et cinéma en tout cas (pas le cirque), sont des actes de foi vérifiables à chaque représentation de la relativité de la mort représentée. Poignardé, César se relève et va manger un sandwich à la cantine.
Dans cette mesure, le cinéma dit documentaire est équivalent au cinéma dit de fiction: la mort ne peut y être qu’imaginaire — à l’exception bien entendu des reportages de guerre où civils et soldats ne meurent pas seulement sur le petit écran, à l’exception encore de ce que l’on nomme des snuff movies, où les actrices et acteurs sont supposés être torturés et tués « pour de vrai » devant la caméra. Le soupçon d’un truquage persistera néanmoins tant la mort filmée, fut-elle réelle, s’apparente à un simulacre dès que l’on est dans un scénario, si atroce ou abject soit-il. Mais quand la mort casse tout, y compris la scène, y compris la possibilité qu’il y ait des spectateurs qui ne soient pas des acteurs, surgissent avec elle l’imprescriptible, l’irréversible, l’impossible du « jeu ».
Dans la majorité des cas, et c’est heureux, le cinéma dit documentaire ne peut traiter de la mort réelle des personnes réelles qui sont filmées qu’en l’évoquant comme déjà advenue ou bien toujours attendue. Je le redis: le sujet du cinéma est la représentation de la vie elle-même, qui, dans le cas du dit documentaire, passe par la relation réelle de corps réels et d’une caméra tout aussi réelle qui les enregistre et les reproduit comme, dès lors, des êtres de cinéma. Des êtres intermédiaires, semblant vivants et qui ne sont que des figures.
Je vise ici la dimension non représentable du Réel (avec une majuscule qui en marque la dimension pensable-impensable) dont le rôle dans nos sociétés et dans nos existences s’apparenterait à un attentat (un passage à l’acte) non seulement contre le confort d’une situation connue (contre la répétition même: un théâtre, un spectacle) mais contre l’illusion que les représentations pourraient effectivement toucher au réel: quand le hasard ou le destin font que c’est le cas, ce réel les détruit. Il y aurait une sorte d’incompatibilité entre la dimension d’un quelconque bout de réel et celle de tout simulacre. L’illusion serait de croire que les représentations, condensés d’artifices (elles sont pensées, écrites, voulues, jouées, vues et entendues) pourraient résister à l’irruption, elle non artificielle, d’un bout de ce réel qui représente, lui, la réalité non réversible de la mort.
C’est aussi pourquoi la question de la représentation des pouvoirs en acte dans nos sociétés n’est possible que comme fiction, simulacre, jeu. Ces pouvoirs ont bien souvent droit de vie et de mort sur celles ou ceux qui font les films dits documentaires, qui les regardent, etc. Ce qu’ils peuvent autoriser, c’est le mensonge qui masque cette dimension fatale. Filmer la mafia en documentaire, par exemple, suppose que l’on accepte de faire croire à la fiction produite par la mafia, au petit théâtre qu’elle veut bien mettre en scène pour satisfaire fallacieusement notre curiosité ou pour redoubler nos inquiétudes. Autrement dit, rien du réel de la mafia (par exemple, mais il est possible de mener le même raisonnement à propos du Vatican ou du Kremlin, etc.). Autrement dit, ce qu’il est possible de filmer en documentaire suppose une autorisation qui transforme comme par un coup de baguette magique une situation réelle, complexe, opaque, en une scène autorisée, c’est-à-dire aseptisée. J’en veux pour preuve le recours de plus en plus fréquent dans les reportages de télévision à une caméra cachée, censée ne pas altérer la vérité de la chose filmée. Or nous savons qu’une caméra cachée est en mesure, en effet, de révéler des vérités cachées, ou des états que ceux qui en ont le pouvoir préfèrent ne pas montrer, mais du même coup l’on sort du cinéma, documentaire ou fiction, en modifiant radicalement la place du spectateur, changée en celle d’un espion. Le spectateur, la spectatrice sont les sujets du cinéma, elles et ils sont dans les mêmes faiblesses que celles et ceux qui font des films: il y a des interdits, des tabous, des dangers à traiter de la perversité toujours masquée des pouvoirs, quels qu’ils soient. Le dénoncer par un truquage de la place du spectateur, devenu l’œil d’un dieu omnivoyant, c’est désigner la faiblesse de la représentation à dépasser ou à contourner les interdits sociaux. La carte du représentable comprend ainsi des taches d’invisibilité, des zones grises où filmer ne peut se faire que par effraction, en altérant profondément la place du spectateur réduit au trou de serrure.
La somme des réels infilmables directement (analogiquement) dessine une carte du monde qui est celle de la liberté des citoyens. Comme l’écrivait Christian Metz, tous les films sont des films de fiction. J’ajoute que ceux qui ne veulent pas le dire sont des films de pleine illusion. Où il est menti sur l’état politique du monde, tel que les multiples interdits doivent se cacher et que les maîtres du visible ont tout intérêt à nier en diffusant des fables (tel Le Parrain, un et deux). C’est en devenant celui qui témoigne des interdits que le cinéma documentaire tient un discours de vérité sur notre monde.
En marge de l’exotisme
Deux films récents, qu’on dit « documentaires », Mafrouza, d’Emmanuelle Demoris, et Kurdish Lover de Clarisse Hahn, nous posent une série de questions sur: 1/ la nature de l’amour mis en jeu dans le geste de filmer en « documentaire »; 2/ la relation du cinéma dit « documentaire » à une réalité donnée comme extérieure au film (non scénarisée); 3/ l’intérêt de mener à bien l’aventure d’un tournage et la mise en forme d’un film au regard des enjeux de sens et de luttes contemporains.
1/ Le cinéma dit « documentaire » peut être attendu et défini comme rendant compte d’une réalité vécue « pour de vrai » — autrement dit non inventée, non imaginaire, mais prenant appui sur la vie réelle de personnes tout aussi réelles (si tant est qu’au regard de soi-même et des autres l’on puisse se penser « réel »), appartenant donc au même monde que nous, quand bien même (Égypte, Kurdistan) nous n’en saurions rien de très précis. Ces personnes appelées à être filmées, et d’accord pour l’être (celles qui ne veulent pas ne sont pas filmées), ont une vie antérieure au surgissement du film dans leur quotidien. Elles ont une histoire en partie seulement façonnée par les formes et les histoires qui viennent du cinéma, de la télévision, du spectacle. Une histoire qui tient à leur famille, à leur ancrage social, à leur religion, à leurs combats, etc. Le cinéma surgit au milieu d’un champ bien encombré, déjà organisé, déjà partagé ou tendu entre diverses mises en scène de diverses institutions, à commencer par la famille, l’église ou la mosquée, la bande, le quartier, l’école, l’armée, etc. Le travail du film revient en partie à se greffer sur ce qui est déjà là, pour y trouver appui, bribes de scénario, situations… Mais l’autre part du travail est bien de démonter ou de déconstruire ces structures organisées et les récits qu’elles portent. En vue de quoi? Pour tout simplement, mais c’est essentiel, faire apparaître les individus qui sont engagés dans ces structures, les faire apparaître comme des sujets, au sens de la subjectivité, c’est-à-dire comme des personnes porteuses d’une dimension de personnages, porteuses d’une fiction personnelle elle-même constituée ou construite à partir des attaches à ces institutions, notamment à la famille, ou bien encore à partir des débris qui restent de ces attaches quand elles sont rompues. Le travail dit « documentaire » consiste avant tout à révéler des subjectivités dans les corps filmés. C’est ce qui a lieu tout au long des dix heures de Mafrouza. C’est ce qui a lieu, de façon nettement plus ponctuelle, avec la grand-mère de Kurdish Lover. Celle-ci, très visiblement, désire jouer avec la caméra, jouer au cinéma. Elle le fait, d’entrée de jeu. Elle joue en même temps avec son éventuelle future bru — mais c’est elle, Clarisse Hahn, qui justement la filme. Significativement, la réalisatrice a placé cette séquence en ouverture « documentaire » de son film (avant, il s’agit d’une « image en mouvement », autant dire d’art plastique, où des corps de jeunes hommes se joignent et se déjoignent). La vieille femme ouvre véritablement le film (qui ne suivra pas cette piste). Peut-être se sait-elle encore séduisante et impertinente en dépit de son grand âge; ou bien, plus simplement encore, trouve-t-elle dans sa familiarité avec la machine cinématographique l’occasion d’une revanche sur les autres femmes de la famille qui, semble-t-il, la méprisent. Voici donc que cette femme plus insultée qu’aimée (apparemment, à moins que les insultes ne soient des preuves d’amour) devient pour quelques minutes une sorte de diva de cinéma. Puissante et maligne, elle parle d’argent. Elle demande à la réalisatrice de la payer. Payer pour jouer, jouer pour payer de sa personne. L’instant d’incertitude ainsi ouvert de main de maître lance le film vers un horizon juste: qu’est-ce que filmer, être filmé(e), quel contrat, dit ou non dit, quelle histoire en gestation à partir du double geste de filmer et d’être filmé(e)? On peut ajouter: de marier et d’être marié? Cette question, argent en moins, corps en plus, revient et hante Mafrouza. Sans cesse, et justement, ceux ou celles qui sont filmés se demandent ou demandent à Emmanuelle Demoris, à moitié cachée par sa caméra, à quoi rime ce film, à quoi il sert? Ce sont généralement les questions que l’on pose aux objets inutiles et indispensables. Demoris répond en filmant encore. Hahn, non. C’est comme si la vieille femme, traitée de « gitane » et d’autres noms encore, à la fois l’avait attirée, oui, bien sûr, et n’avait pas suffi à la satisfaire. Et c’est bien dommage. Le personnage important, la narratrice, la créatrice de situations et de ruptures était apparue, n’est pas revenue. La réalisatrice l’a filmée, et donc l’a vue et entendue. Mais elle avait en tête un schéma plus choral: la famille du « lover ». On peut interroger — de loin, de très loin — les pentes de l’inconscient qui ont fait choisir de ne pas filmer (ou monter) davantage le « lover » et la grand-mère, en dépit de leur connivence éblouissante, et de leur préférer d’entrer dans le cercle de famille pour n’en point ressortir, ou si peu. Or, cette famille kurde nous est montrée comme à la fois mystique — mais de quelle croyance, de quel désir d’infini? — et querelleuse, débordante de plaintes et de récriminations. Triste Kurdistan. (À propos, où sont les vaillants guerriers kurdes? Non pas dans le hors-champ du film, mais dans le hors-film du champ.) Comment Clarisse Hahn, artiste, a-t-elle pu filmer ainsi ce qui est, ou sera, sa future famille? Pour nous en écarter à jamais? Pour s’en écarter elle-même? Abîmes de l’inconscient qui régit le cinéma dit « documentaire » et qui fait, justement, son prix. Il suffit, encore une fois, de se reporter à Mafrouza, filmé par une jeune femme elle aussi, embringuée dans une histoire d’amour sans autre horizon que le film, pour comprendre qu’une famille filmée c’est complexe, les non-dits plus irrémédiables encore que dans la vraie vie. L’opération cinématographique appelle chaque personne filmée à aller vers son être, ce qui d’elle est essentiel et qu’elle ne connaît, alors, que par la grâce de la confrontation avec une caméra, avec un désir de film. Savons-nous comment nous sommes avec les autres? Les familiers? D’autres moins familiers? Cette intruse caméra, que veut-elle de nous? Ces questions peut-être un instant conscientes n’ont de résolution qu’en dehors de toute conscience. Comment penser le nœud où l’on est pris? Et le nœud du nœud quand la caméra s’en mêle. La force indiscutable du cinéma est qu’il implique des sujets au-delà de ce qu’ils en savent ou peuvent en deviner. Jamais un modèle en peinture, en sculpture, jamais un danseur ou une danseuse, jamais l’interprète d’une musique ne se sera trouvé face à lui-même dans une violence de cinéma. Singularité du cinéma de passer à travers des corps et des subjectivités, de les détourner ou retourner, d’aller jusqu’à l’abus. Ceci je crois n’a pas été souligné assez puisque le cinéma a été pensé à partir des comédiens de métier et non des personnes dites « réelles » dont la vie est en grande partie hors-cinéma.
Que celles et ceux qui sont filmés tombent dans la tentation d’être moins puissants à l’écran qu’ils ne sont dans la vie (et quelle que soit cette puissance, puisqu’il s’agit d’une puissance d’être), c’est le signe indiscutable que la demande de la réalisation était faible, très faible. Nous devons engager l’autre — comme dans toute histoire d’amour — à se porter au-delà de lui-même et à nous porter au-delà de nous-mêmes, au-delà de lui ou d’elle. Je ne délire pas. Voyez Mafrouza, voyez La Moindre des choses de Nicolas Philibert, ou Coûte que coûte, de Claire Simon. Mais bien avant ces deux-là, voyez Moi, un Noir de Jean Rouch, ou Pour la suite du monde, de Pierre Perrault et Michel Brault, et vous conviendrez de ce que rien d’excessif ne ruine mon propos. Le cinéma est fait pour ça, a été inventé pour ça: pour confronter le spectateur à un état des êtres insoupçonnable dans la vie ordinaire. Le cinéma mime cette vie ordinaire, la restitue dans toute sa familiarité, mais en vérité pour en faire surgir des êtres de cinéma qui nous étonnent, nous surprennent, nous font comprendre que nous avons devant nous, spectateurs, non seulement un écran, mais un horizon de vie riche de tant de possibles. C’est ce que je nomme fiction au cœur même de ce qu’on dit documentaire. Le spectateur de cinéma (moi) n’est pas là seulement par curiosité — il y a tant de moyens de satisfaire ses curiosités —, il est là pour se projeter, grâce à l’image des autres, grâce aux corps filmés, dans un ailleurs dont il ne sait rien mais qu’il va reconnaître comme possiblement le sien. C’est pourquoi les commentaires sont toujours de trop; c’est pourquoi je, nous, nous efforçons de faire arriver les informations minimales nécessaires par la bouche même des personnes filmées et non par celle d’un narrateur tout puissant et bien plus fort que le spectateur. (Mettons à part les commentaires de Jean Rouch, que j’entends comme plus poétiques qu’informatifs ou ethnologiques). Donc, la vraie vie est ailleurs, sur l’écran.
C’est là que le rapprochement (ne parlons pas de comparaison) entre Mafrouza et Kurdish Lover devient cruel pour ce dernier film. N’objectons pas à Mafrouza d’arguer de sa durée exceptionnelle pour être capable de construire des personnages. Cela arrive dès le premier film de la série: Oh la nuit! Car c’est le croisement aléatoire mais certain de deux désirs de film qui ouvre à la constitution de personnages. Désir de filmer à la rencontre du désir d’être filmé. Pourquoi vouloir des personnages? On ne filme pas l’autre impunément. Il y a un engagement, un jeu permanent entre l’approche et la distance. Mafrouza, Emmanuelle Demoris comme cadreuse, filmeuse, elle-même personnage, est engagée dans ce combat obscur entre trop près et plus loin. Séduction de l’autre, séduction par l’autre, et distance au plus près de ces séductions pour qu’il y ait un film et non point une histoire d’amour qui aura été peut-être vécue, mais cinématographiquement stérile, donc incommunicable. Dans Kurdish Lover, le titre est trop menteur, l’amour est supposé au départ mais point affronté dans la suite: le Kurdish Lover est, premières minutes mises à part, pour ainsi dire absent du film. C’est évidemment discutable. L’objet de l’attention de la cinéaste se centre sur la famille de son lover. Étrange: ce qu’elle fait de cette famille nous donne à penser qu’elle n’y aura jamais sa place. Ou qu’il vaut mieux qu’au lieu de la filmer elle la fuie.
L’amour est au cinéma, dans la pratique du cinéma, non pas ce qui est filmé entre deux personn(ag)es ou deux comédiens, mais ce qui permet de filmer; non ce qui est représenté, mais ce qui installe la ligne de bascule entre vie et art, vécu et créé — et ce n’est pas rien. Filmer c’est ne pas vivre sa vie, mais faire scène de la vie des autres. Je dois, parlant un instant de mon expérience documentaire, avouer être tombé amoureux de la plupart des femmes et de quelques-uns des hommes que j’ai filmés. Amour immédiatement injecté (je choisis le mot) dans le film. Nous avons fait l’amour, elle, eux, moi, en faisant un film. Après tout, c’est une vraie histoire, pas plus stupide, ou pas moins, que celle de la Bible. Mais autant Emmanuelle Demoris filme son éventuel et impossible « lover », le laissant s’avancer dans son amour pour elle sans cesser de le retenir, pour qu’encore il avance; autant Clarisse Hahn ne filme pas le sien, qui disparaît à peu près du film. Pourquoi? Elle n’a pas la force/le désir de le filmer? Elle ne l’aime plus? Elle trouve sa famille plus intéressante que lui? Les réponses à ces questions, nécessairement inconvenantes, sont à laisser au spectateur. Elles ne sont dans tous les cas pas dans le film, qui de ce point de vue s’apparente à un tour de passe-passe: le Kurde amoureux est là… amstragram, il n’est plus là.
2/ L’autre mot du titre de Kurdish Lover est le premier: Kurde. Nous entrons dans une famille Kurde dont nous ne savons à peu près qu’une chose, dite dans un carton d’ouverture, qu’elle est Kurde et qu’elle est la famille du lover de Clarisse Hahn. Or, Kurde se réfère à une réalité plurielle, stratifiée par l’histoire, des siècles d’histoire, « un pays qui n’existe pas », comme dit le carton initial, mais qui pour exister est tout de même en guerre sur trois fronts depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, Iran, Turquie, Irak. Je veux bien qu’entre le film et ses référents il y ait un hiatus nécessaire: le cinéma rend compte du monde en s’en écartant, en se constituant comme disjonction, coupure. Pour que cette subtile mise à distance puisse se produire, il faudrait, comme disait Bertolt Brecht, un peu de son contraire, autrement dit une inscription fût-elle non insistante de la réalité référentielle sur laquelle prend appui (ou prétexte) le film en train de se faire. L’un des mérites de Mafrouza, par exemple, est de ne pas escamoter la question religieuse, traitée directement par les personnages du film et devenant même l’enjeu du dernier film de la série. Mais il y a aussi des portes étroites pour faire passer quelque chose de la violence sociale, armée ou délinquance. Force est de constater que ce n’est guère le cas dans Kurdish Lover. Pour ce peuple en guerres multiples et civiles, pour ce peuple politisé par ses souffrances mêmes et dont les principaux partis à la fois sont persécutés et se déchirent (DKP et PKK), il semble bien difficile de ne rien montrer, de ne rien faire arriver dans le film qui ait rapport à ces réalités non seulement vécues, mais déchirantes, obsédantes. S’ouvre là un trou noir qui désigne non point les réalités de référence mais le souci de ne point les montrer dans leurs complexités. Les westerns de la grande époque hollywoodienne étaient moins muets, moins sourds et moins aveugles sur la survivance des peuples indiens en cours d’extermination. D’ailleurs, comment comprendre la violence ou l’outrance des disputes à l’intérieur de la famille sans, à l’extérieur, la pression d’un monde abîmé? Duquel, donc, rien ne nous sera montré ni dit.
Pas plus que le cinéma dit « documentaire » ne se réduit à une leçon sur les référents qu’il traverse inévitablement, filmant ici et maintenant, le cinéma tout court ne peut éviter, et c’est toute sa difficulté, de filmer quelque chose du monde où il est, où il filme, où il opère, fût-ce dans la plus délurée des fictions. Il y a une fatalité du monde réel à coller au cinéma, lequel à son tour travaille à s’en décoller. C’est ce mouvement à la fois d’attachement et d’arrachement qui fait toute la beauté de l’opération cinématographique. Je pense très précisément au film d’Abbas Kiarostami, dont les référents géographiques et mythologiques ne sont pas si distants de ceux de Kurdish Lover, qui n’est jamais seulement « ethnographique », qui ne fournit nulle explication aux mystères qui percent le film de grottes et de rites inconnus, mais qui mettant en scène des étrangers (relatifs) nous fait ressentir ce que c’est que de ne pas comprendre l’autre chez qui l’on est. Ici, la réalisatrice ne comprend (probablement) rien à ce qu’elle filme, mais comme elle ne se met pas en scène, c’est le spectateur, moi, toi, qui se trouve placé face à un monde obscur et dont il manquerait les clés. Je veux bien qu’on parle de « fascination » pour l’étrangeté de l’autre: là est le piège, qui institue une rupture entre l’autre et moi et me fait savoir insolemment que de l’autre je n’ai rien à apprendre, qu’il reste une chose confuse et non aimable. L’amour, encore, comme passage à une relation qui ne soit pas de simple curiosité. Le spectateur de cinéma est un curieux, oui, mais un curieux d’un genre à part: il est curieux de ce qui peut revenir vers lui en l’impliquant, de l’effet boomerang de tout voyeurisme, où c’est le sujet qui se projetant dans son désir de voir lui donne une dimension plus troublante.
3/ Un détail. Qui pour moi fait symptôme. Tout se passe dans ce film, Kurdish Lover, comme si la petite famille filmée était placée en dehors de notre monde mondialisé. On se souvient de l’aventure de la télévision dans Et la vie continue du même Abbas Kiarostami. Des livres et de la radio dans Mafrouza. Plus la télévision, encore. Comment dire que dans Kurdish Lover, la seule trace de ce présent médiatique qui est le nôtre est la caméra de Clarisse Hahn? Je veux bien que ce petit coin du Kurdistan soit à ce point coupé du monde. On y arrive et on en repart, pourtant. Et la légère fièvre paranoïaque qui s’empare de deux soldats, turcs me dit-on (hors du film) à la vue précisément de la caméra de la réalisatrice, indique bien la piste abandonnée: là comme ailleurs, les images posent problème, les informations, qu’elles manquent ou ne manquent pas, le bruit des médias, même lointains. C’est comme si Clarisse Hahn, le voulant ou non, s’était placée dans un temps d’avant, d’avant la télé, d’avant le cinéma — alors même qu’elle fait un film!
Mais le monde dont les guerres kurdes sont parties prenantes, avec des enjeux politiques et stratégiques majeurs, est un monde où se déchaine la bataille de l’information, y compris pour les Kurdes. Ce film, nous ne l’avons pas vu, nous avons vu le mysticisme de cette famille, le film reste à faire.
Triomphe du virtuel
« Si le capital n’existe plus, ni sa critique marxiste, c’est que la loi de la valeur est passée dans l’autogestion de la survie sous toutes ses formes. Si le cimetière n’existe plus, c’est que les villes modernes tout entières en assument la fonction. Elles sont villes mortes et villes de mort. Et si la grande métropole opérationnelle est la forme accomplie de toute une culture, alors tout simplement la nôtre est une culture de mort. » — Jean Baudrillard, Le Paroxyste indifférent, 1997.
Un. Il y a dans La Marseillaise de Jean Renoir une séquence célèbre où l’on voit quelques-uns des nobles émigrés à Coblence pour fuir la Révolution s’essayer à retrouver les pas et les gestes du menuet tel qu’on le dansait à Versailles quelques semaines auparavant. Cette tâche n’est pas facile, les ci-devant ne sont pas d’accord entre eux, ils ont oublié, ils restent perplexes au plein de la danse: faut-il plier le genou, faut-il saluer avant ou après… — et nous, spectateurs, sommes amenés à constater qu’un monde de rites, de règles, de gestes répétés, de familiarités, est en train de disparaître, en même temps que la mémoire corporelle de celles et ceux qui les pratiquaient. Les habitudes se perdent. D’autres les remplacent. Le corps est dressable. L’esprit l’est aussi. L’un et l’autre jusqu’à un certain point, bien sûr. Dresser, redresser — ce sont deux paragraphes du programme des sociétés de contrôle, et même de contrôle renforcé par la « crise » que nous traversons.
Car voilà que la pandémie s’installe. Tout paraît se perdre, tout devoir se réinventer. C’est ainsi que nous sommes collectivement entraînés à virtualiser les relations qui nous définissaient les uns les autres comme réels et réciproques. En quelques jours, les salles de cinéma sont fermées par précaution, comme tout le reste de ce qui pouvait être fréquenté par un public, nos relations sont requises de passer au virtuel — jusqu’aux apéros devenus apéros virtuels. Ce qui devrait faire rire. Mais non. Tout le réel de nos rapports aux autres est transféré sur écran. Éloigné, en somme, mis en cadre, à part. Nous ne sommes plus dans une salle, nous sommes devant un écran. Nous étions à l’intérieur du cocon-cinéma, nous sommes à l’extérieur. J’espère bien que ça ne durera pas longtemps et que les vieilles bonnes habitudes (s’embrasser par exemple) reviendront. Sait-on jamais? Une épidémie peut cacher un pire à venir. Cette séparation: devant et pas dans, les travailleurs devant des écrans et séparés du devenir de leur propre travail, les spécialisations éloignant les uns des autres, les segmentations de tous ordres — nous en avions critiqué le principe comme l’un des effets malheureux du capitalismeNote des autrices. Cinéma, numérique, survie, Jean-Louis Comolli, ENS Éditions, coll. Tohu-Bohu, Lyon, 2019.. L’étonnant est que cette politique de séparation soit recoupée par une pandémie imposant des écarts en tous genres et qu’ainsi soient marqués d’un côté comme de l’autre la séparation des corps, leur éloignement, leur isolement. Le corps en tant que partageable devient souvenir d’un très récent passé. Ça va changer, à coup sûr. Ça va revenir, nous dit-on. Et quant à moi je l’espère vivement, ce retour des corps. Mais on perçoit bien une convergence de fait entre d’une part la logique d’isolement, la pratique de séparation qui caractérisent depuis les années 30 la version militante du néolibéralisme (qui n’est jamais qu’un capitalisme exacerbé: Milton Friedman — voir le « Il faut s’adapter » de Barbara Stiegler) et d’autre part le principe de sécurité qui sépare les corps les uns des autres.
Deux. Le monde est venu à nous, confinés que nous étions, que nous sommes encore, il est venu en images, sur des écrans, et nous nous sommes réjouis de participer en spectateurs au double triomphe du virtuel et du numérique. Dans cette cuirasse numérique, le Virtuel s’est montré capable de briser notre quotidien, de mettre en nos écrans de quoi trembler de désir ou de peur, de régir à peu près tout ce qui nous semble utile. Tout, d’ailleurs, passe au virtuel, les spectacles, bien sûr, qui y sont depuis les premières projections publiques du cinématographe Lumière — il y a désormais des « e-cinéma »… Mais aussi le travail (télétravail), l’école (cours en vidéo), les consultations médicales (Doctolib), les cérémonies religieuses in absentia — ce qui ne change rien, il est vrai, quant à la « présence réelle » —, les matchs de foot à huis-clos, sauf pour les téléspectateurs, et ainsi de suite. La télévision, la télétransmission portaient déjà dans leur nom un principe de distance (« télé »), tout à fait justifié, mais dont nous savons qu’y supplée parfaitement notre désir, voire notre bonheur d’une relation imaginaire avec les représentations de choses ou de corps. (De la même manière, on peut interroger la téléréalité qui n’a pas cessé de sévir comme réalité éloignée.)
À la longue (les projections cinématographiques sont âgées de cent vingt-cinq ans), le virtuel s’est imposé non seulement pour les raisons pratiques et techniques que l’on sait (la salle de cinéma, les télévisions, les ordinateurs, la vitesse…) mais, je crois, parce que nous nous sommes mis à aimer le virtuel (le commerce y a beaucoup aidé). Aimer le virtuel c’est aimer l’apprivoisé. Pour devenir virtuel, c’est-à-dire possible et en partie inoffensif, le visible doit passer par une machine à montrer. Le tangible devenir image. Le virtuel est comme un jeu où le joueur ne risque rien d’essentiel. Il n’y a ni gain ni perte. Le passage à l’image fait du « monde réel » un joujou. Ajustable à toutes surfaces et toutes durées. Réversible. En quantité d’occurrences, le virtuel se révèle plus praticable, plus souple, plus facile, plus propre, plus « moderne » et plus séduisant, en somme, que tout ce qui relève (encore) du réel. Et, par-dessus tout, le virtuel partage avec les rêves une légèreté, une immatérialité qui l’apparente aux opérations mentales. Tout l’effort des inventeurs du cinéma (les Lumière, Marey…) a été de fabriquer une machinerie produisant des effets immatériels qui puissent être vus par mille paires d’yeux et donner l’illusion de la réalité la plus matérielle.
Trois. Plus que la photo (et par la grâce de la reproduction du mouvement) le cinéma a généralisé l’expérience spectatorielle d’images de corps ressemblants et crédibles. Ces images sont virtuelles en tant qu’elles sont comme en réserve dans le projecteur, n’apparaissant qu’à la condition de leur projection sur un écran ou, comme récemment encore, de leur enregistrement sur un ruban de pellicule. (Toutes les images évidemment ne sont pas virtuelles: mosaïques, peintures, épreuves photographiques… les figurations liées à des matières sont durables et tangibles). Que les images cinématographiques soient produites par le faisceau d’un projecteur ou par une multitude de pixels, elles ont la propriété, projetées, de se dissoudre les unes dans les autres, de se remplacer les unes les autres; ce n’est donc que par commodité que l’on dit « une » image: au cinéma, il y en a, physiques ou potentielles, toujours 24 ou 25 par seconde — et c’est pourquoi la photographie (une image à la fois) couchée sur papier est plus tangible que le film ou le fichier. (Les « écrans tactiles » ne nous offrent qu’un pauvre toucher: l’écran est sensible à la pression de mes doigts, mais ces doigts ne ressentent rien de plus qu’une surface plate.)
Apparaissant sur un écran, les images font à leur tour apparaître les corps filmés comme virtuelsÀ commencer par les corps-signaux des films expérimentaux de Étienne-Jules Marey avant même la mise en point du Cinématographe Lumière.. Le corps de cinéma, le corps filmé, n’est évidemment pas le corps réel. Les images sont enfermées dans un cadre. Il leur manque, ensuite, une dimension, la 3e, le relief, l’épaisseur; de même que leur fait défaut toute capacité haptique. Ce corps virtuel n’est cependant pas rien: il vient de ce que nos cultures ont élaboré à travers toutes sortes de pratiques figuratives et de modes de représentation depuis des sièclesEt quant à la dimension de la ressemblance, elle advient avec les portraits du Fayoum. Cf. L’Apostrophe muette, Jean-Christophe Bailly, 1997.. Et pour nous, depuis 1895, filmés, les corps ont été transformés en images ressemblantes. C’est donc en tant qu’il les change en images, les faisant passer du réel au virtuel, que le cinéma a affaire aux corps. Quant aux corps jouant — qui ont affaire, eux, à une caméra —, ils nous font retrouver le plan du réel: le corps en train d’être filmé réagit, s’adapte ou non au cadre mis en jeu. Il y a relation matérielle entre corps et machine et induction psychologique chez le sujet filmé.
Virtualisé, le corps n’est pas seulement désincarné: il est aseptisé. Les images des corps filmés sont moins dangereuses que les corps dont elles donnent l’image. C’est ainsi qu’à la longue nous avons été formés par les images à la possibilité d’un corps inoffensif. Le contagieux, filmé, ne transmet que son image. Ce que nous observons, alors que la pandémie du Covid-19 est toujours en cours et qu’un vaccin est toujours espéré, c’est que le corps à corps des relations entre humains tend à devenir imaginaire, comme dans les rêves ou les fantasmes. Jusqu’en mars 2020, ce n’était pas le cas. On se touchait, s’embrassait, se caressait, se boxait, se renversait… tous gestes devenus inappropriés et fortement déconseillésLire la tribune de David Le Breton: « Coronavirus: le port du masque défigure le lien social », Le Monde, 11 mai 2020..
La distance qui s’impose abolit le toucher. Les images sont en effet l’une des manifestations de l’intouchable. On en verrait la preuve dans la multiplication des œuvres peintes qui représentent la scène des Évangiles: une trentaine d’artistes ont peint le Noli me tangere (« Ne me touche pas ») entre 1300 et 1650, dont Giotto, Fra Angelico, Martin Schongauer, Titien, Poussin, Le Corrège, Hans Baldung, Véronèse, etc. Ce concours de talents autour d’une même phrase dit bien l’écart entre visible et tactile. Voir sans toucher. De quoi intriguer et fasciner le régime des imagesCf. Perdre de vue, Jean-Bertrand Pontalis Gallimard-Folio, 1999..
La virtuelle, cette autre réalité, est soudain généralisée par la conjonction de la pandémie avec la numérisation du vivant. La dimension tactile (haptique) qui est probablement une donnée première (on naît sans voir mais en touchant/étant touché) est déplacée dans des calculs. Alors que le virus, lui, agit par contact. Sans passer par des suites de 0 et de 1 — comme les « virus » informatiques.
Pour nous, le contact — tactile — est l’une des dimensions de l’expérience de vivre que nous recherchons. Et le toucher, comment ne pas le dire, joue un rôle dans tout nouage érotique. Qu’adviendra-t-il des caresses? Encore que la mise à distance n’empêche pas l’éros de se manifester par toutes sortes de signes. La distance en est un, paradoxalement, tant distance en érotisme est ruser et différer. Distance, mais avec promesse de toucher. Le contact charnel ne peut être seulement imaginaire. Le toucher est d’abord un besoin de matière, la main veut de la chair, du sable, de l’argile, du liquide… L’image cinématographique peut nous donner l’illusion de « toucher du doigt » telle surface, de ressentir tel grain de peau, mais nous savons bien que ce n’est qu’illusion. Il est un moment où l’image de la chair, par exemple, appelle la main mieux que l’œil. Et ce régime favorisant le visible devient de ce fait source de frustration et début de conscience de ce que la représentation cinématographique du monde n’est pas le monde. Frustration, ici, comme condition de penser. (Souvent, j’ai voulu filmer des photographies ou des photogrammes touchés par des mains, rétablissant par l’image le rôle majeur du tactile.) Cette dimension haptique que semble barrer le régime des images, le spectateur la rétablit imaginairement: il est placé sous le régime de l’imitation et l’image d’un toucher ou d’une caresse suscite bien souvent des sensations-miroir.
Quatre. À partir de là, c’est à peu près tous les films qui sont en porte-à-faux; nous verrons comment ça se passe pour les prochains tournages: si la pandémie est appelée à durer, et les nouvelles manières avec elle, comment feront les films à venir? Fictions et documentaires? Nos stars joueront-elles avec un masque? Les baisers seront-ils abolisLa question du baiser filmé est sérieusement posée. Je cite Claude Lelouch: « C’est vrai que les baisers de cinéma, avec le confinement, il va y avoir des obstacles supplémentaires. Mais il va falloir que les amoureux soient un petit peu plus courageux que d’habitude. »? Les coups? Les danses? Respecter les consignes en cours serait se forcer à une hygiène visuelle pire que le Code HaysEn vigueur entre 1930 et fin 1960, et mis en application par la Motion Picture Association of America, ce code opérait par « autodiscipline » de la production. On lui doit les plus intenses moments érotiques de l’histoire du cinéma: pas de nudité, baisers brefs, le moins de corps visible possible, de chastes étreintes…. Les transgresser serait s’exposer au défaut d’irréalisme ou d’anachronisme. Or, il est dans l’éthique du cinéma, dans son moteur même, d’enregistrer les apparences et de figurer le semblable. La question de la ressemblance, qui est celle aussi de la reconnaissance, est devenue question de police et de logiciel. C’est cette double question, reconnaître, ressembler, qui se pose dans la relation entre corps filmés et corps spectateurs. Au cinéma, un principe de reconnaissance est toujours en vigueur. C’est à la fois un point de départ historique (Lumière) et une nécessité psychologique: celles et ceux qui vont voir des films dans les circuits commerciaux comme dans les salles d’art, sont dans l’attente de se reconnaître dans les corps filmés. Exactement comme un corps reconnaît un autre corps, sans préambule ni rituel. Le « dialogue » des corps est immédiat, réflexe. Au cinéma, les corps dans la salle et les corps sur l’écran sont censés se reconnaître comme semblables, en deçà de leurs différences. Les singularités passent par des proximités.
Ce n’est pas seulement que la société soit devenue spectaculaire (Guy Debord, 1967) — c’est que le spectacle s’est concentré: désormais, le visible se donne et se dose principalement sur des écrans, et plus souvent petits que grands. On pouvait avoir cru en la réalité du monde, c’était ensuite le spectacle qui devenait réalité (Debord, Jean Baudrillard), et c’est aujourd’hui la réalité du spectacle qui passe des espaces réels aux virtuels, des salles de cinéma, des stades, des théâtres, aux écrans et aux cadres. Au cinéma, dans une salle, sur un grand écran, les fantômes ont la même « réalité », filmés, que les corps vivants et jouant.
Au visible non cadré, disais-je, s’est opposé le visible cadréCf. Corps et cadre, Jean-Louis Comolli, Verdier, 2012.. Ainsi le virtuel fabrique-t-il une sorte de réalité (la « réalité virtuelle ») qui dément toutes les réalités actualisables: le virtuel n’est pas seulement une modalité des représentations, il est un différé temporel. Les représentations mécaniques jouent avec le temps: ce qui a été tourné hier est — toujours — vu au présent. Cet écart à lui seul nous signale que l’on passe du réel au virtuel. Le réel n’est pas reproductible; le virtuel l’est. Et les écrans imposant un cadre à tout ce qu’ils représentent, un soulignement spatial se conjugue avec un décentrement temporel. Le virtuel articule le maintenant de la représentation avec le passé de la chose ou de l’action représentée. Deux temps se conjuguent et se masquent: c’est assez pour dédoubler la conscience du temps, la fissurer et faire ressentir une disjonction, un écart — les portes du temps sont disjointes — « the times is out of joint »Dans l’Hamlet de Shakespeare — commenté par Jacques Derrida dans Spectres de Marx, 1993..
Cinq. La mise sur écran de parties de corps aura comme premier effet, donc, d’encadrer ces bouts de corps, de visage, cet œil, cette main. Cet encadrement est évidemment porteur d’un ratio, d’une mesure, d’une proportion, d’une mise aux normes, d’un réglage qui met en notre pouvoir les images de ces corps. Mais aussi d’une raison qui s’oppose au désordre des corps et en fait de sages images. Le cadre amène avec lui du rationnel, du vouloir, de l’intention. Le corps cadré est évidemment isolé des autres corps, et parfois de tout environnement; il y a une tension entre les courbes des images corporelles, leur fluidité, et la rigidité géométrique du cadre. Voir le monde en cadres, c’est toujours le dominer. Et le corps cadré est toujours un corps discipliné. Le passage au virtuel, aux images nécessairement virtuelles, revient ainsi à une mise en ordre du visible, qui en est aussi la mise à plat.
Comme les écrans domestiques sont plus petits que nous, nous pouvons les déplacer, les orienter, etc. Cette réduction lilliputienne des écrans signifie leur statut d’accessoires, de prothèses, leur mise à disposition, leur soumission à nos désirs. Ce n’est pas le cas, bien sûr, des grands écrans dans les salles de cinéma. À peu près tout ce qui se présente sur ces grands écrans est plus grand que moi. Il y a un effet de loupe pour les petites choses. Les grandes, elles, nous dominent complètement. Et les images projetées sur ces écrans nous renvoient à une place d’enfant-spectateur face à l’énormité des corps et du monde. Avec nos petits écrans domestiques, c’est tout le contraire, la disproportion doit être inversée: quoi qu’il en soit, je suis toujours plus grand que l’image que je regarde, fût-ce celle d’un géant ou d’un ogre. Et voilà les corps filmés ramenés à une dimension ludique: des jouets, des jeux vidéo. Un tel voisinage avec l’industrie des jeux spectaculaires fait sortir du cinéma.
Six. Les salles de cinéma fermées, tous les festivals de cinéma à venir (à l’exception de Locarno et Cannes) se sont alignés sur le modèle du Cinéma du Réel post-Covid-19: mettre les films de la compétition en ligne, faire siéger virtuellement un jury (!), faire comme si le virtuel et la suppression de la salle de cinéma ne portaient pas atteinte à ce qui est le corps même du cinéma: l’écran plus grand que moi, l’obscurité tout autour, le spectateur seul au milieu des autres, l’extrême singularité de chaque sujet-spectateur centrée sur un écran commun à toutes et tous. Le hors-champ devient mon décor familier, mon chez moi — exit l’inquiétante étrangeté qui caractérise la place du spectateur au cinéma. Le terme freudien: Unheimlich, désigne le heimlich, le foyer, le lieu familier. Que se passe-t-il quand les écrans de cinéma se rapetissent en lieux familiers? On fait semblant de faire du cinéma, on ne fait que semblant. On est dans le comme si. Grand producteur du « comme si », le cinéma ne le pratique pas: toute l’artificialité mise en œuvre implique que l’on ne fasse pas semblant de faire. L’implication des spectateurs dans les films (et non pas seulement dans les histoires que racontent les films) devient curiosité de consommateur.
Les salles ont fermé, la distribution des films a été interrompue et pourtant « l’offre » n’a jamais été plus fournie ni variée. L’offre d’un simili-cinéma. En réalité, les salles fermées ont été « remplacées » par autant de salons ou de salles-à-manger abritant autant d’écrans: le nombre des écrans en ce temps confiné a été multiplié par cent mille. Cette extension phénoménale de « l’offre » signifie que le cinéma a achevé son passage dans la grande distribution, laquelle, sur les petits écrans (d’abord), fait que les films se pressent nombreux tels des marchandises à consommer sans perdre de temps. Programmes et promesses de films en ligne se disputent le désir des spectateurs. Je peux encore espérer que la relation subjective d’un spectateur à un film soit toujours possible, mais elle viendrait se heurter au planning de la grande distribution et de la consommation accélérée — qu’elle ne peut qu’induire.
Je crois que les modes de diffusion ont des conséquences directes, concrètes, sur les relations des spectateurs aux films. Nous entrons dans un temps de la consommation qui est le temps d’une curiosité vite satisfaite (il suffit d’appuyer sur une télécommande). L’âge du spectateur-cueilleur est arrivé. Butiner n’est pas faire cinéma depuis sa place de spectateur. Le curieux-cueilleur n’a pas le temps de laisser le film agir en lui, les temps non comptés de l’inconscient ne sont pas compatibles avec la frénésie de curiosité qui fait passer frénétiquement d’un film à l’autre. Et en toute innocence. Il est certain que ces façons de le consommer modifient en profondeur le travail du cinéma. Sans doute dépend-il de chaque spectateur d’entrer corps et âme dans un film et de s’y laisser dériver, reconfigurer, réécrire. Mais le mode d’emploi global n’est pas celui-là: il est dans l’accumulation d’expériences sensibles et collectionnables — donc plus ou moins échangeables. Un nouveau type de spectateur est ainsi défini par le marché. Il n’y a pas à le déplorer mais à en faire le constat. La place du spectateur est devenue celle de la curiosité, de la collection, et non plus celle d’une mise en aventure et en crise des sujets.
Le dégustateur, ici et là comme le touriste, saisit des bribes du monde qu’il domine. Voir, dans une salle obscure, c’est être perdu dans les images et les sons, c’est avoir perdu ses repères ordinaires. Une remise en cause de notre supposée maîtrise. Quand nous allions à la Cinémathèque de la rue d’Ulm, par exemple, il arrivait tous les soirs à ceux qui se retrouvaient dans le hall ou sur l’escalier, une fois franchies les portes de la salle, de voir les fantômes venir à leur rencontre.
Un Jardin, un film imaginé
Présentation
Les textes de ce dernier chapitre ont été grandement rédigés dans le cadre d’une demande de subvention auprès de la Région Bretagne pour un projet qui n’a pas vu le jour, le projet Women Remix.
Nous ne présentons cependant que la première partie de ce projet intitulé « Un Jardin » pour laquelle Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey étaient auteurices avec nous.
L’ensemble des écrits présentés constitue la trace d’un travail préparatoire. Le temps que représente ce travail, à la fois dans le milieu du cinéma, de l’édition ou des arts visuels, est considérable. L’obtention ou non de certaines subventions dicte des conditions qui peuvent s’avérer décourageantes pour les auteurices qui sont souvent dépendant·es de ce type de financement. Nous avons souhaité visibiliser ce travail souterrain dont il n’est pas rare qu’il reste lettre morte. Ainsi nous adoptons une position féministe matérialiste qui consiste à rendre visibles les stratégies que l’on emploie pour demander de l’argent, d’autant plus que ces dossiers de candidature restent souvent secrets, à cause de la mise en concurrence des travailleur·euses entre elleux. Faire le choix de la publication est une façon de partager un outil. Il s’agit d’un document contextuel, qui porte donc les codes rédactionnels propres aux attentes des institutions. Adapter sa narration du projet fait partie de cet exercice et le document publié témoigne aussi de cette exigence.
Les dialogues du script de la page 165 à 186 entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli ont été inspirés par notre tournage de repérages en décembre 2019 à Paris. Les rushes de ce tournage où Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli lisent séparément les Mémoires de Louise Michel ont été ajoutés au dossier de candidature. Les commentaires d’images de Laura Mulvey dans la séquence 3 sont en partie une retranscription et traduction d’un dialogue entre Laura Mulvey et Élise Legal lors de cette même session de tournage.
Le projet Women Remix tel qu’il a été présenté dans un dossier de subvention
Film multiple, film collectif
Notre projet Women Remix s’inscrit comme une proposition de réponse à la crise traversée par le cinéma français et mondial depuis le début du mouvement #Metoo. Depuis plusieurs années déjà, il réveille les consciences et révèle des paroles cachées, interdites, sur la place des femmes au sein de l’industrie du cinéma, et plus largement dans nos sociétés, puisque le cinéma se veut en être le miroir. Industrie d’hommes, argent attribué élitairement pour faire des films, ce miroir est celui des sociétés où le pouvoir est détenu par un masculin qui orchestre aussi le regard des spectateurs et spectatrices. Yola Le Caïnec, Élise Legal, Léa Busnel, théoriciennes, artistes, cinéastes, nous croyons en la puissance émancipatrice et politique du collectif contre l’individualisme ambiant promu par le système capitaliste (lui aussi dirigé par des hommes), et à la force de l’hybridation dans un film collectif multiple pour redéfinir les lignes de forces de l’outil cinématographique. Dans notre collectif Women Remix nous invitons Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli, dont les théories nous accompagnent dans nos interrogations et expérimentations, au sein de nos cheminements pour un cinéma libéré de l’oppression patriarcale.
Déconstruction et reconstruction des représentations des femmes à l’écran
Notre projet Women Remix s’inscrit dans un double objectif de déconstruction et de reconstruction des représentations des femmes à l’écran. Dans nos recherches pour le film, nous nous sommes globalement concentrées sur la sur-représentation et la sur-sexualisation des femmes cisgenres depuis toujours. Avant tout, il s’agissait de déconstruire les représentations d’un cinéma globalement sexiste, masculin, cisgenre et hétérocentré qui a pour vocation de reproduire et maintenir la norme capitaliste. Il s’adresse au spectateur et à la spectatrice contemporain·es qui attendent des films la création d’un nouveau point de vue sur les femmes au cinéma, et qui se heurtent à des films « anciens » où ils ne se retrouvent plus, et à l’endroit desquels il leur faut donc redéfinir leur regard. En permettant d’aborder différemment par exemple les films d’Hitchcock, on peut les resituer dans leurs contextes et rendre leurs images actives dans le processus de prise de conscience du spectateur et de la spectatrice. L’expérience spectatorielle est au cœur de notre démarche. Tout film, finalement, selon l’axe d’analyse avec lequel on le questionne, permet d’accéder à une autre manière de regarder les femmes à l’écran. Une façon alternative. Le regard féminin, récemment appelé par Iris Brey Female Gaze (en référence au concept de Male Gaze théorisé par Laura Mulvey) dans son ouvrage Le Regard féminin: une révolution à l’écranIris Brey, Le Regard féminin: une révolution à l’écran, Éditions de l’Olivier, Collection « Les Feux », Paris, 2020., fait partie des alternatives possibles.
Women Remix part de cet état des lieux toujours actuel que Laura Mulvey décrit en 1975 dans son article « Plaisir visuel et cinéma narratif » quand elle analyse les inégalités mises à l’œuvre et en scène au sein des images de cinéma: « Dans un monde construit sur l’inégalité sexuelle, le plaisir de regarder a été divisé entre l’actif/masculin et le passif/féminin. Le regard déterminant du masculin projette ses fantasmes sur la figure féminine, la modelant en conséquence. »Laura Mulvey, « Visual pleasure and narrative cinema », Screen n° 16, 1975. « Plaisir visuel et cinéma narratif », traduction par Gabrielle Hardy, Débordements, février 2012. Même si les analyses de Laura Mulvey portent sur le cinéma classique hollywoodien, nous voulons proposer une chaîne d’images issues du cinéma mondial de toutes les époques pour offrir une expérience cinématographique ouverte où il s’agit de donner des outils pour aborder à la fois les films qui émancipent et ceux qui avilissent les femmes à l’écran, de façon à initier et renouveler l’approche qu’en auront tous les types de publics.
Women Remix veut ainsi contenir dans son titre deux postulats, celui de la pluralité et celui d’une continuité entre tradition et modernité. Women implique une recherche plurielle du point de vue féminin dans l’idée qu’il n’est pas un point de vue, mais une multitude de points de vue par lesquels il faut nécessairement passer pour accéder à des formes de vérités. Remix insiste alors sur le fait que ce point de vue, même s’il peut survenir de façon directe dans des films volontairement féministes — ce qu’il ne s’agit pas de remettre en question —, peut survenir aussi dans un travail de réorchestration des images suivant une réflexion des enjeux que chacune porte pour la représentation des femmes.
Nous nous sommes aussi interrogées sur l’absence criante de la diversité des minorités sexuelles et de genre dans le cinéma mainstream, de la diversité des corps représentés à l’écran: de la pluralité finalement. Nous avons travaillé contre des représentations qui, si on les résume grossièrement, disent qu’il n’y a qu’une seule façon « d’être une femme », dictée bien souvent par des réalisateurs cisgenres hétérosexuels qui pour un certain nombre d’entre eux, depuis quelques années, ont été confrontés à des plaintes à leur encontre pour des faits d’agressions sexuelles et/ou de viols, et/ou de pédocriminalité. Vouloir faire croire que les « femmes » sont comme dans leurs films, c’est entraver notre imaginaire, c’est aussi une tentative pour entraver toutes les personnes qui se pensent et sont femmes d’une autre manière que celle que nous relaient ces écrans: c’est nous empêcher d’être plurielles.
La recherche d’une nouvelle mécanique des regards
Women Remix se positionne avant tout relativement à la pensée de Laura Mulvey. Jean-Louis Comolli s’est vite révélé comme le plus à même, parmi les cinéastes français, de donner la réplique à la féministe britannique par les particularités de son propre cinéma et de sa théorie fondée sur l’amour du sujet filmé qu’il veut émanciper en même temps que le spectateur et la spectatrice au sein de ses films. Jean-Louis Comolli définit deux types de projections dans un film, celle de type physique qui a lieu sur l’écran et celle mentale du spectateur ou de la spectatrice qui projette sur le film son propre film. C’est cette deuxième projection que nous voulons reconstruire dans Women Remix.
Cette reconstruction s’appuiera donc sur une déconstruction précise, celle de la mécanique des regards telle que Mulvey l’analyse en distinguant trois types de regards: « celui de la caméra qui enregistre les événements filmiques, celui du public qui regarde le produit fini, et ceux que se portent entre elleux les personnages “dans” l’écran. » L’illusion cinématographique reposant avant tout sur le regard des personnages entre elleux « dans » l’écran, il faudra soit le modifier, soit agir sur le point de vue porté par la caméra ou celui du spectateur et de la spectatrice. Les deux pôles définis par Mulvey seront comme des repères pour évaluer notre action sur les représentations, à savoir agir sur le fétichisme ou le voyeurisme à l’œuvre dans les images. « Alors que Hitchcock étudie les mécanismes du voyeurisme, Von Sternberg produit le fétiche ultime, le hissant à un point où la puissance du regard du protagoniste masculin (caractéristique des films narratifs traditionnels) se brise au profit de l’image elle-même, dans un rapport érotique direct au spectateur. »
Un film en mouvement
Pour ce faire, ce film suivra un chemin bien précis, et sera toujours en mouvement, de façon à ce que chacune de ses étapes de conception soit toujours le lieu d’une réflexion. Sa construction s’est vite imposée en trois parties distinctes, qui seront prises en charge collectivement mais aussi de façon plus particulière selon les compétences et les intérêts de chacun·e, la première partie par Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey, la seconde par Élise Legal, la troisième, Léa Busnel, qui doit interpréter aussi le premier rôle féminin, même si nous pensons proposer aussi le rôle à Sophie Letourneur. Yola Le Caïnec, qui est à l’origine du projet, et a mis en relation les différent·es auteurices, travaillera sur le tissage de l’ensemble et assurera une continuité des différents regards et des différentes voix porté·es par chacun·e.
Trois parties composent le film, elles peuvent se comprendre chacune en elles-mêmes mais elles s’éclairent aussi les unes les autres.
Dans une première partie, « Un Jardin », Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli élaborent ensemble, au fil d’échanges et de lectures, une parole commune pour comprendre comment la représentation des femmes fonctionne à l’écran au sein même des conventions qui y régissent les mises en scène. Quand Jean-Louis Comolli raconte comment il imagine des dispositifs de parole filmée pour qu’advienne à l’écran une image libre des femmes, Laura Mulvey énonce la possibilité d’enfreindre les pulsions scopophiliques des spectateurs (et des spectatrices) en déséquilibrant le triangle du désir, réalisateurice/spectateurice/personnages. L’émancipation par la maîtrise du regard masculin des personnages à l’écran est la plus forte selon Laura MulveyLaura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel, Éditions Mimésis, 2017, p.50..
Dans une deuxième partie, « Cinéma Remix », nous questionnons avec les approches théoriques et pratiques présentées par Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli des séquences de films déjà existants. Ces séquences ont été choisies pour les problèmes qu’elles posaient justement à la représentation des femmes à l’écran, violence, mépris et avilissement. Nous leur proposons une alternative féministe en agissant par la parole filmée et sur le regard des personnages. Nous les investissons donc par la mise en scène et le dialogue de séquences pour y repositionner le regard et la parole des personnages.
La troisième partie, « Si la vie », consiste en une histoire originale, conçue comme une fiction-laboratoire, pour proposer un exemple de film court où la question de la représentation de personnages féminins, active et créative de sens, est la priorité à tous les niveaux de la conception d’un film, de l’écriture au montage. Il s’agira de construire une mise en scène autour de personnages considérés comme féminins qui existent pour eux-mêmes, émancipés du regard masculin cisgenre et hétéronormé.
Le cinéma comme art du temps et de la pensée
Partant d’une part de l’idée comollienne que la durée est la condition pour que naisse la pensée du spectateur et de la spectatrice, et d’autre part de la recherche d’un rythme fondé sur la lenteur et le plan-séquence propre à énoncer un nouveau point de vue au cinéma qu’expérimente Laura Mulvey (voir les mots des auteurices après le scénario) dans Riddles of the Sphinx, nous avons élaboré un film en trois parties qui fonctionnent comme des stases dynamiques.
Nous avons suivi la préconisation de Mulvey qui invite à suspendre, pour qu’elle s’approfondisse mieux, la pensée du spectateur et de la spectatrice qui pourra, de l’une à l’autre, reconstituer un nouveau chemin de compréhension et d’appréhension critique des images.
Leur rythme commun procède de la reprise et la répétition pour converger vers une reconfiguration, qui sera aussi bien politique qu’esthétique, du féminin à l’écran. La musique d’Olivier Mellano, que ce soit avec le groupe mixte MellaNoisEscape ou dans ses adaptations musicales comme celles de L’Aurore de Murnau ou L’Heure du loup de Bergman, pourrait être intégrée et correspondrait aussi à cette idée que le cinéma peut, comme art du temps, activer une pensée créatrice et solidaire du féminin.
Une figure tutélaire: Louise Michel
Jean-Louis Comolli, au fil de nos conversations pour le projet de ce film, et au sujet de la question de la représentation des personnages féminins au cinéma, nous a confié avoir toujours été fasciné par la figure de Louise Michel, se retrouvant lié d’une manière ou d’une autre à elle dans chacun de ses travaux. En filmant les femmes (La Vraie Vie (dans les bureaux), Jeux de rôles à Carpentras…), il cherchait dans les visages et les vies de ses contemporaines l’existence de Louise Michel. Quête impossible mais quête fructueuse car, en cherchant Louise Michel, il trouve d’autres figures émancipatrices.
Les courts-métrages de Laura Mulvey et Peter Wollen, Amy!, en 1979 sur l’aviatrice Amy Johnson, ou Frida Kahlo & Tina Modotti en 1983, en retraçant le parcours de femmes résistant à l’hégémonie patriarcale, font écho au travail de Jean-Louis Comolli. Dans leur long-métrage, Riddles of the Sphinx, le personnage principal de la fiction au centre du film s’appelle Louise. Alors que nous évoquions avec Laura Mulvey la quête de Louise Michel qui habite le cinéma de Jean-Louis Comolli, celle-ci nous révèle que Peter Wollen et elle avaient nommé le personnage principal de leur film en hommage à Louise Michel.
Louise Michel devient alors une sorte de figure tutélaire de notre film qui l’accompagnera dans chacun de ses chapitres et permettra de les lier, figure féministe révolutionnaire qui, parce qu’elle n’a pas vécu à l’époque du cinéma n’a pas pu être enfermée dans ses cadres, et reste ainsi une image manquante qui hante le cinéma de Jean-Louis Comolli comme celui de Laura Mulvey.
Cette vaine représentation nous intéresse en tant que possibilité émancipatrice de la figure féminine à l’écran. Aussi, parce que « la vraie » Louise Michel ne peut exister à l’écran, elle devient multiple.
À la suite de ces échanges, la lecture des MémoiresLouise Michel, Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, CreateSpace Independent Publishing Platform, 20 avril 2015. de Louise Michel nous a semblé édifiante et particulièrement à propos pour notre projet. Pour cette raison nous avons décidé d’intégrer dans la première partie du film la lecture d’extraits de ces Mémoires, de même qu’un texte écrit par Jean-Louis Comolli sur Louise Michel. La lecture fragmentée met en écho les deux voix de Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey, lesquelles, distantes l’une de l’autre mais se répondant l’un·e à l’autre, résonnent dans un jeu de correspondances intimes.
Dans la deuxième partie de Women Remix intitulée « Cinéma Remix », les figures féminines qui émergent et sauvent les situations, héroïnes ou personnages secondaires, sont des prolongements kaléidoscopiques de Louise Michel, tout comme Aimée dans « Si la vie » qui en constituerait, finalement, peut-être, une possibilité fictionnelle contemporaine.
Un Jardin, la première partie du film tripartite Women Remix
Note d’intention
Pour construire la mise en scène de la rencontre entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli, la question prioritaire, qui s’impose comme contrainte positive, est celle de la langue. Laura Mulvey est anglaise, comprend et parle le français relativement bien, et Jean-Louis Comolli ne peut parler l’anglais et ne le comprend que mal. Nous nous appuierons donc sur ce décalage puisqu’il faudra trouver un lieu de langage commun pour Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey afin qu’il y ait échange. Ce lieu, nous le voulons entre autres cinématographique et l’échange arrivera par les croisements de paroles, de lectures, d’images et de champs.
Le lieu est aussi défini par le titre. « Un Jardin ». Le jardin est celui de Jean-Louis Comolli certes, mais comme lieu il suggère également le motif printanier de la renaissance, et plus encore le mythe d’Adam et Eve, investissant l’idée d’une ancienne humanité amoureuse, la chrétienne mais aussi la grecque. Le mythe d’Aristophane (Le Banquet, Platon) pourra en effet être aussi un fil directeur avec les Hommes-sphères, de l’espèce femelle à l’espèce mâle jusqu’à l’espèce androgyne.
Pour faire advenir la rencontre progressivement (cette progression traduit la réalité de la préparation du film), nous avons imaginé trois situations, que nous juxtaposons dans le scénario, mais qui seront sûrement entremêlées dans le montage. Pour filer l’idée de la correspondance, idée de Jean-Louis, iels s’échangent à distance un carnet rouge où il écrit à propos de son film rêvé sur Louise Michel et Laura commente ce qu’il écrit. Iels communiquent aussi par livre interposé, les Mémoires de Louise Michel, dont iels lisent des extraits choisis. Enfin, iels sont prêt·es pour une rencontre où iels vont échanger directement sur leur travail, à savoir comment chacun·e à sa manière résiste à cette indéfectible et violente mort au travail, touchant plus particulièrement les femmes, au sein des images de cinéma. L’utilisation du numérique, avec lequel iels ont un rapport critique pour la réalisation, devient paradoxalement un adjuvant dans leur analyse de l’image.
Synopsis
Jean-Louis Comolli et Laura Mulvey entretiennent une correspondance en s’échangeant un carnet rouge où iels inscrivent des pensées que Jean‑Louis initie autour de Louise Michel. Cette femme le passionne, il la cherche dans chacune des femmes qu’il a filmées. Louise Michel est le nom de l’héroïne de Riddles of the Sphinx (Laura Mulvey, Peter Wollen, 1977). Leur correspondance se prolonge vite dans une écoute à distance de leur lecture d’extraits des Mémoires de Louise Michel. Leur rencontre, nourrie de ces échanges, les trouve toustes deux devant un écran conversant sur des images qu’iels manipulent et analysent tour à tour.
Scénario
Dans un salon ouvert sur un jardin, Jean-Louis Comolli est assis à un bureau recouvert de livres, il tient un carnet rouge à la main.
Au moment où j’écris, le château de cartes macronien s’effondre feuille après feuille sous le souffle d’un vent jaune. Et ça me fait me demander pourquoi j’ai rêvé si longtemps de faire un film, sans le faire, autour de Louise Michel, personnage dont la vie et l’œuvre m’ont capturé dans un cercle magique, jusqu’à ce que j’abandonne le cinéma de fiction « avec des acteurs et des actrices » pour lui préférer, ô combien, le cinéma dit « documentaire » où les fictions se développent sans passer par des comédiens et des comédiennes professionnel·les et sont en prise avec les « vraies vies » de celles et ceux que je filme.
J’aurais beaucoup aimé que le cinéma fut inventé avant 1871, ça m’aurait permis de filmer Louise en direct! Et non pas une comédienne qui joue le rôle de Louise, voilà, mais c’est évidemment un fantasme et même une folie, mais cette folie c’est la vérité de l’opération cinématographique. On peut reconstituer le passé mais le présent est lui-même du récit de son propre développement, et la fiction est toujours au présent en somme.
Je l’ai cherchée, cette Louise faite de compacité entre vie et fiction, je l’ai cherchée dans des femmes réelles ici ou là. Et c’est ainsi, me dis-je, que dans le cours des tournages de mes films dits « documentaires », j’ai eu la chance de filmer plusieurs femmes qui, toutes, présentaient avec la « vraie » Louise une vraie complicité. En 1994, il y eut la Sylvie de La Vraie Vie (dans les bureaux)Jean-Louis Comolli, La Vraie Vie (dans les bureaux), écrit par Anne Baudry et Jean-Louis Comolli, Suisse, France, 1993, 78 minutes. et, avec elle, plusieurs de ses collègues employées à la Caisse d’Assurance Maladie d’Île-de-France (la CRAMIF), la syndicaliste, Muriel l’abandonnée, chacune pouvait l’être et l’était par fragments dans ce film dédié aux femmes non résignées. Deux ans plus tard, je faisais un film à partir du procès des profanateurs du cimetière juif de Carpentras, Jeux de rôles à Carpentras, où je filmais, sans l’avoir auparavant rencontrée, ni même dans les rares fragments vidéo où on la voyait surtout fermer sa porte aux journalistes, Sylvie Mottes, juge d’instruction en charge des enquêtes sur la profanation, instruction qu’elle refusa de conclure, tenant tête publiquement à son procureur de la République — une héroïne à la Louise, du côté de la Loi.
Il arrive, et c’est heureux, que les vies vécues soient des fictions plus fortes que tant de vies inventées. Que les personnages qui les ont vécues, ces vies, soient plus fous que toutes les fictions qui, c’est leur limite, se tiennent très souvent et sauf exceptions à une échelle moyenne pour être acceptées par celles et ceux qui les suivent dans les livres, les séries, dans les films mainstream. La démesure a toujours fasciné, mais entre autres raisons parce qu’elle échappe aux vies communes. La Juliette de Sade, comment ne ferait-elle pas peur?
Oui, assister, favoriser autant que se peut la puissance fictionnelle de personnages de la vie réelle, qui plus est officielle, me touche profondément. Je participe de la naissance d’une dimension poético-mythique dans le passage de « la vraie vie » à la vie filmée, quand se constituent des êtres de cinéma, plus belles et beaux, plus fort·es, plus exemplaires que ne pouvait l’être leur version ordinaire. Et puis, une autre Sylvie: Lindeperg, historienne, dans Face aux fantômes, aux prises avec le toujours au-delà de tout des camps de la mort nazis, et qui fait apparaître dans ce revenir d’un monde où sont écrasées toutes dimensions de liberté et de dignité humaines, la réparation que réalise l’analyse historique, telle que ce qui n’était plus pensable le redevient: décrire et comprendre. Sylvie Lindeperg, là, est éblouissante, elle sait faire sentir combien son savoir est fragile, combien il peut être remis en cause par tel document ou témoignage, combien il doit être chaque fois revisité et en partie redéfini… et ce, sans qu’elle renonce à convaincre, débattre avec elle-même, déconstruire les propagandes…
Voilà les Louise que j’ai pu rencontrer dans mon travail, et j’espère, enfin je crois vraiment que c’étaient des personnages qui avaient un rapport avec cette Louise que je cherchais, dans ses textes, dans sa légende, dans ses écrits, et que je n’arrivais pas à concrétiser dans une fiction, voilà. Le grand malaise que j’ai éprouvé au regard de la fiction vient de là, est lié à cette affaire de Louise que j’ai traînée, ce projet m’a accompagné pendant cinquante ans presque, et jamais il ne s’est réalisé bien que nous ayons été à de nombreuses reprises aux portes de la réalisation. J’ai fait des repérages, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, j’ai eu des producteurs et des productrices, qui n’étaient pas à la hauteur, ou moi je n’étais pas à la hauteur, et donc ça ne s’est pas bien passé. Il y a eu toutes sortes d’incidents. Mais de toute façon, la note fondamentale c’est que je ne pouvais pas y croire, voilà. Je n’y croyais qu’à moitié. Et ça suffit pas, pour faire un film il faut y croire complètement. Plus que les gens qui vont aller voir le film. Donc j’ai fini par comprendre, parce que je suis un peu lent, j’ai fini par comprendre que c’était pas dans la fiction que j’allais trouver ce que je cherchais sans savoir le dire, mais que c’était dans le cinéma documentaire où, en effet, à de nombreuses reprises, alors évidemment avec ces femmes dont j’ai parlé, mais aussi avec d’autres personnes, des jeunes, des vieux·ielles, des hommes… j’ai trouvé cette force d’existence, cette affirmation d’existence, cette affirmation — comment dire? — de croire que nous sommes meilleur·es que nous ne pourrions l’avoir cru, et ces personnes que j’ai filmées elles étaient comme ça, elles étaient meilleur·es, meilleur·es que la veille, ou meilleur·es que le lendemain, pendant le temps du tournage.
On me dit: toutes les femmes ne portent pas une telle dimension héroïque. Ah bon? C’est que toutes n’ont pas été filmées ou ne le sont pas encore. Filmer le corps parlant des femmes et la parole incarnée par des femmes revient à transfuser dans les esprits de celles et ceux qui sont nos contemporain·es une sorte de philtre d’amour qui les transfigure. Il s’agit bien de cela, et l’on pourrait appeler « cinéma » cet art de la transfiguration de toute femme en idéal d’elle-même pour les êtres, en accomplissement de leur être intime pour les choses, objets, fruits, tout ce dont l’apparence ne révèle l’être et ne le prend en charge qu’en étant filmé. Les jardins et les nuages attendent, ils nous attendent car ils nous ont précédé·es.
Jean-Louis Comolli marche devant une baie vitrée donnant sur un jardin, comme le premier personnage dans La Vraie Vie (dans les bureaux).
Est-ce que c’est leur faute à ces malheureuses, s’il n’y a de place pour les unes que sur le trottoir ou à l’amphithéâtre; pour d’autres, si elles ont pris pour vivre ou pour faire vivre leurs petits, pour la valeur de quelques sous, quand d’autres jettent pour leurs caprices des millions et des milliers d’êtres vivants?
« C’est là que nous en sommes! Les êtres, les races, et dans les races, ces deux parties de l’humanité: l’homme et la femme, qui devraient marcher main dans la main et dont l’antagonisme durera tant que la plus forte commandera ou croira commander à l’autre, réduite aux ruses, à la domination occulte qui sont les armes des esclaves. Partout la lutte est engagée.
« Si le diable existait, il saurait que si l’homme règne, menant grand tapage, c’est la femme qui gouverne à petit bruit. Mais tout ce qui se fait dans l’ombre ne vaut rien; ce pouvoir mystérieux, une fois transformé en égalité, les petites vanités mesquines, et les grandes tromperies disparaîtront; alors il n’y aura plus ni la brutalité du maître, ni la perfidie de l’esclave.
Avec cela qu’on va être assez bête pour s’égorger? Et du reste les femmes, quand la chose vaut la peine de se battre, n’y sont pas les dernières; le vieux levain de révolte qui est au cœur de toutes fermente vite quand le combat ouvre des routes plus larges, où cela sent moins le charnier et la crasse des bêtises humaines. Elles sont dégoûtées, les femmes! Les vilenies leur font lever le cœur. »Ibid., p.67.
« Je revendique les droits de la femme, non servante de l’homme. Si un jour nos ennemis me tiennent qu’ils ne me lâchent pas, car je ne combats pas en amateur mais comme ceux qui veulent vraiment, et qui trouvent qu’il est temps que les crimes sociaux finissent. C’est pourquoi, pendant la lutte, je serai sans merci et je n’en veux pas pour moi, n’étant dupe ni des mensonges du suffrage universel ni des mensonges de concessions qu’on aurait l’air de faire aux femmes.
« Quant aux candidatures de femmes, c’est aussi une revendication, celle de l’esclavage éternel de la mère qui justement doit élever les hommes et les fait ce qu’ils sont; mais peu importe, ne faisons-nous pas partie de l’esclavage commun? Nous combattons l’ennemi commun. »Extrait de l’article « La candidature illégale », initialement publié dans la Révolution sociale et cité par Louise Michel dans ses Mémoires. Ibid., p.156.
« Toutes unies et résolues, grandies et éclairées par les souffrances que les crises sociales entraînent à leur suite, profondément convaincues que la Commune, représentant les principes internationaux et révolutionnaires des peuples, porte en elle les germes de la révolution sociale, les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu’elles aussi sauront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, donner, comme leurs frères, leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la Commune, c’est-à-dire du peuple! Alors victorieux, à même de s’unir et de s’entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et travailleuses, tous solidaires par un dernier effort… Vive la République universelle! Vive la Commune! »Extrait du Manifeste de l’Union des femmes, pendant la Commune. Ibid., p.275.
Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli sont assis·es face à un écran, iels se montrent des images, les présentent, les commentent.
C’est une historienne, elle s’appelle Sylvie Lindeperg et qui a écrit un très très beau livre sur l’histoire de Nuit et Brouillard, qui est une histoire complexe, dont elle a totalement élucidé les petits mystères, les non-dits qui avaient accompagné la conception et le tournage du film d’Alain Resnais, Nuit et Brouillard, et donc c’est un film sur un film. Et c’est Sylvie qui était donc la passeuse ou la transmetteuse pour passer de l’analyse de Nuit et Brouillard à ce film dans lequel je la faisais jouer. Elle a été géniale, parce qu’elle est sortie de son rôle institutionnel d’enseignante, de prof d’histoire, de spécialiste entre autres de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et elle a incarné son propre personnage. Quand on filme une personne en documentaire, dans ce qu’on appelle documentaire, cette personne est conduite sans qu’on lui demande, sans qu’on en parle avec elle, est conduite à s’incarner elle-même en quelque sorte, c’est-à-dire à prendre consistance devant la caméra et à devenir un double de ce qu’elle est dans la vie ordinaire, mais un double que nous pouvons filmer. Et donc quelque chose — comment dire? — se concentre, se condense, se forme dans les personnes que nous filmons, leur donne une forme, et qui souvent est une forme plus forte que celle que ces personnes peuvent avoir dans la vie tout court, ne serait-ce que parce que la condensation, le fait de filmer — par exemple Sylvie Lindeperg nous l’avons filmée pendant une semaine, Sylvie Mottes nous l’avons filmée pendant quatre heures. Mais… Il faut tout donner. Si on donne pas tout, alors après c’est fini. Alors quelque chose se met en place chez les personnes qu’on filme avec l’idée que c’est une fois pour toutes, c’est maintenant ou jamais. Et donc elles amènent au fond un aspect agonistique dans le tournage du film, et c’est ce qui fait que les documentaires sont plus précieux que les fictions parce que ce qui s’y passe ne peut pas être reproduit, ça arrive une fois pour toutes. C’est arrivé ou pas. Ça peut aussi rater une fois pour toutes, de la même manière. Mais quand ça arrive, on est dans quelque chose qui est à mon sens — selon mes repères — qui est plus fort que la fiction. La fiction ne marche que parce que le spectateur et la spectatrice y croient, c’est-à-dire qu’elle est peu crédible en vérité, c’est la croyance de nos regards qui amène de la puissance aux personnages de fiction. Là, dans le cas de ces femmes que j’ai filmées, la puissance vient de leur relation au cinéma, c’est-à-dire qu’elle vient d’elles, elle vient du fait qu’entre elles et le fait d’être filmées — moi j’y suis même pour rien à la limite — se construit quelque chose de très fort, qui n’existait pas avant, qui n’existera pas après, qui n’existe que le temps de ce film, voilà. C’est ce que j’appelle une histoire d’amour, c’est-à-dire extrêmement délimitée, précise, cernée, dessinée, et qui se développe avec une grande force.
Laura Mulvey fait apparaître sur l’écran une image très connue de Les hommes préfèrent les blondes d’Howard Hawks en 1953. Laura manipule régulièrement la souris pour ralentir ou stopper l’image et commente en même temps la scène de danse entre Jane Russell et Marilyn Monroe.
Jane Russel était la top star d’Hollywood à cette époque, ou une des top stars d’Hollywood à cette époque. Et pour ce film elle a été considérablement mieux payée que Marilyn Monroe qui était toujours sous contrat, une star mais sous contrat, un différent genre de contrat. Donc, la manière dont la séquence évolue c’est presque comme si elle représentait la manière dont laquelle Marilyn est sur le point de devenir la plus grande star d’Hollywood et en fait la plus grande star au monde, peut-être même la plus grande star de toute l’histoire du cinéma. Et Jane Russell, assez subtilement et en accord, avec compréhension, est déplacée sur le côté. Et la caméra la laisse derrière. Et ensuite Marilyn commence à s’emparer de ce qui commençait à être là. Nous verrons alors son regard très très connu. Et j’étais très intéressée par l’artificialité de son apparence. (…) Quand elle se promenait dans les rues, par exemple les rues de New York, sans son look de Marilyn, personne ne la reconnaissait. Donc c’est une sorte de mascarade aussi importante peut-être que la mascarade de la figure du clown, quand elle adopta ses caractéristiques exceptionnelles et son look extraordinaire.
Donc ici tu vois encore ce geste précis et je l’ai rejoué deux fois pour que la familiarité avec le geste, ce qui se passe dans la séquence, soit ensuite défamiliarisé pour que nous perdions tout sens de position naturelle dans le film et dans le numéro et qu’il prenne une certaine sorte d’étrangeté.
Ceci est selon moi un style particulier de la présence esthétique qu’avait Marilyn. Et ensuite, avec son caractéristique gros plan, quelque chose d’autre semble apparaître. Elle s’immobilise, elle fige ses mouvements jusqu’à devenir presque photographique. Maintenant bien sûr je l’ai ici exagéré puisque j’ai moi-même figé l’image. Mais c’est essayer de capturer la manière dont le caractéristique gros plan de Marylin est devenu une image qui était plus qu’elle-même.
C’est apparu la première fois avec la série des sérigraphies d’Andy Warhol qu’il commença peu de temps après sa mort. Elle mourut en août 1962 et très peu de temps après sa mort Andy Warhol commença à faire des sérigraphies, presque comme en hommage à elle, quasiment comme un masque mortuaire fait pour elle. Et il y a une manière dont, quand vous, quand quelqu’un·e fige Marilyn dans son caractéristique gros plan, c’est impossible de ne pas se souvenir des sérigraphies d’Andy Warhol qu’il réalisa au temps de sa mort.
Cet érotisme étrange et excessif qui vient de sa bouche ouverte, ses yeux fermés du gros plan, mutera ensuite dans son travail et devient l’image de Marilyn après sa mort, donc la mort et le désir se retrouvent presque entremêlés ensemble. À tel point que son énorme célébrité apparaît confirmée par sa mort précoce et mystérieuse, et que donc le sens de vulnérabilité et mortalité semble devenir une part de sa personne, une part de son iconographie. Et ensuite je vais le jouer une fois de plus, pour qu’on puisse le regarder à nouveau et faire pause encore.
À la fin j’ai essayé de la ramener à la vie pour un moment, avant de la rendre immobile, essayé de la ramener comme si c’était, sur le bord, entre l’image de vie et l’image de mort. Et bien sûr c’est ce qu’est le cinéma, il rejoue perpétuellement l’apparence de la vie et de ses figures, ses grandes stars, qui ne sont en fait « désormais plus avec nous » depuis un très long moment, comme on dit en anglais.
La fiction c’est chacun chacune d’entre nous, chacun d’entre nous, chacune d’entre nous est porteur ou porteuse de fiction. Et la fiction qui nous revient à travers les livres, les romans, les films, les récits etc., est une fiction au second degré si j’ose dire. Parce que la vraie fiction, c’est la vie des gens, là où on est en pleine fiction, d’une manière très puissante, irrésistible. Et la plupart d’entre nous ne s’en aperçoit pas, que leur vie est une fiction, autrement dit que leur vie est un récit, qu’ils et elles pourraient raconter. Certains ou certaines le font bien sûr, on a des livres, des tas de livres même, de récits de vie, etc. Mais la plupart des gens qui vivent ça ne prennent pas conscience du fait qu’ils sont dans une fiction et qu’ils et elles portent cette fiction, et que, si ils et elles prenaient le temps de s’arrêter ne serait-ce qu’une demi-journée, ils et elles comprendraient en effet qu’ils et elles sont les narrateurs et narratrices de leur propre vie. Et que leur propre vie n’est pas quelque chose de subi mais quelque chose de fabriqué au fur et à mesure que les jours passent. C’est ça que le cinéma filme, c’est cette fabrication de la fiction liée à la vie. Parce que quand on filme une personne réelle, évidemment — comment dire? —, on opère une sorte de mutation, on la change en comédien ou en comédienne de sa propre personne, c’est pas la même chose. Et donc il y a un dédoublement en quelque sorte, voilà. Alors, les acteurs et les actrices aussi, les comédiens et les comédiennes de métier aussi, mais dans ce dernier cas il y a leur dédoublement dans le personnage qu’on leur a donné à jouer, pas un dédoublement intérieur. Il y a une part de leur personne bien sûr qui se glisse dans ce personnage, mais ça n’est qu’une part. Alors que les hommes ou les femmes que j’ai filmé·es en documentaire — pas parce que c’est moi, comme d’autres ont filmé en documentaire — ces personnes sont toutes entières, il n’y a pas de demi-mesure, elles ne jouent pas, elles ne peuvent pas jouer. Il faut prendre le terme de jouer dans un sens plus radical que le jeu de l’acteur actrice ou le jeu du comédien comédienne, c’est le jeu de la vie qui est en cause, bien entendu, c’est de ça qu’il s’agit, c’est-à-dire qu’il y a des personnes qui refusent d’être filmées parce qu’elles savent que c’est quelque chose qui touche à leur vérité, à leur vie, et que si elles acceptent, c’est ça qui va être mis en cause, qui peut être altéré. Donc on joue avec la vie, c’est pas la même chose que de jouer avec une pièce de théâtre, un texte, un personnage, c’est pas la même chose.
C’est pourquoi, d’ailleurs, aujourd’hui le documentaire est devenu une sorte de genre à succès, tout le monde peut en faire et c’est bien, tout le monde en fait et c’est très bien et je trouve ça formidable! Moi j’ai commencé dans un moment où le documentaire pour ainsi dire existait de manière étroite, ridicule, presque absente. Et donc cette généralisation de la place, de la pratique du documentaire aujourd’hui, pour moi c’est le signe de ce que je viens de dire, c’est-à-dire que la fiction sécrétée, fabriquée par les êtres vivant·es devient un sujet de cinéma, le cinéma, le cinéma ne peut parler que de ça, et que du coup les films qui sont joués par des comédien·nes avec des personnages, des décors, tout ce que vous voudrez, ces films-là ont pour moi un air de fausseté, quelque chose qui tinte, qui sonne faux.
Je vais te montrer une séquence de Douglas Sirk. Douglas Sirk n’était pas au premier rang du Panthéon des metteurs en scène des Cahiers du Cinéma car le contenu féminin de ses films a attiré le concept de sentimentalité. Il a été considéré comme un metteur en scène de forme et pas de contenu. Ce sont les critiques féministes qui l’ont sauvé de cette réputation triste. Elles ont alors nommé ces histoires, ces mélodrames comme des matières proches des vies des femmes silencieuses, les affaires de familles, de la domesticité, des histoires qui touchent les sujets de tous les jours, très connus, mais très souvent tabous. Dans ces situations, la langue des mots de tous les jours échoue, ils deviennent des « textes muets ». Alors, comme a dit le critique littéraire Peter Brooks, les mots n’arrivent pas à représenter les significations et les messages mélodramatiques, ils sont obligés de trouver un autre registre du signe. C’est ici qu’on trouve la grande valeur de l’esthétique filmique de Douglas Sirk. Il a dit: « Les pensées d’un·e metteurice en scène se trouvent dans les angles de sa caméra. Sa philosophie se trouve dans son éclairage. J’ai été guidé par mes yeux, et pas par les mots. Le langage n’est pas le meilleur interprète de la réalité. » Comme vous verrez, Douglas Sirk utilise tout l’appareil du cinéma pour recréer les sens et les émotions.
Imitation of Life est son dernier film sorti en 1959, après il prit sa retraite et quitta Hollywood pour passer le reste de sa vie en Europe. Il était originairement né en Allemagne. Il était l’un des cinéastes de la période de guerre. Ce film est très important car il reflète avec quel sens les studios puissants, dans ce cas précis Universal Studios, prenaient en considération quelque chose du nouveau Mouvement pour les Droits Civiques de la lutte du peuple afro-américain des années précédentes. Et donc ils sont retournés à un film, Imitation of Life, qui a été filmé entre 1930 et 1934, donc c’est un remake du film de John Stahl par Douglas Sirk.
Lorsque vous visionnez le film pour la première fois vous pensez qu’AnnieInterprétée par Juanita Moore, Annie devient la domestique de Lora Meredith, femme blanche qui veut lancer sa carrière à Broadway. est la seule personne noire, la seule afro-américaine dans la scène de Coney Island, mais, lorsque vous faites pause, vous vous rendez compte qu’il y a en réalité d’autres personnes noires qui intègrent la scène et que vous n’avez jamais vues auparavant, et cela en change tout le sens. (…) Et j’ai commencé à me demander ce que cela voulait dire, pourquoi cette invisibilité des figurants et figurantes afro-américain·es? Ils et elles sont là, sont tout juste visibles, ne sont pas invisibles, sont à peine visibles, mais seulement avec l’aide de la technologie. Alors qu’est-ce que ça veut dire? Il me semble que ce sur quoi je réfléchissais dans un sens, la manière avec laquelle la population afro-américaine a été marginalisée par les racistes dans les années 30, le fait qu’ils et elles deviennent marginalisé·es, à peine visibles, et de filmer les personnes noires de cette manière était en un sens transposer ce silence, cette invisibilité, dans l’expérience de l’écran elle-même.
C’est trop rapide. C’est aussi à cause de la manière dont la scène est filmée, l’œil du spectateur est réglé pour suivre Lana TurnerLana Turner interprète Lora Meredith.. Elle est une figure de la star. Vous la suivez descendre les marches, elle est vêtue d’une robe d’une couleur très claire, elle porte un foulard rose à la tête. Et l’œil la suit automatiquement depuis la gauche de l’écran, et ce jusqu’en bas à droite de l’écran quand elle percute le photographe. Donc, à cet instant, quand l’autre femme descend, c’est très difficile, vous devez arrêter l’image, vous devez scruter l’écran plutôt que suivre le mouvement de l’actrice.
Avant que je ne commence à travailler sur Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image, avant d’avoir fait évoluer les idées qui sont dans le livre et dans lequel l’idée du « spectateur possessif » et du « spectateur pensif » est vraiment cruciale, avant ça, il s’est avéré que j’avais laissé de côté les films d’Hollywood depuis un très long moment et que je ne les avais pas vraiment regardés avec les nouvelles technologies, d’abord en VHS en électronique, et ensuite encore moins en digital. J’ai commencé à retourner aux premiers films que j’adorais des années et des années auparavant dans les années 60, puis je suis passée à autre chose pour regarder d’autres choses.
Donc j’ai commencé à regarder de nouveau ces films en les voyant depuis une perspective complètement différente selon laquelle la performance devenait très importante et la place du tableau, plutôt que la séquence narrative, devenait cruciale. Pour l’extrait de Les hommes préfèrent les blondes, manifestement c’est une danse, une séquence de chanson et de danse, c’est un tableau. C’est une séquence que j’avais regardée plein plein de fois avant de pouvoir envisager que ce serait un remix ou que j’écrirais dessus. Je la trouvais juste fascinante. Et quand j’ai commencé à me demander pourquoi, pourquoi elle est si fascinante, il m’est apparu que ça avait à voir avec la performance très gestuelle de Marilyn Monroe. Et la manière avec laquelle elle décompose son mouvement presque en fragments de morceaux.
Le cinéma est didactique et il le restera. Comment cela? Parce qu’il y a deux écrans, celui de la salle (ou du portable) et l’écran mental que nous portons avec nous. Ces deux écrans sont plus ou moins décalés. Ce décalage est didactique. Être spectateur ou spectatrice, c’est être au même moment et dans la même séquence, en partie hors du cadre: dans la salle; et en partie sur l’écran: dans la scène jouée. Imiter c’est redoubler la chose et la redoubler c’est la décaler, donc la voir autrement. D’où l’apprentissage.Jean-Louis Comolli, Une certaine tendance du cinéma documentaire, Verdier, Paris, 2021.
(dialogue à poursuivre en improvisation à partir de deux articles de Laura Mulvey dans Death 24× a Second: Stillness and the Moving Image, le travail de Jean-Louis sur le logiciel Lignes de temps — www.iri.centrepompidou.fr/outils/lignes-de-temps, ainsi que son film sur la période télévisuelle de Roberto Rossellini)
Conclusion
Quand nous avions imaginé faire un film ensemble, à cinq, ce qui nous importait était l’expérience collective, et nous espérons que ce livre lui correspond.
Malgré le temps passé depuis le début de ce travail, partager par ce livre la pensée critique féministe de Laura Mulvey, et le regard acéré de Jean-Louis Comolli sur les flux d’images qui nous entourent, garde la même fraîcheur de la nécessité.
À l’heure où nous écrivons ces lignes qui clôturent sept années de travail, en France, nous lisons tous les jours dans les journaux les chroniques du procès appelé « des viols de Mazan », dans lequel la cinquantaine d’hommes accusés d’avoir violé une femme sédatée n’a pas l’air de savoir ou de vouloir comprendre ce qu’est un viol. Il en est de même pour Christophe Ruggia, dont le procès pour agressions sexuelles à l’encontre de Adèle Haenel alors qu’elle était enfant, vient d’avoir lieu. Celui de Depardieu vient d’être reporté, mais de toute façon, il est juste un peu grossier.
Qui dirige le monde? « Porcs blancs hétérosexuels cisgenres », pourrait être une réponse. Les textes écrits par Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli nous aident à analyser ces événements judiciaires et médiatiques mais ils n’en demeurent pas moins insoutenables.
Il nous tenait à cœur de proposer une mise en dialogue de ces deux pensées, par l’intermédiaire du cinéma d’abord, puis finalement grâce à ce livre. Nous avons cherché un endroit de mixité pour que puisse apparaître un double regard dirigé contre les assignations sexistes. Ensemble, ces analyses deviennent des outils pour mieux appréhender et déjouer les représentations et les places que l’on impose aux femmes, au cinéma et dans la vie.
En 2020, Adèle Haenel a dit que c’était la honte, s’est levée et s’est cassée. Dans chaque affaire qui sort dans le sillage de #Metoo, nous ressentons une vague de malaise qui monte autour de l’idée que « tout le monde savait » mais que tout le monde était un peu gêné, parce que « c’était une autre époque » ou qu’on avait peur de perdre son travail. L’idée que tout le monde a entretenu tout cela, parce qu’il y avait trop à perdre, et que finalement peu de personnes sont prêtes à se « casser » et à perdre leur petite place dans le petit monde du cinéma.
Ce livre est notre humble contribution pour penser un cinéma féministe et dégagé de toute forme d’oppression, aux côtés et dans le sillage d’autres ouvrages qui nous aident à vivre et à penser. C’est d’abord un hommage et un remerciement aux pensées et à la générosité sans cesse renouvelées de Jean-Louis Comolli et de Laura Mulvey. Il et elle étaient co-auteurices de la première partie de notre film rêvé en trois parties, mais n’ont pas désiré l’être des deux autres. Sans doute était-ce trop engageant pour chacun·e. Sans doute aussi ont-iels voulu nous laisser libres pour tracer notre chemin théorique et créatif, émancipées du poids et du caractère impressionnant que peuvent revêtir deux telles figures du cinéma contemporain quand il s’agit de faire à son tour acte de création.
Signer ce livre nous donne du courage: avec lui on sororise aux côtés de Jean-Louise-Laura Michel et on se dit que la pensée ne doit jamais fléchir, jamais mollir, jamais se prendre au jeu des dominances de la vérité et du pouvoir, mais se tenir au plus près de nos consciences. La pensée, ce sont aussi ces clairières claires-obscures de nos imaginations vagabondes, lesquelles nous permettent de considérer d’un autre œil que celui de l’acceptation fataliste le monde qui nous entoure de ses contours de plus en plus ternes, rigides et isolants.
Voilà pourquoi il était nécessaire pour nous de faire se rencontrer Jean-Louis et Laura il y a cinq ans, et de partager aujourd’hui ce livre avec les lecteurices qui auront l’envie de s’en saisir. Nous l’imaginons comme un outil de réflexion pour construire un cinéma et des spectateurices — et donc un monde — émancipé·es. Il peut aussi servir d’outil, bien que pas très lourd, pour taper sur la tête de mecs qui voudraient vous mansplainer sur le male gaze.
Colophon
Traduction : Women Remix.
Relecture par Coralie Guillaubez.
Photographies de Women Remix.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Un jardin, une rencontre imaginée entre Laura Mulvey et Jean-Louis Comolli, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Papago peau rose 180 g/m², Clairbook 80 g/m² en 900 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en mai 2025 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-418-7.
Cette version a été composée par Marine Le Thellec en Gräbenbach Mono (Wolfgang Schwärzler) et Basalte (Ange Degheest).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.