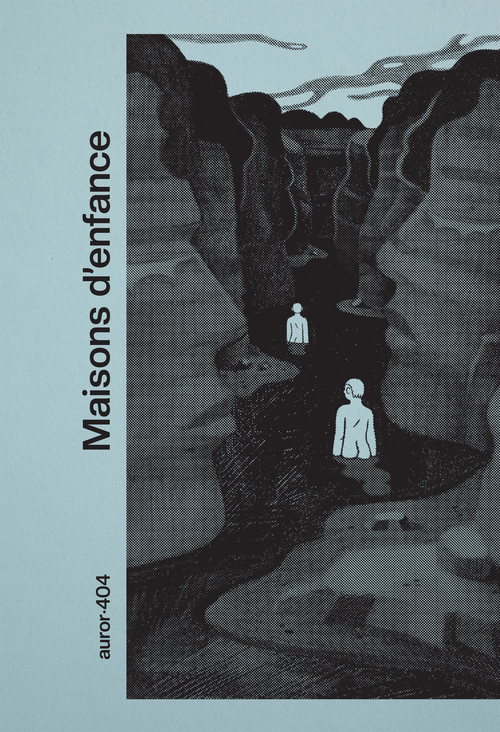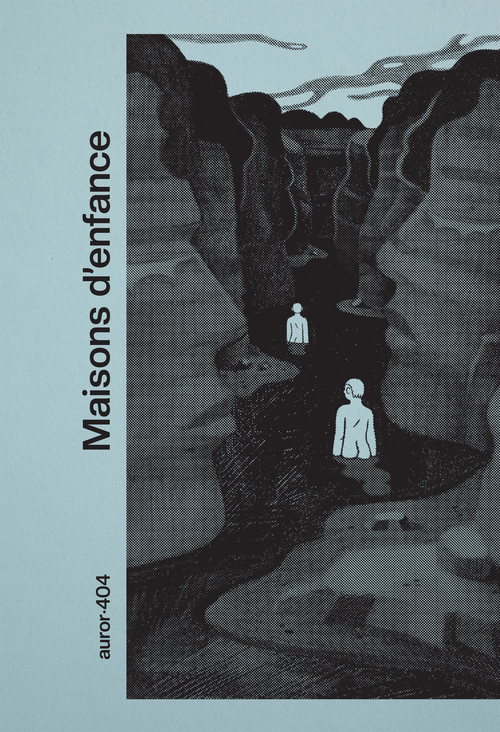
Table des matières
Maisons d’enfance
Samaël retourne dans le bassin minier du Pas-de-Calais vider la maison qui l’a vu grandir. Alors assailli par les souvenirs des violences intrafamiliales que ces murs ont étouffées, il tombe amoureux d’un chercheur renommé. Lorsque cet universitaire l’invite dans sa résidence secondaire, le lieu a priori paradisiaque se referme sur Samaël de toute sa lourdeur bourgeoise. Brassant les notions d’héritage, le récit questionne la difficulté de faire famille autrement. Samaël peut-il se défaire des dynamiques d’emprise qui irriguent sa nouvelle relation ? Peut-il s’enfuir de la maison d’enfance ?
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 03/01/26 à 17 h 18.
- NOTE DES ÉDITEUR·ICES
- Les oisillons n’avaient pas survécu
- Sentinelles
- Se rencontrer
- La lumière à tous les étages
- Se soutenir
- Premier été
- L’enfant préféré
- Se toucher
- Patrimoine queer
- Diogène le père
- Vider les lieux
- La liste des séquelles
- Devenir ? Rien.
- J’espère que t’as honte
- Poussière et gravats
- Jour de Noël
- Jour de l’an
- Qu’est-ce que tu veux, toi ?
- Ciel et sable
- Fondations
- Ces frontières en toi
- Du linge blanc sur mes années de guerre
- Phobie d’impulsion
- Oublie ça
- Deuxième été
- Une fête d’anniversaire
- Ce que je ne peux pas te dire
- Pretium doloris
- Avignon
- S’abandonner
- Photos de famille
- S’en remettre
- Glossaire
- REMERCIEMENTS
NOTE DES ÉDITEUR·ICES
Les éditeurices préviennent les lecteurices qu’iels vont trouver le récit de violences sexuelles dans ce roman, notamment vécues pendant l’enfance.
Nous souhaitons vous avertir en début d’ouvrage pour que vous puissiez aménager votre lecture dans les meilleures conditions, celles qui vous conviennent.
L’écriture inclusive n’est pas utilisée de manière systématique dans le roman. L’auteurice a choisi de distinguer des formes genrées pour les périodes du récit où l’usage de l’écriture inclusive serait anachronique et absurde, par exemple lorsqu’iel cite des slogans homophobes de la manif contre le mariage pour tous.
Les oisillons n’avaient pas survécu
Ses doigts à la peau terreuse, aux ongles épais, cherchaient un reste de tabac. Ce n’était plus un geste, c’était un réflexe : du papier à rouler, puis disposer les filaments ambrés en une forme harmonieuse, se battre avec le briquet. Essuyer brusquement les ravages du vent dans ses yeux trop clairs.
Toute sa vie il avait tenu debout grâce à ce petit jardin, ce lieu à lui, son observatoire. Par le passé, à l’automne, il récoltait les pommes tombées hors du périmètre des vergers du secteur. Il empilait des caisses et des caisses qui embaumaient sa cave. Ces réserves duraient des mois et servaient à nourrir merles et rouges-gorges aux premières gelées. C’était avant, quand il était encore en pleine possession de ses jambes.
Il ne se pardonnait pas la fois où il s’y était pris trop tard. Il avait pourtant reconnu les allers-retours frénétiques de la mésange. Il aurait dû comprendre qu’il n’y avait plus que la moitié du couple, une maman épuisée qui ne parvenait pas à nourrir toutes ces bouches. C’était une nuit d’orage, la mésange endeuillée avait pris peur et s’était enfuie, abandonnant son nid en désespoir de cause. Il avait fallu l’arrivée du jour pour qu’il sorte de son inertie et pense à ce PMU proche de la gare de Béthune, vendant du petit matériel de pêche. Il en était revenu avec une boîte d’asticots pour nourrir les oisillons. Mais c’était trop tard.
Il aurait pu les sauver, s’il avait eu plus de présence d’esprit. Mais il n’était qu’une merde, une grosse merde incapable. Le fantôme de Nietzsche planait autour de son crâne migraineux : il finirait comme lui, fou et muré dans le silence après avoir vu un cheval se faire battre à coups de cravache. Il hurlait qu’on en finisse, bon dieu, qu’on en finisse. Il repensait à sa famille chérie, sa tribu en décomposition.
– J’ai tout sacrifié pour vous, je voulais vous offrir des racines et des ailes, j’ai échoué mes enfants j’ai échoué pardon. Je n’ai pas pu vous sauver non plus, j’étais trop naïf. Vous ne comprenez pas, toutes les cannes que j’ai sculptées, tous les outils que j’ai récupérés, tous les livres que j’ai achetés, tout cela est pour vous. Maintenant, je n’ai plus que des chemins noirs, de la fatigue noire.
Des étoiles dansaient derrière ses globes oculaires, qu’il compressait pour atténuer les écorchures que les sons produisaient à l’intérieur de son crâne. Il devait se concentrer afin de poursuivre sa déclamation.
– Vous savez, quand j’avais 19 ans j’ai travaillé dans une ferme et le patron, Auguste, faisait une chose étrange, il marchait derrière les moissonneuses batteuses de son champ et récupérait les légumes restés au sol. Parce qu’il avait travaillé trois fois pour obtenir cette récolte. Une fois en achetant les graines. Une fois en les plantant. Et encore une fois en les récoltant. C’est ce que je veux vous transmettre, mes enfants. Les valeurs de la décroissance. Ce pour quoi je me suis toujours battu. Ce pour quoi Graeme Allwright s’est toujours battu. Vous savez, je commence à perdre la tête, alors j’écris. Tous ces carnets sont pour vous, la Kapo passe son temps à m’épier, mais elle ne peut pas surveiller ce que je cache dans mes caisses.
L’espace sur la table était réduit à sa portion congrue. Les empilements de documents étaient scrupuleusement protégés dans des boîtes, empilées et alignées devant lui, comme un mur sans fondations. Face à l’engorgement des souvenirs, il poussait le son de la radio, dont il avait bloqué le curseur sur France Info. Ce subterfuge était d’une efficacité limitée. Il voyait bien où ces journalistes voulaient en venir en parlant de frappes chirurgicales, il n’irait pas dans cette direction. Il arrachait la prise du poste de radio quand la vulgarité des propos devenait trop intense. Il se donnait des coups de poing dans la tête pour laver son crâne de ces paroles capitalistes et meurtrières. Faisait renaître les étincelles dans ses globes oculaires. Ça allait mieux.
Il ouvrait son carnet de notes et se concentrait : les choses auraient pu être si simples. Depuis des années il lisait avec attention les auteurs de l’écologie profonde : il fallait vivre en communautés, entre un fleuve et une vallée. Les meilleurs penseurs du siècle dernier avaient théorisé ces oasis de rébellion. Ils étaient eux-mêmes partis se réfugier dans des bois ou des hautes montagnes. En revanche, il fallait à tout prix éviter le piège de l’industrialisation et de la technique, ne pas refaire les mêmes erreurs. Il fallait définitivement interdire les machines.
Lui, il avait construit à la main une muraille sur sa peau, il avait laissé les mauvaises herbes étouffer ses poumons et son cœur. Laisser sa nature prendre le dessus, c’était sa profession de foi. Il disait parfois, du bout des lèvres, mes enfants vous êtes pauvres mais pas miséreux. Pauvre, c’est manquer du superflu, miséreux c’est manquer de l’essentiel.
Il n’y avait plus rien d’inédit dans ces mots prononcés aléatoirement, dans son décompte des jours sans appel, dans ses lettres postées en vain. Il ne comprenait pas pourquoi ses enfants avaient délaissé son ultime courrier, pourtant recommandé. Pourquoi ils ignoraient ses sms interrogatifs, rappelant les dates des dernières nouvelles, soulignant presque statistiquement leur éloignement.
C’était bientôt la fin. Chaque nouvelle aube, il faisait un trait de plus dans le carnet. Chaque nouvelle aube, il pouvait éteindre la veilleuse à son chevet, laisser les muscles de son buste se relâcher. Tout est consigné dans ces carnets, prévient-il. Mais ils seront pour toi après, Samaëlle, tu comprendras en vieillissant, quand tu prendras le temps de les lire.
L’atmosphère était si infâme ici, les seuls petits plaisirs de son existence avaient été annihilés il y a six ans, trois mois et vingt-deux jours. Ce qu’il y avait de plus difficile, c’était la nourriture. Il ne finissait pas ses assiettes, trempait de la mie de pain dans le jus du thon en boîte, répartissait les victuailles dans une gamelle qu’il posait sur le rebord de sa fenêtre : Misère serait contente.
Des lutins en plastique à la morphologie approximative pendaient du plafond, dans le couloir qui menait de l’accueil aux chambres des résidents. Il cherchait des rituels pour tromper le dégoût de ce mois de décembre pluvieux et demanda du papier à la directrice de la maison de retraite, l’autorisation d’afficher ses propres décors sur les murs saumon des espaces communs. Pendant 72 heures, il découpa minutieusement des étoiles aux formes délicates, des cristaux de givre dans des feuilles A4. Ces gestes répétitifs lui permettaient de retrouver l’activité favorite qu’il partageait avec sa fille, de ses premiers pas à ses 17 ans.
Quand il était encore en activité, il pouvait poser des congés sur un coup de tête pour aller aider bénévolement une des grandes causes qu’il défendait. Il l’a fait en 1999 pour aller ramasser le pétrole à la pelle le long des côtes bretonnes.
Samaëlle guettait le journal de France 2 le soir, espérant le voir parmi les personnes interviewées. Elle pleurait devant les goélands englués, elle aurait aimé, elle aussi, grever ses obligations et être là-bas.
L’Autre, Samaëlle essayait au contraire de ne jamais l’avoir dans son champ de vision. L’Autre, inexistante, qui lavait les chaussettes en marmonnant et continuait à aller remplir le réservoir de la vieille Citroën chez Total.
Lui, il avait rapporté de son périple une cassette dédicacée de Gilles Servat. « À Samaëlle, dispensée pour cause de bac blanc de français. »
Sentinelles
Mars 2013. Sur les murs de Paris, la France a besoin d’enfants, pas d’homosexuels. Cent-soixante-dix professeur·es de droit adressent une lettre ouverte aux sénatrices et sénateurs. Iels y dénoncent la mise en place d’un marché des enfants.
Dans les débats, les chroniques des expert·es invité·es, sur BFM en continu, dans les hôtels sociaux où l’État place des mineur·es en procédure d’urgence, ça n’arrête pas : Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants.
Certains extraits tournent en boucle, ce qui leur octroie la consécration de devenir des mèmes. L’éditorialiste Jeanne-Emmanuelle Hutin, fille du PDG du journal Ouest-France, prédit des bouleversements beaucoup plus profonds, dont les conséquences anthropologiques n’ont pas été étudiées. À quelques jours du grand sursaut des valeurs familiales, le quotidien le plus vendu du pays offre une pleine page de publicité aux cars partant de province pour rejoindre le cortège parisien de La Manif pour Tous.
Selon un sondage Ifop, la majorité des Français estime que trop de place est donnée à ce débat. À la MECS où je bosse, j’interroge des collègues qui ont pourtant l’air d’être passé·es à côté de ce flux de reportages, de télé-trottoirs et de décryptages. Tu parles de quoi ? Ha oui, la meuf du Petit Journal, « l’homosexualité c’est contre-nature ». Yann Barthès l’a bien tournée en ridicule, faut pas que tu t’inquiètes !
Les rires désinvoltes produits par ces chroniques me blessent. Aya vient s’asseoir à côté de moi dans la salle de pause, elle me tend un café, rappelle-toi que tu détestes pas les lundis. Tu détestes que la Manif pour Tous pose ses sales pattes partout, dès le début de semaine. Elle ne pense pas si bien dire.
– Lors de leur rassemblement précédent, le seul truc que le maire de Paris a trouvé à faire, ça a été de porter plainte pour pelouse abîmée sur le Champ de Mars.
Elle m’écoute en surjouant les yeux au ciel pour essayer de m’arracher un sourire. Je continue à vider mon sac :
– Ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire, c’est toutes ces petites têtes blondes en sweets à capuche bleu ou rose, qui sont en train d’apprendre à se haïr.
– Y’a pas que des petites têtes blondes, mais oui. Moi aussi je voudrais montrer à Ludovine de la Rochère et Virginie Tellenne les scarifications, les vomissements dans les toilettes des dortoirs, la distribution de cachetons.
– Et tous ces médicaments qu’on leur file, j’ai la sensation de les maltraiter.
– Y’a forcément de la maltraitance quand on a plus que ça pour gérer. En plus, quasi aucune évaluation n’a été réalisée sur les conséquences des psychotropes chez l’enfant. C’est le groupe social dominé par excellence, mais le danger c’est « les pédés ».
– Ce serait bien qu’on ait un tract à diffuser sur tout ça, pour la contre-manif de ce weekend.
Aya et moi on s’est rencontré·es lors de mon premier stage, alors que j’étais en école d’éduc il y a dix ans. Ça a très vite matché entre nous. Je me sentais pas légitime et elle m’a pris sous son aile. Elle avait longtemps milité contre les mutilations sexuelles, elle voulait développer d’autres sujets en lien avec les violences sur enfants et les démarches émancipatrices. Quand j’ai obtenu mon diplôme, on a commencé à militer ensemble en dehors du taf. On est très complémentaires, elle adore se plonger dans des synthèses de méta-données, des tableaux excel et des graphiques. Moi je peux passer des heures à écouter des podcasts, lire des essais ou des témoignages. Les chiffres et les lettres comme elle dit.
Après ma journée de boulot, j’appelle ma pote Myriam qui gère la commission anti-sexiste de notre syndicat. On parle brièvement du contexte ambiant, je sens direct sa lassitude. Pour une fois qu’elle décroche, j’en profite pour bifurquer vers des choses plus personnelles. Elle me parle de l’attaque d’un centre d’hébergement d’urgence par des proprios du 16e qui craignaient pour leurs plus-values. Puis de cette image qu’elle a déjà évoquée quelques fois ces derniers mois, qui semble rester gravée dans sa mémoire. Une vieille dame réfugiée dans le hall d’une banque, vers 23h, mangeant de la pâtée pour chat. C’était à quelques jours de Noël, entre les vitrines somptueuses et les décorations. Sérieux, si je veux tenir sur le long terme, il va falloir que j’aie un peu de beauté autour de moi.
Comme plusieurs autres de mes ami·es, Myriam veut quitter Paris. Je suis encore au téléphone avec elle quand je commence à remonter à pied le boulevard Tolbiac, Ludo m’a donné rendez-vous Place d’Italie. J’essaye d’ignorer le happening immobile d’une cinquantaine de droitards catholiques autoproclamés « sentinelles », dans un quartier jusque-là plutôt préservé des fafs. Les Veilleurs au moins, avec leurs bougies, leurs mains jointes, leurs postures agenouillées, ils ont une esthétique qui pourrait presque m’attirer.
Ludo me fait de grands signes sur le trottoir d’en face. Il scrute mon visage avec un air de diva, un air qui veut dire, t’as des cernes mon petit, tu es sûr d’engranger assez de sport, de fruits, de légumes, de vitamine B12 ? Finalement, il choisit une autre entrée en matière :
– Tu baises un peu en ce moment ? Tu devais pas essayer cette nouvelle appli, Tinder ?
Ludo dit ça avec une pointe de malice, mais je sais qu’il attend ma réponse.
– Je suis dessus depuis un mois, mais je baise pas trop. Surtout à cause de trucs techniques.
Les murs sont vraiment fins à l’appart’ et ça m’angoisse encore de débarquer chez un inconnu. Puis, j’essaie d’avancer sur mon mémoire. On s’installe en terrasse d’un petit bistrot de la Butte aux Cailles. C’est après avoir commandé nos plats qu’il me dit :
– Je sais pas quel choix faire. Accepter la transplantation ou pas ? Dans tous les cas, ça signifie risquer de mourir. Faut que tu le saches…
Je sais.
– On m’a trop souvent fait sentir que j’étais diminué. Déjà enfant, j’ai échappé de peu à l’IME. Je veux pas de ça comme existence. Je veux pas d’une demi-vie.
Il y a une dizaine de personnes à la table d’à côté, des affiches « La différence, c’est la clé de l’existence » sur le mur d’en face. Le soleil persistant est comme ces vidéos pornos qui continuent de tourner après qu’on en a fini : gênant.
Je me concentre sur la manucure de la serveuse qui arrive pile à ce moment-là : du rouge brillant, laqué ; puis sur la corbeille de pain qu’elle pose entre nous, que je fais tomber par maladresse, ça fait rire Ludo.
Je laisse le silence s’installer quelques secondes. Ludo, c’est vraiment un coup de foudre amical. On s’est rencontrés à la Pride il y a des années, il m’a aussitôt dit qu’il était malade. J’ai senti que c’était une info un peu trop grande pour mon cerveau, qu’on allait la mettre de côté pour plus tard.
J’ai pensé il est trop tôt pour prendre une cuite. Puis essayer de formuler quelque chose d’utile.
– Est-ce que tu veux que j’en parle à Joey ? Tu préfères peut-être lui annoncer toi-même ?
– Fais-le, si ça te dérange pas. Y’a déjà mon père et ma sœur qui vont en faire des caisses, pleurer, vouloir trouver des solutions, me convaincre d’accepter la greffe alors qu’après je ne pourrai plus vivre que dans l’hygiène et la prudence. C’est-à-dire plus de sauna, plus de baise, plus rien de ce que j’aime et qui me fait vibrer.
J’ai aussi pensé j’ai envie que tu vives. Parce que chez les pédés, y’a toujours un moment où on recycle un vieux slogan d’Act Up. Malgré ma mièvrerie, j’ai pas envie que mon meilleur pote demi-vive.
Je propose :
– Il y a toujours l’hypothèse où les médecins décident que tu peux pas être transplanté ? À cause de ta fragilité pulmonaire ?
Ludo reformule :
– Mentir à mon père ?
– Pourquoi pas ? Y’a des mensonges qui sont des politesses.
Se rencontrer
Par deux fois ta photo apparaît sur mon écran. Par deux fois je ferme l’application pour ne pas avoir à décider, nerveux.
Ton visage me happe à un endroit qui rompt avec le geste mécanique, la lassitude inhérente à ce site de rencontres. Tu es intéressé par tout contact humain stimulant. Dans la rubrique loisirs, tu indiques cuisiner des plats végétariens et discuter dans d’autres langues. Tu aimerais qu’on t’emmène danser. Tu as un profil d’expat’, tu mets en avant une vie de rencontres éphémères dans différentes capitales européennes.
La troisième fois où ta photo apparaît, je t’ajoute, en me disant que, de toute façon, tu es beaucoup trop attirant.
Tu m’écris le jour même : tu penses que nous avons pas mal d’ami·es en commun, tu me proposes un café pour faire connaissance et me laisse le choix du lieu.
Tu arrives au rendez-vous en même temps que moi, t’es hyper timide. Tu portes une robe en coton délavé et des bijoux fantaisie. Tu trembles un peu en versant l’infusion que tu as commandée.
Tu n’es pas venu au rassemblement hier. Tu n’en es plus capable : la foule, les fafs, leurs expéditions punitives, ça te file des crises d’angoisse. Puis ce qu’ils pourraient faire à nos droits si ce mouvement perdure. Ainsi qu’aux femmes, aux exilé·es, aux pauvres, on sait que ça commence toujours comme ça.
Tu as les larmes aux yeux, une allergie saisonnière, tu as oublié tes antihistaminiques. J’associe instantanément ton regard humide, les volumes de ton visage et tes cernes aux traits d’un martyr chrétien.
Quelque chose se joue dans les premières minutes de notre rencontre, nous dispensant des phases d’ajustement et de mise à l’épreuve.
On ne simule pas l’ignorance : je suis allé lire les interviews dans Libé et Le Monde, suite à la sortie de ton livre, Enfants (pas) naturels.
Toi, tu sembles très intéressé par l’association que j’ai cofondée avec Aya. Tu as écouté une captation de ma prise de parole à la Bourse du travail le 8 mars dernier, sur la question des violences adultistes. Tu es aussi au courant du combat judiciaire que j’ai mené pour devenir officiellement le tuteur de mon petit frère. Tu m’en informes avec tact.
J’hésite sur le niveau de précision que je peux apporter à ça. Je veux pas commencer un date avec un truc aussi lourd. Mais tu poursuis. C’est rare un parcours comme le tien, peut-être même inexistant dans mon milieu. À l’université, on est beaucoup à mettre en lumière nos identités queers, j’ai quelques collègues racialisé·es, mais personne qui vient réellement de classe populaire. Ou alors iels le passent sous silence.
Tu es recroquevillé sur ton siège, les épaules tendues. Tu préviens. Moi je suis un bourgeois. Je parle comme un bourgeois, je vis comme un bourgeois. N’hésite pas à me le faire remarquer si ça devient inconfortable pour toi. C’est vraiment OK que tu me remettes à ma place.
Ton regard reste fixé sur moi pendant tout notre échange. J’ai envie de te donner ma confiance. À la manière dont tu joues carte sur table, aux détails que tu partages, je comprends que c’est réciproque.
Tu me confies certaines hypothèses qui structurent tes recherches : en ce moment, tu écris un article sur les conséquences émotionnelles des sévices sur enfants dans les pensionnats d’Argentine. Tu reviens de plusieurs mois sur ton terrain, tu es en plein dans ton projet d’HDR.
Je n’ai jamais entendu parler de ce sigle, je dis :
– Je suis désolé, c’est quoi ?
Tu complètes :
– C’est tout à fait normal, c’est du jargon. L’Habilitation à Diriger des Recherches. C’est pour suivre des thèses.
Tu ne précises pas que c’est le plus haut diplôme en France. Ça, j’irai le constater plus tard sur Wikipédia.
Tu m’expliques qu’après avoir travaillé sur les modèles parentaux non cis-hétéros lors de ton doctorat, tu t’intéresses aux enfants et aux traumas liés aux institutions normatives, en particulier au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance. Tu proposes que nous collaborions, en nous appuyant sur l’expérience de plaidoyer que j’ai acquis via mon asso et sur mon expertise d’éducateur en foyers d’accueil.
Tu veux diversifier ton approche et établir des connexions entre chercheurs, activistes et professionnels.Tu es assez épuisé par les schémas classiques de recherche en anthropologie, les interminables politiques de citation avant d’entrer dans le vif du sujet, les hiérarchies entre thèmes prestigieux et subalternes. Toi, tu ne cherches pas spécialement à asseoir une carrière académique. Tu veux produire des savoirs décloisonnés, dont peuvent se saisir les travailleurs sociaux.
Ça semble un peu trop impressionnant, je botte en touche : peut-être dans un an, quand j’aurai validé ce master par correspondance, dans le cadre de ma reprise d’études. Oui, bien sûr, il n’y a rien d’urgent, l’HDR c’est du temps long. Et il faut que tu y trouves ton compte, on en reparlera dans un an.
On a effectivement un très bon ami en commun, Étienne. Une petite star dans le milieu artistique parisien, comme je le définis avec affection. Tu dis Étienne, je l’adore, mais ça doit faire deux ans que je ne l’ai pas croisé, il est insaisissable. Je réponds que je n’ai pas ce problème, vu que je vis en colocation avec lui depuis quelques mois.
– C’est toujours l’appart de la rue Pajol, dans le 18e ?
– Oui, toujours. Ça a été l’emménagement le plus simple de ma vie. Sa cousine, qui est proprio, n’a même pas demandé de caution.
Tu confirmes ça a tout le temps été une coloc militante. Tu te réjouis par avance de nos futures conversations.
Quelques jours plus tard, un courrier de toi m’attend dans ma boîte aux lettres : un fanzine sur l’enfance, ironiquement intitulé Nos innocences. Je contemple les pleins et les déliés de la carte qui l’accompagne : ton écriture manuscrite, l’encre adolescente bleu outremer, cet intime presque désuet qui surgit de tes mots. Les trois premières lettres de ton prénom. Un cœur turquoise en guise de ponctuation.
Notre deuxième fois, c’est une matinée de juin. On se retrouve pour une expo de Tom de Pékin, dans un arrondissement où aucun de nous deux ne met jamais les pieds. Tu portes un short en jean grossièrement découpé aux ciseaux et un crop top rose vif, des écarteurs d’oreille. Ton corps produit la même étrangeté que les toiles exposées : un mélange d’érotisme frontal et d’introversion mystique.
L’onirisme épidermique de Tom de Pékin nous fait divaguer en eaux troubles, entre récifs escarpés et recueillement. La lumière du dehors n’en est qu’un contraste plus vif. Cette météo est mon alliée : moi qui suis si peu tactile, je réussis l’exploit de t’appliquer de la crème solaire sur les pommettes, le nez.
Ensuite, l’humidité résiduelle des bords de Seine nous accueille. On se balade le long des quais en ralentissant le rythme de nos envies, de nos voix, de nos frissons. Tu me fais écouter un morceau de Mercedes Sosa,on se partage tes écouteurs comme deux ados.
Notre conversation s’étire des heures et manque de te faire rater le direct de 20h où tu es invité en tant que spécialiste des filiations queers en Amérique Latine. On s’engouffre en dernière minute dans une rame de métro. Tu m’envoies un selfie à 19h58 du studio 105 de la Maison de la Radio.
La lumière à tous les étages
C’était rien. C’était simple à comprendre. Des millions de personnes dans ce monde vivaient sans chasse d’eau, sans système automatique d’évacuation des eaux usées. Mais cette connasse avait des rêves de princesse. Par provocation, elle avait foutu un tampax dans la cuvette des toilettes chimiques et maintenant ça avait tout bouché. Il suait à grosses gouttes à cause de cette incapable, secouant le WC en essayant d’en vider le contenu dans la bouche d’égout ouverte, sur le trottoir.
Il était obligé de faire ça de nuit pour pas que les voisins préviennent la mairie. Ces demeurés étaient inaptes à comprendre qu’à grande échelle, le même procédé s’appliquait quand ils tiraient la chasse d’eau. Ils n’avaient pas conscience du gaspillage insensé des ressources vitales sur cette terre.
Un conflit larvé s’ouvrait entre lui et sa femme.
– Viens déboucher.
– Non.
– Putain tu vas venir !
– Non je peux pas soulever une charge pareille.
– Alors viens foutre ta main dans le tube !
– Non, mon poignet est trop gros.
Samaëlle était intervenue avant qu’ils ne commencent à se cogner. Elle venait d’avoir ses règles, elle ne savait pas, c’était elle, elle s’en occupait. La mère avait souligné ses propos : Tu vois, c’est cette petite pute ! Elle, tu ne l’aurais jamais accusée hein ? Comme le père ignorait si Samaëlle utilisait des serviettes périodiques ou d’autres types de protections, il l’a laissée aller dans la rue retirer le tampon imprégné d’excréments et finir la vidange des toilettes. Au moins sa fille n’était pas comme l’Autre, elle ne faisait pas de simagrées.
Lui, il affectionnait la planète. Il affectionnait les parfums de la terre à l’automne, après la pluie. Une pomme un peu flétrie, mangée au cours de la balade du soir. Mais aussi le travail du bois : modeler à l’opinel des petites sculptures ou des bâtons de marche.
Quel que soit le moment de l’année, il portait un pantalon de velours côtelé usé aux cuisses et une veste de chasse. Il était réfractaire aux modifications corporelles, aux effets de mode, à l’artifice. Il entretenait une silhouette simple, rustique, aux muscles marqués par l’effort véritable. Celui du jardinage et des travaux manuels.
Ses poches étaient remplies de cordelettes, mouchoirs, sacs plastiques, cartons et crayons à papier. C’était un combat pour qu’il se déleste quelques instants de cet uniforme sans âge. Sa femme devait lui courir après pour une lessive ou un point de couture. Sa réussite était le fruit de longues négociations.
Quelque chose se brouillait souvent entre ses tempes. Il s’enfermait dans le noir pendant des heures, désespéré par cette santé fragile qu’il traînait depuis l’enfance. Pour s’apaiser, il se raccrochait à des mantras.
S’il souffrait des lettres de créance, des humiliations régulières devant le banquier, il savait aussi que les prescriptions honnêtes ne se trouveraient pas à l’endroit du capital. Il était un dissident, accablé par la passivité de son voisinage.
Il compensait ses frustrations en achetant des substances douces à son palais. Des harengs marinés, du lard, du pâté en croûte. Son père avait complété son maigre salaire de mineur de fond en étant assistant boucher. Il lui rendait hommage.
Dans la cité minière dans laquelle ils résidaient, il était revêche face aux chats qui vagabondaient et refusaient ses caresses. S’il les chassait officiellement, il allait jeter en cachette des croûtes de fromage dans la cour et observer les félins venir se repaître. Sans doute qu’à travers les purées, les œufs au fromage et les soupes de vermicelles, il se rappelait quelque chose de ses premières années.
Il avait été un enfant chétif, souffrant de la rétention de câlins d’une mère qui perdait peu à peu la tête. Victoria, dont ne restaient que les traits retouchés d’une photo noir et blanc de mariage, avait économisé billet après billet dans une boîte en métal. Plus que tout palpitait sous son épiderme l’envie folle de rentrer au pays. Elle calculait sans répit, faisait l’impasse de certains repas pour alimenter son rêve. Chaque franc prélevé à la tenue du foyer était une victoire.
Puis il y a eu le grand malheur des économies perdues, quand elle a compris qu’il fallait jeter ses illusions dans l’oubli. Alors, elle est partie se balader au bord du canal avec sa caisse en fer blanc sous le bras. Il semble que c’est après cela qu’elle a été internée.
Elle a utilisé du savon, du produit vaisselle et du Cif, puis de nombreuses lingettes pour se nettoyer, car il n’y avait plus d’eau dans le jerricane. Malgré ça, l’odeur était encore sur sa peau quand elle s’est préparée pour le collège, le lendemain. Alors qu’elle sortait tête baissée et cartable sur le dos, il avait sifflé rageusement entre ses dents : Putain arrête ton cinéma, c’est que des matières fécales, c’est naturel.
Se soutenir
On est obligé·es de s’aligner sur leur agenda politique, d’être la contre-manif, celle non autorisée par la préfecture et presque pas relayée dans les médias. Au point de rassemblement, je sens les regards appuyés sur le foulard et le visage de ma collègue. J’entraîne Aya vers la tête de cortège, moins institutionnelle. Le service d’ordre détourne les yeux. Parfois, même ma commu me saoule.
Fumigènes violets, techno et Amel Bent, l’ambiance prend vite. On a besoin d’images percutantes car on sait très bien que demain, dans la presse, ça va être la bataille des portfolios. Une partie des manifestant·es sont en mode bisounours, avec des banderoles « love is love ». Un couple de bears brandit une pancarte « On veut notre lune de miel » et des meufs vénères ont écrit leurs slogans à même la peau. Dans le cortège queers of colors, je vois Étienne parler à un grand gars au crâne rasé, avec un air attendri très caractéristique.
Les journalistes présent·es posent des questions pertinentes, à contrecourant du brouhaha des derniers mois. Aya répond à une stagiaire de Radio Campus, concernant l’impact des dominations adultes sur la santé des ados LGBT, doublement minorisé·es et privé·es de leur pouvoir d’agir.
J’échange quelques messages avec mon frère, qui ne peut pas venir aujourd’hui. Son amie Laelia vient d’être recalée à l’oral de l’école d’éduc qu’elle convoitait. Les membres du jury lui ont demandé si elle accepterait que deux hommes aient recours à la GPA. En quoi ça les regarde, sérieux ? Un autre sms arrive quasi instantanément. Ils lui ont dit que l’amour ne justifie pas de détruire le contrat social. Que s’ils n’étaient pas obligés d’être là, à lui poser des questions, ils seraient dans la rue à coller des affiches.
Je sens mon indignation monter : Laelia serait une super étudiante, une super future collègue. Elle m’avait timidement contacté quand elle avait passé la phase des écrits. J’avais répondu à son enquête métier et essayé de l’aider au mieux. Je ne sais pas quoi répondre à Ulysse. J’aimerais que lui et ses potes aient la possibilité de l’insouciance, qu’on laisse autre chose à nos petits frères et petites sœurs. On encaisse pour quoi, si la génération d’après subit tout autant ?
Plus tard dans l’aprèm, je passe voir Ludo. Il sort d’une semaine d’hospitalisation, je lui fais quelques courses, la vaisselle. Je lui raconte l’ambiance de la manif, mais il n’arrive pas à se concentrer. Marcher quelques mètres l’essouffle, il passe désormais ses journées sur Twitter, contraint de développer d’autres formes d’expression militante.
Il en a marre des textos lui souhaitant un bon rétablissement ou lui suggérant de bien prendre soin de lui et de faire signe s’il a besoin de quelque chose. Qu’est-ce que les gens comprennent pas dans « incurable » ? Puis l’Allocation Adulte Handicapé, c’est sept-cent-cinquante et un euros par mois, vraiment idéal pour bien prendre soin de soi. Il a envie que je reste et n’a aucune énergie. Son père, qui est psy en libéral, ne lui propose pas d’aide financière. Ce serait sans doute une solution trop simple pour un lacanien. Par contre, il se rend disponible à chaque hospitalisation, devançant parfois son fils pour répondre aux questions du corps médical.
Les échanges entre eux ont été houleux quand il a appris que Ludo était sous Prep. Il s’inquiète pour la santé de son fils et pour son estime de lui-même. Il voit beaucoup de patients comme lui dans son cabinet. Être homosexuel ne devrait pas être synonyme d’inconscience relationnelle ou de dépravation. Au coup par coup, il invite Ludo à l’opéra, au restaurant, ou achète un ustensile de cuisine pour équiper son studio.
– J’en veux pas vraiment à mon père, il s’inquiète. Contrôler les choses, ça doit lui donner l’impression d’agir pour mon bien.
Je sens qu’on n’est pas beaucoup de ses proches à être passé·es voir Ludo, je décide de rester avec lui jusqu’au dernier métro. On mate les torses musclés des mecs sur le site d’Asos et toutes les fringues qu’on n’a pas la thune de s’acheter, puis on regarde un Disney dans son lit, en mangeant des conneries.
En montant les six étages vers mon appart ce soir-là, je me sens harassé. L’alarme de mon réveil sonne dans cinq heures et je fais le vœu d’une énergie inédite pour bousculer ce quotidien aride. Sur WhatsApp, il y a une notification de toi : La proposition de trajet en voiture est toujours d’actualité.
Premier été
Il a fait chaud, même si on a en partie roulé de nuit. Un voyage caniculaire à se relayer au volant vitres ouvertes. Une atmosphère propice aux confidences.
Tu as l’air seul. Tu dis oui. Par la suite tu nieras cela, tu es très entouré. C’est vrai, mais on peut être seul avec des gens autour. Ce n’est pas ton cas. En revanche, tu es en plein déboire amical. Je peux te raconter ? J’en parle beaucoup à ma mère déjà, je ne veux pas abuser de ton écoute. Bien sûr que tu peux me raconter.
Alors tu m’expliques la situation avec ton meilleur ami, la personne la plus brillante qui soit, ça t’en coupe le souffle parfois. Tu utilises des mots forts pour évoquer le manque, comme un enfant blessé. Pour toi, une amitié c’est plus que la définition qu’il t’en donne, plus qu’être là pour aider à cacher le cadavre. Tu souffres de cette absence de liens profonds, de cette confusion entre travail et vie privée. C’est pire depuis qu’il est devenu professeur des universités, il n’y a plus beaucoup de place pour l’amusement dans sa vie, plus beaucoup de place pour toi.
Tu conduis avec douceur, un peu en dessous des vitesses autorisées. Dans le compte à rebours de nos anxiétés, cette vacance existe. Le paysage devient de plus en plus luxuriant.
– J’ai l’impression d’être catapulté dans un autre pays…
– Pourquoi tu dis ça ?
– Je sais pas. C’est tous ces volumes : on ne voit plus l’horizon.
– Hahaha ! On dirait que tu n’as jamais vu de montagnes !
Sur France Culture, une personne au phrasé hégémonique explique que sa vie a toujours été une suite de hasards, qu’un d’eux l’a conduite en khâgne à Henri-IV. C’est fou, je n’ai compris qu’au bout de quelques mois que ces études me préparaient à un concours. Mais j’étais bien, j’étais entourée d’élèves qui aimaient les mêmes choses que moi, qui avaient beaucoup lu, c’était ma définition de la France.
Henry-IV. 100 % de réussite au bac chaque année. Un cérémonial de rentrée à coup de discours bien rodés, de place méritée dans cette institution, obtenue grâce à un travail et à des efforts exceptionnels. La rage.
Tu changes de station. On se laisse un peu porter par la musique, puis tu précises c’est reposant, auprès de toi, de ne pas avoir à me mettre en scène. Presque aussitôt, comme pour effacer cette soudaine confession, tu poses une question censée nous éloigner de nous. Tu veux connaître le titre du morceau qui passe, est-ce que je peux shazamer ?
Je me sens mal, c’est en anglais.
– Je… Mon accent est vraiment mauvais.
Tu dis :
– C’est normal, tu ne peux pas avoir l’accent sans avoir fait d’immersion.
Ensuite, d’une manière presque comptable, tu chiffreras tout. Ton salaire, ton héritage, ton parcours scolaire, tes séjours linguistiques. Tu ne nieras jamais tes privilèges.
Et, parce que tu m’autorises à te détester, l’inverse prend peu à peu forme dans ma poitrine.
– C’est une très grande maison. En fait il y a deux maisons, un loft de construction moderne et un mas provençal d’origine. Le loft est plutôt le terrain de jeu de ma mère, le corps de ferme est à moi. Durant l’année, il est souvent occupé par ma tante ou par des ami·es. Les deux espaces sont connectés par une cuisine d’été, un studio de danse et une salle de cinéma, qui sont les passions respectives de ma mère et de sa sœur.
Tu m’expliques que chacun des deux espaces sur parquet peut accueillir une centaine de personnes. Ils sont modulables et sont régulièrement mis à disposition des associations locales, pour des projections, des spectacles. Votre famille a toujours tenu à faire vivre le tissu culturel d’Ispagnac.
Tu poursuis :
– Sur la scène du studio de danse, il y a des rideaux de théâtre d’époque, tu vas adorer. Et des accroches qu’on pourrait utiliser pour faire du shibari. En extérieur, on a aussi un four à pain, un petit champ et une tiny-house aménagée dans la forêt. Les ami·es qui veulent un peu plus d’indépendance peuvent dormir là.
– Mais ça s’étend sur plusieurs hectares ou quoi ?
– Heu. Oui.
En pilote automatique, tu retraces : ton père a été diplomate, votre famille était alors installée en Argentine. Une voiture trafiquée durant la dictature militaire, un accident qui a été assez médiatisé à l’époque : lui et son chauffeur meurent brûlés vifs dans le véhicule. Ta mère, enceinte de toi et de ton frère jumeau, perd les eaux quelques semaines après l’enterrement. Au moment de l’accouchement, tu es le seul des deux nourrissons dont le cœur bat. Tes jeunes années sont bordées par des cours particuliers et les soins d’une nourrice. Ça a longtemps été la confusion entre ta mère, le précepteur et la fille au pair. Pour toi alors tout ça était de l’amour, tu n’avais pas conscience des hiérarchies et des enjeux transactionnels. Lors de ton entrée au CP, vous déménagez au Danemark, où ta mère enseigne désormais à la faculté de médecine de l’université de Copenhague. Elle reprend ton éducation en mains. Avec l’assurance-vie qui lui est revenue, elle achète cet immense lieu dans les Cévennes. Vous y venez toutes les vacances, à partir de tes 8 ans. Tu y retrouves tes cousines et ta tante, qui a désormais épousé ton ancien précepteur. Parce que tu es un ado turbulent et qu’elle en a régulièrement marre de toi, ta mère t’envoie en voyage linguistique en Australie. Là-bas, tu alternes les sessions de surf et de qi gong sur la plage. Tu gravites dans une atmosphère New Age, encadré par des monitrices lesbiennes qui te laissent beaucoup d’autonomie. Tu expérimentes tes tout premiers usages de drogue. À 17 ans, tu parles quatre langues et tu pratiques le foot à un haut niveau. Tu penses que tu es hétéro mais tu regardes beaucoup le milieu de terrain. Tu obtiens ton bac avec un an d’avance et une mention très bien. Tu pars vivre à Paris, où tu intègres une grande école.
Tu n’as jamais fait de petit boulot, excepté un été après ton année de césure : tu as été serveur dans un camping gay en Espagne.
Je dis :
– Waouh, j’ai fait un paquet de petits boulots mais serveur jamais, je manque trop de coordination.
Tu dis :
– Pareil, j’étais nul, j’ai menti pour avoir le poste et avec mon anxiété sociale ça a été un enfer.
C’est très reposant, Ispagnac. Même si tu sais que ça va t’imposer quelques responsabilités en termes d’entretien, au moment de l’héritage. Enfin, surtout des choses techniques. En arrivant, tu déposes nos bagages dans ta chambre. Elle est un peu en retrait des autres espaces de vie et directement reliée à la salle de danse. Tu proposes d’aller jusqu’à la rivière pour délier nos corps après toutes ces heures de conduite. Cette marche du soir a toujours été pour toi une ponctuation dans tes journées de vacances.
Malgré l’heure, des particules de poussière brûlantes s’accrochent à nos mollets. Ma nuque est irritée par le soleil, j’ai un peu le vertige mais tu es très excité à l’idée de me montrer ton point de vue préféré. L’ascension est assez rude, je n’ai pas l’habitude de la montagne.
Tu me retiens par la taille, nous sommes au bord. Sous nos pieds, il y a le vide, puis le fleuve. En face, l’or de la falaise. Je suis un peu bête de t’emmener si haut alors que tu as le vertige. Tes mains m’éloignent du précipice, mes jambes tremblent mais je dis ça va. Je te suis difficilement jusqu’au spot de baignade. Toi, tu connais par cœur chaque rocher, chaque passage escarpé, tu arrives rapidement à destination. Tu sautes à l’endroit le plus profond. Une fois dans l’eau, comme il n’y a que nous, tu retires ton slip de bain. Gauchement, je t’imite. Sur la rive, je me déshabille, je plie mes sous-vêtements, mon t-shirt et mon short, je les dépose auprès de ta robe. J’ai peur de ton regard que je n’ose pas soutenir, mais dont je sens le poids sur ma peau. Il y a tant de gays qui désapprouvent les corps trans.
De ton index, tu soulèves mon menton. Nos regards se soutiennent et ton désir, immense, s’écroule sur moi.
Il n’y a que ce centimètre carré de chair qui nous retient : la pulpe de ton index en contact avec mon menton.
Puis je sens la caresse de ta main sur mon épaule. Elle explore ma peau, glisse vers ce creux très sensible, à l’intérieur de mon bras. Je voudrais te toucher mais mes membres sont de plomb. Toi, tes doigts m’effleurent avec une tendresse qui me bouleverse. Connaissant tes obsessions, je ne t’imaginais pas si doux.
Tu descends lentement vers mon ventre et j’essaie de contrôler ma respiration, de sortir de moi, mais je me sens traqué. Je suis soudain terrifié par la vision précise de la boue dans mes entrailles. J’ai le réflexe de ne surtout pas te salir, pas toi, alors je glisse sous l’eau.
Je m’éloigne en quelques brasses saccadées. Je nage mais intérieurement je perds pieds, mon pouls devient acéré, il grésille, il larsen, j’en entends le battement jusque dans ma gorge.
L’enfant préféré
Lui, il ne parlait qu’avec Samaëlle, tout le reste l’ennuyait. Ses voisins mais surtout l’Autre, sa femme incapable, vide et empotée, constamment à côté de la plaque. Le genre de femme à dire toutes mes félicitations lors d’un enterrement ou à applaudir bêtement en entendant La Marseillaise.
Samaëlle comprenait. Enfant, dans des travaux d’homme elle s’en sortait. Elle ne minaudait pas. À sept ans, elle pouvait manœuvrer seule des outils de précision, scier du bois, bêcher le jardin.
Dans les magasins, elle se tenait raide. Il ne fallait pas trébucher, se cogner contre un caddie, changer l’ordre des choses. Elle se fondait dans le rythme qu’il impulsait, elle était tout le temps prête à mettre dans le panier ce qu’il lui dictait.
Elle devançait même ses paroles. Sa pensée était vive et elle savait, en tout temps, rester à la droite du père.
À la maison non plus, elle ne se trompait pas. Quand elle mettait la table, les couverts étaient au bon endroit, géométriquement disposés. La salade était assaisonnée dans l’ordre correct, le bouillon de légume était agité dans le bon sens.
Uniquement quand elle provoquait en faisant semblant d’oublier ou en se rebellant stérilement comme sa mère.
Elle avait voulu porter les cheveux courts, écouter ces musiques américaines qui passaient à la radio, aller danser le soir. Mais il avait su la recadrer et elle avait compris. Il était hors de question qu’il la laisse être absorbée par la futilité de sa mère.
Quand Ulysse était né, et comme il n’y avait que deux chambres, la mère avait occupé celle de Samaëlle avec le bébé. C’était plus pratique pour le cododo et l’allaitement.
Samaëlle avait donc dû dormir dans le lit conjugal jusqu’à ce que son petit frère fasse ses nuits. La mère lui en avait voulu, elle s’était sentie dégradée. Cette pute prenait toujours sa place.
Si un spasme secouait son corps et qu’elle interrompait le sommeil du père, il l’enfonçait sous les draps, plaquait sa main sur son ventre nu et lui intimait l’ordre d’être docile. Tu vas te soumettre. Cela pouvait se prolonger. Si elle se débattait, il l’étouffait avec un oreiller, la main plus fermement présente sur son ventre. Il ne la libérait qu’au moment où elle était parfaitement immobile.
Se toucher
Le premier matin, tu me demandes :
– Est-ce que je peux faire quelque chose pour que tu te sentes à l’aise ?
– J’aimerais bien que tu me fasses visiter.
Tu réalises que tu n’as même pas pris le temps pour cela, que tu manques à tes devoirs d’hôte mais viens, on va faire le tour.
L’odeur de la maison de ta mère — la maison d’architecte où je dors, à la structure aérienne et aux baies vitrées interminables — c’est un parquet imprégné de cire, un arôme de café frais et de pain grillé, le parfum des draps de lin que l’on plie après qu’ils se sont gorgés de soleil. Du savon artisanal et des balcons fleuris.
L’odeur de l’autre maison — la vieille maison robuste à la silhouette de corps de ferme — c’est ce léger arôme de tourbe en note de tête, le fumet d’un âtre pour le cœur, l’essence boisée des poutres ancestrales en note de fond. Une vague sensation de naphtaline et de poussière dans les piles de couvertures qui attendent sagement l’hiver, le plastique des boîtes hermétiques pour conserver les denrées durant les longues absences des résident·es. Une fragrance rustique, idéale pour les réminiscences. Cette affiche sur la porte de la chambre, je l’ai tout le temps connue. Ça représente un spectacle de Ushio Amagatsu, que j’ai vu avec ma mère à Copenhague quand j’avais six ans. Ce n’était pas très adapté à mon âge, ça me terrifiait quand j’étais enfant. Dans un renfoncement, tu me fais découvrir l’escalier en colimaçon qui mène à un grenier sous les toits. Dans la famille, on s’est tout le temps imaginé que le maçon était amoureux quand il l’a fabriqué. Regarde, sous cette marche il a gravé des fleurs et un cœur.
Cette chambre et ce grenier te renvoient aux étés de tes jeunes années. Tu pourrais presque entendre les rires de tes cousines, leurs gloussements quand elles se cachaient pour te faire une farce. Tu dis. C’est sensoriel, tu vois ?
Je vois très bien. Mais j’ai peur de tes questions retour si je réponds oui. Questions que tu ne poses pourtant jamais : la discipline à laquelle je m’astreins pour ne pas allumer d’étincelles de curiosité a l’air de fonctionner.
Je m’aventure dans la pièce.
– C’est émouvant ce petit lit où tu as dormi.
Tu ris. Tu ne sais pas comment tu y tenais, mais tu l’as conservé jusqu’à l’année de ton bac.
Pour finir, tu veux me montrer un lieu secret dont tu ne m’as pas encore parlé : une cabane suspendue, cachée par les arbres dans le fond du jardin. Entre les planches des murs, des raies de lumière apportent une douceur particulière à cette cachette régressive. Au sol, il y a quelques Club des cinq.
Un poster au glacis légèrement gondolé est punaisé près de la fenêtre, une ruche géante y est dessinée au milieu du bourg d’Ispagnac. Au premier plan, une abeille stylisée arbore une médaille. Voilà un point majeur que j’ai failli oublier d’évoquer. La fête du village…
Tu trouves que les abeilles sont quand même très sexualisées par le dessinateur, c’est gênant ce machisme latent en milieu rural.Cette année, le concours du meilleur apiculteur et le bal du village auront malheureusement lieu après ton départ. On rigole de ce drame : je vais louper le point d’orgue de l’été. Elle ne va pas disparaître, tu pourras y aller l’été prochain. Tu finiras par en avoir marre du miel des Cévennes !
J’avais imaginé visiter les villages alentour et partir en randonnée avec toi, mais tu as fait un énorme stock de provisions et nous ne sortons pas. J’en prends mon parti : ça me va de rester dans l’exacte nuance des lumières qui t’ont vu grandir et de me blottir dans les sons du parc arboré qui entoure le domaine. Au crépuscule, on entend le hululement d’une chouette, le bourdonnement entêtant des insectes, un aboiement lointain. La nuit tombe et l’air se tiédi, amplifiant le karaoké d’un camping municipal. Des bribes nous parviennent. Every breath you take / and every move you make / Every bond you break / Every step you take / I’ll be watching you
Progressivement, la maison de ta mère se peuple. La plupart de tes invité·es sont des habitué·es. Tes collègues et ami·es me questionnent en aparté. Ce serait envisageable que tu décales ta visio Pôle emploi pour que l’on partage ce temps de cuisine ensemble autour du four à pain ?
Le four à pain, c’est un des grands classiques de vos étés à Ispagnac. Vous amenez des tables à tréteaux en bordure du champ et vous passez l’après-midi à cuisiner en extérieur. Quand le feu est presque éteint, vous finissez en y laissant caraméliser un grand plat d’abricots aromatisés à la lavande fraîchement coupée. Ce serait dommage que je rate cela.
Non, je suis désolé, on ne peut pas aisément décaler un rendezvous avec son conseiller. Surtout quand on jongle, comme moi, entre les CDD et les études. Mon financement c’est vraiment de la dentelle administrative. Je pourrais même être considéré en fraude pour avoir passé plus de trois jours dans une région qui n’est pas la mienne. Ha, c’est ennuyeux. Mais ça veut dire que tes études sont payées grâce à nos impôts, c’est cool !
Vous, vous avez réussi à décaler certaines de vos obligations pour pouvoir être ici. Le monde universitaire est tellement atroce, violent, que parfois vous vous autorisez cela. Il faut savoir que les allers-retours quotidiens Paris-Amiens ne sont pas pris en charge par l’Université de Picardie.
Je prétexte un mal de crâne pour ne pas me joindre à l’excursion que vous préparez au marché artisanal de Mende. Tu as aussi manifesté ton envie de rester à la maison.
Maintenant nous sommes allongés, chacun d’un côté du canapé. Tes jambes nues effleurent les miennes, je sens les poils de tes tibias contre ma peau. Lors de notre sortie de table j’ai grapillé chaque millimètre entre nous pour en arriver à cette étape.
La fenêtre est ouverte, une fine brise fait claquer la porte de la bibliothèque. Si je bouge, l’instant parfait se dissipe pour toujours. Alors je reste là, avec ce claquement régulier de la porte, avec ma vessie dilatée de trop de pastèques et de melon. Avec la chaleur moite. Le supplice de ces poils peut-être involontairement entremêlés aux miens.
Tu te lèves, agacé par le bruit. Tu restes un instant debout, dos à moi, une main appuyant fortement contre la porte pour dompter son mécanisme.
Patrimoine queer
Je n’ose plus venir près de toi dans la bibliothèque. Je monte rapidement l’escalier jusqu’à ma chambre, tes ami·es sont couché·es à tes côtés, indolent·es et presque nu·es. Vos peaux se touchent et tu es charnel, démonstratif. J’entends des bribes de conversation sur une poétesse danoise.
Moi, je reçois de la retenue polie. Je suis de ces individus sans grâce sur les pistes de danse : invisible.
Je te montre la synthèse des questionnaires que j’ai fait passer à plusieurs catégories de personnes, dans le cadre de mon mémoire : des victimes, des professionnel·les, des dirigeants politiques soucieux de protection de l’enfance. Les questions portent sur une sélection d’affiches de sensibilisation aux violences sexuelles sur enfants.
– Une campagne de communication grand public a comme slogan « Les victimes d’inceste perdent 20 ans d’espérance de vie », ça m’a servi de point de départ. Parce que les violeurs s’en fichent qu’on meurt vingt ans plus vite alors que nous, avec ce chiffre en tête, on se repose jamais. À chaque fois que je tombais sur cette formule choc, je me demandais pourquoi elle n’avait pas été réservée à la presse spécialisée ou aux cours de médecine ? D’un côté, c’est cool que les effets du stress et du cortisol soient enfin inclus dans les conséquences sur la santé. Mais est-ce que cela permet une évolution des pratiques médicales vers une prise en soin holistique ? Les réponses montrent que les représentations du monde associatif et des institutionnels entrent en friction avec le ressenti des victimes. Il y a peu d’appétence à se former chez les pros. Du côté des hommes politiques, il n’y a pas de mesures pour proposer un parcours de soin global remboursé mais la volonté de « mettre en lumière la réalité de l’inceste ». Côté victimes, j’ai un commentaire qui dit : « On ne meurt pas poignardé à cause d’un couteau, mais à cause de la personne qui le tenait. On ne perd pas vingt ans d’espérance de vie à cause de l’inceste, mais à cause de nos incesteurs, de l’addition des mauvais traitements parentaux, de la lâcheté des médecins, du silence gêné des enseignants, de l’absence de relance de nos amants quand on parle, des psys qui posent des questions déplacées. »
Dans le prolongement du travail que j’ai effectué sur les slogans, tu as imprimé une décennie de campagnes institutionnelles consacrées à la prévention des violences intrafamiliales. Je sélectionne avec toi celles dont les formules sont en adresse directe aux enfants.
On analyse les insuffisances et les contradictions des injonctions à libérer la parole des victimes en misant sur leurs capacités de self-défense, alors que le rapport de force est si déséquilibré.
– Selon les dernières données probantes, 8% des enfants victimes d’inceste bénéficient d’un accompagnement à la hauteur. Que fait-on pour les 92% restants ? Et pour tous ceux, toutes celles qui ont compris que parler empirera encore leur réalité ? Il faudrait des campagnes de santé publique qui pointent explicitement les agresseurs et les témoins passifs.
Tu m’interroges sur mon quotidien à la MECS. Je te décris la matérialité des sons. Les corps disciplinés par les horaires. Le déchirement entre le calme impossible des lieux d’accueil collectif et le silence imposé. Le casque anti-bruit qui soulage de la promiscuité, mais isole.
– Les ados que j’encadre évoluent entre vacarme et silenciation. Ce n’est pas un hasard si un nombre considérable d’entre elleux souffre d’acouphènes. C’est comme s’il n’y avait jamais le bon réglage pour permettre la parole. « L’innommable », la « honte de dire », ce sont des formules médiatiques bien pratiques quand les mots sont annihilés par celleux qui sont censé·es être les adultes de référence. Les adultes de confiance. Alors se taire, c’est surtout un abri contre la déception. Un moyen d’éviter un trauma de plus.
Tu m’écoutes sauter d’une intuition à l’autre en prenant des notes, puis tu imbriques mes pensées fragmentées dans une logique sans interstice. Tu m’invites à poursuivre.
– Tu as dû voir qu’il y a de plus en plus d’expert·es qui parlent des victimes d’inceste en utilisant le champ lexical du virus qui se propage, de l’infection à guérir. Je trouve cette métaphore nauséabonde : on en revient au vieux truc de la souillure. Permettre aux personnes victimes d’avoir accès à une prise en soin de leurs traumas, c’est essentiel. Mais pas tenter de les redresser de force dans une direction, vers des trucs prétendument sains comme une sexualité normale, des sensations bien régulées, des modèles relationnels bien classiques. Aider ces personnes, ce serait ne pas les enfermer dans un déterminisme mortifère. Ce serait leur donner du pouvoir et les laisser décider de ce qui est bénéfique pour elles.
Une nouvelle fois, tu renvoies chacune de mes approximations à un faisceau de références scientifiques. Tu soulignes la vulnérabilité spécifique qui concerne les enfants à l’intersection de différentes oppressions. Penser avec toi me fait me sentir à un endroit essentiel. Jamais je n’ai eu de conversation plus précise, intense et incisive sur ce sujet.
Tu dis qu’il faut envisager un article scientifique. Que si on ne publie pas les premiers, le risque est qu’on reprenne nos travaux sans nous citer. Tu penses que ça pourrait alimenter un chapitre de ton HDR, tout en me permettant d’avoir un début de CV académique. Tu poses des questions auxquelles je suis absolument incapable de répondre est-ce que tu te sentirais prêt à m’accompagner à Bruxelles pour présenter conjointement cette recherche ? Est-ce que tu serais à l’aise dans un colloque à dimension internationale ? Est-ce que ça te fait envie ?
Après ces cinq heures de travail acharné, je finis par abdiquer, presque effrayé : toi, tu es une machine de guerre, tu pourrais continuer de rédiger indéfiniment.
Quand je sors de ton bureau, il y a encore plus de monde dans la maison de ta mère. Et ce néo-aristocrate, Jean-Eude, que vous appelez Eddy. Vous l’admirez car il a choisi de ne pas se corrompre dans un parcours d’enseignant-chercheur. Il préfère faire de la recherche en indépendant. Il privilégie le soin qu’il accorde à ses proches, quitte à être au RSA après un doctorat. Vous louez son courage et son parcours de vie exemplaire.
C’est marrant parce que Jean-Eude, j’ai déjà eu affaire à lui, une fois. Lors d’un gala caritatif, on avait passé un certain temps à échanger sur la playlist de jazz, pas assez aiguisée selon lui. Ensuite, il avait essayé de me soutirer des infos sur Myriam, à l’époque où elle était bénévole dans une structure d’accueil pour sans-abris. Eddy ne se souvient pas, il n’a pas ma mémoire photographique. Puis j’ai ce côté discret et sincère qui inspire la confidence. Les gens s’adressent à moi comme on se raconte à un passager de notre rang lors d’un vol long-courrier. Anonymement et sans que ça porte à conséquence. Plus tard ce soir-là, il avait discrètement dragué Myriam, sans succès. Et depuis qu’il veut l’inviter chez lui, il fait des dons mensuels de 200 euros à son asso. Un versement littéralement impossible quand on vit du RSA.
Mais vous le savez, puisque vous êtes tou·tes régulièrement allé·es dans sa famille. D’ailleurs, ça y est, vous faites mention de ses parents. Des avocats d’affaires, des gens charmants, distingués, qui t’ont invité dans le Parc naturel du Vexin il y a quelques années. Tu te souviens avec malice de ce weekend prolongé dans un petit village où iels ont l’une de leurs résidences secondaires. C’est peuplé de personnes disons « straights » et un peu « beaufs », le Vexin. Nous, on s’était amusé·es à réinventer l’histoire locale en l’imaginant comme un haut lieu des luttes queers depuis le Moyen Âge. On avait créé une fiction très précise où le village actuel était bâti sur l’héritage de ces luttes. Après, durant tout le weekend on imaginait le patron du café, la boulangère, la factrice comme des pédés et des goudous placards. On a énormément ri.
Ce qui me fait rire, moi, c’est qu’on est allés ensemble à la reprise du spectacle d’Étienne en juin, au moment de la Pride. Un spectacle sur les émeutes de Stonewall, qui t’a bien bouleversé et qui n’avait pas spécialement la haute bourgeoisie comme toile de fond. Mais nous sommes des êtres évolutifs, pétris de contradictions et de moi sociaux changeants. Ça doit expliquer.
Plus tard, tu veux me faire changer d’avis sur Eddy et tu me parles de la Conviviale, cette mutuelle queer qu’il t’a fait rejoindre par cooptation. Tu dis quand même au fond l’argent c’est de la merde. On est obligé·es de composer avec, alors qu’on n’aime pas ça et que ça peut être un sujet gênant. Et comme toi, tu en as beaucoup, cet espace te permet de le partager avec d’autres personnes de la communauté, moins privilégiées.
Tu m’expliques que ces moments de redistribution sont très ritualisés, avec une matérialité des billets, une enveloppe dans laquelle les liasses sont déposées, plusieurs tours de table pour que chacun·e puisse se servir, exprimer ses besoins et ses ressentis. Durant ces réunions mensuelles, les personnes pauvres peuvent demander à avoir un temps en non-mixité pour échanger sur leurs affects.
Tu précises que ce n’est pas qu’une question de revenus, plus généralement de patrimoine à partager de manière affinitaire, en dehors des liens biologiques et de la descendance. Que c’est particulièrement important dans le contexte actuel. Que ça t’a permis de te faire des ami·es. Lors de ton déménagement par exemple, une grande partie des membres du collectif se sont organisé·es pour venir.
Tu admets qu’au fil des années, il n’y a pas eu d’évolution dans la dynamique de solidarité : les gens dépendent de toi et de Jean-Eude. Mais ce serait faire l’impasse sur d’autres types de soutien, qui dépassent le rapport financier.
Tu n’as pas l’air de saisir le déséquilibre de charge mentale et de redevabilité. Je te demande le jour où tu quitteras la Conviviale, comment se redessineront ces solidarités ?
J’essaie de partager avec toi mon ressenti : dans le flou de vos mises à disposition d’espaces, dans les plis de vos générosités, il y a de l’implicite. La sensation de ne pas pouvoir rendre la pareille, d’être de ces personnes qui viennent à vous et s’adaptent à vos modes de vie, ça a un coût.
Ta qualité d’écoute est aléatoire, tu t’agites un peu. D’ordinaire, c’est toi qui décides des moments où les gens s’assoient au salon pour partager des discussions intimes.
– Pourquoi tu n’as pas payé de vrais déménageurs si tu as tant d’argent ? Le deal serait plus franc et tu aurais pu leur permettre de cotiser, d’obtenir une couverture santé…
Au ton de voix que tu emploies quand tu me coupes la parole, sec, autoritaire, je découvre un masque social que tu t’étais bien gardé de me montrer jusqu’à présent. Tu te reprends, tu t’adoucis.
– Pourquoi je n’emploie pas des déménageurs, oui. Je ne vois pas ce que je peux rajouter à cela : c’est toi qui as raison.
C’est moi qui ai raison mais le ton est celui d’un politicien haut placé répliquant à un lycéen qui brandirait des slogans altermondialistes, oui, c’est toi qui as raison, il faudrait arrêter le nucléaire, oui. J’imagine que j’ai mal compris un truc. Tu penses que c’est toi qui m’as mal expliqué. C’est ancré dans des dynamiques anarchistes, vous enregistrez des podcasts pour garder trace de cette expérience. Tu m’enverras les liens.
J’ai un peu honte d’avoir émis une critique avant d’avoir tous les paramètres en tête. Je m’excuse. Je t’explique qu’en théorie je suis d’accord, l’argent c’est de la merde, mais que c’est pas si simple. Que mes premiers salaires ont été un vrai levier d’émancipation. Que j’ai pu entamer une thérapie. Que j’économise dans l’espoir de pouvoir faire un jour un prêt immobilier. Mettre mon frère à l’abri s’il m’arrivait quelque chose. Que j’ai pas de filets de protection et que du coup je me suis laissé emporter par mes émotions, j’en suis désolé.
Je déteste me froisser avec toi comme ça, parce que vraiment je t’adore.
Tu dis :
– Pas de souci. Dans la mesure où tu m’as expliqué les raisons de ton point de vue.
Une de tes amies de longue date arrive enfin, la route a été compliquée depuis chez ses parents, en Ariège. Tout en aidant à dresser la table, elle nous confie la souffrance qu’elle éprouve dans son labo de recherche. C’est lié à la difficulté de rassembler des signatures autour d’une pétition qu’elle a rédigée les féministes ne s’opposent pas à ce que les idées de la Manif pour Tous entrent à l’université. Elles sont quasi toutes absentes du débat.
Je comprends pas. Elle m’explique avec un sourire. Parmi les personnes issues de la société civile, il y en a qui militent, effectivement. Mais où sont celles qui pourraient faire avancer le débat intellectuel ? Développer des savoirs pour que les étudiant·es construisent leur culture politique ? Où sont les universitaires ?
Elle ramène avec elle William, son partenaire depuis peu. Elle lui fait l’état des lieux, en surarticulant les explications sur l’endroit où se trouvent le balai, l’éponge, le café, et en précisant fort qu’il aura droit au tarif précaire. William croit qu’il n’est pas pauvre parce qu’il ne paie pas de loyer. Je lui rappelle souvent que si, bien sûr qu’il est pauvre.
Je ne sais pas précisément à qui elle s’adresse quand elle parle ainsi de lui à la troisième personne. Aux autres convives ? À un amphi symbolique ?
William, il reste campé près d’elle, avec sa carrure trapue, son t-shirt Célio, son look de rockeur écorché et totalement cancel. Il tente un jeu de mots pour contrer l’embarras.
C’était prévisible : le jeu de mots ne s’ancre pas dans la culture légitime et fait un magnifique flop. Je suis le seul à avoir la réf et j’ai même plus l’énergie d’être solidaire. Un ange passe.
J’entends ton amie s’adresser à d’autres universitaires pour évoquer le travail qu’elle mène avec Joël, sur son regard dramaturgique autour de la marionnette. Je suis trop attentif alors que je n’ai pas été inclus dans cette discussion. Elle précise, en se tournant vers moi, Joël Pommerat, un metteur en scène.
Pendant ce temps, William essaie encore. Il s’accroche à l’envie de faire famille, cette promesse qui flotte dans l’air. Il sort des paquets de son sac, il propose des alcools clinquants, dénotant avec les mets du terroir qui abondent du garde-manger et du cellier.
Les bouteilles de William ressemblent à ces cadeaux de Noël achetés à Action, emballés dans des boîtes en plastique immenses mais totalement cache-misère. Les remerciements sont appuyés. Personne n’y touche.
Tu dis. Si vous voulez du vin, vous pouvez aller voir dans la cave.En dehors de quelques bouteilles millésimées qui ne sont pas à moi, servez-vous à votre guise. Oui, en fait c’est du vin que les gens veulent : un accord à la fois noble et rustique pour se marier avec le gratin de légumes.
Autour de moi, des groupes se sont formés. Des parois invisibles isolent mon corps, je me sens dépareillé, ça me rappelle la constitution des équipes de sport, au collège. Par réflexe, je consulte mon téléphone. J’écoute un énième message du père, alors que je m’étais promis de ne plus faire ça. Je suis seul ici ! Vous m’avez laissé seul ! Je suis en train de crever comme un rat dans son trou ! Quand vous êtes partis, vous avez même pris Misère ! MON CHAAAT ! Il hurle et éclate en sanglots, avec ce déchirement pathétique qui sait très bien me saisir aux tripes, me peser sur les épaules et accentuer mon mal de dos.
Myriam aussi a tenté de me téléphoner. Je ne me sens pas capable de la rappeler : ça pourrait la mettre en vrac de me savoir en vacances au même endroit qu’Eddy. J’ai l’impression d’avoir été catapulté dans une série Netflix scénarisée par Bourdieu. Mon rôle y est tout pourri : il consiste à trahir les personnes qui me sont les plus chères.
Finalement, c’est Aya que j’appelle. Je craque, je balance tout. Cette maison de famille gorgée de luxe et de souvenirs, avec un hôte qui déroule un discours touristique de l’intime. Me retrouver entouré d’anciens urbains retournés à la terre, des CSP+ passionnés par le fait d’éplucher des légumes hors de prix ensemble, dans une cuisine hors de prix, sur une terre colonisée par les résidences secondaires. En larmes, mordre mon oreiller dans la lourdeur d’une nuit caniculaire, seul dans ma chambre. Les entendre rire sur la terrasse parce qu’iels ont pris des prods. Les voir alimenter leurs profils Tinder de nouvelles photos pour aller baiser avec les locaux, loin du périmètre de leur réputation sociale.
Elle me demande où je suis.
– Dans les Cévennes.
– Dans quel bled dans les Cévennes ?
Elle dit attends j’ouvre mon ordi. Elle est vraiment remontée et la puissance dans sa voix me régénère. Elle a trouvé une station de taxi subventionnée, à moins de 20 km d’Ispagnac. On peut réserver pour le jour-même. Elle me donne le numéro de téléphone. Elle insiste.
– Barre-toi Samaël, ces gens ne te méritent pas, ça n’a rien à voir avec leur niveau d’études. Si tu voulais une thèse, tu obtiendrais une thèse, t’as rien à leur prouver. Barre-toi et tiens-moi au courant. Je t’embrasse mon chou.
Je me souviens m’être dit le taxi, quand même, c’est pas un peu too much ? J’ai hésité. Pendant que vous évoquez le cas d’un collègue indigne qui couche avec une étudiante, je ramasse la vaisselle. Je cherche à faire quelque chose d’utile pour me donner une contenance. Je pense. Je ne suis même pas capable d’être un William, même pas capable d’être un plan.
Tu me rejoins dans la cuisine alors que je me distrais en triant les déchets. Je reconnais ton pas sur le parquet sans avoir à me retourner.
On se retrouve à vider des fonds de verre dans l’évier, on se sourit vaguement. Tu te racles la gorge. Est-ce que ça va ? On aurait dû évoquer la question de l’argent, enfin, j’aurais dû l’évoquer. On a un système assez rodé de répartition des frais avec les habitué·es, mais toi tu es mon invité… Tout en me donnant une petite pichenette sur le bras, tu conclues c’est une telle chance de t’avoir ici avec nous. Je ne vais pas en plus te faire payer.
Je suis injuste : tu ne manques pas d’empathie, juste d’expérience. On est condamnés à ne pas parler la même langue.
Même les conversations intellectuelles ne sont plus d’actualité. C’est une de tes collaboratrices et non toi qui m’informe : grâce à mes retours sur votre futur essai, vous en avez changé le titre. Ce sera plus explicite, plus grand public.
Je t’entends te jeter à bâtons rompus dans des débats politiques auxquels tu ne m’associes pas. Mon avis te semblait essentiel il y a encore quelques jours.
Lorsque tu répliques pour clouer au sol ton contradicteur, ce sont mes arguments que tu avances. Mais tes mots les rendent tellement plus convaincants que lorsque je les ai timidement faits naître dans ta voiture. Tu avais alors souligné, presque déçu, pourquoi tu t’excuses ? C’est tout à fait ça ! Elle est parfaite ta formule !
Je me surprends à ressentir une excitation malaisante face à ce côté martial en toi. Je croyais avoir trop trituré les codes pour me faire avoir, mais si. Ta voix est autoritaire et j’ai les mains moites. Que tu portes du vernis à ongles et un débardeur en mailles fluo n’y change rien. Quand tu es dans ton monde, tu fais preuve d’une puissance virile que j’avais totalement occultée jusque-là.
Dans ton monde, je suis un corps gênant avec lequel tu es obligé de prendre des pincettes et de composer. Je vois comme je t’ennuie, comme ton regard est insondable quand il croise le mien. J’ai échoué à te rencontrer. Ce constat me désempare.
Dans le taxi, la musique est forte, de la variété, un petit côté bal des pompiers. Je peux garder mes lunettes de soleil et m’enfermer dans mon mutisme.
À côté de moi, un sac avec des trucs à manger et à boire que tu m’as préparé à la hâte pour mon trajet retour.
Diogène le père
Je savais que ma psy avait raison quand elle me rappelait que je ne pouvais pas attendre la mort de mon géniteur pour prendre des décisions. Pourtant, en recevant l’appel de la directrice de la maison de retraite, j’ai cru qu’il m’avait simplifié les choses.
Il a reproduit dans sa chambre les empilements de pots de yaourts, de cartons d’emballage découpés, de boîtes de conserve dans lesquelles il consigne des cailloux, des galles de chêne, des trèfles séchés, des bogues de châtaignes. L’aide-soignante se donne beaucoup de mal pour faire sa toilette, trouver des stratagèmes pour sortir ses poubelles. Il souffre. Souvent, il hurle.
Je lui suggère d’en parler avec l’assistante sociale qui gère le dossier. Visiblement elle a zappé quelques paramètres.
Elle s’excuse.
– Vous lui manquez énormément vous savez, il ne parle que de vous. Il a tapissé les murs de photos de ses enfants. Il refuse les lettres recommandées de la mairie. Sa retraite ne suffira pas pour payer un double loyer, il faut vraiment rendre la maison.
Il dit que vous devez revenir y vivre, que ce sont ces murs qui vous ont vu grandir, que c’est là-bas chez vous. Il s’inquiète pour les rouges-gorges et les mésanges charbonnières. Il dit qu’il vous a fait parvenir les clés, que vous devez aller mettre des graines dans les mangeoires du jardin. Qu’il faut faire de cet endroit un sanctuaire pour les oiseaux.
– Ce n’est pas MA maison. Je n’ai absolument rien à voir avec tout ça. Il y a un jugement qui a été prononcé quand même.
Voilà, on parle de mon géniteur et je m’emporte, il n’y a pas de situation qui me mette à ce point hors de moi. Je m’excuse à mon tour.
– Je vous remercie de m’avoir prévenu, je vais m’en occuper. Mais je ne veux aucune interaction avec lui.
Elle m’explique qu’elle imagine bien, qu’elle aurait souhaité une autre solution mais qu’il s’oppose catégoriquement à ce que le CCAS prenne les choses en main pour vider la maison qui est quand même extrêmement encombrée. Un adjoint est venu mais votre papa a bloqué la porte de sa chambre avec sa canne. Il est opposé à tout dialogue, sauf si vous acceptez d’être le médiateur.
Elle prévient qu’il a fait préparer des caisses à mon nom. Que le cuisinier de la maison de retraite a bien voulu aller les déposer. Elles ont été mises sur la table de la cuisine, si sa mémoire est bonne. Il s’agit essentiellement de carnets personnels et de magazines satiriques sur le jardinage.
– La Décroissance ?
– Oui, oui, tout à fait, La Décroissance ! Il a deux abonnements. Il garde toujours un exemplaire vierge pour lui et en annote un second pour vous. Il a ses petites habitudes. C’est le seul courrier qu’il accepte de sortir de sa boîte aux lettres.
J’ai presque envie de rire.
On convient d’une date. Elle accepte de faire le suivi avec la mairie, elle raccroche dans un mélange d’encouragements et de formules de politesse qui ont l’air sincères.
Suite à cet appel, j’ai comme un brouillard étrange dans la poitrine, une météo capricieuse dans le corps. J’ai conscience que des éléments hétérogènes se déchaînent en moi. Le souvenir de notre nudité dans la rivière, bien plus vaste que celle de nos peaux, contribue à cet événement climatique hors norme. Je me suis magnétisé et désorienté à ton contact. On dirait l’instant étourdissant après une explosion.
Vider les lieux
Après l’auto-école à l’abandon et la zone commerciale, il faut tourner à droite. En quelques kilomètres, les maisons aux briques rouge vif et aux jardins coquets laissent place aux panneaux publicitaires, puis aux clôtures métalliques et aux peupliers épars qui longent la départementale.
Ce trajet en voiture, la réservation d’hôtel Formule 1 et l’échange de mails administratifs pourraient me donner l’illusion d’être dans l’une de mes missions professionnelles, mais il n’en est rien. J’arrive dans une rue étroite, bordée de longues barres de façades ternes : l’adresse où j’ai passé les 17 premières années de ma vie.
La clé est posée dans le vide poche du véhicule de location, c’est celle que j’ai utilisée pendant toute mon enfance. Sa forme et son poids différaient des trousseaux modernes de mes camarades, je la cachais dans la poche interne de mon cartable, qui n’avait rien à voir avec le sac à dos Quiksilver de mes rêves.
Ulysse brise le silence. Allez Sam, c’est parti pour le remake horrifique de Captain Fantastic ! Heureusement qu’on est venus ensemble.
On sort de la voiture, les parcelles alentour me semblent plus grandes, les rues quant à elles plus étriquées. Oui, j’ai bien vécu ici, mais ma vision ressemble à un lendemain de fête : tout est trouble et nauséeux, aucune proportion ne correspond aux impressions mémorielles. Étonnamment les quelques personnes qui habitent encore ici, elles, me reconnaissent. Par déduction sans doute : cela fait plus d’une décennie que j’ai quitté la région. Ou peut-être que je me trompe, peut-être qu’elles reconnaissent une pièce trop longtemps manquante au paysage de leurs vies. Jusqu’à ces derniers mois, les choses n’avaient pas changé : les mêmes familles, les mêmes enfants jouaient dans le terrain vague que le personnel municipal se rappelait de tondre avant chaque élection. Maintenant, de nombreux logements sont vides, mais quelques habitant·es rechignent à s’en aller, surtout des personnes âgées.
Des racines ont franchi la limite cadastrale et ont attaqué le trottoir. Mais que cela déborde sur la voie publique n’a plus grande importance : morceau par morceau, ces blocs vont être abattus puis remplacés par des structures aux normes. Mes interlocuteurs ont été souples sur les délais et surtout sur l’état dans lequel le terrain va être remis au bailleur. Pour la Soginorpa, la proximité avec Lens et Béthune fait de cette ancienne cité minière le lieu d’implantation idéal d’une offre pavillonnaire attractive, à destination d’urbain·es en mal d’espace.
Nous avançons vers le portail accroché par un miracle à sa charnière. Nous le poussons de quelques centimètres, un grincement lugubre nous souhaite la bienvenue. Ce terrain grouille. Des tuiles ébréchées, des graviers presque enterrés, des mégots forment un compost atypique sous les hautes herbes. La carcasse se découvre sous les ronces, il n’y en a plus guère que les os, de vivants piliers supportant une charpente en dentelle.
On entre, foulards bien plaqués sur le nez. Il y a toujours le poster moisi face auquel j’ai pris tous mes petits déjeuners, il y a deux décennies. La photo floue de deux fillettes au bord de l’eau, l’une tenant une bicyclette, l’autre dans une pose alanguie. Le père adorait David Hamilton.
Il adorait aussi Le lagon bleu, qu’il nous passait quand on était malades. Je retrouve d’instinct le boîtier dans la pile de cassettes qui encombrent les marches de l’escalier. La pochette est jaunie, le père l’avait ornée de descriptifs et de visuels découpés dans Télé 7 Jours, comme il le faisait pour chaque VHS qu’il enregistrait. Quand il s’y mettait, il fallait rester à ses côtés et répondre aux injonctions souvent constituées d’un seul mot.
Si l’ordre était erroné, il fallait deviner qu’il désignait en fait un autre objet. Surtout pas le provoquer en faisant semblant de ne pas comprendre.
Avec Ulysse, on a depuis longtemps fait notre deuil du papa des films américains. Mais au fond, on aurait tous les deux aimé que ça finisse comme dans Big Fish. On aurait aimé trouver quelque trésor dans l’amas de détritus, une lueur de poésie plutôt que cette interminable agonie sans chute. On aurait aimé que ce long film que notre père s’était fait, lui qui haïssait le cinéma, ait au moins un ou deux arcs narratifs tenables.
Ça ne ressemble à rien. Toucher aux objets abandonnés là depuis des années me semble impensable. Il faudrait une benne et tout jeter. Ulysse n’est pas de mon avis, il a toujours été l’optimiste de la fratrie. Il pointe une mallette de magie, c’est ce qu’il est venu chercher. La seule passion qu’il a en commun avec le père. Je souris parce que c’est toujours ainsi avec Ulysse, une petite blague, un petit divertissement pour détourner l’attention. Cet adolescent est un cadeau des cieux. Ça a dû lui coûter, par le passé, d’être celui qui éloigne la gravité.
Quand il était petit, on prenait chaque weekend le TER ensemble, je l’hébergeais à Lille, dans le studio que je partageais avec Alain, un camarade de promo. Parce que c’était gratuit, je l’ai emmené dans les galeries d’art les plus prestigieuses. Les premières fois étaient effrayantes mais je faisais tout pour lui montrer que notre présence était légitime. Traverser des cours intérieures luxueuses, des couloirs vides sous des verrières, faire semblant d’être sûrs de notre destination. Comme dans la rue pour éviter le harcèlement. À 10 ans, il connaissait le grain de Michael Ackerman, les Polaroïds de Robert Mapplethorpe, les corps agressifs de Peter Lindbergh. Les gens ont souvent été attendris par notre duo. Ils nous ont pris en stop, voulaient savoir si j’étais sa mère, si je l’avais eu ado, une grossesse précoce, une sale histoire ?
– On est frères.
– Ha. Vous avez une belle relation. Fusionnelle. C’est rare pour deux frères.
On est partis en voyage à Paris, à Bruges, on dormait dans des auberges de jeunesse. Je cherchais à transformer les aliments pour faire de n’importe quel repas banal une fête. Je découpais le pain de mie en toasts en forme de cœurs. Je servais les pâtes dans des bocaux fantaisie, en alternant des couches de sauce et de féculents pour former des paysages. Je sculptais des personnages dans la purée. Bon. On mangeait aussi des soupes lyophilisées, les chips mous et les biscottes laissées dans les cuisines collectives par d’anciens voyageurs.
Il se souvient du Sacré-Cœur et des tableaux de Brueghel Le Jeune et des fontaines de chocolat fondu. Il évoque le premier film en VO que je l’ai emmené voir quand il avait 8 ans et le Palais des Beaux-Arts, en libre accès chaque troisième dimanche du mois. C’est de toi que j’ai appris à faire un spectacle de n’importe quel truc du quotidien. Ça fonctionne tellement bien au stage BAFA. Aujourd’hui tadam on a des frites et de la mayonnaise ! Ulysse est un illusionniste. On ne peut jamais savoir s’il fait un tour de close-up quand il occulte la bouffe de mauvaise qualité, le sommeil entrecoupé et les dortoirs humides.
La liste des séquelles
Ce passage dans le bassin minier a réveillé le monstre sous ma peau, toutes mes douleurs sont à vif. Je me souviens de mon père hurlant son besoin de tel ou tel acupression pour se sentir soulagé. Moi je me retiens, je me contiens. J’observe cette matière sous ma peau, venant créer des ondes sur l’épiderme. Je soumets les réactions de mon corps, ce patrimoine héréditaire que je crains quand je me vois sombrer. Le médecin me demande ce qui se passe. Je déroule. Je déroule et je sais que ça va marcher. J’ai droit à plusieurs semaines d’arrêt et à une cure prise en charge par la Sécurité sociale. Vous avez besoin de repos et de temps pour vous. Vous continuez vos séances de kiné ?
Le bruit blanc des derniers jours, d’une densité opaque, brouille encore le fonctionnement de mes tympans. L’organisation de trois semaines hors de Paris me semble une épreuve. Étienne me pousse à faire ma valise.
– Je peux réchauffer des pâtes et des pizzas surgelées à un ado pendant trois semaines.
– Et des légumes ?
– Et des légumes Samaël, oui ! De toute façon, tu as rempli le frigo.
Dans spondylarthrite ankylosante, il y a ankylosante. Je ne veux pas donner raison à ce mot, je reste toujours en mouvement. Sauf maintenant. Dans un carnet, je liste mes symptômes pour le personnel de la cure thermale. Je passe sur les insomnies, le stress, la libido aléatoire. Je me concentre sur les manifestations physiques : raideur et douleur dans le bas du dos, renforcée au repos. Déformation de la colonne vertébrale. Tiraillement dans l’aine et la hanche. Inflammation du rachis. Perte de mobilité. Syndrome de jambes sans repos avec sensations de décharge électrique et de brûlure dans les cuisses et les bras lors d’une position assise prolongée. Spasmes et réveils nocturnes. Fourmillements des mains liés à la compression du nerf médian. J’ai du mal à admettre les fragilités de mon corps, je les cache, je ne veux surtout pas en faire un sujet. Quand il a eu quatorze ans, mon frère a fait un ulcère, depuis je n’arrête pas de me torturer l’esprit. Que pourrait-il nous arriver si mon corps lâche ? J’essaye de me rappeler la voix autoritaire de Myriam, quand j’ai complètement décompensé au téléphone en disant qu’on pourrait finir SDF. Ulysse et toi vous serez jamais à la rue ! Jamais ! Je ne permettrais pas ça.
Je pense à Ludo, à tout ce qu’il ne dit pas de ses douleurs. En l’absence d’ascenseur dans mon immeuble, je ne peux même pas l’inviter dans l’appart où je vis. Je pense à toutes les fois où il envoie un message pour annuler une sortie. Un peu fatigué. Je préfère être posé chez moi à jouer à Zelda aujourd’hui. Toutes les fois où, pour nous épargner, il nous donne l’impression d’avoir la possibilité de choisir. Quand ça devient trop fluide, trop plan sur le long terme entre nous, il me rappelle qu’il va mourir jeune, qu’il faudra que je m’en remette. Devant lui, j’encaisse. Je fais semblant. Le corps des autres ne pourra jamais être notre vêtement de nerfs, ça ne se passe que depuis nos organes. Dans ma chambre je choisis la pire chanson mélodramatique de ma playlist, j’explose en sanglots trois minutes, ça va mieux.
Il faut que je prépare mon sac, mes documents médicaux. C’est drôle, j’ai un carnet de vaccins Seniors parce que j’ai commencé après ma majorité. Ma demande de mise à jour semblait très suspecte, d’autant que je n’avais pas de carnet de santé à présenter pour prouver mes dires. Vous avez forcément fait ces vaccins pour aller à l’école. Non ?Mais enfin, c’est obligatoire, comment ça se fait ? Je pourrais envenimer la situation, lui suggérer de poser la question à mes parents, mais je la laisse s’emporter jusqu’à obtenir ce que je demande. Dans votre cas, il n’y a pas d’autre recours que d’utiliser un document destiné aux personnes âgées.
Mon père était opposé au sport, aux profs, à la médecine. Je me souviens de son humiliation devant le cardiologue. Vous êtes obèse monsieur. Si vous ne voulez pas mourir, il faut arrêter de manger. Moi, le midi je ne me nourris que d’une pomme. Le daron, ça l’avait cloué. Il avait les yeux fous quand il répétait cette phrase. Il s’est foutu de moi, il m’a dit de ne me nourrir que d’une pomme.
Concernant le tabac, il balayait d’un revers de main les campagnes de prévention. Il fumait dès le petit dej’, parfois dehors mais rarement. Ne te méprends pas Samaëlle, les riches qui dictent ces lois hygiénistes peuvent prendre un mois de vacances au Club Med pour se détendre. Moi j’ai que mes cigarettes.
Devenir ? Rien.
La dame de l’office du tourisme me demande si je suis bien curiste ou juste touriste. Curiste, je répète. Ha, c’est que vous faites jeune, vous auriez pu accompagner quelqu’un.
Oui, depuis mes 17 ans je fais jeune pour mes soins, mes inflammations chroniques, mes rhumatismes, mon hypertension artérielle. Ici, ma maladie auto-immune détonne parmi les retraité·es. On me répète les mots détente, lâcher-prise, reconnexion. Trois semaines d’attentions et de développement personnel. C’est trop.
Je sens l’angoisse glacer mes entrailles, ma respiration s’affoler. Le coach sportif échange avec moi, me drague un peu, cherche à me faire parler. C’est à cause d’un petit ami indélicat ?Je réponds oui. Vous êtes une femme magnifique, vous méritez mieux. Je réponds oui d’un signe de tête, je sens que si j’articule ne serait-ce qu’un mot, la digue cédera sous une crise de larmes.
Rien ne va dans ses questions, rien ne va dans mes réponses. Rien ne va non plus dans mon corps, dès qu’il passe l’épreuve des regards médicaux. Surtout cette carte vitale et ce torse, qui me définissent aux yeux du personnel thermal. Je suis venu ici pour prendre le temps de m’écouter et les gens me bâillonnent de faux compliments. Mais c’est que vous faites jeune ! C’est que le syndrome de choc post-traumatique n’a pas vraiment entaché votre teint !
En visio, ma psy suggère qu’une prise de conscience permet d’agir à l’inverse de ce qu’on nous a fait. Les tribunaux eux, ne se gênent pas pour marteler que le déni, ou l’absence de travail sur soi, poussent à reproduire la violence. Les victimes ont donc le choix entre devenir bourreaux ou infirmier·es sacrificiel·les. Moi, d’échecs en déménagements, je m’acharne à devenir rien.
Elle mentionne les cartons de carnets et les albums photo de mes parents, que j’ai pour l’instant entreposés dans ma chambre. Je n’ai aucune obligation de les ouvrir. Aucune obligation à les jeter non plus. Je pourrais les laisser chez quelqu’un de confiance le temps de faire mon choix.
Elle a raison, je ne suis pas en état de prendre des décisions hâtives. Surtout pour quelque chose d’aussi symbolique. Je lui dis que je voudrais me désolidariser des réactions de mon corps quand je lis les anecdotes de mes ami·es dans notre groupe de discussion. Pas besoin de louer un camion, je prendrai celui de mon père ou Dimanche, pas possible : déj’ chez mes grands-parents. Je voudrais faire taire la rancœur, convoquer toutes leurs générosités, le souvenir de la fois où Lubna nous a invités à sa table pour Noël. Mais ça fonctionne pas. Ma psy m’encourage à accueillir cette émotion.
Alors ok, j’avoue. Je jalouse les rituels du dimanche en forme de poulet-frite-tarte-aux-pommes. Sur les formulaires, je laisse le vide comme un écho face à la case personne à prévenir en cas d’urgence. J’ai pas d’appels téléphoniques pour savoir si je suis bien arrivé, si le trajet s’est bien passé, pas de félicitations quand j’obtiens un contrat de travail, ou de mère pour relire mon mémoire ou de cadeau d’anniversaire. Surtout j’ai jamais eu un parent qui m’a pris dans ses bras de manière saine. Y’a tout un monde relationnel qui m’a échappé.
Avec ses soins riches en eaux thermales dont les propriétés sont prouvées, la cure permet de réduire durablement les douleurs causées par les maladies chroniques sans effets indésirables. Je conserve ironiquement la brochure tandis que je plie bagage à la fin des dix-huit jours réglementaires. Mon maillot de bain est imprégné d’argile blanche détoxifiante, aux vertus anti-inflammatoires. Mon cerveau, lui, sature de souvenirs qui remontent de force. Il me reste trois jours avant la reprise du travail, mes amies Claire et Bri m’ont proposé de faire escale chez elles avant de rentrer à Paris. Je sens que ce passage chez elles est une transition nécessaire avant le retour au quotidien. D’ailleurs, ma contrariété disparaît dès que je franchis la porte de leur duplex.
Autour d’un apéro, elles m’exposent les avancées de leur projet professionnel d’assistantes familiales. Brigitte détaille on hésite sur la stratégie pour que notre dossier passe. Deux meufs lesbiennes en coloc : est-ce qu’il vaut mieux qu’on dise qu’on est en couple ? Ou qu’on est hétéras ? Qu’on envisage une hystérectomie pour bien prouver que c’est pas la projection d’un impossible désir d’enfant ?
C’est absurde. L’une est infirmière psy et l’autre a été AsMat pendant cinq ans. Elles s’imprègnent de tout ce qu’elles trouvent sur les violences éducatives ordinaires, la motricité libre et sont à jour sur l’intégralité des rapports de l’ASE. Mais leur dossier ne passerait pas ? Il y a tellement de familles d’accueil agréées qui voient ça comme une prestation hôtelière. Je parle d’expérience. J’en ai vu des couples soufflant c’est bon, on est pas des Thénardier, en se plaignant que les jeunes disent pas assez merci, des propriétaires terriens au revenu de 6k mensuel attendant qu’une main-d’œuvre vulnérable joue le rôle d’aide à domicile.
Claire chemine à voix haute. Elle pense à tou·tes les jeunes qu’elle accueille en première ligne aux urgences psys. Ce projet, c’est une réflexion qui vient du corps. Et de l’âge sûrement aussi, même si c’est dur à admettre. C’est pas une question d’horloge biologique. C’est dans le corps, mais dans le sens où ça vient d’un état antérieur au raisonnement. Si on se contentait d’être rationnelles, personne ne s’occuperait d’enfant. Brigitte ajoute que dans un projet de famille d’accueil, y’a l’idée d’un choix mutuel, de redonner du pouvoir aux enfants.
Dans le car qui me ramène chez moi, je regarde le jour se lever, c’est un spectacle dont je ne me lasserai jamais. J’ai connu beaucoup de weekends chez Claire, puis chez Claire et Anne, et désormais chez Claire et Bri. Je me souviens de l’époque où Claire était en couple avec Anne. Face à l’actu, on partageait des poncifs pour se consoler. Au moins, nos petits-enfants sauront qu’on n’a pas marché du mauvais côté de l’histoire.
Mais Claire dit qu’elle marque les dates d’anniversaire des bébés de ses potes pour pouvoir les fêter. Qu’elle ne s’ennuie jamais devant l’intensité de leur présence au monde. Je vais essayer d’appliquer ce principe.
Un peu essoufflé, je traîne ma valise sur les dernières marches qui mènent à l’appart. Dans la cage d’escalier, je croise un grand gars au crâne rasé qui sort de notre coloc, avec ce sourire niais qu’on a tous dans cette circonstance précise. Je ne fais aucune remarque à Étienne, qui écoute de la pop sentimentale dans sa chambre. Il me crie à travers la porte Ulysse est à Paris 8 avec Laelia, c’est la journée porte ouverte pour les inscriptions en licence.
Ce soir-là, après les retrouvailles avec mon frère, je m’attelle au difficile : suivre les conseils de ma psy, t’écrire un mail de mise au point pour t’expliquer ce qui m’a traversé cet été.
Ensuite, je vérifie que toutes mes phrases sont bien écrites au « je », qu’elles ne concernent que mon ressenti et ne portent aucune accusation. J’en retire tout ce qui me semble heurtant.
Le lendemain, je change les tournures pour gommer la violence de la situation décrite. Pour être sûr d’être légitime à te l’envoyer, je prends encore quelques jours à retourner chaque mot, à en questionner le bien-fondé. Est-ce que mon cerveau est en train d’être matrixé par le bullshit bienveillant des accords toltèques ?
Bizarrement, c’est à ce moment-là que tu m’envoies un article scientifique analysant l’apport pédagogique des ouvrages de Christiane Rochefort. Le texte dont tu me parlais cet été, quand nous évoquions les multiples contraintes qui avaient bridé nos imaginaires juvéniles.
Tu signes des trois premières lettres de ton prénom. Ton message n’est pas très consistant mais j’ai le privilège de cette syllabe douce, que je prononce dans un souffle, quand la majorité des gens t’appellent par ton nom de famille. J’imagine que c’est une main tendue.
Je ne suis pas dupe de mes contradictions. La lucidité ne m’aide pas pour autant à agir. Puis ces allers-retours qui reprennent chaque weekend, entre le passé et la décharge publique, ça n’aide pas. J’ai besoin de vacances. Je m’en veux d’avoir été prétentieux l’été dernier, d’avoir préféré les Cévennes à la traditionnelle semaine à l’auberge de jeunesse de l’île de Groix avec mon frère. Notre rituel depuis désormais huit ans me manque. Chaque fin de saison, sur la plage en contrebas du sentier côtier, on faisait le bilan de nos cœurs. Aujourd’hui c’est vide. C’est brisé. Ce serait parfait pour laisser les vagues s’engouffrer. La mer aussi me manque.
Durant cette période, il n’y a que des microcontacts qui nous relient. Tu m’envoies un mail où tu me relances concernant un colloque à Bruxelles, au printemps prochain. L’université prendrait en charge nos deux déplacements. Tu dis que tu détestes cette période, fin novembre, puis les obligations festives de décembre, mais que tu t’envoles pour l’Amérique Latine à la fin de la semaine.
En te lisant, des crépitements embrasent mes joues. Mais ça doit être un besoin de remplir l’ennui, de repousser la tristesse. Dans quelques jours tu seras loin, en plein soleil, dans des lieux de cruising, aux endroits les plus hédonistes. J’ai raté le coche et je ne sais comment te parler de ce que je traverse. Le décalage entre nous est important.
À la suite d’un scandale médiatique d’ampleur qui concerne des détournements de fonds publics et l’Aide Sociale à l’Enfance, tu me réécris. Tu proposes de m’inclure dans le groupe de rédaction d’un texte, entre le plaidoyer et la pétition. Bizarrement, me concentrer sur la mise en forme de ces revendications collectives me fait du bien. Cela me remet en mouvement et occupe mon esprit. Tu voudrais que je signe la version finale. Je sais pas trop, je suis personne. Au contraire, il faut des gens comme toi ! La liste de signataires envisagée — des essayistes, des universitaires — manque cruellement d’expert·es de terrain.
Les entretiens que je mène actuellement pour mon mémoire demanderaient que je continue d’être non identifié politiquement sur le web. Mais, évidemment, je vais signer. Cela va paraître dans un grand journal, une part de moi en sera fière. Je vais signer et mon nom inconnu sera mêlé aux vôtres. Plusieurs d’entre vous iront jusqu’à consulter mon profil LinkedIn. Iels ne m’ajouteront pas.
Dans le cabinet de ma psy, ça va pas fort. Mes pensées tournent en boucle.
– Je me souviens de tout ce verre pilé charrié en moi à chaque rejet. À chaque tu es si brillant intellectuellement, mais intimement tu demandes trop. Ce serait un running gag si ce n’était si écorchant. Mais cette fois-ci, il n’y a même pas ça. Je ne comprends absolument pas pourquoi ce garçon a voulu me faire une place dans sa vie. Il côtoie quotidiennement des gens tellement plus doués et éloquents que moi. Il y a beaucoup de choses que je comprends grâce à la thérapie. Grâce à vous. Mais ce point-là, vraiment, ça reste un mystère.
Elle me propose un exercice de verbalisation : si je le pouvais, qu’est-ce que je souhaiterais te dire ?
– Je sais pas. Je parlerais de la maison. La maison, pour moi, c’était la ruine. C’était la honte. Les cinq degrés dans la cuisine quand je descendais au milieu de la nuit rédiger mes rédactions à la lampe de poche. Mais dans son monde, on dit aussi : La maison Dior. La maison Yves-Saint-Laurent. La maison Gallimard. La maison mère. La maison de famille. Sa maison. Et moi… Putain mais moi je m’écroule en fait, je m’écroule.
Je consulte mon téléphone précipitamment à chaque notification. Même au travail. L’élan est à chaque fois déceptif.
– Genre, c’est ça que t’as dis, que tu t’écroules ? Parce qu’un random match Tinder veut pas que tu le suces ? T’es sûr que t’exagères pas un peu mon chou ?
Les mots d’Aya à la pause-café me font exploser de rire. C’est la personne parfaite pour m’aider à redescendre. Pour me rappeler qu’on a des gamins à aider et que ça ne va pas s’arrêter à cause d’un coup de blues.
– Quand même, on ne peut pas dire que c’est un random match Tinder. C’est mon corps qui dysfonctionne…
– Mec ! Il ne dysfonctionne pas, ton corps ! Et quand bien même. Tu ferais ressentir ça à quelqu’un toi ? Genre, ton corps dysfonctionne, répare-toi avant de me côtoyer ? Jamais mon chou, jamais tu ferais ça ! T’as eu un flashback. Un putain de flashback. Et le petit chat d’ethno-anthropologue-qui-n’est-pas-un-match-tinder-random, il a pas su te dire des choses tendres et te prendre dans ses bras. Pourtant, faut pas une bibliographie scientifique de dix pages pour comprendre ça. Alors c’est bien beau le ruisseau, la lumière dorée sur les murs de chaux et les petits rossignols qu’on entend depuis la fenêtre de sa chambre, mais c’est lui qui n’a pas assuré.
J’espère que t’as honte
Elle, ne voulait pas rentrer au bercail après sa journée de travail. Elle errait, le plus lentement possible, dans les rayons du centre commercial. Faisait des courses quotidiennes en additionnant mentalement les prix pour ne pas avoir de mauvaise surprise en caisse. Choisissait le chemin le plus long pour rentrer.
Elle, observait les maisons, se nourrissait des façades lumineuses des autres, de leurs jardins parfaitement domptés.
Un jour son mari a commencé à lui dire les mots : enculée de ton père ; couineuse ; perfide congénitale ; dégénérée… Et à partir de ce moment, cela a tourné en boucle.
En guise d’histoire du soir, elle racontait à Samaëlle : Mon père m’aimait tu sais, il mettait juste les doigts je n’avais pas mal.
Elle, elle disait en sanglotant que Samaëlle mentait. Dis que tu mens sinon je vais aller me jeter dans le canal. Oui, Samaëlle mentait. La mère jubilait de cet aveu. Tu n’es vraiment qu’une petite pute.
Quand il n’y avait plus de matière à engueulade entre les géniteurs, il fallait recycler les anciennes. Encore. Et encore.
Avec Ulysse, plus tard, ils se sont rendu compte qu’ils partageaient le même ressenti : ils pouvaient sortir les pop-corns et prédire la nuit blanche à slalomer entre les bris de vaisselle.
Le plus pénible, c’était l’après-crise. Le père métamorphosé en bonhomme jovial, escamotant les heures précédentes dans un magistral tour de passe-passe. Apportez-moi du papier et un stylo !
L’assemblée se retrouvait prisonnière devant la conférence dessinée, hochait la tête en cadence devant les schémas de résolution de conflit. Regardez, si on construisait nous-mêmes les parpaings, ça ne nous coûterait rien ! Allez, si vous y mettez du vôtre, d’ici quatre ou six mois l’extension pourrait être faite !
Dans ces démonstrations de bonne volonté, il fallait montrer un visage encourageant et débarrassé de toute rancœur. Il fallait rire aux moments souhaités mais surtout pas dans un quelconque impromptu.
Quand la mère finissait par s’enfuir, le père ouvrait la porte et hurlait dans la cour : sale violée de ton père, etc.
Samaëlle demandait toujours aux parents de ses amies Vous pouvez me déposer là, s’il vous plaît ? Je finirai à pied. Les mères ne voulaient pas la laisser sur la départementale, Allez, on t’amène jusqu’à chez toi. Je préfère que mes parents ne voient pas qu’on m’a raccompagnée en voiture. Ils sont stricts ? Oui, ils sont stricts.
Poussière et gravats
Le mari d’une copine d’enfance me prête sa camionnette. Bien qu’on ne se soit pas recroisés depuis le lycée, il a aussi tenu à débroussailler. Il m’informe on vient d’accepter la proposition de relogement à quelques kilomètres, on voulait pas que les filles aient à changer d’école. Il rit un peu nerveusement. De notre vie ici, il ne va rester que de la poussière et des gravats.
Je propose au voisinage de récupérer ce qui peut leur être utile : le mobilier et la vaisselle qu’on a entreposés dans la cour avec Ulysse, le bois d’allumage et le charbon, les outils et les bouteilles de gaz rechargeables. Un des gars me lâche j’ai toujours été strict sur l’élevage de mes filles, les poules au poulailler. Mais ton père, quand même, c’était autre chose ! On l’entendait hurler de l’autre bout de la rue.
L’extérieur de la maison ressemble maintenant à quelque chose de conforme. Des personnes proposent de filer un coup de main pour vider l’intérieur, mais c’est au-dessus de mes forces. Je réponds par un truc un peu drama et sibyllin, il y a des voyages qu’il faut faire seul. Mon ancienne camarade de classe saisit bien l’idée, je suppose qu’avoir grandi dans la même rue, ça aide. Sûrement pour me soutenir, elle affirme les objets dont tu t’es passé depuis 15 ans, tu peux t’en passer toute ta vie. Elle me confie qu’elle aussi, son père c’était quelque chose. Il a été retrouvé mort dans sa voiture alors qu’elle attendait son premier enfant, il était à la rue et n’avait pas osé appeler à l’aide. Il ne savait même pas que j’étais enceinte.
Maintenant, c’est l’heure du fameux voyage solo : il faut entrer, affronter ces deux étages sombres et la cave. Ado, je me cognais beaucoup, aux coins des meubles, dans l’escalier diminué de moitié par les étagères de fortune accrochées au mur.
Les gants de toilette, eux aussi, sont toujours là comme momifiés, suspendus à un fil de fer au-dessus de l’évier de la pièce du bas, avec les serviettes-éponges mélangées aux torchons de vaisselle que la crasse a rendus rigides.
La nourriture périmée, le papier, le métal, le plastique, je vois où je vais pouvoir les jeter. Il y a des poubelles pour ça. Mais je fais quoi d’un toilette chimique pas vidé depuis des années ? Je fais quoi des classeurs de mon père, compilant l’intégralité des articles de presse qu’il a pu trouver sur Graeme Allwright ? Je fais quoi des sculptures de nus féminins qu’il avait confectionnées en autodidacte, avec notre mère comme modèle ? Chaque nouvelle découverte est un cas de conscience. Me débarrasser, prendre des décisions pragmatiques, oublier : l’effort me fatigue d’avance.
En haut de l’escalier, je suis face à des sacs plastique collants de suie, des centaines de bocaux et de boîtes de conserve contenant du fil de fer, des écrous, des vis, des bouchons de liège, des liasses de papiers carton découpés dans des boîtes de céréales ou de purée mousseline. Je revois le père, chaque journée d’encombrants, qui fouillait dans les empilements sur les trottoirs et négociait avec les personnes vidant leur garage, à l’affût d’un trésor. Il croyait sincèrement que ces matériaux de récupération seraient utiles un jour.
Je ne saurais chiffrer le nombre de dimanches après-midi qu’on a passé à extirper de vieux clous d’objets destinés à la déchèterie, à les redresser au marteau et à les classer par taille dans des pots de Nutella usagés. Chaque heure libre de nos weekends d’enfants était destinée à alimenter les stocks.
Ulysse était petit quand il a quitté ce lieu. Lorsque nous sommes venus à deux, il s’est contenté de prendre en photo les différents recoins. Mais je sais qu’il est triste de ne pas avoir d’espace où conserver ses souvenirs afin de les trier plus tard. Je mets dans un tote bag quelques albums illustrés, ses dessins de maternelle, un cahier d’écolier, des cartes Pokémon. Pas plus, pour ne pas encombrer sa chambre actuelle.
La peluche que j’aurais aimé récupérer, elle, est introuvable. Mais c’est sûrement mieux que de tomber sur son cadavre moisi.
Jour de Noël
Iels ont mis Ulysse et Aya dans le coup pour réussir à banaliser toute ma semaine. Pas de souci pour inverser, vous savez que Noël, c’est pas ma fête… Vous n’aurez qu’à me faire livrer des huîtres à la MECS !
Pour bien maintenir la surprise, en dehors de quelques effets personnels, c’est mon frère qui prépare ma valise.
Iels m’offrent un ferry miniature en guise d’indice et j’explose de joie : iels ont appelé Hélène qui a accepté de nous privatiser un dortoir de l’auberge de jeunesse.
Elle nous attend à Port-Tudy avec un grand sourire. Ce matin, je suis allée mettre le chauffage dans le dortoir et tenez, voici la clé du bloc sanitaire. N’hésitez pas à passer me voir au bourg s’il vous manque quelque chose !
Ça fait longtemps qu’elle n’a pas ouvert l’auberge en hiver, la dernière fois, c’était pour les fiançailles de Reï et Katy.
Reï et Katy, ces deux-là n’ont plus d’âge. La légende dit qu’ils se sont rencontrés à l’ouverture du lieu dans les années 60, quand on pouvait planter la tente en échange d’un coup de main aux chantiers participatifs.
C’est en hommage à ces éternels fiancés qu’Hans a peint la fresque aux étoiles filantes sur le dernier bunker du Méné. Sa fresque bleu nuit, la plus mystique.
À Groix, tout devient simple. On va se baigner dans une eau à 8 degrés. On remonte en courant se frictionner sur la plage, la peau rougie. Le froid des matinées gelées est contrebalancé par les balades vivifiantes sur le chemin côtier. Ulysse nous fait visiter les tunnels secrets et les forts abandonnés qu’il a découverts d’années en années en explorant l’île.
Bonnets enfoncés jusqu’aux oreilles, on mange de la pizza devant un coucher de soleil à Pen-Men. On retourne vers le bourg avec le faisceau embrumé du phare qui éclaire notre route, vent de face. Il y a un petit côté Goonies dans cette lente procession de vélos dans le noir.
Nos corps s’éprouvent dans la rugosité des éléments. Nos sommeils sont profonds. Dans de rares moments, je fantasme ta présence. J’aimerais que tu sois là pour te raconter ma première rencontre avec cette île, lors de mon stage de fin d’études. À l’époque, Hélène était l’une des seul·es à accepter des séjours de rupture dans son auberge de jeunesse. Mais il faudrait au moins un événement de type colloque international pour que tu fasses le déplacement. Je ris à cette idée incongrue, en pédalant vers la pointe aux chats : tu n’es pas quelqu’un qu’on déplace.
Ludo n’est pas là et ça m’attriste un peu. Ce matin, on a discuté ensemble au téléphone et il voulait tenter le repas en famille cette année, mais quand même. Faudra trouver un lieu plus inclusif l’hiver prochain. Quand j’ai transitionné, il a eu la même réaction qu’Ulysse. Ok, maintenant t’es plus ma sister, t’es mon bro. C’est lui qui m’a emmené pour la première fois dans un sauna. J’étais excité et mortifié. Je n’en aurais jamais été capable sans son soutien. Dans la vie, il y a des scripts qu’on ne peut pas changer. Ça n’empêche pas de bien jouer.
Le 24 au matin, alors que toute la bande s’apprête à partir en rando vers l’ancienne vigie des sauveteurs, un monsieur descend plein gaz le chemin du Méné. C’est Georges, un des indéfectibles bénévoles, qui veut constater de ses yeux l’ouverture de l’auberge pour Noël.
Georges, au début je trouvais qu’il serrait un peu fort les gens dans ses bras. Puis j’ai appris à le connaître et j’ai changé d’avis. En tout cas, il ne fait pas de différence : mec, meuf, profil indéterminé, avec lui tout le monde a droit aux mêmes accolades généreuses.
Et aujourd’hui il est particulièrement fier de son coup : il a déniché un grand sac de guirlandes bariolées, de boules dépareillées et de petits santons vintages. Il ne sera pas dit que vous passiez ce réveillon sans décos ! Il les confie à Ulysse, aux anges, puis repart comme il est venu, sur son scooter pétaradant.
En début de soirée, on descend sur la plage derrière l’auberge pour faire un feu de camp. On a des chamallows, des clémentines et des thermos de thé brûlant avec nous.
Joey est la maîtresse de cérémonie, elle a apporté des lampions. Devant les flammes et les braises, on se raconte nos rêves.
Elle, elle rêve d’une PMA en Espagne ou en Belgique, mais ne se sent pas encore prête : le cœur encore trop brisé pour ça. Elle dit j’suis pas juste « une femme célibataire » qui veut faire un enfant. Je suis une lesbienne qui veut faire un enfant. Et à mon âge, avec mes convictions, ça frotte partout. Ça frotte au regard de ma psy, aux attentes de mes parents, aux discours fertilisants qui veulent faire de nos utérus des armes. Elle dit qu’elle a encore besoin d’attendre. Pourtant, elle sait que je serai le meilleur des marrains. Elle précise au reste du cercle vous aussi, je vous veux comme marraines !
Lubna jette dans le feu un papier avec dessus tout ce qu’elle ne veut plus vivre. On se recueille ensemble autour de ce rituel de purification. Elle vient d’acheter son propre appartement et plus jamais elle se laissera cogner dessus par un gars.
D’ailleurs — et peut-être que ça changera, et si ça change faudra jamais qu’elle s’en veuille — les mecs cis, c’est fini. Elle ne veut plus jamais servir la soupe aux agresseurs, quitte à définitivement arrêter le sexe.
Ulysse lui rappelle que les objets à pile, ça remplace très bien les gars, même si ça fait pas plus qu’eux le ménage. Quoique… Y’a des robots aspirateurs maintenant.
Vient le tour de Claire. Et de Brigitte. Elles, elles ont fini d’aménager les chambres à l’étage et espèrent fort que le Département fasse passer leur dossier. Il ne faut plus qu’un tampon sur un formulaire, un document officiel et c’est bon, elles seront famille d’accueil.
Moi, je réfléchis aussi énormément à la fonction de mon lieu de vie. Je l’ai toujours rêvé accueillant, mais avec une chambre de neuf mètres carrés en coloc à Paris, c’est pas évident. Je n’ai jamais souhaité parier sur un truc aussi mal fichu que d’emménager en couple et je ne vois pas le fait d’habiter avec des ami·es comme un truc provisoire. Au contraire, ça me semble la solution la plus souhaitable sur le long terme. Vraiment, je fais pas ça juste pour économiser sur le loyer ou dans une perspective de décadence insouciante avant les choses sérieuses. Y’a pas plus grave, plus souffreteux, plus drama que moi ! Alors mon rêve, ce serait juste de vivre avec mes ami·es dans un provisoire qui dure infiniment !
Jour de l’an
Dans le journal que tu tiens de ce voyage, tu n’arrêtes pas de t’adresser à moi. Tu trouves que ça fait bizarre d’être là-bas à l’âge qu’avait ton père quand il s’y est fait assassiner, que ça brasse des souvenirs. Même si les entretiens que tu réalises dans le cadre de ton travail t’occupent bien l’esprit.
Tu donnes moins de cours au deuxième semestre, tu peux rester encore quelques semaines ici, bouger un peu à travers le pays pour profiter de ta famille et d’anciens amis.
Je te réponds que je comprends, que les souvenirs c’est important, mais seulement jusqu’à un certain niveau d’ombre. Qu’ici, on vient de passer le solstice mais que du coup en Argentine ça doit être l’été, que ça me rassure de te savoir en plein soleil.
La collègue qui est d’astreinte avec moi rentre dans mon bureau sans frapper. Oh, c’est France Culture que t’écoutes ? Nan, c’est pas France Culture, c’est un autre message que tu viens d’envoyer.
Mais elle a raison, tu parles lentement et avec évidence, comme sur France Culture. D’ailleurs, parfois, tu parles sur France Culture.
Qu’est-ce que tu veux, toi ?
Février. La maison est vidée mais je dois retourner une dernière fois dans le bassin minier pour de l’administratif avec le service urbanisme.
Tu hallucines complètement. Pourquoi je ne t’en ai pas parlé plus tôt ? J’avais pas envie de te trigger avec des histoires de papounet qui refuse de mettre un point final à son agonie. Tu lèves les yeux au ciel. Tu dis reste quelques jours dans les Hauts-de-France, je peux t’héberger et t’accompagner dans le Pas-de-Calais.
Pour me changer les idées, tu m’emmènes dans une soirée fetish. Tu m’offres : du LSD, un harnais, de la danse, des alcools, des chaînes. Tu proposes de nous encagouler dans la foule pour faire tomber les masques. OK. Ça me permettra peut-être de ne plus être tétanisé par ton visage, ses perspectives vertigineuses, ta façon sexuelle de bouger sur de l’électro. Tu n’es même pas bon danseur, mais il y a un magnétisme carnassier dans tes mouvements, dans ton œil mi-clos, dans les contrastes que dessine le latex sur ta peau. Tu entres sur la piste et tu passes du premier de la classe au mec le plus sale du dancefloor. Tout cela s’imprime dans ma pupille et me torture d’envies inavouables.
Tu finis par trouver un espace en retrait, tu danses presque collé au mur. À un moment, tu dis je voudrais être un chien. Tu ris, tu ajoutes que ton problème, c’est que tu ne veux pas de maître. Tu montres d’un mouvement de tête l’imposant groupe de gars près de nous, tenant leurs puppys en laisse, enfin pas d’eux comme maîtres.
Tu fends la foule jusqu’au bar, je te suis. Je veux voir l’animal en toi, te faire boire dans le creux de mes mains, te marquer. Être le responsable de cette cicatrice angulaire entre ton pouce et ton index.
Puis ce matin, tu t’es rapidement préparé pour marquer ta motivation à m’aider. Au réveil, tu as enfilé ce jogging un peu lâche qui me fait complètement vriller. Pendant que je tente de me donner une contenance dans la salle de bain, tu nous prépares un petit-déjeuner que j’ai du mal à avaler. Les formalités qui m’attendent me coupent l’appétit.
Je ne suis pas un cadeau aujourd’hui. Tu dis que ce n’est pas bien grave car je le suis tous les autres jours. C’est mignon et ça ne te ressemble pas. J’en déduis que je dois vraiment avoir une mine épouvantable.
Les enjeux entre nous sont si différents. Toi, tu optimises. Maintenant que tu es référent égalité des chances à l’université, tu veux comprendre. Et moi, je déprime. Je vois l’enquête ethnographique et non le geste amical dans ta volonté de m’accompagner.
Tu bifurques vers la départementale, bordée de pylônes électriques et de champs monochromes. Je t’explique c’est une cité vétuste, qui porte un numéro et qui n’a pas la chance d’entrer dans les critères de l’Unesco. Ces habitations vont bientôt être rasées, alors qu’à quelques rues une autre cité bénéficie d’une réhabilitation.
Certaines fenêtres sont désormais condamnées par des parpaings. Pendant qu’on traverse en voiture ce lieu en friche, je pense à ton jogging tombant parfaitement sur ton corps et à ton pubis rasé. J’y pensais déjà sous la douche, chez toi. Ma main se replie douloureusement sur mon ventre, on est presque arrivés. Ta maison est là ? tu demandes.
Mais je suis incapable de te laisser y entrer. Ta présence est trop incongrue ici, comme de la grâce dans une décharge à ciel ouvert. Je dis attends-moi dans la voiture, je t’en prie. J’ai juste un papier à signer et des clés à rendre.
Je ne veux pas que tu m’associes à l’odeur de la maison, je ne veux pas que tu découvres mes réminiscences olfactives, ces odeurs de gras refroidi, de bouffe en décomposition et de matière fécale. Comment je pourrais te dire les moisissures sur le mur de ma chambre, l’absence d’électricité dans les pièces de l’étage, le froid humide qui m’a amené jusqu’à la pneumonie et m’a alité tout un trimestre en cinquième ? Non, vraiment, quelque chose me tabasse dans ce retour à l’endroit de mon enfance.
Je ne sais pas. Je ne ressens plus mon désir ni l’alphabet de mon système nerveux. Je suis corseté dans des chairs armures, dans un corps blockhaus, dans des guet-apens. Parfois, je crois percevoir dans ta voix changeante les mêmes guerres civiles et souterraines. Je m’y accroche.
J’implorerais bien un exorcisme pour faire fuir l’automate qui me hante. Je dis j’implorerais mais je n’y arrive pas : lâcher prise me demande plus de courage que de partir au front.
Ciel et sable
Durant quinze kilomètres, nous marchons, Gravelines dans notre dos. Nous tournons à gauche, puis encore à gauche, dans des dunes grisées de vent. Même si je sais que c’est un sursis, je reste longtemps à tes côtés, dans ce paysage minéral, dans ce tunnel aigue-marine, dans le grain de ta voix. Cette conversation sans intrusion me laisse flottant, ou alors c’est l’air iodé.
Ta peau est beaucoup trop proche, alors je regarde la mer. La centrale nucléaire de Gravelines embrume l’horizon, bizarrement belle, mais dévastatrice, mais belle.
À notre retour sur le parking, je m’absente un instant pour aller aux toilettes. Quand je reviens, tu es assis dans le coffre de ta voiture, tu picores des chips. Je reste debout à une prudente distance. Viens t’assoir. Je m’assois.
Nous nous frôlons. Rapidement mes doigts sont gras, je puise compulsivement dans ce paquet de chips entre nous.
Tu m’entraînes sur la banquette arrière et cette fois, je n’ai nulle part où glisser, aucune boue intime où aller me noyer. Tes mains m’immobilisent fermement.
Après, tu me serres dans tes bras. On reste blottis dans cette voiture, dans ce parking. Je respire l’odeur très légèrement aigre de ta transpiration, mon front contre ta barbe, ma bouche contre ta jugulaire.
Cet endroit est cinématographique. Tu souris à mes mots. Tu dis je n’osais pas le formuler mais je trouve aussi. Que c’est cinématographique. Tu ajoutes ça m’arrive très rarement.
Sur la route retour, on écoute des sons en aléatoire sur ton téléphone. Le morceau suivant parle de ciel et de sable. Tu dis c’est nous ce titre, c’est notre journée. Tu dis cet algorithme est vraiment bien.
Fondations
Une à deux fois par an, au supermarché, je le croise. Après quelques secondes de tétanie, je me rassure. Cette apparition boiteuse — t-shirt noir délavé, panier contenant quelques portions individuelles de nourriture, chairs irritées par des bas de contention — n’est pas mon père. J’ai pourtant besoin de suivre dans les rayonnages ce clone au regard vide. Je veux connaître ses hésitations de parcours, la marque des denrées devant lesquelles il s’arrête. Mon cœur se sert quand je le vois calculer le prix de ses articles et reposer un paquet de biscuits sur le présentoir.
Peu de mes ami·es le savent mais la tentation de reprendre contact avec lui est toujours là. Joey le sait. Claire le sait et réajuste les choses l’important c’est que ça évolue. Que tu ne restes pas figé dans le ressassement.
Même si je m’astreins à ne plus donner de nouvelles, j’ai toujours la culpabilité d’avoir échoué. Je pourrais alimenter la légende qu’il se raconte, y aller deux fois par an, à Noël et à son anniversaire, l’observer lever dramatiquement les bras au ciel en se lamentant.
Avec Ulysse, on a essayé par le passé, on a eu droit à un monologue de reproches et aux regards indignés du personnel, dans le couloir de la maison de retraite. On en est ressortis migraineux et les vêtements empestant le tabac. Mon frère avait conclu c’est lui qui nous battait, mais c’est nous les monstres.
Quand je suis entré au lycée, je l’ai forcée à passer un pacte avec moi, ça l’a indignée. Bien sûr que je ne raconterai rien à Ulysse, c’est quelque chose qui concerne les femmes ça ! Y’a vraiment que ton frère qui compte pour toi, c’est fou !
Les mots n’ont jamais eu la moindre valeur pour ma mère, alors elle n’a pas respecté sa parole. Avant même qu’il ne soit en âge de comprendre, elle a rempli le cerveau de mon frère de détails graphiques sur l’inceste. Désormais, elle perd la tête et j’ai encore l’impression qu’elle le fait exprès. L’oubli est une maladie dégénérative si pratique.
Récemment, j’ai essayé de répondre à une conversation WhatsApp archivée depuis des lustres. Elle s’obstinait à y monologuer avec des expressions creuses de type bonne continuation et météo agréable. J’ai essayé de lui faire comprendre qu’on n’allait pas pouvoir reprendre en mode small talk. Elle m’a répondu : mais vous n’avez aucune idée de ce que j’ai subi ! Je ne vous ai jamais rien dit.
Devant ce type de réponse, il n’y a plus que la rage qui s’exprime en moi. Je pourrais me claquer la tête dans le mur face à son déni. Heureusement, il y a Ulysse pour relativiser. On peut pas faire rentrer un rond dans un carré, c’est comme ça. Surtout pas lui faire entendre raison. Parce que lui faire entendre raison, c’étaient les mots de notre père quand il la frappait et qu’elle s’enfuyait en nous menaçant d’aller se noyer dans le canal.
Ces frontières en toi
Les vendredis après-midi, je quitte Étienne et Ulysse en pleine partie de Pokémon ou discutant cinéma comme si leur vie en dépendait.
Tu portes une chemise, un pantalon à pinces et des chaussures vernies qui contraignent tes mouvements. Chez toi, tu enfiles une tenue de yoga, un jogging ou une robe, ensuite il te faut un sas de décompression pour te dévêtir de ta retenue, de ton langage protocolaire.
Je suis fasciné par les montagnes, les gouffres et les dénivelés que forme la topographie de ton corps.
Sur tes étagères, il y a des livres écrits par des membres de ta famille, sur trois générations. Je me demande ce que cela doit te faire dans les os, dans les tendons, dans la voûte plantaire d’être ainsi ancré dans une lignée. Épinglés au frigo, le flyer d’un stage de danse et une photo de toi à six ans, à Copenhague, dans les bras de ta mère.
Tu as le regard grave, j’imagine un enfant sage. Tu me le confirmes, avec quelques nuances : quand la scolarité classique succède aux cours privés, tu as du mal à accepter les consignes, les nouvelles règles de vie. L’enseignante est encore en train d’expliquer que tu as déjà résolu l’exercice. Tu t’ennuies. Tu collectionnes les autocollants de tes footballeurs préférés, tu les gardes précieusement sous blister, dans un classeur. Le soir dans ton lit, tu te réconfortes en refaisant les matchs que tu connais par cœur.
Toi tu aimes les stades, la sueur, les vestiaires. Les trapèzes et les dorsaux finement dessinés du milieu de terrain. En fin d’adolescence tu ne peux plus faire l’impasse sur les insultes, le boys-club, les paroles que tu profères parfois avec les autres et qui te donnent de plus en plus la sensation de jouer contre ton camp. Alors tu te prives d’une joie brute, tu arrêtes le foot. Tu ne regrettes pas : tu préfères la justice à un plaisir discriminant. Parfois, durant les longues absences professionnelles de ta mère, tu fouilles dans sa chambre. Elle a gardé peu de choses de lui, mais il y a ces chaussures de randonnée quasi-neuves, qu’il venait d’acheter. Il n’a pas eu le temps de les faire à ses pieds. Tu remarques qu’il faisait la même pointure que toi. C’est une marque technique de grande qualité, intemporelle, tu peux partir en haute montagne avec. Les gens projettent des trucs sur ce geste, tu veux marcher dans ses pas ? Tu en as honte. Non, ça n’a rien de symbolique. Tu as la sensation d’obtenir une compassion que tu ne mérites pas. Tu as eu une enfance heureuse, on t’a porté de l’attention, tu n’as jamais manqué de rien. C’est l’histoire de ta mère.
Je suis curieux de tout. Comment ça tient un corps qui n’a pas connu le froid, les coups ? Mais qui a connu la solitude, les vols long-courriers en passager UM, les deuils avant même d’être né ? Ça doit faire s’agencer autrement le squelette.
Tu reviens de la cuisine avec deux tasses que tu poses au sol près de nous, tu hésites. Souvent les émotions c’est trop pour toi, tu as du mal avec celles des autres, tu te sens envahi. Tu te souviens de ton audition pour le poste que tu occupes : la soirée à trembler dans le noir, dans ta chambre, en attendant le résultat. Tu avais l’impression de jouer ta vie. Honnêtement, la première chose qui me réjouit quand un collègue obtient une titularisation, c’est le soulagement de ne pas avoir à chercher quoi dire pour le réconforter.
À 21 ans, tu vas pour la première fois aux UEEH. Tu découvres un potentiel révolutionnaire qui t’émerveille. Tu te sens à ta place. La lumière est sélective, mais ta culture, ta beauté hors norme et ta discrétion font de toi une personne essentielle. Tu ne veux pas tirer la couverture à toi, tu es angoissé quand tu t’aperçois que tu deviens le centre d’attention de quelqu’un. Presque malgré toi, tu es un excellent leader : des chercheuses, des écrivaines, des personnalités politiques t’approchent déjà. À cette période, des mecs qui ont deux fois ton âge te plaquent au mur sans précaution ni after care. C’est excitant, tu ne protestes pas.
Comment tu t’envisages dans le futur ? Ta réponse fuse sans l’ombre d’une hésitation. Tu sais que tu iras vieillir là-bas. Tu y es en territoire connu dans chaque coin de ciel, dans l’épaisseur d’un nuage, les chants nocturnes des rapaces, la régularité du vent dans les branches, les voix aux terrasses quand tu traverses le village. D’ailleurs même avant, si tu souhaitais tout plaquer, tu pourrais. Quand tu compiles les cours que tu donnes, l’administratif, les sollicitations journalistiques et la rédaction des chapitres de ton HDR, tu en es à 60h/semaine.
Parfois, ta famille s’amuse à t’inventer une autre vie, tu ferais de la permaculture ou tu animerais des groupes de parole dans une association rurale. Mais tu aimes tellement ce que tu fais, la recherche.
Tu sais déjà toutes les prochaines fois où tu iras en Argentine, ton planning des six prochaines années est booké. Tu dis. Quand je veux me donner des espaces de respiration, je regarde les vitrines des agences immobilières dans les villes où je suis invité. Je choisis un des appartements. Je m’y invente une vie. Tu me montres sur ton téléphone l’album photo consacré à ces vitrines.
Ta carrière, ça a été une question de chance. Le bon timing, les bonnes intuitions pour ton sujet de thèse, une promesse d’édition avant même ta soutenance. Ensuite, ça s’est enchaîné. Post-doc, invitations dans des événements hybrides où un talk avec un intellectuel-star côtoie harmonieusement le vernissage d’une exposition collective. Ton essai, Enfants (pas) naturels, fait sortir l’anthropologie des rayons spécialisés pour la propulser en tête des ventes. Valeurs actuelles démonte tellement la parole que tu portes, celle du combat des parents queers pour avoir officiellement accès à la procréation, que beaucoup de personnalités de gauche se sentent obligées de te défendre. À l’autre bout de l’échiquier, des mèmes homophobes, des appels au viol et des insultes te ciblent quotidiennement.
Tu dis c’est pire quand ça vient de ton propre camp, j’ai déjà été attaqué en public par des féministes, je ne sais pas quoi répondre à ça. C’est moins flippant, mais plus douloureux. Le commentaire de cette chercheuse sous l’article annonçant ta nomination à un observatoire de l’éthique publique te met, encore aujourd’hui, une boule au ventre. Ce JPP DES MECS CIS, comme si tu rejoignais des instances prestigieuses tous les quatre matins.
Dans ce contexte harcelant, tu n’arrêtes pas de travailler, c’est ce qui te fait tenir. Tu sais que si tu restes seul trop longtemps, tu pourrais te faire du mal, alors tu rends des services dans tous les sens. Tu tisses des liens avec des représentants syndicaux qui t’invitent à un débat lors de leur congrès national. Tu maintiens des conversations régulières avec un ami d’enfance aux opinions politiques éloignées des tiennes, mais dont l’épouse travaille à la Cour des comptes. Tu proposes un appel téléphonique à la chargée de plaidoyer du Refuge, pour faire le point sur l’agenda de la Fondation, envisager des revendications communes, etc. Ces routines te stimulent, tu excelles dans l’art de la maïeutique.
Tu t’inquiètes quand je cite le travail d’une de tes collègues.
– Tu peux pas comparer, elle, elle est au CNRS.
– Je compare pas.
– Mais elle n’enseigne pas. Ou en tout cas, elle sélectionne précisément à qui elle enseigne. Je ne pourrai jamais publier autant.
Tes liens avec ton meilleur ami se sont améliorés. Au fond, tu n’avais pas conscience de tout ce qu’il avait à gérer, à l’époque. Là, tu dois recruter en urgence un vacataire pour des heures de TD et tu commences à comprendre comme c’est délicat et chronophage.
C’est vraiment mal payé, vacataire. Tu sollicites ton répertoire de connaissances, tu restes pragmatique : qu’il n’y ait aucun malentendu sur le montant du salaire. Tu expliques cet emploi précaire avec force détail. Ce n’est pas agréable, mais il faut s’y plier : tu n’es que le messager. Tes interlocuteurs comprennent. Tu joues une partition dont tu as l’habitude. Tu as cette intelligence comportementale.
Quand je te rejoins dans ce colloque à Bruxelles, pour présenter notre recherche-action, j’observe cette posture stratégique dans chaque silhouette que je croise. J’ai déjà vu cela en politique ou aux avant-premières des spectacles d’Étienne. La sincérité des mots des vrais spectateurs sonne souvent comme une absence assez gênante de compréhension des rouages. Leur naïveté émotionnelle, leur premier degré, les décrédibilise.
Un déjeuner succède aux premiers exposés, quelqu’un précise nous pourrons poursuivre les échanges de manière informelle. Pas une seule fois tu ne me parles ou ne me regardes.
Comme si elle devinait mes pensées, une de tes plus proches collaboratrices me chuchote avec affection ce n’est pas à propos de toi, avec moi aussi il agit comme cela dans ce genre de contexte.
Tout en participant aux échanges mondains, tu éparpilles tes aliments. Tu n’avales pas. Tu partages les détails croustillants, mais partiels, d’une brouille publique avec un autre intellectuel. Tu évoques des potins stratégiquement choisis. L’assemblée t’écoute avec délectation, c’est léger, à un moment tu disla vengeance est un plat qui se mange froid. Les gens ne s’attendent pas à ce genre de phrase dans ta bouche. Tu as la tête penchée sur l’épaule d’une écrivaine en vue qui t’embrasse sur la joue vraiment très près de la commissure des lèvres. Je suis convaincu qu’elle sera sur la liste de tes invité·es, l’été prochain. Tu précises à chaud, quand t’es un mec, ta colère passe pour de la violence. Montrer des émotions dans le milieu universitaire, c’est un aveu de faiblesse, mais la vengeance est un plat qui se mange froid.
De retour à Paris, tu voudrais aller prendre une bière pour marquer l’entrée dans le weekend. Tu trouves que tu as un peu trop sociabilisé avec des collègues ces dernières heures, tu aimerais avoir le luxe de rompre avec tes obligations. Tu penses à ta mère. Elle vieillit et tu voudrais passer davantage de moments à ses côtés.Les gens n’ont pas idée de ce qu’ils font peser sur toi quand ils se confient et qu’ils t’entraînent dans des discussions n’ayant pas de lien avec ton champ disciplinaire.
Sur le toit-terrasse du Louxor, tu remarques l’affiche du cinédébat de ce soir. Il est animé par un spécialiste de la famille qui défend des thèses opposées aux tiennes. Je voulais couper avec le taf, c’est raté.
Je lance des pics gratuits sur cet expert qui t’insupporte. Mais regarde comme il est cheum, personne ne va venir. Parce que tu es sûr que nous sommes sans témoins, tu t’autorises à éclater de rire. Sur le chemin retour, tu me confies que nos moments te font un bien fou, que tu apprécies mon ironie, ma manière de me fondre dans chaque lieu sans reprocher aux gens de ne pas réellement être eux-mêmes. Tu ajoutes c’est ridicule de dire à quelqu’un qu’il n’est pas authentique en telle ou telle circonstance, on a des identités multiples, des dizaines de masques sociaux différents.
Du linge blanc sur mes années de guerre
Ta main sur ma joue, je deviens liquide. Je me noie dans les trois premières lettres de ton prénom. Cette syllabe fleuve est un braquage. Comme les symboles d’un bandit-manchot qui s’alignent. L’état liquide est un état fluide, c’est-à-dire parfaitement déformable : mes perceptions se modifient et je crois voir ton prénom dans chaque graphème approximatif sur les publicités géantes des murs du métro, sur toute la ligne 12, dans les journaux gratuits froissés sur le sol de la rame. Parfois, aussi, je lis ton nom dans les tendances Twitter.
En fonction des conférences que tu donnes, tu passes tes samedis en club avec tes plans d’un soir, à Londres, à Copenhague ou à Buenos Aires. Moi, j’ai le bilan carbone d’un travailleur social et quand je tombe amoureux, je prends le rythme de tes playlists : techno, rap féministe et tubes argentins. Je veux m’imprégner de toi, te faire de la place, être submergé par mes émotions. Je veux me faire violence, oublier mes stratégies de rétentions sensitives. Sans cela, je pourrais passer des années à délaisser la musique et le plaisir, muré dans un quotidien millimétré.
Un soir de mars, tu prononces une phrase que je m’empêchais d’espérer. On pourrait se retrouver dans ma maison des Cévennes, mais juste à deux cette fois ? Tu ne veux pas reproduire les erreurs de l’an dernier. Tu souhaites que nous partions écrire ensemble sur nos enfances, la manière dont nos écorchures réciproques peuvent s’interpénétrer, devenir force, croiser la théorie et nous apprendre des choses.
Tu dis. On pourrait observer comment nos outils conceptuels sont imprégnés de nos vies, comment nos récits intimes et nos théories s’imbriquent, à la manière de nos pensées et de nos systèmes nerveux.
Tu ne me proposes pas une thérapie détournée, il ne s’agit pas de ça, mais tu veux qu’on avance ensemble, qu’on trouve des pistes. La théorie ça ne te suffit plus, il faut aussi de l’art.
Tu ajoutes. On se rejoindra ensuite au festival d’Avignon ? Comme ça, je commencerai à rencontrer tes ami·es.
Tu dis aussi que tu cherches à te désidentifier de ta posture d’ethno-anthropologue, que tu as besoin d’élucider quelque chose en toi et que tu te sens violent.
Je m’oppose tu es la personne la plus adorable qui soit. Tu hausses les épaules. Je viens de tomber dans l’écueil du premier degré naïf. Désolé, c’était une tentative maladroite de te faire un compliment.
Tu dis. Cette posture d’autorité, cette violence symbolique que je porte en moi, me dégoûte. J’exerce une contrainte sur mes étudiant·es. Mais aussi sur toi. Quand ça me saute trop aux yeux, j’ai envie de me faire du mal.
Ça crée un blanc. Mais je sais que tu es entré dans une boucle et que ça va reprendre : en ce moment tu me confies régulièrement cela, que tu pourrais te faire du mal. Pour contrer cette pulsion, souvent tu as besoin de l’insouciance provoquée par la fête. Tu as besoin de t’oublier dans le lâcher-prise, quand moi, j’aspire à éloigner la peur.
Je sens que ma parole ne va pas faire le poids : c’est toi le tribun. Je sens aussi qu’on en arrive à ce point où on ne pourra être qu’au-delà ou au-deçà des mots.
Je saisis ton poignet, je te murmure à l’oreille. Je veux ta main au plus vulnérable de moi, sur mon ventre.
Au début c’est douloureux et désagréable, comme une coupure. Mais je combats mes réflexes, je ne me débats pas dans mes propres remous internes.
J’ai envie de toi. J’ai envie de t’étreindre, de te mettre à genoux, de te forcer à prononcer des compliments sur ton propre corps. Ta patience a su faire de moi un sujet. De désir.
Il y a d’abord ta respiration qui s’accélère, puis ton bras libre qui prend appui contre le mur. Je ne sais pas si c’est une déclaration ou un aveu mais tu murmures que tu veux être à moi et que je peux tout te faire.
Sous le tissu souple de ta tenue de yoga, j’ai accès à chaque endroit de ton corps. Ton dos. Ton torse. Ton bassin. L’intérieur de tes cuisses. L’onde sourde de ton bas-ventre qui se contracte. Je sens tes muscles, tes clavicules, ta peau, tes nerfs s’abandonner. Je sais qu’il n’y aura jamais rien de plus beau.
Phobie d’impulsion
C’est l’un de ces ponts de mai où les journées s’étirent. Toi, tu rejoins tes camarades de la Conviviale pour votre grande réunion annuelle dans les Cévennes. Moi, je prends un train pour passer le weekend chez Joey. La douceur dans l’air nous ferait presque oublier les Veilleurs, qui sont partout, même en dehors des heures de pointe. Pour atteindre le métro, on slalome entre ces âmes perdues qui nous susurrent qu’elles nous pardonnent. Je ne lâche pas ta main.
Après 4h30 de TGV, je suis chez Jo. De son bureau qui me sert aussi de chambre d’ami, on voit un coin de ciel couleur ardoise, entre les barres blanches des immeubles. Des mouettes. Cadrage minuscule, mais dont les contrastes et la lumière tourmentée ne laisse aucun doute sur mon arrivée à Brest. On passe l’après-midi, la soirée, une partie de la nuit sur le balcon à boire des bières. J’observe les habitant·es de ce quartier résidentiel et tous ces corps que je n’ai pas envie de toucher m’interpellent. Est-ce que c’est lié à l’altitude et au vide ? Sans savoir où je veux en venir, j’explique à Joey j’avance de ville en ville en essayant de ne pas laisser de trace. Je me sens traqué par mon passé et quand je dors, il me revient en rêve. J’en peux plus du sixième étage, mon lit collé à la vitre, parfois j’ai des phobies d’impulsion. Je sais que je peux lui confier ça. On se comprend. Elle me parle enfin de sa rupture avec Ju. J’suis rassurée parce qu’elle me manque.Même si ça fait toujours un peu bizarre d’être rassurée de souffrir. Et je vois très bien. On a envie de rire de nos états respectifs, Joey s’exclame je sais ce qu’il faut qu’on fasse !Un karaoké ! Jo sort les micros et on enchaîne Mylène Farmer, Céline Dion, Francis Cabrel.
Francis, je fais abstraction de ses doigts d’adulte pris sur des poignets de gosse quand j’entonne mon enfant nue sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits et je laisse les paroles me téléporter vers ce lieu fleuri et baigné de lumière orangée, où tu m’as miraculeusement réinvité.
Le lendemain, Joey doit affronter une lettre de son voisin, glissée sous la porte de l’appartement, ses compliments pour le concert nocturne et ses multiples propositions : venir chanter avec nous (étant moi-même guitariste), aider Joey à sortir les poubelles (qui sont lourdes), prendre le café (ça se fait entre voisins).
À nos retours respectifs de Brest et d’Ispagnac, on affronte plusieurs discussions complexes. Tu me tends une enveloppe. Cadeau de la Conviviale. Enfin, plutôt de toi et Eddy. Tu dis j’imagine qu’il faut bien payer le loyer, mais ça rapporte peu de travailler au contact d’ados comme tu le fais. Tu pourrais occuper un poste tellement plus prestigieux intellectuellement. Je déteste quand ça tourne comme ça, avec la lumière crue du plafonnier et la table de la cuisine entre nous. Je ne sais pas si j’accepte ou si je cède, mais je prends l’enveloppe.
Tu me regardes avec un air perdu. Tu as conscience des asymétries entre nous et tu as parlé avec maladresse. Tu bégayes que ce n’est pas possible de se sacrifier comme ça. Tu sais que je n’élève jamais la voix dans l’intimité, mais tout de même j’aurais le droit d’exprimer de la colère. Ce genre de décalage est ma hantise. Je t’ai un jour confié que mes premiers cris étaient nés dans la rue, quand j’avais fini par trouver des sœurs de colère dans les pink blocs, qu’elles m’avaient appris à prendre le haut-parleur et à mêler ma voix aux leurs. Ce n’étaient plus des cris qui annonçaient des coups, mais des armures massives. Tu te souviens de cela, tu dis je… Je crois que je ne conçois pas les liens humains de. De la même manière que toi. Toi, tu écoutes beaucoup tes émotions. Moi je suis pas sûr qu’on puisse. Qu’on puisse donner foi ainsi à un ressenti.
Tu m’as plusieurs fois montré la façade du premier immeuble où tu as habité, à ton arrivée à Paris. Durant tes trois années de licence, tu as littéralement vécu collé au théâtre des Bouffes du Nord, mais tu n’as jamais trouvé l’occasion d’y aller.
Je propose :
– On pourrait aller dîner dans un restaurant indien ce soir et passer aux Bouffes du Nord prendre des places ? Il faut absolument que tu vois un spectacle avec ce mur en fond de décor !
Notre connivence revient. Tu dis :
– On pourrait aussi prendre des places pour Étienne et Ulysse ? Mais choisissez la pièce. Moi, j’y connais rien en théâtre.
– D’ailleurs, pourquoi tu as déménagé de ce premier appartement ?
– J’avais envie de profiter d’une année de césure en Argentine, de voyager sur les traces de mon père.
À ton retour en France, tu as acheté l’appartement actuel, où tu vis depuis dix ans. Et maintenant que tu as obtenu ce poste, tu fais les allers-retours entre Paris et la fac au gré de ton planning de cours. Le pied-à-terre dans les Hauts-de-France pour le boulot, ça te fait un peu d’air frais. Ces deux dernières années, tu es moins dans l’entre-soi universitaire. Tu as l’air de croire à cette phrase.
– Et comment s’est passé le retour à Paris, après un an en Argentine ?
– En fait c’était une période compliquée, je venais de découvrir que j’étais pédé. Enfin je suis bi, mais tu vois jusqu’à 21 ans je croyais que j’étais hétéro donc là ça a été une grande obsession sur les mecs. Je plaisais facilement alors j’ai fait n’importe quoi. Chiottes publiques, aires d’autoroute, barebacking. Sexuellement, je n’étais pas capable de me protéger.
Je regarde ta silhouette frêle, longiligne. À côté de nous, sur les grands boulevards, passent la stridence d’une ambulance et quelques SDF. Je t’imagine plus jeune, les traits encore fragiles. Je veux te dire que l’on ne porte jamais le poids d’une protection seul mais pour cela il faudrait que je t’interrompe. Or, pour la première fois depuis que je te connais, je sens ta voix vaciller.
– Ils étaient deux, une sorte de coup monté tu vois et j’ai pas pu résister, ça a été très brutal, sans lub, sans capote. Après, j’ai cru que j’avais attrapé le SIDA. Enfin, le VIH. Je me suis pas mal renseigné sur tout ça depuis heureusement, mais mes symptômes en fait c’était juste une dépression…
La rage me fait serrer les mâchoires. Je voudrais aussi te prendre dans mes bras mais je sais d’expérience que l’empathie frontale ou l’effusion démonstrative, ça va pas le faire. Mais putain, c’est pas possible, sur ça aussi on s’est flairés. J’ai envie de retrouver ces deux mecs et de les buter. J’ai envie d’aller en sortie de boîte de nuit hétéro et de tabasser des gars, comme ça, en aléatoire. Qu’ils arrêtent un peu d’avoir la confiance et de s’insérer en nous. Puis je pense à Ulysse et bien sûr, je ne ferai jamais ça. Alors je me tais. Je t’écoute.
– …et je viens juste d’en sortir, c’est venu avec ma titularisation. J’ai quand même traversé des épisodes de joie, mais y’a vraiment eu peu de lumière en moi ces dix dernières années. Enfin, j’ai jamais été hospitalisé, juste un peu sous médocs parfois. Tu me rencontres au bon moment !
Oublie ça
En TD de sciences, en première, j’avais dérobé un prisme dans le boîtier du prof de physique-chimie. Le spectre qu’il produisait me fascinait. D’appart en appart, il a toujours eu une place de choix sur mon bureau. Avant de te retrouver ce samedi soir, je le glisse dans la poche de ma veste. Une sorte de symbole que je veux t’offrir pour te rappeler toute la lumière qu’il y a en toi.
Devant le bar où l’on se retrouve, tu es mutique, froid. Je regrette d’avoir choisi ce lieu surpeuplé. Clairement pas l’idéal pour ton anxiété sociale. J’essaye de savoir comment tu te sens et tu esquives mes questions. On passe cette soirée ensemble pour fêter l’obtention de ton master, on n’est pas en thérapie de groupe.
D’ailleurs, tu vas bien. Je ne dois pas faire attention à ce que tu dis les vendredis soir car tu es épuisé de ta semaine. Les choses sombres qui ont pu t’échapper ne sont pas représentatives de ce que tu penses. Mais vraiment pas du tout. Oublie ça.
Je reviens du comptoir avec une bière et un cidre. Il y a un regret sincère, mais aussi de l’agacement, quand tu m’annonces que tu ne pourras pas venir me voir à Groix, en août. Tu dois profiter de ta double nationalité, de ton passeport argentin, puis tu veux renforcer tes liens avec la partie de ta famille restée à Copenhague. Toute l’année, tu as suivi des cours de Danois avancé dans cette perspective et l’été est la seule période où tu peux un peu te laisser aller.
Je rentre seul ce soir-là. Je pense à Claire qui enchaîne parfois 18h de garde aux urgences sans moufter. Je pense à mes weekends d’astreinte, aux mails pros auxquels moi aussi je réponds passés 23h. Je pense à Ludo qui est surqualifié pour tous les tafs de merde qu’il enquille, parce qu’on peut pas faire la fine bouche quand on est travailleur handicapé.
Je pense aux anecdotes de tes ami·es l’été dernier, sur la manière dont leurs profs les préparaient aux classes prépa dès l’entrée au lycée. À ta mère qui t’a expliqué ce qu’était un doctorat alors que tu étais encore collégien. Je sers nerveusement un objet dans mon poing : le prisme est toujours dans ma poche. Je me sens ridicule.
Le lendemain, tu me demandes de te rejoindre chez toi. Tu m’informes que tu as réfléchi au planning de la semaine d’écriture que tu m’as proposé dans les Cévennes. Comme tu veux avancer sur la rédaction de ton HDR, tu souhaites lui donner un angle plus intellectuel.
Tu as échangé avec ton associée. Selon elle, l’écriture intime desservirait ta carrière. Ce serait finalement mieux d’organiser un séminaire informel avec certain·es de tes collègues et ami·es. Tu souhaites me les présenter depuis longtemps. Tu es sûr que j’y trouverai aussi mon compte. Durant tout cet échange ton visage est fermé, embarrassé : tu ne publies pas assez en ce moment. Je voudrais te redonner le sourire, me concentrer sur cet objectif, mais un malaise diffus gagne ma colonne vertébrale. Je veux bien qu’on réfléchisse ensemble au séminaire que tu souhaites organiser, mais je n’arrive plus à trouver de connexions entre ce que tu écris et le terrain. Je marche sur des œufs. Je tente, prudemment :
– Tu m’as dit que tu voulais mener une démarche réflexive qui décloisonne les différents niveaux de savoirs. C’est pas trop ce que je perçois dans ce premier jet. On dirait que la présence d’éducateurs est ajoutée artificiellement au panel d’invité·es.
– J’ai l’impression que tu me reproches de ne pas assez m’intéresser aux réalités des travailleurs sociaux ?
– Je te reproche pas de…
– Je n’ai pas dit que tu me reprochais, j’ai dit que j’en avais l’impression.
– Je voulais juste souligner que le dispositif envisagé, en tout cas ce que j’en comprends en te lisant, ça leur demande un grand effort de déplacement.
On tire chacun sur les fibres d’un tissu fragile, un tissu qui opacifie et englue notre conversation. Pour l’instant, on se rejoint dans cette béance sans basculer l’un en dehors de l’autre. Mais quelque chose s’est déchiré et tu es blessé. Je connais tes engagements. C’est évident que tu as besoin de personnes rigoureuses dans leur discours. Déjà familières du vocabulaire anthropologique et des cadres universitaires. Tu es venu me chercher pour la finesse de mon regard sur les enjeux de classe. Mais ramener tout à ça, dire que les codes de la haute bourgeoisie servent de référentiel, cette fois ça n’est pas pertinent. Je ne dois pas oublier que si les savoirs queers ont pu gagner en légitimité à l’université, c’est grâce aux bourgeois que je suis si prompt à critiquer. Je pointe des manquements sans savoir que d’autres travaillent déjà sur ces sujets. Ce ne serait pas honnête de leur entrer en concurrence. Et ce désir de décloisonnement, c’est surtout mon affaire, puisque c’est en lien avec mes préoccupations professionnelles. Je peux proposer des pistes.
Non.
– C’est pas mes préoccupations, je suis là pour t’assister.
Tu veux comprendre notre différend, tu me bombardes de questions. Tu m’entraînes dans ton bureau, tu allumes ton ordinateur et le second écran. Je remarque que tu bégayes beaucoup. Plus que d’ordinaire. Je t’ai troublé, tu es mal à l’aise. J’essaye d’apaiser l’atmosphère, j’adopte les mêmes réflexes qu’avec les enfants dont je m’occupe, quand ils semblent en surcharge émotive. Je me maintiens un peu de profil pour qu’on puisse se parler sans se regarder dans les yeux.
Pour apporter de la consistance à mes réponses, j’évoque les leviers que j’utilise dans mon asso, notamment les pédagogies féministes et queers qui sont le squelette des modules de réflexion que l’on propose.
– Lors de la dernière formation professionnelle que j’ai pu donner, on a questionné les angles morts de l’expression infantiliser, souvent utilisée pour dénoncer les attitudes sexistes. On a commencé un manifeste de ce que serait une lutte féministe qui porterait les droits des enfants comme cause majoritaire.
La lumière est trop vive et je n’ose pas te le dire. Tu me relances.
– On a aussi composé le portrait-robot de ce qui est actuellement le lanceur d’alerte idéal, quand il est question de violences faites aux enfants. Intuitivement, on pourrait penser que les porte-paroles que l’on retrouve dans les médias sont des femmes, ce serait en cohérence avec leur surreprésentation dans les événements militants. Mais, en se basant sur un an de coupures de presse, on a observé qu’un procureur, un chef d’entreprise et un sportif de haut niveau se partagent le podium. Trois hommes blancs à la mâchoire carrée et aux épaules larges, souvent pris en photo en costume trois pièces. Les valeurs de virilité saine qu’ils représentent, je pense que ça arrange tout le monde…
Tu écris dans un carnet. En fonction de ce que j’esquisse, tu reprends tout ou partie de mes exemples ; tu reformules ; tu me lis tes notes pour vérifier qu’elles sont fidèles à ce que je tente d’exprimer. J’essaye de me concentrer pour ne perdre aucune des ramifications de mes pensées, je cherche à épurer mes explications pour ne pas te noyer de détails ou d’explications qui ne concernent pas ta problématique.
– …l’un d’eux a fourni un témoignage très détaillé sur ce qu’un proche de sa famille lui a fait subir. L’agresseur est un homosexuel placard qui l’a violé plusieurs fois avant sa puberté. Ce témoignage est essentiel, mais n’est qu’une réalité parmi d’autres. Les médias qui se refusent à écouter la pluralité des récits ont une responsabilité quant à la petite musique que ça envoie, que les violeurs seraient des hommes complexés aux sexualités déviantes. En passant sous silence les viols par opportunisme, les agressions des bons pères de famille insérés socialement, ils ne remettent pas le système hétéropatriarcal en question.
J’ai les yeux irrités, la gorge sèche, je suis incapable de mesurer le nombre d’heures écoulées, où l’on reste assis côte à côte, toi notant sur ce carnet en posant question sur question, moi racontant jusqu’à des faits confidentiels qui ne sortent d’ordinaire jamais des murs de la MECS.
Comme dans un jeu de chaud et froid, le ton de ta voix me guide vers la bonne direction. Il n’est plus sec mais encourageant. Parfois tu complètes oui, ça c’est justement une idée que j’ai eue en discutant avec toi.
Il y a longtemps eu une habitude entre nous : ces questions que je posais, pour impulser un léger changement de trajectoire dans ton raisonnement, provoquer un second souffle dans ton argumentaire. Aujourd’hui, les rôles s’inversent. Tu me fais lire des transcriptions d’entretiens, tu m’écoutes, les plis soucieux se dissipent sur ton front et il y a de l’admiration dans ton regard. Je reçois cela comme un baume.
À un moment, tu stoppes brusquement l’échange. Tu as besoin d’une pause, peut-être ? On bosse depuis des heures.
J’ai la tête vide.
Tu dis :
– C’est toi qui devrais aller prendre la parole devant le Sénat tout à l’heure pour défendre l’ASE.
Je pouffe nerveusement. Mais, parce que tu estimes qu’on vient de dénouer un point majeur, tu me couvres de compliments.
– C’est aussi toi qui devrais animer le séminaire. Moi, je pourrais me contenter de faire la vaisselle, la cuisine, aller chercher les gens à la gare.
– …
– Quand tu résumes les concepts, tout est limpide. Tes paroles s’accordent et démultiplient le sens des choses. Moi, quand je m’exprime, c’est souvent très chiant. Le discours critique que je porte sur les choses est obscur. Au fond, ma démarche n’est pas vraiment utile. Toi, ton travail est admirable. Il fait du bien aux gens.
– …
– Quand je suis en ta présence, je ressens une connexion si forte.
Je sors de chez toi, j’ai besoin de manger. Je connais bien cet état et je sais que mon corps va trouver d’instinct la rue où tourner pour avoir la portion alimentaire la plus efficace. Menu kebab falafel, Ice Tea et tarte aux daims, je pleure en engloutissant mes frites. Le vendeur me parle, ça le met mal à l’aise les pleurs, il veut m’aider mais par quel bout prendre mes émotions ? Je lui dis c’est rien, juste trop de pression au travail. Il rigole, il connaît ça. Pour me changer les idées, il commente de manière expansive le match qui défile à l’écran. Cette technique m’est familière, je suis touché. Le décor, les sons, sortent du voile terne où mon regard les avait relégués depuis quelques heures.
Deuxième été
– Tu es déjà venu ?
– Oui, l’an dernier.
Tes invité·es sont unanimes :
– Quelle chance cette maison, c’est vraiment un coin de paradis !
Un jour tu m’as dit qu’auprès de ta mère, tu redevenais adolescent. Aujourd’hui, tu as enfilé un débardeur délavé qui doit dater de tes quinze ans et je peux parfaitement visualiser une version antérieure de toi, jouant au foot avec tes potes. C’est une chorégraphie fluide. Avec ta mère, ta tante et tes cousines, vous déplacez du bois pour l’hiver. Puis vous posez un parquet extérieur autour de la salle de danse, en prévision d’un grand rassemblement familial qui aura lieu à la fin du mois. Derrière ton image de queer dissident, tes vacances sont ponctuées de mariages, de baptêmes et de cousinades.
Ta famille s’adresse de manière vague à ta bande diffuse d’ami·es. Nous sommes tou·tes bienvenu·es et avons le droit au costume de la convivialité. Peu importe si quelques pièces du puzzle s’intervertissent ou disparaissent de saisons en saisons.
Tu proposes aux nouvelleux venu·es de faire le tour du propriétaire. Tu t’arrêtes devant une affiche punaisée, tu expliques que tu trouves la communication autour de votre fête de village un peu sexiste. J’ai déjà entendu cette histoire.
Ce lieu caniculaire me laisse dans un état ambivalent. Malgré cette étrange mélancolie, je suis si fier d’être une personne qui revient.
La semaine précédente, tu as rappelé par mail à l’ensemble des convives les modalités du séjour. Chacun·e fera à sa guise mais, pour toi, il s’agit de journées d’étude. Tu comptes te lever tôt pour écrire avant que la canicule n’anesthésie la pensée. Tu souhaites manger à heures fixes et plutôt légèrement, faire une sieste l’après-midi et lire, être présent pour échanger le soir.
La blague initiale se transforme en réalité : selon les villes de départ, tu établis les feuilles de routes jusqu’à la maison de ta mère, tu organises les menus sur un Google doc pour que l’on puisse inscrire notre participation aux recettes qui nous inspirent.
Tu ne veux pas, comme les années précédentes, qu’un temps considérable soit dilapidé dans la cuisine.
Tu reviens d’une semaine de jeûne et de méditation, la nourriture te désintéresse et parfois elle te dégoûte.
Je te rassure. S’il le faut, je rappellerai à tes collègues les horaires, les temps de préparation, les achats de petite épicerie. Ne t’inquiète pas.
Une fête d’anniversaire
Tu recherches le danger dans mes attaches, que je cesse de suivre le mouvement physiologique de tes articulations et que je serre plus fort. Le désir déborde des chambres pour le lit de la rivière, le parquet sous les vignes grimpantes, la fraîcheur de l’ombre à même le sol.
J’ai passé des mois à vouloir découvrir le goût de tes crachats et de ta merde, maintenant je les connais par cœur. Tu demandes ma langue, tu demandes mes doigts profondément en toi, que je te saisisse à la gorge. À la fin d’une séance, tu t’abandonnes contre mon torse, les membres engourdis.
Je renifle le sol puis tes jambes, imprégnées des odeurs du jour : chlorophylle, argile et soleil. Je te renifle, j’expérimente ce jeu de piste de la terre à ton corps. L’odeur de chaleur, de résine et de poussière. L’odeur de la bordure du Tarn. Ses résidus dans la toison des aisselles, ses traces desséchées dans le pli de l’aine ou le creux de tes bras. Je te salive et je te mords comme le chien que je désire également être. Tu dis fais-le, va plus loin. Tu n’es excité que par les personnes sûres d’elles-mêmes, alors je fais au mieux pour l’être. Je veux rester dans tes plis, désaseptiser ton cul, lécher toutes les particules épousant ton épiderme, les débris organiques, l’humus, tes poils. Tu répètes que je peux aller plus loin.
Bien que cela ne te ressemble pas, tu abandonnes plusieurs fois tes recherches scientifiques et tes routines d’écriture. Ton énergie est basse, tu t’autorises une matinée improductive. Tu désires simplement rester au lit avec moi.
– Ce concours entre apiculteurs locaux a lieu tous les ans, c’est pas très grave si on le rate, on s’y rendra sans faute l’an prochain.
– Oui, et puis je finirai par en avoir marre du miel des Cévennes.
L’après-midi, on se cache dans la cabane sous les arbres, où personne ne va jamais. Je dessine au khôl des fleurs sur ta peau, autour de mes morsures.
Cette nuit-là, je me réveille en sursaut. Tu es là. Ta respiration est là. Son rythme lent et lourd. Ton corps longiligne lové contre le mien.
Ils sont si loin, ces temps où la terreur me glaçait l’estomac, quand d’autres corps s’endormaient près de moi, que je tentais d’étouffer des sanglots compulsifs.
Je me suis souvent demandé pourquoi tu étais revenu vers moi. J’ai souvent cru que tu regretterais de m’avoir invité de nouveau. Que le jour où tu me l’avais proposé, tes mots avaient simplement dépassé ta pensée. Ou que tu l’avais fait par politesse. Que tu finirais par trouver une manière élégante de me décommander.
J’avais été si inadapté à la situation l’été dernier. J’avais acheté des trucs de merde au Super U, des terrines végé, des infusions bio. Quand j’avais vu le standing de ton garde-manger, j’avais préféré que tout ça reste caché dans ma valise.
On voudrait que l’autre nous comprenne, nous connaisse par cœur, mais pour cela il faudrait imaginer qu’un système de vidéosurveillance ait archivé les violences inouïes de mon enfance. Il faudrait imaginer que tu sois prêt à consacrer du temps au visionnage de ces bandes magnétiques. Il faudrait imaginer que je sois capable de te laisser faire, au lieu d’appuyer sur reset. Je ne te laisserai jamais faire.
La dernière chose que je souhaite, c’est te voir t’approcher de ce puits d’horreurs. J’aime que tu ne sois pas abîmé à cet endroit. J’ai peu confiance en moi, mais je suis fier de cette capacité : t’avoir préservé.
J’ai trouvé un foyer érotique dans la proximité de nos peaux. Je sens le poids de cette réalité densifier mes os. Les hachures des derniers mois me semblent balayées mais tu n’es pas mon salut. Tu n’es pas mon salut et je refuse de baisser la garde. Je crains trop de devenir poreux, de te laisser entrevoir tout ce que je ne te dis pas. Ce que je ne te dis pas de ma colère. De ma haine parfois pour ce que me font tes yeux. Dans ton admiration, dans ta tendresse, tu fais erreur sur moi. Tu fais erreur alors que tu es si lucide, si brillant d’ordinaire.
Pour prendre soin de notre lien, souvent il faudra que je te garde à distance. Il faudra que j’aille courir, frapper dans des sacs, soulever de la fonte. Que je parte loin, là où la rage ne pourra rien me faire dévaster. J’ai le devoir de te préserver des violences qui ont forgé ma vie avant même que je n’aie d’envies propres. Aucune de mes envies n’est propre. Comment nettoyer mon désir ? Comment le rendre net, acceptable ? Quel programme utiliser ?
Bien sûr, je voudrais faire crever les flashbacks, je voudrais en faire des baudruches qui explosent en plein vol. Mais la bonne volonté ne suffit parfois pas. Il faut nous résigner à faire de nous des inconnus intimes. Pour me faire pardonner, je protège ton sommeil et j’embrasse ta peau.
Tout ce qui fait souffle en toi la manière dont tu respires quand tu as enfin atteint une phase de sommeil profond et c’est rare en général tu dors peu tes yeux ton cul tes humeurs tes reins l’espace entre ton nez et tes lèvres tes paupières ton bassin tes cuisses ton pubis tes jambes tes lobes d’oreille ton conduit auditif ta nuque tes orteils tes chevilles tes genoux tes hanches ton goût tous les goûts de ta peau bien plus que l’apnée de cette énumération. Des courants d’arrachement contre lesquels il est inutile de lutter.
Pour te laisser travailler sans distraction, j’accompagne ta tante jusqu’au centre-bourg. Elle me confie : l’odeur de la maison, elle ne l’a jamais retrouvée ailleurs. Les poutres sculptées par le temps, la suie du poêle à charbon, les bâches, la cire des bougies, la fraîcheur des pierres. Les yeux fermés, elle sait où placer sa main entre les pierres pour récupérer la clé dissimulée. Elle connaît les craquements du bois et les rayons de lumière obliques pris entre les volets à l’heure de la sieste. Elle dit que franchir l’orée de ce chemin, c’est passer un portail temporel.
C’est la seule personne de ta famille qui me vouvoie. En disant ces mots, elle me prend le bras comme le font les enfants et les vieilles dames.
Je pense à la guerre en Syrie, à la dernière réforme, aux posts militants dénonçant des tortures que je ne lis qu’à moitié. Je dis le peu de raison de se réjouir, faut s’y agripper sans trop douter.
Pour mon anniversaire, tu m’emmènes dans un festival féministe au fin fond de la montagne, où tu es sobre et où je danse torse nu contre toi. Tu suis, de la pulpe de ton index, les lignes encore boursouflées sur ma peau. Tes doigts en redessinent les courbes, électrisent mes cicatrices. J’improvise et tu guides, nos corps se cognent, la paume de ta main se plaque sur mon sternum, les transferts de poids bousculent nos centres de gravité.
Tu murmures tu es beau. Moi, je t’aime. Au petit matin, nous rentrons par la route intérieure, celle qui traverse la montagne et nous fait longer la forêt. Nous croisons des biches, des renards. Le temps s’étire, tu conduis avec cette douceur alanguie que tu adoptes souvent avant le sexe. Ta voiture est mon foyer.
En fin de matinée, en gare de Mende, nos au revoir sont évidents, confiants. Je vais faire une escale improvisée à Nîmes pour déjeuner avec une amie perdue de vue depuis le début du lycée, puis je retrouve Ludo, Myriam et Joey à Avignon. Tu prévois de nous y rejoindre dans quelques jours. Malgré cette nuit blanche, je me sens très en forme. Pour la première fois de ma vie, j’ai trouvé un ancrage.
Ce que je ne peux pas te dire
Stéphanie avait été la meilleure amie de Samaëlle, de ses six ans à l’entrée en seconde. Elles s’étaient construit un monde fantastique et précis, à base de monstres et de princesses. Elles s’y retrouvaient à chaque temps libre, dans la cour, sur le chemin de la salle de sport, à chaque récréation. Ce fut la relation la plus fusionnelle de son enfance, ensuite Ulysse était né et avait pris toute la place.
Stéphanie, mère de deux enfants, m’attend sur le parking d’un restaurant asiatique formule illimitée, dans un vertigineux bond temporel.
Ce genre de lieu, ce serait tellement ton angoisse. J’ai ta voix en tête, ta manière polie de décliner. Je suis trop éloigné de la pratique sociale des lieux de restauration rapide. Je serais complètement inadapté. Je souris, je crois que tu me manques déjà.
Stéphanie n’a pas changé et sa fille lui ressemble. Elle m’a ajouté sur Facebook il y a quelques années. On en restait à un cœur sur les photos de ses vacances, un message sur mon mur à chaque anniversaire. Cette année, elle a ajouté que j’avais l’air d’être en vacances très près de chez elle, que si jamais je passais par Nîmes elle aimerait beaucoup me revoir.
On s’embrasse affectueusement, elle n’arrive pas à me genrer au masculin et s’excuse. Moi, je m’excuse de procurer cette gêne en elle. Elle dit, c’est parce que je ne t’ai pas revu·e depuis tout ce temps. Mon souvenir de toi, c’est une adolescente, ça reste gravé comme ça mais.
Elle me présente sa fille : justement ce matin Billie me demandait si j’avais une meilleure amie et je lui disais que j’en avais eu une, quand j’avais son âge. Elle se tourne vers l’enfant. Tu vois c’est Samaël·le, je te présente mon ami·e.
Billie tournicote ses boucles brunes, gigotte. Je lui fais un petit signe de la main puis elle part au coin jeu inspiré des piscines McDo remplies de balles en plastique.
Stéph s’est séparée de Grégory, ils s’étaient vraiment mis en couple trop jeunes et elle vient de rencontrer un nouveau gars, un prof d’EPS. Sa mère sait qu’on se voit aujourd’hui, elle me salue, elle aimerait m’inviter à déjeuner une prochaine fois. Je dis pourquoi pas, ça m’arrive de plus en plus de venir dans ce coin désormais. Son frère a été hospitalisé. Un long processus jusqu’au diagnostic. Une schizophrénie. Elle a deux enfants, Billie et Romain. Romain c’est compliqué, c’est un enfant différent, il est dans son monde, il est merveilleux mais c’est difficile avec l’école. Les cases. Les pourquoi sans réponse. Les échanges avec l’instit parfois ça la fait pleurer. Et toi, ta famille ?
Moi, et bien Ulysse va bien, il entre en terminale. Stéph s’exclame c’est fou, je l’ai connu bébé. Oui, c’est presque un adulte maintenant, il fait sa première colo comme animateur BAFA cet été.
Je fais bref. J’ai coupé les ponts mais y’a quelques mois j’ai plusieurs fois dû retourner dans le bassin minier pour vider la maison d’enfance, suite à l’hospitalisation de mon père. Ça a pas été simple.
Stéph dit qu’elle se doute. Que ça a dû être bien pire que pas simple. Je sens qu’elle n’est pas là pour faire du small talk et tant mieux, je suis nul avec ça.
Qu’elle se souvient d’un de mes anniversaires où elle avait été conviée et même s’il n’y avait pas eu de vague, elle s’était sentie comme une marionnette. Vladimir, il aimait bien tirer les ficelles quand même.
Elle dit aussi qu’elle en parlait beaucoup avec sa mère, que cette dernière l’avait écartée de ma famille pour la protéger mais que moi, je n’avais pas eu cette chance.
Je dis je sais plus trop, je crois qu’on avait décidé de dormir sous tente car c’était les vacances, on avait nos walkmans, on avait voulu danser. Ça a toujours été flou pour moi cette période.
– Oui, on avait dormi sous tente, on n’avait pas bien choisi notre jour. Quand il a commencé à tonner, on a décidé de rentrer. Moi, ma mère m’a accueilli les bras ouverts. Toi, tu n’as pas eu cette chance.
Cette expression, tu n’as pas eu cette chance, qu’elle répète deux fois en si peu de temps, me glace le dos.
Elle dit qu’elle entendait de sa chambre ce qui se passait dans notre maison. Qu’elle entendait les hurlements de mon père à travers les murs. Et les miens. Elle dit que j’ai complètement été passé à tabac cette nuit-là. Que mon grand-père était aussi présent et que peut-être avec lui il y a eu autre chose. Des cris plus étouffés. Qu’ensuite pendant plusieurs jours personne ne m’a vu et que sa mère a hésité plusieurs fois à appeler la police.
Oui, je crois que je vois à quoi elle fait allusion. Au fond, j’ai toujours senti que ce soir-là avait existé.
Elle dit qu’elle est désolée de pas avoir été là pour m’aider. Que j’étais sa meilleure amie et qu’elle m’a abandonné. Qu’elle y a repensé souvent après avoir déménagé. Qu’elle ne sait pas si elle se remettra un jour de cette sensation de trahison.
J’ai une sensation de trouble, comme avant un malaise vagal. Tous ces adultes qui gravitaient autour de nous, les instits, le médecin de famille, les voisin·es, personne n’y trouvait rien à redire.
Comme ma prof de français de troisième, que j’aimais beaucoup au demeurant. Toi, Samaëlle, tu es une personne qui aime la famille, je t’imagine bien, plus tard, présidant une grande tablée avec tes grands-parents, oncles, tantes, enfants, neveux et nièces. Cette réplique, vraiment.
Au point qu’ensuite, j’arrivais plus à parler de mon enfance. Ce n’était même pas une question de tabou, juste un truc inexistant. Des perceptions parfois, mais en lesquelles j’avais si peu confiance. Je résumais par un j’ai pas l’impression d’avoir eu d’enfance. Et pour certaines années c’était littéralement ça : la page blanche.
Pretium doloris
La tête contre la vitre, je souffle. J’aime bien les voyages en train mais au cours de celui-ci, je me sens particulièrement épuisé. C’est une sensation qui tiraille douloureusement l’intérieur de mes membres. Il y a aussi de la confiance qui revient, concernant mes sensations, mes souvenirs, la fiabilité de mes perceptions.
Je m’assoupis vaguement, mon cerveau m’envoie des visions de sédiments, de glaise, de sables mouvants et tous ces autres composants qui forment des vices de forme dans mes fondations.
Il y a aussi le visage de ce garçon, Dimitri, qui me revient comme une fulgurance. Dimitri était dans ma classe en cinquième. Durant un an, nous avons partagé un espace commun de sueur, de bruits, de corps bousculés et de punitions collectives. Nous étions l’indifférence même l’un pour l’autre.
Un matin, devant le collège, il a marché dans ma direction, il a introduit ses doigts en moi à travers mes vêtements, puis il a continué son chemin. Je ne pense pas que ses doigts aient éprouvé du plaisir par ce geste.
Je ne me souviens pas des émotions qui m’ont traversé à l’époque, je me souviens d’une envie de hausser les épaules quand son geste me revenait en tête, parfois des années après.
Je l’ai plaqué au sol pour lui piétiner la main. Le lendemain, il est arrivé avec un plâtre, il était tombé dans les escaliers.
Ce genre d’incident m’a poursuivi en vieillissant, mais j’ai arrêté d’exploser des os, je crois que j’étais devenu trop indifférent. Puis aucun os brisé ne remplacera ma déception d’avoir sous-évalué ce que méritaient les doigts du grand-père.
Pour mon premier CDD, j’ai voulu mettre quelques centaines de kilomètres entre mes géniteurs et moi. J’hébergeais mon frère durant ses vacances scolaires. À la fin du mois d’août, il a explosé en larmes parce que l’année précédente il ne savait pas à quoi s’attendre alors il avait tenu, mais que c’était plus possible.
Je l’ai pas ramené chez nos parents, je crois que ça a brisé le cœur de notre mère. Le Noël suivant, elle nous a écrit qu’elle avait mis le couvert pour quatre, avec des photos de nous dans nos assiettes vides.
À l’époque, je gagnais 1200 euros par mois. Quand j’enlevais le loyer, les charges, l’assurance, l’abonnement internet et téléphonique, nos Pass Navigo et les 30 euros d’assurance vie que ma banque m’avait forcé à souscrire en échange d’un prêt à la consommation pour éponger mon découvert, il me restait 80 euros.
C’était inenvisageable de sacrifier le montant de notre budget bouffe mensuel pour me permettre une séance psy, j’étais pris à la gorge. Je suis allé à une permanence administrative du CGLBT, un·e bénévole a monté pour moi tout un plan de bataille, m’a mis en contact avec une assistante sociale. J’avais trop fait de prêts pour éponger des découverts, trop enchaîné les jobs non déclarés qui me détruisaient le dos. J’avais trop peur. Alors j’ai accepté d’entamer un combat judiciaire. Pour débloquer de la thune, une demi-part supplémentaire ou je ne sais quoi lié au quotient familial.
Au tribunal, ça a été un calvaire, mes géniteurs étaient perdus dans ce décor institutionnel de téléfilm du dimanche soir, ça n’a rien réparé, ça les a humiliés pour des mauvaises raisons.
Moi, j’avais si peur des expertises psychologiques auxquelles je me suis soumis. J’ai dit la vérité, mais pas la réalité. Les menaces de mort à la hache, à la machette, avec tout le voisinage impassible, ça ne me semblait pas réaliste. Le seul truc qui comptait, c’était de sortir Ulysse de là.
Peu à peu, les fantômes du bassin minier partent s’occuper entre eux et je me concentre sur les paysages changeants, la douceur vallonnée de la Provence. C’est loin de l’océan, mais c’est quand même super joli cette région.
Les prochains jours, ça va être si excitant de retrouver les camarades. Le Festival d’Avignon, c’est un des marqueurs symboliques de mes étés et je suis habité par ces retrouvailles. Étienne présente sa nouvelle créa dans le In et Joey joue Que la honte change de camp durant tout le mois, dans le Off. Ludo nous a fait un planning resserré et exaltant. Il n’y a jamais que dans l’effervescence des voyages — ces voyages qui m’emmènent d’un être aimé à l’autre — que je me sens chez moi.
Avignon
Un jour, en classe, j’ai compris que le mot pensées désignait à la fois ma fleur préférée et les rêves qui me traversent. Cela a été mon premier souvenir conscient de poésie. À l’adolescence, le théâtre a été un point de bascule similaire. Une manière de dire les choses qui s’infusait en moi comme une brûlure et comme un baume. Je me rappelle avec précision du premier siège en velours rouge dans lequel je me suis assis. C’était à la Comédie de Béthune et j’avais 14 ans. Le spectacle s’appelait La chasse aux rats. En raison de la nudité de deux des interprètes lors de la scène finale, notre prof de français avait dû batailler pour que la sortie scolaire ne soit pas annulée. J’ai longtemps été hanté par cette pièce sur la marginalité et le rejet, j’avais l’impression que l’amour ne pouvait se vivre que comme cela, dans le no man’s land d’une décharge publique, entre deux inconnus un peu ivres.
Dans la cité des papes, mes émotions s’entourent du même feu apaisant, entre nostalgie et exaltation au présent. J’ai besoin de marcher seul dans les rues sinueuses avant de rejoindre mes ami·es, d’éprouver l’ombre de certains bâtiments, les recoins d’escaliers où d’années en années je me suis blotti pour tenir le journal de bord des spectacles que je découvrais. Ces chroniques, c’est mon journal intime. Je ne sais pas à partir de quand j’ai commencé à faire cela, un jour je t’en ai fait lire un bout et tu as dit ton écriture est comme un minéral brut à l’intérieur duquel il y aurait des éclats de diamants.
Parfois, quand mon corps est loin, plongé dans quelque chose d’opaque et de résistant, je sais que le théâtre me permet de remonter. J’ai attendu des heures pour Steven Cohen, Angélica Liddell, Pippo Delbono ou Trajal Harrell. J’ai enduré de longues apnées auprès d’elleux. Puis j’ai repris mon souffle, je me suis reconnu.
J’arrive devant le café où j’ai rendez-vous avec Ludo, il me tend un cadeau. Je déchire l’emballage au son de ses joyeux anniversaire et découvre le Popples vert de mon enfance. Il ne me laisse pas le temps d’être déconcerté et enchaîne avec un ton faussement mystérieux je l’ai retrouvé sur une plateforme numérique de niche qui propose des ventes aux enchères… Ebay. Cette peluche vintage est parfaite. Je suis si ébahi que j’accepte tous les tracts qui me sont tendus. J’en suis déjà à cinq promesses mensongères d’achat de place pour des spectacles aux titres plus que douteux. Ludo est radieux, on rejoint Joey et Myriam pour une soirée drag au cabaret du Rouge Gorge.
S’abandonner
Les mots s’assèchent jusqu’à s’effriter, ma vue se brouille, une très grande lassitude pétrifie mes muscles.
J’ai pris le temps cette fin de semaine — marquée par les préparatifs des noces d’argent de ma tante à Ispagnac — pour digérer notre nuit de jeudi dernier et ta déclaration d’intérêt romantique.
Je me rends compte trop tard que tu as investi notre relation d’une intensité que je ne suis pas en mesure de suivre et d’égaler.
Quand j’ai commencé à sentir ce problème, je crois que j’ai pensé qu’une distance provisoire permettrait de stabiliser notre relation à un niveau d’échange intellectuel qui nous conviendrait à tous les deux.
J’ai fait glisser notre relation d’un registre à un autre, certes sans ouvrir d’espace de discussion sur les implications de cette évolution, mais je pensais que tu comprendrais.
J’ai commis une erreur dans ma communication car, à l’attitude que tu as en ma présence, je constate que tu ne saisis pas du tout.
Je constate aussi que je réagis à tes désirs de connexion émotionnelle par un besoin salvateur de prise de distance.
Je fais le constat que j’ai toujours autant d’intérêt aux conversations intellectuelles avec toi, mais que je ne me sens actuellement à l’aise dans aucun autre registre relationnel.
Je m’effondre au pied du Palais des Papes. C’est moche, je transpire d’angoisse et de la morve reste sur mon visage.
La boue revient dans mes poumons, presque rassurante. C’est un mélange connu de sécrétions, de violence, de honte, qui a construit ce que je suis.
Tu disais. Je parle comme un bourgeois, je vis comme un bourgeois, n’hésite pas à me le faire remarquer si parfois c’est inconfortable pour toi. C’est vraiment OK que tu me remettes à ma place.
Les personnes que tu m’as présentées ne garderont pas de lien avec moi et aux dernières nouvelles, tu collabores avec une jeune salariée de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Grâce au retentissement médiatique de tes recherches sur les violences systémiques que subissent les enfants trans et intersexués, le gouvernement sera forcé de nommer une commission indépendante pour enquêter sur les dysfonctionnements administratifs et médicaux lors des signalements. Lettre ouverte à l’appui, tu refuseras le compromis d’un poste de consultant au sein du ministère. Ton obstination à l’endroit du contre-pouvoir contribuera à faire débloquer des fonds d’ampleur pour ce qui deviendra, selon la novlangue de l’époque, une cause majeure du prochain quinquennat. Tu seras — c’est mérité — l’un des intellectuels de référence pour la pensée queer intersectionnelle.
Photos de famille
J’ouvre les cartons qu’on est allés récupérer avec Ulysse, l’hiver dernier. Ces reliques ressemblent à celles qu’on trouve dans les spots d’urbex. On voit encore le logo publicitaire des caisses à endives sous les couches de peinture blanche premier prix. C’est tout à fait mon père, d’avoir essayé de faire quelque chose avec du rien. Du côté polonais, je ne dispose que de quelques fragments, des paroles rapportées. Mes grands-parents traversent l’Europe à pied et arrivent en France avec une valise en carton. Victoria passe sa vie à vouloir repartir. Enceinte à 45 ans, elle essaye de faire passer le bébé. Mais il passe pas. Il est chétif. Il ne cesse de réclamer de l’attention. Elle ne peut pas, elle tire le rideau, s’enferme dans le noir de sa chambre, puis dans des hospitalisations répétées. Elle meurt dans un asile psychiatrique du Pas-de-Calais, alors que Vladimir est adolescent. Casimir, lui, est mineur de fond et assistant boucher. Son entourage considère qu’il se dévoue au chevet de son épouse. Une vie de sacrifices. La silicose l’emporte quelques années après le décès de Victoria. Je regarde ces tirages sans savoir quoi en faire. Je n’ai jamais confectionné d’album et n’ai aucune photo accrochée au mur. Tout tourne. Ma mère qui veut se jeter dans le canal — ça ne vous dérange pas de rester là, à le regarder me dire des insanités ? —, les réponses de mon père – elle a encore fugué, allez la chercher ! Elle vous structure à sa psychose depuis longtemps et maintenant c’est cristallisé —, toutes les fois où il nous a insultés parce qu’en rentrant de l’école nous n’allions pas fabriquer des parpaings dans l’arrière-cour pour construire des pièces supplémentaires.
Je m’attaque à une autre caisse. Les souvenirs reviennent en flashs : cette punition lors d’un cours d’anglais, en CM2, parce que je n’avais pas ramené de photos de ma maison pour le lexique qu’on allait constituer. Les blessures auto-infligées quand ma rage me submergeait. Le jour où je me suis frappé trop fort. Durant des semaines j’ai porté un bandeau pour cacher la plaie sur mon front.
Pendant longtemps, j’ai cru que je n’avais rien à raconter parce que je n’avais pas d’Histoire. Désormais, je voudrais sortir du cadre.
Je déverse sur mon lit le paquet d’images provenant de la branche italienne. Le grand-père maternel, Benito, viole tout ce qu’il trouve sur son passage : sa propre sœur ; puis Elvire, une adolescente orpheline qu’il épouse en réparation ; puis leurs enfants ; puis les enfants de leurs enfants. Il fuit ses Pouilles natales avec sa jeune épouse enceinte, forcée d’abandonner ses souvenirs. Ils échouent dans un baraquement, près de Lens. Entre deux accouchements, Elvire fait les trois-huit à l’usine. Elle a déjà l’air très vieille quand ma mère est enfant. Elle perd son dernier-né en couche et reste hospitalisée de longues semaines. C’est à ce moment-là que des Témoins de Jéhovah l’approchent. Elle finit sa vie entre maladie d’Alzheimer et lecture compulsive de La Tour de Garde.
Je sais peu de choses de la rencontre de mes parents. Maria-Dolores est passée sans transition des bras de Benito à ceux de mon père, Vladimir, qu’elle rencontre lors de son premier job d’été, à 18 ans. Lui, vit alors chez un agriculteur qui l’a engagé comme main-d’œuvre, en échange du gîte et du couvert. Dans le grenier où il dort, quelques livres sont entreposés : Dolto, Nietzsche, Libres enfants de Summerhill, Wilhelm Reich. Au fil de ses lectures, il s’invente jardinier, redresseur de torts et de boutures. Il a six ans de plus que ma mère, il est très investi comme bénévole auprès des Francas, il fait partie de l’équipe d’organisation du camp d’été où ils se rencontrent. Maria-Dolores voulait qu’ils soient juste amis, ils se sont mis en couple. Elle a été sa première et seule conjointe, même s’il a eu des velléités de polygamie, au moment de la naissance d’Ulysse. Il se rêvait à la tête d’une tribu, pour réparer tout ce que ses parents immigrés n’ont pas pu lui donner : une éducation, un titre de propriété qu’il pourra transmettre à sa descendance.
Lors de ma naissance, nous habitons dans un premier temps chez Elvire et Benito. Mon père est peut-être dérangé par le fait de vivre sous le toit d’un violeur-pédocriminel-incesteur, nous déménageons assez vite. Son choix stratégique se porte sur une de ces bâtisses vendues pour une somme symbolique, contre obligation de travaux. Quand ma mère voit la maison, elle en pleure d’épouvante : jamais on ne vient s’installer là. Quelques semaines après, ils sont propriétaires d’une ruine dans laquelle ils posent leurs valises et un enfant de 18 mois.
J’essaie de trouver une cohérence dans le peu d’éléments biographiques en ma possession. Les rares fois où je tente de raconter mon passé, mon interlocuteur me demande pourquoi ton père n’a pas fait un prêt pour les travaux ? Ou n’importe quelle autre interrogation pragmatique qui sort d’un cerveau logique. C’est vrai ça, pourquoi mon père n’a pas fait un prêt pour les travaux ? C’est vous qui avez raison.
J’essaie de répondre à ce mail que tu m’as envoyé, titré invitation colloque. Deux lignes à la tournure polie pour m’indiquer que tu dois finaliser des documents de communication d’ici la semaine prochaine. Puis ta signature universitaire, l’énumération de tes responsabilités et des liens hypertextes associés. C’est quatre fois plus long que le corps du texte.
Ton message est lisse. C’est à moi de savoir reconnaître les demandes implicites : est-ce que je vais faire le déplacement ? Est-ce qu’on laisse mon nom à côté du tien dans le programme, pour cette présentation qu’on était censés faire ensemble ? J’imagine qu’il aurait pu y avoir d’autres bifurcations entre nous, tu étais dans une phase d’hésitation quand on s’est rencontrés, désormais tu embrasses ta destinée. Tu sais tout ce que tu perdrais si tu te révoltais contre ces sujets dont tu es érudit : l’héritage, la famille, le prestige, la carrière. Tu perds pas. Avec tes collaborateurs, vous pouvez débattre longtemps sur le fait que vous n’aimez pas ces mots-là, qu’il ne s’agit pas de carrière non, plutôt d’intérêts professionnels inscrits dans une temporalité, que votre héritage vous le mettez à profit des défavorisé·es, que tes biens sont au cœur de réseaux de solidarité, ta voiture mise à disposition quand tu n’es pas en France, ton appartement parisien prêté à des réfugié·es l’été, cet investissement immobilier qui servira de logement étudiant à loyer modéré et que toutes tes relations font partie de cette grande famille queer qui étire tes mois d’août. Avec tes collaborateurs, des énarques, des normaliens, vous ne remarquez pas la désinvolture de vos serments, vous vous affrontez dans des joutes autour de vos maisons de vacances à un demi-million d’euros et de vos histoires familiales pas si faciles non, le cheminement géographique de vos ancêtres dont vous connaissez la biographie de manière poussée. Vous ne manquez pas de souligner vos neuro-atypies, le fait qu’une branche de la dynastie a un ancêtre non caucasien, qu’une maladie a fauché un destin. Vous dites que vous n’êtes pas comme les autres chercheurs en sciences sociales. Vous, vous prenez soin des savoirs expérientiels. Votre terrain a une dimension auto-ethnographique. Vous citez vos collaborations, vous n’ajoutez jamais votre signature sur le travail d’une doctorante auquel vous n’avez pas pris part. Vos explications sont très logiques, elles attendrissent et flattent. La terre ne valait rien à l’époque où votre famille a acheté et vous n’êtes pas responsables de vos naissances. Puis elles prennent au piège quand vous vrillez vers d’autres justifications : pourquoi vous avez fini par prendre du personnel de maison, mais pas comme ces bourgeois·es de droite qui exploitent des femmes de ménage sans papiers. Vous, vous payez correctement, vous avez du respect pour le travail du care et vos enfants jouentavec ceux de vos employées. Toi, tu as toujours fait très attention à la place que tu occupais dans la sphère universitaire, tu as été irréprochable sur ton vocabulaire, tu as repris des ami·es quand leurs paroles étaient problématiques. Tu uses de tes capitaux symboliques, économiques, intellectuels, de la plus juste des façons. Tes collègues disent souvent ça de toi, que tu es très généreux. Il y a sûrement une version où tu n’as fait que te montrer généreux. Où les emails que tu m’envoies sont un cadeau : tu profites des ponts de mai pour télétravailler d’Ispagnac, tu me décris les randonnées que tu fais avec ta mère, les bourgeons et les odeurs de printemps et la rivière où tu es retourné seul et je te lis en attendant le RER, après avoir raccompagné Julie à la MECS suite à son IVG médicamenteuse pour laquelle la sage-femme s’est sentie obligée de lui faire la morale.
Non. Je relis le corps froid de ton mail. Tout cela avait un sens quand c’était avec moi que tu rentrais. Quand je connaissais la fréquence hertzienne de tes angoisses nocturnes et la manière de les parasiter, la marque de biscuits au chocolat à acheter quand tu avais besoin de réconfort. Bien sûr, je pourrais répondre à ton mail et endosser une dernière fois ce cosplay de dame de compagnie. Je pourrais prendre vos armes, je pourrais incorporer cette sémiologie de classe, on co-signerait des tribunes essentielles dans Le Club de Mediapart, tribunes qui deviendraient virales pour les quelques milliers de personnes qui s’entre-suivent sur Twitter et tu serais l’intellectuel accompagné du militant terrain cercle parfait boucle bouclée théorie et pratique alors tu me tiendrais peut-être de nouveau la main en soirée dans cette micro-brasserie dj-set qui fait aussi salle d’escalade un tiers-lieu dans un quartier populaire qui a gardé son âme.
Il faut faire taire le larsen, que je respire calmement et que j’arrête de chercher tes yeux. J’ai envie d’aller manger des chips avec mes potes sur la plage et depuis quelques jours, c’est avec Hélène que j’échange des emails. Ensemble, on réfléchit à ce qui pourrait être mis en place pour avoir un accès PMR à l’auberge de jeunesse de Groix. Là-bas, ce n’est pas un lieu à moi, mais à force je préfère. Là-bas, tous les étés ces mêmes visages un peu hors-la-loi, la température parfaite de l’eau dans la douche au fond du bloc sanitaire, l’effet apaisant de la chaleur sur mes trapèzes tendus, les bruits circadiens autour de ma tente. Là-bas, sans doute qu’il y a un bout de mes fondations.
Alors, cité minière, inceste et silicose, est-ce que je dois vraiment m’accrocher à ce récit ? Pourquoi ce que mes géniteurs me lèguent devrait m’appartenir ? Pourquoi est-ce que cela devrait compter davantage que La Réalité, cet album de Raphaël qui m’a mille fois sauvé la vie ?
Si je n’appartiens pas à ces photos, je peux appartenir aux quais de gare à l’aube pour rejoindre des ami·es et des horizons voulus, je peux accepter mon inadéquation à leur monde biologique et reproductif.
Je peux aussi partager avec Ulysse notre propre album photo, celui qu’on compose à deux en nous éloignant du sordide, dans nos voyages en stop et notre vie quotidienne à la coloc, avec Étienne. Ce sont ces images-là que je veux imprimer, pour offrir à mon petit frère la possibilité d’avoir quelque chose à transmettre. Pour contrecarrer les généalogies brisées, faire notre propre récit mémoriel et le tisser à nos mondes actuels. Aller arracher de force ce privilège.
S’en remettre
Par deux fois, j’ai senti que j’étais prêt à tout pour y être accepté, pour faire partie des tiens. Par deux fois je m’y suis crevé le cœur.
L’opulence de ce lieu m’indiffère désormais. Mais ne plus jamais revoir la lumière du soir disparaître derrière les montagnes, quand on s’éclipsait du dîner pour goûter ensemble à la sérénité crépusculaire et à l’odeur de lavande dans la fraîcheur naissante, j’ai pas les mots.
Ne plus jamais revoir ta mère, ta tante, tes nièces, tes voisin·es. Ne plus entendre leurs échanges sans heurts, l’harmonie de leurs rires, la revanche diffuse de leur joie sur les deuils. Parce que votre famille connaît le sang versé et le prix du bonheur, et que ce bonheur-là prend chez vous la densité d’un joyau brut, ça aussi j’ai pas les mots.
Sur mon téléphone, tes photos, tes sms, tes vidéos étaient en tête de toutes les applications. Ils ont progressivement été recouverts des nombreux messages d’affection de mes ami·es. Puis ils iront se perdre dans des méandres où je tenterai de ne jamais descendre.
Je n’ai pas insisté mais j’ai pleuré. Souvent. Au rayon fruits et légumes du Super U. Derrière mes lunettes de soleil que je conserve jusque dans le métro. Dans un sauna de ville périurbaine, alors que j’ai la queue d’un inconnu dans la bouche.
Je ne dis pas que je suis en capacité immédiate de me réjouir quand j’aperçois ton nouvel essai en devanture de ma librairie de quartier. Mais le temps fera le reste.
Ulysse est entré en licence histoire des arts. Depuis septembre, il a obtenu une chambre en cité universitaire à Saint-Denis et un statut de boursier échelon 5. Aujourd’hui, pour notre goûter hebdomadaire, il tient à m’inviter. Il me pince la joue théâtralement et oui mon bro, ça grandit vite hein, mais faut bien que la roue tourne ! Aussi, tu vas être extrêmement surpris, j’ai adhéré à Solidaires étudiant·es — Paris 8.
En me remettant activement aux tâches administratives de mon asso, je réalise à quel point ça me manquait les camarades en retard, les ordres du jour pas respectés et les soirées à se nourrir de houmous avec Aya. Ce qui me manque beaucoup moins, ce sont les luttes d’égo, l’amertume de nos vies de bénévolat usées jusqu’à la corde, les victoires qui ne sont que les sauvetages in extremis de vieilles revendications. Je voudrais sortir du ring.
Au téléphone, je dis à Joey ça va aller. Mais je vais pas pouvoir refaire une année de plus comme ça à Paris, sans nouvelles perspectives. Même pour Étienne, la colocation c’est une parenthèse. C’est génial qu’il soit amoureux, qu’il s’encouple, tout ça. Mais je ne veux pas me sentir en sursis jusque dans ma propre chambre. J’ai besoin de donner une nouvelle épaisseur à mon lieu de vie, puis j’en peux plus du militantisme parisien. Pour l’instant, je fais au jour le jour. Mais vraiment, j’ai besoin qu’il se passe quelque chose.
Joey précise que justement, elle en arrive aux mêmes conclusions. Elle dit qu’elle, elle souhaite plus attendre d’avoir une amoureuse pour se lancer dans sa démarche de PMA. Elle a eu l’adresse d’une clinique fiable en Espagne, par des copines du Planning familial.
Elle m’informe aussi qu’il y a une structure spécialisée qui vient d’ouvrir dans le Finistère, qui cherche des professionnel·les avec pile mon profil.
Elle me propose d’envisager cette idée qu’on a plusieurs fois lancée sans la prendre assez au sérieux, celle d’acheter une maison à plusieurs, vers Brest. Les tarifs y sont abordables et cette ville où nous nous sommes rencontré·es répond à nos besoins, océaniques et telluriques. Ludo pourrait y venir souvent, sa santé s’est un peu stabilisée et il rêve de passer du temps dans le Finistère.
Ce sera un lieu collaboratif, où l’on pourra régulièrement accueillir nos adelphes, une maison porteuse, une maison phare, une perspective. Parce qu’habiter, ce n’est pas juste vivre quelque part, c’est connaître un lieu, s’y sentir légitime et reconnu. Alors il ne s’agira pas d’invitation, mais d’hospitalité. Il faudra être prêt·es à nous déplacer nous aussi, affronter les discussions douloureuses, ne pas présupposer de la qualité de notre accueil.
Parce que l’intensité ne pourra jamais se réduire à une graduation dans l’échelle de mesure des affects
REMERCIEMENTS
Une première version du texte a bénéficié de conseils d’écriture pleins de tact et de justesse, par Alexie Morin. Je la remercie pour ses mots, qui ont légitimé mon projet.
Colophon
Paru dans la collection 39°5.
Relecture par Coralie Guillaubez.
Illustré par Rob Cœur.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Maisons d’enfance, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Sirio Color Celeste 210 g/mœ, Bouffant blanc 80 g/m² en 1 300 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en septembre 2025 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-425-5.
Cette version a été composée par Burn~Août en Creato Display (Anugrah Pasau).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.