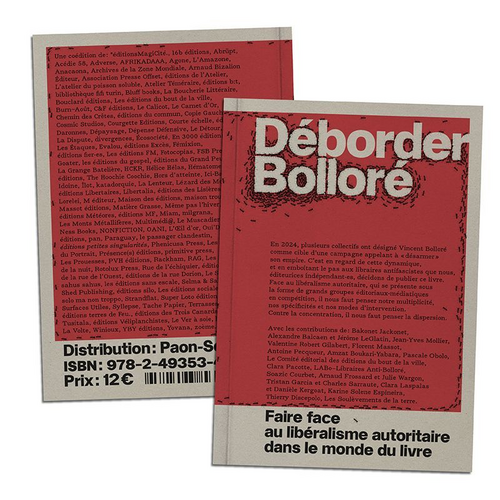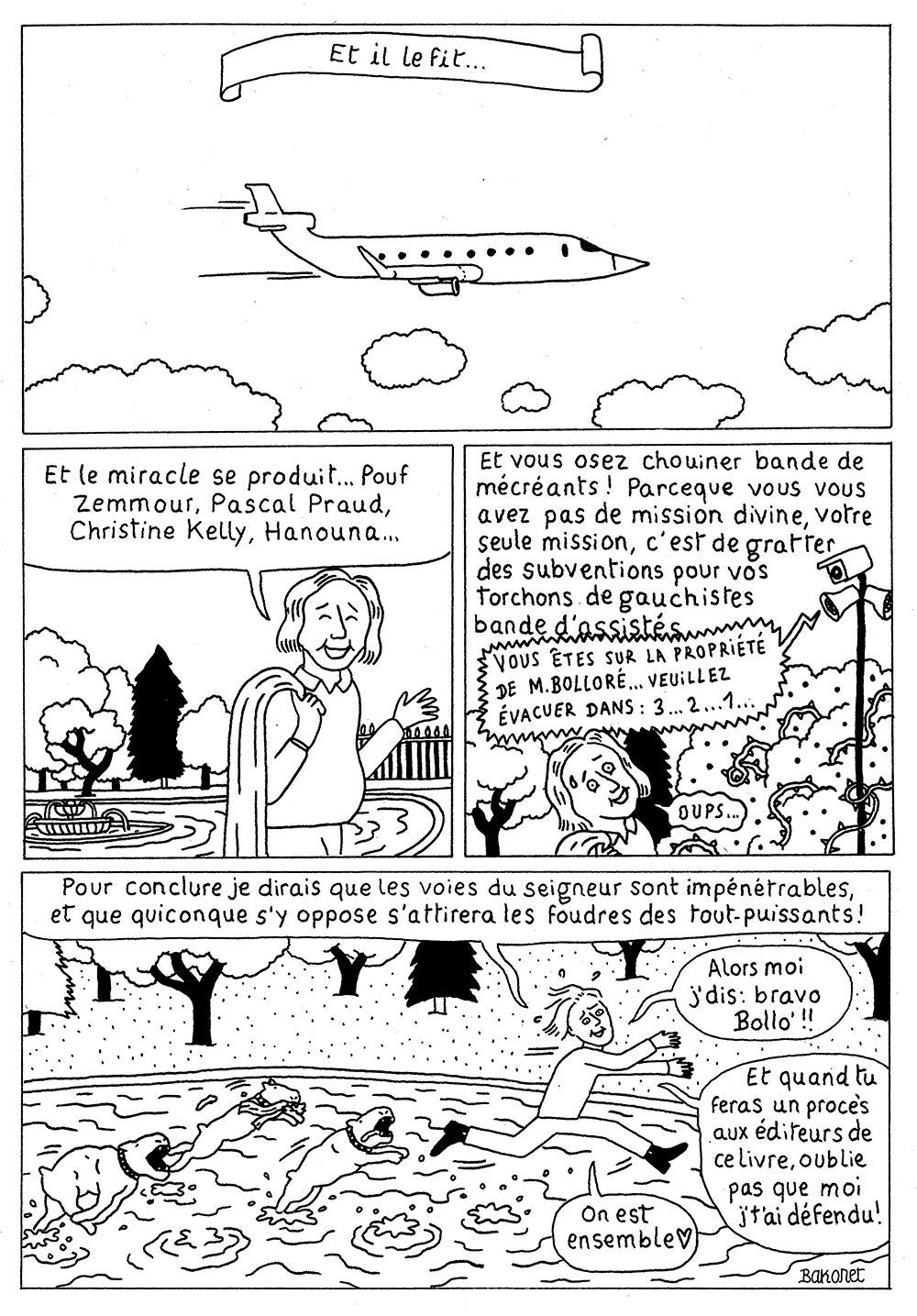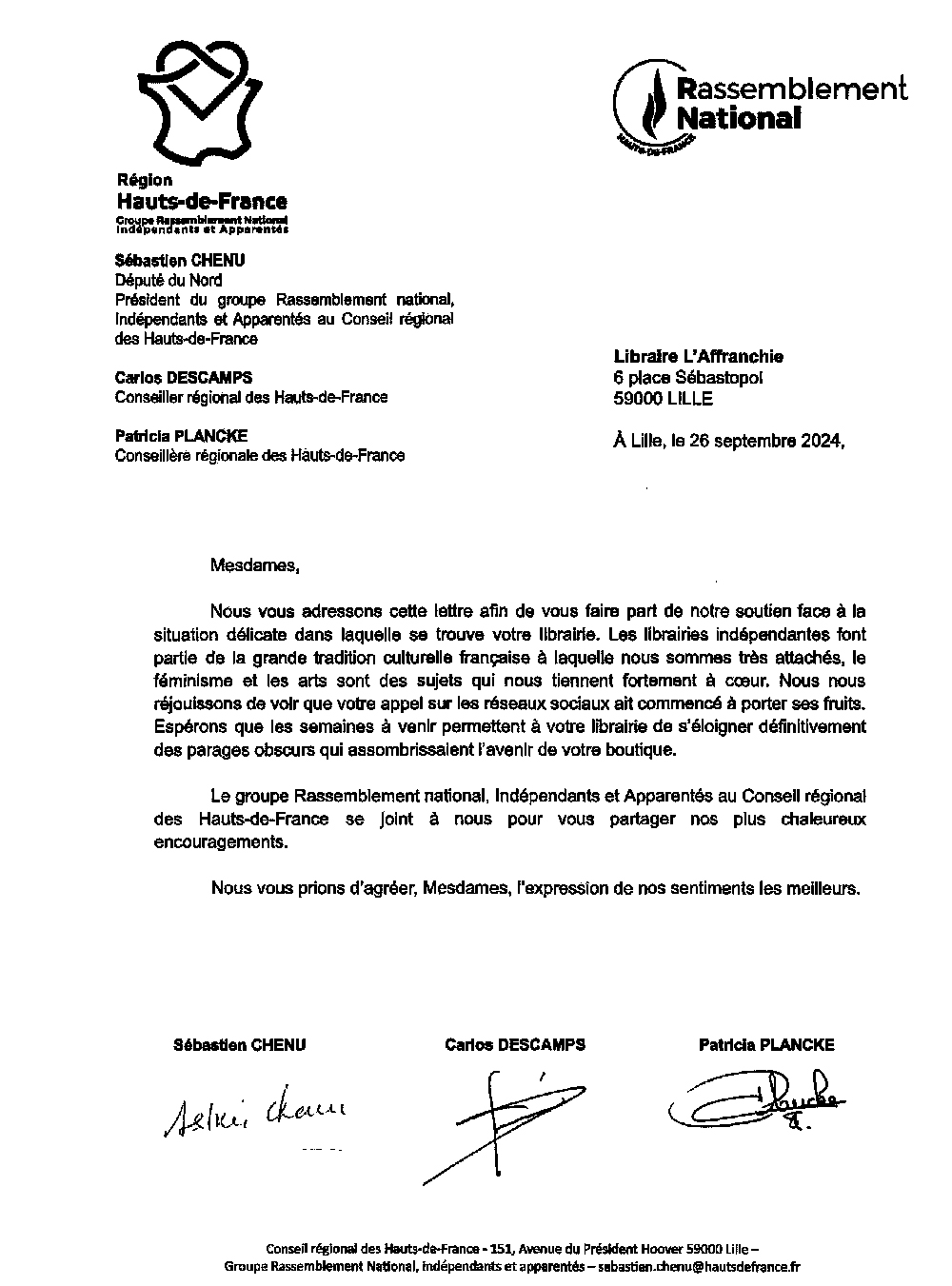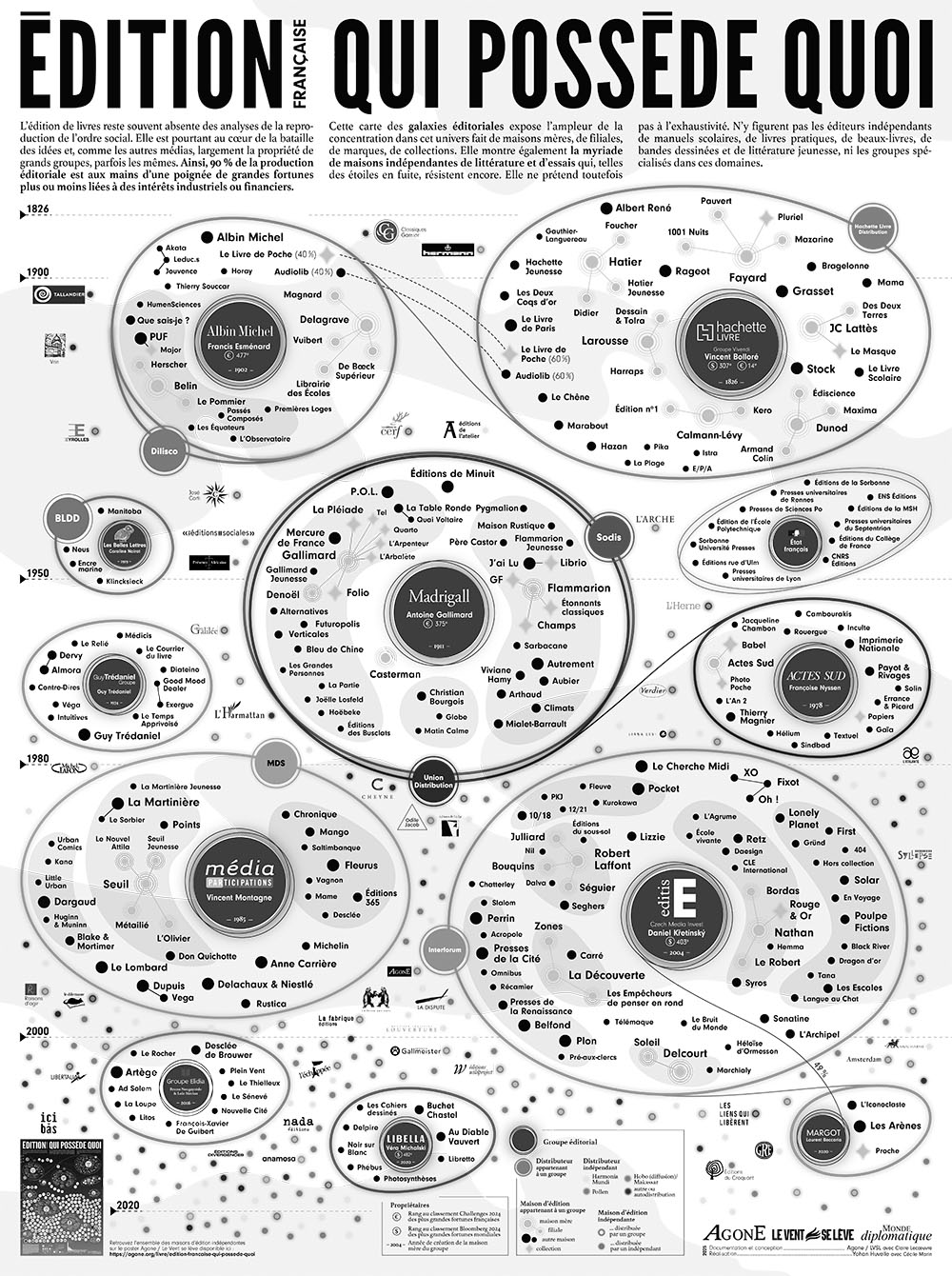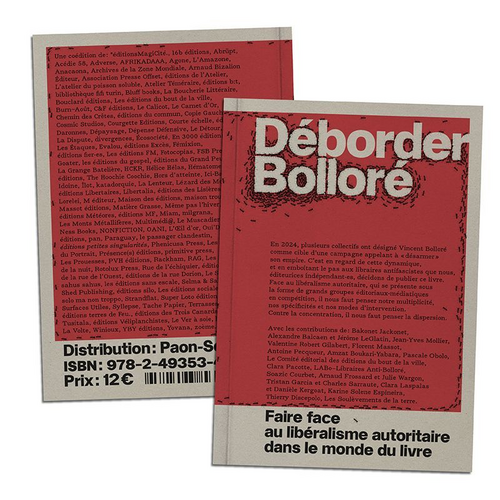
Table des matières
Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre
Dans le contexte de la campagne Désarmons Bolloré, et en emboîtant le pas au boycott appelé par les « libraires antifascistes », nous, éditeurices indépendant·es, coéditons collectivement ce recueil pour prendre part depuis notre secteur à la réflexion générale sur le démantèlement de l’empire Bolloré. Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d’imprimeureuses, d’éditeurices et de libraires qui analysent et/ou subissent les dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché. Chacun·e tente de formuler, depuis sa position respective, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 18/07/25 à 16 h 04.
- Préambule
- Préface —
- Le livre, cette marchandise —
- Hachette, un empire vieux de deux siècles —
- L’empire Bolloré s’étend à l’édition : la construction d’un leader mondial de la culture —
- Bolloré, Arnault, Křetínský : comment le capitalisme flingue l’édition[1] —
- Les enjeux de la concentration éditoriale
- Valeurs et éthique
- Garde-fous démocratiques
- Maintenir son indépendance face aux pressions économiques
- La disparition des nouveaux talents
- Une volonté commune de résistance aux grands groupes
- Le droit de conscience et la législation anti-concentration
- Soutenir les maisons indépendantes
- Encourager du pluralisme via le numérique
- Réseautage et mutualisation des ressources
- Conclusion
- Bolloré : le laboratoire africain —
- Entretien —
- Entretien —
- Lie de la terre et lieux bâtards —
- Lesbienne à la page —
- Au-delà de Bolloré : ce qu’Hachette révèle de la condition de salarié·e en librairie —
- Déborder, depuis une position de libraire engagée —
- L’odeur de l’encre. L’imprimerie : mirage des techniques, réalité des concentrations —
- Des manuels bien pratiques —
- Éditer en féministe —
- Entretien —
- Pour un statut d’éditeur indépendant
- Trois propositions pour une pratique du démantèlement (de l’empire Bolloré) —
- Note sur la production du recueil
- Coédition
Préambule
Ce recueil a été réalisé en seulement quelques mois. Malgré toute l’énergie que nous y avons consacrée, il conserve de nombreux angles morts, et bien des questions essentielles au secteur du livre n’y sont pas abordées.
Déborder Bolloré, Alexandre Balcaen, Amzat Boukari-Yabara, Soazic Courbet, Thierry Discepolo, Karine Solene Espineira, Arnaud Frossard, Tristan Garcia, Bakonet Jackonet, Danièle Kergoat, LABo—Libraires Anti-Bolloré, Clara Laspalas, Jérôme LeGlatin, Le Comité éditorial des éditions du bout de la ville, Les Soulèvements de la terre, Florent Massot, Jean-Yves Mollier, Pascale Obolo, Clara Pacotte, Antoine Pecqueur, Valentine Robert Gilabert, Charles Sarraut, Julie Wargon, coédition collective, 2025
Préface —
Vincent Bolloré l’assume, il mène depuis plusieurs années un « combat civilisationnelVincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022. » et il a, pour cela, un plan de bataille : imposer des idées racistes, sexistes et transphobes sur la scène politique pour faire élire le parti qui saura mener la contre-révolution réactionnaire qu’il désire. Force est de constater que la première partie du plan s’est déroulée sans trop d’accrocs. La dernière séquence politique nous a montré que, même si le RN ne gouverne pas encore, il se trouve dans une position de faiseur de rois. Dans cette perspective, il ne s’agit pas seulement de faire élire un·e président·e — qui pourrait bien être Bardella ou un·e autre, tant que le cœur y est — mais de créer le climat dans lequel les partis politiques, les groupuscules et autres militant·es de l’extrême droite pourront avoir les coudées franches. Il leur faut travailler les consciences et, si cela est nécessaire, ils n’hésitent pas à violenter les corps des plus rétif·ves. Faire d’une pierre deux coups, en usant de tous les relais médiatiques possibles pour saturer l’espace des idées d’extrême droite et fonder ainsi le socle de légitimité à partir duquel celles et ceux qui les portent agissent : à l’assemblée et dans les rues.
Il était donc légitime qu’en juillet 2024, au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron, plusieurs collectifsPour retrouver l’appel et la liste des premiers signataires : https://desarmerbollore.net/appel désignent Vincent Bolloré comme cible principale d’une campagne appelant à « désarmer » son empire. C’est en regard de cette dynamique, et en emboîtant le pas aux libraires antifascistes« 100 libraires s’engagent à escamoter les livres Bolloré », lundimatin, 28/11/2024, disponible sur https://lundi.am/80-librairies-s-engagent-a-escamoter-les-livres-Bollore, consulté le 12/02/2025. que nous, éditeurices, décidons de publier ce livre. Les maisons d’édition qui le signent sont des espaces indépendants des grands groupes, des espaces indépendants depuis lesquels peuvent encore s’exprimer des paroles qui échappent aux logiques du discours dominant. Les voix y trouvant un écho sont rares et menacées par les idées conservatrices, n’en déplaise aux prophètes·ses du « grand remplacement » et aux croyant·es obsédé·es par le « lobby LGBTQIA+ ».
Certaines des maisons d’édition qui coéditent ce livre sont souvent qualifiées « d’engagées » ou de « militantes ». Si l’apport de cet adjectif peut sembler être un gage de qualité aux yeux de certain·es, il nous semble important de questionner ce qu’il dit de notre pratique tout en invisibilisant celle d’autres. Généralement, une maison d’édition est présentée comme militante dès qu’elle traite de sujets dits « de gauche » : justice sociale, antiracisme, féminisme, etc. L’adjectif militant, dès lors, devient une manière de catégoriser toute une production. Tandis qu’il nivèle les conflits et inimitiés qui existent entre les différentes approches, « militant », en opposition à une prétendue objectivité, devient le signe d’une subjectivité partisane et agressive aux contours flous. La neutralité dont se targuent les grands groupes éditoriaux dissimule les subjectivités partisanes dont ils sont les porte-parole ou les chiens de garde. Dans cette préface, nous les appellerons militant·es de l’économie, partisan·es du libéralisme autoritaire. Quand iels ne participent pas activement à l’extrême droitisation de la société, iels y consentent pourvu que le statu quo tienne — que le business as usual suive son coursSi celles et ceux qui sont actuellement à la tête de Editis et Média-Participations n’assument pas toujours ouvertement de parti pris politique ; on peut penser que c’est la rationalité économique qui guide leur ligne éditoriale. Dans le cas de Françoise Nyssen qui a été présidente d’Actes Sud (Cambourakis, Payot & Rivages, Textuel) jusqu’en 2022, les allégeances sont plus claires. En 2017, elle est nommée ministre de la Culture par Édouard Philippe, sous la présidence d’Emmanuel Macron. De Gallimard, on retiendra, à titre d’exemple, la collaboration avec l’occupant nazi et ses alliés français pendant la Seconde Guerre mondiale..
D’aucun·es objecteront que les idées d’extrême droite n’ont pas attendu Bolloré pour essaimer, que la concentration dans le monde du livre existe depuis que l’édition s’industrialise ; qu’entre les deux, il y a finalement une affinité naturelleÀ ce sujet, la compromission totale de Gallimard avec l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale est un fait marquant. Compromission telle, qu’au sortir de la guerre, l’entreprise a échappé de peu à sa nationalisation. Pour en savoir plus, nous renvoyons à Thierry Discepolo, « Chapitre IV. Qui contrôle le passé contrôle le futur, et qui contrôle le présent contrôle le passé » dans La Trahison des éditeurs : troisième édition revue & actualisée, Marseille, Agone, 2023.. En conséquence de quoi iels demanderont « Pourquoi Bolloré, plutôt que Daniel Křetínský, Antoine Gallimard ou Vincent MontagneDaniel Křetínský a racheté le groupe Editis (La Découverte, Plon, Robert Laffont, etc.) à Vivendi (Bolloré) en 2023 avec une filiale de Czech Media Invest (CMI), une holding contrôlant l’un des plus grands groupes de presse tchèque. Antoine Gallimard est le PDG de Madrigall (Gallimard, Flammarion, Minuit, P.O.L, etc.) dont LVMH (Bernard Arnault) est entré au capital en 2013. Vincent Montagne est le PDG de Média-Participations (Seuil, Dargaud, La Martinière, etc.). En 2022, Hachette, Editis, Madrigall et Média-Participations représentaient à eux quatre 70 % du marché de l’édition en France. ? » On peut légitimement se demander si les militant·es de l’économie qui avancent masqué·es ne sont pas plus dangereux·ses — ce à quoi on peut objecter que jamais, auparavant, une telle concentration éditoriale n’a été aussi clairement au service d’un projet politique. Mais notre opération est stratégique, voire opportuniste : profiter de la brèche ouverte par la campagne « Désarmer Bolloré » pour visibiliser ce qui chez les autres partisan·es du libéralisme autoritaire se fait plus discrètement. En cela, Bolloré est une figure de choix : exubérant, il ne dissimule pas son idéologie et assume un certain degré de brutalité pour l’imposer. Il ne faut pas prendre la chose à l’envers : ce n’est pas Bolloré qui invente la concentration éditoriale avec le rachat d’Hachette par Vivendi en 2023, la structure même de l’économie du livre était déjà perméable à l’apparition d’un tel personnage. De la même façon, les idées d’extrême droite ne sont pas seulement le fruit d’individus ou de partis quelconques, elles sont la matrice même à partir de laquelle nous sommes gouverné·es. De sorte que les grand·es capitalistes et celleux qui composent l’extrême droite dans toute sa diversité, par leur action concertée, ont un rôle d’intensification des politiques déjà menées, qu’elles soient éditoriales ou gouvernementales. S’il est nécessaire d’apporter une nuance en replaçant les actions de Bolloré dans un contexte où les idées conservatrices ont pignon sur rue dans le monde entier, il ne faut pas négliger sa puissance de nuisance ainsi que celle des autres militant·es de l’économie. Il faut « déborder Bolloré », c’est-à-dire dépasser la figure de Bolloré pour porter l’attention sur ce qui le rend possible en nommant, au passage, celleux qui, avec lui, participent et profitent de la dégradation générale des conditions de viePour ce qui est de la dégradation des conditions de vie, on peut noter le rôle d’acteur majeur que joue Vincent Bolloré en Françafrique de par ses activités logistiques et extractivistes sur le continent africain, sous le nom Bolloré Logistics, mais aussi par la mainmise qu’il y a sur les médias ; voir Thomas Deltombe, « Les guerres africaines de Vincent Bolloré », Le Monde diplomatique, 01/02/2024, disponible sur : https://www.monde-diplomatique.fr/2009/04/DELTOMBE/16970, consulté le 12/02/2025. Depuis 2018, le milliardaire est mis en examen pour corruption d’agent public étranger dans l’enquête sur l’attribution de la gestion du port de Lomé. Pour mieux comprendre la place et l’action de l’empire Bolloré sur le continent africain, voir Olivier Blamangin, « Vincent Bolloré, affaires africaines » dans Thomas Borrel, Amzat Boukari Yabara, Benoît Collombat, Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Paris, Seuil, 2021..
Les contributions mettent en avant la pensée de chercheureuses, d’imprimeureuses, d’éditeurices et de libraires qui analysent et/ou subissent les dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché. De façon indépendante et sans être lié·es par une prise de position commune, chaque auteurice tente de formuler, depuis sa position, des réponses à cette question urgente : comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre ?
Alexandre Balcaen, éditeur chez Adverse, et Jérôme LeGlatin, auteur et traducteur chez le même éditeur, explorent l’écosystème de l’édition, dans lequel l’élaboration d’un livre, sa production et sa distribution s’articulent en une chaîne d’acteurices interdépendant·es. Ils mettent ainsi en lumière les régimes d’interdépendances structurelles du secteur, ainsi que les leviers souterrains qui permettent l’expression de rapports de force disproportionnés, la diversité peinant plus que jamais à se maintenir, entre accélération des flux et quête de rentabilité. Jean-Yves Mollier, historien et spécialiste de l’édition et des médias et auteur, entre autres, d’Une autre histoire de l’édition françaiseJean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La fabrique, 2015., retrace deux siècles d’existence du groupe Hachette, aujourd’hui leader de l’édition en France, affichant un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros et une forte présence internationale. Puis, Valentine Robert Gilabert, ex-avocate et travailleuse de la culture, retrace la chronologie des acquisitions majeures du groupe Bolloré, révélant les étapes de son expansion structurelle et logistique. Elle éclaire le rôle central de Vivendi, présenté comme leader mondial des médias, et explore l’intérêt croissant de Bolloré pour l’édition, secteur clé pour influencer les récits culturels et politiques. Enfin, Florent Massot analyse la concentration croissante du secteur de l’édition française entre les mains de quelques oligarques. Il décrit comment ces figures du capitalisme ont acquis des maisons d’édition historiques (Hachette, Flammarion, etc.), transformant ces institutions en outils de rentabilité et de promotion d’idéologies conservatrices. Florent Massot met en lumière les conséquences de cette concentration : une réduction de la diversité éditoriale, une marginalisation des voix critiques et une dépendance accrue aux logiques de marché.
La deuxième partie se penche sur l’emprise médiatique de Vincent Bolloré, et ses effets dans les pays du continent africain.
Dans son texte, Antoine Pecqueur explore l’emprise de Vincent Bolloré en Afrique, au-delà des infrastructures logistiques auxquelles son nom a longtemps été associé. Après la vente de ses ports et chemins de fer en 2022, l’homme d’affaires breton a renforcé son influence médiatique et culturelle : salles de concert, cinémas, partenariats universitaires, signatures d’artistes. Avec Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, il façonne un paysage médiatique stratégique qui lui permet d’affirmer son hégémonie culturelle. Amzat Boukari-Yabara, dans l’entretien que nous avons fait avec lui, interroge les conséquences de cette hégémonie sur la production et la diffusion des savoirs, la représentation des récits africains et la dynamique panafricaniste. Il analyse également les usages politiques de cette domination et les résistances émergentes : foires du livre, initiatives culturelles alternatives et alliances transnationales. Dans un autre entretien, Pascale Obolo revient sur les obstacles à la diffusion des voix diasporiques en France et des récits minoritaires en Afrique. Face à l’impact de la concentration éditoriale et du contrôle des réseaux de distribution par des groupes comme Bolloré, qui filtrent les récits et limitent la diversité des voix, Pascale Obolo met en lumière le rôle crucial des foires indépendantes, véritables espaces de résistance où se fabriquent et se diffusent les contre-récits.
Dans leur texte, les éditions du bout de la ville décrivent comment « déborder Bolloré » peut signifier, à l’échelle d’une maison d’édition minuscule, tenter de « désembourgeoiser » le livre en publiant celles et ceux dont l’existence même s’oppose au projet politique et économique du bloc bourgeois dans sa dérive fasciste. Iels nous alertent aussi sur l’importance de réinventer des lieux d’éducation populaire afin de faire face aux « librairies » que rêve d’essaimer Pierre-Édouard Stérin, activiste milliardaire d’extrême droite, dans le cadre de sa « bataille culturelle ». Clara Pacotte, fondatrice des éditions RAG et autrice, aborde ensuite la question des voies creusées par les éditeurices indépendant·es afin d’hybrider les genres et rendre compte de la pluralité des cultures et des vécus de celleux qui écrivent. Le LABo, pour Libraires Anti-Bolloré, qui échange depuis quelques mois sur les réalités du métier et les résistances possibles à Bolloré, nous plonge, quant à lui, dans le quotidien du métier de libraire, entre injonctions commerciales et tentatives de préserver une certaine exigence éditoriale. Entre cartons Hachette, flux tendus, surproduction et contradictions quotidiennes, iels questionnent leur rôle et leurs marges de manœuvre dans un secteur structuré par des logiques de rentabilité. Soazic Courbet, de la librairie l’Affranchie à Lille, s’interroge sur ce que signifie être une libraire engagée au regard des systèmes de dominations dans les milieux du livre. Elle souligne l’importance d’une réflexion collective sur les dynamiques qui nous lient et invite à penser l’édition en féministes, comme une résistance aux idéologies dominantes patriarcales, capitalistes et fascistes. Arnaud Frossard, fondateur des éditions de la Grange Batelière, libraire au Merle moqueur et ancien imprimeur, interroge les mutations de l’imprimerie de labeur, celle qui concerne l’impression de livres ou de brochures. L’essor de l’informatique de bureau, le développement des techniques d’impression favorisant les courts tirages et surtout la concentration éditoriale ont fragilisé ce secteur, exacerbé par de grands groupes dont l’hégémonie accentue les rapports de force entre éditeurices et imprimeureuses.
Tristan Garcia, philosophe et auteur, et Charles Sarraute, sociologue des médias, alertent sur l’impact croissant des manuels scolaires dans la formation des enseignant·es dans un contexte où le recrutement devient de plus en plus difficile et les formations de plus en plus courtes. Ils soulignent le risque d’une dépendance accrue aux manuels, perçus à tort comme des reflets parfaits des programmes. Avec Bolloré à la tête de la majorité des éditeurs de manuels, Tristan Garcia et Charles Sarraute pointent la menace d’une instrumentalisation idéologique : réécrire les contenus scolaires et remodeler les enseignements dans le but de diffuser des récits nationaux, coloniaux et conservateurs en remodelant les enseignements. Clara Laspalas, éditrice aux Éditions sociales et Danièle Kergoat, sociologue, illustrent, à travers l’évolution de l’édition féministe, comment des collections comme « Le Genre du Monde » s’ancrent dans les luttes sociales. Elles offrent des outils critiques et émancipateurs, mêlant travaux académiques et engagements militants. Face à des groupes tels que Bolloré, l’édition féministe joue un rôle crucial dans la dénonciation des systèmes d’oppression, la préservation de la diversité des voix et la promotion de pratiques éthiques. Elles insistent sur l’importance d’un universalisme critique, nécessaire à une émancipation collective qui prenne en compte les spécificités des différentes luttes sociales. Dans un entretien, Karine Solene Espineira analyse l’évolution des représentations des personnes trans* dans l’audiovisuel et la presse, mettant en lumière à la fois les avancées et les écueils persistants. Si leur visibilité a augmenté durant ces vingt dernières années, elles restent souvent stéréotypées ou instrumentalisées, renforçant des imaginaires normatifs plutôt que de refléter la diversité de leurs parcours et expériences. La concentration médiatique et le projet politique réactionnaire de Vincent Bolloré conduisent ses médias à déployer des stratégies narratives spécifiques pour façonner le regard du public, jouant sur la désinformation, la peur ou l’invisibilisation. À travers cette réflexion essentielle sur le pouvoir des images et des récits, Karine Solene Espineira nous invite à interroger les mécanismes de représentation et à imaginer des alternatives plus justes et inclusives. Dans son texte, Thierry Discepolo, fondateur des éditions Agone et auteur de La Trahison des éditeursThierry Discepolo, La Trahison des éditeurs, Op. Cit., interroge l’avenir de la diversité éditoriale face à une concentration croissante du marché. Alors que les grands groupes dominent le secteur et captent la majorité des aides publiques, il alerte sur l’urgence de reconnaître un statut spécifique aux éditeurs indépendants, afin de garantir leur viabilité et leur rôle essentiel dans la production de savoirs et d’idées. Les Soulèvements de la terre, en tant qu’organisation participante à la campagne « Désarmer Bolloré », revient sur l’influence déterminante de Vincent Bolloré dans la sphère politique et médiatique, détaillant comment son arsenal logistique, éditorial et médiatique alimente la « guerre civilisationnelle » qu’il se targue de mener. Y sont dressées des stratégies concrètes de résistance collective pour contrer son emprise croissante sur la culture, l’information et le débat public.
Le pari stratégique que fait ce livre part du constat suivant : depuis quelques années, nous observons un regain d’intérêt pour la pratique de l’édition. Pas une année ne passe sans qu’une structure éditoriale ne voie le jour, se singularisant par le choix des livres publiés, de la forme qu’ils prennent, des thématiques qu’ils abordent mais aussi par le travail réflexif des éditeurices sur leur pratique. Face au libéralisme autoritaire, qui se présente sous la forme de grands groupes éditoriaux-médiatiques en compétition, il nous faut penser cette multiplicité et ses spécificités. Contre la concentration, il nous faut penser la dispersion. Une dispersion qui n’est pas synonyme d’éparpillement mais qui est la modalité d’une solidarité en actes depuis des positions situées. Ainsi avons-nous fait le choix stratégique de coéditer ce livre en nommant chacune des maisons d’édition signataires plutôt que de créer un énième collectif qui les rassemblerait toutes. En plus de réunir de nombreuses maisons d’édition qui le cosignent, ce livre mobilise des structures de diffusion/distribution, des librairies et des auteurices. Il a été pensé et rendu possible à partir d’une multiplicité qui a choisi la dissémination comme manière d’agir. Par dissémination, nous entendons la capacité qu’ont les différent·es acteurices (des auteurices aux lecteurices) de ce livre à le propager : en communiquant la nouvelle de sa sortie ; en s’associant à une imprimerie coopérative afin de réaliser des affiches en risographie ; en demandant à un distributeur de mettre lesdites affiches dans les cartons à destination des libraires ; en proposant ces textes en accès libre sur internet pour qu’ils soient facilement imprimables et diffusables par celles et ceux qui les soutiennent. Déborder Bolloré est le fruit d’une discussion entre tout·es ces acteurices qui pensent nécessaire de trouver une forme d’intervention à la mesure de la menace que représentent Vincent Bolloré et consorts. De sorte qu’à la mise en compétition qui est le régime général de gouvernement, se substitue quelque chose de l’ordre de l’entraide, de la confiance et des liens. Finalement, peut-être est-ce cela « être indépendant·e » : se donner la capacité de choisir les dépendances qui nous font exister et de combattre celles qui nous tuent.
Le livre, cette marchandise —
La chaîne du livre, prise par un bout
Si de nouveaux tournants décisifs de la révolution numé-rique mondiale sont en cours dans le secteur culturel, l’activité d’édition a toujours pour objectif en 2025 de réaliser la présentation de textes et d’imagesTextes et images composant contenus, créations, savoirs ; quelques énoncés, parmi d’autres (infotainment, spectacle, essai, fiction, etc.), que l’on pourrait interroger ou préciser dans un autre cadre, mais dont on considérera, ici, que ce qu’ils désignent participent de cette production de masse.. Et cette présentation aboutit, parfois encore, à un objet imprimé qu’on appelle : livre63 565 titres, c’est le nombre de titres représentant la production commercialisée en France en 2023 (nouveautés et nouvelles éditions, hors auto-édition et impression à la demande). Source : https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/chiffres-cles-pour-le-secteur-du-livre/information/.
L’élaboration d’un livre se réclame d’un ou plusieurs auteurs, que ceux-ci aient initié une proposition ou obéi à des prescriptions — il importe de noter que les effets complémentaires, sinon complices, de l’uniformisation des expressions humaines (via une somme de procédés éducatifs et socioculturels mondialisés, réglés par les sciences de la communication) et de l’automatisation des processus créatifs remettent désormais en cause cet impératifEn septembre 2023, la prolifération d’ouvrages générés par IA est telle qu’Amazon se voit contraint d’abaisser à trois titres par jour le nombre de publications autorisées pour un même « auteur ». En novembre 2024, l’annonce du lancement de la maison d’édition 8080 Books par Microsoft mentionne l’usage d’expérimentations technologiques pour « réduire le délai entre le manuscrit final et l’arrivée du livre sur le marché » et « démocratiser la publication de livres » via « un protocole éditorial rigoureux qui impliquera de repérer rapidement les idées et les arguments méritoires, d’assister l’élaboration des manuscrits ». Si cette annonce ne mentionne pas ouvertement le concours d’IA, The Guardian précise dans le même article que Microsoft a signé un accord avec la maison d’édition HarperCollins pour utiliser une somme d’essais du catalogue afin d’entraîner un modèle d’IA..
L’éditeur se reconnaît responsable d’une suite de publications qui constitue, en son pendant concret, un catalogue et, en son pendant idéologique, intellectuel, sensible, une ligne éditoriale. L’éditeur aspire à ce que son catalogue et sa ligne éditoriale se singularisent, pour des raisons diverses, parfois conjuguées (esthétiques, intellectuelles, éthiques, économiques, mercantiles, etc.).
L’activité éditoriale — que l’éditeur opère seul ou dirige une équipe — consiste à examiner les propositions spontanées reçues, observer l’offre de ses concurrents ou prospecter la création internationale, passée et présente, afin d’initier, sélectionner, solliciter des projets. Cette activité est par ailleurs soumise à des obligations administratives (droit, comptabilité, gestion) et peut assumer des enjeux promotionnels (marketing, presse, événementiel).
L’activité éditoriale consiste aussi à réaliser la maquette d’un livre, composition virtuelle en vue de l’impression de l’objet-livre. Cette réalisation requiert des compétences de nombreuses disciplines : correction, traduction, typographie, photogravure, graphisme, mise en page, fabrication.
-
l’imprimeur, pour la fabrication de l’objet-livre (en lien direct avec le papetier),
-
le diffuseur, pour la commercialisation de l’objet-livre en direction des librairies (par le biais de ses équipes de représentants de commerce, qui opèrent par des rendez-vous physiques ou distants — téléphone, email, ou envoi de bons de commande préremplis),
-
le distributeur, pour la logistique relative à l’objet-livre (préparation et facturation des commandes, stockage, transport),
-
le libraire, pour la commercialisation de l’objet-livre en direction des particuliers et des collectivités.
Ces maillons (auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires) composent un ensemble, à la fois atomisé et interconnecté, qu’on appelle : chaîne du livre.
Pour tout livre vendu, chacun de ces maillons perçoit une commission établie en pourcentage sur le prix de venteEn moyenne (il peut exister des variations considérables selon les contractualisations) : 8 % pour l’auteur ; 21 % pour l’éditeur ; 15 % pour l’imprimeur ; 8 % pour le diffuseur ; 12 % pour le distributeur ; 36 % pour le libraire., à l’exception de l’imprimeur qui est payé forfaitairement. Cet ensemble de pratiques techno-économiques contractualiséesÀ noter que si c’est l’éditeur qui établit un contrat avec l’auteur, c’est le diffuseur-distributeur qui établit les contrats avec les éditeurs et avec les libraires — ce qui, on le verra, n’a rien d’anodin. est régi en France par la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre. Ce prix de vente public, fixé par l’éditeur, ne peut être soumis à aucune remise supérieure à 5 % pour une durée de deux ans après parution. La loi vise ainsi à tempérer les effets de la concurrence entre les différents modèles de librairies — de la grande distribution au commerce en ligne ou l’échoppe de proximité. C’est encore sur la base de ce prix unique, mis en regard d’un ratio entre les coûts du premier tirage et les ventes prévisionnelles, que l’éditeur peut modéliser avant parution la trajectoire économique de sa marchandise.
Du 7-2-1 au 15-4-1
L’activité éditoriale a longtemps épousé les principes d’une règle économique empirique, dite du 7-2-1. Pour 10 livres produits, 7 sont déficitaires, 2 atteignent l’équilibre financier, 1 seul génère des bénéfices suffisants pour amortir le déficit cumulé des sept premiers. Selon cette règle, une maison d’édition est une structure économique qui réalise généralement des bénéfices restreints.
La pérennité de la maison repose alors sur la gestion de son fonds, c’est-à-dire sur la disponibilité de ses anciens titres. Cette gestion reste une gageure : les coûts de réimpression d’un titre peuvent parfois annuler les bénéfices d’un premier tirage épuiséPour un tirage s’établissant en moyenne au-delà de 500 exemplaires, c’est l’impression offset qui sera privilégiée (pour des raisons économiques). Or, on distingue dans ce cas les frais de calage (tirage des plaques, réglages de la machine), incompressibles et reconductibles en cas de retirage, et les frais de roulage (papier, encre, temps de travail), dégressifs en fonction du tirage. En cas d’épuisement du stock d’un premier tirage dont le seuil de rentabilité était assez élevé, les coûts d’un retirage générant des ventes faibles peuvent absorber les bénéfices réalisés sur le tirage initial. Pour des tirages au départ plus faibles, l’impression numérique offre depuis une vingtaine d’années une alternative plus souple, dans la mesure où elle ne nécessite pas de frais de calage. L’impression à la demande, en forte progression ces dernières années, profite elle aussi du développement du numérique, mais son coût de production plus élevé nécessite l’éviction d’une bonne part des intermédiaires entre auteur/éditeur et acheteur.. Maintenir un fonds est de plus un choix onéreux, puisqu’il immobilise de la trésorerie et génère un coût de stockage. Néanmoins, c’est une condition sine qua non pour tout éditeur attaché à l’inscription de son catalogue dans une temporalité longue, d’autant plus nécessaire lorsque sa ligne éditoriale ne s’établit pas selon l’agenda de l’actualité. Ainsi, un fonds peut se révéler rentable à moyen ou long terme, en fonction des évolutions historiques, politiques, sociales, culturelles — évolutions auxquelles peuvent participer, travail de fond du fonds, cesdits catalogues.
La gestion du fonds est une question tout aussi névralgique pour une librairie, bien que répondant à des contraintes différentes. Une librairie bénéficie d’une marge commerciale équivalente, en moyenne, au tiers du prix du livre. Pour que la disponibilité permanente d’un livre en rayon soit financièrement amortie, il faut qu’il ait été vendu au moins trois fois (deux fois pour rembourser le coût d’acquisition de l’ouvrage, une fois supplémentaire pour participer aux charges de la librairie : salaire(s), loyer, amortissement du matériel, abonnements aux bases de données de référencement et de comptabilité/gestion, électricité, assurance, etc.). La librairie doit de plus gérer l’encombrement de sa surface de vente, entre rayonnages pour le fonds et tables de présentation pour la nouveauté (l’optimisation de cette surface de vente peut s’opérer avec un calcul de rentabilité au mètre linéaire d’exposition).
Le bénéfice net d’une librairie ou d’une maison d’édition défendant une politique de fonds s’établit rarement au-delà de 3 % de son chiffre d’affaires, puisque préserver la disponibilité d’un grand nombre de références générant des ventes faibles est particulièrement coûteux (on parle ici de « titres à rotation lente »). Le moyen communément jugé le plus efficace pour augmenter ce bénéfice net est ce qu’on appelle le best-seller, soit un livre générant des ventes exceptionnellement élevées (on parle alors de « titre à rotation rapide »). D’aucuns diront alors qu’éditeurs et libraires ont tout intérêt à ce qu’il advienne.
Le système économique en place visant l’accélération et l’augmentation ad infinitum des bénéfices, la règle du 7-2-1 a glissé ces trente dernières années vers un ratio plus proche de 15-4-1 (15 livres déficitaires, 4 à l’équilibre et 1 qui génère les bénéfices nécessaires). La stratégie est simple : à multiplier les paris, on multiplie les chances d’obtenir un succès. Mais l’efficacité économique du modèle 15-4-1 nécessite un raccourcissement de la durée de représentation d’une nouveauté en librairie. Il faut en effet qu’un pari jugé perdu laisse rapidement sa place au pari suivant. Et il s’agit donc de dynamiser les flux.
Pour permettre cette accélération, le secteur de la distribution a bouleversé les règles établies en abolissant le délai de garde. Celui-ci imposait aux libraires de conserver un livre en magasin pendant au moins trois mois, avant de pouvoir le retourner à l’éditeur. Le délai de garde était donc d’une importance cruciale pour offrir un minimum de visibilité à un ouvrage après parution. Désormais, la durée de présentation d’une nouveauté en librairie peut ne pas dépasser quelques jours.
La chaîne du livre, prise par un autre bout
Mais plutôt qu’aborder les choses à partir de l’activité d’éditeur ou de celle d’auteur, une connaissance adéquate du secteur du livre gagnera à se concentrer sur son centre de commande effectif : la distribution, à partir de quoi tout rayonne. Trop souvent considérée comme le rouage purement logistique et marchand d’une organisation socio-économique se vouant à des idéaux culturels plus purs (au point qu’il est courant de présenter cette organisation comme un biotope plutôt qu’une industrie…), la distribution organise structurellement le secteur, le déterminant de fond en comble.
Ce qu’on appelle distribution consiste pour l’essentiel en une poignée de structures économiques surpuissantes, liées aux groupes d’édition qui dominent le marchéLes principaux groupes d’édition possèdent tous leur société de distribution : Hachette Distribution pour Hachette Livre, Interforum pour Editis, Sodis et Union Distribution pour Madrigall, Volumen pour La Martinière / Le Seuil, MDS pour Média-Participations, Dilisco pour Magnard-Vuibert, etc. Les groupes d’édition Hachette Livre, Editis et Madrigall traitent ainsi, via leurs entreprises de distribution, plus de 85 % du marché. À titre d’exemple, Hachette Livre possède des maisons telles que Grasset, Fayard, Stock, Le Livre de Poche, Larousse, Hatier & Hachette Éducation — soit l’essentiel des manuels scolaires — et tant d’autres ; tandis qu’Hachette Distribution gère, en sus des maisons du groupe Hachette, la commercialisation et la logistique des ouvrages publiés par Albin Michel, Bayard, Odile Jacob, Bamboo, Glénat, etc. Les effets de concentration sont vertigineux.. Ces entreprises de distribution gèrent la commercialisation de la majorité des ouvrages existants, en organisant les flux physiques (stockage, livraison et retour des marchandises) et financiers (facturation, remboursement) entre les éditeurs et les libraires. Les distributeurs occupent de plus une position singulière : la commission qu’ils perçoivent sur les livres vendus s’accroît par leur gestion des flux, désormais si conséquents, de livres invendus. Le transport et le contrôle de l’état de la marchandise retournée puis, en fonction de cet état, sa réhabilitation et réintégration dans les stocks, ou son renvoi à l’éditeur en tant que « marchandise défraîchie », ou bien encore sa destruction par le biais du pilon sont autant d’opérations que le distributeur facture. Pour le distributeur, non seulement chaque mouvement de chaque livre rapporte, mais l’invendu lui-même, lorsque stocké, parfois des années durant, ou bien purement détruit, est source de bénéfices.
Bien plus qu’une erreur d’analyse, seul un travail acharné de refoulement sociopolitique peut alors faire croire, comme nous l’avons entendu si souvent, que la recherche du « gros coup » de la part des éditeurs explique la surproduction qui gangrène l’économie du livre ou que la multiplication des auteurs entraîne la hausse vertigineuse des publications. C’est, ici comme là, voir le problème tout à l’envers, en particulier lorsqu’on en vient à tenir les travailleurs précaires d’un secteur industriel pour responsables des ravages opérés par ce dernier.
Éditeurs, libraires, auteurs, lecteurs sont devenus les acteurs, plus ou moins volontaires, plus ou moins conscients, nécessaires au secteur de la distribution pour accroître l’expansion spatiale et temporelle de la circulation marchandeEntre 2007 et 2023, le nombre de titres disponibles est passé de 565 000 à 856 210, tandis qu’entre 1999 et 2019, le nombre de nouveautés augmentait de 76 %. et ses profits afférents. Autant d’intermédiaires, dont les comportements et désirs (choix éditoriaux, sélection des libraires, productions artistiques, intérêts du lectorat) sont en premier lieu déterminés par la logique hyper-productiviste du capitalisme mondialisé. Et si des résistances ont toujours cours en chacune des sphères d’activité du secteur, distribution compriseSi elles sont rares et occupent une part de marché très marginale, quelques entreprises envisagent l’activité de diffusion-distribution selon des biais politiques de soutien à la création marginale, affichant des conditions transparentes, acceptant de soutenir des maisons d’édition à la fréquence et aux volumes de publication faibles, voire s’alignant sur la décision de l’éditeur d’imposer la vente ferme (interdisant alors les retours sur invendus)., les marges de manœuvre se sont réduites comme peau de chagrin ces vingt dernières années.
La dérégulation progressive, au tournant des années 2000, du protocole du retour sur invendus ayant fait sauter toute contrainte relative au délai, à la quantité, ou à l’état des marchandises retournées par les librairies, l’ampleur et la vitesse des flux ont été décuplées — autant d’effets circulatoires débridés bénéficiant en premier lieu aux entreprises de distribution. La nature même des métiers d’éditeur (plus que jamais pourvoyeur de marchandises en quête d’une visibilité éphémère sur des étals encombrés) et de libraire (par une accentuation dramatique et chronophage du rôle de sous-gestionnaire comptable et physique des flux) en a été bouleversée. Les premiers subissent les conditions techniques et économiques imposées par la distribution pour obtenir un simple droit de représentation en librairies. Les seconds ne peuvent plus avoir une connaissance adéquate des innombrables produits qu’ils proposent à la vente (les rayons des librairies étant de plus soumis à un engorgement qui dessert toute politique de fonds), et voient les taux de remise dépendre de leur soumission aux offres commerciales proposées, sinon imposées, par le diffuseur.
Bras commercial armé de la distribution, le diffuseur a pour fonction de présenter les produits au libraire et établir avec lui les commandes. Le conflit d’intérêt entre diffuseur, déterminant le volume des commandes, et distributeur, dont les bénéfices sont directement liés au flux de marchandises, serait bien sûr patent si les deux fonctions n’étaient pas remplies, comme c’est le plus souvent le cas, par la même entreprise. On notera enfin que l’entreprise de diffusion-distribution, propriété d’un groupe d’édition spécifique, est souvent plus favorable aux labels de la maison-mère qu’à la constellation d’autres structures d’édition indépendantes qu’elle représente par ailleurs (entendre alors combien l’indépendance de ces structures d’édition participe de fait d’un type de dépendance très particulier).
Conséquence logique de ce passage, relativement récent, à une économie de flux dans le secteur du livre : 1) de plus en plus de marchandises sont vendues, mais pour chaque titre en quantités de plus en plus faibles, 2) de moins en moins de marchandises sont vendues au total, en pourcentage d’une masse d’objets produite toujours plus élevée, finissant ici stockée, là détruite. Cette augmentation délirante des volumes de marchandises, ainsi que leur circulation, stockage et destruction effrénés, entraînent in fine une explosion des profits pour les entreprises de diffusion-distribution, alors même que le reste du secteur plonge dans une dépression systémique.
Qui alors pour imaginer que sortiraient indemnes de ce grand lessivage culturel deux à trois générations d’auteurs (variable d’ajustement industriel type, dont les conditions de vie se sont effondrées), d’œuvres (que la qualité de marchandise jetable affecte dès l’origine), de lecteurs (débordés, sinon sidérés, par une offre rendue insaisissable et ne requérant plus d’eux qu’une réactivité réflexe d’achat) ?
Mais si tout cela semble encore tenir, si certains peuvent encore parler d’un secteur du livre et non pas uniquement d’un champ de ruines, c’est grâce à la puissance d’aliénation du système. Ainsi, exemple symptomatique, dans le cas de retours importants d’invendus effectués par le libraire — retours importants qui sont aujourd’hui la règle, puisqu’un tiers du volume de nouveautés distribuées est retourné par les librairies — le distributeur, qui centralise aussi les flux financiers, a dans un premier temps versé à l’éditeur une somme correspondant à l’ensemble des marchandises reçues et payées au distributeur par le libraire. Le droit de retour, spécifique au commerce du livre, permet au libraire de retourner les livres qu’il n’a pas vendus (ce qui explique les difficultés, pour l’éditeur, à établir un plan de trésorerie prévisionnel : un livre vendu à une libraire ne l’est véritablement que si un client l’achète. Dans le cas contraire, la vente peut être invalidée et le livre retourner à l’éditeur). Le retour des invendus développe alors, dans ses conséquences financières, des rapports de force singuliers. Le libraire se voit non pas remboursé, mais crédité d’un avoir pour une future commande auprès du distributeur. L’éditeur quant à lui, de par les livres qui lui ont été réglés mais qui sont désormais retournés, se retrouve endetté auprès du même distributeur. Pour éviter d’avoir à rembourser son dû (qu’il n’est, sinon taux de ventes exceptionnel ou dynamisme miraculeux du fonds, jamais en mesure d’honorer), l’éditeur relance pour un tour, via de nouvelles parutions lui assurant de nouvelles liquidités, la circulation virtuelle de l’argent et celle, très concrète, des dettes.
Autrement dit, pour ne pas avoir à payer l’échec, annoncé de par la nature du marché, des livres déjà parus, l’éditeur publie de nouveaux livres, forcément toujours plus déficitaires selon l’évolution logique, irrésistible, de l’économie en place. Dans le secteur du livre, comme partout ailleurs, l’endettement se fait à la fois agent actif et ralentisseur utile de l’effondrement en cours. Et quelques acteurs, toujours plus minoritaires, bénéficient de plus en plus largement de cette catastrophe, le temps que ça durera.
Il importe de noter enfin comment les aides publiques (soient-elles régionales, étatiques, européennes) participent depuis des décennies, dans tous les secteurs de l’économie réelle et financière, à diluer dans le temps et l’espace nombre des conséquences du désastre. Ce système de protection institutionnalisé rallonge ainsi la durée de l’effondrement global, prolonge l’espace-temps du profit, et lui permet de développer toujours plus avant ses effets de nuisance matériels et psychiquesL’industrie culturelle est le secteur de production capitaliste dont le pouvoir de nuisance reste le plus inconsidérément négligé. En ce qu’elle ruine des puissances esthétiques — et dévaste ainsi des rapports exclusifs qu’entretiennent, de tout temps, ces puissances de bouleversement avec les champs perceptifs, sensibles, intellectuels, symboliques, psychiques, techniques, politiques, sociaux —, l’industrie culturelle a des effets destructeurs démesurés sur ce tout commun qui agence les possibilités, pour chacun d’entre nous, humains, d’exister.. Les aides et subventions publiques sont aussi vitales pour la majorité des acteurs culturels, réduits à la dépendance et la précarité, qu’elles composent au final un rouage du hold-up généralisé qu’est le système organisé de captation de la richesse publique par le secteur privé.
Autrement dit, aussi : il n’y a aucun problème particulier dans l’économie actuelle du livre, dans son régime terminal de surproduction marchande et de paupérisation, économique et libidinale, généralisée, et aucune manière d’accommodement ou d’amélioration à espérer, puisque le dysfonctionnement est l’ordre de ce monde, capitaliste. L’écoulement productiviste ne connaîtra pas la moindre suspension. Tout fonctionne à l’idéal, droit dans le mur.
Hachette, un empire vieux de deux siècles —
En 2026, l’empire fondé par Louis Hachette en 1826, au cœur du quartier des Écoles, à deux pas de l’actuelle Sorbonne, aura deux siècles. Loin d’avoir subi l’usure du temps, ce groupe d’édition demeure numéro un en France, avec un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2023, et numéro six dans le monde. Premier ou deuxième selon les années au Royaume-Uni, leader du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande, numéro trois aux États-Unis, fortement implanté en Amérique latine, mais également en Asie, il n’a rien perdu de sa superbe en passant des mains de la famille Lagardère dans celles des Bolloré en 2022. Son concurrent immédiat, le groupe Editis, que le groupe Vivendi a échangé contre le numéro un, ne pèse que 751 millions d’euros en termes de chiffre d’affaires, et les trois suivants, Média-Participations (702 millions), Madrigall (Gallimard et Flammarion, 612 millions) et Huygens de Participations (Albin Michel, 231 millions) ne peuvent rivaliser avec lui« Classement des éditeurs 2024 », Livres hebdo, nº 45, septembre 2024, p. 52-59.. Avec deux tiers de son chiffre d’affaires réalisé à l’extérieur de la France, il a réussi, à partir de 2006 — date de son rachat de Time Warner Book Group — une internationalisation entamée après 1980, année de la reprise d’un empire demeuré familial par l’industriel Jean-Luc Lagardère. En décidant, fin 2024, de scinder le groupe Vivendi en quatre entités dont l’une porte désormais le nom de Louis Hachette Group (LHG), les actionnaires de l’entreprise Vivendi (16 milliards d’euros en 2021 ; 9,5 en 2022 après scission avec Universal Music) ont rendu hommage à un nom dont ils entendent bien faire un élément dynamique de leur capital. Ainsi, au moment où cet empire multimédia fêtera ses deux cents années de domination sans partage du monde de l’information et de la communication, le fondateur, Louis Hachette, sera-t-il invité à continuer à faire fructifier le dividende de ceux qui ont décidé de faire revivre son patronyme en l’enrôlant dans une bataille idéologique sans précédent ?
Si la concentration dans le monde de l’édition est un phénomène ancien en FranceJean-Yves Mollier, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, 2e éd., Montreuil, Libertalia, 2024., elle a pris, en 2022, lors de l’OPA réussie de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère, une tonalité différente. En effet, lorsque le patron du groupe Vivendi, propriétaire d’Editis depuis janvier 2019, a tenté d’ajouter au numéro deux le leader du marché, il n’a pas simplement voulu marier deux géants de l’imprimé, comme s’y était essayé Jean-Luc Lagardère à l’automne 2002. Il a délibérément cherché à mettre son empire médiatique au service de son idéologie. Il le disait et le répétait à ses proches depuis qu’il avait quitté l’univers des ports africains et du bois en 2014 pour diriger Vivendi : la France était foutue si l’Église ne redressait pas la barreVoir Vincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022, p. 53. Vincent Bolloré considère que seule l’Église a la capacité de l’aider dans ce qu’il dénomme son « combat civilisationnel ».. Pour ce Breton féru de voile et de marine, propriétaire d’un yacht qu’il prêtait parfois à ses amis, notamment Nicolas Sarkozy pour son mariage avec la France, en 2007, l’Église catholique ne pouvait être que réactionnaire et favorable aux partis de droite plutôt qu’à ceux de gauche. Rejetant comme un songe infernal l’époque de Témoignage chrétien, des prêtres ouvriers, Vincent Bolloré ne voulait voir dans l’Église de France que l’héritière du baptême de Clovis et des rois capétiens. Reprenant en partie le drapeau qu’avait brandi Rémy Montagne lors de la création du groupe Média-Participations en 1985, afin de mettre son groupe de presse et d’édition au service de Jean-Paul II et de son message adressé à la jeunesseJean-Yves Mollier, « Média-Participations, une offensive catholique sur le terrain de l’idéologie », dans Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, op. cit., p. 89., Vincent Bolloré décidait de ranger ses chaînes de télévision et de radio, ses journaux et ses maisons d’édition en ordre de bataille pour remporter ce qui est devenu sa campagne de France lors des élections législatives de 2024.
Par cette décision qui entraîna le passage d’Éric Ciotti aux côtés du Rassemblement national, l’homme d’affaires rompait avec la tradition de neutralité officielle du patronat français lors des grandes compétitions électorales et tournait le dos à la position de Jean-Luc Lagardère. Quoique proche de Jacques Chirac, ce dernier avait toujours entretenu des rapports amicaux avec la direction du Parti socialiste et même avec le ministre communiste Jean-Claude Gayssot. Manifestement, l’opération lancée en 2020, réussie dès 2022, mais finalisée définitivement en 2024, affichait sa singularité. Si l’on cherche à tout prix à lui trouver des antécédents, on peut la rapprocher de ce que fut, dans les années 1930, l’OPA du parfumeur François Coty (Joseph Marie Spoturno) sur Le Figaro, mis au service d’un groupe nettement orienté à l’extrême droite de l’échiquier politique. Mais, chaque époque étant, par nature, différente, c’est dans le contexte propre aux années 2020 qu’il convient de se situer. Vincent Bolloré a vu l’opinion états-unienne changer, et celle de l’Europe de l’Ouest s’aligner progressivement sur son modèle. C’est en toute connaissance de cause, et en songeant à Donald Trump, à Elon Musk et à Rupert Murdoch qu’il a décidé de faire du groupe Hachette Livre un auxiliaire de son « combat civilisationnelVincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, op. cit., p. 20. ».
La naissance d’un empire médiatique
Né en 1800, mort en 1864, Louis Hachette laissait en héritage à ses enfants et à ses gendres, un empire orienté vers la diffusion à grande échelle de la presse et des livres, en France, et, déjà, hors de ses frontièresJean-Yves Mollier, Louis Hachette (1800–1864). Le fondateur d’un empire, Paris, Fayard, 1999.. Pendant vingt-cinq ans, de 1826 à 1851, il avait régné sur l’édition scolaire et universitaire, sans chercher cependant à sortir de son périmètre initial. Libraire au Quartier latin après avoir été chassé, comme ses condisciples, de la prestigieuse École normale (supérieure) en 1822, fermée pour cause de libéralisme et de fronde de la religion catholique, il avait ajouté à sa formation de latiniste et d’helléniste une solide culture juridique acquise sur les bancs de l’École de droit. Devenu libraire en 1826, en raison d’une opportunité, il avait immédiatement mis en chantier les livres que réclamait la mise en place d’une réforme de l’instruction qui se voulait universelle, et il s’était mué en éditeur scolaire protégé des autorités au moment où François Guizot jetait les bases d’une école primaire gratuite pour les garçons pauvresLa loi du 28 juin 1833 impose à toutes les communes de plus de 500 habitants l’entretien d’une école et la gratuité de l’enseignement pour les enfants « indigents ».. Avec la vente au ministère de l’Instruction publique, en 1831, 1832 et 1833, d’un million d’exemplaires de l’Alphabet et premier livre de lecture, il entame le décollage de sa maison d’édition. Accusé d’être un « monopoleur » par les autres éditeurs scolaires, qui le soupçonnent d’entretenir des liens incestueux avec les hôtes de la rue de GrenelleC’est le siège du ministère de l’Instruction publique devenu, en 1932, ministère de l’Éducation nationale., il domine rapidement l’ensemble de la production des manuels scolaires, des salles d’asile — ancêtres des maternelles — aux classes terminales des lycées.
Dans les années 1830–1850, il transforme une modeste boutique de la rive gauche de la Seine en un vaste domaine immobilier qui s’étend sur le boulevard Saint-Germain, la rue Hautefeuille, la rue Serpente et ce qui deviendra plus tard le boulevard Saint-Michel. Dans cette ruche où travaillent plusieurs centaines d’employés, du lundi au dimanche midi, la division du travail rationalise les tâches, et des directeurs de collection, les premiers en France, sont recrutés afin de faire de l’édition une activité de plus en plus standardisée. Des périodiques vantant les ouvrages publiés par la librairie Louis Hachette et Cie s’adressent au personnel enseignant qui fournit également les rédacteurs des manuels. Avec l’édition de dictionnaires, dont le fameux Littré sorti des presses au début des années 1860, d’encyclopédies, de matériel pédagogique et de tout ce qu’on appellera plus tard le « parascolaire », cette entreprise affiche sa capacité à étendre ses tentacules sur tout ce qui touche, de près ou de loin, à l’enseignement.
En 1853, l’ouverture de la première « bibliothèque de gare », c’est-à-dire un kiosque installé dans l’embarcadère de la Gare du Nord à Paris, amorce une diversification qui va progressivement changer la nature de cette entreprise d’édition. Louis Hachette s’est inspiré de l’exemple du libraire britannique William Henry Smith qui s’était lancé à la conquête des loisirs des voyageurs de chemin de fer en 1848 à Londres. Toutefois, à la différence de son confrère, Louis Hachette n’a pas souhaité diffuser les livres de ses concurrents et se contenter de prélever la part revenant au libraire. Pendant les deux années où il a mûri son projet et négocié des contrats d’exclusivité avec les compagnies ferroviaires, il a mis au point une collection de livres baptisée « Bibliothèque des chemins de fer » et divisée en sept (puis huit) sections. Il a choisi de matérialiser ces divisions en affectant aux couvertures de chaque série une couleur bien distincte, le rose pour les livres destinés au jeune public, le saumon pour les romans, le rouge pour les guides de voyage, etc. Le succès de la première série sera tel que, dès 1857, la « Bibliothèque rose illustrée » sortira de la collection et sera gérée de façon autonome, source d’immenses profits dus au génie imaginatif de la comtesse de Ségur et de ses émules. Jamais, malgré ses nombreuses protestations, cette autrice ne sera rémunérée au pourcentage, en fonction des ventes, mais toujours au forfait, la privant, comme ses héritiers, de ressources financières très importantes puisque son droit d’auteur demeurera propriété de la Librairie Hachette cinquante ans après son décès.
En dehors de cette collection, celle des « Guides Joanne » qui changeront de couleur quand ils deviendront les « Guides bleus », a permis de fidéliser le public des voyageurs adultes et celui des touristes, au fur et à mesure que le réseau ferré tisse sa toile sur l’ensemble du pays. Des journaux destinés aux enfants et aux adolescents ont rejoint les périodiques précédents et, en 1862, un employé a été recruté pour diriger le service de publicité de la librairie, Émile Zola. Il fera, dans cette cathédrale du livre et de la consommation de produits culturels, son apprentissage des grands magasins, transposé plus tard dans le roman intitulé Au bonheur des dames. À la différence d’Honoré de Balzac, il n’a pas souhaité rédiger d’œuvre comparable à Illusions perdues qui aurait consigné son expérience de ces années, dont il écrit, dans sa correspondance, qu’elles lui ont permis de comprendre en profondeur les rouages du capitalisme d’éditionJean-Yves Mollier, L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1880–1920), Paris, Fayard, 1988, p. 213-219, pour les débuts d’Émile Zola dans l’édition.. Cette connaissance intime du lancement commercial d’un livre le conduira à privilégier la réclame des journalistes avant que le contenu de ses romans ne commence à choquer les plus conservateurs d’entre euxHenri Mitterand, Zola, 3 tomes, Paris, Fayard, 1999–2002..
Au moment où la maladie l’emporte, en 1864, Louis Hachette livrait une troisième bataille destinée à lui assurer le marché, si possible exclusif, des bibliothèques populaires. Ses kiosques de gares, où la vente des journaux dépasse celle des livres dès 1865, se sont multipliés sous le Second Empire au point de parvenir au millier en 1900, mais, pour éviter l’intervention de l’État dans la régulation de ce marché, Louis Hachette l’a ouvert à tous ses concurrents le 1er janvier 1860. En échange, ses services prélèveront 40 puis 45 % du prix de vente pour couvrir les frais de ces « boutiques à lire » ouvertes au cœur des villes. Dans les années 1930, quand la diffusion des publications de la librairie Gallimard sera prise en charge par les Messageries Hachette, ce pourcentage passera à 48 %, et, en 1971, à 52 %. Toutefois, la décision d’augmenter la part du diffuseur cette année-là provoquera la rupture du contrat et la création, par le groupe Gallimard, de ses propres structures de diffusion et de distribution, le CDE et la SODIS. Comme on le voit, à travers cet exemple, la Librairie Hachette, qui conservera cette raison sociale jusqu’en 1971, possède aujourd’hui une très longue expérience de la distribution des livres puisqu’en 1897 elle a ajouté au réseau de ses bibliothèques de gare, celui de ses puissantes messageries, ces deux départements représentant, en 1939, 60 % de son chiffre d’affairesfootnote:XXe siècle, Paris, Fayard, 2008, p. 49-54.].
Au décès du fondateur, la société en nom collectif Louis Hachette et Cie était déjà la plus grosse entreprise d’édition en Europe et elle possédait des succursales en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et songeait à implanter le Département Étranger Hachette (DEP) aux États-Unis. Possédant des actions dans des papeteries et des imprimeries, ayant racheté de très nombreuses maisons d’édition en difficulté, elle avait étendu les rameaux d’un capitalisme à la fois vertical et horizontal qui avait amené son créateur à diriger le Cercle de la Librairie tout en accumulant une fortune considérable dont les deux châteaux du Plessis-Piquet et du Loiret n’étaient que la partie émergée. Après avoir associé ses deux gendres puis ses deux fils, plus jeunes, à son entreprise, il avait pris toutes les garanties pour qu’elle lui survive et continue à se développer après sa mort. Il avait suscité bien des jalousies et été, plus d’une fois, l’objet d’attaques venimeuses en raison de sa tendance à chercher à constituer des sortes de monopoles, et il avait noué des alliances stratégiques avec tous les pouvoirs, mais n’avait jamais songé à entamer lui-même une carrière politique. Sa proximité avec le demi-frère de l’Empereur, le duc de Morny, ainsi qu’avec Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique et directeur de collection chez Hachette, avait suscité de nombreuses inimitiés, mais il avait triomphé de tous les obstacles et construit un véritable empire de l’imprimé.
La Librairie Hachette de 1864 à 1980
Avec ses messageries de presse qui font travailler 5 à 6 000 ouvriers dans le quartier Réaumur-Drouot, en rive droite, dès 1920, puis ses messageries du livre, bâties au même moment dans le quartier de Javel, en rive gauche, la Librairie Hachette diffuse et distribue l’ensemble de la presse nationale et près de 70 éditeurs en 1939. Grâce à l’efficacité de son service commercial, elle dispose de 80 000 points de vente à cette date, et son chiffre d’affaires a pris un tel embonpoint qu’il a fallu modifier la structure juridique de l’entreprise. Transformée en société anonyme en 1919, au moment où la Banque de Paris et des Pays-Bas entre au capital et achète le quart des actions afin de disposer de deux sièges au conseil d’administration, la Librairie Hachette est cotée à la Bourse de Paris depuis 1922 et bénéficie d’une croissance qui fait bien des envieux. Du côté des éditeurs et des libraires, Larousse et Armand Colin ont organisé une Maison du Livre français, en 1920, pour tenter d’enrayer la domination des Messageries Hachette, mais celle qu’on appelait la « pieuvre verte » depuis 1900 puis le « trust vert » autour de 1930 a continué à écrire sa success story. Même la nationalisation de la SNCF, en 1937, n’a modifié en rien les contrats antérieurs et la Librairie Hachette a conservé son monopole sur les bibliothèques de gare, présentes dans le métro depuis 1905, et, plus tard, dans les aéroports sous la forme des Relay.
Accusée de censurer le contenu de ses bibliothèques de gare à plusieurs reprises, y compris à la Chambre des députés, elle est en butte aux attaques de la CGT en 1936. Les conditions de travail dans son « bagne » industriel, les messageries, y sont dénoncées, sans pour autant obtenir le départ de son directeur, Georges Lamirand, futur secrétaire d’État à la Jeunesse du maréchal Pétain. L’entrée de l’armée allemande à Paris, le 14 juin 1940, aurait pu aboutir au démantèlement de cet empire, mais le ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop, et celui de la Propagande, Joseph Goebbels, ont préféré négocier un arrangement et se sont contentés de faire administrer l’entreprise et les messageries par des militaires sans la mettre en vente comme ils l’ont fait pour Calmann-Lévy ou Nathan. En raison de la durée des négociations qui traînèrent en longueur, les dirigeants de la Librairie Hachette prétendront, à la Libération, avoir résisté aux pressions allemandes. La consultation de leurs archivesCelles-ci, classées « monument historique » en 2002, sont déposées à l’IMEC, à l’abbaye d’Ardenne, où nous les avons consultées à de nombreuses reprises. — la correspondance des gérants — dément cependant totalement cette version, Edmond Fouret ayant cherché à bâtir un système de messageries européen dans lequel sa société aurait possédé 51 % du capital et les nazis 49 % alors que ceux-ci proposaient l’inverse et exigeaient le contrôle du Département Étranger HachetteJean-Yves Mollier, L’Âge d’or de la corruption parlementaire. 1930–1980, Paris, Plon, 2018, p. 26-43..
C’est pendant la période qui s’étend du mois d’août 1944 au mois de mai 1947 que, pour la première fois de son existence, cette entreprise dont le chiffre d’affaires avait atteint 1,4 milliard de francs en 1939, a failli disparaître. La mise sous séquestre des messageries, dès le départ des Allemands, puis la volonté des résistants de léguer au pays des institutions nouvelles dans lesquelles un système de distribution de la presse permettrait l’accès de tous à l’information, annonçaient une nationalisation qui était la bête noire des dirigeants de la société. Pour empêcher ce plan d’être mis à exécution, les privant de leur principale source de revenus, ceux-ci organisèrent une riposte de grande ampleur qui nécessita le concours des banques d’affaires et la complicité d’une partie des propriétaires de journaux. Dans un premier temps, il fallut mettre sur pied une société de messageries concurrente, L’Exécutive, dotée d’une trésorerie lui permettant de consentir des avances importantes aux journaux, et, dans un second, mobiliser, à l’Assemblée nationale, les « députés d’Hachette » dont deux d’entre eux auront une belle carrière, Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand, tous deux opposés, comme le radical Édouard Herriot, à la nationalisation, synonyme, affirmaient-ils, de despotisme ou, pire, de totalitarismeIbid., p. 85-208, où nous décrivons en détail la stratégie de la Librairie Hachette et les compromissions des députés amis..
Le vote de la loi Bichet, en février 1947, allait signifier à la fois la victoire d’une entreprise qui avait fait rédiger par ses avocats dans les locaux de sa filiale, L’Exécutive, la loi que défendit Robert Bichet, au nom du MRP et de ses alliés, et la résistance des syndicats qui, grâce aux statuts des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), seront protégés et en mesure d’obtenir des conditions de travail et de rémunération sans rapport avec la situation qu’ils avaient connue avant 1940. Très ambiguë par conséquentVoir Laurence Franceschini et Camille Broyelle (dir.), La loi Bichet sur la distribution de la presse, 70 ans après, Paris, Université Paris II-Panthéon-Assas, 2018., cette législation finira par devenir le symbole d’une époque faste à la fin du [smallcaps]#e siècle, quand les syndicats perdront le contrôle des NMPP. Mais on ne saurait oublier les conditions de son adoption, symptomatiques du pouvoir corrosif de l’argent. Pour la Librairie Hachette, le nerf de la guerre était sauvé et puisque les statuts lui assuraient 49 % des actions des NMPP, il lui suffirait d’acheter, en sous-main au début, France-Soir puis d’autres titres de presse, pour disposer d’une partie des 51 % d’actions attribuées aux cinq coopératives de journaux. Dès l’entrée en fonction des NMPP, la Librairie Hachette était en mesure d’en contrôler le fonctionnement et, puisque le directeur était nommé par elle, et qu’elle percevrait 1 % du chiffre d’affaires, il lui suffirait d’accepter avec enthousiasme toutes les demandes d’augmentation du prix des journaux, accompagnées de la hausse des salaires du personnel, pour que son bénéfice augmente en permanenceIbid., p. 267-290 pour tous les chiffres de la période 1947–1970..
C’est grâce à ce système unique de financement que la Librairie Hachette put se passer du recours aux emprunts bancaires pendant une longue période et qu’elle bénéficia d’un trésor de guerre, disponible en argent « liquide » puisque les journaux s’achetaient alors au kiosque et se payaient comptant. Aux beaux jours des NMPP, son restaurant digne d’une table étoilée et sa cave considérée comme la meilleure de Paris firent des merveilles. L’aide généreuse accordée par les NMPP à tous les leaders de partis politiques qui s’engageaient à ne jamais voter en faveur de la nationalisation des messageries permit à ceux-ci de résoudre le douloureux problème du financement des campagnes électorales. François Mitterrand, président de la FGDS, s’est vu attribué, pour l’année 1967, une rente équivalente à la somme de 4 500 à 5 000 € par mois versée par lesdites NMPP et déclarée à l’Urssaf puisqu’il s’agissait, officiellement, de la rémunération d’études « documentairesDans les archives des NMPP, la pochette « Contacts politiques. Réaumur NMPP » est sans ambiguïtés sur le financement des partis politiques. ». On peut remarquer que les archives des NMPP ont bien conservé la trace des versements accordés aux hommes politiques de la FGDS, du PSU et de l’UNR cette année-làfootnote:XXe siècle, op. cit., p. 283-290.], mais aucune d’éventuels travaux justifiant ces rémunérations. Prévue dans la troisième partie du Programme commun de gouvernement de la gauche, signé en juin 1972, la nationalisation des NMPP avait disparu des 110 Propositions de François Mitterrand en 1981, sans que cela ait troublé les consciences tant la victoire de la gauche effaça, au moins provisoirement, le souvenir de ces petits accommodements.
Hachette chez Lagardère
En décembre 1980, Jean-Luc Lagardère rédigeait un communiqué de presse annonçant son raid victorieux sur ce qui était devenu, en 1971, le Groupe Hachette. Avec 41 % des actions rachetées discrètement par une banque amie, l’homme d’affaires allait ajouter à la station de radio Europe numéro 1, contrôlée par Matra, un empire possédant plus de 200 journaux et magazines, dont France-Soir, Paris Match, Elle, Télé 7 Jours, des maisons d’édition prestigieuses, parmi lesquelles Fayard, Grasset et Stock, ainsi que la maison-mère du Livre de Poche, la LGF. Jusqu’en 1993, Hachette caracole en tête mais, cette année-là, il est dépassé par le Groupe de la Cité (Havas, Larousse, Nathan, Plon, Perrin, Presses de la Cité) constitué en 1988 et bien décidé à continuer à grossir. Neuf ans plus tard, cette entreprise, dominée par son actionnaire principal, la Compagnie générale des eaux, rebaptisée Vivendi, et qui était devenue Vivendi Universal Publishing (VUP), s’écroulait et était rachetée par Jean-Luc Lagardère. Au terme d’une bataille qui mit aux prises l’ensemble du monde du livre, syndicats d’auteurs, de libraires et d’éditeurs, Arnaud Lagardère qui avait succédé à son père, décédé en 2003, était autorisé par la Commission européenne à reprendre 40 % de VUP tandis que les 60 % restants, dénommés la même année Editis, étaient vendus au fonds Wendel Investissement. Grâce à cet achat qui faisait tomber les maisons Dalloz, Harrap’s, Larousse, Nathan, dans l’escarcelle du groupe Lagardère, celui-ci devenait le leader incontesté du marché français et un acteur international de plus en plus présent dans les bassins linguistiques anglophone et hispanophone.
Deux ans plus tard, en 2006, le démantèlement du géant de la communication AOL Time Warner, et la reprise de sa branche livre, Time Warner Book Group, qui venait s’ajouter à Hodder Headline, Octopus et Chambers également absorbés, transformait le groupe Hachette en un énorme conglomérat réalisant 70 % de son chiffre d’affaires hors des frontières de la France. Dans l’Hexagone, le duopole Hachette-Groupe de la Cité (puis VUP) a disparu et l’écart entre le numéro un et le numéro deux ne cessa de se creuser puisqu’à l’aube des batailles qui vont faire entrer en jeu la famille Bolloré, Hachette réalisait un CA de 2,6 milliards d’euros contre 800 à 850 millions pour Editis, propriété de Grupo Planeta depuis 2008, puis de Vivendi qui l’a récupéré en janvier 2019. D’autres mutations, plus souterraines, sont intervenues dans la gestion d’un groupe qui a renoncé à sa vocation industrielle pour lui substituer une ambition financière conforme à l’air du temps qui impose la recherche d’une « valeur pour l’actionnaire » transformée en boussole des grandes entreprisesJean Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, éditions du Seuil, 1985, et Michel Diard, « Comment la finance a transformé le groupe Lagardère », La revue des médias, en ligne sur : https://larevuedesmedias.ina.fr/comment-la-finance-transforme-le-groupe-lagardere, consulté le 12/02/2025.. Jean-Marie Messier y a perdu son poste de PDG de Vivendi Universal en 2002 quand la bulle financière a éclaté, mais Arnaud Lagardère a emprunté une voie similaire quand il s’est résolu à vendre ses actions dans EADS et Canal+ (pour 3 milliards d’euros), puis la plupart de ses journaux reçus en héritage à la mort de son père.
Dès 1981, en prévision de l’arrivée de la gauche au pouvoir, Jean-Luc Lagardère avait modifié les statuts de sa holding, la Financière MarlisÀ cette date, Hachette avait 51,5 % des actions, Hachette Filipacchi Médias, 20 %, le reste appartenant aux banques., et, en 1993, il constitua une SCA (société en commandite par actions) chargée de lui assurer le contrôle de ses entreprises sans y être majoritaire. Il avait dû vendre une partie des actifs immobiliers de l’ancienne Librairie Hachette, notamment le siège des NMPP, puis, en 1995, celui de la maison-mère au Quartier latin. Ces deux opérations effacèrent une partie des dettes (7 milliards de francs) laissées par l’aventure de La 5, la chaîne de télévision lancée par Silvio Berlusconi, et, à sa mort en 2003, Jean-Luc Lagardère était à la tête d’un empire solide divisé en quatre entités rentables. Très bien gérée, d’abord par Jean-Louis Lisimachio, puis par Arnaud Nourry, Hachette Livre allait devenir la vache à lait du groupe et sa part n’a cessé de grossir, passant de 11 % en 2004 à 29 % en 2013Michel Diard, art. cit., au fur et à mesure des investissements malheureux d’Arnaud Lagardère dans le sport et les chaînes de télévision qui l’ont amené à se séparer d’une grande partie de son patrimoineJean-Yves Mollier, Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, op. cit., p. 126-137.. Au-delà de ces chiffres, c’est la rentabilité de Hachette Livre au sein de Lagardère Groupe qui a pris une dimension jamais observée du temps de Jean-Luc Lagardère. Cette surexposition de Hachette à l’intérieur du groupe Lagardère n’a évidemment échappé ni au fonds d’investissement Amber Capital, le premier à avoir songé à évincer Arnaud Lagardère de son poste, ni à Vincent Bolloré appelé par Nicolas Sarkozy en 2020 au chevet d’une entreprise qui avait cru que l’ancien président de la République serait la recrue qui permettrait de redresser la barre.
La suite de cette aventure est connue : dès le mois de juin 2022, Vivendi avait acheté plus de 50 % des actions de Lagardère et était, mécaniquement, en mesure de contrôler Hachette Livre que Vincent Bolloré entendait fusionner avec Editis. C’était la reprise d’un scénario qui n’avait pas plus de chances d’aboutir en 2022 qu’en 2002, la Commission européenne ne pouvant décemment laisser se réaliser une telle concentration. Toutefois, comme on l’a vu, Vincent Bolloré n’était pas un chef d’entreprise comparable à Jean-Luc Lagardère ou à Jean-Marie Messier. Proches, pour le premier de Jacques Chirac, pour le second d’Édouard Balladur, ils n’avaient jamais confondu leurs amitiés politiques avec la gestion de leurs affaires. Avec Vincent Bolloré, le but poursuivi n’était plus strictement financier ni économique, et encore moins industriel. Il s’agissait d’offrir à la diffusion de ses idées et de son idéologie une panoplie de médias dans lesquels le livre aurait toute sa place. On revenait à la stratégie déployée par Rémy Montagne (fondateur de Média-Participations) en 1985–1990, mais, cette fois, il n’était plus question de spiritualité ou de message évangélique, mais, plus prosaïquement, de mettre la France en harmonie avec les dirigeants les plus autoritaires de la planète.
Il appartiendra aux historiens du futur de dire si ces plans de conquête de l’opinion par tous les moyens ont abouti ou ont été abandonnés en cours de route, mais le passage du groupe Hachette des mains de la famille Lagardère aux mains du clan Bolloré a constitué un changement majeur, et même une rupture, à l’intérieur du paysage éditorial français.
Quoi qu’il ait pu en dire, Arnaud Lagardère a été le jouet de forces qui le dépassaient et il a fini par vendre, à la fin de l’année 2024, les dernières actions qu’il possédait dans le Groupe Lagardère, preuve évidente de sa rapide descente aux enfers.
Demeure une inconnue : les volontés des enfants de Vincent Bolloré, appelés à le remplacer à la direction de Vivendi, mais pour le moment muets quant à leur vision de la stratégie qu’il conviendra d’adopter. La décision de créer la division Louis Hachette Group, chargée de réunir tous les médias possédés par Vivendi, est un hommage rendu à l’homme qui fonda son empire, deux siècles plus tôt. Toutefois, la volonté de ses successeurs d’intervenir dans le débat public en pesant sur les orientations politiques du pays n’a plus aucun rapport avec la gestion d’un groupe qui avait su s’entendre aussi bien avec des dirigeants légitimistes, puis orléanistes, et, après 1870, avec des républicains modérés, radicaux et même socialistes…
L’empire Bolloré s’étend à l’édition : la construction d’un leader mondial de la culture —
Rachat de médias, de chaînes télé, de magazines, d’agences de communication, de groupes publicitaires… L’empire de Bolloré n’a cessé de grandir et s’étend aujourd’hui au secteur de l’édition. Il commence en 2018 avec l’acquisition d’Editis, deuxième groupe éditorial français, puis il s’attaque dès 2020 à son rival, Hachette Livre, le numéro un de l’édition en France et numéro six dans le monde.
C’est Vivendi, une filiale du groupe Bolloré, qui est à la manœuvre. Les opérations ont un objectif clair, que rappelle chacun de ses communiqués de presse : « Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communicationCommuniqué de presse de Vivendi, 02/07/2018 (voir la partie en fin de page « À propos de Vivendi »), disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-sort-capital-de-fnac-darty-poursuivant-developpement-de-partenariats-2/. Toutes les ressources en ligne ont été consultées en février 2025.. » Aujourd’hui, et depuis la prise d’Hachette, l’objectif est clairement atteint. Vivendi se présente désormais comme le leader mondial dans les contenus, les médias et la communicationCommuniqué de presse de Vivendi, 09/12/2024 (voir la partie en fin de page « À propos de Vivendi »), disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-le-projet-de-scission-adopte-a-plus-de-975-par-lassemblee-generale-des-actionnaires/. Sur son site, le groupe Bolloré qualifie même sa filiale de « leader mondial de la cultureExtrait du site du groupe Bolloré présentant les activités de Vivendi, disponible sur : https://bollore.com/fr/activites-et-participations-2/communication/vivendi/ ». Ce texte se propose de revenir sur les acquisitions majeures du groupe Bolloré qui ont mené à la construction d’un empire médiatique dominant, révélant une stratégie d’expansion redoutable.
Tout d’abord et afin de comprendre les enjeux qui se trouvent derrière ces opérations, il convient de préciser que l’entrée dans le capital d’une entreprise passe par l’achat de titres, que l’on appelle parts sociales ou actions selon la forme juridique de l’entreprise. Cette entrée dans le capital (dite prise de participation) peut aboutir à une prise de contrôle lorsque la part de capital acquise permet d’obtenir une majorité suffisante à l’assemblée générale (l’organe décisionnel de l’entreprise). La prise de contrôle peut être amicale lorsque l’entreprise cible est informée et favorable à l’opération, ou bien hostile lorsque celle-ci lui est imposée. La loi vient encadrer ces prises de participation et lorsqu’une entreprise acquiert plus de 30 % du capital d’une autre entreprise, elle doit obligatoirement déposer une offre publique d’achat (OPA) sur la totalité du capital. Ce seuil de 30 % vise à protéger l’entreprise cible des prises de contrôle dites « rampantes », c’est-à-dire exercées en prenant une partie du capital permettant de constituer une minorité de blocage, sans prise de contrôle officielle. De plus, les OPA sont conditionnées au paiement d’une prime de contrôle très coûteuse. Dernier point devant être précisé, l’acquisition de titres permet d’obtenir des voix lors des votes à l’assemblée générale qui, même si elles ne sont pas majoritaires, permettent d’exercer une influence sur les décisions stratégiques, comme la nomination des dirigeant·es, ou celle des membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise.
Pour Bolloré, le procédé est souvent le même : au départ, une entrée au capital d’une société présentée de façon amicale (parfois, elle est au contraire souterraine pendant plusieurs mois), suivie de rachat progressif de titres jusqu’à la prise de contrôle. Lorsqu’il ne parvient pas à son objectif, il revend ses titres et encaisse d’importantes plus-values, lesquelles sont ensuite utilisées pour lancer une nouvelle prise de pouvoir sur une autre société« L’empire médiatique de Vincent Bolloré ne cesse de croître », Radio France, L’Enquête des Matins du Samedi, 12/02/2022, disponible sur : https://radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-enquete-des-matins-du-samedi/l-enquete-des-matins-du-samedi-du-samedi-12-fevrier-2022-1008926. Et il fait bien ses calculs : ses prises de contrôle sur les autres sociétés restent très souvent en deçà de ce seuil de 30 %, lui évitant ainsi le paiement de la prime de contrôle.
Acquisition après acquisition
Tout commence en 1981 lorsque Vincent Bolloré reprend les Papeteries Bolloré spécialisées dans le papier ultrafin, notamment connues pour le papier cigarette OCB : O pour le fleuve breton Odet près duquel se situait le premier moulin à papier de l’entreprise familiale, C pour les bois de Cascadec dans lesquels était située la première usine, et B pour Bolloré. C’est à ce moment-là qu’il sauve l’entreprise familiale, alors en grandes difficultés financières, en positionnant son activité dans la production de plastique ultrafin. Il la transformera ensuite en un groupe d’activités diverses (logistique pétrolière, premier distributeur indépendant de fioul domestique en France, films plastiques, flux des personnes, concessions portuaires, plantation de palmiers à huile en Afrique et en Asie…) avec d’ores et déjà un intérêt pour les médias.
Dès 1998, le groupe Bolloré tente une prise de contrôle du groupe Bouygues, propriétaire de la chaîne TF1, dont il finit par acquérir 12,6 % du capital. Son idée est de recentrer les activités de Bouygues exclusivement sur la chaîne télé : « Toutes les autres activités du conglomérat (BTP, travaux publics, routes) et même Bouygues Telecom doivent être vendues, selon lui. Tout doit être mis en œuvre pour conforter la pépite du groupe : la première chaîne est celle qui a le plus d’audience, le plus de recettes publicitaires en France« Bolloré : la marche vers un empire médiatique », Mediapart, 21/02/2022, disponible sur : https://mediapart.fr/journal/economie/210222/bollore-la-marche-vers-un-empire-mediatique. » Sa première tentative sera finalement un échec, lancer une OPA lui coûterait trop cher. Vincent Bolloré revend sa part à François Pinault (milliardaire et homme d’affaires, propriétaire du magazine Le Point). Néanmoins, avec cette transaction, il réalise une plus-value de 250 millions de francs qui lui permet de partir, la même année, à l’assaut d’un autre groupe : Pathé. Il entre d’abord à hauteur de 5 % du capital, sans que son PDG Jérôme Seydoux n’en soit informé« Vincent Bolloré veut monter à 20 % dans le capital de Pathé », Les Echos, 16/12/1998, disponible sur : https://lesechos.fr/1998/12/vincent-bollore-veut-monter-a-20-dans-le-capital-de-pathe-805106. Il monte ensuite jusqu’à 19,6 % du capital, avant de revendre sa part, réalisant une plus-value encore plus importante de plus de 800 millions de francs« Vivendi et Canal Plus rachètent la participation de Bolloré dans Pathé », Le Monde, 26/01/1999, disponible sur : https://lemonde.fr/archives/article/1999/01/26/vivendi-et-canal-plus-rachetent-la-participation-de-bollore-dans-pathe_3532587_1819218.html.
En 2000, le groupe fait son entrée dans le capital du label de musique américain Universal Music Group, présenté comme le « leader mondial du divertissement musicalExtrait du site du groupe Bolloré présentant les activités de Universal Music Group, disponible sur : https://bollore.com/fr/activites-et-participations-2/communication/universal-music-group/ ». En 2001, il achète la salle de spectacle l’Olympia, puis il entre dans le capital de Gaumont, propriété de Nicolas Seydoux, frère du Jérôme précité. Il dispose de 10 % du capital dès 2004, et cède ensuite sa part en 2017 pour un montant de 31 millions d’euros, réalisant alors une plus-value de plus de 100 % par rapport à son investissement initial, et de plus de 130 % en tenant compte des dividendes reçusCommuniqué de presse du groupe Bolloré, 06/04/2017, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/04-06-17-gaumont.pdf.
En 2004, le groupe Bolloré s’introduit dans le secteur de la publicité et de la communication. Il entre dans le capital de Havas, une entreprise française de conseil en communication, qui lui permet de bénéficier d’un premier pied d’influence dans la communication des marques Peugeot, LVMH, Danone, Canal+ ou Air France. Cette entrée en capital se fait discrètement par l’intermédiaire de quatre de ses filiales qui lui permettent de totaliser entre 4 % et 5 % du capital d’Havas. Son entrée ne sera d’ailleurs rendue publique qu’un mois plus tard. La prise d’Havas révèle la brutalité des manœuvres du groupe. En effet, en juillet 2004, Vincent Bolloré informait le PDG d’Havas, Alain de Pouzilhac, de son arrivée au capital en lui assurant « qu’il ne dépasserait pas 5 %« La bataille sans merci pour le contrôle d’Havas », Le Monde, 02/06/2005, disponible sur : https://lemonde.fr/actualite-medias/article/2005/06/02/la-bataille-sans-merci-pour-le-controle-d-havas_657428_3236.html ». Mais dès octobre 2004, le groupe Bolloré franchit les 20 % du capitalCommuniqué du groupe Bolloré, 02/10/2004, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/121004havas.pdf. Vincent Bolloré est nommé président en juin 2005, présidence qui dure 8 ans avant d’être remise à son fils, Yannick Bolloré, toujours en poste« Ces cinq “oups” qui ont forgé la légende Bolloré », Les Echos, 17/02/2022, disponible sur : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/ces-cinq-coups-qui-ont-forge-la-legende-bollore-1387652.
Le groupe Bolloré poursuit son expansion dans le secteur de la communication et se lance, en 2005, à l’assaut du groupe publicitaire britannique Aegis. Même procédé : il entre dans le capital par l’intermédiaire de plusieurs de ses filiales qui lui permettent de totaliser 6 % du capitalCommuniqué du groupe Bolloré 04/08/2005, disponible sur : https://www.bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/04082005aegisfr.pdf. Alors qu’il justifie cette prise de participation comme un simple placement financier sans intention d’en prendre le contrôle, il monte en quelques mois à près de 18 % du capital et en devient le premier actionnaire« Le groupe Bolloré continue de monter dans le capital du britannique Aegis », Le Monde, 16/10/2005, disponible sur : https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2005/10/16/le-groupe-bollore-continue-de-monter-dans-le-capital-du-britannique-aegis_699977_3236.html. Toutefois, il ne parvient pas à obtenir une place au conseil d’administration, mettant en échec ses possibles intentions de rapprocher Havas et Aegis pour en faire un acteur dominant du marché. Il ne s’arrête pas là et consolide sa position dans le secteur publicitaire en faisant l’acquisition, en 2006, de 40 % du capital de l’institut d’études et de sondages CSA qui réalise des études marketing et d’opinion dans tous les secteurs économiques, et qu’il présente là encore comme « un des leaders sur le marché françaisCommuniqué du groupe Bolloré, 10/07/2008, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/0709-08csa.pdf ». Il en détient la totalité dès 2008.
En parallèle, le groupe met un pied dans le secteur médiatique en lançant, en 2005, la chaîne Direct 8 sur la TNT (renommée C8 en 2016). Puis en 2007, il lance le journal MatinPlus (renommé ensuite DirectMatin, CNews matin et CNews), un quotidien gratuit français distribué dans 11 agglomérations à 900 000 exemplaires jusqu’en 2021. En 2010, il rachète la chaîne Virgin 17 au groupe Lagardère, renommée ensuite Direct Star. Fin 2011, l’audience des chaînes Direct 8 et Direct Star représente 3,5 % d’audience, et le journal DirectMatin compte 2,7 millions de lecteurices quotidien·nesRapport d’activité 2011 du groupe Bolloré, p. 4, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/12/bolloreinstitfrsecurise.pdf.
Les débuts de Vivendi : l’assaut sur la culture
Le groupe Bolloré connaît un tournant majeur en 2012 lorsqu’il entre dans le capital de Vivendi qu’il façonnera alors comme sa filiale « leader mondial de la culture ». L’entrée est étonnamment simple : en septembre 2012, il cède ses chaînes Direct 8 et Direct Star et reçoit en échange 1,8 % du capital de VivendiCommuniqué du groupe Bolloré, 27/09/2012, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/092712vivendi.pdf. Il cède la totalité des parts dont il dispose dans le groupe publicitaire Aegis (où il est finalement monté à 26,4 % du capital) pour 915 millions d’euros, qu’il réinvestit en achetant des actions Vivendi pour augmenter sa part dans le capital« La cession d’Aegis donne des munitions à Bolloré pour monter dans Vivendi », Les Echos, 13/07/2012, disponible sur : https://www.lesechos.fr/2012/07/la-cession-daegis-donne-des-munitions-a-bollore-pour-monter-dans-vivendi-360202. Dès octobre 2012, le groupe Bolloré dispose de 5 % du capital de Vivendi et devient le premier actionnaireCommuniqué du groupe Bolloré, 16/10/2012, disponible sur : https://bollore.com/bollo-content/uploads/2018/01/10-16-12-bollore-vivendi.pdf.
Avec Vivendi, les acquis de Bolloré prennent une autre ampleur. À cette date, Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard avec son jeu Call of Duty), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), et le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT)Communiqué de presse de Vivendi, 16/10/2012 (voir la partie en fin de page « À propos de Vivendi »), disponible sur : https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2012/10/20121016-CP121016-Bollore1.pdf. Mais surtout, Vivendi détient le numéro un français de la télévision payante, le groupe Canal+. Selon la présentation faite sur le site du groupe, Canal+ est « l’un des leaders de la création et de la distribution de contenus dans le monde », et est présent dans plus de 50 pays, avec 26,4 millions d’abonné·es, dont 17,1 millions en Europe, 8,1 millions en Afrique et 1,2 millions en Asie-Pacifique. Canal+ est également le premier actionnaire de MultiChoice (« leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone »), le premier actionnaire Viaplay (« leader scandinave de la télévision payante et du streaming »), ainsi qu’un actionnaire de Viu (« leader du streaming en Asie »). Enfin, avec sa filiale Studiocanal, Canal+ est le premier producteur et distributeur de longs métrages et de séries TV en Europe.
Dès septembre 2013, Vincent Bolloré est nommé vice-président du conseil de surveillance, puis président de Vivendi en juin 2014Communiqué de presse de Vivendi, 26/11/2013, disponible sur : https://vivendi.com/communique/projet-de-scission-du-groupe-valide-vincent-bollore-president-de-vivendi-apres-la-scission-arnaud-de-puyfontaine-directeur-general-des-activites-medias-et-contenus-composition-du-directoire/. Son arrivée à la tête de la direction se fait rapidement ressentir : les activités de Vivendi sont recentrées sur les médias et les contenus. C’est ce qu’il appelle « le nouveau Vivendi ». C’est alors le début de son projet de construction d’un groupe d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Les objectifs de Vivendi sont redéfinis : « le groupe a défini quatre grands sujets prioritaires que sont les contenus du futur, les data et leur monétisation, l’Afrique et la coopération et les projets entre filiales« Lettre à nos actionnaires », Vivendi, mars 2015, p. 4,disponible sur : https://vivendi.com/wp-content/uploads/2015/03/20150312_VIV_LAA_Vivendi_Lettre_aux_actionnaires_mars_2015.pdf ». Suivant ces objectifs dont celui de « renforcer ses positions en Afrique », la chaîne A+ est lancée fin 2014, « une nouvelle chaîne 100 % africaine faite pour et par des africains. […] A+ ambitionne de devenir la chaîne de référence de l’Afrique francophone, de refléter les identités et les spécificités du continent, et d’être résolument tournée vers le futurIbid., p. 5 : « A+ pousse ses pions en Afrique ». ».
En 2015, Vivendi développe ses activités dans le secteur du spectacle vivant avec la gestion des billetteries numériques. Présente dans le capital de la société de vente de billets Digitick dès 2010, Vivendi poursuit son expansion : Digitick devient See Tickets et est présent dans 9 pays en Europe et aux États-Unis avec plus de 20 millions de billets vendus en 2018Communiqué de presse de Vivendi, 15/02/2019, disponible sur : https://www.vivendi.com/communique/digitick-devient-see-tickets-mieux-servir-clients-promoteurs-de-spectacles/. L’Olympia utilise depuis cette plateforme pour sa billetterie. Le groupe lance également Vivendi Talent et organise dans la salle de spectacle son programme « Vivendi Talent Show », qu’il présente comme « visant à détecter et accompagner les talents de demain dans l’humour, la musique, le cinémaPrésentation de Vivendi Village, 26/10/2015, disponible sur : https://vivendi.com/wp-content/uploads/2015/10/20151026_VIV_PDF_Vivendi_Essentiel_2015.pdf ». Fière de sa position, Vivendi organise d’ailleurs les assemblées générales de ses actionnaires à l’Olympia à partir de 2015.
Encore en 2015, présenté comme le cœur de sa stratégie numérique, Vivendi acquiert 80 % du capital de Dailymotion pour un montant de 217 millions d’euros : « Avec Dailymotion, le Groupe dispose d’une plateforme de distribution OTT (over-the-top) de dimension mondiale et accède à une forte expertise technologique complémentaire à celle dont il dispose déjàCommuniqué de presse de Vivendi, 30/06/2015, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-finalisation-de-lacquisition-de-dailymotion-fr/. »
Toujours en 2015, Vivendi s’attaque aux frères Guillemot, propriétaires des sociétés de développement, d’édition et de distribution de jeux vidéo grand public Ubisoft (connue pour ses jeux Rayman, Assassin’s Creed, Prince of Persia) et Gameloft (Asphalt, Dungeon Hunter). En revendant 85 % des parts qu’elle possède chez Activision Blizzard, Vivendi acquiert 6,6 % du capital d’Ubisoft (pour 140,3 millions d’euros) et 6,2 % du capital de Gameloft (pour 19,7 millions d’euros)« Ubisoft : Yves Guillemot, l’homme qui a fait plier Vincent Bolloré », Les Echos, 21/03/2018, disponible sur : https://lesechos.fr/2018/03/ubisoft-yves-guillemot-lhomme-qui-a-fait-plier-vincent-bollore-987176. Dès 2016, elle détient 100 % du capital de Gameloft. Selon les chiffres publiés sur le site du groupe Bolloré, Gameloft a plus de 120 jeux vidéo à son catalogue et a une audience moyenne de 44 millions de joueur·ses mensuel·les en 2023. On relèvera, là encore, la brutalité des manœuvres mises en place, dénoncées par Yves Guillemot : « Nous avons le sentiment d’avoir vécu une agression. J’ai reçu un appel de Vincent Bolloré deux heures avant l’annonce de son entrée dans le capital d’Ubisoft. Il ne m’en a même pas parlé ! Cela a duré cinq minutes […]. Entre-temps, nous avons reçu un mail de Vivendi nous indiquant qu’ils étaient montés à 6 % dans notre capital« Yves Guillemot : “Vincent Bolloré se comporte avec nous comme un activiste” », Les Echos, 29/10/2015, disponible sur : https://lesechos.fr/2015/10/yves-guillemot-vincent-bollore-se-comporte-avec-nous-comme-un-activiste-256483. » Sa tentative de prise de contrôle est finalement un échec et Vivendi se retire d’Ubisoft en 2018 après être montée à 27,31 % du capital. Vivendi cèdera sa part pour un montant de 2 milliards d’euros, soit une plus-value de 1,2 milliard d’euros. À l’annonce de son retrait, elle rappellera néanmoins que : « Vivendi, qui détient déjà Gameloft, leader mondial des jeux pour mobile, confirme son intention de continuer à se renforcer dans les jeux vidéoCommuniqué de presse de Vivendi, 05/03/2019, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-cede-solde-de-participation-ubisoft/. »
Acquisition sur acquisition, le groupe continue d’étendre son rayonnement médiatique et culturel et poursuit son expansion. En 2016, Vivendi entre à hauteur de 26,2 % au capital de Banijay Group qu’elle présente comme l’« un des plus grands producteurs et distributeurs indépendants au monde de programmes télévisuelsCommuniqué de presse de Vivendi, 23/02/2016, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-est-entre-a-hauteur-de-262-au-capital-de-banijay-group/ », avec notamment les émissions et séries télévisées Koh Lanta, Fort Boyard, N’oubliez pas les paroles, Touche pas à mon poste !, On a échangé nos mamans, Tout le monde veut prendre sa place, L’Île de la tentation,L’Incroyable famille Kardashian, Les Ch’tis, Les Marseillais, The Simple Life, Totally Spies !, Foot 2 rue, LoliRock. Elle entre également cette même année dans le capital de la Fnac (à hauteur de 15 %) dans le cadre de son « partenariat stratégique fondé sur un projet de coopération dans les domaines culturelsCommuniqué de presse de Vivendi, 11/04/2016, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-entre-au-capital-de-la-fnac-dans-le-cadre-dun-partenariat-strategique/ ». Elle cèdera sa part en 2018 pour un montant de 267 millions d’euros, réalisant une plus-value de 108 millions d’eurosCommuniqué de presse de Vivendi, 02/07/2018, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-sort-capital-de-fnac-darty-poursuivant-developpement-de-partenariats-2/. Enfin, Vivendi se positionne comme « partenaire des festivals de l’été » et coproduit le Brive Festival, les Déferlantes, les Eurockéennes, Garorock, Hamac Festival, Hellfest, Mainsquare, Musilac, Marciac Jazz Festival et les Vieilles CharruesCommuniqué de presse de Vivendi, 25/07/2016, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-partenaire-des-festivals-de-lete/.
Précisons également qu’en plus de ses opérations en France, Bolloré s’étend aussi en dehors. Il avait notamment pour objectif de bâtir un empire en Italie : Vivendi est devenue la 1re actionnaire de Telecom Italia (prise de 24,9 % du capital), puis s’est immiscée dans le capital de l’importante chaîne italienne Mediaset (jusqu’à 28,8 %), en deuxième place juste après Silvio Berlusconi. L’autorité de régulation des médias et des télécoms italiens a estimé que Vivendi enfreignait la loi sur les concentrations en se plaçant de manière dominante à la fois dans le secteur de la télécommunication et dans le secteur des médias« L’Italie met un coup d’arrêt à l’offensive de Bolloré », Mediapart, 20/04/2017, disponible sur : https://mediapart.fr/journal/economie/200417/litalie-met-un-coup-darret-loffensive-de-bollore. La filiale a donc été contrainte de réduire sa participation dans le capital de Mediaset. Elle détient également 19,78 % de MediaForEurope, son « leader européen de la télévision, de la production audiovisuelle et d’internet », 11,87 % du capital de Prisa, son « leader des médias et de l’éducation en Espagne et dans le monde hispanophone », ainsi qu’une partie du capital de Telefónica, son « nº 1 des télécommunications en Espagne et au BrésilExtrait du site de Vivendi, « À propos — Vivendi est un leader dans les contenus, les médias et le divertissement », disponible sur : https://vivendi.com/notre-groupe/a-propos/ ».
L’échange de nos données numériques dans le groupe Bolloré
Fort de ses acquisitions dans les médias, les contenus et la publicité, le groupe commence à mettre en place des accords d’échange de données entre ses différentes filiales. Les data sont alors monétisées au bénéfice d’Havas qui peut mieux cibler ses contenus publicitaires et affiner ses stratégies marketing. En janvier 2015, Havas et Universal Music Group (UMG) mettent en place un partenariat : « Les données qu’UMG a en sa possession au travers de ses multiples artistes et genres musicaux seront croisées avec les données comportementales du groupe Havas pour mieux comprendre la corrélation entre les artistes, les fans de musique et les marquesCommuniqué de presse de Vivendi, 05/01/2015, disponible sur : https://vivendi.com/communique/havas-et-universal-music-group-creent-une-alliance-globale-centree-sur-les-donnees-musique-2/. » Les données transmises concernent les ventes de musique, l’activité de streaming en temps réel, mais aussi des données issues des médias sociaux, des écoutes radio et de billetteries.
En 2016, et dans cette même perspective, Bolloré fait racheter sa filiale Havas par son autre filiale Vivendi pour un montant de 2,4 milliards d’euros. Il s’agit alors d’une opération inédite qui vient réunir au sein de la même entité, deux activités habituellement séparées : la production de contenu et la publicité« Rachat de Havas par Vivendi : le mariage risqué des contenus et de la pub », Libération, 11/05/2017, disponible sur : https://liberation.fr/futurs/2017/05/11/rachat-de-havas-par-vivendi-le-mariage-risque-des-contenus-et-de-la-pub_1568960/. En parvenant à une connaissance pointue des consommateurices et de leurs données, l’objectif est de renforcer l’influence de Vivendi et lui assurer une maîtrise unique dans les médias, les contenus et la communication.
L’édition comme nouvelle cible
En juillet 2018, Vivendi lance des négociations pour acquérir Editis, deuxième groupe de l’édition française avec 50 maisons d’édition, 4 000 nouveautés publiées par an et un fonds de plus de 45 000 titresCommuniqué de presse de Vivendi, 30/07/2018, disponible sur : https://vivendi.com/communique/bonnes-performances-trois-principales-activites-de-vivendi-premier-semestre-2018/. À peine six mois plus tard, le 31 janvier 2019, Vivendi détient 100 % du capital. Pour Vivendi, « cette acquisition s’inscrit dans la logique de construction d’un grand groupe de contenus, de médias et de communicationCommuniqué de presse de Vivendi, 31/01/2019, disponible sur : https://vivendi.com/communique/edition/ ». Le rachat des acteurs principaux du secteur de l’édition est donc simplement la suite de son plan. L’arrivée de Bolloré inquiète, et à raison. Comme le souligne Mediapart, « les enjeux de rentabilité demeurent dominants dans les choix de Bolloré en matière éditoriale, puisque durant la première phase du rachat d’Editis par Vivendi en 2018, ce sont en priorité les départements techniques et commerciaux qui ont été repris en main, imposant fusions et “économies d’échelle”« Bolloré à l’assaut de l’édition », Mediapart, 01/10/2021, disponible sur : https://mediapart.fr/journal/culture-idees/011021/bollore-l-assaut-de-l-edition » (une augmentation des quantités produites afin de baisser le coût moyen de production).
Obstinée dans son offensive à grande ampleur dans l’édition, Vivendi s’attaque ensuite à son concurrent, le groupe Lagardère, propriétaire d’Hachette Livre. Le numéro 2 de l’édition française se lance alors dans la prise du numéro 1, et il va vite. En avril 2020, à peine un an après l’acquisition d’Editis, Vivendi cède 10 % de son capital d’Universal Music Group et en retire 3,5 milliards d’euros qui lui permettent d’acheter 10,6 % du capital du groupe Lagardère. Hachette Livre rassemble plus de 200 marques d’édition et publie plus de 15 000 nouveautés par an dans une douzaine de langues. Hachette Livre dispose par ailleurs de plusieurs filiales spécialisées dans la diffusion et la distribution de livres (à savoir la commercialisation, le stockage et le transport des livres) en France et dans le mondeExtrait du site Hachette Livre — Distribution, disponible sur : https://hachette.com/distribution/. Il est le premier distributeur de livres en France et dispose de trois plateformes basées en Suisse, en Belgique et au Canada. Il est aussi l’un des plus grands distributeurs en Espagne et le leader de la distribution de livres au Royaume-Uni. Il est également implanté dans le secteur aux États-Unis. Selon Yannick Bolloré, nommé président du Conseil de surveillance de Vivendi en 2018, l’objectif est de viser l’internationalisation des activités afin de devenir un acteur mondial de référence dans la cultureCommuniqué de presse de Vivendi, 09/06/2023, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-autorise-par-la-commission-europeenne-a-mettre-en-oeuvre-son-projet-de-rapprochement-avec-lagardere/.
L’assaut sur son concurrent est d’autant plus significatif que le groupe Lagardère est lui aussi un empire médiatique colossal (présidé par Arnaud Lagardère succédant à son père Jean-Luc et comptant Nicolas Sarkozy comme l’un de ses administrateurs). C’est donc un empire qui en engloutit un autre. Cette opération lui permet d’étendre considérablement ses possessions dans le secteur médiatique. Le groupe Lagardère regroupe en effet les revues et magazines Paris Match (vendu en octobre 2024 à Bernard Arnault qui détient déjà Le Parisien et Les Echos), Le Journal du Dimanche (JDD), JDNews, ainsi que les radios Europe 1, Europe 2, RFM. Le groupe Lagardère possède aussi plusieurs salles de spectacle (Casino de Paris, Arkéa Arena, Arena du Pays d’Aix, Folies Bergère) et gère la régie publicitaire des marques Europe 1, Le Journal du Dimanche, JDNews, Europe 2, RFM, Ouï FM, Radio FG, FG Chic, Maxximum, FG Dance, Radio Meuh, Radio Public Santé, Replay News, Crooner Radio, Sonos Radio, BTLV Mystères & Inexpliqués, myLymedias et depuis septembre 2024, Chante France et Radio Nova. Il est également propriétaire des commerces Relay et des boutiques Duty Free & Fashion, qui tombent donc dans l’empire Bolloré. Selon les chiffres renseignés sur le site du groupe, ce réseau s’étend sur 5 122 points de vente dans le monde, dans plus de 290 aéroports ainsi que 700 gares et stations de métro. D’après le site de Relay, leurs enseignes sont présentes dans près de 300 gares et stations de métro et 25 aéroports en France.
On peine à s’en remettre que les acquisitions compulsives reprennent déjà : en plus du groupe Lagardère, Vivendi renforce son emprise sur la presse magazine et acquiert, en 2021, 100 % de Prisma Media, « le numéro un de la presse magazine en FranceCommuniqué de presse de Vivendi, 31/05/2021, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-finalise-lacquisition-de-prisma-media-numero-un-de-la-presse-magazine-en-france/ ». Cette entreprise compte à son actif une vingtaine de marques, dont les magazines Femme actuelle, Voici, Gala, Geo, Télé-Loisir et Capital. Selon les chiffres publiés sur son site, les ventes sont évaluées à près de 130 millions de magazines par an, avec 40 millions de Français·es en audience globale. Puis, en janvier 2022, Vivendi entre dans le capital de Progressif Média à hauteur de 8,5 %. Il s’agit d’un groupe français de communication digitale spécialisé notamment dans la conception et la réalisation de campagnes sur les réseaux sociaux, connu pour sa participation à plusieurs projets d’extrême droite. Ses locaux déménageront en octobre 2024 pour rejoindre les bureaux de CNews, Le Journal du Dimanche et Europe 1. Vivendi le présente comme « un opérateur et un promoteur de produits et services centrés sur l’épanouissement des personnes et leur engagement en faveur du bien communCommuniqué de presse de Vivendi, 18/01/2022, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-va-prendre-une-participation-dans-le-groupe-de-communication-digitale-progressif-media/ ». On rappellera que l’actualité autour de ses dernières activités sont pourtant d’un autre genre, portant notamment sur de susceptibles campagnes de désinformation : d’abord, une campagne contre l’association Reporters sans frontières, laquelle avait saisi l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’une demande de mise en demeure de la chaîne CNews pour manquements à ses obligations légales d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information« Une agence d’influence proche de Bolloré a mené une campagne de désinformation contre RSF », Mediapart, 04/07/2024, disponible sur : https://mediapart.fr/journal/culture-et-idees/040724/une-agence-d-influence-proche-de-bollore-mene-une-campagne-de-desinformation-contre-rsf, puis une campagne anti-Louis Boyard, député LFI, après que celui-ci ait voulu rappeler en novembre 2022, lors de l’émission Touche pas à mon poste !, les agissements de Vincent Bolloré en Afrique« Le directeur de Canal+ à la manœuvre pour torpiller le député LFI Louis Boyard », Mediapart, 10/02/2025, disponible sur : https://mediapart.fr/journal/france/100225/le-directeur-de-canal-la-manoeuvre-pour-torpiller-le-depute-lfi-louis-boyard.
Puis, après être montée à 45,23 % du capital du groupe Lagardère en 2021Communiqué de presse de Vivendi, 16/12/2021, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-a-acquis-la-participation-damber-capital-dans-lagardere/, Vivendi lance une OPA en février 2022 sur la totalité du groupe afin d’en prendre le contrôleCommuniqué de presse de Vivendi, 14/06/2022, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-detient-5735-du-capital-du-groupe-lagardere-a-lissue-de-son-opa-amicale/. Le rapprochement entre les groupes Lagardère et Vivendi alarme, et fait l’objet d’une étude par la commission d’enquête parlementaire sur la concentration des médias, créée par le Sénat en novembre 2021. Car le constat fait peur : si Hachette Livre et Editis venaient à fusionner, cela aboutirait à la création d’un acteur dominant en France et en Europe qui représenterait 52 % du top 100 des ventes en France, 78 % de la littérature générale et 74 % du domaine scolaire[multiblock footnote omitted].
Pour pouvoir finaliser le rachat du groupe Lagardère et acquérir Hachette Livre, Vivendi doit obtenir l’autorisation de la Commission européenne, laquelle contrôle les concentrations d’entreprises afin d’empêcher les abus de position dominante. La Commission européenne ouvre alors une enquête approfondie sur le projet d’acquisition et soulève les risques pour le secteur :
-
Il n’existerait qu’un nombre limité d’acteurices crédibles actif·ves tout au long de la chaîne du livre qui seraient capables de concurrencer l’entité Editis-Hachette. Une telle fusion reviendrait donc à réduire considérablement la concurrence dans le secteur de l’édition, ce qui aurait des répercussions négatives sur les auteurices, les petit·es éditeurices, les vendeureuses de livres au détail et, en définitive, les lecteurices.
-
En combinant Paris Match de Lagardère et Gala et Voici de Vivendi, l’opération réduirait le choix des magazines « people » en France, en créant un leader puissant sur le marché qui impacterait leur prix et risquerait de nuire à leur qualité et à la diversité de leur contenu« Concentrations : la Commission ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi », Commission européenne. Représentation en France, 1e 01/12/2022, disponible sur : https://france.representation.ec.europa.eu/informations/concentrations-la-commission-ouvre-une-enquete-approfondie-sur-le-projet-dacquisition-de-lagardere-2022-12-01_fr.
Devant les préoccupations de la Commission européenne, Bolloré a finalement été contraint de se séparer d’Editis pour espérer obtenir l’autorisation, ce qui ne faisait pas partie de ses plans d’origine puisqu’il n’évoquait pas cette possibilité lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire en janvier 2022Rapport du Sénat 29/03/2022, Tome I, p. 252, disponible sur : https://senat.fr/rap/r21-593-1/r21-593-11.pdf. Contraint de revoir sa stratégie, il soumet à la Commission européenne un projet d’acquisition du groupe Lagardère conditionnée à une cession d’Editis. Il propose alors une cession au moyen d’une opération de distribution-cotation, et non une cession à 100 % du capitalCommuniqué de presse de la Commission européenne, « Concentrations : la Commission ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi », 30/11/2022, disponible sur : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_7243. Comme le précise Arnaud de Puyfontaine, président du Directoire de Vivendi, il s’agit d’une « étape importante dans notre objectif de créer un acteur mondial de l’édition » tout en s’assurant soigneusement « de la pérennité et l’intégrité d’Editis » qui ne serait pas cédée intégralementCommuniqué de presse de Vivendi, 25/10/2022, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-a-notifie-aupres-de-la-commission-europeenne-son-projet-de-rapprochement-du-groupe-lagardere/. En d’autres termes, une partie du capital serait distribuée aux actionnaires de Vivendi après une cotation en bourse, et une autre partie serait cédée à un tiers (étaient alors en lice un trio constitué des milliardaires et hommes d’affaires Stéphane Courbit, Daniel Křetínský et Pierre-Edouard Stérin). Précisons ici que Stéphane Courbit est le fondateur du groupe de production et de distribution audiovisuel Banijay cité plus haut, dont il est toujours un important actionnaire. Daniel Křetínský est quant à lui déjà propriétaire des magazines Elle, Marianne, Télé 7 Jours et Franc-Tireur.
Cette proposition n’est pas jugée suffisante par la Commission européenne qui décide, le 30 novembre 2022, d’ouvrir une enquête approfondie. L’opération de distribution-cotation d’Editis ne lui permettrait pas de peser suffisamment face à Hachette Livre. Afin de répondre aux préoccupations de la Commission, le projet de distribution-cotation est abandonné au profit d’une cession à 100 % d’Editis, vendu à International Media Invest, propriété de Daniel Křetínský« Cession d’Editis : Bruxelles approfondit son enquête jusqu’en avril », Livres Hebdo, 30/11/2022, disponible sur : https://wan-avocats.com/wp-content/uploads/2023/01/Livreshebdo-fr_Cession-d-editis-bruxelles-approfondit-son-enquete-jusqu-en-avril_30-11-2022.pdf. Le magazine Gala est quant à lui cédé au groupe Figaro, propriété de la famille Dassault. C’est sous ces conditions que Vivendi obtient, le 9 juin 2023, l’autorisation de la Commission européenne pour l’acquisition du groupe Lagardère« Concentrations : la Commission autorise l’acquisition de Lagardère par Vivendi sous certaines conditions », art. cit.. Le 21 novembre 2023, Editis et Gala sont définitivement cédés et Vivendi, qui détient désormais 60 % du capital du groupe Lagardère, peut pleinement exercer 50 % de ses droits de voteCommuniqué de presse de Vivendi, 21/11/2023, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-finalise-son-rapprochement-avec-lagardere/. Sans attendre, Vincent Bolloré nomme son fidèle Maxime Saada (déjà PDG de Canal+, PDG de Dailymotion, et membre du conseil d’administration de Gameloft) comme vice-président du groupe Lagardère.
Néanmoins, en parallèle de son autorisation, la Commission européenne a ouvert une nouvelle enquête pour contrôler que Vivendi n’ait pas procédé à une prise de contrôle anticipée du groupe Lagardère en s’immisçant notamment dans la gestion de Paris Match et Le Journal du Dimanche avant la finalisation de la procédure d’acquisition« Rachat de Lagardère par Vivendi : la Commission européenne ouvre une enquête pour une “éventuelle prise de contrôle anticipée” », Toute l’Europe, 27/07/2023, disponible sur : https://touteleurope.eu/economie-et-social/rachat-de-lagardere-par-vivendi-la-commission-europeenne-ouvre-une-enquete-pour-une-eventuelle-prise-de-controle-anticipee/. Plusieurs éléments suspects sont en cause : des remaniements au sein de la rédaction de Paris Match (sur ce point, voir les développements de Reporters sans frontières, à l’origine de l’ouverture de l’enquête« Prise de contrôle anticipée de Lagardère par Bolloré : RSF demande à la Commission européenne de mener une enquête approfondie », Reporters sans frontières, 15/06/2023, disponible sur : https://rsf.org/fr/prise-de-contrôle-anticipée-de-lagardère-par-bolloré-rsf-demande-à-la-commission-européenne-de), le déménagement en mars 2023 des locaux de CNews dans le même bâtiment qu’Europe 1, le JDD et Paris Match, mais aussi la nomination à la tête du JDD en juin 2023 de Geoffroy Lejeune, ex-directeur de Valeurs actuelles, magazine d’extrême droite, lequel est notamment définitivement condamné pour injure publique à caractère raciste envers la députée LFI Danièle Obono après son scandaleux article « Obono l’Africaine« Danièle Obono dépeinte en esclave : Valeurs actuelles condamné pour injure raciste », Le Monde, 29/09/2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/29/daniele-obono-depeinte-en-esclave-valeurs-actuelles-condamne-pour-injure-raciste_6096468_3224.html ». Si une prise de contrôle anticipée est effectivement constatée, l’acquisition ne sera pas pour autant remise en question. La peine encourue est une amende (pouvant aller à 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise).
La prochaine étape ?
Nous voilà en décembre 2024, la filiale Vivendi du groupe Bolloré est devenue « leader mondial de la culture ». Pourtant, le groupe n’en possède que 29,9 %, restant juste en deçà du seuil des 30 % au-dessus duquel il serait obligé de lancer une OPA sur la totalité. Comme le relève Le Nouvel Obs : « Pourquoi débourserait-il une fortune dans cette fameuse OPA — a minima 6 milliards d’euros — pour s’arroger 100 % d’un groupe qu’il régit déjà en copropriétaire omnipotent« Bolloré une famille en or », Le Nouvel Obs, 12/12/2024, édition papier. ? »
Pour augmenter sa part sans devoir faire une OPA, Bolloré délocalise chacune des activités de Vivendi sur des places boursières aux règles moins contraignantes. Lors d’une assemblée générale, qui ne se tiendra pas à l’Olympia mais aux Folies Bergère, nouveau fief pris au groupe Lagardère, il met fin à Vivendi. La filiale est scindée en quatre sociétés distinctesCommuniqué de presse de Vivendi, 09/12/2024, disponible sur : https://vivendi.com/communique/vivendi-le-projet-de-scission-adopte-a-plus-de-975-par-lassemblee-generale-des-actionnaires/ : Canal+ est cotée à Londres, Havas à Amsterdam, et Hachette à Paris. Vivendi reste cotée en France et gère le reste des activités. Cette opération est présentée comme « créatrice de valeur »Projet de scission du groupe Vivendi, disponible sur : https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2024/11/20241118_VIV_Vivendi_4pScission.pdf : son statut de conglomérat ne permettait pas de refléter la vraie valeur de ses activités, lesquelles étaient sous-valorisées en bourse. Avec la création de quatre sociétés, les quatre activités additionnées vaudraient alors plus cher que l’ancienne Vivendi (14 à 16 milliards d’euros contre 9,2 milliards aujourd’hui selon l’article du Nouvel Obs précité). En réalité, il s’agit surtout de se soustraire à la réglementation des OPA, en permettant au groupe Bolloré de monter au-dessus de 30 % dans chacune de ses entreprises sans être contraint de payer la fameuse prime de contrôle très coûteuse« Bolloré renforce son emprise sur son empire médiatique sans en payer le prix », Mediapart, 08/12/2024, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/081224/bollore-renforce-son-emprise-sur-son-empire-mediatique-sans-en-payer-le-prix. L’opération permet aussi une importante exonération d’impôts, près de 6 milliards d’euros seraient soustraits à la taxe sur les plus-values« Scission de Vivendi : Bolloré accroît son empire médiatique », Billet de blog / Le Club de Mediapart, 24/12/2024, disponible sur : https://blogs.mediapart.fr/edition/ledition-des-stagiaires-de-colleges-et-lycees-mediapart/article/241224/scission-de-vivendi-bollore-accroit-son-empi.
Nous avons donc désormais des sociétés distinctes et bien protégées pour chacune des trois activités de cet empire : média, publicité et édition. C’est sur ce nouveau schéma que seront développées les activités du groupe. Pour l’édition, la société Louis Hachette Group est créée. Elle regroupe les acquis du groupe Lagardère, détenu à hauteur de 66,53 %, ainsi que ceux de Prisma Media, détenu à 100 %. Le groupe Bolloré en est l’actionnaire principal à hauteur de 31,4 %.
Mais quel intérêt Vincent Bolloré a-t-il à construire un tel empire médiatique ? C’est précisément cette question qui lui est posée lors de son audition par la commission d’enquête parlementaire le 19 janvier 2022. Il répond alors : « C’est uniquement un projet économique. Le secteur des médias est le deuxième mondial en termes de rentabilité. Notre intérêt n’est donc ni politique, ni idéologique, mais purement économique. Depuis vingt ans, ce groupe s’est constitué uniquement sur des questions économiques. Vous le voyez, notre segment de l’information [CNews, seule chaîne d’information du groupe] est absolument insignifiant, tant en chiffre d’affaires que dans le poids du paysRapport du Sénat du 29 mars 2022, Tome II, p. 277, disponible sur : https://senat.fr/rap/r21-593-2/r21-593-21.pdf ; se reporter à la page 274 dudit rapport pour lire l’intégralité de l’audition de Vincent Bolloré.. » Bolloré certifie que : « contrairement aux croyances répandues, les médias sont le deuxième secteur le plus rentable au monde, après le luxeIbid, p. 275. ».
Difficile de savoir quel avenir il réserve à l’édition, car ses intentions ne sont pas rendues publiques. On décèle toutefois un indice dans cette audition au cours de laquelle il indique : « Dans le monde de l’édition, à l’exception de quelques personnes gagnant beaucoup d’argent, les auteurs ne s’en sortent pas avec leurs droits d’auteur. Un groupe capable de proposer à un auteur français de traduire son œuvre à l’étranger, de l’adapter en série ou en plus petits éléments digitaux pour les passer sur Dailymotion, Canal ou autre, me semble être un sujet passionnant pour ce fameux softpower, qui reste très important pour la FranceIbid, p. 287.. »
Bolloré, Arnault, Křetínský : comment le capitalisme flingue l’éditionArticle publié initialement sur Blast/le souffle de l’info, 16/10/2024. —
Alors que la foire internationale du livre de Francfort en Allemagne ouvre ses portes chaque année en octobre avec ses 7 000 marques exposantes et éditeurices du monde entier, je m’interroge sur la situation de l’édition mondiale et la concentration des marques entre les mains d’un petit nombre de structures gigantesques et internationales. Cette foire, remise au goût du jour à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour que les peuples fraternisent et pour renouer avec la paix, a-t-elle encore un sens pour l’édition indépendante et ne tend-elle pas vers un manque de pluralisme ? L’absence de l’auteur de GomorraDans ce roman-reportage, Roberto Saviano dénonce la Camorra, puissante organisation mafieuse napolitaine., Roberto Saviano, de la délégation officielle italienne, pays « invité d’honneur » de la foire cette année, illustre bien cette dérive.
Ce grand rendez-vous annuel, où je me suis rendu pour la première fois il y a quarante ans, est un peu le pouls de l’édition mondiale. Une fois par an, les éditeurices du monde entier y échangent leurs idées, relaient des nouveaux courants de pensée, et cèdent les droits des livres de leur catalogue à des éditeurices étranger·es — même si ces transactions sont désormais majoritairement conclues à l’avance, tuant dans l’œuf toute réelle possibilité de découverte et d’enchères à proprement parler. Il m’est arrivé de céder en moins de 24 heures des droits de traduction en plus de trente langues de certains de nos titres. Mais j’ai pu observer au fil des décennies que l’édition est de plus en plus « sans éditeurs », pour paraphraser André Schiffrin et son livre prophétique L’édition sans éditeursAndré Schiffrin, L’édition sans éditeurs, Paris, La fabrique, 1999.. Les légendaires éditeurs — comme Jean-Claude Fasquelle chez Grasset et Claude Durand chez Fayard, pour qui il était impensable de manquer le rendez-vous de Francfort — ont disparu.
La foire est devenue celle des agent·es, et l’espace de l’édition française s’est réduit comme une peau de chagrin, des centaines de marques qui avaient leur propre stand se retrouvant sur un même stand, celui du groupe qui les a rachetées. Mais Schiffrin qui parlait de la situation américaine n’imaginait pas que cela toucherait aussi rapidement la France et que l’édition deviendrait elle aussi « un centre du contrôle de la paroleAndré Schiffrin, Le contrôle de la parole, Paris, La fabrique, 2005. ».
Les enjeux de la concentration éditoriale
Le paysage éditorial, en France comme ailleurs, connaît une profonde transformation. Cette dernière décennie, la concentration des maisons d’édition s’est intensifiée. Des financier·ères et industriel·les, souvent plus intéressé·es par la diffusion forcée de leur vision politique très ancrée à droite et à l’extrême droite et par une certaine rentabilité que par la création littéraire, ont pris le contrôle, notamment en France, de nombreuses maisons d’édition historiques. La concentration de l’édition française a débuté dans les années 70, et plus particulièrement depuis les années 80. Mais jamais autant de fleurons de l’édition française ne se sont retrouvés entre les mains de si peu de personnes.
J’ai moi-même eu comme actionnaire minoritaire Hachette, à 34 % du capital de ma maison d’édition à partir de 2006. Quelle idée ! Être minoritaire n’intéresse pas ces consortiums. Outre le fait qu’ils vous imposent un contrôle drastique de vos comptes, ils vont être frileux sur les prises de risques et vous passerez toujours après les structures qui leur appartiennent à 100%, notamment quand des éditeurices du groupe s’intéressent à un titre en particulier.
Je me souviens d’avoir demandé une aide financière pour l’autobiographie du footballeur Ronaldo et pour en acquérir les droits mondiaux. Les dirigeants d’Hachette m’avaient dit : « Si on t’avance des fonds conséquents, ça va faire des jaloux chez les dirigeants des maisons appartenant au groupe Hachette et il faudra leur donner la même chose, on préfère renoncer… »
Arnaud Nourry et Arnaud Lagardère, après être rentrés d’un voyage aux États-Unis où les fonds de pension actionnaires leur avaient remonté les bretelles sur la croissance du groupe, avaient pris la décision de sortir brusquement du capital des petites structures, nous mettant tous·tes en grandes difficultés. Le 8 décembre 2009, les éditions Anne Carrière dont Hachette avait une participation minoritaire sont mises en liquidation judiciaire. La valorisation d’un groupe se fait sur le chiffre d’affaires des structures dont il détient le capital. Une structure minoritaire ne rentre pas dans le calcul ! Ça m’a appris à ne plus pactiser avec ces groupes.
Le phénomène de concentration des maisons d’édition n’est pas propre à la France. D’autres marchés, notamment les États-Unis et l’Allemagne, connaissent des dynamiques similaires, bien qu’à des degrés variés. Aux États-Unis, le géant Bertelsmann, propriétaire de Penguin Random House, fusion de deux mastodontesEn 2013 a lieu la fusion de Penguin Group et Random House, les deux géants de l’édition anglophone mondiale. en 2013, contrôle une part massive du marché avec des marques comme Knopf et Viking. Cette domination a atteint un point critique lorsque Penguin Random House a tenté de racheter Simon & Schuster, opération qui a finalement été bloquée par les autorités antitrust américaines en 2021.
« L’administration de Joe Biden s’oppose, pour des raisons de concurrence, au mariage entre le numéro un et le numéro quatre de l’édition américaine… estimant que le mastodonte issu de cette fusion risquait de réduire le nombre d’ouvrages édités et de diminuer les avances financières faites aux auteurs, notamment de livres à succèsNicole Vulser, « Le rachat de Simon & Schuster par Bertelsmann est bloqué par la justice américaine », Le Monde, 2 novembre 2022, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/11/02/le-rachat-de-simon-schuster-par-bertelsmann-est-bloque-par-la-justice-americaine_6148174_3234.html. »
En Allemagne, la situation est similaire, avec le géant Bertelsmann, qui domine le paysage littéraire allemand.
Les maisons d’édition « dépendantes » de leurs actionnaires et des impératifs de rentabilité tendent à privilégier des œuvres à fort potentiel commercial immédiat. Cela se traduit par un phénomène d’ultra « best-sellerisation » sur lequel ces consortiums vont investir tous les moyens financiers au détriment des voix émergentes ou minoritaires, mais aussi par une orientation de la ligne éditoriale vers l’idéologie que souhaitent défendre leurs actionnaires.
Ce qui nous tue c’est au fond de voir Vincent Bolloré sortir son argent pour acheter la maison (Fayard) de Claude Durand, celle qui a édité Soljenitsyne, García Márquez et autres pour publier Zemmour ou Sonia Mabrouk. On achète de la mémoire pour vendre de l’idéologie nauséabonde et souvent mal écrite.
Bernard Arnault, lui, se paie la NRF et les Éditions de Minuit pour mieux vendre LVMHEn 2013, LVMH entre au capital de Gallimard à hauteur de 9,5 %.… Comme le dit Mediapart dans un article du 31 mai 2024, LVMH, se pose en nouveau maître de Saint-Germain-des-Prés, la boutique Louis Vuitton a d’ailleurs pris place là où se trouvait la mythique librairie La Hune. Média-Participations et son actionnaire Michelin s’achètent une conscience écologique avec les éditions du Seuil, tout comme Křetínský, qui a fait fortune grâce au charbon et à de nombreux actifs polluants, lorsqu’il rachète Editis.
Valeurs et éthique
Les éditeurices indépendant·es se distinguent par un engagement plus fort en faveur de la qualité littéraire et de l’éthique éditoriale. Contrairement aux maisons d’édition « dépendantes », ils privilégient souvent la valeur artistique et intellectuelle des œuvres qu’ils publient et accordent une importance particulière à la cohérence de leur catalogue, en construisant une véritable identité éditoriale autour de thématiques, de styles et de genres spécifiques. Ils peuvent être plus sensibles à l’écologie et la manière dont est fabriqué le livre en n’imprimant qu’en France par exemple.
Je me souviens être allé à une réunion livre-écologie du SNE (Syndicat national de l’édition) et d’avoir vu débouler le numéro 2 d’Hachette non pas pour prendre au sérieux la question écologique, mais pour bien vérifier que les membres seraient d’accord pour faire front au sujet d’une taxe éventuelle qu’ils voulaient éviter, prélevée sur le prix du livre pour financer le recyclage de ceux-ci. L’argument numéro 1 étant qu’un livre, ça ne se jette pas ! C’est se mettre des ornières, car alors que les particuliers jettent rarement leurs livres par les fenêtres, une majeure partie des livres en stock finissent au pilon à cause des invendus et des frais délirants de stockage réclamés par les gros distributeurs.
Les éditeurices indépendant·es peuvent refuser de publier des ouvrages dont les propos ou les messages ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Des maisons comme Le Tripode ou La fabrique, dès leurs débuts, ont su bâtir une identité forte, en misant sur des choix audacieux et sur la qualité des contenus. Ces éditeurices ont permis à des œuvres atypiques de trouver leur public, même si leur potentiel commercial n’était pas évident au départ. De nombreux·ses auteurices aujourd’hui mondialement connu·es ont été découvert·es par des maisons d’édition indépendantes, comme Virginie Despentes par moi-même, refusée à l’époque par toute l’édition française. Nous avons souvent été dépouillé·es de nos auteurices par de grosses majors comme dans la musique. Mais nous n’aurions jamais obtenu les prix Renaudot pour Virginie Despentes ou Ann Scott dont j’avais publié les premiers romans.
Alors si un auteur ou une autrice souhaite avoir un prix à tout prix il n’y a pas beaucoup de maisons où aller… À part quelques exceptions qui confirment la règle, on sait que seules quelques maisons d’édition y ont accès, encore une répercussion de la concentration. Ces éditeurices se battent pour publier les membres des jurys et ainsi se garantir des votes favorables au moment des délibérations. L’organisation des prix littéraires est un vaste sujet… Les coulisses ressemblent un peu aux organisations mafieuses du début des années 1930, durant la Prohibition, à Chicago.
Garde-fous démocratiques
L’édition indépendante joue un rôle fondamental dans la défense de la démocratie. En permettant à des voix alternatives, critiques et contestataires de s’exprimer, elle contribue à la vitalité du débat démocratique.
Plusieurs ouvrages dénonçant les dérives de la politique ou de l’économie française ont été publiés par des maisons indépendantes, qui ont osé porter ces voix critiques malgré le risque commercial et juridique. Des œuvres comme Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, que j’avais amenée aux éditions Les Arènes — alors indépendantes d’Editis — ou Entre-soi. Le séparatisme des richesMonique Pinçon-Charlot, Entre-soi. Le séparatisme des riches, Paris, éditions Pyramyd, 2024. de Monique Pinçon-Charlot, ou L’insurrection qui vient du comité invisiblecomité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, La fabrique, 2007. ont contribué à nourrir le débat public sur des sujets tels que le mépris de classe, les inégalités sociales et le néolibéralisme.
Dans un contexte de concentration médiatique, les grands groupes contrôlent à la fois la presse, la télévision et l’édition. Le risque de voir certaines voix étouffées ou marginalisées, et certaines idéologies mises en avant, est réel. Comme celle de l’extrême droite par Vincent Bolloré, qui a déjà mis en place dans les médias qu’il détient ce type de pratique. De nouveaux acteurs tels que Pierre-Edouard Stérin, souhaitent rentrer dans l’industrie du livre pour défendre le commerce et le « patrimoine catholique et français ». Avec la création de Périclès, ce seraient 150 millions d’euros destinés à promouvoir au cours des dix prochaines années des « valeurs clés ». Périclès, acronyme pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Avec pour volonté dans les cinq prochaines années d’intégrer plus de 300 boutiques dans un nouveau réseau de librairies en France et le programme de lutte contre le wokisme, en évitant la diffusion de certains livres, on peut l’imaginer. Et dans la foulée, organiser quelque « 5 000 événements culturels locaux » dans ces commerces. Le même Pierre-Edouard Stérin dont le Le Monde révèle comment grâce à l’Institut libre de journalisme (ILDJ), ses réseaux et ceux de Vincent Bolloré, il alimente avec ce dernier les médias de la droite réactionnaire et bien au-delàLiselotte Mas, Asia Balluffier, Elsa Longueville, Mahé Richard-Schmidt, « Enquête sur l’Institut libre de journalisme, l’école créée par la droite identitaire pour conquérir les médias », Le Monde, 26/09/2024, disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/video/2024/09/26/enquete-sur-l-ecole-creee-par-la-droite-reactionnaire-pour-conquerir-les-medias_6334270_3224.html.
Maintenir son indépendance face aux pressions économiques
Les éditeurices indépendant·es doivent non seulement faire face à des coûts de production élevés, mais également à une concurrence déloyale de la part des grands groupes, qui peuvent imposer des prix de vente inférieurs grâce à leur contrôle de la chaîne logistique et leur capacité à amortir les pertes sur d’autres segments de marché (le fret, le charbon, le luxe, les assurances ou les ventes d’armes…). Ces mêmes groupes détenteurs des outils de distribution appliquent des tarifs beaucoup plus élevés aux éditeurices indépendant·es — de ce que j’ai pu voir sur certains contrats — qu’à leurs propres marques, réduisant ainsi les marges potentielles. La vente en librairies coûtera 50 % du prix public hors taxe à un gros éditeur pour monter jusqu’à plus de 60 % pour certaines petites maisons indépendantes. Les maisons d’édition signent un engagement de confidentialité sur leurs contrats et ce n’est pas toujours facile de savoir qui paye quoi.
Les groupes tels qu’Hachette ou Editis possèdent des accords privilégiés avec les principales chaînes de librairies et les plateformes en ligne, ce qui leur permet de placer leurs ouvrages dans des positions avantageuses, que ce soit en librairie ou sur les sites de vente en ligne. Cela signifie que, même si une maison indépendante publie un ouvrage de qualité, elle aura beaucoup plus de mal à le distribuer dans certains points de vente. Par exemple, les Relay implantés dans les gares sont la propriété de Vivendi aujourd’hui et deviennent sa vitrine. J’étais allé Gare de Lyon à la Fnac pour leur demander s’ils avaient bien le dernier livre de Denis Robert que je venais de publier. J’ai été stupéfait d’apprendre qu’il n’y avait plus de rayon « essais » ; vous pouvez vérifier. Voilà ce qui se passe quand on met la librairie entre les mains d’une personne dont ce n’est pas le métier.
Les rachats successifs de maisons d’édition indépendantes par les grands groupes éditoriaux constituent l’un des signes les plus visibles de cette pression économique. La maison d’édition emblématique Plon a vu son indépendance disparaître lorsqu’elle a été rachetée par Editis en 2004. Depuis, elle fait partie d’un vaste portefeuille de maisons gérées par un même groupe, tout comme les éditions du Cherche Midi, Robert Laffont ou Sonatine. Toutes sont soumises aux mêmes contraintes économiques et aux mêmes objectifs de rentabilité. Alors que les groupes d’édition absorbaient surtout des maisons en difficultés dans les années 80, depuis les années 2000 et encore aujourd’hui, ils rachètent de grandes marques emblématiques à des prix très élevés. Il est très difficile pour les propriétaires de ces maisons de résister aux propositions de rachats basées sur une année de chiffre d’affaires voire plus, et non basée sur leur rentabilité. Les sommes disproportionnées qu’ils touchent lors de la vente les rendent multimillionnaires. Le but de ces acquisitions pour ces groupes est d’avoir le plus gros chiffre d’affaires possible afin de valoriser le groupe en conséquence. « Selon le PDG d’Editis, Alain Kouck, les acquisitions du Cherche Midi, de First et de XO représentent au total un chiffre d’affaires additionnel de 45 millions d’euros qui vont accroître de 6 % celui d’Editis. L’impact sur la marge opérationnelle devrait être encore supérieur et atteindre 10 %Nathalie Silbert, « Editis fait tomber dans son escarcelle le groupe XO », Les Echos, 12/01/2006, disponible sur : https://www.lesechos.fr/2006/01/editis-fait-tomber-dans-son-escarcelle-le-groupe-xo-559159. »
Autre exemple, Le Seuil, maison d’édition intellectuelle et littéraire emblématique marquée à gauche, a été rachetée par La Martinière en 2004, avant que La Martinière elle-même ne soit absorbée par Média-Participations en 2018. Le président des éditions du Seuil depuis 2018, Hugues Jallon, a été limogé en 2024, car « trop à gauche ». Selon le média La Lettre, serait en cause entre autres le profil anticapitaliste de l’homme, par ailleurs écrivain. Il a été remplacé par Coralie Piton, qui a fait ses armes chez McKinsey, à la Fnac et chez Canal+. Dès lors, ces jeux de rachat et d’absorption des petits par les gros brouillent les cartes pour les lecteurices. Pour plus de transparence, une mesure simple à mettre en place serait d’obliger de faire figurer sur les livres à quel groupe appartient la maison d’édition. On noterait Hachette/Fayard ou Média-Participations/Le Seuil sur la couverture, pour que les lecteurices sachent à qui iels donnent leur argent.
La disparition des nouveaux talents
Selon une étude de l’Observatoire de l’économie du livre (2023), les nouveaux·elles auteurices ont beaucoup moins de chances d’être publié·es par les grandes maisons d’édition depuis 2015. Cette tendance s’explique en grande partie par la concentration accrue du secteur, où les grands groupes préfèrent miser sur des valeurs sûres plutôt que d’investir dans la découverte de nouveaux talents. Mais aussi de nombreux·ses auteurices bien installé·es dans leur maison historique se sont vu refuser leurs derniers manuscrits et se sont retrouvé·es sans éditeurice parfois contraint·es à se publier en autoédition. Bien sûr le capitalisme sait très bien récupérer les tendances pour ensuite les dévoyer et l’on assiste à de nouvelles collections dans l’air du temps chez les éditeurices des grands groupes. Le capitalisme, comme le disait Lénine, vendra la corde qui le pendra et quand ça peut vendre on veut bien signer ! Mais je salue le courage de ces éditeurices qui sont obligé·es de faire des contorsions, de s’autocensurer ou de se voir refuser certains livres par les services juridiques… J’en ai récupéré quelques-uns, comme le livre de Marc Eichinger et Thierry Gadault, L’Homme qui en savait beaucoup trop, et qui parle du scandale Areva. J’ai été poursuivi ainsi que les auteurs pour diffamation par Anne Lauvergeon. Il y a eu un premier procès que nous avons gagné, puis un procès en appel du jugement que nous avons gagné aussi. Le temps passé et le coût de telles procédures feront hésiter plus d’un·e éditeurice et de ses conseiller·ières juridiques à se lancer dans ce genre de publication. C’est ce qu’on appelle les « procédures-bâillons ».
Je ne compte pas le nombre d’éditeurices travaillant pour de grands groupes qui ont admis avoir refusé des œuvres en raison de pressions commerciales ou politiques. Dans un article de 2022, Le Monde rappelle comment Nicolas Sarkozy a fait pression sur des éditeurices du groupe HachetteRaphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, « “Vous savez que c’est Arnaud Lagardère, votre patron ?” : comment Nicolas Sarkozy fait pression sur des éditeurs », Le Monde, 22/03/2022. et n’hésite pas à intervenir au sein du groupe pour surveiller les livres et les médias parlant de lui et de ses « affairesOlivier Laffargue, « Les 10 affaires dans lesquelles Sarkozy est cité ou mis en cause », Le Monde, 21/03/2018. », par exemple en appelant la directrice des éditions Fayard, Sophie de Closets, pour lui demander des excuses pour avoir édité les livres de Gérard Davet et Fabrice Lhomme intitulés La Haine. Les années SarkoGérard Davet et Fabrice Lhomme, La Haine. Les années Sarko, Paris, Fayard, 2019. en 2019 puis Apocalypse. Les années FillonGérard Davet et Fabrice Lhomme, Apocalypse. Les années Fillon, Paris, Fayard, 2020. l’année suivante, ce qui aurait fortement déplu à Nicolas Sarkozy.Livres Hebdo relate en mars 2022 qu’alors administrateur du groupe Lagardère, Nicolas Sarkozy « consacre beaucoup d’énergie à surveiller et punir le petit monde de l’éditionDahlia Girgis, « Le Monde pointe l’interventionnisme de Nicolas Sarkozy chez Hachette », Livres Hebdo, 24/03/2022. ». J’ai bien sûr en souvenir plusieurs éditeurices qui ont été contraint·es de monter leur maison d’édition suite au refus par leur direction de publier un titre auquel iels tenaient absolument. Il n’y a rien de pire je trouve pour un·e éditeurice que de ne pas pouvoir partager avec les lecteurices un livre qui lui parait essentiel. Mais cette concentration et les conséquences sur la liberté d’expression ont obligé certain·es à devenir des entrepreneureuses alors que ce n’était pas forcément prévu au programme.
Une volonté commune de résistance aux grands groupes
Il faudrait une prise de conscience des auteurices et qu’iels refusent de continuer à publier dans ces maisons d’édition dépendantes, car les maisons d’édition indépendantes pourraient tout à fait rivaliser avec les grands groupes, si les lecteurices et les libraires répondaient présent·es et qu’une grande partie des auteurices refusaient de participer à cette concentration. On a du mal à comprendre pourquoi certain·es auteurices continuent à publier chez Hachette ou au Seuil alors qu’iels défendent des valeurs contraires aux actionnaires de ces maisons. Je les imagine sur un podium aux côtés de l’actionnaire de la maison pour une remise de prix et obligé·es de faire un hug à M. Vincent Bolloré en bonus.
En Italie où iels ont un peu d’avance sur nous, une ribambelle de petites maisons d’édition a fleuri ces derniers mois, nous apprend l’hebdomadaire L’Espresso« En Italie, les petites maisons d’édition montent au front », Courrier international, 03/09/2024, disponible sur : https://www.courrierinternational.com/article/litterature-en-italie-les-petites-maisons-d-edition-montent-au-front_220340. Avec l’extrême droite au pouvoir, de nombreux·ses professionnel·les ouvrent leur maison pour relever un défi : attirer de nouveaux·elles lecteurices et contribuer au débat culturel national.
Comme le dit Vincent Edin, directeur de collection aux éditions Rue de L’échiquier : « À force de marteler l’évidence que 90 % des grands médias nationaux appartiennent à 9 oligarques, le grand public s’est dessillé sur l’influence et l’agenda des milliardaires dans le débat public. Il ne viendrait pas à l’idée de militantes féministes sincères de chroniquer chez CNews, de militant·es écologistes de gloser dans Le Point et de tenants du progrès social de s’exprimer dans Les Echos. Mais cette évidence ne percole pas, hélas, dans l’édition« Et l’édition indépendante, bordel ? », Vincent Edin sur Linkedin, disponible sur : https://www.linkedin.com/posts/vincent-edin-32a690132_et-l%C3%A9dition-ind%C3%A9pendante-bordel-%C3%A0-force-activity-7249751473746505729-0ZsG/?originalSubdomain=fr. »
Le droit de conscience et la législation anti-concentration
La question d’une clause de conscience pour les auteurices et les éditeurices, soit une disposition légale qui les autoriserait à rompre un contrat pour des divergences morales fondamentales, similaire au droit de retrait des journalistes face à des positions idéologiques opposées, pourraitavoir du sens. Je pense aux auteurices édité·es chez Fayard par Lise Boëll qui est une éditrice particulièrement reconnue pour ses choix éditoriaux marqués à l’extrême droite dans une maison qui a longtemps été marquée à gauche. Sa relation avec des auteurs comme Éric Zemmour et Philippe de Villiers a suscité des discussions sur les limites de l’éthique éditoriale et la manière dont les convictions personnelles des éditeurices peuvent influencer les publications.
L’une des premières mesures à envisager pour protéger l’édition indépendante est l’introduction d’une législation anti-concentration, comme celle qui existe déjà dans le secteur des médias. En France, il existe des lois qui limitent la concentration dans les domaines de la télévision, de la radio et de la presse, afin de préserver le pluralisme des voix et des opinionsL’article premier de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée affirme le principe de la liberté de communication et énumère d’autres principes, d’égale valeur, au nom desquels l’exercice de cette liberté peut être limité par exemple des seuils de concentration spécifiques que les éditeurs de télévision et de radio sont tenus de respecter. Ces seuils forment le « dispositif anti-concentration ». Ils visent à assurer l’indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir politique et d’acteurs privés influents et à satisfaire l’objectif constitutionnel de respect du pluralisme des offres via la présence d’une diversité d’opérateurs. Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’une chaîne nationale de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle dépasse 8 % de l’audience totale des services. Légifrance.. Une telle législation pourrait être étendue à l’édition, pour éviter que quelques grands groupes ne monopolisent le marché.
Comme le relate Olivier Milot dans Télérama en 2023 : « [l’idée serait de] faire entrer l’édition dans le cadre législatif limitant la concentration dans le secteur des médias. […] Actuellement, la loi autorise à un même groupe de posséder simultanément télévisions, radios et journaux, mais fixe des seuils d’audience maximum à ne pas dépasser pour chacun d’eux. L’idée serait d’inclure l’édition dans ce dispositif et d’interdire à un même groupe d’avoir une position trop importante dans plus de deux secteurs sur quatre (presse, radio, télévision, édition) pour éviter les abus de position dominanteOlivier Milot, « Concentration dans le secteur de l’édition : les auteurs réclament une clause de conscience », Télérama, 08/09/2023, disponible sur : https://www.telerama.fr/livre/concentration-dans-le-secteur-de-l-edition-les-auteurs-reclament-une-clause-de-conscience-7017064.php. »
Aux États-Unis, la tentative de rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House a été bloquée en 2021 par les autorités antitrust, précisément pour éviter une trop grande concentration du marché. Une législation similaire en France pourrait protéger les maisons d’édition indépendantes des rachats par des géants comme Hachette ou Editis.
Soutenir les maisons indépendantes
Afin de garantir la survie des éditeurices indépendant·es, des mesures de soutien financier sont également nécessaires. Les pouvoirs publics pourraient instaurer un système de subventions quasi inconditionnel ou d’allègements fiscaux pour encourager ces maisons à poursuivre leur activité. Ces subventions pourraient être conditionnées à de très simples critères comme dans la presse. La presse est en effet beaucoup plus soutenue au niveau européen et français avec des aides au pluralisme. La liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias figurent dans la constitution française depuis 2008.
En parallèle, il est essentiel de promouvoir les œuvres des maisons indépendantes à travers des circuits courts de distribution. Des initiatives de soutien aux librairies indépendantes, qui jouent un rôle clé dans la diffusion des ouvrages des petit·es éditeurices, pourraient être renforcées. Ces circuits courts, en évitant les grands distributeurs contrôlés par les grands groupes, permettraient aux éditeurices indépendant·es de toucher directement leur public tout en réduisant les coûts de distribution. 50 % du chiffre d’affaires de notre maison et donc 50 % des ventes de nos livres se sont effectués par Internet.
En France, des initiatives comme celle du Centre National du Livre (CNL), qui octroie des subventions aux éditeurices pour la publication d’œuvres littéraires dites de qualité favorisent à mon avis trop souvent les mêmes maisons d’édition comme Actes Sud ou Gallimard.
Il y a en effet quelques maisons qui savent tirer leur épingle du jeu, mais pour ma part j’ai essuyé de nombreux refus d’aide à la publication ou à la traduction et finalement, si j’ai obtenu 20 000 € de subventions cumulées en 42 ans d’édition, je crois que c’est le maximum. Cela représente bien peu en regard du temps passé à monter les dossiers de demandes de subventions, à tel point que cela m’a souvent fait renoncer à entamer les démarches. C’est sans doute le but recherché aussi. Ces aides pourraient être élargies et plus spécifiquement orientées vers les maisons d’édition indépendantes, avec moins de conditions. Des projets collaboratifs, comme les salons du livre ou les foires dédiées à l’édition indépendante, pourraient aussi bénéficier d’un soutien accru pour renforcer leur visibilité, tout comme des aides aux librairies qui mettent en avant ces éditeurices.
Encourager du pluralisme via le numérique
Le numérique offre des opportunités pour soutenir les maisons indépendantes, à condition que les plateformes en ligne favorisent un pluralisme équitable et que les petit·es éditeurices bénéficient de visibilité. Actuellement, les grands groupes d’édition dominent les ventes sur les plateformes numériques telles qu’Amazon ou Fnac, grâce à des accords de mise en avant et à des budgets marketing conséquents. Pour équilibrer la situation, il serait possible de créer des incitations législatives ou fiscales en faveur des plateformes numériques qui promeuvent les ouvrages d’éditeurices indépendant·es. Des quotas de mise en avant de leurs œuvres pourraient être imposés aux plateformes, à l’image des quotas de diffusion culturelle existants pour la télévision ou la radio. Les chaînes hertziennes doivent ainsi consacrer, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale françaiseSource : Conseil supérieur de l’audiovisuel..
Par exemple, en Allemagne, des plateformes comme Genialokal, qui regroupent des librairies et éditeurices indépendant·es, permettent aux petites structures de vendre leurs livres en ligne en évitant les géants du commerce électronique. Un modèle similaire en France pourrait renforcer la visibilité des éditeurices indépendant·es tout en offrant aux lecteurices des alternatives aux grandes plateformes. Le site placedeslibraires.fr offre quant à lui la possibilité d’acheter en ligne auprès de nombreux·ses libraires indépendant·es.
Réseautage et mutualisation des ressources
La création de réseaux de collaboration entre maisons d’édition, soutenues par des subventions du CNL ou des DRAC, aiderait aussi l’édition indépendante. Ces réseaux permettraient aux éditeurices indépendant·es de mutualiser leurs ressources, que ce soit pour la production, la distribution ou la promotion de leurs ouvrages.
Ces initiatives pourraient prendre différentes formes : des coopératives d’éditeurices, des réseaux de distribution partagée ou des groupes de promotion collective lors de salons ou d’événements littéraires. Par exemple, en France, des initiatives comme la Fédération des éditeurs indépendants ou L’Autre Livre, qui regroupent des éditeurices alternatif·ves, ont déjà commencé à mutualiser leurs efforts pour organiser des événements et promouvoir la diversité éditoriale.
Pour reprendre la définition de la Fédération des éditeurs indépendants, on entend par « structure éditoriale indépendante » toute maison d’édition respectant l’ensemble des trois conditions :
-
Publier uniquement à compte d’éditeurice des publications de toute nature, commercialisées auprès du public (l’éditeurice finance l’édition sans demander à l’auteurice de participer financièrement).
-
Ne pas être contrôlée, directement ou indirectement, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, par un groupe d’édition ou un groupe financier.
-
Réaliser un chiffre d’affaires dont le montant annuel ne dépasse pas 10 millions d’euros.
Conclusion
La mondialisation de l’édition et sa rapide concentration, ces dernières années, incitent à prendre des mesures au plus vite à l’échelle européenne ou nationale si l’on veut que le peu de maisons d’édition indépendantes qui restent puisse survivre et que de nouveaux·elles éditeurices indépendant·es puissent éclore. Donner les clés de la pensée et de la parole à des milliardaires trop souvent d’extrême droite est très dangereux pour nos démocraties. Comme le dit le sociologue Vincent Tiberj : « Il y a bien une droitisation “par le haut”: les discours propagés par certains médias […] finissent par orienter le débat, puis les propositions politiques qui s’offrent aux FrançaisVincent Tiberj, La droitisation française. Mythe et réalités, Paris, PUF, 2024.. »
Les mêmes actionnaires sont à la tête d’entreprises responsables de la destruction de notre planète. L’édition indépendante saura mieux trouver les nouvelles voies d’une édition écologique et sociale qu’il va falloir mettre en place dans ce monde en crise et accompagner les changements de société. La protection de l’édition indépendante et de son pluralisme passe par un ensemble de mesures combinées, allant de la régulation du marché à des soutiens financiers ciblés, en passant par une meilleure visibilité en librairie, sur les plateformes numériques et dans les médias. La mise en place d’une législation anti-concentration permettrait de freiner la domination des grands groupes, tandis que des subventions et allègements fiscaux aideraient les éditeurices indépendant·es à rester compétitif·ves. Le développement de réseaux de collaboration et de circuits de distribution alternatifs renforcerait leur résilience économique. En se portant en défenseuses du pluralisme et en soutenant les initiatives des maisons indépendantes, la France et l’Europe pourraient aider à remettre en place un écosystème éditorial riche, diversifié et démocratique.
Bolloré : le laboratoire africain —
Avant de mettre la main sur une partie des médias et de l’édition française, Vincent Bolloré a fait de l’Afrique la première étape dans sa conquête de l’hégémonie culturelle. Récit.
Sans ses activités africaines, Vincent Bolloré n’aurait jamais pu mener en France son projet politique. L’une des premières raisons est purement matérielle. En décembre 2022, l’homme d’affaires vend Bolloré Africa Logistics, regroupant ses activités d’infrastructure et de logistique sur le continent africain, au groupe MSC. La transaction se chiffre à près de 5,7 milliards d’euros. Un coup magistral[multiblock footnote omitted]. Bolloré profite de l’effet de la crise sanitaire, durant laquelle les armateurs réalisent des profits spectaculaires, principalement à cause de la surconsommation américaine. Ces groupes de fret maritime multiplient alors les acquisitions pour devenir des géants de la logistique mondiale. Un timing parfait pour céder ses actifs.
D’autant que Vincent Bolloré est devenu un acteur incontournable en Afrique subsaharienne, contrôlant 22 concessions portuaires et ferroviaires et 66 ports secs ; il a pleinement tiré profit de la privatisation de ces infrastructures prescrite par le FMI et la Banque mondiale. Cette cession va donc lui permettre d’avoir les coudées franches pour se concentrer et se développer en France dans les médias et l’édition. En 2022, grâce notamment à cette plus-value, l’entreprise a dégagé un bénéfice net de 3,4 milliards d’eurosOC / AFP, « Groupe Bolloré : profits exceptionnels de 3,4 milliards d’euros en 2022 », BFM, 14/03/2023, disponible sur : https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/groupe-bollore-profits-exceptionnels-de-3-4-milliards-d-euros-en-2022_AD-202303140699.html.
Mais surtout, il faut voir l’Afrique comme la première étape dans sa conquête de l’hégémonie culturelle. C’est là qu’il a pu expérimenter ce qu’il applique aujourd’hui en France. Cette bataille passe déjà par les écrans. Sur le continent, Canal+, dont Vincent Bolloré a repris les rênes en 2015, compte aujourd’hui 8 millions d’abonné·es (en France, la chaîne s’approche des 10 millions d’abonné·es), ce qui en fait le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophoneAmaury de Rochegonde, « Canal+ en quête d’abonnés au-delà des mers », Stratégies, 09/07/2024, disponible sur : https://www.strategies.fr/actualites/medias/LQ3403525C/canal-en-quete-dabonnes-au-dela-des-mers.html. Pendant longtemps, la chaîne gagnait des abonné·es en Afrique alors qu’elle en perdait en France. Le logo noir et blanc est désormais bien visible dans les rues de Dakar, d’Abidjan ou de Kinshasa. Depuis sa reprise en main bolloréenne, la chaîne se concentre sur le sport, les séries et le cinéma. Les programmes humoristiques les plus subversifs, vestiges de l’ancien esprit Canal, ont été supprimés, de quoi convenir aux régimes autoritaires qui accordent les autorisations de diffusion. Le divertissement doit être le plus lisse possible. Toute aspérité politique est gommée : les documentaires apportant un point de vue critique sont écartés de la grille. En 2017, un reportage montrant les manifestations contre le président togolais Faure Gnassingbé a été supprimé des plateformes numériques de Canal+ immédiatement après sa diffusion. Le Togo est alors un marché majeur pour les activités de logistique du groupe. L’ONG Reporters sans frontières dénonce un « cas de censure »« RSF demande au comité d’éthique de Canal+ de se saisir d’un cas de censure », RSF, 18/12/2017, disponible sur : https://rsf.org/fr/rsf-demande-au-comit%C3%A9-d-%C3%A9thique-de-canal-de-se-saisir-d-un-cas-de-censure. Plus récemment, en décembre 2023, Canal+ a supprimé le signal de trois chaînes de son bouquet, critiques à l’égard du général Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée, à la demande des autorités de ConakryMathieu Galtier, « Canal+ en Afrique, une stratégie agressive assumée », Jeune Afrique, 19/12/2023, disponible sur : https://www.jeuneafrique.com/1515185/economie-entreprises/canal-en-afrique-une-strategie-agressive-assumee/. Il ne s’agirait pas de se fâcher avec les pouvoirs en place. Dans sa stratégie, Bolloré mise sur l’essor de la classe moyenne africaine, sur une jeunesse aux aspirations mondialisées. « En l’aliénant », souligne le réalisateur camerounais Jean-Pierre BekoloAntoine Pecqueur, « Afrique, la culture made in Bolloré » Revue du Crieur, nº 6, janvier 2017, disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-du-crieur-2017-1-page-52?lang=fr.
Au sein de la population, la chaîne se heurte néanmoins à des griefs de plus en plus forts. On lui reproche déjà le coût des abonnements, prohibitif au regard du niveau de vie, qu’elle tente de compenser avec des offres promotionnelles. Pas sûr que cela soit suffisant face à la concurrence des plateformes. Une partie se détourne aussi des contenus en français pour rechercher des programmes en langues africaines. Ces dernières sont encore trop souvent mal considérées, peu valorisées. La domination culturelle est aussi une domination linguistique. Or il y a désormais un mouvement de réappropriation de ces langues, notamment par les plus jeunes générations. Au Sénégal, les émissions en wolof rencontrent un succès grandissant. Le groupe l’a bien compris en intégrant de plus en plus de contenus locaux dans ses bouquets.
L’enjeu est également géopolitique. Au moment où le continent suscite la convoitise des plus grandes puissances, Canal+ se retrouve parfois perçu comme un héritage de la Françafrique. Par exemple au Cameroun, où le groupe a supprimé de son bouquet Afrique Média, une chaîne suspectée d’être pro-russe. Certain·es y voient l’ombre du Quai d’OrsayAntoine Pecqueur, « Ils sont mieux que les Français ! », Le Monde diplomatique, nº 831, juin 2023, disponible sur : https://www.monde-diplomatique.fr/2023/06/PECQUEUR/65823. Les conflits se font aussi par écrans interposés. L’opérateur chinois StarTimes, jouant sur la pseudo-neutralité de Pékin, profite de ce contexte pour conquérir le continent, y comptant désormais 16 millions d’abonné·es. Mais Bolloré riposte en lançant en avril 2024 une offre publique d’achat (OPA) sur le géant sud-africain MultiChoice, dont il possède déjà 35 % du capital. La preuve que même s’il a cédé ses activités de logistique, l’homme d’affaires compte bien rester actif en Afrique. Avec ses 21,7 millions d’abonné·es, MultiChoice couvre 50 % du marché, principalement les pays anglophones, alors que Canal+ est surtout présent dans les pays francophones — une complémentarité stratégiqueMathilde Boussion, « MultiChoice, joyau de l’audiovisuel africain, en passe d’intégrer la galaxie Bolloré », Le Monde, 09/06/2024, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/06/09/multichoice-joyau-de-l-audiovisuel-africain-en-passe-d-integrer-la-galaxie-bollore_6238109_3234.html. « L’acquisition la plus ambitieuse de notre histoire », affirme Maxime Saada, le président du directoire de Canal+Maxime Saada, « MultiChoice sera l’acquisition la plus ambitieuse de l’histoire de Canal+ », Le Figaro, 05/05/2024, disponible sur : https://www.lefigaro.fr/medias/maxime-saada-multichoice-sera-l-acquisition-la-plus-ambitieuse-de-l-histoire-de-canal-20240505. Fiorina Capozzi nous rappelle que « par sa formation de banquier, c’est toujours Vincent Bolloré lui-même qui pilote les acquisitionsFiorina Capozzi, Vincent Bolloré. Le nouveau roi des médias européens, Florence, goWare, 2016.. » Lorsque cette OPA de 2,7 milliards d’euros sera finalisée, le groupe Canal+ envisage même une cotation à Johannesburg, après être entré à la bourse de Londres le 16 décembre 2024.
Ce risque de concentration vertigineuse de l’audiovisuel africain entre les mains de l’homme d’affaires breton suscite une vive inquiétude, d’autant que sa stratégie mêle un néolibéralisme décomplexé à une idéologie ultraconservatrice. D’un côté, Bolloré exploite économiquement le continent et, de l’autre, le méprise de la façon la plus brutale, en diffusant ad nauseam sur ses chaînes CNews et C8La fréquence de C8 n’a pas été renouvelée par l’Arcom et la chaîne a donc cessé d’exister le 28 février 2025. des propos associant l’immigration à l’insécurité et pointant du doigt la population africaine. Sur CNews, la chroniqueuse Véronique Jacquier propose de « recoloniser l’Afrique économiquementL’Heure des pros 2, CNews, 29/08/2023. ». Le même média ne cesse de pourfendre toute critique du postcolonialismePhilippe Bernard, « Il est logique de voir CNews, liée aux opérations africaines de Bolloré, militer contre l’étude des séquelles du colonialisme », Le Monde, 06/03/2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/06/il-est-logique-de-voir-cnews-liee-aux-operations-africaines-de-bollore-militer-contre-l-etude-des-sequelles-du-colonialisme_6072152_3232.html. Le milliardaire s’inscrit en parfait héritier des barons du capitalisme colonial.
Mais ce qu’il n’avait pas anticipé, c’était la résistance politique de la population. Dans les rues de Yaoundé ou de Ouagadougou, la figure de Bolloré participe de la montée du sentiment anti-français. En 2016, la catastrophe ferroviaire d’Eseka, au Cameroun, faisant 79 mort·es, sur une ligne de train gérée par Bolloré, a aussi terni durablement son image sur le continentFanny Pigeaud, « Au Cameroun, l’indélébile tâche de sang d’Eséka », Afrique XXI, 04/02/2022, disponible sur : https://afriquexxi.info/Au-Cameroun-l-indelebile-tache-de-sang-d-Eseka. Son nom se retrouve sur les pancartes des manifestations dénonçant la mainmise de Paris, même si bien souvent ces rassemblements sont instrumentalisés par la Russie. On notera d’ailleurs sur ce plan une évolution dans la ligne éditoriale des médias de Bolloré, qui accordent de plus en plus de place aux journalistes pro-russes. La guerre en Ukraine est traitée dans LeJournal du Dimanche par Xenia Fedorova, ancienne directrice d’information de la chaîne RT France, financée par l’État russe et interdite de diffusion depuis 2022 dans l’Union européenne. Elle sort aussi en mars 2025 un livre chez Fayard (Bannie. Liberté d’expression sous condition). Une manière pour le milliardaire de se rapprocher, par effet collatéral, des régimes africains proches du Kremlin ?
Dans sa conquête gramscienne de l’hégémonie culturelle sur le continent, Bolloré ne se limite pas aux chaînes de télévision. Il a également mis en place un réseau de salles de spectacle et de cinéma : les CanalOlympia. Ce nom, qui réunit deux marques de son groupe (outre Canal, l’homme d’affaires possède aussi la salle parisienne l’Olympia), est censé traduire la double vocation de ces équipements. À l’intérieur, ils sont utilisés comme salle de cinéma, et à l’extérieur, ils font office de scène de concert en plein air. Alors que les États africains mettent très peu de moyens dans les arts et que la plupart des cinémas et théâtres ont fermé depuis plusieurs années, Vincent Bolloré veut apparaître en sauveur de la culture. Mais de quelle culture parle-t-on ? La programmation des cinémas fait surtout la part belle aux blockbusters américains. Quant à l’activité des concerts, elle met en avant les artistes produits par Universal, comme Fally Ipupa ou Burna Boy. Ce n’est pas un hasard : la major de l’industrie musicale est détenue à 28 % par Vincent Bolloré et Vivendi, qui en sont toujours les actionnaires majoritaires même après la scission de juin 2021« Les actionnaires de Vivendi approuvent la scission d’Universal Music », Les Echos, 22/06/2021, disponible sur : https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/les-actionnaires-de-vivendi-approuvent-la-scission-duniversal-music-1325747. Une fois encore, un exemple parfait de concentration horizontale (le maximum d’actifs dans le même secteur) et verticale (posséder les différents maillons de la chaîne). Universal mise sur le continent, avec, pour la partie francophone, une équipe dédiée installée à Abidjan. Associée à Canal+, la major a même lancé une émission africaine de télécrochet.
Mais la frilosité est de mise : n’imaginez pas y dénicher des musiques subversives, artistiquement ou politiquement. À travers ses labels, ses chaînes et ses salles de spectacle, Bolloré a pris le contrôle sur les pratiques culturelles, de leur production à leur diffusion. Il a entre ses mains une industrie hautement stratégique, car en Afrique, encore plus qu’ailleurs, la contestation passe par la musique. Les artistes n’hésitent pas à tenter de prendre le pouvoirAntoine Pecqueur, « Afrique, des musiciens contre le pouvoir », Revue du Crieur, nº 13, mars 2019, disponible sur : https://shs.cairn.info/revue-du-crieur-2019-2-page-30?lang=fr&tab=auteurs. En Ouganda, le principal opposant au dictateur Yoweri Museveni est un rappeur, Bobi Wine, que vous ne retrouverez pas dans le catalogue Universal, dont les concerts sont de véritables meetingsAntoine Pecqueur, « Ouganda : le réveil de la jeunesse », Mediapart, 10/01/2021, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/international/100121/ouganda-le-reveil-de-la-jeunesse. Dans des pays où le taux d’analphabétisme est parfois très élevé, les chansons sont aussi là pour faire passer des messages politiques, de la défense des services publics à l’engagement féministe. Maîtriser l’industrie musicale est une manière d’agir directement sur la population. La divertir et l’endormir.
L’implantation même des CanalOlympia ne manque pas d’interpeller : la première salle a ouvert en 2017 au sein même de l’Université de Yaoundé. Tout un symbole : le milliardaire s’installe là où se forme la jeunesse africaine. Le groupe bolloréen a d’ailleurs noué des partenariats avec nombre d’universités africaines, en finançant une salle multimédia à Brazzaville, une bibliothèque à Douala… Ces lieux de formation sont un terrain idoine pour partir à la conquête des esprits. Le capitalisme de séduction version Bolloré. Pour l’inauguration du CanalOlympia de Yaoundé, les étudiant·es avaient même interprété une chanson spécialement écrite en hommage à l’homme d’affaires. Une mise en scène digne d’un rassemblement nord-coréenAntoine Pecqueur, « Afrique, la culture made in Bolloré », art. cit.. Sur la centaine de salles promises par Bolloré, seule une vingtaine a pour l’instant surgi de terre.
À travers le champ culturel, le milliardaire cherche peut-être moins à séduire la population que ses dirigeants. Un exemple redoutable de soft power. Il se construit à peu de frais une image de bienfaiteur, en offrant aux États une vitrine artistique. Une monnaie d’échange parfaite pour obtenir un accès privilégié au marché. Pour asseoir ces dernières années sa présence en Afrique, l’homme d’affaires a joué sur les mêmes ressorts que ceux qu’il exploite actuellement en France. Bien implanté dans les médias, il a su nouer des liens étroits avec la classe politique. Avec néanmoins une nuance de taille : en France, il se place du côté de l’opposition, alors qu’en Afrique, il s’est distingué en soutenant les pouvoirs en place. Il fut ainsi proche des présidents les plus autoritaires : Alpha Condé, en Guinée, ou Faure Gnassingbé, au Togo. Et ce qui le motive, c’est de s’inscrire dans l’agenda politique. Les campagnes électorales sont ses périodes de prédilection, durant lesquelles il peut jouer, depuis les coulisses, au grand ordonnateur. Exactement comme il le fait désormais en France où il prône l’union des droites, et où l’un de ses présentateurs favoris, Pascal Praud, est prévenu de la dissolution de l’Assemblée nationale avant même le Premier ministre Gabriel AttalAriane Chemin et Ivanne Trippenbach, « Législatives 2024 : comment les médias de Vincent Bolloré orchestrent l’alliance du RN et de la droite », Le Monde, 16/06/2024, disponible sur : https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/06/16/legislatives-2024-comment-les-medias-de-vincent-bollore-orchestrent-l-alliance-du-rn-et-de-la-droite_6240508_823448.html. L’éditorialiste du Monde, Philippe Bernard, l’avait pressenti : « Le capitaine d’industrie “fait” certaines élections en Afrique de l’Ouest. Pourrait-il être tenté de les “faire” en FrancePhilippe Bernard, « Il est logique de voir CNews, liée aux opérations africaines de Bolloré, militer contre l’étude des séquelles du colonialisme », art. cit. ? »
Le milliardaire a donc pu tester en Afrique cette mécanique inextricable entre médias, communication et politique. Le rôle joué par son agence de publicité et de communication Havas (ex-Euro RSCG, jusqu’en 2012), spécialisée dans l’influence de l’opinion publique, fut capital. C’est elle qui a organisé la stratégie, les événements de ces campagnes. L’un des épisodes emblématiques fut l’organisation par Bolloré d’un concert en septembre 2015 à Conakry, la capitale guinéenne, en pleine campagne présidentielle. Un budget de 100 000 € pour cette fête de la musique produite par Vivendi : rien n’est trop beau pour accompagner la réélection d’Alpha CondéComplément d’enquête, France 2, 07/04/2016..
Mais les choses ne se sont ensuite pas complètement passées comme prévu : Alpha Condé a été renversé en 2021. Nombre de dirigeants proches de Vincent Bolloré ne sont plus au pouvoir. Et les nouvelles générations sont parfois moins enclines à ces arrangements néocoloniaux.
L’Afrique laisse donc désormais à Bolloré un goût amer. Se venge-t-il en laissant ses animateurices se complaire dans un racisme outrancier ? Le milliardaire a assurément essuyé sur le continent des revers qu’il a du mal à digérer. L’un de ses échecs les plus retentissants est celui de la boucle ferroviaire devant relier la Côte d’Ivoire au Bénin, en passant par le Burkina Faso et le Niger. Une ligne de près de 2 700 kilomètres, qui devait faciliter, davantage que la mobilité des populations, l’accès aux matières premières et à leur exportation par le golfe de Guinée. Vincent Bolloré en avait fait une cause personnelle, se disant prêt à injecter son propre argent. Avant même d’avoir signé les concessions ferroviaires, il a fait construire une centaine de kilomètres de voies ferrées, aujourd’hui à l’abandon dans le désert nigérienRémi Carayol, « Au Niger et au Bénin, le train fantôme de Bolloré », Afrique XXI, 02/03/2022, disponible sur : https://afriquexxi.info/au-niger-et-au-benin-le-train-fantome-de-bollore. Car la boucle n’a jamais été réalisée, pour des raisons juridiques et politiques, les nouveaux gouvernements de la région se montrant moins coopérants que leurs prédécesseurs. L’autre échec concerne les Bluezones, ces installations autonomes en énergie, implantées à Conakry, Niamey, Yaoundé… Censées être des lieux de développement économique, proposant Wi-Fi, eau potable ou activités sportives, elles sont aujourd’hui pour la plupart totalement désertées.
Plus que par philanthropie, Vincent Bolloré a aussi multiplié ses projets africains dans un but de communication à destination de la France. Une manière de s’offrir un storytelling flatteur, suintant en fait le paternalisme néocolonial. Et cela a fonctionné. Le Monde a consacré en 2015 une série d’été en six épisodes à la boucle ferroviaire — un choix éditorial qui interpelle alors même que le projet était loin d’être concrétiséAlexandre Piquard et Serge Michel, « La conquête de l’Ouest (de l’Afrique) », Le Monde, 02/08/2015, disponible sur : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/08/11/le-rail-africain-l-autre-bataille-de-vincent-bollore_4721061_3212.html. Jeune Afrique a traité pour sa part avec enthousiasme des Bluezones en réalisant des reportages vidéo en partenariat avec… Canal+ Afrique« Dans les bluezones africaines de Bolloré », Jeune Afrique, 11/09/2015, disponible sur : https://www.jeuneafrique.com/263769/economie-entreprises/au-coeur-des-bluezones-de-bollore/. Même les instituts français, bras armés de la diplomatie culturelle française (financés à la fois par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture), ont noué des partenariats avec le groupe.
À l’époque, Vincent Bolloré était perçu par beaucoup comme un entrepreneur audacieux, misant envers et contre tout sur l’Afrique. La dimension culturelle de son projet n’était peu ou pas mentionnée. Localement, des opinions plus critiques se faisaient entendre, mais elles restaient marginales. Or un regard attentif de la stratégie bolloréenne en Afrique subsaharienne aurait permis une plus grande vigilance. Car tout était déjà écrit : le rôle joué par la culture et les médias, les calculs politiques, la concentration économique, le tout porté par un engagement personnel. Un cocktail qui aujourd’hui explose en France.
Grandeur et décadence : et si la chute de l’empire bolloréen venait de l’Afrique ? Le Parquet national financier a requis en 2024 un procès pour corruption contre le milliardaire« Le parquet financier demande un procès pour Vincent Bolloré pour corruption au Togo », Libération, 07/06/2024, disponible sur : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/le-parquet-financier-demande-un-proces-pour-vincent-bollore-pour-corruption-au-togo-20240607_MMKEECJMRZDY3HRN2FLIKTI4LE/. Ce dernier est suspecté d’avoir utilisé l’activité de conseil politique de sa filiale Havas pour obtenir la gestion de ports à Lomé et Conakry. Bolloré aura tout tenté pour échapper au procès public : il a même fait en 2021 une reconnaissance préalable de culpabilité.
Ce procès risque d’être une boîte de Pandore, exposant au grand jour tous les rouages de ce savant mélange des genres, depuis les infrastructures portuaires jusqu’au conseil politique. Onze associations de lutte pour la transparence en Afrique ont déposé plainte en mars 2025 devant le Parquet national financier, dénonçant des faits de recel et de blanchiment« Vincent Bolloré et son groupe visé par une plainte panafricaine les accusant d’être au cœur d’un système de corruption », Le Monde, 19/03/2025, disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/03/19/vincent-bollore-et-son-groupe-vises-par-une-plainte-panafricaine-l-accusant-d-etre-au-c-ur-d-un-systeme-de-corruption_6583461_3224.html. Elles réclament la restitution aux « États et populations victimes » des milliards d’euros générées par la cession de Bolloré Africa Logistics. Le groupe pourrait perdre des alliés. Le conseil d’éthique du plus grand fonds souverain de Norvège, actionnaire du groupe Bolloré, a par ailleurs déjà dénoncé dans un rapport en mars 2024 de « graves » violations des droits de l’homme au Cameroun, visant la Socapalm, la société camerounaise des palmiers, dont le groupe Bolloré détient une participation de 23,1 %« Bolloré bafoue les droits humains en Afrique, selon l’un de ses actionnaires », Reporterre, 06/08/2024, disponible sur : https://reporterre.net/Bollore-bafoue-les-droits-humains-en-Afrique-selon-l-un-de-ses-actionnaires. On a, en tout cas, hâte de voir la couverture du procès de Bolloré par les médias lui appartenant.
Entretien —
Je suis docteur en histoire et civilisations de l’Afrique. J’ai fait un doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2010 puis un postdoc à l’Université de Montréal. Depuis 2012 j’ai publié plusieurs ouvrages, dont ma thèseAmzat Boukari-Yabara, Walter Rodney, un historien engagé (1942–1980), Paris, Présence Africaine Éditions, 2018. en 2018 chez Présence Africaine, deux livres sur le NigériaAmzat Boukari-Yabara, Nigéria, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2013. et le MaliAmzat Boukari-Yabara, Mali, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014. publiés par un éditeur universitaire belge, De Boeck, et Africa Unite! Une histoire du panafricanisme, publié par La Découverte en 2014 et réédité à plusieurs reprises. Plus récemment, j’ai codirigé avec trois camarades L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la FrançafriqueThomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Paris, Le Seuil, 2021., au Seuil en 2021, qui est sorti en poche il n’y a pas très longtemps. À côté de ça, j’écris dans des revues scientifiques ou de manière plus spécifique, des chapitres de recueils collectifs.
J’ai une production intellectuelle que je ne qualifie pas forcément d’universitaire parce que je ne suis pas en poste, je me considère comme un chercheur indépendant, un intellectuel organique. Ce qui m’intéresse, c’est de participer à des projets collectifs, que ce soit des projets éditoriaux, artistiques ou politiques qui permettent de réinjecter le savoir dans de l’espace public et dans des activités militantes.
Depuis 2013, je suis également membre d’une organisation, la Ligue panafricaine-UMOJA« La Ligue Panafricaine-UMOJA est une organisation internationale composée de sections territoriales implantées en Afrique et dans la Diaspora. Elle a pour objectif de fédérer les forces et les courants africains dans la réalisation de l’Unité, l’Indépendance et la Renaissance du Continent à travers la construction d’un État Fédéral Africain (États-Unis d’Afrique) qui est la forme la plus aboutie du panafricanisme politique. » D’après le site internet : https://lp-umoja.com/, dont je suis devenu président il y a trois ans. C’est une organisation politique anti-impérialiste qui fait un travail de formation, d’analyse et de prospective sur les questions africaines et afrodescendantes, avec une ligne sociale, solidaire et progressiste. La Ligue panafricaine-UMOJA est totalement autofinancée et indépendante. Elle est présente dans plusieurs pays en Afrique et dans la diaspora (France, Belgique, Suisse, Canada, Haïti). C’est la plateforme militante de référence sur le panafricanisme par laquelle je travaille avec d’autres collectifs.
En plus d’être militant et chercheur, je travaille avec des structures plus institutionnelles (UNESCO, COPABLe Congrès Pan Africain d’Éthique et de Bioéthique (selon leur site : https://copab-ankh.org/about-us) est un événement réunissant des chercheurs, praticiens et décideurs africains pour discuter des enjeux éthiques liés aux sciences de la vie, à la santé et aux technologies sur le continent. Il vise à promouvoir une réflexion adaptée aux réalités africaines et à renforcer la gouvernance éthique., etc.) sur des projets culturels ou des réformes d’institutions pour lesquels je suis consulté. On a besoin aujourd’hui de refonder les institutions afin qu’elles soient plus en phase avec nos luttes. Il y a d’un côté une dimension scientifique par ma formation doctorale, d’un autre, une dimension militante dans ces espaces que j’essaie d’impacter intellectuellement, et enfin, une dimension politique dans le sens où la question des institutions et du pouvoir est posée. C’est un peu comme ça que j’essaye de connecter mon travail de chercheur, d’historien et de militant.
En 2017, avec d’autres camarades, nous avions créé une maison d’édition, Panafrikan Éditions« Panafrikan Éditions est une jeune maison d’édition dont l’objectif est entre autres de promouvoir la culture littéraire afrodescendante en encourageant les jeunes et des auteurs confirmés à faire connaître leurs œuvres pour la conscientisation de l’Afrique et de ses filles et fils. Panafrikan Éditions vise aussi à publier toute œuvre littéraire qui participe à l’émergence de l’intelligence humaine. » D’après la page « Panafrikan Éditions », disponible sur : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066622810727. On a choisi de la baser à Brazzaville pour des raisons fiscales et politiques. Fiscales pour s’inscrire dans un environnement économique et commercial africain ; politiques car ouvrir une maison et publier des livres en Afrique, c’est nécessairement une tribune de contestation politique et sociale. On a publié deux bouquinsDont l’un est Discours panafricanistes, Ligue Panafricaine-UMOJA, Brazzaville, Panafrikan Éditions, 2019. qui sont propres à la LP-ULP-U pour Ligue Panafricaine-UMOJA. : un recueil de textes et un livre de programme politique. Suite à cela, on a reçu des manuscrits, mais avec le Covid-19 d’une part, et les coûts de production importants des ouvrages d’une autre, on a fait une pause. Sur le circuit de production du livre, nous voulions aussi reprendre les connexions avec des imprimeries basées dans les pays d’Europe de l’Est qui, du temps de la Guerre froide, accompagnaient les publications anti-impérialistes à destination de l’Afrique. En ma qualité de président de la LP-U, je suis aussi le directeur de publication du magazine Panafrikan« Panafrikan a pour ambition de promouvoir l’idée du panafricanisme à travers l’Afrique et dans la Diaspora. Notre mission est la création d’un journal panafricaniste de référence, disponible en ligne, en plusieurs langues, africaines comme étrangères, mais aussi distribué en version papier partout sur le continent et dans la Diaspora. » D’après la page « Panafrikan Magazine », disponible sur : https://www.facebook.com/groups/panafrikan.magazine/. Les numéros sont disponibles sur le site de la LP-U : https://lp-umoja.com/category/panafrikan-magazine/ qui est produit par les membres, avec un code ISBN mais un format principalement numérique.
Je pense que l’activité militante, c’est aussi beaucoup produire du savoir, des documents, des communiqués, des ouvrages, etc. La question de l’édition est vraiment centrale dans l’autonomie militante.
Il y a plusieurs niveaux. Déjà, il y a le niveau institutionnel. Le monde de l’édition scolaire en Afrique est contrôlé par quelques grands éditeurs scolaires qui sont liés à la construction des programmes. On est sur des chasses gardées de Hatier, Hachette, Nathan, etc., qui produisent des versions africaines de leurs manuels scolaires. Cela peut se faire parfois en lien avec des éditeurs locaux, mais c’est toujours estampillé de la marque de ces grands groupes et ça passe souvent au niveau politique par les ministères africains de l’Éducation qui maintiennent des programmes scolaires calqués sur le modèle français, ou par l’UNESCO ou d’autres structures supranationales. Il faut bien avoir en tête que le livre est principalement présent dans l’espace scolaire et universitaire et qu’il occupe, culturellement, une place utilitaire : apprendre à lire, à réfléchir, à découvrir.
Un autre élément important est qu’il n’y a pas de littérature « de gare ». Les représentations du livre et de la lecture en tant que loisir sont développées au niveau de l’éducation des enfants, mais chez les adultes elles sont moins présentes. Le livre ne fait pas partie des loisirs les plus envisagés. Et bien sûr, les nouvelles générations sont davantage portées sur l’oralité, la viralité et les contenus multimédias. L’image du livre en Afrique reste encore trop associée à l’image de l’intellectuel.
L’objet livre, en tant que tel, occupe une place assez limitée car il représente un secteur, la culture, qui est peu valorisé même par les chefs d’État africains qui ont un profil de moins en moins intellectuel et de plus en plus technocrate ou autoritaire. Plusieurs chefs d’États au moment des indépendances étaient des enseignants ou des écrivains qui pouvaient prendre le temps d’aller au théâtre ou de donner des conférences. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins le cas en dehors des obligations protocolaires, et encore.
Dans tous les pays africains francophones, il y a des politiques publiques qui visent à valoriser le livre, qui se manifestent par des journées dédiées, des dons organisés, etc. La place du livre est alors assez encouragée tout en restant bridée. Dans les pays anglophones, le secteur du livre dispose d’un poids économique plus important du fait d’une offre et d’un public un peu plus large, ainsi que d’un usage militant plus important dans le domaine de la conscientisation.
Le secteur de l’édition est assez inégal en Afrique. Si j’en reste aux pays francophones, il y a des pays dans lesquels les gens ont un pouvoir d’achat suffisant pour consommer des livres. Du côté de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, un peu du Bénin et du Cameroun, il y a des éditeurs, relativement importants, qui portent des catalogues et publient des livres dont la distribution va être locale. Ces éditeurs essayent de faire vivre un secteur du livre avec des rencontres, des salons et une actualité. Ils s’appuient sur le fait qu’un bon nombre d’auteurs africains ou de la diaspora sont édités par des éditeurs non africains, et peuvent venir sur les foires, les festivals et les salons en Afrique, mais sans forcément que leurs ouvrages y soient toujours disponibles. Cela pose la question de « qui écrit » et surtout, « pour qui ».
Pour que les livres circulent, il faut tout un circuit de distribution, notamment des librairies. Il y a un petit nombre de bonnes librairies indépendantes et assez bien dotées dans quelques capitales africaines. Mais on voit arriver la Fnac, ou d’autres grandes enseignes françaises, qui ouvrent des espaces dédiés aux livres. Cela pose une série de problèmes, à commencer par les types de titres qui sont mis à disposition du public. J’ai déjà eu l’occasion de les sonder en proposant mes propres ouvrages dans des librairies dépendantes de ces réseaux. Celles-ci m’ont dit que ça ne les intéressait pas, qu’elles préféraient commander des auteurs qu’on retrouve partout, dans les aéroports, les gares ou les supermarchés, ce qui conduit à se demander si ce sont vraiment des libraires ou simplement des commerciaux.
Oui, bien sûr. On a nos propres réseaux de diffusion. Quand je voyage, je prends souvent une valise de livres que je distribue. Des gens sur le continent africain peuvent me commander aussi telle ou telle référence. Surtout, ce sont des libraires de la diaspora, comme Tamery SematawyLa librairie Tamery Sematawy, située à Paris (19 rue du Chalet, 75010), est spécialisée dans divers sujets liés à l’Afrique et à sa diaspora, mais propose aussi une sélection d’ouvrages afro-américains, caribéens et antillais. Elle organise également des rencontres avec des auteurs et des conférences sur la question panafricaine., qui ont des relais en Afrique et profitent des voyageurs militants pour envoyer du stock. Il y a aussi un certain nombre d’associations étudiantes qui développent des clubs de lecture. L’avantage aujourd’hui, c’est qu’on peut facilement faire des choses en ligne et connecter des étudiants ou des militants qui sont en Afrique ou ailleurs. Il y a une époque où je proposais mes livres, tel qu’Africa Unite!Africa Unite!, op. cit., sous forme de prix à gagner lors d’événements. Tu participais et tu pouvais repartir avec un exemplaire. Beaucoup de PDF circulent aussi via WhatsApp. Je suis dans des groupes réunissant des milliers de personnes dans lesquels ne circulent que des livres au format PDF. Ce sont soit des PDF « propres », soit des formats piratés. L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la FrançafriqueL’Empire qui ne veut pas mourir, op. cit., était déjà piraté trois jours après sa parution. Après, lire un bouquin de mille pages sur un écran de téléphone, ce n’est pas très agréable.
D’un point de vue idéologique, comment analysez-vous la transition de Bolloré, des infrastructures logistiques vers le contrôle des médias et de la culture en Afrique?
Idéologiquement, c’est la conquête des esprits et la construction d’un soft power. C’est aussi un positionnement sur l’avenir, puisque les contenus audiovisuels et le divertissement sont ce qui façonne aujourd’hui les jeunesses africaines. Et il faut savoir que le continent africain, du point de vue démographique, est extrêmement jeune. La culture et les médias sont également deux secteurs qui le préservent des contestations les plus radicales. Ce n’est pas la même chose d’avoir en face de soi des jeunes dépolitisés ou des travailleurs africains qui s’inscrivent dans un secteur concurrentiel, syndicalisés et revendicatifs.
Dans ce même esprit, Bolloré a revendu ses infrastructures portuaires qui nécessitaient de lourds investissements, des coûts, des assurances et l’exposaient à trop de risques. C’est aussi une manière de se refaire une virginité, en s’associant à une image de joie et de loisirs tout en se débarrassant de cette image de prédateur qu’il s’était construite.
À l’instar de la place qu’il peut occuper en France, Bolloré est très présent dans le paysage médiatique africain. Sa logique est de mettre en place une continuité entre les deux continents. Dans une époque où domine la bataille des idées, c’est une manière d’harmoniser sa stratégie de contrôle et de façonnement des opinions. On le voit aussi avec Musk : il s’agit de maîtriser les opinions, les discours et les pensées pour ensuite orienter les consciences vers des modes de consommation bien précis. C’est une stratégie redoutable, d’autant plus qu’elle est difficilement attaquable d’un point de vue moral quand on ne sait pas qui est Bolloré. On peut se dire naïvement qu’il apporte de la culture en Afrique, et l’Afrique a besoin de culture, mais la dimension critique de ces contenus culturels est fortement limitée.
Canal+ est très présent en Afrique francophone, notamment au sein des classes moyennes, mais aussi en termes d’infrastructure logistique. Les chaînes de télévision publiques ou privées ont des moyens en deçà de celles de Bolloré. Il n’a pas besoin de faire pression pour écarter la concurrence locale et pour prendre des parts de marché. Il se positionne sur des points stratégiques dans l’industrie du divertissement, avec par exemple NollywoodNollywood est l’industrie du cinéma nigérian, l’une des plus grandes au monde en termes de production de films, reconnue pour ses films à petit budget mais à fort impact culturel. au Nigéria ou MultiChoiceMultiChoice est une entreprise sud-africaine de médias et de divertissement, principalement connue pour ses services de télévision payante comme DStv et GOtv en Afrique. en Afrique du Sud. Canal+ est un système rodé et mondialisé qui permet au public africain d’avoir accès à tout un ensemble de produits de consommation culturelle. Canal+ permet aussi de transposer des formats d’émissions produites en France, mais qui n’y sont plus diffusées, et les réadapter au continent africain. Un peu comme les manuels scolaires d’apprentissage du français qui africanisent les noms des personnages pour s’adapter aux élèves africains.
Dans la diaspora, la chaîne Canal+ est très familière. Quand on est noir de France ou afrodescendant, on la connaît et on peut instinctivement se tourner vers elle en s’attendant à y trouver un contenu assez open, friendly, cool, décontracté, etc. Canal+ a fidélisé un premier public avec des séries, du foot, des émissions et des humoristes qui parlent à la jeunesse, notamment celle issue des banlieues et des diasporas africaines qui, en retournant sur le continent africain, va rechercher ce type de production culturelle. Après dans nos milieux militants africains, ce sont d’autres médias, militants et engagés, tels que Afrique MédiaAfrique Média est une chaîne de télévision panafricaine axée sur l’actualité et la géopolitique. ou Jotna TV« Jotna Tv est une chaîne d’information en continu créée par de jeunes panafricains engagés et conscients des enjeux de l’heure. Elle compte offrir une information de qualité, un nouveau point de vue, une nouvelle voix, sous un prisme panafricain. » D’après la chaîne Youtube « Jotna TV », disponible sur : https://www.youtube.com/c/JOTNATV qui sont suivis. Avec Canal+ Afrique, il y a un ciblage très fort des nouvelles générations qui fait écho à tout un réseau d’influenceurs émergents et avec une qualité technique et esthétique dans la production. Canal+ Afrique propose des contenus très attractifs et conçus pour créer une certaine dépendance. Si je m’imagine être un jeune Africain, que je souhaite faire du cinéma et que je vois la face lisse de ce que produit la chaîne, je peux être facilement attiré par cette vitrine et me dire que c’est vers ça qu’il faut tendre. Évidemment, il existe un univers du cinéma d’essai et du film africain indépendant mais il est confronté, aujourd’hui, aux nouveaux goûts du public qu’impose Bolloré. Il importe aussi beaucoup de blockbusters et de grosses productions qui tranchent avec l’esthétique des films africains. C’est comme s’il faisait une sorte d’OPA sur nos goûts. C’est une attaque déloyale vis-à-vis du cinéma et de la télévision africaine.
Tout ce qui passe à l’écran modèle, caricature et oriente les comportements. J’ai grandi au Bénin et je me rappelle que quand on était petits, on regardait à la télévision des séries brésiliennes, les telenovelas, et évidemment après, avec les copains, on les rejouait. Puis il y a eu les séries américaines qui ont impacté les consciences collectives, puis Nollywood. Aujourd’hui c’est différent. Ce que Bolloré propose via Canal+ et son industrie culturelle, c’est l’élaboration d’un supposé narratif africain, ou en tout cas, l’africanisation de tout ce qui peut être mis à l’écran, des thèmes communs comme la famille, l’éducation des enfants, l’amour, etc. Et cela a un impact évident sur les comportements, les relations sociales, les discussions, les habitudes, etc.
Après bien sûr, c’est une industrie culturelle qui produit des contenus apolitiques avec une logique de diversité consensuelle. Bolloré n’est pas là pour se créer des problèmes et les séries qu’il produit sont forcément désengagées, ce n’est pas Arte. Ce n’est pas en regardant ses chaînes que les jeunes vont se révolter. Nous sommes loin de contenus culturels qui produiraient une conscientisation. Il participe à la construction d’imaginaires qui sont faussement décolonisés, dans le sens où ce ne sont plus des Occidentaux ou des Blancs que l’on voit à l’écran, mais des locaux qui vivent, dans la plupart des cas, selon un mode de vie occidental. Les réalisateurs et les producteurs africains, choisis par Bolloré, travaillent avec des canevas préétablis et un degré de liberté réduit, de manière à ce qu’ils produisent des contenus attendus par le public.
Je ne connais pas suffisamment le maillage international de son réseau pour déterminer son poids sur les identités nationales. Ce que je sais, c’est que dans les domaines où je vois des émissions diffusées par les chaînes qui appartiennent à Bolloré, il y a quand même une dimension, que je ne vais pas décrire comme panafricaine, mais supranationale avec un relent impérialiste. Dans le sens où, même s’il s’agit de producteurs locaux ou d’acteurs d’un pays, les contenus sont produits de façon à parler à un public large, issu de différents pays. Une série tournée au Cameroun pourrait tout à fait connaître un succès en Côte d’Ivoire et inversement. Je ne pense pas que l’intérêt de Bolloré soit d’aider à produire du nationalisme culturel ivoirien, camerounais, ou togolais, etc. Il n’est donc pas dans une volonté de fixation des identités nationales dans les contenus qu’il propose. Il cherche plutôt à produire une culture audiovisuelle et numérique agrégée qui puisse circuler partout en Afrique sans rencontrer d’opposition ni soulever de polémique identitaire qui amènerait par exemple une communauté à boycotter ses médias.
Est-ce que la mainmise sur la production de contenus culturels interfère avec les dynamiques panafricaines?
Oui et non à la fois. Bolloré produit des communautés culturelles, africaines, voire panafricaines, mais dans le sens non militant du terme. Cette production passe aussi par des événements, tels que la Coupe d’Afrique des nations, qui sont en quelque sorte des événements continentaux panafricains dans lesquels la diaspora va se reconnaître. Il y a un véritable positionnement stratégique de sa part à ce niveau-là. Ensuite, il faut bien avoir en tête que le réseau de Bolloré est un réseau transnational. Le réseau qui se déploie dans le plus grand nombre de pays africains, finalement, c’est celui de Bolloré, alors que ça devrait être un réseau « panafricain ». Il y a alors un vrai souci en termes de prédation de l’idée panafricaine.
Derrière le panafricanisme, il y a cette idée très forte de nous unir et il est toujours plus facile de s’unir contre un ennemi commun. Bolloré pourrait être alors cet ennemi commun contre lequel justement construire cette unité. Mais ce n’est pas facile, c’est même assez compliqué. Parce qu’il y aura toujours des personnes qui prendront le parti de Bolloré tant qu’un travail de conscientisation n’aura pas décolonisé les esprits en profondeur. Bolloré est un acteur important dans les domaines du numérique, des médias, des technologies et de l’innovation. Nombre de ses infrastructures bénéficient à des jeunes alors même que nous essayons de les toucher sur les questions panafricaines. Il faut leur expliquer que celui qui leur donne accès au Wi-Fi, à la construction de telle salle de concert, etc., c’est celui qu’il faut combattre. C’est assez ambigu. Il finance plus la culture que les Instituts culturels français à l’étranger mais c’est une culture qui appauvrit culturellement. On a des camarades qui travaillent dans le domaine de la musique ou de la production culturelle, qui travaillent au final pour des entreprises de Bolloré. Parfois on peut les sentir un peu gênés vis-à-vis de cela. C’est compliqué, car Bolloré est à la fois un élément d’attraction, mais aussi de répulsion. Toute la difficulté est d’arriver à se positionner et à maintenir son intégrité.
En tant que panafricains, c’est évident que nous combattons l’empire de Bolloré, car c’est un empire capitaliste et raciste par l’idéologie qu’il diffuse. Ce qu’il met en place va à l’encontre de nos idéaux, nos causes et nos luttes panafricaines. Il s’inscrit, du point de vue de l’histoire, dans des dynamiques coloniales, néocoloniales et impérialistes. Toute la difficulté est de relier le Bolloré caché au Bolloré visible, le Bolloré d’Afrique au Bolloré de France, expliquer ses liens avec la politique africaine de l’État français, montrer ses connexions avec Zemmour ou Sarkozy, etc. Il faut informer sur cette constellation et cela soulève de véritables enjeux pédagogiques. Cela nous oblige à chercher des alternatives face à un système de rouleau compresseur. Il y a des campagnes pour dénoncer Bolloré, qui peuvent être des campagnes de terrain ou des campagnes virtuelles sur les réseaux sociaux, mais qui, pour moi, ne touchent pas suffisamment de monde. Beaucoup de personnes en Afrique estiment aussi qu’on a d’autres priorités. Bolloré n’est pas ce à quoi pense tout un chacun quand il se lève le matin.
Après, le souci, c’est que si on parvient à chasser Bolloré, d’autres arriveront. C’est tout le problème du capitalisme. C’est d’ailleurs ce sur quoi joue beaucoup Bolloré en disant que s’il n’y va pas, d’autres le feront à sa place, notamment d’autres puissances mondiales. En revanche, si on chasse Bolloré, on saura comment chasser ceux qui voudront lui succéder.
Est-ce que Bolloré fait usage de son influence culturelle et médiatique pour influencer les élections et les pouvoirs en place sur le continent africain?
Il est connu pour avoir des entrées auprès des régimes africains au Togo, en Guinée, au Cameroun, etc. N’oublions pas que c’est sur son yacht que Nicolas Sarkozy fêta sa victoire à l’élection présidentielle française en 2007. Si demain Bolloré décide de déstabiliser un chef d’État africain, il peut mobiliser son réseau médiatique pour construire une campagne de dénigrement. Mais il peut aussi, au contraire, utiliser ses médias pour soutenir tel ou tel chef d’État si cela peut lui valoir un contrat. Donc il pratique une forme de corruption médiatique et de trafic d’influence qui lui permet d’accéder, par la visibilité qu’il donne à certains dirigeants africains, à des contrats, des parts de marché ou des retours sur investissement. En plus de ses médias, il peut facilement mettre à disposition d’importants moyens matériels et logistiques. Cela lui confère beaucoup d’influence. Après, je ne pense pas qu’il agisse spécifiquement au niveau des élections. Mais ce qui est certain, c’est que son groupe de communication, Havas, travaille pour les campagnes électorales de chefs d’État africains.
Quelles sont les formes de résistance qui émergent face à l’hégémonie culturelle de Bolloré en Afrique?
Là où ses entreprises sont pointées du doigt, il y a des formes de résistances juridiques, syndicales et venant des travailleurs par des grèves, ou des procédures judiciaires, mais Bolloré a lui-même une capacité juridique et un réseau d’avocats très opérants. Il peut tout à fait plaider coupable comme il l’a fait pour un procès en corruption au TogoLe Monde avec AFP, « Corruption au Togo : Vincent Bolloré demande à la Cour de cassation d’annuler toute la procédure », Togo Actualité, 12/10/2023, disponible sur : https://togoactualite.com/corruption-au-togo-vincent-bollore-demande-a-la-cour-de-cassation-dannuler-toute-la-procedure/, consulté le 27/03/2025., s’il pense mieux s’en sortir ainsi. C’est quelqu’un qui ne se cache pas, même s’il s’exprime assez peu dans les médias. Son discours via ses entreprises est souvent celui d’une fausse innocence, d’une incompréhension ou d’un malentendu. Il incarne vraiment le colon paternaliste qui se persuade de faire le bien en payant par exemple correctement ses employés pour mieux masquer sa prédation.
Ensuite, en termes de résistance, il y a des appels au boycott des médias de Bolloré ou de ses entreprises. Mais avec un succès assez limité, il me semble. Il y a peut-être deux raisons à cela. Soit il n’y a pas suffisamment de « consommateurs » pour que ce soit significatif, soit les consommateurs ne sont pas sensibilisés ou bien même, adhèrent à cette logique libérale du marché. Dans le secteur culturel, les initiatives restent limitées, car lui-même peut se permettre de produire des artistes « contestataires ». Ils sont alors placés dans une situation ambiguë dans laquelle le système les finance pour, quelque part, produire et contrôler son autocritique.
Le panafricanisme et les alliances transnationales entre acteurs culturels africains et diasporiques peuvent-elles jouer à ce niveau-là?
En tant que panafricains, ce qu’on essaie de faire, c’est déjà d’identifier les différentes connexions et ramifications de son empire. Après on essaie de sensibiliser sur le fait que seule la logique d’une unité africaine peut le contrecarrer dans les différents pays où il est implanté.
On a lancé, avec des camarades communistes, un questionnaire sur la situation dans plusieurs pays africains. On a demandé à d’autres camarades qui sont sur le terrain de nous faire des retours et un état des lieux de comment là, à l’instant T, ils perçoivent l’impact et la force de son empire. L’idée est de réfléchir collectivement, grâce à leurs retours situés, à des choses à mettre en place pour lutter contre lui, tout en sachant que c’est un empire qui est évidemment lié au système politique français. C’est-à-dire qu’il faut trouver le moment où le faire vaciller de la manière la plus efficace, en nous inscrivant dans une temporalité globale et internationale. On ne peut pas renverser Bolloré uniquement en Afrique et inversement. Il y a des vases communicants entre la France et les pays africains. C’est pour ces raisons qu’on ne peut lutter contre lui sans avoir une approche panafricaine. Il faut que la diaspora comprenne qui est Bolloré et prenne conscience du fait que son fonctionnement en Afrique est celui de la prédation.
Quelles sont les initiatives pour toucher les diasporas et leur faire comprendre ce que fait Bolloré en Afrique?
Il y a des événements qui ont lieu à différentes occasions, notamment le Salon anticolonial et antiracisteCe Salon fait partie de la Semaine anticoloniale et antiraciste, du collectif Sortir du colonialisme, Montreuil : https://semaineanticoloniale.com ou des conférences sur la Françafrique dans lesquelles revient régulièrement la question de Bolloré. Mais c’est assez compliqué de réellement « toucher la diaspora », dans la mesure où la diaspora vit en France parmi des millions de français, qui ne sont pas non plus spécifiquement touchés par l’action de Bolloré quand bien même ils la subissent chaque jour sans le savoir. Pour « toucher la diaspora » en France, il faudrait toucher tout le monde. Il faut que nous fournissions un travail plus important, un travail qui soit systémique et plus souterrain.
À notre échelle d’éditeurices et au-delà de notre travail strictement d’édition, est-ce que vous voyez des champs que nous pourrions davantage investir?
Oui bien sûr. Je pense que nous pourrions réfléchir à des formes de coédition entre des éditeurs localisés en Afrique et des éditeurs localisés en France. On pourrait développer une politique tarifaire du livre qui permettrait qu’un livre édité en France soit disponible dans un format plus économique ou moins cher en Afrique. Cela pose aussi la question suivante : comment redéployer de vieilles structures, ou comment s’inspirer de celles déjà existantes ? Je pense notamment à AfrilivresAfrilivres est une association panafricaine créée en 2002. Son siège est basé à Cotonou, au Bénin. Elle regroupe 54 maisons d’édition de 14 pays francophones au sud du Sahara, de Madagascar et de l’Ile Maurice. Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/Afrilivres/, un regroupement de médias et de maisons indépendantes africaines, qui dans une dynamique panafricaine et grâce à une alliance transnationale d’éditeurs indépendants, rend visible la production de livres édités en Afrique et met en lumière sa richesse culturelle.
Avec Thomas Deltombe, Benoît Collombat et Thomas Borrel, lorsqu’on avait publié L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la FrançafriqueL’Empire qui ne veut pas mourir, op. cit., on avait confié le chapitre sur Bolloré à Olivier Blamangin. Entre la première et la deuxième édition, on a dû modifier le chapitre parce qu’entre temps, Bolloré avait vendu ses activités en Afrique. Cela nous montre aussi qu’il faut des éditeurs pour soutenir ce genre de production sur le néocolonialisme français dont Bolloré est un porte-étendard. La bataille de l’édition est une bataille idéologique importante. Il faut produire à tous les niveaux de l’édition et de la critique vis-à-vis de Bolloré. Parfois, peut-être que nous devrions faire notre autocritique : qu’avons-nous fait, ou pas fait, pour permettre qu’émergent un tel empire et un tel système ? Qu’est-ce qu’on n’a pas su anticiper ? Qu’est-ce qui nous a pris par surprise ? Parce qu’on est quand même poussés dans nos retranchements vis-à-vis de choses assez sales et brutales. Voilà, mais je pense qu’il y a quand même de l’espoir.
Je me dis qu’il y a de quoi créer des espaces de respiration intellectuels, artistiques, créatifs, etc., dans la continuité du mouvement de sortie du Covid-19, dans lequel on avait besoin de produire, de se lâcher, de dire ce qu’il y avait à dire, de penser vraiment le monde comme si c’était le dernier jour et la fin du monde. Cette notion de fin du monde, elle nous impose de faire le choix, je ne vais pas dire le choix romantique, mais celui de choisir notre mort, de choisir comment nous voulons mourir en tant qu’intellectuels, en tant qu’éditeurs et en tant que producteurs de culture. Et ce qui est sûr, c’est qu’on ne veut pas mourir sous la botte de Bolloré, on ne veut pas mourir de cette manière-là. Donc c’est à nous de mettre du panache dans tout ça, et surtout, de planter suffisamment de graines le temps que le terreau culturel se régénère et devienne plus sain.
À titre personnel, j’ai tendance à penser que d’une manière ou d’une autre, ces empires vont éclater. Que ce soit celui de Musk ou de Bolloré, ou d’autres milliardaires, ils finiront par s’effondrer. Bolloré, même s’il a sa relève multiple, est déjà un peu vers la sortie. C’est à nous de tenir nos positions et de ne pas nous faire aspirer vers le côté obscur.
Entretien —
Le monde des éditions m’a toujours fasciné. J’ai eu l’occasion de réfléchir à ce qui sépare les voix qui sont publiées de celles qu’on invisibilise. Je me suis intéressée et j’ai questionné cette concentration du pouvoir et des ressources nécessaires à l’édition. L’observation initiale qui a nourri ma réflexion repose sur un constat empirique : l’absence frappante de certains récits issus des minorités dans le monde des livres et de l’art. Cette lacune s’est révélée de manière particulièrement marquante lorsque j’ai travaillé à l’École d’art de La Réunion. Il était alors possible pour un·e étudiant·e de traverser cinq années d’études sans jamais entendre parler d’un·e seul·e artiste de l’île. Cette situation soulève une question essentielle : comment un·e jeune étudiant·e peut-iel se projeter dans un milieu artistique qui ne reflète pas son propre environnement, qui ne lui offre pas de modèles associés ?
Cette invisibilité ne se limite pas au monde académique. En fréquentant les foires d’édition d’art, j’ai constaté l’absence quasi totale d’éditeurices africain·es ou issu·es de la diaspora. Lorsqu’iels étaient présent·es, c’était toujours de manière marginale, relégué·es aux espaces périphériques du marché. Aujourd’hui encore, des événements d’envergure internationale tels qu’Offprint à Paris ou Printed Matter’s Art Book Fair à New York — considérée comme la plus grande foire d’édition d’art au monde — ne comptent pratiquement aucun·e éditeurice africain·e. En France, rares sont les maisons d’édition qui publient des artistes noir·es, et lorsque cela se produit, c’est souvent à la suite de l’obtention d’un prix ou d’une reconnaissance institutionnelle.
Bien sûr, ces dix dernières années ont apporté beaucoup de changements. Un énorme travail a été effectué dans le champ de l’art pour les femmes par exemple, aussi bien en termes d’achats dans les collections publiques que de publications. Pour pallier leur invisibilisation, des systèmes de bourses ou d’accompagnement à l’écriture ont été mis en place pour encourager la production de réflexion théorique — comme l’association Aware, soutenue par le ministère de la Culture. Mais c’est beaucoup plus facile à mettre en place pour les questions féministes — c’est pour cela que la parité existe. Concernant les questions raciales, on freine encore des quatre fers. Si de plus en plus d’étudiant·es racisé·es dans les écoles d’art poussent à une pluralité et une diversité dans les réflexions, il reste très difficile de parler de race en France, c’est même contre la Constitution. Impossible donc de faire des études chiffrées, des statistiques. Or si l’on n’a pas de chiffres pour démontrer le problème, le problème n’existe pas. Les pratiques coloniales sont encore ancrées au sein des institutions, on les retrouve dans tous les systèmes de production de connaissance, des arts et de la culture.
Comment réparer cette injustice ? Cette question a motivé mon entrée dans le monde de l’édition. Je suis partie du constat de l’uniformisation de la production de livres d’art, et du manque cruel de diversité, avec l’envie de faire évoluer cette situation dans le but d’imaginer ensemble de nouveaux futurs possibles au sein du monde de l’édition.
C’est ainsi qu’est née AFRIKADAA, la revue que vous codirigez depuis 2013. Pouvez-vous nous raconter ?
J’ai grandi avec Revue Noire, créée en 1991 par Simon Njami, l’un des premiers curateurs noirs — c’est lui notamment qui a organisé l’exposition Africa Remix au Centre Pompidou à Paris en 2005. Revue Noire est la première revue qui a parlé d’art « contemporain » en ce qui concerne les artistes africain·es. À l’époque, on parlait d’« art premier », « art primitif », « art tribal ». Ces termes excluaient du contemporain les artistes du continent. Cela participe du même récit colonial que lorsque Sarkozy prononce à Dakar un discours dans lequel il affirme que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire« Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy », écrit par Henri Guaino et prononcé par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, le 26 juillet 2007 à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Le Monde Afrique, 09/11/2007, disponible sur : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html, consulté le 28 mars 2025. ». Revue Noire n’existait plus depuis 2001 mais une scène artistique contemporaine africaine et diasporique avait émergé en France, une scène très prolifique dont tout le monde refusait de parler. Simon Njami m’a incitée à créer ma propre revue. C’est ainsi qu’AFRIKADAA est née. Une maison d’édition pour se concentrer sur les courants artistiques issus des minorités. Une manière d’écrire une histoire de l’art plus inclusive, où des artistes issu·es du continent africain et des diasporas seraient rendu·es à leur juste place. Une histoire de l’art écrite par des personnes concernées, et pas uniquement des personnes blanches dissertant sur nos corps-objets (considérés comme « meubles » dans le Code Noir en 1685) ou nos corps-sujets (devenus sujets d’étude avec la colonisation). Nous revendiquons des corps-producteurs, producteurs de pensée. Au fond, cela pose la question : qui a le droit de parler ? Sur qui ? Notre pensée n’est pas dans l’exclusion de celle de l’autre, mais elle s’infiltre dans les manquements. Nous nous efforçons de réécrire ce qui a été invisibilisé ou ce que l’on ne veut pas montrer. AFRIKADAA est donc un acte politique. Sa mission est d’écrire un « contre-récit » — mais ce terme n’est pas le bon. Car il ne s’agit pas d’écrire un récit « contre l’autre » ; il s’agit plutôt de donner à lire un « récit augmenté ».
Fondée pour défendre et promouvoir les pratiques artistiques afrodescendantes, AFRIKADAA est un laboratoire d’idées, une plateforme éditoriale et un collectif artistique. Son expertise en matière de narration culturelle et son réseau d’artistes enrichissent le projet d’une profondeur critique et esthétique qui fait écho aux luttes et aux aspirations des diasporas noires. Les voix qui s’expriment par la revue aujourd’hui viennent combler un manque et un décalage existant entre continuum colonial des discours et pratiques de résistances locales ; et montre que continuer de parler de nous sans nous fait preuve d’une incompréhension globale sur les problématiques postcoloniales. AFRIKADAA s’impose ainsi comme une poche de résistance vis-à-vis des pratiques de légitimation du pouvoir.
Au départ, par manque de budget, la revue était numérique. Et puis nous sommes passé·es au papier — l’inverse de ce qui se fait habituellement — car il nous importait d’avoir une trace physique de ce livre-objet et de pouvoir « contrôler » sa présence en ligne. N’ayant aucune prise sur l’hébergeur du site, nous avons eu peur de voir notre contenu disparaître. Au départ, nous imprimions en fonction de notre argent : 200, puis 500, aujourd’hui, nous sommes autour de 1 000 exemplaires. La vente des publications nous permet de payer les auteurices et l’imprimeur. Nous avions envie que la revue soit distribuée, mais c’était ardu. Elle est diffusée essentiellement en ligne et les commandes via le site internet émanent beaucoup de l’étranger. En France, il n’existe que quelques points de dépôts-ventes dans des musées. Au sein de l’édition l’édition d’art, nous sommes vraiment dans une niche, avec des tirages très petits ; nous ne sommes pas vraiment concerné·es par les logiques de la grande distribution et nous nous situons sur un marché différent de celui que distribue Bolloré.
La revue est dirigée par un collectif d’artistes chercheureuses militant·es et racisé·es. C’est un espace dont le rôle est de visibiliser, soutenir, encourager, parfois protéger des artistes issu·es des minorités. Les membres du collectif, organisé·es en association, sont bénévoles et ne touchent pas de subvention qui soutiendrait une quelconque diversité dans le monde de l’édition. Chaque année, nous déposons une demande d’aide à l’édition au Centre national des arts plastiques ; chaque année, notre demande est retoquée. Celle concernant notre prochaine publication, Politics of Sound #2 : les musiques qui réparent les corps et les récits, n’a pas été seulement refusée, elle a été présentée comme inéligible, sous prétexte que nous nous intéressons à la musique, alors que le CNAP s’occupe uniquement d’art contemporain. En nous renvoyant vers le Centre National du Livre, ce dernier nous a assuré qu’il s’occupait bien de musique mais pas d’art contemporain. Or, AFRIKADAA est bel et bien enregistrée en tant que revue d’art contemporain. On tourne en rond, chacun·e se renvoie la balle. Une forme de discrimination s’opère donc dans l’obtention de subventions ou d’aides. Ce n’est pas auprès des institutions qu’il faut nous tourner.
Je pense que notre force vient de notre public qui nous rappelle que notre travail est important. La stratégie qui a été adoptée dans les librairies pour faire venir de plus en plus de monde et vendre nos publications, a été d’organiser beaucoup d’événements tels que des rencontres, des lectures performées, des discussions collectives. Comme la revue s’adresse à un public de niche, nous devons aller le chercher là où il se trouve : dans des lieux associatifs, dans les quartiers populaires. On organise un événement avec un repas, on lit des textes collectivement, on partage. C’est un peu notre façon de pallier une distribution qui est très dure, voire à laquelle on n’a pas accès. Comment lutter contre le tsunami qui contrôle tout, de la production de la pensée jusqu’à sa distribution, dans les médias ? Comment rendre audibles nos idées et les discours, les pratiques de nos auteurices ?
Nous sommes obligé·es d’effectuer un travail de fourmi. C’est beaucoup d’efforts, mais il est important de faire comprendre les difficultés des éditeurices et auteurices indépendant·es. Dans les milieux militants, nous sommes parfois fatigué·es car nous avons l’impression de lutter contre le vent. Pour moi, ce projet de livre, Déborder Bolloré, c’est un peu cela. Nous sommes face à un géant, mais nous ne sommes pas seul·es.
Votre action au sein de l’édition indépendante est motivée par un double mouvement : d’un côté, apporter une diversité dans le paysage éditorial français ; de l’autre, réfléchir à la circulation, et donc, à la diffusion-distribution des livres en Afrique. Les deux ne sont-ils pas nécessairement liés ?
Les deux sont liés ! Pour produire du commun et pouvoir vivre ensemble, pour appréhender le monde complexe et changeant dans lequel nous vivons, nous avons besoin de pensées qui viennent de partout dans le monde et de différentes manières de les produire. Ce qui veut dire lire des voix qui viennent d’ailleurs, qui ne sont pas dans le régime impérialiste, pro-capitaliste, dominant, colonial. Parce que quelque part, les solutions et les récits que portent ces voix nous permettent de comprendre ce monde-là. Par exemple, des auteurices autochtones vont nous parler de préservation des sols et de respect du vivant, une notion oubliée en Occident. Je suis intimement convaincue que nous avons vraiment besoin d’être éclairé·es par ces pensées.
Les éditeurices indépendant·es que je défends publient des auteurices ou visibilisent le travail d’artistes étiqueté·es « wokistes » par la droite, des penseureuses décoloniaux·ales, intéressé·es par les questions de genre et les enjeux queer… Ce sont des structures de résistance, qui prennent des risques. Or la richesse de ce travail éditorial n’est pas reconnue, dans un monde qui fonctionne à l’envers, dans lequel les personnes produisant de la valeur sont les plus précarisées. C’est un rapport de force très violent. Vrai à plein de niveaux dans la société, et particulièrement dans le domaine artistique. L’artiste est sous-payé·e, or sans son travail, il n’y a pas de musée, pas de collectionneur·ses, pas de curateurices. Selon moi, il en va de même pour ces éditeurices qui fournissent des clés de compréhension indispensables, mais sont dans la précarité et peu considéré·es, voire inaudibles.
Aujourd’hui, ce n’est plus la valeur par le travail ou le contenu qui prime. Or, le fait de défendre des valeurs qui sortent du capitalisme et ne sont pas marchandes ne me permet pas de pouvoir survivre. Au vu de la violence qui règne actuellement dans nos sociétés, en tant qu’éditeurices indépendant·es, nous devons nous repenser, repenser notre rôle et l’espace que nous occupons afin de pouvoir participer aux transformations sociétales, et lutter contre les pensées extrêmes.
Mais il ne faut pas non plus nous leurrer. Nous sommes également « en guerre » avec d’autres maisons d’édition indépendantes qui servent une pensée d’extrême droite et fabriquent des récits élaborés pour « défoncer » nos productions, alors même qu’elles s’en inspirent. Il y a une récupération de nos luttes et de leurs outils pour les retourner contre nous. Les exemples les plus frappants se trouvent dans le champ du féminisme avec le féminisme d’extrême droite (le collectif Némésis). La militante africaine-américaine Tarana Burke, à l’origine de MeToo, a été complètement invisibilisée derrière Alyssa Milano. Toujours dans le domaine des violences sexuelles, des femmes d’extrême droite ont repris des discours féministes pour mieux dénoncer des harcèlements, désignant les migrants comme boucs émissaires. Le capitalisme récupère très vite les idées pour les vider de leur sens — c’est une forme d’extractivisme, il en fait ensuite quelque chose souvent de marchand.
Il est donc important de se rassembler et de penser comment ensemble nous pouvons être une alternative, parce nous incarnons des courants de pensées qui luttent contre cette forme d’impérialisme, de capitalisme et de concentration de pouvoir que représente Bolloré, et la réalité politique qu’il représente.
Vous militez en faveur d’une réorganisation de l’écosystème éditorial, et en quelque sorte, d’une auto-organisation.
Le monde de l’art est un véritable business. Ce qui est étonnant, c’est qu’il y a une prescription de l’écrit, mais une déconsidération totale du livre. Dans un premier temps, on constate la disparition progressive, dans les foires d’art, des stands de maisons d’édition. À Art Paris par exemple, il n’y aucun stand dédié à l’édition d’art. De plus, le prix d’un stand est exorbitant. Si les galeries ont de plus en plus de mal à y accéder, c’est tout simplement impossible pour une maison d’édition.
En parallèle, je voulais apporter plus de diversité dans le paysage éditorial européen. La première fois que j’ai été invitée à travailler pour la foire Miss Read à Berlin, elle a été annulée à cause du Covid-19. À la place, j’ai donc proposé que l’on réalise un livre : Decolonizing Art Book Fairs. Il est primordial d’amener ces questions de décolonialité et de diversité sur la table. Je travaille également pour l’événement « Artist Talk by The Eyes », organisé durant la foire Paris Photo. Dans la section édition — l’une des rares qui subsiste —, les maisons présentes sont de grosses structures — Taschen ou même Louis Vuitton — même si l’on trouve également des structures moyennes. Cette année encore, on ne compte aucun·e éditeurice issu·e du continent africain. Soulignons qu’il faut pouvoir investir 3 000 € dans le stand. Je me bats au quotidien pour plus de diversité dans la sélection des photographes, à travers notamment le dispositif de carte blanche donné aux curateurices invité·es : je choisis systématiquement un livre mettant en valeur le travail d’un·e artiste racisé·e, publié par un·e éditeurice qui n’est pas représenté·e dans la foire.
En réalité aujourd’hui, les foires d’édition d’art indépendante rencontrent un réel succès : elles sont de plus en plus nombreuses à se créer. Aux Rencontres de la photographie à Arles par exemple, deux foires se déroulent en même temps. Au vu des difficultés en termes de diffusion-distribution, les petit·es éditeurices indépendant·es trouvent dans ces foires une plateforme alternative essentielle. Selon moi, c’est bien tout une réflexion sur comment faire exister le livre en dehors des cercles classiques de distribution qu’il faut mener. Il s’agit d’emmener le livre — et les savoirs qu’ils contiennent — partout. Et de pallier un manque dans le système traditionnel : l’absence de rencontre entre les différent·es acteurices de la chaîne.
Exactement ! À sa création en 2014, nous l’avons pensée comme un projet artistique : un espace de communion, de réunion, de partage d’expertises et de connaissances, de soutien, de workshops artistiques et d’expositions, dans un double mouvement : exposer la pratique éditoriale sous toutes ses formes et questionner la pratique curatoriale à travers l’objet-livre.
Bien sûr, il s’agit d’abord pour les éditeurices de vendre en direct leurs publications. Le stand coûte 150 € pour les éditeurices implanté·es sur le continent, 50 € pour les éditeurices-artistes qui font des zines ; et pour les maisons implantées en dehors du continent, c’est 300 €. Créer cette foire, c’était une manière d’encourager le peu d’éditeurices en art qui existent sur le continent — c’est vrai, il en existe peu, mais il en existe bel et bien !
Sur le continent africain, la majorité des distributeurs sont européens : leur priorité est d’abord de diffuser des livres d’auteurices européen·es. Notre idée n’était pas de devenir l’équivalent des grosses boîtes de distribution, mais une vraie alternative. Cartographier les maisons d’édition réalisant des livres d’art sur le continent était le premier enjeu, afin de les mettre en réseau et de faire en sorte que toustes les acteurices se rencontrent. Le public est friand de ces rencontres, avec les éditeurices et les auteurices, mais également avec la matérialité de l’objet-livre : il y a un besoin de physicalité et de dialogue. Les programmes de talks sont aussi très importants, car si les difficultés de circulation que nous rencontrons sont liées à des problèmes de diffusion-distribution, elles sont également dues à la multiplicité des langues parlées sur le continent. Il nous faut créer ces espaces de dialogue et d’écoute. Nous avons mis en place des réseaux de diffusion alternative pour faire circuler les publications entre les pays. Par exemple, un·e éditeurice du Cameroun effectue une sélection de livres qu’iel pourrait vendre au Kenya, ou en Afrique du Sud, et iel laisse cette sélection en dépôt à une maison d’édition de ce pays. L’éditeurice du Cameroun prend un pourcentage et le reste va à l’éditeurice du Kenya. On ne parle évidemment pas de milliers d’exemplaires en circulation, de toute façon ces structures ne produisent pas autant de livres. Ou alors, on partage les stands : une structure éditoriale achète un stand et elle y représente plusieurs maisons d’édition — une pratique également mise en place à la foire Miss Read à Berlin.
Depuis trois ans, nous alimentons également la bibliothèque Ousmane Sembène : nous demandons à chaque maison d’édition de donner gracieusement un livre pour augmenter le rayon art de cette bibliothèque. Aujourd’hui, c’est certainement l’un des fonds de bibliothèque les plus intéressants en art !
L’éducation doit être au cœur de nos démarches. L’un des enjeux de l’African Art Book Fair est de désacraliser l’objet-livre. Car en Afrique, ce n’est pas toujours évident d’avoir accès aux livres. Il y a peu de librairies, peu de bibliothèques et elles sont généralement dans des états catastrophiques — hormis celles des institutions étrangères, comme l’Institut français ou l’Institut Goethe. Les gens fréquentent la foire en famille et il est important de s’adresser aux enfants. À Dakar, deux artistes sont invité·es pour travailler dans des écoles afin de réaliser un livre d’artiste avec les enfants. Le workshop de l’année dernière consistait à ramasser des déchets et des coquillages sur la plage pour constituer un livre d’artiste mais aussi sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques par le biais du recyclage des matériaux qu’ils ou elles utilisent pour faire leur livre d’artiste. C’est toujours émouvant, car souvent ce premier livre fabriqué par des enfants est le premier à entrer dans leur maison. Mettre le livre à la portée de l’enfant, c’est lui faire prendre conscience que ce n’est pas qu’un objet rare et cher et que s’il sait raconter des histoires, lui aussi peut réaliser un livre.
Absolument ! Nous travaillons beaucoup autour de cet espace, notamment avec le collectif Chimurenga, basé à Cape Town, en Afrique du Sud. Durant l’apartheid, les étudiant·es noir·es n’avaient pas accès aux bibliothèques. Les seules personnes racisées à y pénétrer étaient les gardiens et les femmes de ménage. Donc quand les étudiant·es avaient besoin d’un livre pour étudier ou réviser un examen, iels donnaient une liste de titres au gardien, qui, durant sa ronde, collait de petits stickers rouges sur le dos des livres. Quand les femmes de ménage venaient le soir, comme beaucoup d’entre elles ne savaient pas lire, elles repéraient les stickers, sortaient les livres de la bibliothèque à la fin de leur service, les donnaient aux étudiant·es qui les lisaient ou les photocopiaient durant la nuit, et les remettaient en place le lendemain. Cette histoire est significative car elle parle de contournement, de solidarité, de collectif… autant de stratégies inspirantes.
À partir de cette histoire, est née la bibliothèque de Chimurenga qui devait s’infiltrer dans celle de Cape Town — une bibliothèque constituée exclusivement d’auteurices noir·es et pas seulement de livres, mais aussi de films, de disques, d’objets, etc. Ce projet a eu lieu à Lagos, à New York, à San Francisco…
Dans le cadre de la Saison Africa2020 à Paris, nous avons travaillé avec ce collectif pour relire la bibliothèque du Centre Pompidou. Nous voulions penser la bibliothèque comme un espace de monstration, un espace refuge, et déconstruire la manière dont l’Occident a pensé ce lieu exclusivement comme un espace de savoirs. Nous avons travaillé pendant deux ans avec dix chercheur·es internationaux·ales, en nous demandant ce que venaient faire les habitué·es qui fréquentaient la Bibliothèque publique d’information. Des personnes sans domicile fixe y restent au chaud toute la journée ; leurs corps s’y reposent. Cela devient un espace safe. Des personnes sans-papiers ou des migrant·es viennent prendre des nouvelles de leur pays, puisque des chaînes de télévision du monde entier sont accessibles. C’est un endroit où l’on ne demande pas de carte à l’entrée, ni aucun papier. Une multitude de personnes cohabitent donc dans ce lieu, aux fonctions multiples. Nous avions par exemple imaginé des installations avec des aires de repos, parce qu’en réalité, c’est ce qu’il se passe en cachette. Nous tenions à visibiliser cet usage.
La bibliothèque est aussi un endroit et un outil essentiels pour lutter contre la discrimination. Avec la revue AFRIKADAA, nous avons travaillé pendant un an avec des étudiant·es racisé·es qui subissaient des discriminations en école d’art, souvent liées à leurs recherches portant sur les questions décoloniales ou des sujets liés à l’exil ou à l’immigration. Du point de vue théorique, le corps enseignant est généralement démuni face à ces questions. Et cela a posé des questions matérielles très concrètes : contrairement à leurs camarades, ces étudiant·es étaient obligé·es d’effectuer leurs recherches en dehors de l’école, car la majorité des livres des bibliothèques d’école d’art concernent l’art occidental, blanc. Cela a donné lieu à un projet de bibliothèque augmentée, expérimenté à la Villa Arson : une bibliothèque décoloniale qui s’infiltre dans la bibliothèque de l’école d’art, toujours dans cet esprit d’écrire une histoire de l’art plus inclusive. Une bibliothèque dans laquelle se retrouvent évidemment de nombreux livres d’éditeurices indépendant·es défendus à l’African Art Book Fair.
À l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, nous avons donné des outils (une méthodologie et une bibliographie numérique) à un collectif d’étudiant·es. À l’École nationale supérieure d’art de la photographie d’Arles, nous avons réalisé une bibliothèque sonore dans la bibliothèque de l’école, sur la thématique de la représentation des corps noirs et issus des minorités dans la photographie. L’objectif de ce workshop était de réécrire une histoire de la photographie plus inclusive. La radio est une alternative intéressante à la diffusion. La plateforme éditoriale Chimurenga s’en est emparée en créant son Pan African Space Station. C’est également ce que nous avons développé à Miss Read, à travers la lumbung radio« lumbung Radio est une radio communautaire inter-locale en ligne. Elle diffuse en continu de multiples langues, musiques et œuvres d’art. Chaque station de radio participante dépend de ses propres moyens de production, de sa façon de penser, d’apprendre et de partager. L’intention est de produire un espace audiophonique commun construit sur la multiplication des pratiques existantes de ses contributeurs. » Voir leur site internet : https://lumbungradio.org/ : c’est une manière virtuelle de présenter les éditeurices et leurs livres et de travailler sur la question cruciale des archives à travers les bibliothèques sonores.
Lie de la terre et lieux bâtards —
Que peut bien vouloir dire « déborder Bolloré » à l’échelle de notre petite maison d’édition indépendante et politique ? Face à un nouveau régime de la perception qui nous insensibilise à l’horreur, nous devons nourrir critique sociale et imaginaires, et ce, aux deux extrémités de la chaîne du livre : à un bout, en éditant celles et ceux dont l’existence même est contradictoire avec le projet politique porté par le bloc bourgeois dans sa tendance fasciste ; à l’autre bout, en réinventant des lieux d’éducation populaire autour de l’édition indépendante et politique qui fassent pièce aux lieux dont un autre milliardaire d’extrême droite veut parsemer les campagnes françaises, dans le cadre de sa « bataille culturelle ».
Repolitiser l’édition
Du point de vue de ses conditions de production et de diffusion, le livre est une marchandise. Pas tout à fait comme les autres certes, mais une marchandise tout de même. Le fonctionnement du marché du livre conduit, comme pour toute autre marchandise, à la concentration des moyens de production et de diffusion, ceux-ci tendant « naturellement » au monopole. Ce processus, qui s’aggrave ces dernières années, ne date donc pas d’hier. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est que cette situation de quasi-monopole — avec la puissance de frappe sur les esprits qui en découle — est ouvertement mobilisée par quelques multinationales pour mener une pseudo-guerre « civilisationnelle ».
Cultiver la haine relève certes de la plus élémentaire rationalité économique. Flatter les bas instincts a toujours été rentable. Mais les grandes familles bourgeoises qui faisaient traditionnellement l’édition depuis l’après-guerre ne menaient pas d’opérations idéologiques aussi brutales. La parenthèse est désormais refermée. Comme en écho aux années 1930, Bolloré fait à nouveau, dans cette période de crise avancée du capitalisme, le pari du fascisme.
La réflexion que nous devons mener en tant qu’éditeurs et éditrices indépendant·es ne peut se limiter àcelle d’un acteur économique de niche. À l’écrasement économique que subit l’édition indépendante s’ajoute désormais une menace de censure politique. Les visées agressives de Bolloré nous obligent à endosser le rôle d’éditeur et éditrice engagé·es, comme les années 1960-70 en ont produit, ou d’« éditeur protagonisteJulien Hage « La génération des éditeurs protagonistes de la décolonisation. Radicalités, rigueurs et richesses de l’engagement éditorial », Bibliodiversity nº 4, février 2016, p. 9-17. » comme le nomme la sociologie contemporaine. Le conflit qui fait jour au sein de l’édition actuellement traverse l’ensemble de la société et nous impose d’assumer nos livres comme autant d’interventions politiques. Le contenu de nos livres, et par là leur portée politique et sociale, peut effectivement déborder.
Réinventer une littérature en partant des exclu·es du monde de l’écrit, sans doute est-ce là le cœur de tout projet éditorial antifasciste. La volonté de désembourgeoiser l’acte d’écrire, comme celui de lire, n’est pas nouvelle. Nul hasard si, dès les années 1930, on trouve les termes d’un conflit autour de l’édition d’une littérature du prolétariat agricole et ouvrier. « Pourquoi y a-t-il en proportion si peu d’ouvriers qui écrivent ? Si peu qui sont publiés ? Quel rapport entre l’écriture et l’expérience sociale des auteurs ? La culture fascine — mais là comme ailleurs existent des inégalités socialesHenry Poulaille, Nouvel âge littéraire, Bassac, Plein Chant, 2016 [1930].. »
Éditer la lie de la terre
Qui porte la plume ? Qui tape sur le clavier ? Qui est enregistré·e dans le micro du Zoom ? Celles et ceux qui n’intéressent pas économiquement Bolloré nous intéressent, et notre tâche est de les éditer. Loin d’une certaine passion française pour les essais surplombants qui emploient le langage de l’université et pour les autofictions égotiques de quelques privilégié·es (même bien intentionné·es). En tant que petite maison d’édition, notre objectif n’est pas tant que les grandes signatures qui font métier d’écrire des livres ou de penser le monde quittent les multinationales du livre (si elles le font, tant mieux, nous accueillerons Sorj Chalandon ou Svetlana Alexievitch avec une grande joie), mais bien d’éditer celles et ceux dont la prise de plume constitue en soi une prise d’arme, un acte politique. L’organisation matérielle de leur vie et les systèmes imbriqués de domination auraient dû les empêcher d’écrire, c’est pourquoi leur pensée et leur existence sont la négation même du programme de Bolloré. « Si j’ai narré tout au long mes aventures, c’est qu’elles sont typiques de l’espèce d’humanité à laquelle j’appartiens : les exilés, les persécutés, les traqués de l’Europe ; les milliers et les millions qui, à cause de leur race, de leur nationalité ou de leurs croyances, sont devenus la lie de la terre. Les pensées, les craintes, les espoirs, même les contradictions et les incongruités du “je” de ce récit, sont les pensées, les craintes, les espoirs et surtout le désespoir dévorant d’un pourcentage considérable de la population européenneArthur Koestler, La lie de la terre, Paris, Calmann-Lévy, 2013 (première édition française 1946).. » C’est sur ces mots qu’Arthur Koestler conclut La lie de la terre, écrit en 1941.
Les paroles des exploité·es, et des dominé·es en général, ne sont pas tant « minoritaires » que minorisées. « Commencez l’histoire par les flèches des Américains natifs, et non par l’arrivée des Anglais, et vous obtiendrez une histoire complètement différenteChimamanda Ngozi Adichie, « Le danger d’une histoire unique », Facing History & Ourselves, 2016, disponible sur : https://www.facinghistory.org/fr/resource-library/le-danger-dune-histoire-unique, consulté en février 2025. », nous rappelle l’écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Si les formes varient, ces écrits ont en commun de faire vivre « la mémoire des vaincu·esMichel Ragon, La mémoire des vaincus, Paris, Le Livre de Poche, 1992 [1989]. » qui est, faut-il le rappeler, l’histoire de quasiment toute l’humanité.
Depuis une quinzaine d’années, une nouvelle vague d’édition critique émerge en France — notamment portée par le diffuseur Hobo diffusion. À côté d’un travail important de réédition de classiques des mouvements d’émancipation (de Rosa Luxemburg à Pierre Kropotkine en passant par Selma James ou bell hooks), les voix d’en bas« Voix d’en bas » est une collection des éditions Plein Chant. commencent à se faire une petite place dans l’édition sous l’impulsion notamment des mouvements féministes, décoloniaux et autochtones.
Si nous faisons une place à ces écrits, ce n’est pas pour faire exister une sympathique diversité mais parce que leur portée est profondément universelle et qu’ils jouent un rôle essentiel dans l’intelligibilité du monde contemporain. Prenons l’exemple de la puissante pensée critique qui s’élabore derrière les murs des prisons. Cette littérature, « affirme le droit pour un délinquant de parler de la loiMichel Foucault (préface) dans Serge Livrozet, De la prison à la révolte, Paris, L’esprit frappeur, 1999 [1973]. », pour reprendre les mots de Michel Foucault. Cette parole « entreprend de voir du point de vue de l’infracteur le sens politique de l’infractionIbid. ». Que ces voix échappent à la censure, qu’elles défient l’oubli sur lequel repose la prison, qu’elles contestent la Loi et le châtiment, et l’ordre dominant s’en trouve troublé. Elles sont encore essentielles à bien d’autres égards : elles renseignent « celles et ceux qui se croient libresThierry Chatbi, Nadia Menenger, À ceux qui se croient libres, Montreuil, L’Insomniaque, 2015. » sur la carcéralisation du monde. Elles nous rappellent qu’il n’y pas de frontière entre légalité et barbarie au sein d’une société totale. Elles établissent en chair et en os le sens de cette liberté sociale que nous désirons contre le mortifère fascisme. Ces paroles, il ne faut pas les ranger dans un hypothétique — et repoussant — rayon prison, mais en philosophie, en histoire sociale, en récits d’aventures, en romans d’anticipation.
Regarder le camp
La fréquentation assidue de l’horreur contemporaine ne produit plus grand-chose. La torture est devenue le spectacle de notre époque. De cette insensibilisation collective renaissent les fascismes 3.0. Le flux continu des images de mort a comme tué les mots. Pour comprendre ce que signifient « tuerie de masse », « génocide » ou « catastrophe industrielle », il nous faut écouter la vie particulière de chacun·e des mort·es et des survivant·es : « S’il est écrit que je dois mourir / Il vous appartiendra alors de vivre / Pour raconter mon histoire / S’il est écrit que je dois mourir / Alors que ma mort apporte l’espoir / Que ma mort devienne une histoireRefaat Alareer, « Que cela devienne une histoire » dans Que ma mort apporte l’espoir, poèmes de Gaza, Montreuil, Éditions Libertalia, 2024.. »
Assurément, il manque une littérature contemporaine des camps qui rende perceptible la condition de notre époque — celle de l’exilé·e surnuméraire ou celle de l’individu exploité et administré au sein d’un monde industriel, par exemple —, et qui rende possible d’y résister. Il manque une littérature qui soit capable de tendre un miroir à chacun et chacune pour lui demander : « Est-ce le monde qui regarde le camp ou le camp qui regarde le mondeHélène Châtelain, Iossip Pasternak, Goulag, France, 13 Productions, 2000. ? »
Comme l’écrivait magistralement Varlam Chalamov : « Le camp est une école négative de la vie. Aucun homme ne devrait voir ce qui s’y passe, ni même le savoir. Il s’agit en fait d’une connaissance essentielle, une connaissance de l’être, de l’état ultime de l’homme, mais acquise à un prix trop élevé. C’est aussi un savoir que l’art, désormais, ne saurait éluderVarlam Chalamov, Récits de la Kolyma, Lagrasse, Verdier, 2003.. » Dans les années 1950–1960, Les Éditions de Minuit ou Maurice Nadeau ont su faire une place dans la littérature à ces voix que personne ne voulait entendre et encore moins lire. Ils ont brisé un silence social en éditant les récits de celles et ceux qui ont été « contestés comme membre de l’espèceRobert Antelme, L’Espèce humaine, Paris, Gallimard, 1957. » comme le disait Robert Antelme. Ces textes ont ainsi servi à « méditer sur les limites de cette espèce, sur la distance à la “nature” et sa relation avec elle, sur une certaine solitude de l’espèce, et pour finir, surtout à concevoir une vue claire de son unité indivisibleIbid.. » L’humanité et la vitalité des écrits des camps nous indiquent comment nous façonner une attitude intègre, combattre le sentiment d’impuissance et refuser le cynisme dans cette époque de catastrophe permanente. La mémoire vivante de la position humaniste, antifasciste, anti-autoritaire, antiraciste des survivant·es des camps est indispensable pour construire un point de vue éclairé sur les événements en cours et, plus généralement, trouver les qualités nécessaires pour penser, vivre et agir aujourd’hui.
Aujourd’hui, les mêmes qui font mine d’écouter avec dévotion et gravité les paroles des dernier·ères survivant·es des camps justifient dans le même temps les pratiques génocidaires d’un État colonial, construisent d’énièmes prisons de haute sécurité et exportent la gestion militarisée de leurs camps. On ne peut décidément pas honorer la mémoire des mort·es sans faire l’effort de comprendre comment ils et elles sont mort·es.
L’édition indépendante contemporaine, si elle prend au sérieux l’hypothèse d’un fascisme international, ne doit pas éluder ce savoir. Le « point de vue situé » de l’exterminé·e doit être son point de départ. Recommencer encore et encore ce geste d’édition pour mettre à jour le projet nu de l’extrême droite : tuerie, enfermement et torture de masse. Relire et rééditer les paroles des survivant·es du siècle passé contribue à faire émerger une littérature de cette sorte au XXIe siècle.
Construire des lieux bâtards
Éditer les exclu·es du monde de l’écrit et de la lecture — les vaincu·es du livre en quelque sorte — nécessite, avant tout, beaucoup de temps. La confiance avec ces auteurs et autrices en devenir est longue à construire. Le temps nécessaire pour faire accoucher de ces textes ne se compte pas pour l’éditeur et l’éditrice, et il est compliqué à trouver pour l’auteur et l’autrice. Les difficultés se poursuivent au moment de la diffusion et de la circulation de ces textes : où ont-ils leur place dans les rayonnages des librairies ? La portée générale de leur analyse critique empêche d’en faire de simples « témoignages ». Ils ne sont pas non plus suffisamment conformes aux canons des essais pour être défendus en sciences humaines. Enfin, les librairies rechignent à reconnaître leur caractère littéraire puisque leurs auteurs et leurs autrices ne font pas métier d’écrire. Impossible à classer, ces textes finissent souvent par se perdre dans la littérature générale. La reconnaissance auprès des lecteurs et lectrices est à rebâtir pour chaque livre.
Pour faire vivre cette littérature atypique — même au sein de l’édition indépendante —, il nous faut donc aussi inventer des lieux qui puissent à la fois accueillir ce travail d’accouchement des textes sur un temps long et qui permettent en même temps un autre type de diffusion. Il ne s’agit pas de concurrencer les librairies indépendantes mais, en tant qu’éditeurs et éditrices, de compléter ce qu’elles proposent.
Nous avons fait ce pari en montant un lieu au Mas-d’Azil, un village ariégeois où est basée la maison d’édition depuis 2012. Notre Maison de Papier accueille les bureaux de la maison d’édition, des espaces de travail pour écrire, une salle où se tiennent des ateliers d’éducation populaire proposés par des associations du village ainsi qu’un comptoir de vente. Une fois par semaine les habitant·es peuvent venir y commander des livres que nous acheminons depuis les deux librairies indépendantes partenaires situées dans les villes du département. Ils et elles peuvent aussi trouver là une sélection assez ramassée de livres, construite autour de catalogues de l’édition indépendante ou des classiques de la littérature populaire. Chaque trimestre nous proposons une programmation qui « déplie » un livre de notre propre catalogue en invitant auteurs et autrices, traducteurs et traductrices, un autre éditeur ou éditrice indépendant·es dont nous apprécions le travail. Rentrent ainsi dans cet endroit des gens qui ne se seraient jamais risqués dans une librairie. Dans cette époque, la soif de discuter se fait sentir.
Nous n’avons rien inventé. Nous nous sommes contenté·es de puiser dans ce qui existait déjà du côté des cafés associatifs, du tiers-secteur culturel, des centres sociaux ou, plus loin encore, des athénées libertaires. Les exemples sont de plus en plus nombreux de ces lieux où le livre existe autrement et touche d’autres personnes, complétant la diffusion en librairie, assumant une dimension politique. Des lieux bâtards où se mènent expérimentations sociale, politique et culturelle en faisant une place centrale à l’édition indépendanteLe spectre est large : citons par exemple La Chapelle à Toulouse (31) qui accueille la librairie associative du Kiosk, le café-librairie Michèle Firk niché au creux de La Parole Errante à Montreuil (93), le café Plùm à Lautrec (81), Chez Josette à Charleville-Mézières (08). Les éditions Divergences ont ouvert depuis peu à Quimperlé (29) une librairie qui est aussi café, point poste et dépôt de pain..
Au moment où nous étions en train de faire, une fois de plus, appel aux bras et aux poches trouées de nos ami·es pour ouvrir notre lieu, nous apprenions que ceux du camp d’en face avaient la même idée. À une différence près : ils ne comptaient pas sur l’habituelle perfusion étatique de l’industrie culturelle — en voie de tarissement — mais bien sur le fonds d’investissement de Pierre-Édouard Stérin, un autre milliardaire ultraconservateur engagé à l’extrême droite. À travers la structure Fonds du Bien Commun, ce dernier annonçait mettre un milliard d’euros sur la table pour, entre autres, « réinventer le modèle de la librairie multi-activités, via une offre culturelle au service des familles dans les petites et moyennes villes françaises dépourvues d’offre, grâce à une diversification de produits et d’activités (petite restauration, animation culturelle, espace jeunesseNicolas Gary, « Le milliardaire Pierre-Edouard Stérin veut faire pousser des librairies », ActuaLitté, 04/09/2024, disponible sur : https://actualitte.com/article/119046/economie/le-milliardaire-pierre-edouard-sterin-veut-faire-pousser-des-librairies, consulté en février 2025.. » Plusieurs centaines de ces lieux doivent ainsi permettre d’organiser 5 000 événements culturels en défense du patrimoine catholique et de la famille pour consolider partout en France les positions de la droite traditionaliste. Ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste révélé par le journal L’Humanité, baptisé « Périclès » — pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Ce plan, censé faire gagner 300 villes au RN en 2026, prévoit en outre la création d’une école de formation : « réserve d’hommes et de femmes, jusqu’à un millier, prêts à devenir candidats, experts, technocrates, pour être placés dans les ministères et administrations en cas de victoire de l’extrême droite en 2027Thomas Lemahieu, « Périclès, le projet dévoilé », L’Humanité, 19/07/2024, disponible sur : https://www.humanite.fr/politique/bien-commun/projet-pericles-le-document-qui-dit-tout-du-plan-de-pierre-edouard-sterin-pour-installer-le-rn-au-pouvoir, consulté en février 2025.. » Leurs ennemis : « wokisme, immigration, islamisme et socialisme. »
Ce projet d’une constellation de lieux-librairies d’extrême droite verra ou non le jour sous cette forme. En attendant, dans l’ombre de ces patrons propres sur eux, leurs petits copains en sweats à capuche reprennent activement le travail historique de l’extrême droite, la terreur de rue, en prenant notamment pour cible les lieux du livre. Mars 2022 : la librairie La Confiserie de Rabastens (81) est ravagée par un groupe de jeunes hommes qui profèrent des insultes racistes et tabassent les libraires. Août 2023 : La Brèche, librairie parisienne liée au Nouveau parti anticapitaliste est taguée par le GUD (Groupe union défense, organisation étudiante d’extrême droite) et les Zouaves Paris (groupuscule néonazi). Mars 2024 : la Librairie Publico à Paris est attaquée à trois reprises en quelques jours par des militants du groupe Natifs (ex-Génération identitaire). Juin 2024 : la vitrine antiraciste de la librairie jeunesse le Petit Pantagruel à Marseille est brisée. Le même mois, la librairie Le Failler à Rennes est dégradée alors que sa vitrine accompagne le mois des fiertés. Février 2025 : le lieu collectif la Chapelle à Toulouse est recouvert d’inscriptions nazies.
Face à Bolloré et à ses amis, c’est une tâche éminemment politique autant que sensible qui incombe aux éditeurs et éditrices : faire en sorte que les vaincu·es écrivent leurs récits et s’inscrivent dans ceux de leurs prédécesseur·es ; que les paroles minorisées soient légions et convergent dans des catalogues qui leur donnent de la voix ; que les éditeurs et éditrices les accompagnent ou les aident à accoucher ; que les diffuseurs les défendent pour ce qu’ils sont ; que les libraires s’appuient sur ces voix pour sortir — un peu — de la logique de la nouveauté ; que des nouveaux lieux s’inventent encore et toujours.
Lesbienne à la page —
Il y a autant de façons de faire de l’édition indépendante que d’être lesbienne. Personne ne sait exactement ce que c’est d’être lesbienne : c’est trop de choses en même temps et aucune définition ne peut convenir à toustes. Publier des livres en dehors des circuits hégémoniques comporte de nombreuses nuances. Ce texte adopte donc la perspective de mon expérience qui mélange les gouines et les pages depuis plus d’une décennie, à la fois en tant qu’autrice et éditrice.
Comme l’écrit Dorothy Allison dans une lettre adressée à Joanna Russ le 23 février 1996 : « Class stuff, lesbian stuff, sex stuff—dont’ know where one crevice ends and another begins. Just know where I am, sort of, at any one momentNdÉ : Traduction proposée par Clara Pacotte, l’autrice de ce texte : « Des trucs de classe sociale, des trucs de lesbiennes, des trucs de sexe — je ne sais pas où l’une de ses failles s’ouvre et où une autre se ferme. Je sais juste, à peu près, où je suis moi, à tout moment. ». »
J’ai fabriqué plein de fanzines en collectif depuis 2011 dans lesquels je mélangeais tout et c’est toujours une activité qui me donne énormément de plaisirNotamment avec le collectif Travlator$ entre 2011 et 2016, puis à partir de 2018 avec le collectif EAAPES sur les questions de féminismes dans les littératures de science-fiction.. Rassembler, imprimer, relier, faire vite pour l’événement du lendemain, tirer jusqu’à épuiser les toners des imprimantes gratuites à disposition dans les lieux cachés, soufflés à l’oreille, les invitations sous le manteau à user des photocopieuses dans les caves des maisons des associations et des écoles d’art pas trop fauchées, les salles des profs des copines, les bureaux d’autres. D’abord ancienne étudiante en bons termes avec les responsables de pôles édition, je me suis retrouvée petit à petit invitée à enseigner dans des écoles d’art. Outre la proposition souvent faite de pouvoir revenir à l’avenir dans les locaux pour des projets d’impression personnels ou externes, les moments de workshops sont un accès, au moins temporaire, à la journée ou à la semaine, au matériel mis à disposition des équipes enseignantes et des étudiantxs — la plupart du temps gratuitement. C’est une façon, par exemple, d’obtenir des consommables ou des outils de reliure grâce aux lignes dédiées des budgets des administrations qui initient ces invitations, de repartir avec une partie du stock trop spécifique pour resservir sous peu dans l’école.
Faire des fanzines tel que je l’entends, c’est faire le plus cheap possible, le plus d’exemplaires possible (quantité qui reste toujours assez limitée par le prix du papier, le temps d’impression et de façonnageLe façonnage peut comprendre, en fonction de la forme finale : la découpe, le massicotage, le pliage, l’assemblage, la reliure, et le contre-collage de l’ouvrage.), diffuser là où on peut à qui on veut, et surtout remplir les pages de ce qu’on veut voir exister et dire ici et maintenant — entre les envies de tout péter et les désirs d’aimer.
Ma pratique de l’édition dite indépendante dans le cadre de RAG Éditions, créées en 2020, suit la même logique. Que ce soit décider de rendre hommage à des dictionnaires mêlant culture lesbienne contemporaine et ré-interprétations mythologiquesEsmé Planchon, Héléna de Laurens et Clara Pacotte, Le Jukebox des Trobairitz, Rennes, RAG Éditions, 2023., donner libre cours aux fantasmes explicitement sexuels d’une femme au travail alimentaire ingratLA Warman, Whore Foods, Chroniques d’une caissière en chien, Rennes, RAG Éditions, 2023., permettre l’existence d’un recueil de textes vengeursProjet à paraître chez RAG Éditions en 2025. ou de ceux d’une peintre et chercheuse qui écrit aussi de la poésie en BretagneLou-Maria Le Brusq, Malédiction, Rennes, RAG Éditions, 2024.. Ce qui a changé, c’est que je ne fais plus l’impression et la reliure moi-même.
Si je traduis, mets en page et publie des livres, c’est exactement pour la même raison que je fabrique des fanzines avec mes copines depuis des années : dire ce que je veux quand je veux.
J’ai la liberté de pouvoir publier le langage tel qu’il est pratiqué par certaines marges dont je fais partie — par exemple les lesbiennes, les auteurices qui réfléchissent à des futurs alternatifs, celleux qui oscillent entre fiction et mise en scène de soi.
Concrètement, je publie ce que je voudrais trouver parmi les étagères d’une de mes librairies préférées. J’ai l’impression de m’incruster et c’est jouissif.
Je veux incruster des histoires drôles, sales, fantasques, celles qui mélangent la poésie et l’auto-fiction, celles qui inventent des sous-cultures, celles qui malaxent d’autres textes, celles qui sont sans filtre, celles qui mêlent le quotidien au fantasme. Ici je parle en tant qu’éditrice, mais aussi en tant qu’autrice. Mon travail d’écriture rejoint ces idées et j’écris plus d’épopées lesbiennes et de textes pornos en épisodes pleins de fruits et de bruits que de textes plus théoriques comme celui-ci.
J’ai appris à ne pas me justifier d’exister en tant que lesbienne et donc à ne pas, non plus, me justifier de faire exister des choses dans lesquelles je peux me reconnaître.
Si l’écriture a été inventée pour compter, faire du commerce, échanger des biens, j’imagine une branche de l’évolution linguistique qui, avant tous les alphabets, en parallèle de la diversification des langues, et des dialectes, a bifurqué. Elle aurait fait un pas de côté et se serait petit à petit éloignée de l’écriture « classique » pour devenir un système de narration à part. Comme la musique, qui a ses propres symboles et ses propres systèmes.
Il y aurait un système d’écriture pour dire tout ce qui n’est pas monnayable, pas quantifiable ou standard.
Parler de standards c’est déjà affirmer l’existence de tout ce qui ne rentre pas dans les limites de ceux-ci.
C’est avoir des fichiers texte remplis de mots soulignés en rouge et ne jamais pouvoir oublier qu’on s’écarte de la norme. Ou s’atteler à la tâche légèrement fastidieuse, mais non moins malicieuse de remodifier tous les néologismes ou accords post-binaires que les correcteurs orthographiques ont automatiquement décidé de « remettre en ordre », « dans le droit chemin ».
C’est traduire en lien étroit avec les autrices pour savoir ce que le français peut apporter et ce qu’il faut inventer pour ne pas dénaturer un texte dans lequel le genre n’est pas binaire. Avec LA Warman, dont j’ai traduit le livre Whore Foods, nous avons échangé tout au long de la traduction — je voulais retranscrire au mieux la sexualité complexe et drôle des personnages, elle était ravie de savoir que lèvres en français peut parler à la fois de la bouche et du sexeEn anglais lips désigne les lèvres buccales et labias les lèvres génitales., elle me détaillait des références culturelles connues des queer étasuniennxs noyées dans le texte avant de choisir si elles deviendraient des notes de bas de page ou bien seraient adaptées au contexte francophone, parfois on gardait des expressions en anglais.
Dévier des standards de manière ostentatoire c’est éclairer leurs faiblesses et les mettre en défaut.
RAG Éditions me permet de me rapprocher d’une pratique que la langue orale connaît bien mieux : l’hybridation ; la grammaire, l’orthographe, la syntaxe, la rectitude de certaines règles et de leurs interdictions — la langue orale, déviante et évolutive par essence, s’en affranchit beaucoup plus facilement, traverse les frontières, mélange les cultures, crée de nouvelles expressions, des mots, des façons d’assembler les idées, de décrire les émotions.
La langue française inclusive sous toutes ses formes existantes et à venir est une pratique qui s’inscrit dans le refus d’une certaine partie des auteurices et éditeurices (dont je fais partie) d’accepter l’hégémonie d’une langue normée par un groupe restreint qui n’incarne pas nos valeurs. Au XIXe siècle, George Sand et certainxs de ses pairs s’insurgent, par exemple, contre la normalisation de la ponctuation, inventent des nouveaux points exclarrogatifs, d’amour, d’ironie, de doute« Si George Sand s’insurge, c’est surtout pour insister sur le fait que les auteurs, par le biais de la ponctuation — ça nous paraît évident aujourd’hui, mais ça ne l’était pas à l’époque — expriment une part de leur originalité, surenchérit Myriam Ponge. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la voix de l’écrivain, son rythme. Elle a essayé de défendre cette voix contre une application très stricte des règles », dans Pierre Ropert, Une histoire de la ponctuation : point d’ironie et point de doute, la ponctuation poétique, disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/une-histoire-de-la-ponctuation-point-d-ironie-et-point-de-doute-la-ponctuation-poetique-6537190, consulté le 20/12/2024.. Iels se défendent contre les imprimeurs de l’époque qui jugent les auteurices trop émotive·fs et capricieusxs pour gérer elleux-mêmes la ponctuation de leurs textes. Elle écrit dans une lettre à Charles-Edmond en 1871 : « Je nie [que la ponctuation] relève immédiatement des règles grammaticales, je prétends qu’elle doit être plus élastique et n’avoir point de règle absolue.
Il y a une foule de bons traités de la ponctuation. Il faut les avoir lus, il faut s’en aider au besoin, il ne faut pas s’y soumettre avec servilitéAnnette Lorenceau, « La ponctuation au XIXe siècle », dans Langue française, nº 45, 1980, p. 56-59.. »
Dans les années 1980, l’autrice et linguiste étasunienne Suzette Haden Elgin développe une langue par et pour les femmesRuth Menzies, « Creating a “Truer” Language Within a Work of Fiction : The Example of Suzette Haden Elgin’s Native Tongue », e-Rea, 15/03/2012, disponible sur : https://journals.openedition.org/erea/2410, consulté le 12/02/2025. avec la volonté de proposer une alternative capable de rendre compte de l’expérience du monde par les femmes. C’est aussi une façon de pouvoir communiquer en dehors du spectre de compréhension de leurs oppresseurs. On retrouve cette idée avec les cryptolectes, langues parlées et comprises uniquement par certainxs membres d’une population dans le but de communiquer entre elleux en restant inintelligibles pour l’extérieur du groupe (de la police ou des hétéros dans les exemples qui suivent). Il en a existé un certain nombre au sein des communautés LGBTQIA+, surtout utilisées par les hommes gays et les travailleureuses du sexe, du début du XXe siècle à la dépénalisation progressive de l’homosexualité, et il en existe toujours. Par exemple, læ PolariMélange polymorphe et constamment évolutif empruntant notamment au langage secret des voleureuses, à l’argot cockney, au verlan, au yiddish, à la lingua franca des marins, au langage codé de l’US Air Force., en Angleterre, fait l’objet d’études et de processus de transcription pour éviter sa disparition depuis les années 2000. Læ KaliardaNé à partir des années 1940, ce langage argotique secret inventé par des travailleureuses grec·ques du sexe comme un moyen de protection a été réapproprié par les femmes trans et les homosexuel·les pendant les années d’extrême répression, notamment durant la dictature militaire (1967–1974). L’emploi de cet « argot » a continué, tant à Athènes qu’en province, jusque dans les années 1980 — notamment dans les lieux de drague homosexuelle et de travail du sexe. Un documentaire réalisé en 2015 par la militante trans Páola Revenióti — également éditrice — est disponible sur : https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/peuples-et-luttes-en-grece/kaliarda, consulté le 09/01/2025., en Grèce, est un bon exemple d’hybridation de langues étrangères et de références culturelles croisées propres à des groupes sociaux marginalisés. Linguistiquement, des dizaines de néologismes usent d’humour noir et de dérivés de notions partagées. Par exemple, un terme pour dire « supporteur de la dictature » contracte le mot qui veut dire « jeune homme actif » et le nom d’une marque de biscuit qui rappelle le nom du dictateur de l’époque (Papadopoulos).
Alors qu’aujourd’hui la dichotomie homme/femme est heureusement remise en question par une partie des acteurices culturel·les, les glyphes inclusifs développés par des collectives militantes et les formes d’écriture hybrides s’emparent des mêmes problématiques. Grâce à des typographies proposées sous des licences accessibles à toustes, il est possible de contourner certaines limites de la langue. La collective Bye Bye BinaryVoir notamment leur travail de typographie libre sur leur site : https://typotheque.genderfluid.space/fr explique : « Ces conditions d’utilisation cherchent à naviguer entre les tensions et paradoxes des politiques de partage et la critique de la notion d’autorat. Premièrement, la figure de l’auteurice original·e est ambigüe, toute production est infusée des précédentes et s’inscrit dans un continuum de références et de pensée. Deuxièmement, le fait d’apposer une signature sur une production est lié à une histoire d’appropriations de pratiques non canonisées et négligées par l’histoire dominante. C’est donc une question dont il faut prendre soin, en faisant attention aux références, aux généalogies, aux contextes. Il s’agit d’éviter l’appropriation abusive en insistant sur une attribution inclusiveExtrait du texte explicatif du principe de Licence CUTE (Conditions d’utilisation typographiques engageantes) consultable sur : https://typotheque.genderfluid.space/fr/licences, consulté le 15/02/2025.. » On peut citer aussi les travaux de recherche linguistique sur les flexions grammaticales neutres de Alpheratz qui proposent notamment un lexique et différentes options possibles afin de rendre neutre une partie des mots de la langue françaiseExtraits disponibles sur le site de Alpheratz : https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/, consulté le 15/02/2025..
Main dans la main avec les langages codés qui continuent d’exister à des fins de lutte, d’affirmation communautaire ou d’autodéfense des personnes marginalisées et notamment LGBTQIA+Læ pajubà, au Brésil, est un hybride de langues africaines (umbundu, kimbundo, kikongo, egbá, ewe, fon et yoruba), de portugais et d’emprunts à l’espagnol, au français et à l’anglais., les outils de l’édition indépendante permettent désormais de faire exister des langues qui portent en elles des vécus minoritaires.
Comme nos ancêtres — avec les précédentes tentatives successives de déroger aux règles imposées — on continue d’énerver les « défenseureuses » de la langue française avec des nouveaux termes et des nouvelles lettres, pour mon plus grand bonheur. Celleux que ça dérange n’ont plus leur mot à écrire, on n’a pas attendu leurs avis pour être là et on n’en a surtout pas besoin. Des arguments qu’on connaît par cœur, des critiques qu’on pourrait avoir gravées sur des pierres tombales d’académicien·nes depuis le temps, des rhétoriques de dépréciations en sous-genre, — mais pendant ce temps-là, ces mêmes personnes naviguent péniblement dans les eaux troubles des écorchures faites aux dictionnaires et sont bien incapables de savoir quelle horreur langagière on va encore leur sortir pour « mettre en péril la langue française ». Heureusement des linguistes se retrouvent aussi dans la défense de l’évolution de la langue et contre la déification d’un « français immuableVoir Les linguistes atterrées, Le français va très bien, merci, Paris, Gallimard, 2023, collection Tracts (nº 49). ».
Depuis que j’ai commencé à écrire ce texte, je me pose de plus en plus la question de la viabilité de ma maison d’édition et du système qui sous-tend la production de livres. Concrètement, je réunis les conditions d’existence d’un livre (travail éditorial avec les autrices, traduction, correction, mise en page), je le fais fabriquer, il est ensuite distribué, je dois me charger de sa promotion par des biais digitaux — je fais tout ça gratuitement en plus de mon travail alimentaire. De plus en plus, les plateformes digitales majoritaires développent des idéologies d’extrême droite dangereuses pour les communautés dont je fais partie, ce qui ajoute à mes doutes quant aux choix que je fais pour faire exister mon activité éditoriale. Puis-je promouvoir ce travail, par exemple, sur des applications détenues par des oligarques qui pensent que les personnes trans et/ou homosexuelles sont malades mentales ? Si les conditions économiques et idéologiques d’un système du livre monopolisé par les milliardaires ne me permettaient plus de poursuivre une activité à dépôt légalEnregistrement dans les registres de la Bibliothèque nationale de France. et ISBNNuméro d’identification unique du livre., ma pratique de l’édition indépendante se transformerait en pratique pirate à encore plus petite échelle et en retour au fanzine. S’il n’est pas question d’abandonner l’acte de publier aux autoritaristes, changer de méthode est une question que j’envisage en permanence.
L’édition que je pratique est avant tout une libre interprétation du colportage dans son sens — souvent — péjoratif, c’est-à-dire « faire connaître », « répandre », « propager ». Une pensée où infusent les écarts de langue comme des virus qui prennent de plus en plus d’espace dans le paysage littéraire.
Le synonyme le plus proche de « colporter » donné par le CNRTLCentre national de ressources textuelles et lexicales. est le verbe « publier ». Se figurer un monde du livre où la diffusion se fait dans un premier temps de main à main puis de bouche à oreille et inversement est une vision qui me parle.
Historiquement les colporteureuses étaient entre autres des passeureuses itinérant·es d’écrits censurés par la monarchie ou l’Empire, des passeureuses de copies illégales de textes révolutionnaires. Iels donnaient accès aux livres à des personnes vivant dans des lieux reculés ou ruraux à une époque où la production des livres était centralisée à Paris. Ces personnes vivaient une existence assez marginale, sur les routes, où le livre pouvait aussi être synonyme du gîte ou du couvert et où les censeurs avaient du mal à les suivre et donc à les trouver et les arrêter.
L’idée de colportage pose aussi la question de la légitimité de celles qui racontent. Qui sont celles qu’on taxe de propager des rumeurs et de déformer les propos ? En inventant des figures historiques telles que les porteuses de fables, par exemple, Monique Wittig et Sande Zeig imaginent dans leur Brouillon pour un dictionnaire des amantesMonique Wittig, Sande Zeig, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, Paris, Grasset, 2011. un rôle de transmission orale complètement indépendant d’un réseau qui ne serait pas concerné par les histoires colportées. On peut aussi penser aux trobairitzFéminin de troubadour en langue occitane. Dans la langue d’oïl (français du nord) on dit trouveresse. du XIIe et XIIIe siècle, femmes bien réelles, qui transportaient géographiquement des histoires chantées et imaginaires ou non. Quand diffuser un texte était encore une affaire de copie manuscrite, les écrits jugés légitimes d’être transcrits, copiés et transportés n’étaient pas ceux qui parlaient aux marges. Celleux qui colportent voyagent physiquement, vecteurices géographiques des histoires qui parlent à leurs interlocuteurices. On sait à qui on s’adresse et on ne dit pas à n’importe qui. Selon moi, celleux qui colportent aujourd’hui, héritièrxs de ces figures historiques et mythologiques, participent donc de la subsistance des histoires qui ne sont pas considérées. Les histoires sensibles se transmettent par d’autres moyens que les écrits majoritaires et la diffusion à grande échelle.
Au-delà de Bolloré : ce qu’Hachette révèle de la condition de salarié·e en librairie —
La responsabilité active de certains acteurs de la vie publique et médiatique dans la propagation des idées d’extrême droite est chaque jour démontrée et analysée, avec Vincent Bolloré en première ligne. L’urgence de la situation oblige à renforcer la mobilisation contre l’extrême droite institutionnelle et ses allié·es au-delà des seules échéances électorales avec, par exemple, le lancement de la campagne « Désarmer Bolloré », à l’initiative d’une grosse interorganisation militante. Nous, libraires salarié·es, pensons que cette logique d’offensive contre l’extrême droite doit se prolonger partout, et y compris dans notre corporation.
Si Vincent Bolloré était déjà présent dans le monde du livre depuis un certain temps, son rachat d’Hachette fin 2023 constitue une accélération décisive de son agenda politique. Il opère également une articulation inédite entre une logique monopolistique portée à son paroxysme et un contrôle idéologique fasciste de la production d’idées. En prenant la tête du leader incontesté du marché du livre français, il devient d’autant plus puissant et dangereux. Si des initiatives de résistances à ces dynamiques existent déjà et notamment dans la librairieBien que l’essentiel de ces initiatives soient restées spontanées et individuelles, il nous semble important de citer l’Association pour l’écologie du Livre et son travail pour faire valoir, souvent depuis les librairies, une écologie matérielle, sociale et symbolique dans la chaîne du livre. https://ecologiedulivre.org/, nous pensons qu’il est temps que l’inertie cesse et que ces pratiques se massifient, se structurent et se normalisent.
Clairement verbalisée, cette résolution ne reste pas moins difficile à poursuivre. Les discours de nos patron·nes qui désignent les contraintes structurelles et économiques pesant sur notre commerce comme le principal empêchement d’un tel mouvement sont déjà visibles et connus. Si nous y reconnaissons une part évidente de vérité, nous y entendons également une justification bien commode de leur passivité. L’objectif de ce texte n’est donc pas de verser dans ce discours, mais de proposer un autre point de vue.
Nous sommes nombreux·ses à tenter de faire ce travail de résistance, c’est-à-dire à faire notre métier avec des considérations politiques et éthiques. Nous sommes nombreux·ses à considérer le livre autrement que comme un produit et les librairies autrement que comme un lieu de commerce. Quand le livre est un média qui participe, au même titre que la presse ou la télévision, de la production et de la diffusion d’idées, sa pratique commerciale exige une déontologie.
Mais nous nous heurtons à toute une série de paramètres limitants dès lors que l’on tente d’agir depuis nos positions de libraires salarié·es. Car exercer notre métier selon cette exigence demande du temps, une capacité d’organisation, ainsi que l’élaboration et la diffusion d’un savoir professionnel critique. Chacun de ces éléments est mis à mal par la réalité actuelle de nos situations, telle que nous souhaitons vous l’exposer ici.
Notre métier de libraire est souvent l’objet de fantasmes. Que l’on discute avec des personnes qui fréquentent ces commerces ou non, des lecteurices ou non, se présenter comme tel·le provoque généralement une réaction émerveillée et curieuse. C’est un gain presque instantané de capital social. La personne en face de nous imagine aisément une vie intellectuelle et culturelle riche dans une temporalité au ralenti, une existence plongée dans le monde des idées, un quotidien fait de lectures derrière un comptoir, interrompues de temps en temps par une clientèle en quête de conseils vers l’illumination littéraire. Si le mythe est tenace, la réalité est très différente.
Loin de passer notre temps à lire des ouvrages, à les sélectionner minutieusement pour « construire » l’assortiment (c’est-à-dire la proposition éditoriale d’une librairie, son stock) et orienter la clientèle dans sa recherche, le quotidien du travail de libraire est marqué par l’exécution d’une série de tâches très diverses, souvent physiques et répétitives.
En premier lieu, une manutention nécessaire, conséquente et parfois massive : la réception et le traitement quotidien de dizaines de cartons venant des distributeurs, contenant des centaines de livres qui reviennent en stock ou des nouveautés à ranger sur les tables et en rayon (à l’exception des mois d’été et de décembre, chaque semaine en librairie voit arriver son lot de nouvelles parutions).
On accueille certains de ces cartons avec entrain, si ce n’est avec joie. Ils arrivent avec de jolis noms : Belles Lettres, Makassar, Harmonia Mundi, Pollen, Serendip, etc. Ces petites structures indépendantes de distribution gèrent la logistique (acheminent les cartons de livres depuis leurs entrepôts, traitent les retours d’invendus, traitent les réassorts, etc.) d’une multitude de maisons d’édition tout aussi modestes et indépendantes. Dans ces cartons se trouve tel livre, écrit par tel·le auteurice, publié dans telle maison d’édition que l’on affectionne. Une nouvelle sortie que l’on attendait ou le retour d’un livre en rupture, qui auront tous deux besoin d’être défendus pour obtenir une meilleure visibilité, voire un succès de librairie.
Mais dans une économie où 70 % des parts du chiffre d’affaires sont captées par quatre grands groupes éditoriaux, la très grande majorité des cartons arrivent avec d’autres noms, parfois plus lugubres : Union Distribution ou Sodis (propriétés de Madrigall, la holding de la famille Gallimard), MDS (propriété de Vincent Montagne), Interforum (propriété de Daniel Křetínský), et enfin Hachette (propriété de Vincent Bolloré). Mais la provenance des cartons ne nous donne pas vraiment d’indications sur la valeur de leur contenu, et cela révèle des contradictions. Prenez Le Silence de la mer de Vercors. Cette nouvelle de 1942 a été la première publication (clandestine) des Éditions de Minuit. Elle parle de la résistance au nazisme, a été écrite par un résistant, dans une maison d’édition qui deviendra notamment, une fois passée la seconde guerre mondiale et la sortie de la clandestinité, une voix forte contre les crimes français pendant la guerre d’Algérie. Ce livre est une pierre angulaire de l’antifascisme français. Pourtant, il n’est disponible aujourd’hui qu’au Livre de PocheVercors, Le Silence de la mer, Paris, Le Livre de Poche, 2018 [1942]., propriété du groupe Hachette et donc désormais de Vincent Bolloré.
Pour prendre des exemples plus récents, les livres de Gaël Faye, de Paul B. Preciado ou de Virginie Despentes arrivent aussi dans des cartons Hachette. Qui de nous soutiendra que leurs livres et les idées qu’ils véhiculent participent du projet fasciste de réactionnaires comme Bolloré ? Il est donc bien question de contradictions, mais aussi de compromis : vendre en masse ces livres équilibre une économie qui nous permet de soutenir celles et ceux qui ne profitent pas de la même notoriété et ont donc besoin de notre travail.
Pour élaborer un assortiment de livres avec des considérations éthiques, il ne suffit donc pas de faire des choix et des arbitrages entre les distributeurs, mais entre chaque titre. Il faut changer ses habitudes d’achat, se rendre capable de se projeter dans le contenu politique et idéologique des livres que nous proposent les diffuseurs avant que les livres existent, se renseigner sur le contenu de chaque ouvrage présent en magasin pour les garder ou les évacuer. En ce sens, la fascisation évidente du catalogue du groupe Hachette, et la certitude que ses bénéfices profitent au « combat civilisationnelVincent Beaufils, Bolloré, l’homme qui inquiète, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022. » de Vincent Bolloré, facilite le travail. Face à un doute, il suffit de ne pas le prendre ou de s’en débarrasser. À l’heure où l’extrême droite ne cesse de gagner du terrain, dans les urnes, dans les têtes et dans les rues, nous, employé·es de librairie refusons de participer à cette entreprise mortifère et tenterons de nous y opposer par tous les moyens et truchements que notre position nous permet. Outre refuser de participer à la mise en place de livres ouvertement réactionnaires, l’enjeu est plus largement de limiter la place du groupe Hachette dans les librairies où nous exerçons. C’est un travail de fourmi, une entreprise modeste et potentiellement intimidante tant la firme est un acteur central de la production éditoriale. Mais une tentative qui nous permet aussi de retrouver du sens dans l’exercice de notre métier. Pour autant, toutes ces tâches constituent une dépense abyssale d’énergie et de temps.
Et, du temps, nous en avons peu, car non seulement nous le passons à ouvrir, débiter et refermer des cartons (de retours), mais nous en passons aussi beaucoup devant des ordinateurs. Ce sont des logiciels de gestion, dont l’amélioration technique est croissante et parallèle à la professionnalisation du métier, qui nous permettent de gérer les flux énormes de marchandises sans avoir besoin de connaître le contenu de chaque livre. C’est avec l’appui de ces logiciels (mais parfois dans une complète soumission à leur logique) que nous sommes capables de gérer plusieurs dizaines de milliers de références dans un magasin, de choisir lesquels restent et lesquels partent, de choisir parmi les 818 000 titres différents disponibles sur le marchéMinistère de la Culture, Chiffres clés dans le secteur du livre, 2024, disponible sur : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/chiffres-cles-dans-le-secteur-du-livre/. Toutes les ressources en ligne ont été consultées en février 2025. ceux qui sont dignes d’intégrer notre assortiment.
Pas un moment de notre temps de travail n’est donc destiné à lire. D’ailleurs, aucun contrat professionnel en librairie ne spécifie une obligation quelconque à cela. Pour autant, l’obligation implicite ou explicite existe. Elle est déjà personnelle : il est difficile, par conscience professionnelle, d’avoir l’impression de bien faire notre travail de libraire, et notamment d’orienter la clientèle, sans lire un minimum (ou un maximum). Elle est ensuite structurelle : il est très fréquent que notre hiérarchie nous demande des comptes à ce niveau-là, que ce soit par des reproches directs ou des remarques implicites, par l’injonction aux « notules » et aux « coups de cœur » (ces petits encarts écrits par les libraires que l’on retrouve sur les livres, dans les lettres d’information, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, etc.), ou par l’exigence intensifiée des rencontres en librairie. L’injonction est ainsi principalement tournée vers la lecture de nouveautés, des lectures utilitaires, parfois en dehors de toute considération de plaisir ou d’intérêt.
Cette réalité est justifiée dans certains discours par le simple fait que nous, libraires, sommes censé·es être passionné·es de lecture. Si cela est vrai dans une grande majorité des cas, il serait erroné d’affirmer que notre rapport à la lecture, et notamment en quantité, n’est pas profondément affecté par notre vie professionnelle. Par ailleurs, comme nous ne pouvons pas nous permettre de tout lire ou de lire avec une grande attention, nous recourons souvent aux métatextes (la critique, les recensions journalistiques, etc.), ce qui exige une veille médiatique fréquente, renforcée par l’exigence d’être au fait de l’actualité, qu’elle soit littéraire, politique ou autre. Alors que les horaires d’ouverture des librairies nous obligent à travailler tard et souvent le week-end, tout ce travail de lecture — non rémunéré — se fait en dehors des temps de travail effectifs.
Nous, libraires, vivons donc bien plus dans un monde de 1 et de 0, de pixels, de chiffres, de codes et de statistiques que dans un monde de lettres, de mots, de phrases et d’idées. Nous sommes bien plus la tête dans des cartons et derrière des écrans que devant du papier. Le fantasme est loin…
Les évolutions récentes de l’économie du livre et de l’innovation technologique ont tendance à renforcer cette réalité. Avec 75 000 nouveautés qui paraissent chaque annéeSyndicat national de l’édition, Chiffres clés, 2024, disponible sur : https://www.syndicat-librairie.fr/ressources/chiffres-cles, nous devons choisir et lire parmi trois fois plus de nouveaux ouvrages qu’il y a trente ans. Chaque année, ou presque, est un record en termes de nouvelles parutions. Ce fait est largement documenté, médiatisé et discuté dans le monde du livre, et il est à mettre en parallèle avec une réalité corollaire : les livres passent moins de temps sur les tables de librairies, au point où les obligations contractuelles à garder un livre au minimum trois mois avant de le retourner n’existent plus chez une majorité de distributeurs. Pour nous, cela veut dire que nous devons lire davantage et plus souvent si nous voulons rester à la page.
Enfin, la pratique désormais très ancrée de la rencontre en librairie, qui consiste à inviter un·e auteurice à venir discuter de sa nouvelle parution, et l’existence désormais incontournable des réseaux sociaux et des sites vitrines ou marchands ont beaucoup élargi le champ des tâches qui nous incombent : nous devons nous improviser animateurices de conférences, et devenons tour à tour chargé·es de communication, community manager ou encore web designer (au point où ces compétences sont désormais très valorisées au recrutement).
La diversification et l’intensification de ces tâches, si elles ne sont pas mauvaises ou inintéressantes en soi, rendent difficile de dégager le temps nécessaire à développer une connaissance fine de notre assortiment, et donc le contenu des livres que nous mettons à disposition d’achat auprès de notre clientèle. Plus cette dynamique se renforce, plus nous devons nous reposer sur des logiques gestionnaires pour faire notre travail, et, in fine, les livres disparaissent derrière des lignes sur un logiciel.
Ainsi, il devient impossible d’effectuer un travail critique des idées politiques qui sont véhiculées par les livres, a fortiori à l’ère de la bataille culturelle de l’extrême droite et du caractère particulièrement insidieux de son avancement. Il est parfois difficile de discerner, dans la production, ce qui relève d’un discours progressiste ou conservateur, d’un discours qui soutient l’émancipation de toustes ou le maintien du statu quo capitaliste, patriarcal, hétérosexuel et raciste, ou tout cela à la fois.
Les analyses qui viennent d’être énoncées ne sont pas toujours consensuelles. Nous souhaitons à présent visibiliser deux impensés, deux phénomènes qui, jusqu’ici, ont échappé à l’analyse et qui nous semblent essentiels dans le renforcement de ces dynamiques délétères et l’impossibilité de lutter efficacement contre.
Le premier de ces phénomènes est l’indifférenciation systématique entre patron·nes ou gérant·es de librairie, et salarié·es en librairieIl est question ici de librairies comportant des salarié·es (souvent moins de 10, voire moins de 5 salarié·es) et ne reposant pas sur une aventure individuelle. Modèle par ailleurs de plus en plus croissant.. Cet amalgame se retrouve autant dans les discours professionnels de la filière que dans les médias, y compris ceux de gauche (jusque dans des panels de libraires invité·es à une émission réputée d’extrême gauche, où les positions desdit·es invité·es ne sont pas situées). Cette absence de distinction découle peut-être d’une image d’Épinal tenace qui tend à représenter la librairie comme un petit commerce familial qui s’hérite ou, dans certains cas, se lègue à l’employé fidèle ayant fait son début de carrière sous les commandements éclairés (mais paternalistes) du fondateur. Ce cliché relève d’une réalité sociale depuis longtemps révolue et nous pensons qu’il est plus que temps que cet amalgame cesse, car il invisibilise les différences parfois diamétralement opposées tant dans les intérêts que dans les conditions de travail de ces deux positions sociales.
Nos librairies reposent toujours sur un modèle très vertical. La hiérarchie y est souvent très marquée. Le management est au mieux paternaliste, et souvent purement directif. Dans le modèle le plus courant de la librairie généraliste, l’organisation se fait par rayon. Chaque libraire qualifié·e se spécialise et a la charge (partagée ou non) d’une ou plusieurs des grandes sections qui la divise et que la clientèle connaît bien : littérature, sciences humaines, jeunesse, bandes dessinées, pratique, beaux-arts. Cette charge se définit simplement par la gestion complète du rayon qui lui est attribué : les achats, le réassort, le rangement, les retours, l’élaboration de l’assortiment, la majorité des conseils à la clientèle, la lecture, l’animation, etc. Pourtant, ce que promet ce type d’organisation pour notre autonomie et notre indépendance est presque toujours relatif. En effet, les patron·nes, en tant que responsables de la « ligne éditoriale » du lieu qu’iels dirigent, conservent la main et le dernier mot sur les politiques d’assortiment et d’achats, en particulier lors des traditionnels rendez-vous avec les commerciaux·ales de la diffusion qui viennent présenter les catalogues de nouveautés des éditeurices.
Combien de fois le refus de prendre tel ou tel ouvrage, motivé politiquement par un·e de nos collègues libraires, a été annihilé par la décision impérieuse et arbitraire d’un·e patron·ne ? Considérant d’un côté « qu’on ne peut pas se permettre » de se passer d’une vente facile, et de l’autre, qu’il s’agirait de ne jamais déplaire à nos client·es. En vertu des sacro-saints principes de la société du service, la satisfaction de la clientèle semble constituer un horizon indépassable pour nos patron·nes. Selon cette logique, ne pas prendre le dernier ouvrage d’Éric Zemmour peut, dans certains cas, être considéré comme une faute professionnelle. Dès lors, quand on doit s’opposer à nos patron·nes pour un livre dont l’auteur et les idées sont aussi consensuellement décriés, comment réussir à leur imposer le boycott de la majorité du catalogue d’Hachette sous le seul prétexte qu’il appartient indirectement à Vincent Bolloré, aussi réactionnaire et dangereux ce dernier soit-il ?
Les « ventes faciles », c’est-à-dire celles qui n’ont pas besoin de notre travail pour se faire, sont quasiment toujours à l’avantage des grands groupes éditoriaux — Hachette en premier lieu — car ce sont eux qui sont favorisés par les prix littéraires, eux qui ont les meilleurs réseaux auprès des médias prescripteurs, eux qui disposent des meilleurs moyens de publicité, c’est-à-dire du marketing agressif qui touche les lecteurices partout où iels sont.
Obnubilé·es par la fiabilité ou la rentabilité économique de leur commerce, et d’autant plus qu’iels sont parfois isolé·es des espaces de ventes, nos patron·nes oublient que l’absence d’une « vente facile » n’est pas systématiquement synonyme d’une perte de chiffre d’affaires. Iels s’enferment dans les logiques gestionnaires et compromettent toute intégrité et considération éthique au nom de la sécurité et de la prévisibilité financière.
De ce fait, nos modestes tentatives d’avancer des réflexions politiques sur la façon de faire notre métier se heurtent et s’opposent aux intérêts économiques de nos patron·nes. Beaucoup d’entre nous finissent par s’autocensurer et s’autoréguler en anticipant les directives de leur hiérarchie, avec ce que cela implique d’effacement de la personnalitéIl faut pourtant reconnaître les bénéfices sociaux à investir de notre personnalité dans notre métier de libraire. C’est cela qui permet la singularité de nos assortiments et donc la bibliodiversité..
Mais parlons aussi des conditions matérielles et de la souffrance au travail. Il y a, d’abord, tous les phénomènes déjà cités : l’accélération d’un rythme déjà frénétique ; la diversification aliénante de nos tâches ; notre incapacité à absorber la surproduction éditoriale et donc l’impression de ne vendre que du papier ; la difficulté de faire avancer nos considérations éthiques. Tout cela peut provoquer une perte de sens, qui se traduit chez certain·es de nos collègues par des arrêts de travail en série.
Ensuite, la convention nationale prévoit, au 1er novembre 2024Syndicat de la librairie française, Salaires minimums, 2024, disponible sur : https://www.syndicat-librairie.fr/social/salaires-minimums, un salaire minimum de 1 965 € brut pour des libraires qualifié·es comme gestionnaires de rayon, et cela dans les librairies qui ne sous-qualifient pas leurs employé·es en vendeur·ses. C’est donc 164 € brut au-dessus du SMIC, ou environ 9 % de plus. Pour ce qui est de l’ancienneté, la convention de branche prévoit un premier palier de 30 € brut de prime après trois ans dans la même entreprise, puis plusieurs paliers allant jusqu’à 120 € brut pour vingt ans d’ancienneté. La belle affaire…
Enfin, les cas de maltraitance au travail sont légion. Le harcèlement, les licenciements abusifs, les discriminations, les mauvaises payes, le surmenage institutionnalisé sont monnaie courante dans cette profession, y compris dans les lieux dont l’assortiment témoigne d’un vif intérêt pour la question sociale (ou l’intérêt n’est-il qu’opportuniste ?). À Paris, où le maillage extrêmement dense de 400 librairies lui vaut le surnom de « capitale du livre » proclamé par le Syndicat (patronal) de la librairie française (SLF), un·e libraire en quête d’emploi aura tôt fait de dresser une liste des rares endroits où iel peut avoir des conditions de travail dignes — une fois éliminés les commerces qui cumulent tout ou partie des abus sus-cités et qui vont parfois jusqu’à agresser physiquement leurs salarié·es.
Nous le répétons : ces pratiques sont tellement répandues qu’elles nous amènent à nous questionner sur leur caractère structurel.
Dans ces conditions, il paraît évident qu’un grand nombre de libraires, y compris (et même surtout) parmi les plus aguerri·es, s’épuisent, se lassent, et changent de lieu de travail ou, de façon plus radicale, de profession. L’ancienneté, tant dans la boutique que dans la profession elle-même, est pourtant un gage particulier de qualité dans notre métier. Plus on connaît le lieu, ses rayons, ses collègues et sa clientèle, plus il nous est facile de travailler finement son assortiment, plus il nous est facile d’aborder des questions politiques avec les habitué·es, plus on développe des relations de confiance et parfois d’amitié avec nos confrères et consœurs, avec des éditeurices indépendant·es et d’autres acteurices du livre. Ce qui réduit l’atomisation et permet d’imaginer de nouvelles façons de faire.
Comment, dès lors, produire et maintenir l’existence d’un savoir et d’une culture professionnelle (politiquement) critique dans une corporation où les équipes et les emplois ne se pérennisent pas ? Comment rendre massives et consensuelles des considérations éthiques quand les premiers enjeux des libraires salarié·es sont simplement l’accès à un emploi et des conditions de travail dignes ?
Le deuxième phénomène que nous voulons visibiliser ici est le rôle des organismes de formations de libraires dans ces dynamiques. Au premier rang desquels : l’École de la librairie, située à Maisons-Alfort (94700), fondée en 1972 sous le nom d’Association de formation de la librairie (ASFODEL), également connue sous le nom Institut national de formation de la librairie (INFL) entre 2001 et 2020, à l’aune de la signature d’une convention avec le SLF. Cette école, véritable institution, est centrale dans notre corporation : au cœur de l’élaboration et de la diffusion du savoir professionnel, son pouvoir normatif est indéniable.
Au-delà des formations destinées à des libraires déjà en poste, l’école propose un brevet et une licence en alternance ainsi que des formations en continu à destination de personnes en reconversion. En ajoutant les autres formations professionnalisantes et de nouvelles offres comme Book ConseilOrganisme privé de formation aux métiers de la librairie proposant une offre distancielle., il y a chaque année plusieurs centaines d’individus qui arrivent sur le marché de l’emploi. Ce chiffre a drastiquement augmenté ces dernières années, contrairement au nombre de places en librairies qui, lui, est resté stable. Ce fait vient accentuer la tension de l’emploi en librairie, et propose une alternative pratique à la remise en question des conditions de travail : en effet, pourquoi les améliorer quand on peut aisément remplacer des employé·es coûteux·ses et indociles avec une nouvelle main-d’œuvre ? Il faut donc questionner la fausse promesse que constituent ces formations, sources de souffrance non seulement pour une partie des récent·es diplômé·es, mais pour les apprenti·es elleux-mêmes, qui forment un vivier bien utile de salarié·es à très bas coût et sont souvent dans des situations de grande souffrance dans leur entreprise, parfois en l’absence complète d’intervention de l’école, cette dernière n’hésitant pas à valider des contrats avec des librairies ayant un passé récurrent de maltraitance.
D’un autre côté, si la vision enseignée et normalisée par l’École de la librairie — dont la fameuse méthode de gestion des stocks initiée par Michel OllendorffMichel Ollendorff, passé par Hachette, Le Seuil, Gallimard, Les Furets du Nord et La Procure, fut un des fondateurs de l’ASFODEL et son premier directeur. Il est notamment l’auteur de Le Métier de libraire paru aux éditions du Cercle de la Librairie en 2008. — a permis et permet toujours à certaines librairies de survivre à des temps moins fastes, elle relève d’un savoir professionnel acritique, une « doxa » qui mène à une politique d’assortiment incohérente et uniforme si l’on s’y soumet absolument. Pour résumer, cela consiste à considérer les livres avec une rotation basse (c’est-à-dire qui ne se vendent que rarement dans la librairie) comme des poids morts dont il convient de se débarrasser, au détriment du fonds et d’un travail qualitatif. Une méthode de gestion des stocks qui ne devrait en aucun cas devenir l’alpha et l’oméga de la librairie. Pourtant, nos jeunes collègues, désarmé·es et confus·es devant l’immensité de la production éditoriale, n’ont souvent pas d’autres choix que de s’y conformer pour réussir à exercer leur travail dans ce rythme frénétique. Ce n’est qu’après plusieurs années d’expérience et d’approfondissement d’un fonds qu’iels peuvent enfin réussir à la dépasser.
En participant d’une dynamique qui raccourcit notre ancienneté en tant que libraires et diffuse un savoir professionnel acritique, ces formations jouent un rôle a minima passif dans l’évolution néfaste de l’économie du livre. Il serait temps qu’elles fassent leur autocritique, démarche complexifiée par un discours selon lequel les librairies « indépendantes » seraient vertueuses par nature, et que les seuls responsables de la mise en péril du modèle économique du livre sont des acteurs extérieurs et malveillants tels que la Fnac, Amazon ou des financiers comme Bolloré. Nous pensons au contraire que ces évolutions relèvent de problèmes structurels dans lesquels le SLF et les organismes de formations ont aussi leur responsabilité.
Conclusion
Ces institutions ont pourtant du poids, et pourraient faire bouger les choses, au vu de ce que leur lobbying a pu faire pour les régulations récentes sur les frais de portSyndicat de la librairie française, Frais de livraison, 2024, disponible sur : https://guide.syndicat-librairie.fr/vente-en-ligne/frais-de-livraison ou la reconnaissance de notre commerce comme essentiel pendant la pandémie de Covid-19. Mais devons-nous nous étonner que ce type d’organisme n’ait pas une position plus radicale et plus politique ? Devons-nous nous étonner que leur politique se limite à une soumission stratégique aux structures économiques actuelles ? Que le seul horizon souhaitable pour un·e libraire soit de devenir ellui-même patron·ne ? Après tout, nous parlons d’un puissant syndicat patronal qui n’a pas d’intérêt à un changement du statu quo et de centres de formations existant grâce aux subventions macronistes de l’apprentissage, formule néolibérale par excellence.
Alors, comment rompre avec ces dynamiques ? Atomisé·es, isolé·es, nous gagnerions à nous fédérer et à nous associer pour peser davantage, dans un cadre formel, syndical par exemple, ou non. Si certaines de ces initiatives sont restées vaines jusque-là, l’instauration d’un réel rapport de force contre le patronat et ses intérêts pourrait enfin faire cesser l’arbitraire, améliorer nos conditions de travail, faire changer une convention de branche désuète et protéger nos collègues des abus.
Nous pourrions soutenir nos camarades qui souhaitent faire avancer des considérations éthiques et politiques plus que légitimes dans leur façon de faire leur métier et qui, aujourd’hui, craignent pour leur emploi quand iels le font. L’allongement de nos carrières, la pérennisation des équipes et la solidification de nos réseaux à travers, par exemple, des autoformations, pourraient enfin faire advenir un savoir et une culture professionnelle (politiquement) critique.
Ainsi, nous gagnerions en agentivité contre l’évolution délétère de l’économie du livre, l’accroissement de la capitalisation dans l’industrie et la mainmise d’idéologues fascisants sur la production, la diffusion et le débat d’idées. En nous rassemblant et en nous faisant reconnaître comme une véritable force constituée à l’encontre de ces offensives néolibérales et réactionnaires, nous pourrions plus facilement nous organiser pour déborder Bolloré et consorts, bien au-delà des rares librairies où les patron·nes s’embarrassent encore d’une éthique.
Déborder, depuis une position de libraire engagée —
En 2016, pour mes 30 ans, j’ai eu la chance, grâce à Aurélie Olivier du festival Littérature, etc., de lire la bande dessinée Les Sentiments du prince Charles, de Liv Strömquist, traduit par Kirsi Kinnunen et publiée aux éditions Rackham. La première page du livre nous projette aux côtés du prince Charles et de Diana lors d’une conférence de presse peu de temps après leurs fiançailles. La journaliste s’adresse au prince Charles et lui demande : « Êtes-vous amoureux ? » Il lui répond : « Oui… Quel que soit le sens du mot “amour” » alors que Diana le regarde le cœur au bord des yeux. Quand je lis cette bande dessinée à l’époque, je porte pour la première fois les fameuses lunettes du genre, celles qui nous font voir le monde tel qu’il est dans son ensemble, c’est-à-dire empreint de domination et de violences patriarcales. Les lectures s’enchaînent, les nouvelles lunettes aussi et les nombreuses dynamiques d’oppressions se dévoilent, l’une après l’autre. L’Affranchie s’est ainsi construite depuis, au regard de ces nombreuses lectures, un livre à la fois.
En relisant l’article de Marie Kirschen pour la Revue du Crieur, numéro 24, « Les féministes jouent livre sur table. Comment la “vague féministe” secoue le milieu de l’édition » du 4 avril 2024, il est clair que le mouvement #MeToo, depuis 2017, a largement permis un développement des publications féministes. Qu’il s’agisse de nouvelles collections dans de gros groupes éditoriaux (« Nouveaux jours » chez JC Lattès, « Points Féministe », « Œuvre du matrimoine », une collection Librio chez Flammarion), de la création de nouvelles maisons d’édition (Dalva en 2021, blast en 2019, Hors d’atteinte en 2018), ces engagements touchent désormais tous les genres littéraires : des essais aux beaux livres historiques, des romans aux albums jeunesse. Que vous passiez dans une librairie indépendante ou dans un supermarché du livre (ou grande surface culturelle), vous trouverez des références féministes. C’est un fait incontournable. Pour une librairie spécialisée, c’est-à-dire une librairie qui propose principalement des livres sur un sujet déterminé, le stock de L’Affranchie peut paraître généraliste, puisque vous y trouverez des romans, des BD, de la poésie, des albums jeunesse, des essais, des livres de cuisine, d’architecture, d’écologie… à la grande spécificité que toutes nos références sont engagées en féminismes. Concrètement, cela veut dire que nous valorisons les livres engagés, qui sont écrits par des femmes, personnes non-binaires et trans, et donc, que nous avons moins de 1 % de livres écrits par des hommes hétéro cisgenre dans notre stock. Il ne s’agit pas d’une discrimination comme je peux le lire régulièrement en ligne. Il s’agit d’une prise de position : vous trouverez partout, tout le temps, des livres écrits par des hommes cishet, nous pouvons décider de ne pas les vendre.
Quand j’écris ces mots en janvier 2025, L’Affranchie compte pas moins de 6 500 références en stock, pour un chiffre d’affaires de 300 000 € HT au bilan 2023. L’Affranchie a été créée en 1992, je l’ai reprise en 2012, il y a donc 13 ans, et jusqu’en septembre 2023, j’étais la seule à y travailler à temps plein. Jusqu’en 2016, la librairie était spécialisée en théâtre et poésie, les engagements féministes se sont ensuite immiscés dans nos vies — celle de la librairie et la mienne. Qu’est-ce que ce chiffre d’affaires, après autant d’années d’existence, dit de nous ? Qu’être spécialisées et engagées ne nous rapporte pas d’argent. Que chaque mois est une bataille pour payer les échéances, les salaires, le loyer. Je repense à cette réponse du prince Charles, « quel que soit le sens du mot “amour” » et je ne peux m’empêcher de copier cette réplique et de l’attribuer à notre questionnement actuel : « Alors vous êtes engagé·es ? — Oui… Quel que soit le sens du mot “engagé·es”. »
Si je devais vous expliquer un peu plus précisément qui est L’Affranchie, voici ce que je vous dirais :
– Être une librairie engagée, c’est par exemple choisir toutes les références qui entrent en stock, ne pas s’inscrire aux offices[multiblock footnote omitted] mais les travailler, livre par livre. C’est apprendre à lire entre les lignes, savoir repérer les arnaques, les opportunistes, les faux livres engagés. Prenons l’exemple de Caroline Fourest et de son livre, Le vertige MeToo, publié chez Grasset, filiale du groupe Hachette Livre. Cet essai est présenté par la maison d’édition sur son site internet comme : « Un éclairage indispensable pour ne pas transformer une révolution en terreur, et garder le cap : celui de la lutte contre les abus de pouvoir. Cinquante nuances en zone grise. Pour sauver MeToo de ses excès. » Et c’est exactement cette dernière phrase qui à elle seule sonne l’alerte du faux féminisme ! Ce livre s’enfonce crassement dans l’énorme porte ouverte du « pas tous les hommes » du « on ne peut plus rien dire ». Ces manœuvres éditoriales sont d’autant plus subtiles que cela demande d’avoir lu la quatrième de couverture jusqu’au bout, de connaître l’autrice, pour savoir de quoi elle parle exactement. Si j’avais été inscrite aux offices, il est certain qu’Hachette m’aurait livré ce livre parce qu’il est identifié dans leur système bibliographique comme féministe, je l’aurais donc acheté sans le vouloir. Le sujet n’est pas ici de lire ou de ne pas lire cette autrice ou les publications de cette maison d’édition, c’est surtout de savoir que de nombreuses idées sont véhiculées dans les livres et que les raccourcis peuvent être vite faits, que si l’idée est de filtrer les livres aux idéologies fascistes, il faut enquêter, livre après livre.
– Être une librairie engagée, c’est renoncer à vendre des livres alors qu’ils bénéficient de beaucoup de presse, qu’ils sont chroniqués dans les émissions culturelles de grande écoute et qu’ils sont donc susceptibles de générer beaucoup de chiffre d’affaires. Il s’agit de renoncer à ce chiffre d’affaires pour rester cohérentes avec nos choix éditoriaux. Je me souviens d’un passage un jour d’un membre du Centre national du livre à la librairie, qui en regardant notre rayon romans et nouvelles me lançait : « Il vous en manque beaucoup des livres de femmes. » Bien sûr, il ne s’agit pas que d’être une autrice pour intégrer nos rayons, il s’agit surtout de proposer des histoires qui n’encouragent pas les stéréotypes et la binarité de genre : non je ne vends pas les livres de Mélissa Da Costa, publiée au Livre de Poche, filiale d’Hachette Livre, alors qu’elle fait partie des autrices les plus vendues en librairie, tout comme ceux d’Amélie Nothomb, qui ne manquerait pas un grand dîner mondain même si Trump s’y présentaitEllen Salvi, « Bardella, champagne et saumon fumé : les égarés de l’édition française », Médiapart, 06/02/2025, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/france/060225/bardella-champagne-et-saumon-fume-les-egares-de-l-edition-francaise. La cohérence, c’est une attention constante et assidue. Je me souviens être un jour passée dans une librairie qui se disait féministe et d’avoir retrouvé le dernier Mona Chollet à une étagère du dernier Eric Zemmour. Je ne pense pas devoir expliquer l’incohérence totale de l’affaire.
– Être une librairie engagée, c’est défendre des catalogues, acheter des livres en sachant qu’ils ne se vendront pas seuls, qu’il faudra les lire, les conseiller, les défendre, parce que les médias n’en parleront pas. Ces livres-là sont édités par des maisons d’édition aux ressources humaines et financières limitées, qui ne peuvent donc pas consacrer des budgets faramineux en communication. Contrairement, par exemple, et on s’en souvient, au dernier livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des combats, publié chez Fayard — filiale d’Hachette Livre —, et dont la couverture était affichée par Mediatransports dans toutes les gares de France à sa sortie en août 2023. La question du budget alloué à la communication est d’autant plus intéressante qu’on sait pertinemment que l’extrême droite est pionnière en matière d’utilisation de la presse et des internets comme biais de légitimation et de diffusion de leurs idées. Chaque librairie a de la visibilité, qu’il s’agisse de sa clientèle, de ses réseaux sociaux, de ses programmes de rencontres, de ses conseils ; choisir de quoi et de qui nous parlons est un outil très puissant à ne jamais sous-estimer.
– Être une librairie engagée, c’est aussi prendre conscience que nous devons parfois négocier avec nos engagements pour survivre. Et même si je suis la première à dire que nous ne pouvons pas profiter du système que nous dénonçons, le fait est que c’est extrêmement difficile de se passer du système, même quand on est une librairie indépendante aussi têtue que L’Affranchie. Par exemple, l’utilisation des réseaux sociaux. Nous savons très pertinemment que Meta n’est pas une entreprise alliée de nos luttes. Pour autant, la visibilité qu’Instagram apporte est irremplaçable, en tout cas pour L’Affranchie. Il est absolument certain que nous n’aurions pas la notoriété que nous avons sans les réseaux sociaux. La librairie s’est d’ailleurs relevée à plusieurs reprises de périodes aux trésoreries inexistantes grâce à des appels à soutien en ligne.
Depuis quelques années, je me suis exprimée régulièrement sur les oppressions systémiques dans le milieu du livre. Comme je l’écris plus haut, une fois que l’on porte les bonnes lunettes, tout est visible. Le sexisme, le racisme, le validisme, le classisme, tout est vraiment visible. Quand je dénonce les violences sexistes et sexuelles de ce milieu, en juillet 2022, lors de la remise des prix des Rencontres nationales de la librairie, je ne m’attends pas à la déferlante de témoignages et de soutiens des consœurs — et de certains confrères — présent·es. Et je ne m’attends surtout pas à être ignorée par toutes les institutions officielles présentes (les différents syndicats nationaux ou régionaux, le CNL, la Sofia — Société française des intérêts des auteurs de l’écrit). Si vous ne connaissez pas les Rencontres nationales de la librairie, il s’agit des rencontres interprofessionnelles des métiers du livre. On compte environ 1 000 libraires, éditeurices, représentant·es, réuni·es le temps d’un weekend pour discuter des problématiques liées à nos métiers au regard des enjeux de société. Cette année-là, nous sommes accueilli·es par la ville d’Angers, représentée par son maire, Christophe Béchu, récemment nommé ministre en charge de la Transition écologique. Il a par exemple réclamé « le retrait — aux abords des écoles — d’affiches représentant des couples d’hommes, illustrations d’une campagne de prévention contre le virus du sida au prétexte qu’elles pouvaient troubler les enfants sur le chemin de l’écoleYves Tréca-Durand, « Polémique. Élus et militants LGBT réclament le départ de Christophe Béchu du gouvernement », Le Courrier de l’Ouest, 13/07/2022, disponible sur : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/polemique-elus-et-militants-lgbt-reclament-le-depart-de-christophe-bechu-du-gouvernement-47dfc066-02c0-11ed-af6b-c1de6dcf54b6 ». Nous sommes donc toustes réuni·es dans une salle de conférence, les représentant·es institutionnel·les se relaient, disent leur joie de nous voir toustes ensemble, et Christophe Béchu très enthousiaste, enchaîne les blagues et les clins d’œil. La salle rit. Et je me souviens de ma sidération. La salle rit alors que cette personne est reconnue comme l’un des membres LGBTQIA-phobes du gouvernement. Je suis assise aux côtés d’amies libraires et nous sommes vraiment très mal à l’aise. Le lendemain, je reçois donc le coup de cœur du jury pour mon travail de rencontre et de podcast mené à la librairie depuis 2020, et à cette occasion je vais dire très gentiment que nous ne sommes pas dupes. Nous, les engagé·es, les féministes, les minoritaires, nous voyons très bien ce qui se trame : nos luttes sont capitalisées, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour faire cesser les oppressions systémiques, pourtant bien vivaces dans le milieu du livre. Pour être plus claire, nous les voyons très clairement ces maisons d’édition qui publient des auteurs pédocriminels depuis toujours et qui soudainement créent une collection de textes féministes « pour soutenir la parole des femmes ». Je termine ma prise de parole par ces mots : « Nous sommes juste derrière vous », comprendre : les féministes arrivent et ne lâchent pas l’affaire.
L’année suivante, en 2023, j’ai l’opportunité de remettre un prix lors de la 4e édition des Trophées de l’édition. J’ai une minute de parole avant le dévoilement de la lauréate, vous commencez à me connaître un peu, je n’ai pas manqué de dire ce que je pensais des éditeurices présent·es dans la salle. Dans mon monde éditorial, celui que je défends chaque jour à L’Affranchie librairie, je soutiens le travail important de maisons d’édition engagées, je peux nommer par exemple Hors d’atteinte, les éditions du commun, blast, La Déferlante, L’Arche Éditrice, Divergences, Daronnes, Shed publishing, Hystériques & AssociéEs, et évidemment bien d’autres, qui cherchent à éditer différemment. Ce soir-là, je me vois remettre un prix à l’application de livres audio, Audible, un projet financé par Amazon. Oui, Amazon (exemple concret de négociation avec soi-même, remettre ce prix pour une minute de discours). Je suis sur scène, face aux représentant·es des plus gros groupes éditoriaux : Hachette Livre, Editis, Média-Participations, Madrigall. Et je me répète, je leur dis que nous ne sommes pas dupes, nous les voyons capitaliser sur nos luttes, profiter du besoin de changements de la société pour continuer à s’enrichir tout en continuant de précariser les auteurices, les libraires, les salarié·es. Parce qu’une très grande partie du milieu de l’édition est à l’image de cette cérémonie : des gens qui ont du pouvoir et un seul prix sur tout le palmarès qui récompense la « petite maison d’édition de l’année ». Je peux vous assurer que je ne suis pas restée longtemps au théâtre de l’Odéon, je me souviens encore des regards glaçants qui m’ont été lancés alors que les coupes de champagne brouillaient déjà pas mal de regards.
1. Je ne veux pas m’étendre sur ma capacité à me faire des ennemis, institutionnels et masculins, mais il me semble important de parler des conséquences de mes prises de parole. Lorsque je parle, je n’imagine pas que cela aura des répercussions financières sur L’Affranchie. Parce que je ne dis rien que personne ne sache déjà, parce que je reste polie et souriante, je ne crie pas. Chaque année en juillet, les libraires peuvent déposer une demande d’aide au Centre national du livre pour le développement des animations, il s’agit du VAL, aide aux librairies pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale, pour soutenir l’activité des librairies de qualité. J’ai repris la librairie en 2012 et chaque année depuis la reprise nous avons reçu cette aide, elle a même augmenté d’année en année compte tenu du nombre important de rencontres que nous organisons. Si vous avez bien suivi, en juillet 2022 je reçois un prix, une reconnaissance professionnelle pour mon travail de rencontre et de podcast. Et bien cette année-là, 4 mois après mon discours, l’aide annuelle passe de 4 500 € à 3 500 €. Pourquoi ? Sans explication. Je décide de ne plus demander cette aide. Parce que je suis butée et que dans toute ma cohérence, je ne veux plus recevoir d’argent d’une institution qui n’est pas en accord avec mes engagements. Je ne fais pas le procès du CNL ici, je dis juste : heureux sont les hommes, heureux sont les Blancs, heureux sont les généralistes qui trouvent écoute et argent auprès de cette institution financée par le ministère de la Culture, financée par nos impôts, et dont les coupes budgétaires annoncées ne vont pas arranger les choses en matière de répartition des aides. Aux dominants l’argent public.
2. Autre chose, la partie visible de l’iceberg des problèmes dans le milieu du livre ne représente que 10 % de ce qui s’y passe réellement. Mais ce qui est historiquement et scientifiquement connu avec les icebergs — et les problèmes — c’est qu’une fois qu’on est en mesure de les voir, ces 90 % immergés, la noyade est imminente. (Oui, il y avait assez de place pour que Jack soit sauvéJack Dawson, personnage emblématique du film Titanic réalisé par James Cameron, meurt glacé dans l’eau en laissant toute la place à Rose DeWitt Bukater sur la planche de bois sur laquelle elle est allongée en attendant les secours. Une grande polémique a ému les spectateurices à la sortie du film sur le fait qu’il y avait suffisamment de place sur la planche pour que Jack soit lui aussi sauvé..) Alors, si on en revient à notre sujet, qui va être sauvé·e de la catastrophe annoncée dans notre cher milieu du livre ?
Ce qui est formidable avec les engagements féministes, c’est qu’en pensant d’abord « simplement » lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes, on se retrouve à écrire un texte pour dénoncer l’emprise de l’empire Bolloré sur le milieu du livre (en passant par des références de pop culture sûres, telles que le sont la princesse Diana et Titanic). Parce que oui, 13 088 signes plus tard, je le nomme, après avoir pris le risque d’écrire Amazon, j’écris Bolloré. Je l’invite dans la conversation ou plus exactement je vais vous dire ce que j’en pense de toute cette affaire d’emprise.
D’après le dictionnaire Larousse (marque éditoriale du groupe Hachette depuis 2004), voici une double définition de cette dernière :
1. Ascendant intellectuel ou moral de quelqu’un ; influence de quelque chose sur une personne : Être sous l’emprise d’une passion.
4. Relation de domination, de manipulation et de maltraitance, utilisant la violence psychologique (dévalorisation, isolement de l’entourage, contrôle, menaces, etc.), voire la violence physique ou l’abus sexuel, en alternance avec des marques d’affection, ce qui a pour effet de vulnérabiliser une personne (conjoint, par exemple) et de la maintenir dans un état de dépendance psychologique et/ou matérielle.
Lorsque nous nommons l’emprise de l’empire Bolloré sur le milieu du livre — et des dictionnaires —, il s’agit donc de montrer que le groupe éditorial Hachette Livre domine et maintient dans un état de dépendance les libraires, par le nombre de marques éditoriales qu’il représente, autant que par les idées qu’il véhicule. Et évidemment, je vais vous en parler par le prisme de L’Affranchie librairie. Je ne suis spécialiste d’aucune autre structure, aucune autre entreprise, mes réflexions ne concernent donc que mon expérience. Lorsque les coéditeurices à l’origine de cette publication m’ont demandé d’écrire sur ce sujet, il a été très vite précisé que je n’étais pas en accord avec l’appel au boycott de ce groupe éditorial en librairieMuriel Steinmetz, « 80 librairies annoncent vouloir boycotter certains livres édités par le groupe de Vincent Bolloré », L’Humanité, 21/11/2024, disponible sur : https://humanite.fr/culture-et-savoir/boycott/80-librairies-annoncent-vouloir-boycotter-certains-livres-edites-par-le-groupe-de-vincent-bollore. Que je voyais cela comme une fausse solution, qui tend simplement à s’occuper des 10 % visibles de l’iceberg (Hachette Livre) sans prendre en compte les 90 % immergés (la fascisation du milieu du livre). Alors je vais essayer de faire simple et d’être précise en arrivant enfin à la consigne d’écriture : déborder Bolloré, depuis ma position de libraire engagée.
Déborder Bolloré, c’est savoir que notre société a un fâcheux besoin de personnifier les idées. C’est-à-dire qu’il est plus facile de dire que Vincent Bolloré est le problème et de tenter de le combattre lui, comme l’homme dont la chute règlerait tout, plutôt que de réellement se questionner sur la fascisation du milieu du livre. Donc oui, Hachette Livre domine le marché avec un chiffre d’affaires, illisible pour la plupart d’entre nous, de 1 366 400 000,00 € en 2023« HACHETTE LIVRE (VANVES), Chiffre d’affaires, résultat, bilans », Societe, disponible sur : https://www.societe.com/societe/hachette-livre-602060147.html (c’est le moment où vous vous rappelez que L’Affranchie a fait 300 000 € HT de CA la même année) : « [en 2022] Les Français ont acheté 364 millions de livres neufs imprimés générant un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros », explique Sandrine Vigroux, responsable GfK Market Intelligence Biens culturels. Hachette Livre représente donc environ ¼ du chiffre d’affaires global de la vente de livres neufs (ne me demandez pas de positionner L’Affranchie s’il vous plaît). Cette domination écrasante du marché n’est pas nouvelle et Vincent Bolloré n’est lui-même pas nouveau, il rôde dans les milieux de la culture depuis longtemps déjà, rachetant ici et là tout ce qu’il peut pour étendre son empire et continuer à diffuser tranquillement ses idéologies« Grand fauve du capitalisme français, catholique traditionaliste et homme de droite réactionnaire […] », biographie de Vincent Bolloré, Libération, disponible sur : https://www.liberation.fr/tags/vincent-bollore/. Alors concrètement, vous commencez à mieux connaître L’Affranchie librairie, un fonds engagé, moins d’1 % de références écrites par des auteursAuteurs : des hommes donc. hétéros cisgenres, fervente dénonciatrice de l’opportunisme éditorial, et bien cette librairie idéale que l’on décrit gentiment comme radicale, malgré tout son travail pour la valorisation des maisons d’édition engagées, compte Hachette Livre comme son deuxième plus gros chiffre d’affaires en 2024. Oui vous lisez bien, L’Affranchie librairie survit parce qu’elle vend pour 50 000 € de son chiffre d’affaires les publications du groupe Hachette Livre, au coude à coude avec Union distribution — groupe Madrigall (Makassar arrive en huitième position avec 35 000 € HT).
Le jour où j’ai vu la répartition des chiffres d’affaires annuels de la librairie, je n’en croyais pas mes yeux. J’ai vérifié, comparé, cliqué ici et là, aucune erreur, cette librairie dont j’ai pensé le fonctionnement et le développement dans la plus grande cohérence avec nos engagements féministes survit notamment grâce aux ventes de livres édités par des maisons d’édition appartenant au groupe Hachette Livre. Donc L’Affranchie est aussi sous son emprise. J’étais sans doute un peu naïve, d’accord, de penser que nous pouvions réellement faire différemment. Donc quand je lis qu’il faut boycotter Hachette livre, deux sirènes alertent mes pensées :
2. Quels sont ces livres que nous vendons et qui représentent un sixième de notre chiffre d’affaires ?
Certaines librairies, dont certaines sont signataires de l’appel au boycott, réussissent à survivre sans l’un ou l’autre des principaux groupes éditoriaux. Il s’agit sans doute de librairies généralistes, qui peuvent se rattraper sur les autres grands groupes éditoriaux et compenser la perte en vendant d’autres livres. Pour L’Affranchie, c’est un peu différent, même si les publications engagées se sont largement développées, elles restent limitées. Et au-delà de le faire ou non, cet appel au boycott est encore une injonction qui ne prend pas en compte les conditions matérielles de chacun·e.
Nos conditions matérielles à L’Affranchie : la librairie m’a été transmise en 2012 alors que j’avais 24 ans. Sur mon compte épargne à ce moment-là, moins de 3 000 €, gagnés l’été en travaillant dans la verrerie près de chez mes parents. L’Affranchie librairie est une SCOP, j’en suis la salariée gérante, avec une rémunération de 1 500 € net par mois. La librairie est locataire, le loyer mensuel est de 2 600 € TTC. Depuis septembre 2023, Lucie Telle est la première libraire embauchée à temps plein après son apprentissage d’un an, pour lequel nous avons reçu une subvention annuelle de 8 000 € de la Région Hauts-de-France. Jusqu’en septembre 2024, elle était rémunérée au smic, depuis cette date et suite à l’arrêt de ses APL, j’ai pu l’augmenter pour qu’elle reçoive elle aussi 1 500 € net par mois. Je n’ai pas de PEL, pas de famille ou de conjointe dont la richesse serait comme un matelas de sécurité. Mon travail est ma seule source de revenu, le chiffre d’affaires mensuel de la librairie est le seul moyen de payer nos rémunérations et loyers. En janvier 2025, mon compte épargne est tout simplement vide et cela depuis de nombreuses années déjà.
Qui a les moyens matériels de faire différemment ? Qui peut réellement boycotter, militer, résister, quitter un réseau social ? Lorsque je décide de ne pas vendre de livres écrits par des hommes hétéro cisgenre, j’accepte le risque de perdre le chiffre d’affaires que la vente de leurs livres produirait. Libraire est un métier bien singulier. Bon nombre de gérant·es peuvent prendre le risque de ne pas se payer. D’ailleurs il est commun pour les libraires de ne pas se rémunérer les premières années après l’ouverture de leur librairie. Parce qu’iels ont des droits au chômage par exemple, ou, aussi, parce qu’iels ont un capital personnel qui peut leur permettre de vivre sans rémunération (économies dues à un précédent emploi, héritage, rentes, compagnon·nes aux revenus suffisants). Quand je pose la question « qui a les moyens matériels de boycotter ? », je pense à ce capital personnel, cet argent qui soutient l’indépendance et la liberté et qui, étant loin d’être dans toutes les poches, participe largement à la possibilité ou non de se priver d’un chiffre d’affaires, de faire grève, de consommer de telle ou telle façon.
« Créons des collectifs où personne n’aura le temps d’être militant à temps plein, et on verra si la Révolution advient plus viteAmandine Agić, « À mes camarades radicales, à toutes les autres — de l’argent gratuit », dans Gouines, Marie Kirschen et Maëlle Le Corre (coord.), Paris, éditions Points, 2024.. »
Je suis libraire, j’ai donc commencé par nos conditions matérielles. Pour autant, jamais je ne dirais que nous sommes les plus précaires, cette place infernale revient évidemment aux auteurices qui reçoivent entre 6 et 10 % de droits sur chaque livre vendu. Je reformule donc ma question : qui peut se permettre de vivre de ces conditions ? Et si je vais plus loin, qui profite de la précarisation des auteurices qui sont pourtant à la base créative de toute la chaîne ? Pas d’auteurices ? Pas de livres. Pas de livres ? Pas de chaîne du livre. La question de la rémunération des auteurices est aussi un bon exemple de la négociation constante entre les engagements et la survie. Lorsque l’appel à boycott a été lancé, certaines autrices féministes publiées dans les maisons d’édition du groupe Hachette Livre ont été interpellées sur les réseaux sociaux. Et quand je dis interpellées, je dis en réalité accusées de pactiser avec le diable. Alors même si je suis d’accord pour affirmer qu’il est préférable théoriquement d’être éditée dans une maison d’édition indépendante et engagée lorsqu’on est féministe, je sais aussi que ça n’est pas possible financièrement pour toustes. Être publiée par une grande maison d’édition permet de recevoir de plus gros à-valoir« Un à-valoir est un paiement partiel, à déduire de ce qui est dû. C’est donc équivalent à un acompte. », « À-valoir » (dernière modification le 3 décembre 2022), Wikipédia, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80-valoir qu’en général dans les plus petites maisons d’édition. La question des moyens matériels se pose donc ici aussi, qui peut dire non à une rémunération de 10 000 €, 20 000 €, 30 000 € ? Et ces sommes sont loin d’être régulières, très très peu d’auteurices vivent réellement de leurs droits.
« Dans un secteur où la précarité domine, peu d’entre nous vivent de leur métier et la création littéraire n’est que rarement rémunérée, continuant de faire de l’écriture une pratique exceptionnelle et souvent privilégiée. À l’heure où j’écris ces lignes, des organisations d’artistes-auteurices défendent la mise en place en France d’un statut qui permettrait de garantir la continuité de nos revenus, par l’augmentation de la contribution des diffuseurs. À celles et ceux qui se demandent comment l’écriture pourrait participer à changer radicalement la société, une première piste de réponse : garantir la possibilité d’en vivre pour celles et ceux qui la pratiquent, l’inscrire plus avant comme un bien commun et non un bien marchand en l’extrayant des logiques concurrentielles et de marché dans lesquelles elle est priseJuliette Rousseau, Péquenaude, Paris, éditions Cambourakis, 2024.. »
Alors que je me relis, en mars 2025, un livre attire fortement mon attention, il s’agit de Pour une sécurité sociale de la culture, par le groupe culture du Réseau Salariat, aux éditions du Croquant. Je n’ai pas le temps de le lire immédiatement pour vous en parler mais ces réflexions, tout comme celles de faire passer en intermittence le statut d’auteurice, sont autant de démarches visant la professionnalisation du métier (= écrire est un métier, pas juste un don au monde qui ne nécessite pas de salaire puisque ce serait une passion).
Si collectivement nous ne prenons pas le temps de réfléchir à ces questions complexes de rémunérations et de visibilité, un risque plus grand nous attend avec impatience, celui de ne plus avoir le choix. Parce qu’une fois que les tenants de l’ultralibéralisme seront les seuls vendeurs de livres, que les éditeurices indépendant·es et engagé·es ne tiendront plus le coup et que les auteurices qui ont vraiment quelque chose à écrire seront fatigué·es de le faire gratuitement, qu’est ce que cela donnera d’après vous ? Un monde où celleux qui ont le pouvoir économique détiendront sans grand effort le pouvoir culturel. Ce pouvoir-là, littéraire, cinématographique, musical, ce pouvoir du divertissement est politique. Il porte en lui seul toute l’évasion, toute la liberté, toute la force d’émancipation des dynamiques d’oppressions. Si ce pouvoir est détenu par le fascisme, alors, la culture sera fasciste. Donc, si on en revient à mon image si habilement trouvée de l’iceberg, en arrêtant notre action au boycott d’Hachette Livre, on oublie que les 90 % des problèmes immergés sont déjà en train de pourrir le milieu du livre. Et qu’une nouvelle injonction ne sert simplement à rien du tout et ne sauvera absolument personne.
Là, vous vous dites d’accord, on arrête de personnifier le mal, on pense le système de domination libéral et fasciste dans son ensemble, on arrête les injonctions, on n’en a pas toustes les moyens. Et alors, on fait quoi maintenant ?
On fait quoi maintenant ? On contrepouvoirPouvoir qui s’oppose ou fait équilibre à l’autorité établie. « Contre-pouvoir », (dernière modification le 3 janvier 2025), Wikipédia, disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-pouvoir.
L’Affranchie le fait jour après jour, valoriser les fonds engagés, oui, mais aussi favoriser la cohérence éditoriale tout en faisant du cas par cas. Exemple, jamais L’Affranchie ne se passera du livre de Douce Dibondo, La Charge raciale, publié chez Fayard début février 2024. Lise Boëll prend la tête des éditions Fayard en février 2024, elle est, par exemple, l’éditrice historique d’Eric Zemmour, et plus récemment celle de Jordan Bardella. Malgré l’envie irrépressible de le faire, on ne peut pas appeler au boycott total de Fayard parce que cela veut dire pour le moment boycotter une partie de la pensée primordiale de Douce DibondoDouce Dibondo est une journaliste et féministe française d’origine congolaise, militante en tant que femme noire, queer et afroféministe.. Mais comme la vie est parfois bien faite, le format poche de La charge raciale est annoncé aux éditions Payot (groupe Actes Sud) en juin 2025. Donc oui, on négocie quelques mois avec soi-même le temps de trouver des solutions plus durables et plus satisfaisantes.
Depuis juin 2024, des libraires engagé·es contre le fascisme échangent sur leurs pratiques et leurs idées pour contrer l’extrême droitisation des imaginaires. Alors que je cherchais ce que je pourrais vous proposer comme solution affranchie, une libraire (merci Chloé) a partagé son idée de remplacer les éditions LGF / le Livre de Poche, filiale du groupe Hachette Livre, par leurs équivalents dans d’autres groupes éditoriaux. Parce que oui, les classiques, une fois tombés dans le domaine public sont disponibles, en général, dans plusieurs éditions à des prix assez équivalents. Ce qui m’a fait me demander : quelle place occupent les poches dans mon satané 50 000 € de chiffre d’affaires Hachette Livre ? La réponse est très intéressante puisque sur les 50 000 €, 9 000 € sont des ventes LGF / Le livre de Poche. J’aime l’idée de faire parler nos chiffres. Nos client·es achètent des poches, de plus en plus d’ailleurs, parce que les prix des livres sont de plus en plus élevés. Certaines références peuvent être achetées dans d’autres maisons d’édition, d’autres ne pourront pas l’être, des maisons d’édition indépendantes proposent aussi des versions livres de poche de textes contemporains, fouillons les catalogues, trouvons des petits prix engagés (par exemple à La Contre Allée, aux éditions Le Sabot, Zoé poche, Argyll, Mémoire d’encrier, Les Plumées chez Talents Hauts, Goater).
Évidemment, je n’ai pas de solutions toutes faites. Je ne peux pas vous dire : « faites tout cela et nous allons déjouer le grand capital fasciste pour toujours. » Par contre, je peux vous raconter une dernière histoire. Une belle histoire, avec son lot de suspens, son pic horrifique et sa fin heureuse.
En septembre 2024, je reçois un avis de ma banque m’indiquant que le loyer de la librairie n’est pas passé. Que notre découvert autorisé de l’été ne peut être reconduit. C’est jeudi matin, je suis seule à la librairie, je suis fatiguée et je n’ai pas vraiment d’idée pour trouver de l’argent rapidement. Je reçois le jour même un mail du service recouvrement d’Hachette Livre, notre compte est bloqué suite à notre impayé du mois dernier. J’ai une rencontre la semaine suivante avec Sophie Pointurier et Sarah Jean-Jacques à l’occasion de la parution de leur livre, Le déni lesbien. Celles que la société met à la marge, édité chez HarperCollins, distribué donc par Hachette Livre. Je ne vais pas recevoir le livre, puisque le compte est bloqué. Je vais alors comme ça sans trop réfléchir écrire une publication sur Instagram en expliquant comment il nous manque 15 000 € pour payer nos dettes du mois et le loyer.
« Ça n’est pas facile de vous dire que nous avons toujours des difficultés financières. Mais L’Affranchie survit surtout grâce à vous depuis tant d’années donc je préfère vous inclure aussi dans nos réflexions et recherches :
– si chaque personne qui suit ce compte achète un livre on est sauvées pour le moment. Si vous le pouvez, passer nous voir, et si vous êtes loin ou occupé·e vous avez + de 6 800 références disponibles sur notre site internet : www.laffranchielibrairie.com
L’Affranchie est une librairie pleine de joie et de fureur de vivre. Vous êtes presque 13 000 ici, si chacun·e d’entre vous achète un livre, on est sauvées. C’est facile dit comme ça nonExtraits de la publication Instagram du 20 septembre 2024, disponible sur : https://www.instagram.com/p/DAIiu5Bs0ab/?hl=fr&img_index=1 ? »
Quand j’écris ces mots, nous sommes deux mois après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Et ce que je propose c’est une action simple et compréhensible. Pour combattre l’extrême droitisation du monde, acheter un livre dans une librairie engagée. L’appel a été largement entendu puisque plus de 600 commandes sont passées en une semaine sur notre site de ventes en ligne, et que des centaines de personnes viennent à la librairie acheter un ou plusieurs livres. Les médias, soulagés d’avoir enfin une bonne nouvelle à relayer vont faire passer l’info, journaux, radio, reportage télévisé, L’Affranchie est partout. Le soutien va aussi venir des consœurs et confrères par leur écoute, leurs messages d’encouragement et leur argent. Parce que oui, lorsqu’une librairie indépendante a une trésorerie stable, elle peut aussi proposer une aide financière rapide, un prêt, à une autre structure (contrepouvoir : se passer des banques), et l’aide inestimable de cette librairie amie m’a permis de payer le loyer et les traites Hachette Livre impayées immédiatement. Les chiffres d’affaires de septembre et d’octobre vont ainsi ressembler au chiffre d’affaires du mois de décembre, grâce à la clientèle de toute la France qui a voulu aider une librairie indépendante et engagée à continuer d’exister.
Cette partie de l’histoire, c’est la belle et surprenante aventure d’une librairie qui s’est faite entendre et qui va réussir à payer ses dettes, ne plus avoir d’impayés pendant quelques mois et tenter d’avoir une toute petite trésorerie (pour le moment on maintient environ 5 000 € sur le compte). Fin septembre, une semaine après l’appel, alors que je m’occupe de la comptabilité, les yeux rivés sur le compte en banque qui sort enfin du rouge, je trouve dans le courrier, cette lettre du Rassemblement national :
Quand je dis plus tôt dans un discours : « Nous [les féministes] sommes juste derrière vous », c’est une erreur. C’est l’extrême droite qui l’est, juste derrière nous. Ils sont là et ils s’immiscent partout, ils envahissent tout, et ils nous regardent nous noyer, l’un·e après l’autre.
« Les dictateurs sont des manipulateurs, des voleurs de cerveaux, ils connaissent, ils flairent les désirs des gens, et disent au peuple ce qu’il a envie d’entendre. Un vieux jeu qui se répète depuis que le monde est mondeEdith Burck, Le Pain perdu, trad. René de Ceccatty, Paris Éditions du sous-sol, 2023.. »
Suite à cet appel à soutien, je n’ai pas de solution plus concrète à proposer que de politiser son argent. Libraires, client·es, il faut penser l’acte d’achat comme un acte de résistance. L’économie est pour l’instant le levier le plus fort : retournons le capitalisme contre lui-même. Cela demande de travailler nos stocks, de proposer des rencontres sur des fonds moins connus, de faire connaître des imaginaires qui vont à l’encontre de la fascisation du monde, de remettre des espèces dans nos transactions pour éviter de rémunérer les banques, soyons toustes plus indépendant·es, ça ne sauvera pas le monde mais ça participera à créer d’autres possibles, un acte à la fois.
L’odeur de l’encre. L’imprimerie : mirage des techniques, réalité des concentrations —
L’imprimerie de labeur — celle qui concerne l’impression de livres ou de brochures — bénéficie d’un prestige diamétralement opposé à la connaissance que l’on peut avoir de sa structure et des évolutions sociales et techniques en cours depuis plusieurs dizaines d’années. La tradition de l’ouvrier typographe et des caractères en plomb entretiennent cette mythologie.
Cependant, ce secteur de la chaîne graphique subit, lui aussi, les bouleversements du monde de l’édition depuis la fin du XXe siècle.
Le développement de l’informatique de bureau, des techniques d’impression favorisant les courts tirages et, enfin, la concentration dans l’édition ont accentué le rapport de force entre éditeur et imprimeur.
L’imprimerie soumise à la pression financière des groupes
Bien avant l’arrivée de Vincent Bolloré, le groupe Hachette était déjà un acteur déterminant dans l’évolution de l’imprimerie. Ses stratégies et ses investissements sont révélateurs d’une tendance à la destruction du savoir-faire des ouvriers du livre et d’une uniformisation des productions.
Actionnaire dans l’imprimerie, dans l’édition et dans la librairie, occupant parfois même une position de monopole, le groupe Hachette, sous Vincent Bolloré, n’est plus seulement une puissance économique mais tend à devenir une machine idéologique. Dans l’imprimerie, c’est un acteur important et innovant depuis le début du XXe siècle.
Dès 1923, afin de développer et de rationaliser sa production de manuels scolaires, les éditions Hachette encouragent le rapprochement de deux de ses fournisseurs : l’imprimerie Brodard (fondée en 1858 et installée à Coulommiers (77)) et les Ateliers Taupin, spécialisés dans le brochage et cartonnage (créés en 1908 et installés dans le 15e arrondissement de Paris). La nouvelle entité « Société Imprimerie Brodard et Ateliers Joseph Taupin Réunis », plus communément appelée Brodard & Taupin, signe alors un contrat d’exclusivité avec Hachette. Avec près de 400 ouvriers et 30 presses typographiques, ces ateliers peuvent produire jusqu’à 27 000 livres par jour« Brodard, les étapes d’une saga industrielle », Le Parisien, 28/09/2010, disponible sur : https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/coulommiers-77120/brodard-les-etapes-d-une-saga-industrielle-28-09-2010-1085361.php.
En 1953, cette association prend un nouvel essor avec la création par Hachette de la collection du « Livre de Poche », dont Brodard & Taupin a assuré la production jusqu’en 2007. À cette occasion, un site de production est construit à La Flèche (72) en 1967.
À partir des années 1980, Hachette Filipacchi Médias investit dans des imprimeries à forte capacité de production. Mais à l’orée de l’an 2000, le groupe cède ses activités d’imprimerie offset. L’imprimerie Brodard Graphique (filiale à 100 % du groupe Hachette Filipacchi Médias) est vendue au Groupe Maury. Ces transferts de capitaux peuvent paraître anodins mais sont symptomatiques de l’influence d’Hachette dans le monde de l’imprimerie. On peut souligner que si Hachette se désengage financièrement, le groupe poursuit son partenariat commercial avec l’imprimerie, dont le chiffre d’affaires dépend des volumes de production accordés.
En 2010, la non-reconduction du partenariat commercial avec Brodard & Taupin provoque la fermeture du site historique de Coulommiers, entraînant la suppression de 190 emplois. Anecdote optimiste : pour protester contre la fermeture et le refus par la direction de verser une prime compensatoire raisonnable, des salariés de l’imprimerie ont mis le feu à 3 tonnes d’encre et de bobines de papier. « Depuis l’annonce de la liquidation judiciaire lundi, l’entreprise est en état de siège, explique l’un d’eux. Nous sommes prêts à tout tant que les négociations n’avancent pas, nous avons encore 6 000 tonnes de papier à l’intérieur de l’entreprise« Les salariés d’une imprimerie en liquidation brûlent le stock d’encre et de papier », Actualitté, 16/07/2010, disponible sur : https://actualitte.com/article/78309/numerique/les-salaries-d-une-imprimerie-en-liquidation-brulent-le-stock-d-encre-et-de-papier. » En 2020, après une longue bataille judiciaire, 65 ex-salariés de l’usine se voient accorder plus de 3 millions d’euros de dommages et intérêts, soit environ 50 000 € par personne. Malheureusement, sur les quelque 150 salariés à s’être saisis des prud’hommes après la fermeture du site, il n’en reste plus que 65 engagés dans la procédure, dont certains sont décédés.
Cet exemple est caractéristique de la pression financière exercée par les groupes éditoriaux sur les imprimeries. Ce rapport de force est manifeste lors de la publication des appels d’offres d’impression. Hachette et Editis, grâce aux volumes qu’ils peuvent garantir, sont particulièrement agressifs lors de ces négociations tarifaires.
La concentration permet aux groupes de « rationaliser » leurs achats. D’ailleurs, le chef de fabrication se confond avec le responsable achat ou travaille sous sa responsabilité : la fabrication d’un livre n’est plus affaire de compétences techniques mais d’une capacité à négocier et à mettre en concurrence. Si la fidélité d’un chef de fabrication à son imprimeur était la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, les méthodes changent.
Sous la houlette des contrôleurs de gestion, les négociations s’appliquent pour l’ensemble des éditeurs du groupe ; elles portent sur les tarifs et l’occupation du temps machine. Lorsque Hachette ou Editis ouvrent un appel d’offres, ils garantissent un volume d’affaires et une réservation de temps machine en contrepartie de tarifs bas.
Le ou les imprimeurs qui remportent le marché ont une activité « garantie » mais se retrouvent dépendants du renouvellement de ce contrat et parfois asphyxiés par le volume de livres à imprimer. Ainsi, pour honorer les termes du contrat (délai, qualité), ces imprimeries ralentissent le développement commercial auprès d’autres clients et ne peuvent empêcher le départ de ceux qui se sentent négligés. Ces deux groupes, Hachette et Editis, suivis par Madrigall, Albin Michel, Actes Sud… se partagent alternativement le parc machine.
Soumission d’ordre moral
L’extrait qui suit, tiré d’un rapport d’Hachette Livre, est un nouveau témoignage de sa mainmise sur ses fournisseurs. Au-delà du rapport de force économique déjà évoqué, voici une soumission d’ordre moral :
« Hachette Livre incite vivement ses fournisseurs à s’inscrire dans une démarche de certification sociale, et recommande de se référer à des normes telles que SA 8000, OHSAS 18001 et ILO-OSH 2001. Hachette Livre procède à une évaluation continue de ses fournisseurs d’achats directs via la plateforme Ecovadis, favorisant ainsi l’amélioration continue de leurs performances environnementales, sociales et éthiques. Des audits de conformité sont également effectués dans les locaux et sites de production des fournisseurs, avec des sanctions en cas de non-conformité. En 2023, quinze sites industriels de fournisseurs ont été audités, révélant une seule non-conformité critique, entraînant la mise en place d’un plan d’action corrective« Rapport RSE Hachette Livre. Bilan 2023 & Perspectives 2024 », Hachette Livre, 06/06/2024, disponible sur : https://media.hachette.fr/11/pdf-file/2024-07/2404-036_rapport_rse_def3_intercatif-sans-fsc.pdf, consulté en février 2025.. »
La « certification sociale » appartient à la novlangue dont sont adeptes les managers. Elle remplace avantageusement et à bon compte la protection syndicale dont ont bénéficié, jusqu’à récemment, les ouvriers du livre (ce que nous aborderons un peu plus loin).
Alors que le groupe Hachette exige de ses fournisseurs qu’ils se reportent à des normes pour gérer la question sociale, le scandale des certifications forestières, censées garantir la provenance des papiers utilisés pour les livres du groupe, met en lumière l’abjecte fumisterie de ses valeurs « écologiques », un fameux exemple du greenwashing ! Deux « labels » se partagent le marché de certification de la filière bois, qui concerne l’approvisionnement du papier pour l’édition : FSC (Forest Stewardship Council) et PEFChttps://www.pefc-france.org/le-label-pefc/, consulté en février 2025. (Programme de reconnaissance des certifications forestières, qui a pour devise : « Gardien de l’équilibre forestier »). Ces deux logos se retrouvent sur tous types de produits et d’emballages comme le papier hygiénique, mais aussi les cahiers et bien d’autres articles. Ces deux labels déploient une communication très forte autour de leurs valeurs à l’apparence inébranlable : le respect pour l’environnement, le respect des droits du travail et des peuples autochtones. Une première enquête de l’émission Cash Investigation, intitulée « Razzia sur le bois » (diffusée sur France 2 le 24 janvier 2017), met en lumière des dysfonctionnements importants : pour tester cette organisation, les journalistes ont notamment demandé et obtenu la certification PEFC de gestion forestière durable pour des sites aussi incongrus et peu boisés qu’une porcherie, un supermarché ou des réacteurs nucléaires… Ce documentaire a fait grand bruit dans le milieu de l’édition et de l’imprimerie, au point que les responsables de production de la commission fabrication du CNL (Centre national du livre) se sont réunis pour préparer une réponse commune. Et le 1er mars 2023, Le Monde révèle l’enquête internationale « Deforestation Inc. » sur les carences des grandes sociétés d’audit environnemental. « Ces acteurs se voient confier la certification des exploitations, mais ils peinent à détecter les manquements des acteurs de la filière ou ignorent de nombreux dommages environnementaux. […] Cette enquête pointe les failles dans les règlementations et la collusion entre industriels et certificateurs peu scrupuleuxICIJ, « Une enquête révèle les failles du système de certification du bois “responsable” », Le Monde, 01/03/2023, disponible sur : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/01/une-enquete-revele-les-failles-du-systeme-de-certification-du-bois-responsable_6163785_4355770.html, consulté en février 2025.. »
La Fédération des syndicats du livre : un rempart s’est effondréCette partie est largement inspirée du livre Le Syndicat des correcteurs de Paris et de la région parisienne (1881–1973) d’Yves Blondeau (supplément au Bulletin des correcteurs, nº 99, 1973) et du témoignage précieux de Floréal Cuadrado et de ses mémoires Comme un chat. Souvenirs turbulents d’un anarchiste, faussaire à ses heures, vers la fin du XXe siècle (Éditions du Sandre, Bruxelles, 2015) et Du Rififi chez les aristos (à paraître).
« Les correcteurs parisiens ont toujours été de fortes et originales personnalités qui ont occupé une place à part soit dans la Fédération du livre, soit dans la CGT, soit dans les deux organisations à la fois. Deux traits principaux les ont jusqu’ici caractérisés : leur militantisme syndicaliste révolutionnaire et leur qualification professionnelle. Bref, le Syndicat des correcteurs, qui constitua un refuge pour nombre de militants en rupture de métier par suite de la répression patronale, n’est pas un syndicat comme les autres, il est quelque chose de plus. » Jean MaitronJean Maitron (1910–1987) : militant, historien du mouvement ouvrier, notamment créateur et directeur du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Cette citation est extraite du livre de Floréal Cuadrado, Du Rififi chez les aristos (à paraître).
Le Syndicat des correcteurs, créé en 1881, a pris véritablement naissance en 1904 avec l’arrivée de militants anarchistes et de syndicalistes révolutionnaires. Tous ces militants avaient en commun de lutter sur leur lieu de travail dans le cadre de leur syndicat, contre l’exploitation patronale, pour permettre l’émancipation des travailleurs et réaliser dans la pratique l’idée fondamentale du syndicalisme révolutionnaire : l’abolition du salariat. Ces principes, restés très vivants chez les correcteurs, sont l’une des grandes originalités de leur syndicat, alors qu’aujourd’hui, nombreux sont les syndicats à être liés aux partis et dans lesquels la démocratie syndicale revendiquée n’est que rarement effective. Par exemple, dès 1919, les représentants des correcteurs menaient bataille avec d’autres délégués pour l’admission des femmes dans la profession et dans les organisations syndicales. Et en 1989, le Syndicat des correcteurs comptait le plus important pourcentage de femmes parmi ses adhérents à la Fédération du Livre. Autre particularité, les femmes percevaient le même salaire que les hommes, appliquant depuis des années le principe « à travail égal salaire égal ». Il n’y avait par ailleurs aucune différence salariale entre un débutant et un correcteur chevronné.
Le Syndicat des correcteurs était un refuge pour militants pourchassés. Dans cette « terre » d’accueil, ils pouvaient, tout en gagnant leur vie, continuer à exister comme les militants qu’ils étaient.
Citons plusieurs figures féminines majeures actives au sein du Syndicat des correcteurs. May PicquerayElle est l’autrice de May la réfractaire, 85 ans d’anarchie, Montreuil, Libertalia, 2021.(1898–1983), celle qui refusa de serrer la main de Trotski à Moscou. Celle qui monta sur la table du congrès de l’Internationale syndicale rouge pour haranguer et dénoncer les congressistes en train de se goberger alors que le peuple russe mourait de faim. Celle qui, infatigable féministe, pacifiste et antimilitariste réalisa des faux-papiers pour des réseaux de résistants durant l’Occupation. Et ce qui ne fut pas son moindre exploit, elle fut vingt ans durant une flamboyante correctrice au Canard enchaîné. Ou Rirette Maîtrejean (1887–1968), compagne de Victor Serge, qui fut acquittée au procès de la bande à Bonnot. Plus tard, elle se lia d’amitié avec Albert Camus et lui fit connaître la pensée libertaire. Elle fut correctrice en presse dès 1923, et lorsque Louis Lecoin lança le journal Liberté, elle se chargea de sa correction. Citons aussi Marcel BodyIl est l’auteur d’Un ouvrier limousin au cœur de la révolution russe, Spartacus, Paris, 2015 et Les Groupes communistes français de Russie : 1918–1921, Allia, Paris, 1988.(1894–1984) qui, membre de la mission militaire française envoyée en Russie en 1918, fut de ceux qui refusèrent de participer aux opérations alliées — dont la France — contre le gouvernement soviétique. Membre de l’Internationale communiste, il devint diplomate soviétique en Norvège, aux côtés d’Alexandra Kollontaï. Antistalinien, lorsqu’il fut contraint de revenir en France, il devint correcteur et adhéra au Syndicat des correcteurs. Il traduisit du russe les textes de Lénine, Trotski et plus tard ceux de Bakounine, sous l’égide de l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam. Dans les années 1960, il participa à la revue de Boris Souvarine, Le Contrat social, et en 1974 au Réfractaire en compagnie de May Picqueray.
Dans les années 1990, le Syndicat des correcteurs défendait toujours les principes de la CGT d’avant 1914. Principes qui lui avaient donné ses lettres de noblesse. Après Mai 68, quelques-uns de ses membres prétendirent le moderniser en supprimant ce qu’ils considéraient n’être que des archaïsmes. Le principal étant, selon eux, la rotation des mandats. C’était pourtant grâce à cette rotation qu’il avait évité de se transformer en bureaucratie syndicale comme l’étaient devenus beaucoup d’autres syndicats.
Mais le développement de l’informatique de bureau a détruit de nombreux métiers et les nouvelles techniques d’impression favorisant les courts tirages ont transformé le paysage des imprimeurs et les métiers du livre. Les ouvriers du livre détenteurs d’un savoir intellectuel et technique, porteurs de cette histoire syndicale et révolutionnaire, ont été remplacés par des opérateurs.
Si nous avons une bonne connaissance des métiers du livre, des origines jusqu’aux années 1960, force est de constater que l’histoire de ses ouvriers est moins documentée à partir du moment où arrive la photocompositionLa photocomposition est un procédé de composition de lignes de texte en qualité typographique par un principe photographique, et non, comme depuis les débuts de l’imprimerie, par des caractères en plomb assemblés manuellement ou mécaniquement. Assis devant le clavier d’une machine imposante, une « photocomposeuse », un opérateur peut ainsi produire des colonnes de texte sur des films, qui sont ensuite découpés et assemblés pour réaliser les maquettes transparentes des pages de journal, brochures, livres, etc., au travers desquelles on « flashe » (sensibilise) les plaques de l’imprimerie offset.. C’est à ce moment-là que les effectifs des principaux syndicats de cette branche chutèrent de façon drastique et, par conséquent, la fédération les regroupant, redoutée jusqu’alors par l’ensemble du patronat du secteur, devint un simple partenaire social.
La dégringolade de ses effectifs commença avec l’arrivée de nouveaux outils. Ceux-ci étaient plus simples à utiliser et requéraient des connaissances différentes de celles qu’avaient les anciens ouvriers du livre. Pour les patrons, ils avaient l’avantage de pouvoir être utilisés par des personnels qui n’étaient pas liés à l’histoire du syndicalisme du livre.
Le premier de ces outils fut la photocomposeuse. Elle arriva sur le marché dans les années 1960, faisait le même travail que les linotypesLa linotype est une machine de composition au plomb qui utilise un clavier, permettant de produire la forme imprimante d’une ligne de texte d’un seul tenant. Cette combinaison de machine à écrire et de micro-fonderie, imaginée aux États-Unis en 1885, permettait une composition accélérée et plus régulière des blocs d’imprimerie qu’avec la typographie traditionnelle. La linotype révolutionna l’édition en permettant à de petits ateliers de saisir des textes importants dans des délais raccourcis, et rendit possible l’énorme développement, autour de 1900, de la presse quotidienne en lui offrant une réactivité impossible auparavant. La linotype régna sans partage sur l’imprimerie jusque dans les années 1960, époque à laquelle elle fut remplacée par la photocomposition, tandis que le tirage offset supplantait l’impression typographique. et coûtait bien moins cher. Ces machines présentaient un autre avantage, celui d’être bien moins complexes à utiliser et de ne pas nécessiter de personnel ayant des connaissances techniques particulières. Dès lors, les typographes ont été peu à peu remplacés par un personnel généralement féminin, et évidemment moins bien payé. Ces femmes étaient souvent des secrétaires en reconversion. Il leur était demandé d’avoir un bon niveau en français et une vitesse de frappe supérieure à 10 000 signes à l’heure. Une production bien plus importante que celle des typographes. Après une rapide formation, elles devenaient clavistes. La plupart de ces femmes, comme de nombreuses autres en France à l’époque, n’adhérèrent à aucune organisation syndicaleSeules le firent les femmes qui pensaient pouvoir travailler en presse parisienne. Pour pouvoir travailler dans ce secteur, il fallait en effet obligatoirement adhérer à un syndicat de la presse parisienne.. Un parfait exemple du continuum de l’exploitation patriarcale : de l’exploitation domestique à l’exploitation salariale, ou comment la double journée de travail se développait pour les femmes. Les typographes quant à eux étaient majoritairement membres du Syndicat du livre, leur départ de la production fut la première réduction importante des effectifs de ce syndicat.
Une décennie plus tard, de nombreux ateliers de labeur, où étaient confectionnés les revues, les livres, etc., fermèrent leurs portes pour être remplacés par des ateliers de PAO (publication assistée par ordinateur). L’informatique venait de s’immiscer dans l’industrie du livre et elle n’allait plus en sortir. Les outils informatiques avaient l’avantage de permettre la fusion des anciens métiers du livre. De nouveaux personnels composaient ces ateliers. Ils n’avaient pas grand-chose à voir avec les ouvriers qui travaillaient dans le labeur. C’étaient des jeunes qui avaient vécu les journées de Mai 68 et avaient en mémoire l’attitude réactionnaire du PCF et de la CGT. L’image de courroie de transmission du très stalinien PCF, que véhiculait la CGT avec ses dogmatismes, n’était pas faite pour attirer ces jeunes. Avec la fermeture des ateliers de labeur, les effectifs du Syndicat du livre subirent une nouvelle réduction.
Les responsables de la Fédération française de travailleurs du livre (FFTL), au lieu de prendre la mesure de ces chutes d’effectifs, décidèrent de ne rien changer à leur mode de fonctionnement. Cette fédération comptait, dans les années 1970, environ 70 000 adhérents. En 1993, ses effectifs n’étaient plus que de 25 000 adhérents…
Face à cette chute et, par conséquent, à celle des revenus des adhésions, la Fédération des syndicats du livre a été en proie à de graves querelles : d’un côté, le CILP (Comité intersyndical du livre parisien) qui gérait les relations avec les patrons de la presse quotidienne nationale (PQN) regroupés au sein du Syndicat de la presse parisienne (SPP) ; de l’autre, la FILPAC (Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication), qui gérait les relations avec les patrons de la presse quotidienne régionale (PQR) et l’ensemble des éditeurs (presse périodique, édition, labeur et communication), ainsi qu’avec le patronat de l’industrie du papier et du carton.
Cette crise, qui vit s’affronter ces deux fédérations, la Chambre syndicale typographique parisienne (CSTP) et le Syndicat des correcteurs, prit partiellement fin en 1998. Mais il était trop tard pour protéger activement les ouvriers du livre de la révolution numérique qui s’immisçait dans le quotidien de l’imprimerie.
La fermeture de l’imprimerie Floch-London, une brève histoire des mutations dans ce secteur
Pour revenir maintenant à la tendance de fond concernant les transformations du monde de l’imprimerie du livre, attardons-nous sur l’histoire de l’imprimerie Floch-London pour laquelle j’ai travaillé pendant presque vingt ans. En 2001, lorsque je suis embauché à l’imprimerie Floch-London, appelée également Imprimerie Jacques London, sise dans le 9e arrondissement de Paris, au 13 de rue de la Grange-Batelière, ce lieu fait partie des rescapés de la grande vague de modernisation et de rationalisation des imprimeries de labeur. Au fond d’une cour d’immeuble, cette entreprise, créée avant la Seconde guerre mondiale par Jacques London, occupe un rez-de-chaussée de 400 m2 et un sous-sol équivalent.
À mon arrivée, l’atelier et les bureaux comptent une quinzaine de personnes ; dans les années 1960, cet atelier comptait 70 personnes et a fonctionné jusqu’à la fin des années 1980 avec ce personnel et tous les métiers nécessaires à une production autonome.
L’imprimerie Floch, créée dans les années 1920, est située quant à elle à Mayenne (53). C’est une des imprimeries historiques pour l’impression de livres de littérature générale. En 1996, elle fait l’acquisition de l’imprimerie Jacques London, alors en difficulté financière, afin d’offrir à ses clients un service d’impression couleurs. Jusqu’alors, les éditeurs imprimaient les couvertures, et autres éléments couleurs, chez des imprimeurs dédiés et proches de leur bureau parisien afin d’assister aux calages et aux réglages des couleurs en machine. L’imprimerie Grou-Radenez, 11 rue de Sèvres, Paris 6e, était également célèbre dans ce domaine.
Les concentrations dans l’édition ont provoqué une concentration dans l’imprimerie. La constellation d’imprimeries indépendantes disparaît au profit de groupes industriels qui monopolisent les outils de production. Les métiers changent et l’édition demande aussi que les services soient regroupés au sein d’une même entité afin de faciliter les commandes, les flux de productions et de faciliter la réparation des litiges.
Ces changements coïncident avec l’accélération des capacités de production : la tendance est alors « plus de livres en moins de temps ». Comme on l’a vu, ils coïncident également avec le développement de l’ordinateur personnel, l’arrivée de la PAO et l’informatisation des ateliers : les procédés photographiques de préparation des formes imprimantes disparaissent peu à peu pour être remplacés par des procédés numériques. Cette révolution informatique réduit les étapes de préparation et le travail réalisé par des ouvriers du livre qualifiés peut être fait par des opérateurs polyvalents… La puissance des logiciels remplace peu à peu le savoir-faire. Les clavistes qui avaient remplacé les linotypistes, eux-mêmes fossoyeurs des célèbres typographes, maîtrisaient toujours l’orthographe, la grammaire et le code typographique… et parfois plusieurs langues. Elles sont aujourd’hui remplacées par une main-d’œuvre à bas coût, sans protection syndicale, située parfois dans les anciennes colonies (notamment MadagascarExtraits de la page d’accueil de l’entreprise Nord Compo : « 03. Avantage concurrentiel : L’usine de production de la société à Madagascar nous donne un avantage concurrentiel. / 04. Taille : Basée en France et employant plus de 500 personnes dans le monde, Nord Compo fournit des services à certains des plus grands noms de l’édition, notamment Hachette, Elsevier, Pottermore, Ingram, Sourcebooks, Wolters-Kluwer, University of Ottawa Press, InterVarsity Press et OverDrive, ainsi qu’à de nombreux éditeurs plus modestes. », Nord Compo, disponible sur : https://www.nordcompo.com/, consulté en février 2025.) : les salaires sont si bas que la compétence d’une claviste est remplacée par deux opérateurs saisissant le même texte au kilomètre, assistés d’un logiciel qui se charge de comparer les deux saisies et de corriger automatiquement pour aboutir à une version finale.
De son côté, l’imprimerie Floch avait développé, dans les années 80, une rotative flexographique pour livre, appelée Roto-page. Ces machines étaient les premières lignes de production en continu pour le livre de littérature générale. Avec ce matériel, elle a pu rivaliser avec les grands groupes d’imprimerie équipés de rotatives Cameron, comme l’imprimerie Bussière (à Saint-Amand-Montrond). Ces développements techniques étaient pensés et réalisés au sein de l’entreprise grâce à l’expérience acquise dans les ateliers. Rappelant que dans cette économie industrielle, l’amortissement et la longévité du matériel étaient essentiels. L’imprimerie devait posséder un atelier de techniciens capables de réparer et d’améliorer les machines.
Le développement des techniques d’impression « numériques », concentré entre les mains de quelques constructeurs, a détruit cette autonomie. Le matériel « numérique » n’appartient plus en propre à l’imprimeur, c’est un leasing : une redevance à la copie associée à un contrat d’entretien exclusivement assuré par le constructeur.
L’imprimerie Floch-London, le site parisien, est devenu au fil des ans une aberration économique et un témoin de la transformation du métier. L’atelier comptait une quinzaine de personnes en 2001, seulement 6 y travaillaient encore à la fermeture en 2015 pour une production identique. L’automatisation et la performance des presses offset et la réduction des étapes du prépresseLe prépresse regroupe l’ensemble des opérations qui précèdent l’impression. Aujourd’hui, dans une imprimerie, ces diverses opérations consistent principalement à produire des plaques d’impression ou autres formes imprimantes qui seront montées sur une presse à imprimer. ont favorisé cette réduction du personnel.
En 2015, l’imprimerie Floch fut mise en redressement judiciaire et elle dut immédiatement fermer l’atelier parisien. Ce dernier fut sacrifié afin de sauver la maison mère de Mayenne. Ce fut la fin de l’histoire tumultueuse et emblématique de l’imprimerie Jacques London. L’obstination de la direction à préserver la particularité de l’imprimerie Floch — un site parisien pour faciliter le travail des éditeurs et le refus de la transformation industrielle vers l’impression numérique — provoque sa perte. Ironie de l’histoire, l’imprimerie Floch fut reprise par l’imprimerie Laballery, spécialisée depuis plusieurs années dans l’impression numérique et les courts tirages.
En guise de conclusion
Aujourd’hui, le groupe Hachette propose un service d’impression unitaire et à la demande pour les ouvrages à faible rotation (environ 50 exemplaires par an), grâce à un partenariat de sa branche Hachette Livre Distribution avec la société d’impression Lightning Source, dont la devise est « Imprimez responsable ! » et l’argument commercial : « La réimpression automatisée des ouvrages permet aux éditeurs de disposer du juste stock de façon permanente.Extrait du site internet de Lightning Source, disponible sur : https://www.lightningsource.fr/, consulté en février 2025. »
Il est important de préciser, et cela intéressera particulièrement les libraires, que ce site de production, à Maurepas (78), est voisin d’Amazon Hub Locker et que le site web de Lightning Source est hébergé par Amazon.
Cependant, et paradoxalement, le développement numérique dans le livre a permis à des individus ou à des groupes d’affinité de s’accaparer des moyens de production jusqu’alors réservés à des entreprises et, par là même, à gagner en autonomie grâce à leur créativité.
Avec la récupération de matériels « obsolètes », la mise en commun d’outils, le partage de nouveaux savoir-faire et d’astuces, la génération née sous l’ère informatique et numérique possède les armes de la contre-attaque tout en apprivoisant les connaissances anciennes. Celles dont les témoins de la « grande époque » de l’imprimerie semblent embarrassés pour préparer un autre futur.
Des manuels bien pratiques —
En juillet 2023, un message posté sur le réseau alors appelé « Twitter » mettait en garde contre un quasi-monopole de Vincent Bolloré sur le marché des manuels scolaires.
« Petit rappel : 74 % du marché des manuels scolaires sont aux mains de Bolloré. S’il formate les vieux par la télé, il entend bien s’occuper de la jeunesse aussihttps://x.com/Milady__Oscar/status/1679034307883462657, consulté le 19/03/2025. »
Largement diffusé dans les sphères militantes de gauche et d’extrême gauche, ce message de mise en garde sera vérifié par Libération. Les « 74 % » proviennent en fait d’un entretien avec Antoine Gallimard, qui s’inquiétait dans Le Monde des effets d’une fusion entre les groupes Editis et Hachette, au moment où les actifs du groupe Lagardère, et donc Hachette, étaient sur le point d’être repris par Vivendi appartenant à Vincent Bolloré. Antoine Gallimard (qui plaidait aussi, évidemment, pour ses propres intérêts) alertait :
« Dans le secteur de l’éducation, si sensible socialement et politiquement, le constat est sans appel : 84 % en parascolaire, 74 % en scolaire… Il n’y a donc pas à douter que cette fusion créerait une situation de domination jamais atteinte sur le marché français. […] La filière ne pourra conserver sa pluralité si un acteur ultra-dominant s’approprie le plus gros de sa valeur. »
Finalement, Editis sera cédé en novembre 2023 à un autre milliardaire qui mène lui aussi depuis quelques années une politique très offensive de rachat de médias, et forme en quelque sorte dans le paysage français la deuxième branche d’une tenaille idéologique avec Bolloré : Daniel Křetínský. Ce dernier pousse vers des contenus et des lignes éditoriales plutôt libérales et surtout laïques associées en France au Printemps républicain (le magazine Franc-Tireur, Marianne), tandis que Bolloré mène ouvertement une lutte culturelle conservatrice voire réactionnaire, qui embrasse des thèmes d’extrême droite ou traditionalistes chrétiens.
La gauche et l’extrême gauche se sont émues à l’idée de voir les trois quarts des manuels scolaires tomber dans l’escarcelle de Bolloré — alors que le marché, comme dans les médias, tend plutôt à se redistribuer entre ces deux pôles idéologiques.
L’émergence dans le débat public d’une « question des manuels scolaires » n’est pas nouvelle, et s’inscrit dans le contexte d’une réorganisation du monde de l’éditionEt d’une réelle implication de proches de Vincent Bolloré dans la politique éditoriale de certaines maisons, dont le meilleur exemple récent est Fayard. Après avoir sorti l’autobiographie de Jordan Bardella, cet éditeur s’apprête à publier, en mai 2025, un ouvrage d’Alain de Benoist, penseur historique de la « Nouvelle droite », qui sera préfacé par Michel Onfray.. C’est donc par le thème des cessions et fusions de grands groupes d’édition, plutôt que par le problème de l’institution scolaire, de la formation des enseignants et des contenus de cours, qu’a d’abord été envisagée la menace d’une prise de contrôle du marché de l’édition scolaire.
Pour éviter le reproche de céder à une panique morale de gauche, il serait intéressant de revenir sur ce qu’est le marché de l’édition scolaire, et ce que pourrait bien venir y faire quelqu’un comme Vincent Bolloré. Il nous semble que cela permettrait de ne plus se représenter une sorte de cheval de Troie d’extrême droite introduit dans la forteresse d’un système scolaire sanctuarisé, mais plutôt de se figurer que des capitalistes engagés dans une lutte idéologique explicite, comme le sont Bolloré et Křetínský, trouvent un véritable intérêt économique à investir ce marché, en même temps qu’ils participent à et sont l’indice de la dégradation de l’Éducation nationale depuis quelques décennies.
Si les manuels scolaires redeviennent un sujet d’inquiétude, un thème du débat public et un terrain d’intervention politique possible pour la droite conservatrice, réactionnaire et l’extrême droite, c’est bien du fait de l’affaiblissement continu depuis plusieurs décennies, mais accéléré depuis quelques années, du recrutement, de la formation et de l’intégration des jeunes enseignant·es par l’Éducation nationale.
Commençons par quelques chiffres pour prendre la mesure de ce qui est qualifié par beaucoup de « crise de la vocation d’enseignant·eSandrine Garcia, Enseignant, de la vocation au désenchantement, Paris, La Dispute, 2023. ». Au concours du Capes 2024, qui permet de recruter les futur·es professeur·es du secondaire, il n’y a eu que 287 admis pour 429 postes en physique-chimie ; 831 admis pour 1 040 postes en mathématiques ; sans parler de disciplines considérées depuis longtemps fragilisées : 75 admis pour 165 postes en allemand, 89 admis pour 122 postes en musique. Au total, 635 postes sur les 4 122 proposés au Capes n’ont pas été pourvus. Cela représente 12 % des postes proposés, donc des besoins officiels du ministère ; c’était 16 % l’année précédenteCes chiffres du Ministère sont disponibles sur : https://cyclades.fr/.
Et s’il y a moins de postes pourvus, c’est bien parce qu’il y a de moins en moins de candidat·es aux concours.
Depuis quelques années, le ministère multiplie les rapports pour relativiser l’ampleur de cette désaffection. Mais la communication officielle gomme ainsi une tendance de fond, à propos de laquelle les chercheureuses en histoire et science de l’éducation alertent régulièrementEntre 2004 et 2016, le nombre de candidat·es aux concours d’enseignement, à la fois pour les professeur·es des écoles et les enseignant·es du secondaire, a été divisé par deux : il est passé de 61 000 à 29 000 alors que le nombre de postes proposés aux concours est resté globalement le même. C’est ce qu’expliquent Frédéric Charles, Serge Katz, Marlène Cocouault, Florence Legendre, Angélica Rigaudière et Pierre-Yves Connan : « La perte d’attractivité du professorat des écoles en France au début du XXIe siècle », dans Géraldine Farges et Loïc Szerdahelyi (dir.), En quête d’enseignants. Regards croisés sur l’attractivité d’un métier, Rennes, PUR, 2024..
Les différentes réformes du mode de recrutement des enseignant·es, depuis les années 1970, ont bien eu des effets sur le nombre de candidat·es. En 1977, le concours en fin de troisième année a été abandonné au profit du seul baccalauréat. Le niveau de recrutement a donc été baissé, entraînant une remontée du nombre des candidat·es. En 1985, sous Mitterrand, le DEUG a de nouveau été exigé (deux années d’études supérieures, donc) et en 1992 la licence (trois années). En 2011 la mastérisation des concours, puis la création des ESPE, instituts de formation des professions de l’enseignement, a multiplié les voies d’accès aux concours : certain·es candidat·es passent les concours avec un master 1 dans une discipline donnée, ou avec un autre master en poche ; d’autres le préparent à l’ESPE. Bien sûr, comme le met en avant le ministère pour analyser la crise actuelle, chaque changement dans le niveau de recrutement crée bien une « crise » — mais elle est en général vite résorbée et la courbe des candidatures remonte au bout de quelques années.
Pour interpréter cette baisse des candidatures aux concours d’enseignement, plusieurs hypothèses s’affrontent ou se complètent. Concernant le métier de professeur·e des écoles, certains insistent sur le caractère genré du métier : la République française a longtemps misé sur une armée de réserve féminineL’expression est de Géraldine Farges, ibid., prête à s’engager dans le métier d’institutrice puis de professeure des écoles, métier à la fois valorisé symboliquement et mal traité en ce qui concerne la rémunération, le temps de travail et les conditions, clairement dévaluées par rapport au secondaire : à travail égal entre le primaire et le secondaire, il n’y a jamais eu salaire égal. On estime que « l’armée de réserve féminine de la République » n’existerait plus vraiment pour le professorat des écoles, de nombreuses femmes se détournant d’un métier déconsidéré ; il faut ajouter que l’interprétation très restrictive de la loi sur la laïcité, au moment où Jean-Michel Blanquer a été ministre de l’Éducation nationale, ainsi que la circulaire sur les signes religieux, ont détourné certaines candidates, notamment des jeunes filles musulmanes portant un voile, de ce concours et de l’enseignement au primaire.
Plus largement, les quelques études chiffrées sur la désaffection du métier d’enseignant en FranceL’enquête de l’Ipsos « Facteurs d’attractivité et de rejet du métier d’enseignant chez les étudiants », est disponible sur : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230201-enquete-Ipsos-2022-devenir-enseignant-recrutement-formation-initiale-enseignants.pdf, consulté le 19/03/2025 recoupent des observations et des intuitions à peu près partagées par toutes celles et ceux qui, au primaire, dans le secondaire et dans le supérieur, réfléchissent à ce mouvement de fond, qui transforme et affaiblit considérablement le corps enseignant. D’abord la rémunération est jugée trop basse par rapport au travail demandé. Ensuite on évoque les changements dans la nature même de ce travail (notamment l’usage accru d’outils numériques, le temps consacré au logiciel ProNote, au cahier de texte numérique, la multiplication des réunions, du temps hors salle de classe consacré à la préparation des cours, à la mise en ligne de ressources). On met bien sûr en avant la difficulté accrue des conditions de travail, avec la crainte pour beaucoup d’aspirant·es au métier de la violence des élèves (notamment suite aux attaques terroristes), et l’impression que les enseignant·es ne sont pas soutenu·es par leur hiérarchie, plus largement par l’institution. Mais on se plaint aussi d’un système de mutation très rigide, jugé injuste voire punitif, qui contraint les jeunes enseignant·es à devoir partir pendant de longues années loin de leur région, de leur milieu familial, de leur conjoint·e (le rapprochement de conjoint·es n’étant jamais assuré), alors qu’on note chez beaucoup d’étudiant·es destiné·es à cette carrière un attachement accru à la solidarité familiale et à leur ville d’origine, accentué par l’appauvrissement et la crise économique.
Il est intéressant de noter que le déclin du « désir d’être enseignant·e » ne gagne rien à être interprété abstraitement en termes de « crise de la vocationSandrine Garcia, Enseignant, de la vocation au désenchantement, op. cit. », voire — dans des termes plus droitiers — à de la paresse ou à un refus de faire un travail exigeant, ni même — dans des termes cette fois plus volontiers gauchistes — en désertion d’une institution vouée à la reproduction sociale et à une protestation contre l’aliénation par le travail. C’est plus concret que cela. Nombre d’étudiant·es qui ne passent pas les concours décident pourtant, une fois leur Master en poche, d’être contractuel·les. Iels ne sont pas opposé·es à l’idée d’enseigner, mais inquiet·es du statut d’enseignant·e, dévalué, peu désirable, anxiogène. Le recours massif par l’Éducation nationale à des vacataires, donc à des non titulaires, explique la formation d’une nouvelle « armée de réserve ». Celle de vacataires volontaires ou involontaires, du primaire au supérieur, qui font à bien des égards tenir l’édifice branlant de l’Éducation nationale, mais dans des conditions qu’on pourrait dire « abimées », désormais soumi·es à une hiérarchie, puisqu’embauché·es et évalué·es par un chef d’établissement, ne bénéficiant pas d’un salaire pendant les vacances, n’étant pas protégé·es par le statut de fonctionnaire…
Entre 2015 et 2021, la part du personnel non titulaire de l’Éducation nationale est passée de 14,5 à 22 % du total des effectifs. Cette hausse de 68 %, qui est destinée à se poursuivre, s’explique en partie par le recrutement d’AED et d’AESH, mais aussi, comme le notent plusieurs représentant·es syndicaux·ales, par le nombre grandissant de contractuel·les qui se substituent aux remplaçant·es, elleux-mêmes pris·es sur des postes à l’année qui ne sont plus pourvus par des titulairesErwin Canard, « Dépêche nº 661-708 », AEF-Info, nº 5, 11/2021, L’auteur reprend l’analyse de Sophie Vénétitay, du SNES.. Par ce jeu de chaises musicales, de plus en plus de contractuel·les participent à l’effort de l’Éducation nationale, dans des conditions dégradées, et avec une formation lacunaire voire inexistante.
C’est ici que le contexte de diminution du nombre de titulaires, de candidats et de la réserve d’aspirant·es à l’enseignement permet de mieux comprendre l’importance stratégique de la formation des enseignant·es et, plus particulièrement, des manuels qui leur sont proposés.
Il est évident que le nombre de plus en plus réduit d’inscrit·es aux concours entraîne une baisse du niveau de ces concours et une transformation de la composition du futur corps enseignant. Les seuils d’admission aux concours de plusieurs disciplines baissent d’année en année. Quand ils demeurent à peu près stables, c’est le nombre d’admis·es qui dégringole. Le dilemme devient donc : faut-il baisser les exigences du concours, pour recruter plus, ou juste autant ? Ou bien faut-il maintenir le niveau d’exigence et constater l’écroulement du nombre d’admis·es, le vivier de candidat·es diminuant à vue d’œil ?
Il ne s’agit pas de tenir un discours réactionnaire sur une baisse de niveau des jeunes enseignant·es, mais de constater que la transformation du recrutement devrait impliquer une formation plus soutenue, avec plus de moyens et plus d’accompagnement — alors que c’est tout l’inverse. Prises à la gorge par le manque de postes pourvus et en même temps l’injonction politique à mettre un·e enseignant·e devant chaque classe (pour épargner au gouvernement une remise en cause publique, une campagne médiatique et la colère des familles), les académies sont contraintes à des recrutements de dernière minute, des campagnes de « job dating« Rejoignez les femmes et les hommes de l’Éducation nationale qui changent la vie pour toute la vie ! Organisation des journées du recrutement du 13 au 16 et du 21 au 24 mai », sur le site de l’académie de Versailles. Voir aussi Marlène Thomas Decreusefond, « Au job dating de l’académie de Versailles : “Je pensais qu’il fallait des diplômes pour être prof” », Libération, 30/05/2022. » pour aller chercher des vacataires, des personnes titulaires d’un Master, parfois éloignées depuis longtemps de leur discipline, mais qui accepteraient de prendre une classe.
Souvent formé·es à distance grâce à du matériel numérique, des tutoriels, des modèles de séquences de cours envoyées par mail, ces enseignant·es très précaires, dont beaucoup abandonnent vite après avoir saisi l’occasion d’une expérience professionnelle, sans réelle conscience des attendus et des contraintes du métier d’enseignant·e, n’ont parfois pas — et c’est normal — une connaissance précise du programme de leur discipline.
Le manuel vient donc souvent remplacer le programme. Il offre clé en main des séquences de cours, dans une situation d’urgence où l’on se trouve envoyé·e du jour au lendemain devant une classe, sans être bien certain·e de son propre niveau dans la discipline à enseigner, qu’on ait eu un concours de justesse — et aux exigences revues à la baisse — ou qu’on ait été recruté·e sur la foi d’un Master, sans formation particulière pour l’enseignement.
Mais plutôt que de se plaindre d’un manque de vocation, il faut bien comprendre que les difficultés de jeunes enseignant·es, titulaires, stagiaires ou vacataires, inquiet·es pour leur logement, leurs moyens de transport, fragilisé·es dans leur formation, balloté·es par le système de mutation, angoissé·es par leurs conditions de travail, la pression des parents, la violence des élèves, le manque de soutien de l’institution, accentuent une précarisation qui a même été rendue désirable pour certain·es : iels préfèrent s’imaginer enchaîner quelques « piges » dans l’enseignement plutôt que de s’y engager pour toujours.
Le métier d’enseignant·e, rendu à la fois plus ardu et plus « flexible », s’apparente donc nécessairement, pour toute une classe précaire, à une sorte de boulot d’intérim : les outils fournis pour faire le boulot ne sont pas nécessairement questionnés d’un point de vue pédagogique, ni idéologique. Pour gagner du temps, on aura recours à des vidéos, des tutoriels, de la documentation fournie par les éditeur·ices de manuels, aussi bien qu’aux manuels eux-mêmes. Le temps et le recul nécessaires à la préparation d’un cours n’étant pas forcément à disposition, on fait avec ce qu’il y a.
Et qu’est-ce qu’il y a ? Des manuels, mais aussi tout un ensemble de ressources associées, produites par des entreprises privées.
296 millions d’euros et 10,6 % de l’ensemble du marché de l’édition. Voilà ce que représentait le secteur du livre scolaire en 2023. Ces chiffres ont été dévoilés au moment du « choc des savoirs » promis par le Premier ministre de l’époque et ancien ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, qui prévoyait une grande réforme des manuels, lesquels seraient désormais « labellisés » par l’État. (Cette réforme semble à ce jour en suspens.)
Depuis le XIXe siècle l’État français se pose la question du contrôle du contenu des manuels scolaires. Bien vite, la République a admis son incapacité à avoir la main sur tous les livres fournis aux enfants et aux adolescent·es dans tous les territoires, et a donc délégué la fabrication et la distribution des manuels aux éditeur·ices privé·es, ouvrant ainsi un marché économique lucratif, disputé depuis près d’un siècle et demiAlain Choppin, « Le manuel scolaire, une fausse évidence historique », Revue d’histoire de l’éducation, nº 17, 2008, p. 7-56..
Au fond, on pourrait dire que l’État français se réserve les programmes scolaires, qui sont comme le potentiel des contenus d’éducation, et qu’il charge des entreprises privées de l’actualisation de ce potentiel, sous la forme de livres mettant en scène chacun à leur façon un parcours dans les programmes nationaux. Ces livres, rédigés depuis longtemps par des enseignant·es, avec l’appui d’universitaires, d’inspecteur·ices d’académie, mais pilotés par diverses maisons d’édition, qui ont chacune leur politique, leur esthétique, leur façon de mettre en scène les savoirs, représentent donc un enjeu économique dont l’importance n’a d’égal que le flou qui entoure son fonctionnementVoir le rapport très intéressant du sénateur Michel Leroy, « Les manuels scolaires : situation et perspectives », 2012, disponible sur : https://www.education.gouv.fr/les-manuels-scolaires-situation-et-perspectives-6017, consulté le 19/03/2025..
En France, la charge des écoles maternelles et primaires (dont l’acquisition et la maintenance des équipements) repose sur les communes, celle des collèges sur les départements, et celle des lycées sur les régions. Chaque collectivité locale a sa façon de financer l’achat de manuels scolaires. De plus en plus de régions (Occitanie, Centre-Val de Loire, PACA, Île-de-France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Réunion, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Martinique) font le choix de la gratuité totale ou partielle des manuels scolaires pour les familles. Parfois, elles versent une subvention aux établissements, mais de plus en plus souvent elles fournissent aux lycéens du matériel pédagogique numérique, qui inclut les manuels. Quoiqu’elles n’aient pas l’obligation formelle d’actualiser l’ensemble des manuels en circulation après chaque réforme du programme, il existe une forte pressionSur le lobbying effectif et/ou potentiel, rappelons que Bolloré via Vivendi est propriétaire du groupe de communication Havas, dont de nombreux salariés font l’aller retour dans les cabinets ministériels. De même au sein de l’agence Plead (groupe Havas), le même conseiller veille aux intérêts et à la réputation de Cyril Hanouna et Hachette Livre. au rachat régulier de nouveaux ouvrages, plus en adéquation avec les programmes. La durée de vie moyenne d’un manuel est de cinq ans.
On comprend donc que les maisons d’édition aient un intérêt économique aux réformes du programme de l’Éducation nationale. Le Syndicat national de l’édition notait qu’après une année 2023 sans réforme, les éditeur·ices scolaires se préparaient à « faire face aux défis et perspectives des prochaines annéesLes chiffres du Syndicat national de l’édition sont disponibles sur : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/72236-synthese-des-chiffres-de-l-edition-2023-2024.pdf, consulté le 19/03/2025. », impliquées par l’annonce du « choc des savoirs », et la refonte probable des manuels de mathématiques et de français au primaire, et de nombreuses disciplines dans le secondaire.
Ajoutons que le segment de marché consacré aux ouvrages de préparation aux concours de la fonction publique n’est pas négligeable. Après une baisse en 2023, les manuels de préparation au concours de recrutement de professeur·es des écoles, mais aussi aux métiers de la police et de la gendarmerie, « offrent de bonnes perspectives de croissance de ce marché en 2024Ibid. ». Il existe là un public captif, puisqu’il est nécessaire de posséder certains ouvrages pour bien préparer ces concours.
Dernière précision : il ne faut plus entendre depuis longtemps par « édition scolaire » un marché limité aux seuls livres imprimés. Depuis des années, les manuels s’accompagnent de contenus en ligne, de tutoriels, d’animations pour les enfants et les adolescent·es, de propositions de séquences de cours filmées et de divers contenus numériques, particulièrement utiles pour des enseignant·es débordés, en difficulté dans la préparation de leurs cours.
« D’ici cinq à dix ans », annonce Raphaël Taieb, PDG et cofondateur de lelivrescolaire.fr, « on sera sur un marché du manuel scolaire numérisé à 70 % et le modèle économique va évoluer vers de l’abonnement, comme Netflix ou Spotify. Ce qui va impliquer une vraie révolution culturelle pour les acteurs historiques habitués à vendre de gros volumes de livres papier à plus de vingt euros l’unité, contre cinq à dix euros l’abonnement en moyenne. Cette nouvelle donne va lisser la courbe de revenus des éditeurs scolaires avec moins de pics lors des années de réforme et moins de creux, hors réformeNicolas Richaud, « Édition : le manuel scolaire, un marché au début de sa numérisation », Les Échos, 21/08/2022, disponible sur https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/edition-le-manuel-scolaire-un-marche-au-debut-de-sa-numerisation-1782928, consulté le 19/03/2025.. »
Il faut donc à tout prix réinscrire les interventions d’investisseur·euses tel·les que Bolloré dans le contexte de ce marché à la fois juteux et changeant. Le livre scolaire représente 12 % du chiffre d’affaires global du secteur de l’édition, juste derrière les secteurs « Jeunesse » et « Loisirs, vie pratique, tourisme et régionalisme ». Actuellement, six groupes éditoriaux se partagent l’essentiel du marché : Bordas et Nathan, qui appartiennent à Editis (que voulait conserver Bolloré, mais qui échoit désormais à Křetínský), Hachette et Hatier (du groupe Lagardère, racheté par Bolloré), Magnard (du groupe Albin Michel) et Belin. Par l’intermédiaire d’Hachette International, Bolloré contrôle en outre 85 % du marché de l’édition scolaire en Afrique subsaharienne francophone, où son groupe reste très implanté.
Ce marché historique, en voie de transformation avec le numérique, est très attractif ; on comprend que le groupe de Bolloré s’y soit intéressé, celui de Křetínský aussi. Il ne s’agit pas seulement d’une stratégie politique pour agir sur notre culture commune, mais bien d’intérêts économiques convergeant avec ces intérêts idéologiques, dans le cadre d’une institution d’État de plus en plus fragile. Qui sait si, à l’avenir, les décideur·euses politiques, dans les départements ou les régions, ne pourraient pas négocier des contrats préférentiels avec un·e seul·e éditeur·ice, pour un seul et même manuel ? En échange de la gratuité, qui est mise en scène par les départements et les régions comme le résultat d’une action politique forte et concrète, le rapprochement avec tel ou tel groupe éditorial pourrait aussi marquer l’engagement idéologique, la couleur politique du département ou de la région, qui chercherait à promouvoir pour « ses enfants » un certain type d’enseignement.
Livrons-nous à un petit exercice de spéculation. Imaginons qu’au-delà des contradictions qui les traversent, les camps conservateurs, réactionnaires et d’extrême droite s’accordent pour réinvestir le champ qu’ils ont longtemps estimé perdu pour leur cause, celui de la formation des enseignant·es, de la pédagogie et — par voie de conséquence — des manuels en France. Pour l’heure, un tel bloc idéologique se constitue surtout en négatif, en formant une alliance contre le vocable qu’ils ont imposé dans le débat public : le « wokisme », qui couvre un vaste spectre, des études de genre aux études postcoloniales et décoloniales, du féminisme à la pensée critique, de la déconstruction philosophique aux épistémologies situées, voire du marxisme à des pensées libérales de l’extension des droits des individus. Derrière l’apparence d’un bloc d’opposition, une nébuleuse idéologique oppose son attachement à des « contre-récits », qui pourraient donc venir s’insinuer jusque dans les manuels de toutes les disciplines enseignées à l’école, au collège et au lycée.
Dans un premier temps, on pourrait aisément se représenter un phénomène de purge, une sorte de « cancel contre-cancel » paradoxale, visant à expurger des manuels scolaires tout ce qui s’apparenterait pour ce bloc à des thèses intolérantes et délirantes de la gauche et de l’extrême gauche culturelle, qui auraient bénéficié d’une longue hégémonie dans le champ culturel et universitaireC’est la position défendue, par exemple, par Eugénie Bastié dans La Guerre des idées. Enquête au cœur de l’intelligentsia française, Paris, Robert Laffont, 2021.. Appuyé·es par des éditeur·ices en accord avec les principes de leurs nouveaux propriétaires ou actionnaires, dont Vincent Bolloré, des auteur·ices de nouveaux manuels pourraient lancer une chasse à des contenus idéologiques trop marqués : le wokisme défendant la « théorie du genre » dans les sciences de la vie ; le marxisme remettant en cause les fondements de l’économie de marché en sciences économiques et sociales ; mais aussi la « déconstruction des savoirs » en général, qui aurait trop insisté sur un décentrement de la seule littérature française en lettres, sans parler de l’enseignement des crimes et des génocides de l’impérialisme européen, des différentes vagues de colonisation, la repentance exagérée de l’Occident à l’égard de la mise en œuvre de l’esclavage transatlantique…
Cela serait mis en scène comme une forme de rééquilibrage, après que la balance a trop penché à gauche, avec une sorte de sourire en coin : vous avez eu votre moment, maintenant c’est à nous…
Au nom d’une prétendue science « neutre », qui ne devrait pas prendre parti, ou au contraire d’une conception ultra-militante d’un Occident, d’une nation française ou d’une chrétienté qui n’auraient pas à rougir de leur passé, il s’agirait de défendre et d’illustrer le récit de leur glorieux passé plutôt que de le déconstruire. Ce serait là une première phase de censure contre des pensées qui auraient elles-mêmes censuré « d’autres conceptions possibles ». Elle consisterait en un nettoyage de contenus et de formes de pensées critiques, considérées comme héritées de la postmodernité et devenues beaucoup trop dominantes dans l’enseignement.
Remarquons que ce travail de sape hypothétique devrait se faire au nom d’une exigence contradictoire, qui révélerait déjà une tension entre celles et ceux désireux·ses de justifier ce nettoyage par l’idéal d’une conception des savoirs sanctuarisés, neutres, sans prise de parti (des esprits plus libéraux, des zététicien·nes, mais aussi des conservateur·ices attaché·es à une certaine idée de la lucidité scientifique, dégagée des opinions des un·es et des autres), et celles et ceux qui le légitimeraient au nom de la défense de « nous » français·es, occidentaux·ales, chrétien·nes, en assumant cette offensive et leur prise de parti.
L’opération se présenterait certainement comme une sorte de restauration, dans les deux cas, d’un « bon sens » perdu par la gauche culturelle. On déciderait de refonder en nature la binarité des sexes, et puis peut-être plus tard celle des genres en biologie, contre une supposée propagande wokiste et idéologie trans (là encore, certain·es le feraient au nom d’un principe de prudence ou de tradition — « le plus raisonnable est encore de distinguer les hommes et les femmes » —, tandis que d’autres le défendraient au nom d’une vérité de nature, ou de la volonté divine) ; on en reviendrait aux principes « évidents » d’une économie de marché ne questionnant pas ses présupposés, tels que la recherche de la croissance ou la concurrence ; on interdirait l’usage de toute forme d’écriture inclusive, voire de réflexion critique sur le genre dans la langue, en renvoyant à un enseignement simple de la tradition validée par l’Académie depuis des siècles, etc.
À mesure que chacun·e, conservateur·ice, réactionnaire ou esprit d’extrême droite, pousserait dans son sens, grâce à l’appui de maisons d’édition acquises à sa cause, on verrait émerger la revendication plus affirmée de pouvoir écrire, publier et diffuser à l’usage de « nos enfants » des manuels dont on n’aurait pas seulement retranché du contenu idéologique excessif et dangereux, mais dont on proposerait de réécrire positivement les contenus.
Quatre axes de réécriture des manuels scolaires pourraient se dégager, si on veut bien spéculer sur une telle entreprise d’intervention idéologique, appuyée par une fortune comme celle de Bolloré :
– Le premier axe de réécriture serait certainement la revendication fière, assumée, de récits opposés à l’activité déconstructrice et critique. Aussi bien Éric Zemmour que de nombreux éditorialistes conservateur·ices et réactionnaires ont désormais adopté l’expression de « récit nationalPlusieurs historiens ont dénoncé cet usage dans le « tract » collectif Zemmour contre l’histoire, Paris, Gallimard, 2022. », en louant l’historiographie française du XIXe siècle, de Banville aussi bien que de Renan, qui aurait été attachée à la construction et à l’écriture d’un imaginaire de la nation. Ce récit censé présenter aux enfants une continuité entre des populations, des territoires, des régimes pourtant très hétérogènes, forgerait ainsi l’identité française, l’accompagnerait du tableau de ses grandes réalisations, assumerait ses crimes sans s’en excuser comme le prix à payer pour sa grandeur, etc. L’expression de « roman national », popularisée par Pierre NoraPierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984–1992., est désormais utilisée pour contrer une historiographie qui, de l’École des Annales à la micro-histoire, aurait abandonné la personnalisation de l’histoire, les « grands hommes », au profit des effets de structure et de la longue durée. Mais elle est aussi mobilisée contre toute forme de critique historique un peu trop scrupuleuse, au nom de la simplification nécessaire d’un grand récit qu’il faudrait livrer à l’esprit des enfants de la nation, pour leur apprendre leur identité et forcer le respect à l’égard de celle-ci. Opposée aux chicaneries de l’historiographie, cette conception prospère sur le terreau d’un fort ressentiment à l’égard de savoirs critiques, qui auraient participé à la décomposition de l’esprit national en n’apprenant pas aux enfants une culture commune leur permettant de faire corps.
On peut facilement se représenter l’effet d’un tel recours au « grand récit » national dans des manuels. En histoire mais aussi en littérature, il acterait le choix de tourner le dos à la recherche contemporaine et à toute relecture critique du canon, pour en revenir aux « grands textes » comme au temps du Lagarde et MichardSur les constructions idéologiques du manuel Lagarde et Michard, voir par exemple l’article de Jean-François Halté et André Petitjean, « Pour une théorie de l’idéologie d’un manuel scolaire. Le Lagarde et Michard : le cas Diderot », Pratiques : linguistique, littérature, didactique, nº 1–2, 1974, p. 43–64. : le théâtre de Molière, Racine et Corneille, le roman psychologique et naturaliste du XIXe siècle.
Une telle restauration irait sans doute de pair avec la canonisation de certain·es auteur·ices contemporain·es — on imagine aisément que Michel Houellebecq y serait présenté comme le grand auteur français de la fin du XXe et du début du XXIe siècle.
– Deuxième axe de réécriture : la promotion acharnée de la hiérarchisation contre le relativisme, de la verticalisation contre l’horizontalisation des savoirs. On peut imaginer, en sciences humaines, le glissement qu’opérerait un recours systématique aux notions de « majeur » et de « mineur », pour qualifier des arts, mais aussi des pratiques, voire des cultures. Il y a le haut et le bas, le savant et le populaire, le grand et le petit…
– Troisième axe : une certaine prétention à la rationalisation. Comme nous l’avons déjà dit, la mise en scène d’un retour à la raison contre des excès gauchistes pourrait prendre l’apparence de la défense d’une science neutre, opposée au « standpoint » féministe par exemple, et aux savoirs situés ; mais il pourrait aussi se draper dans un recours à l’efficacité, à un certain « bon sens » ou « sens des réalités » pour préparer les élèves au marché du travail, dans les sciences économiques, plutôt que d’encourager la critique et l’imagination d’autres formes d’organisations sociales, tenues pour hautement irréalistes. Au nom d’un « sens commun », contre à la fois l’influence jugée néfaste de la critique, de la contre-culture et de pensées de l’émancipation, on proposerait d’enseigner avant tout aux enfants des contenus simples et raisonnables, leur permettant de mieux s’insérer plus tard dans un monde concurrentielOn peut y voir une expression du « réalisme capitaliste », défini et critiqué par Mark Fisher, Le réalisme capitaliste. N’y a-t-il pas d’alternative ?, Montreuil, Entremonde, 2018..
– Il y a un quatrième et dernier axe à envisager, si l’on se rappelle qu’avec Vincent Bolloré on a affaire à un propagandiste d’une forme de catholicisme traditionaliste, qui considère la foi comme un guide nécessaire dans la vie. Ce pourrait être l’introduction ou la réintroduction d’idées proprement religieuses dans des manuels d’histoire aussi bien que de sciences : on pense à l’« hypothèse créationniste » opposée au cadre de pensée évolutionniste et darwinien, qui pourrait n’être plus présenté que comme « une autre hypothèse ». L’insistance de certains médias dont Bolloré est le propriétaire sur le discours parascientifique de « chercheur·euses » exposant leurs « découvertes » sur la possibilité d’une vie après la mort« “Au-delà des frontières de la vie et de la mort” : des scientifiques découvrent un « troisième état de l’existence » », CNews, 18/09/2024, disponible sur : https://www.cnews.fr/science/2024-09-18/au-dela-des-frontieres-de-la-vie-et-de-la-mort-des-scientifiques-decouvrent-un, consulté le 19/03/2025., discutant doctement de preuves de l’existence de Dieu par la cosmologie et la physique quantiqueÀ noter que l’un des auteurs du livre Dieu, la science, les preuves. L’aube d’une révolution, Paris, Guy Trédaniel Éditeur, 2021, n’est autre que Michel-Yves Bolloré, « ingénieur, entrepreneur et auteur indépendant » d’après son site personnel, et frère de Vincent Bolloré., pourrait nous incliner à penser qu’ultimement, à l’horizon d’une éventuelle réécriture de manuels scolaires, le camp idéologique soutenu par quelqu’un comme Vincent Bolloré pourrait bien vouloir porter le combat jusque dans les sciences de la vie, la physique et la philosophie, pour y défendre une sorte de « fidéisme » : les vérités morales, sociales aussi bien que naturelles, ne pourraient en définitive être fondées sur rien d’autre que la foi en la Révélation.
Il va de soi qu’une poussée extrême en ce sens, jusque dans les manuels à destination des enfants ou des adolescent·es, produirait une réaction au sein d’un camp très hétéroclite, uni seulement contre le spectre du wokisme ; aussi faut-il bien se faire une image du système de poids et de contre-poids idéologiques à l’œuvre dans le champ — plutôt que le camp — qui pourrait penser dans un premier temps profiter comme d’une aubaine de l’influence d’un oligarque tel que Bolloré pour reprendre pied dans le domaine de l’enseignement.
Arrêtons là notre exercice de spéculation. D’un simple exercice d’imagination, appuyé par l’état actuel d’une Éducation nationale très affaiblie et les intérêts économiques d’un grand patron aux opinions politiques affichées et au projet idéologique clair, qui fédère derrière lui conservateur·ices, réactionnaires et extrême droite en guerre contre ce qu’iels appellent le « wokisme », on peut tirer la quasi-certitude qu’il n’y aura pas en France de grand basculement soudain et que, même si Vincent Bolloré ou un·e autre oligarque, porté·e par la conjonction entre ses intérêts économiques et un projet idéologique, s’emparait de la grande majorité des maisons d’édition scolaire en France, nous ne nous retrouverions pas du jour au lendemain avec des manuels fascistes destinés à rééduquer les enfants ; c’est, croyons-nous, plus insidieux que cela.
Sans doute faut-il donc sortir d’une indignation éruptive, mais éphémère sur les réseaux sociaux et dans les médias, à l’occasion de la révélation de chiffres incertains sur une possible prise de contrôle de l’édition scolaire par Bolloré.
Ce n’est pas sur ce terrain, celui des éditorialistes, que sera gagné ce combat. Le spectre du grand méchant « Bolloré » n’est, en ce qui concerne la question des manuels scolaires, que le symptôme d’une Éducation nationale affaiblie par la crise des recrutements, le manque de moyens, la dévalorisation du métier, la précarisation, le recours systématique à des contractuel·les, qui est en train d’accomplir la transformation, selon les vœux d’Emmanuel Macron, de l’enseignement comme « métier » à l’enseignement comme « missionEmmanuel Macron, « Discours d’ouverture de la réunion des recteurs d’académie », 25/08/2022 : « Le métier de professeur n’attise plus le rêve et que les vocations se tarissent et que c’est la cause profonde de la situation que nous connaissons dans cette rentrée comme dans les précédentes, mais qui doit aussi conduire collectivement à sortir des débats datés. Il y a des gens qui sont de formidables enseignants et qui sont contractuels, et c’est parfois très intelligent de prendre des contractuels pour faire certaines missions. Ce n’est pas non plus un tabou et c’est vrai pour l’Éducation nationale comme pour toutes les tâches, y compris les plus régaliennes qui soit. » ». Une mission, certes, mais d’intérim : une pige.
À mesure de cet affaiblissement, la droitisation certaine du corps enseignant forme un terreau fertile où le désir des conservateur·ices, des réactionnaires et des stratèges d’extrême droite de se réimplanter, par une guerre culturelle, dans le champ longtemps tenu pour perdu de la culture, de l’art, et surtout de l’enseignement prend tout son sens.
Rappelons à ce sujet qu’aux élections législatives de 2024, plus de 20 % des enseignant·es auraient voté pour le Rassemblement national, alors qu’en 2012 le Front national n’obtenait guère que 3 % de leurs suffragesVoir Philippe Watrelot, « Vote RN : la fin de la forteresse enseignante », Alternatives Économiques, 29/10/2024, disponible sur : https://www.alternatives-economiques.fr/philippe-watrelot/vote-rn-fin-de-forteresse-enseignante/00112741, consulté le 19/03/2025.. C’est sur fond de cette sensibilité de plus en plus grande d’un corps enseignant transformé, hétéroclite, en partie titulaire et vieillissant, en partie jeune et précarisé, qu’il faut comprendre la véritable menace d’une intervention droitière et extrême-droitière dans les contenus d’enseignement.
Pour l’heure, la résistance des chercheurs et chercheuses, des formateurs et formatrices, des syndicalistes dans le domaine de l’éducation et dans la plupart des disciplines du savoir, pourrait être suffisante pour empêcher une réécriture pure et simple de l’histoire dans nos manuels scolaires.
Au fond, il suffit de se demander quelles thèses contemporaines à peu près sérieuses, validées par la communauté scientifique, pourraient asseoir la légitimité de la restauration de récits nationaux prétendument fondés, d’une re-hiérarchisation forcenée des savoirs, des pratiques, des cultures, d’un recours à un simple « bon sens » légitimant en vrac la binarité de genre, l’évidence naturelle du marché concurrentiel, voire d’hypothèses créationnistes et de formes ultra-autoritaires de fidéisme…
Pour l’heure, une hypothétique restauration s’accompagnerait surtout d’un retour en arrière vers des autorités passées, à défaut de pouvoir se fonder dans les savoirs actuels, et puis, elle aurait beaucoup de mal à s’accorder sur des contenus défendables jusqu’au bout, présentables à des enfants et des adolescent·es dans un cadre scolaire ; il existe suffisamment de ressources intellectuelles, savantes et vulgarisées, pour s’y opposer.
Mais la recherche et le monde intellectuel sont eux aussi fragiles. Et si le travail de sape actuel venait, sur une ou deux générations, à épuiser jusqu’à un point de rupture les pensées critiques, les pensées d’émancipation, les sciences humaines et sociales, les épistémologies actuelles, le garde-fou ne tiendrait plus.
Pour dépasser une indignation médiatique, qui accorde sans doute trop à la puissance de Bolloré et personnalise les intérêts et les idées qu’il représente, il est important de comprendre les positions en jeu et comment on en est arrivé là. S’il est possible aujourd’hui d’envisager un coup économique ou idéologique de sa part, c’est du fait de trente à quarante ans de destructuration profonde de l’Éducation nationale. Réagir en légiférant contre toute situation monopolistique dans l’édition, en particulier l’édition scolaire, ne changerait rien à l’affaire, et donnerait plutôt des armes au camp agresseur, désormais en droit de se désigner comme agressé, empêché, censuré — les fidèles de Vincent Bolloré sont des habitué·es de cette stratégie, comme on l’a vu avec le non-renouvellement de la fréquence de sa chaîne C8 par l’Arcom. Cela ne ferait peut-être qu’accroître sa force idéologique, à terme, sans beaucoup retenir sa force économique, qui aura bien d’autres débouchés.
Nous pensons qu’il nous faut d’abord réapprendre à connaître et comprendre un tel adversaire. Il nous semble important de mesurer son caractère idéologiquement composite, afin de jouer sur ses contradictions. En réalité, nous ne sommes pas du tout face à un camp homogène et cohérent. L’effet de masse et de bloc ne nous apparaît que tant que différents camps s’accordent contre ce à quoi nous nous identifions. Mais dès qu’ils doivent abattre leurs cartes, proposer leur propre récit idéologique — par exemple proposer d’autres contenus d’éducation —, des tensions intenables ressurgissent entre des esprits très attachés à la laïcité et des propagandistes catholiques, traditionalistes ou intégristes, mais aussi entre des conservateur·ices, attaché·es aux traditions, à ce qui leur semble la mesure du bon sens, et des réactionnaires exalté·es, voire des accélérationnistes, des turbo-fascistes, désireux·euses de renverser la table. Leurs conflits internes rendraient difficile l’élaboration d’un programme commun, plus encore celle de manuels scolaires sur lesquels iels s’entendraient.
Si, dans notre hypothèse spéculative, Bolloré s’emparait des manuels scolaires français, celles et ceux qui poussent pour l’instant derrière lui, avec lui et autour de lui, se déchireraient assurément quant à la réécriture de l’histoire, des sciences, de la littérature ou de l’économie…
Mais il ne s’agit pas simplement d’attendre et de laisser agir des contradictions qui s’accentueraient avec le pouvoir pris par un tel assemblage idéologique ; il faut pouvoir, dès maintenant, aller pointer les inconsistances de ce qui nous semble un peu trop un camp ennemi cohérent et uni.
Surtout, il nous semble indispensable de nous réapproprier l’Éducation nationale. Et par « nous », nous entendons ici, le plus largement possible, tous ceux et toutes celles qui tiennent à l’émancipation individuelle et collective plutôt qu’à l’autorité, l’ordre, de « justes inégalités » et leurs maintiens. Or cette réappropriation suppose de ne pas abandonner l’institution au nom d’une opposition de principe à l’école, machine disciplinaire à reproduire les inégalités. On peut, comme dans des traditions anarchistes ou autonomes, mener à bien la critique radicale de l’institution scolaire et pour autant ne pas la déserter, ce qui revient à la laisser à ceux et celles qui l’utiliseront pour la renforcer et détruire toute possibilité de s’y opposer ou de développer des formes d’éducation alternative.
Le cas des manuels est de ce point de vue emblématique. Comme nous l’ont appris diverses formes de critiques de l’idéologie, un manuel représente une des formes privilégiées de l’autorité institutionnelle sur les savoirs, du canon, des normes de la langue, de l’histoire officielle, etc. En ce sens, il est un objet légitime d’attaques par celles et ceux qui souhaitent l’émancipation. Cependant, s’il n’est pas seulement critiqué mais abandonné, tout à fait désinvesti au profit de formes alternatives, à l’écart des institutions éditoriales et éducatives, alors il sera effectivement laissé à l’adversaire, dont il deviendra une arme redoutable.
Il nous semble donc qu’il faut, devant la perspective de la pénétration d’idéologies et d’imaginaires conservateurs, réactionnaires et d’extrême droite dans les institutions éditoriales et éducatives, dans les contenus mêmes d’enseignement, agir doublement. Il faut mener une critique interne et externe, sans nous laisser prendre par notre propre contradiction entre refus et défense de l’institution scolaire. Il faut que toute idéalisation de l’institution scolaire et de ses manuels comme un sanctuaire de l’esprit critique et de l’émancipation se trouve contrebalancée par une critique et des pratiques alternatives, par la possibilité d’autres formes d’éducation ; mais il faut aussi, pour ne pas abandonner les classes populaires, et tous ceux et toutes celles pour qui l’Éducation nationale est un des rares moyens de s’émanciper — y compris de l’Éducation nationale elle-même, de ses normes et de ses contraintes —, rester dans l’institution, y garder pied.
Très concrètement, cela signifie que face à la tentation grandissante d’une désertion pure et simple par des étudiant·es, des militant·es, des personnes attachées à l’émancipation, il faut réaffirmer combien nous avons besoin d’enseignant·es, de formateur·ices, de chercheur·euses, de personnes écrivant des manuels de lecture, de sciences, d’histoire, d’économie, du primaire au supérieur. Et cela n’empêche absolument pas d’en conduire aussi la critique radicale.
Pour que les manuels scolaires — qui sont l’une des forges essentielles des normes, des canons, des formes dominantes — ne soient pas livrés à l’ennemi, il faut simultanément, et de façon coordonnée, les défendre et les attaquer, les faire et les défaire.
Tout, en fait, est bon à prendre pour résister à une décomposition de l’Éducation nationale. Car cette décomposition ne signifiera certainement pas qu’on s’en émancipera d’autant mieux mais qu’on deviendra prisonnier·es d’une institution malade. Le problème n’est pas tant que son autorité sera affaiblie — ce dont il faudrait se réjouir ! — mais qu’elle sera à la fois de plus en plus faible et de plus en plus autoritaire.
Pas question d’idéaliser les manuels. Il existe mille manières d’apprendre pour se libérer, évidemment. Il ne faudrait pas rester piégé·es dans la forme livresque du manuel, par exemple, mais prendre en compte tous les autres formats de la formation, défendre les expérimentations à part de l’institution, qui permettent aussi aux enseignants de se former, aux élèves de s’éduquer, des expériences collectives aussi bien que des vidéos YouTube, des chaînes Twitch autant que des lycées autogérés, des podcasts, des séminaires, des associations et des communautés… Mais il faut aussi tenir aux manuels scolaires, les pratiquer et les écrire, ne pas les livrer pieds et poings liés à l’hypothèse d’une restructuration éditoriale défavorable, agressive.
Ne surestimons pas le danger d’une main basse sur les manuels scolaires ; mais ne sous-estimons pas ce que ça nous dit de l’état de l’école. La percée conservatrice, réactionnaire, d’extrême droite dont Bolloré est l’un des emblèmes, pourrait être l’occasion pour nous de sortir d’une sorte de sommeil dans le camp de l’émancipation sur la question de l’éducation des enfants (comment et pourquoi en avoir ; comment et pourquoi les élever) ; ce devrait être l’occasion pour toutes et tous de prendre la mesure de ce qui a été abimé et affaibli dans l’Éducation nationale, dont l’hypothétique menace de l’intervention d’un oligarque d’extrême droite n’est jamais qu’un symptôme parmi d’autres. Ce serait le moment de nous refabriquer de véritables manuels pratiques de pédagogie ; car, face à l’ombre portée d’un Vincent Bolloré jusque dans la formation et l’enseignement, il importe moins de défendre notre éducation telle qu’elle est que telle qu’elle pourrait être.
Éditer en féministe —
On assiste depuis plusieurs années à une multiplication des publications et des maisons d’édition féministes ou se revendiquant féministes. Si on peut se réjouir d’une telle déferlante, on peut toutefois se questionner sur ces différentes initiatives dans un monde de l’édition gouverné par des milliardaires conservateurs. Qu’est-ce que cela signifie vraiment d’éditer en féministe aujourd’hui ? Et quel avenir pour ces initiatives face à la montée des idéologies réactionnaires et à la concentration des pouvoirs culturels ?
Les éditions féministes, une histoire
L’histoire des éditions féministes, qu’il s’agisse des livres ou des revues, n’est pas un long fleuve tranquille. Elle suit les méandres des mouvements féministes, leurs flux et leurs reflux. Cependant, elle ne se limite pas aux mouvements eux-mêmes, au contraire, elle est étroitement liée aux mouvements sociaux plus globaux. Ce qui n’est pas sans jouer sur les politiques éditoriales, celles des grandes maisons comme celles des petit·es éditeurices et a fortiori des éditeurices dédié·es.
Les éditions féministes, comme toutes les éditions engagées, varient en nombre selon la période. Le féminisme de la première vague, dès le XIXe siècle, plus que par des ouvrages, s’est davantage exprimé par le biais de revues et de journaux — spécialisés ou non — liés aux luttes pour les droits des femmes, le droit de vote et le droit de se présenter aux élections notamment (on ne parle pas ici des ouvrages « féminins » dévolus à l’apprentissage des rôles de mère-épouse). On peut citer The Lily, journal américain (1849–1856), ou, en France, La Citoyenne, journal d’Hubertine Auclert (1881–1891).
Il faut attendre les mouvements féministes de la deuxième vague pour voir entrer en lice les maisons d’édition, qu’elles soient directement liées aux mouvements ou dépendantes des grands groupes. Ce qui différencie ces deux périodes éditoriales, c’est sans doute les années 1970 à partir desquelles se développent parallèlement l’activisme militant et la recherche scientifique : les femmes entrent à l’université, on étudie la condition féminine (par exemple, Michelle Perrot crée le cours « Les femmes ont-elles une histoire ? » en 1973), on assiste à l’essor des sciences humaines et sociales en édition. C’est une explosion du nombre de titres et de collections consacrées dans les grandes maisons (Payot fait traduire Phyllis Chesler, Sheila Rowbotham et Mary Wollstonecraft, Robert Laffont publie Histoire de la répression sexuelle, des collections sont créées : « Libre à elles » au Seuil, « Condition féminine » au Mercure de France, ou encore « Mémoires des femmes » chez Syros) et, évidemment en moindre nombre, des éditions consacrées aux féminismes (Éditions Des femmes, éditions Tierce, etc.Fanny Mazzone, « Féminisme, genre et sexualités, politiques éditoriales et traductions depuis les années 1960 jusqu’à MeToo », Politika, 23/01/2025, disponible sur : https://www.politika.io/fr/article/feminisme-genre-sexualites-politiques-editoriales-traductions-annees-1960-jusqua-metoo, consulté le 26/03/2025.). Il est certain que si les grandes maisons d’édition surfent sur la vague, il faut souligner que les directeurices de collections de ces maisons sont souvent partie prenante des mouvements militants. On peut citer Colette Audry pour la collection « Femme » chez Denoël, Luce Irigaray pour la collection « Autrement dites » chez Minuit ou Huguette Bouchardeau chez SyrosAudrey Lasserre, Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970–1981), thèse de doctorat en littérature et civilisation françaises, Université Sorbonne Nouvelle, 2014..
Cette floraison de collections, de revues et de livres perdure jusque dans les années 1980. Durant cette décennie, le mouvement social est marqué par les luttes sur l’IVG, contre le viol, le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), le Planning familial, les collectifs militants divers dont la Coordination des femmes noires. 1981, c’est l’élection de François Mitterrand et la création du ministère du Droit de la femme. S’ensuit, en tout cas durant la première période du quinquennat, une institutionnalisation (très relative) de collectifs militants. Mais les années 1980, c’est très vite le choc pétrolier, la politique d’austérité, l’apparition du chômage de masse. On assiste également à la baisse des subventions pour les études féministes à l’université, le déclin de la prégnance de la pensée marxiste et le recul des sciences humaines et sociales en généralANEF, Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche. Livre blanc, Paris, La Dispute, 2014.. Durant cette période, c’est un relatif calme plat du côté des grandes maisons d’édition. Bien peu des collections dédiées dans ces maisons se maintiennent. « Mémoires des femmes » chez Syros ou les Éditions Des femmes font partie des rares à résister.
La contestation féministe mais aussi sociale est en berne jusqu’en 1995. Il faut noter toutefois que dans les années 1990, on voit apparaître, avec les mouvements lesbiens, une activité éditoriale dédiée. Par exemple, la collection « Chemin des dames » aux éditions Gay Kitsch Camp.
1995 voit la grande grève de la Fonction publique contre le plan Juppé sur les retraites et la Sécurité sociale. Simultanément (mais non en conséquence), le 25 novembre 1995, 40 000 personnes vont défiler à Paris dans une manifestation pour les droits des femmes à l’appel de la Coordination pour le droit à l’avortement et à la contraception.
Un renouveau revendicatif commence. Les mouvements féministes commencent à parler en termes de « genre » et nourrissent de plus en plus leur réflexion grâce à des ouvrages états-uniens. Une période de traductions s’amorce timidement. Par exemple, ce n’est qu’en 2005 que Judith Butler (Trouble dans le genre, La Découverte) ou Catharine A. MacKinnon (Le Féminisme irréductible, Éditions des femmes) seront traduites. C’est aussi la création, en 1996, de la « Bibliothèque du féminisme » à L’Harmattan, ou celle, en 2000, de la collection « Le genre du monde » à La Dispute, dont le premier titre sera La mixité au travail de Sabine Fortino, paru en 2002.
En 1995, on voit apparaître les prémices de la troisième vague des mouvements féministes. De nouveaux thèmes apparaissent, tant universitaires que militants : la question des sexualités, des approches postcoloniales et intersectionnelles, de l’écologie ; on note un accroissement significatif des traductions.
En 2002, l’Alliance internationale des éditeurs indépendants est créée. En 2010, les Éditions iXe sont fondées. Au niveau sociétal, c’est la loi sur le mariage pour tous, les ABCD de l’égalité.
En 2017, on assiste à un tsunami #MeToo. C’est, tant en France qu’à l’international, l’irruption des dénonciations du harcèlement sexuel et de toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Les répercussions sur les thèmes du militantisme et de la recherche féministe sont très importantes. Elles le sont aussi sur le monde de l’édition. Il suffit de taper sur Google « #MeToo et l’édition » pour voir apparaître une kyrielle d’articles, certes plus ou moins informés mais reprenant tous le même thème d’une déferlante féministe dans l’édition : ainsi, le 14 octobre 2018 Livres Hebdo publie un article de Pauline Croquet : « #MeToo, du phénomène viral au “mouvement social féminin du XXIe siècle” » ; dans L’Express du 29 mai 2021, c’est « Le féminisme, nouvelle conquête de l’édition », de Pauline Leduc ; le 10 mars 2021, une enquête de Livres Hebdo a pour titre : « Le boom féministe : #MeToo, la déferlante éditoriale en chiffres ».
Entre 2017 et 2020, la production de livres consacrés aux femmes en non-fiction a augmenté de 15 %Cécilia Lacour, « Le boom féministe : #MeToo, la déferlante éditoriale en chiffres », Livres Hebdo, 10/03/2021, disponible sur : https://www.livreshebdo.fr/article/le-boom-feministe-metoo-la-deferlante-editoriale-en-chiffres, consulté le 26/03/2025.. Cela dit, il est certain que cette profusion n’a bien souvent rien de vertueux. L’opportunisme plutôt que l’engagement féministe est pointable pour beaucoup. En témoignent d’ailleurs les productions sous le label « Femmes » (ou « Femme ») qui mêlent allègrement les ouvrages de développement personnel aux ouvrages féministes. On retrouve cela, par exemple, dans les collections de livres pratiques comme « Bibliothèque pratique Femmes d’aujourd’hui » chez Albin Michel, « Profession femme » chez First ou la collection « Les Insolentes » chez Hachette Pratique.
Deux autres bémols doivent être mentionnés. Tout d’abord le backlash que l’on peut observer depuis quelques années avec la campagne réactionnaire menée contre les ABCD de l’égalité, contre la soi-disant théorie du genre et le wokismeSimon Massei, Discipliner les banlieues ? L’éducation à l’égalité des sexes dévoyée, Paris, La Dispute, 2024.. Et aussi, la question de la concentration des pouvoirs culturels, la mainmise de Bolloré (et d’autres comme Daniel Křetínský, Bernard Arnault ou Rodolphe Saadé) sur des maisons d’édition, des médias, des systèmes de diffusion et de distribution. Il est évident que ces milliardaires défendent, à travers l’édition, des valeurs parfaitement opposées à celles des féminismes. Les féminismes ont un fort potentiel corrosif par rapport aux systèmes de domination, alliant une dimension scientifique à un engagement militant. Ils se caractérisent, sinon comme internationalistes, du moins transnationaux, ce qui permet une circulation des idées. Car ils avancent les linéaments pour penser une autre société, libérée des rapports de domination. C’est ce qu’exprimait en quelques mots, la présentation de la collection « Le genre du monde » de La Dispute : « Sous ce label, sont publiés des livres qui en explorant les rapports hommes femmes contribuent à renouveler la compréhension de la société. » C’est bien pourquoi les féminismes sont si violemment attaqués par les régimes autoritaires.
Bolloré, un empire contre les féminismes
Il est évident que les prises de position des éditions féministes s’opposent frontalement à l’empire Bolloré et aux idées de l’extrême droite. Vincent Bolloré, magnat des médias et de l’édition, incarne une vision réactionnaire du monde, fondée sur un conservatisme patriarcal et une idéologie identitaire. Son empire médiatique et culturel, qui s’étend des chaînes de télévision (C8, CNews, Canal+) aux maisons d’édition (l’ensemble du groupe Hachette regroupant plus de quarante maisons d’édition), en passant par la communication, le cinéma ou la radio lui permet de diffuser massivement des idées traditionalistes et anti-féministes, tout en muselant les voix dissidentes.
Bolloré défend un modèle de société patriarcal, glorifie la famille traditionnelle et s’oppose aux droits des femmes, comme en témoignent ses positions anti-IVG (avec la diffusion du film Unplanned en 2021 et sa rediffusion lors de la dernière émission de C8) ou son opposition au mariage homosexuel. La revue Silence révèle également le sort subi par les femmes qui travaillent dans les plantations du groupe agro-industriel Socfin, détenu en partie par Bolloré. Ces femmes subissent quasi quotidiennement des violences sexuelles et sexistes sans qu’aucune enquête importante ou sanction significative n’ait été menéeLola Keraron, « Cameroun : face aux violences de Socfin, les femmes résistent ! », Silence, nº 540, 2025, p. 5–8.. Son soutien à Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022, où il se déclare « conscient du danger de remplacement de la civilisation« Éric Zemmour rend “hommage” à Vincent Bolloré et le qualifie de “patriote qui veut défendre la France” », Le Monde, 22/01/2022. », révèle aussi son alignement avec les thèses de l’extrême droite. Bolloré défend une France qu’il imagine menacée par l’islam, le wokisme, et les mouvements progressistes. Il désigne comme boucs émissaires les immigré·es, les LGBTQIA+, les écologistes et les « bobos », alimentant ainsi un discours de division et de peur.
Cette idéologie réactionnaire s’accompagne d’actions concrètes pour imposer sa vision : l’éviction de Zaho de Sagazan de la programmation radiophonique d’Europe 1 après qu’elle a adressé sur Instagram « un gros mais vraiment gros, gros fuck à Cyril Hanouna », ou encore l’arrêt du financement du film Grâce à Dieu de François Ozon, qui dénonce les abus sexuels dans l’Église catholiqueMarie Bénilde, Le péril Bolloré, Paris, La Dispute, 2025, p. 41.. Sur ces chaînes d’information on a pu et on peut voir des figures médiatiques proches de l’extrême droite comme Jean-Marc Morandini, Cyril Hanouna, Éric Zemmour ou encore Pascal Praud. Il nomme Lise Boëll, l’éditrice d’Éric Zemmour, à la tête de Fayard, qui publie quelques mois plus tard la biographie de Jordan Bardella, figure montante du Rassemblement national. Ces décisions montrent comment Bolloré utilise son influence pour étouffer les débats qui dérangent son idéologie conservatrice. L’empire Bolloré est marqué par la suppression systématique des voix de gauche dans les médias qu’il contrôle. Présent dans la presse écrite, la radio, la télévision, mais aussi dans l’édition, la communication et le cinéma, Bolloré est devenu un acteur central de la diffusion des idées réactionnaires en France.
Il est donc essentiel pour nos maisons d’édition engagées et féministes de continuer d’exister afin de lutter contre l’empire Bolloré et ses sicaires. Nous devons dénoncer leurs actions, reprendre les arguments et les démonter mais aussi nous donner des armes pour argumenter et battre tant leur l’idéologie que leur silence.
L’édition sous influence
Comment les idées d’universalisme, d’égalité des genres ou de justice sociale peuvent-elles être relayées lorsque Bolloré et ses semblables possèdent une grande partie des médias, ainsi qu’un nombre impressionnant de maisons d’édition ? Ces groupes disposent de systèmes de distribution gigantesques : des points de vente, une logistique capable de livrer un livre n’importe où sur le territoire en quarante-huit heures, et une force de frappe marketing qui inonde les libraires et les lecteurices d’information. Face à cette machine bien huilée, les voix dissidentes sont écrasées et marginalisées.
Malgré la multiplicité des maisons d’édition détenues par Bolloré, celles-ci défendent sensiblement les mêmes idées, le même idéal de société conservateur. On assiste à une homogénéisation des discours. Dans le domaine de l’édition féministe, les grands groupes profitent du travail de défrichage des petites maisons indépendantes et de la déferlante du mouvement #MeToo pour placer leurs livres en librairie. L’histoire des féminismes, comme celle de l’édition féministe, s’écrit par vagues. On assiste, depuis quelques années, à une explosion de nouveaux titres, de collections et de maisons d’édition consacrées aux féminismes. Si cette multiplicité est à saluer, les grandes maisons d’édition, elles, surfent sur la vague féministe tout en continuant à publier des livres intrinsèquement misogynes ou des auteurs problématiquesMarie Kirschen, « Les féministes jouent livre sur table », Revue du Crieur, nº 4, 2024, p. 76-99.. Leur approche est souvent commerciale, privilégie les ouvrages de développement personnel ou de bien-être au détriment des livres de sciences humaines et des analyses critiques. Leurs choix éditoriaux sont dictés par des impératifs de rentabilité, ce qui les empêche de dénoncer un système dont elles profitent pleinement. Mais que restera-t-il lorsque la vague #MeToo sera passée de mode ? Avec Bolloré et les autres milliardaires à la tête des maisons d’édition mainstream, on peut craindre un retour de bâton conservateur, effaçant des années de luttes et de réflexions. Ce backlash a même déjà commencé avec le développement des théories masculinistes. Par exemple, Hachette Book Group lance deux nouvelles collections, « Basic Venture » et « Basic Liberty », dédiées à publier des auteurs et des textes conservateursFanny Guyomard, « Aux États-Unis, Hachette Book Group lance une nouvelle marque éditoriale à la ligne conservatrice », Livres Hebdo, 14/11/2024, disponible sur : https://www.livreshebdo.fr/article/aux-etats-unis-hachette-book-group-lance-une-nouvelle-marque-editoriale-la-ligne, consulté le 26/03/2025.. En 2022, Laura Magné et Laurent ObertoneLaurent Obertone soutient Éric Zemmour, il a été invité d’honneur de l’université d’été du parti Reconquête. Il espère que « la France ait un Trump ou un Salvini ». créent la maison d’édition Magnus qui a publié le livre Transmania de Marguerite Stern et Dora Moutot. On peut également citer l’avènement d’influenceurs masculinistes revendiquant des théories qui naturalisent et hiérarchisent les genres comme Thaïs d’Escufon ou Papacito.
En revanche, les maisons d’édition indépendantes prennent des risques : elles multiplient les discours, explorent de nouvelles formes, et donnent la parole à des autrices et des courants féministes souvent marginalisés. Elles défendent une vision plurielle et engagée du féminisme, loin des logiques de marché. Mais face à la puissance de frappe des grands groupes, leur survie est fragile.
Éditer en féministe : un acte de résistance
Lutter contre Bolloré, c’est continuer à produire des ouvrages féministes, queer, matérialistes qui permettent de montrer que le système de domination est global, que chaque rapport social est dépendant des autres, qu’ils se construisent en interaction et se renforcent les uns les autres. Alors l’entrée par le genre est un coin enfoncé dans le système et permet de démontrer que vouloir tendre vers l’émancipation n’a de sens que si l’on pense cette dernière du double point de vue individuel et collectif et que pour la construire, les individus doivent acquérir tant une conscience de genre qu’une conscience de classe. Le système patriarcal, intrinsèquement lié au capitalisme, ne peut être combattu de manière isolée. Bolloré incarne parfaitement cette alliance. Lutter contre lui, c’est donc lutter contre ce qu’il représente : une concentration de pouvoirs qui étouffe les voix progressistes et perpétue les inégalités. Éditer en féministe implique de publier des textes qui interrogent les rapports de pouvoir, les systèmes d’oppression et les normes patriarcales et d’aller à contre-courant en faisant connaître et reconnaître la fantastique richesse des études féministes en sciences humaines. C’est montrer leurs capacités d’invention, leurs pouvoirs heuristiques pour penser et repenser les grands problèmes sociaux et intervenir dans les débats qui traversent les études de genre.
C’est aussi démonter les faux-semblants. C’est analyser, par exemple, le procès Mazan sans s’arrêter au courage, bien réel par ailleurs de Gisèle Pélicot, mais aussi en démontrant que tous les hommes ne sont pas terrifiés par ces viols, qu’au contraire, certains contre-attaquent. L’un des avocats des accusés, avec un sourire, a lancé aux militantes féministes : « Mon client a un message pour vous, à toutes ces hystériques, ces mal embouchées : merde ! Voilà, mais avec le sourire. » Éditer en féministe signifie reprendre ces débats, les approfondir, et les rendre accessibles à toustes, qu’il s’agisse du consentement, de la culture du viol, des stratégies d’action, etc.
Lutter contre Bolloré, c’est aussi créer des espaces sûrsPar exemple, Shed publishing annonce qu’un lieu va être créé à Marseille « dédié à l’édition et à la diffusion des idées : une salle de lecture, un espace d’exposition, de débats, de rencontres, de projections […] avec une programmation artistique, intellectuelle et militante antiraciste, décoloniale et queerféministe ». Mais aussi la création du comité « Éditer en féministe » ou la réouverture de Violette and Co, librairie féministe à Paris., à l’abri des logiques de rentabilité et du backlash conservateur. En continuant à éditer et à promouvoir des ouvrages féministes, nous assurons la diffusion des idées progressistes, même dans des contextes politiques et idéologiques hostiles. Ces espaces deviennent des refuges pour les autrices, chercheuses et militantes souvent marginalisées dans l’édition traditionnelle et mainstream. Donner la parole à ces voix, c’est démocratiser l’accès aux savoirs féministes, faire émerger des récits alternatifs qui remettent en question l’ordre établi, et mettre à disposition du plus grand nombre les outils nécessaires pour transformer la société. Éditer en féministe, c’est lutter contre toutes les formes de domination. Face à l’empire Bolloré, cette démarche est plus que jamais nécessaire : elle est vitale.
Les féminismes face à l’anti-wokisme
Lutter contre Bolloré, c’est lutter contre l’anti-wokisme car les féministes sont au premier banc des accusé·es. Certes la situation en France n’est pas encore aussi alarmante qu’aux États-Unis — où des recherches universitaires sur le genre sont purement et simplement bannies, et où certains livres sont interdits« La censure des livres, nouveau front dans les guerres culturelles aux États-Unis », émission Le Grand Reportage, France Culture, 30/08/2024. —, mais l’anti-wokisme gagne du terrain. Ce soi-disant concept étant un véritable fourre-tout à usage idéologique, réactionnaire au sens premier du terme, il ne peut évidemment faire l’objet d’une définition sérieuse. Mais une chose est certaine, il sert à discréditer les luttes pour l’égalité, qu’elles concernent le genre, la race ou la classe.
Cependant, ce qui est sérieux, c’est la charge contre l’École et l’Université. En 2022, un colloque intitulé « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture », s’est tenu à la Sorbonne, sous l’égide de l’Observatoire du décolonialisme, ouvert par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, et clos par Thierry Coulhon, président du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Le but était clair : rompre avec la « pensée unique » incarnée par le wokisme, le féminisme, l’intersectionnalité, etc.[multiblock footnote omitted], avec comme intervenants : Pierre-Henri Tavoillot, qui a théorisé le concept d’« islamo-gauchisme » ou encore Jean-François Braunstein qui nie le concept de genre. À cela s’ajoute la baisse de la place des sciences humaines dans les librairies et les journaux, le combat acharné contre l’éducation à la sexualité à l’école mais aussi la publication de plusieurs ouvrages remettant en cause le mouvement #MeToo et le « wokisme » comme Le Vertige MeToo de Caroline FourestEllen Savi, « L’antiféminisme prospère en librairie », Mediapart, 26/10/2024, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/france/261024/l-antifeminisme-prospere-en-librairie, consulté le 26/03/2025.. On peut aussi assister à l’instrumentalisation des thèmes féministes par l’extrême droite, c’est le cas du collectif Némésis. Ce collectif raciste, xénophobe, islamophobe, validé par l’extrême droite (Génération identitaire, La Cocarde, etc.Rémi Yang, « Némésis, le groupuscule d’extrême droite qui se dit féministe », Streetpress, 03/12/2019, disponible sur : https://www.streetpress.com/sujet/1575362795-nemesis-le-groupuscule-extreme-droite-feministe-racisme-catho-fachosphere, consulté le 26/03/2025.) se sert de certains aspects du féminisme pour justifier ses positions discriminatoires et pour lutter contre « le grand remplacement ».
Ces événements illustrent la volonté de certain·es de remettre en cause les avancées des études de genre et des sciences sociales critiques. Parmi les cibles privilégiées de cette offensive, on trouve la fameuse « théorie du genre », régulièrement diabolisée par les conservateur·ices. On peut alors s’inquiéter de ces charges, et considérer sur ce thème, qu’un travail d’édition féministe est indispensable.
Éditer en féministe : des principes aux pratiques
Éditer en féministe, c’est aussi avoir un catalogue cohérent avec les valeurs que nous défendons. Comment prétendre défendre des idées féministes tout en publiant des auteurs comme Jordan Bardella ou Michel Houellebecq, dont les discours sont aux antipodes de nos combats ? On ne peut pas dénoncer un système tout en en profitant. Publier des livres féministes, revient donc à refuser de se contenter d’une approche superficielle ou opportuniste.
Éditer en féministe, c’est aussi mettre en cohérence nos pratiques internes avec les principes que nous défendonsTribune, « Le féminisme est aussi une affaire d’édition », Le Club Mediapart, 05/05/2021, disponible sur : https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/050521/le-feminisme-est-aussi-une-affaire-d-edition, consulté le 26/03/2025.. Cela signifie adopter un fonctionnement horizontal, garantir une rémunération juste et respecter les autrices et auteurs. Dans un milieu de l’édition traditionnellement conservateur et masculin, ces engagements sont une rupture nécessaire. Bien que 66 % des effectifs du secteur soient des femmes, elles restent largement sous-représentées aux postes de direction : seulement 9 % des 100 plus grandes entreprises culturelles sont dirigées par des femmes« Maisons d’édition : les femmes prennent le pouvoir », Entreprendre, 06/04/2016.. Ce milieu, très homogène et bourgeois, reproduit les mêmes schémas de domination que l’on retrouve ailleurs. Les cas de harcèlement et de violences sexistes y sont malheureusement fréquents, comme en témoigne l’affaire du patron de Bragelonne, accusé de comportements inappropriés à connotation sexuelle« Affaire Marsan : huit autrices de Bragelonne “rappellent la société à ses obligations” », Actualitté, 28/05/2021, disponible sur : https://actualitte.com/article/100521/tribunes/affaire-marsan-huit-autrices-de-bragelonne-rappellent-la-societe-a-ses-obligations, consulté le 26/03/2025. par une vingtaine de femmes mais aussi la tribune dénonçant « la persistance des agressions sexuelles et des viols dans le monde littéraire et dans les études de lettresTribune, « Violences sexuelles : “Ce qui se passe dans le milieu du cinéma se passe aussi ailleurs, à l’université, dans les écoles, dans l’édition” », Le Monde, 07/03/2024. ». Face à ces dérives, le Syndicat national de l’édition a mis en place un dispositif de prévention contre les risques de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles dans le monde du livre. Mais cela ne suffit pas : il faut repenser en profondeur les structures et les pratiques du secteur.
Il serait enfin nécessaire, pour conclure, de montrer la nécessité, en féministes, d’éditer des ouvrages qui démolissent l’idéologie identitaire et réactionnaire qui fait tant de ravages en ce moment. Des ouvrages qui proposent de repenser l’universalisme, un universalisme qui englobe les différents féminismes, seul antidote à nos yeux. Il est essentiel de continuer le travail que nous avons commencé depuis plusieurs décennies : éditer des livres qui ébranlent les systèmes de domination — capitaliste, patriarcal, colonial —, publier des voix marginalisées et aussi continuer tous·tes ensemble à réfléchir à nos pratiques éditoriales. C’est en offrant des récits qui libèrent, et des espaces qui préfigurent le monde que nous voulons, que nous pourrons résister à Bolloré.
Entretien —
Je suis une personne trans qui a œuvré dans les milieux associatifs dès les années 1990, notamment avec Maud-Yeuse Thomas et Tom Reucher, avec qui nous avons fondé Existrans, la première marche trans (en 1997). En publiant les premiers essais, comme mon ouvrage de 2008 (La transidentité. De l’espace public à l’espace médiatique), ou encore les numéros des « Cahiers de la transidentité » (L’Harmattan, 2012 à 2015) qui rompaient avec les autobiographies, nous souhaitions investir le champ des savoirs, et montrer que les personnes trans vivaient dans un monde auquel elles avaient le droit d’apporter une critique — qu’elles étaient politisées, et pas uniquement centrées sur leurs questions d’hormones et d’opération. Nous nous sommes immédiatement inscrites dans les luttes féministes qui nous ont apporté énormément de choses, notamment la compréhension des discriminations et de leurs effets, mettant à jour les intersectionnalités et les coproductions, car les oppressions s’entrecroisent et se nourrissent les unes les autres (patriarcat, sexisme, ultralibéralisme, xénophobie, etc.). C’est à cet endroit-là que s’enracine mon engagement militant, que je nomme « lutter contre l’inacceptable » : il n’y a pas de luttes qui me sont fermées d’office et je ne reste pas cantonnée à la question trans.
Je suis sociologue des médias, je travaille sur la représentation des personnes trans dans les médias. J’ai fait une thèse de doctorat pour laquelle j’ai travaillé sur les archives de l’Institut national de l’audiovisuel depuis 1946. Je suis membre associée dans l’unité de recherche pluridisciplinaire Sophiapol de l’université Paris Nanterre. Mais ce sont des affiliations symboliques : je n’ai jamais réussi à obtenir un poste. Je suis une précaire de l’université, et une chercheuse engagée. Je milite pour que mon engagement pour les personnes trans ne disqualifie pas ma recherche universitaire — contre une prétendue posture d’objectivité ou d’universalisme revendiquée par l’université et qui m’empêcherait d’exposer un point de vue.
Dans les années 1990, j’ai réalisé que les personnes trans ne se reconnaissaient pas dans leurs représentations, ni même dans les invité·es des plateaux débats de la télévision. Je me suis alors posé la question : pourquoi ce décalage ? Cela a été doublé par le constat d’un sentiment de maltraitance médiatique, car les propos tenus étaient toujours négatifs. Les personnes concernées le vivaient comme une double peine : elles étaient maltraitées dans l’espace public et dans l’espace médiatique. Or comment peut-on se construire quand la télévision vous dit que vous êtes un monstre et que l’on se fout de votre gueule ? Quand on vous présente en paria, en marginal·e, et que l’on vous accole des stigmates très négatifs ? À l’inverse, on peut également poser la question : comment se construit-on dans une société où l’on a déjà une place ?
À la suite de ce constat, j’avais réalisé une première enquête de réception, pour savoir ce qu’il en était pour d’autres personnes trans. Beaucoup m’avaient expliqué qu’à cause de telle ou telle émission, elles n’avaient pas osé faire leur coming out auprès de leur famille. La représentation qui existait ne leur correspondait pas, or c’était la seule ! Elles craignaient donc d’être assimilées à cette image et d’être mal perçues par leurs proches. D’autres ont su trouver à l’étranger ce que j’appelle des « médiations », des productions véhiculant une autre image — le monde anglo-saxon notamment a su produire des contenus intéressants, même si pas mal de trash a aussi été réalisé.
C’est pour cela que j’ai eu envie de travailler sur les représentations : elles ne sont pas neutres. Elles ne font pas tout, mais elles ont des effets sur le réel et sur l’estime de soi.
Vous constatez que ces représentations ont des effets sur les politiques publiques et sur la compréhension que les auditeurices ont des vies des personnes trans. On ne peut pas quantifier les effets de telles représentations mais elles disent quelque chose de l’atmosphère politique dans laquelle nos existences sont prises, elles disent aussi quelque chose de la souveraineté du pouvoir sur les corps. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les personnes trans ont longtemps été majoritairement approchées, imaginées, considérées, sur la base de représentations construites sur leur sujet, leur préexistant comme on le voit dans le film Framing Agnes de Chase Joynt (2022) — à travers ce qu’aujourd’hui on appellerait un cis gaze. C’est un peu comme si quelqu’un·e disait qui vous êtes mais sans jamais vous avoir croisé·e, et encore moins vous avoir donné l’opportunité d’une parole libre. C’est seulement depuis une dizaine d’années que la pratique de consulter des personnes trans a commencé à se répandre. Avant cela donc, on se basait sur des idées toutes faites, des stéréotypes, des hérités culturels. Par exemple, dès les années 1970, on voit régulièrement apparaître des personnes trans dans les séries policières : elles sont dans un commissariat, au bois de Boulogne, et en général, elles meurent — c’est un schéma vraiment récurrent. Ces représentations se pérennisent, s’auto-alimentent et enfin se perpétuent. C’est ainsi que l’on aboutit à des personnages qui ne correspondent plus du tout à la réalité. La représentation médiatique est restée bloquée alors que les personnes trans, réelles, ont évolué. C’est particulièrement frappant dans la série Louis(e)Créée par Thomas Perrier et Fabienne Lesieur, réalisée par Arnauld Mecardier, diffusée sur TF1 en 2017.. Le personnage de Louise est totalement obsolète : c’est un personnage des années 1980, posé en 2017, qui a quasiment trente ans de retard sur la question trans !
Jusqu’aux années 2000, on assiste à un autre phénomène : il existe peu d’exemples de personnes ayant pu s’exprimer sans l’encadrement physique ou symbolique de l’autorité médicale. Dans les années 1980–1990, c’était très marqué : il y avait toujours un psychiatre sur les plateaux de débat et les talk-shows (les émissions de Jean-Luc Delarue ou de Christophe Dechavanne par exemple). Et cela a joué sur les politiques. Durant les débats qui ont conduit à la loi simplifiant le changement de sexe dans l’état civilDécret nº 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil., on sait qu’en off, des politiques demandaient l’avis d’« expert·es » (médecins, psychiatres cisgenres) ou exprimaient l’idée que des avis du corps médical seraient judicieux par exemple. Même au stade d’un simple changement d’état civil, une expertise extérieure est réclamée et considérée comme rassurante, et bien sûr, les personnes concernées sont toujours mises de côté. Sandy Stone, dans son « Manifeste posttransexuel », mettait d’ailleurs bien en lumière, dès 1987, le fait que tout le monde avait le droit de disserter sur la question trans… sauf les transSandy Stone, « The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto », dans Julia Epstein et Kristina Straub (éd.), Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity, Londres, New York, Routledge, 1991 (traduction française : « L’Empire contre-attaque : un manifeste posttranssexuel », Comment s’en sortir ?, nº 2, 2015)..
En parallèle de ces représentations, un backlash se préparait, que beaucoup font remonter à 2019, avec les premières tribunes dans Marianne et Le FigaroPar exemple : Pauline Arrighi, « Trans : suffit-il de s’autoproclamer femme pour pouvoir exiger d’être considéré comme telle ? », Marianne, 17/02/2020.. Mais pour moi, il a commencé bien avant, et l’on peut observer deux phases. Certaines idées du backlash actuel ont été posées dans les années 1970, avec par exemple Janice Raymond et son livre très violent, L’Empire transsexuelJanice Raymond, The Transsexual Empire: The Making of the She-Male, Boston, Beacon Press, 1979 (traduction française : L’Empire transsexuel, Paris, Le Partage, 2022). Sandy Stone écrit d’abord son manifeste en réaction à ce livre.. Puis le livre est tombé dans l’oubli, même si une partie des féministes radicales — pas toutes ! — sont restées obsédées par les personnes trans. Vers 2003, est apparu le site sisyphe.org, un site francophone publiant des textes à charge et qui pourtant n’avait rien d’anti-trans à sa création car il s’agissait de proposer « des articles sur la condition des femmes, la politique, les droits humains, les rapports de pouvoirs, les biotechnologies, la poésie, les arts, etc. ». Il a été rejoint par la plateforme tradfemVoir leur site : https://tradfem.wordpress.com/category/plateforme/, dont le projet de départ était très alléchant : une plateforme de traduction mettant à disposition en français des textes des féminismes anglo-saxons. Mais parmi les textes traduits, nombreux sont anti-trans et alimentent sisyphe.org. Puis, en 2014–2015, est apparu un autre site, partage-le.com, dirigé par Nicolas Casaux, où l’on peut carrément retrouver une rubrique « transactivisme », terme fait partie du lexique importé des États-Unis et diffusé par les courants ultraconservateursCe lexique a été repris sans recul par les médias français et surtout par les médias de Bolloré (CNews particulièrement. À l’opposé, le service public (France Télévisions) n’utilise jamais ce vocabulaire.. Cette alliance sur internet a travaillé doucement, sans faire de bruit, pendant une dizaine d’années. C’est seulement maintenant que cela surgit. C’est ce qui a permis, à partir de 2011, à des polémiques d’éclater : sur les manuels de SVT, puis sur le mariage pour tous (2013) — certainement celle qui a abouti au plus gros retour de bâton anti-trans —, enfin sur les ABCD de l’égalité (2014), accusés de faire la propagande de la « théorie du genre ». Quand Alain SoralConférence « De l’antiracisme à Égalité & Réconciliation », Alain Soral, Farida Belghoul, Mathias Cardet, 22 juin 2013 au théâtre de la Main d’Or. déclare que la déconstruction du genre détruit et nuit aux repères identitaires des enfants, on est quasiment déjà dans le discours actuel de Dora Moutot, de Marguerite Stern, de Bruno Retailleau… La proposition de loi adoptée par le Sénat l’année dernière, pour fortement restreindre les transitions des jeunes personnes trans, montre que les discours et rhétoriques anti-trans ont des effets sur le politiqueMathilde Mathieu et David Perrotin, série « Mineurs trans : la fabrique d’une panique », quatre épisodes, Mediapart, mai 2024.. La politisation de cette question, d’abord question de société puis devenue une question d’égalité des droits, est alarmante : on veut revenir sur des droits, on veut revenir en arrière.
Les médias de Bolloré ont bien préparé le terrain depuis des années et personne n’a rien vu. Enfin si — mais pour interpeller, il faut avoir du pouvoir, et pour être écouté·e, il en faut encore plus. Les effets de ces caricatures et stéréotypes peuvent aussi se mesurer sur les réseaux sociaux où s’expriment haine et désinformation, tout en montrant que certains esprits ne prennent aucun recul et ne font preuve d’aucune approche critique. On leur dit que les trans veulent transidentifier la population tel un grand remplacement des personnes cisgenres, iels le croient, sans même réaliser l’absurdité de l’affirmation.
Maud-Yeuse Thomas, chercheuse transféministe indépendante et engagée, parle de suprémacismes : du blanc sur les autres couleurs, des genres binaires sur les autres, des masculinités toxiques sur les autres, etc.
C’est très juste, car il ne s’agit pas simplement de faire valoir l’avis d’une majorité sur une minorité désignée comme subversive, mais de la bouter hors des frontières, de l’effacer. On veut mettre ces minorités dehors : hors de la culture, hors du champ politique, hors du droit et hors de l’égalité du droit. On crée des ennemi·es de l’extérieur, comme les personnes migrantes ou les cultures musulmanes, mais aussi de l’intérieur avec les LGBTQI+, les trans particulièrement, les femmes qui portent le voile, les jeunes des banlieues, les « wokes », etc. Ces multi-suprémacismes finissent par converger : masculinistes, chrétiens conservateurs, personnes d’extrême droite, malheureusement aussi certaines féministes radicales, pour un monde avec des hommes et des femmes, des mâles et des femelles, des hétérosexuel·les, que des gens qui sont utiles à la société (les autres sont des rats ou des assisté·es). Ces discours créent un monde où des personnes ne veulent plus rien d’autre qu’elles-mêmes. C’est ça le suprémacisme : on est au-delà de la hiérarchie, on veut simplement éliminer. Symboliquement ou pas, la violence existe, et cette violence nuit à l’individu.
Aux États-Unis, par exemple, quand Hunter Schafer, l’actrice de la série Euphoria, perd ses papiers, on lui renvoie des papiers d’homme. C’est de l’effacement pur et dur. Quand on veut interdire l’accès aux soins médicaux et aux opérations, que l’on veut poursuivre les parents de personnes trans en justice et même les poursuivre quand iels ont déménagé dans un autre État, on est bien au-delà de l’interdiction.
Finalement le suprémacisme s’est fait jour en désignant des « wokes » puis en créant le courant « anti-wokes », une sorte de résistance, mais c’est ça le vrai danger. Quand on voit le chemin qu’a fait Zemmour, et son impunité, c’est intolérable. Or quand Jean-Michel Aphatie rappelle une vérité historique sur ce qui a été fait durant la guerre d’Algérie, il est privé d’antenne le jour même« Jean-Michel Aphatie mis en retrait de l’antenne de RTL après sa comparaison entre Oradour-sur-Glane et les massacres en Algérie », Libération, 05/03/2025, disponible sur : https://www.liberation.fr/economie/medias/jean-michel-aphatie-mis-en-retrait-de-lantenne-de-rtl-apres-sa-comparaison-entre-oradour-sur-glane-et-les-massacres-en-algerie-20250305_USWGL5YVRFAR7JDHBAH6DIKETU/. Il y a quelque chose qui n’est pas juste, qui n’est pas égalitaire, qui n’est pas normal. Et cela dit vraiment quelque chose de notre monde et de notre société.
Avec du recul, comment voyez-vous l’évolution des représentations des personnes trans sur les grandes chaînes ces vingt dernières années ? Seriez-vous d’avis de dire, qu’en général, elles ont plus d’espace de visibilisation ?
Cela varie, évidemment, il y a des fluctuations, un peu comme les marées et leurs vagues. Il y a aussi des disparités selon les aires culturelles — en Espagne, par exemple, le cinéma de Pedro Almodóvar (le personnage d’Agrado dans Tout sur ma mère, 1999) a proposé des choses très différentes des représentations francophones, même si un film comme La Piel que Habito (2011) laisse perplexe et (très) mal à l’aise. Aux États-Unis, il y a parfois des audaces et des représentations de notre temps, jusque dans une simplicité parfois salutairePar exemple, avec des séries comme Euphoria (depuis 2019), Sense8 (2015–2017), Star Trek: Discovery (2017–2024), Supergirl (depuis 2015), Pose (2018–2021) ou encore Umbrella Academy (2019–2024)., ce qui est d’autant plus étonnant vu le contexte politique depuis une décennie.
La visibilité a indéniablement augmenté en premier lieu à cause de la multiplication des chaînes. Il y a presque cent fois plus de médias qu’il y a quarante ans. Donc chaque média, au moins une fois par an — en général c’est plus — aborde le thème. C’est une première donnée qui alimente le sentiment que « l’on ne parle plus que de cela ».
La question trans s’est disséminée dans les différents genres audiovisuels. Au départ, elle était présente à travers des faits divers, puis des reportages, puis des documentaires dans les années 1980 et des apparitions dans les séries policières. Sont ensuite apparus les talk-shows et les personnes trans y ont fait leur entrée. Enfin, la téléréalité arrive avec les années 2000 ; là encore, les personnes trans y trouvent leur place. Donc multiplication des médias, multiplication des genres audiovisuels et mondialisation de ces mêmes médias, ce qui crée encore plus de sources. Mais la visibilité est à double tranchant et je me méfie de cette ambivalence. C’est évidemment très important, car tant que l’on ne parle pas d’une chose, elle n’existe pas. Si l’on ne donne pas de chiffres sur la discrimination des trans, pour les politiques, elle n’existe donc pas. Or ce qui n’existe pas, n’a pas à demander de droits. Et ce qui existe peut devenir un mouvement social — la revendication par un groupe de son existence, et donc de droits.
Mais en créant parfois des focales déformantes, cette visibilité engendre des détournements, des caricatures et des stéréotypes. Ainsi on peut avoir l’impression d’une surreprésentation de la thématique alors que dans la réalité, c’est loin d’être le cas. Christine Boutin avait déclaré que l’on ne pouvait plus regarder la télévision sans voir des gays et des lesbiennesChristine Boutin, « On est envahis de gays », Le Monde, 27/05/2013, disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/27/christine-boutin-on-est-envahis-de-gays_3418318_3224.html. Mais qui lui demande d’aller regarder ces feuilletons ? Je travaille en ce moment sur une communication sur la représentation des personnes trans dans les séries, et en compilant des extraits, c’est vrai qu’on arrive à un résultat assez impressionnant. Mais en fait, ce résultat représente quelque chose comme 0,1 % (très probablement moins encore) de la production mondiale des séries. Je me pose sincèrement la question de savoir pourquoi des personnes investissent autant de temps et d’énergie dans des choses qu’elles détestent. Selon moi, l’isolement et la focalisation sur un cas nourrit leur peur et devient une autolégitimation de leur haine.
Quels sont les rôles qui leur sont généralement donnés dans les émissions de télévision, dans les séries, les films et dans la pop culture ?
De nombreuses séries ont vu le jour ces dernières années : Star Trek: Discovery (2017) met en scène le personage de Gray Tal, interprété par Ian Alexander, un homme transgenre ; Euphoria (2019) campe le rôle de Jules Vaughn, interprétée par Hunter Schafer, etc. La constante entre elles ? Les personnes trans tiennent des rôles et elles sont également consultantes dans ces séries : on les écoute dans la construction de leur rôle, au scénario et à l’écriture. Fini les apparitions trans qui tournaient exclusivement autour de « l’avant/l’après ». Parfois, c’est même extrêmement simple : pour signifier son changement de sexe entre la saison 2 et la saison 3 d’Umbrella Academy, Elliot Page passe devant un coiffeur ; il en sort avec une nouvelle coupe de garçon et retrouve ses frères qui commencent par l’appeler Vania, qui répond : « C’est Viktor […] J’ai toujours été Viktor. [Silence] Ça dérange quelqu’un ? », et les frères acquiescent : « Non, ça me va très bien », « Oui moi aussi ! Cool. Je suis heureux pour toi Viktor ». Cette simplicité est importante : on prend acte et on passe à la suite. Dans Supergirl, c’est pareil : la question trans est presque anecdotique. Attention, cela ne veut pas dire qu’elle est traitée à la légère, ou qu’elle est secondaire, mais cela signifie que l’on n’en fait pas un douloureux problème. C’est une donnée de la vie des gens.
Ces séries sont souvent du domaine du fantastique et de la SF, elles portent des discours très actuels, s’adressent à un public jeune et sont très médiatisées. Si, comme je le disais, cela ne représente en réalité rien par rapport à la production mondiale ou à la production étasunienne de séries, ce sont de bonnes visibilités, simples et saines, parfois habilement militantes, dans le sens où elles dénoncent des injustices et retournent le problème, comme dans l’épisode 2 de la saison 1 de Sense8 où Nomi, hospitalisé, est confonté au mégenrage et à son infantalisation.
Au cinéma, les personnages trans sont souvent des hommes, mariés, pères de famille, qui décident un jour de partir et de revenir en tant que femmes ; à partir de là, l’histoire bascule. La personne trans est donc l’élément perturbateur : elle crée des problèmes, elle bouleverse l’ordre. Mais le film Une femme fantastique (Una mujer fantástica, réalisé par Sebastián Lelio, 2017), par exemple, propose, avec le personnage de Marina, une véritable approche transféministe. La focale est complètement retournée : c’est la société qui est montrée comme élément perturbateur de la vie et de l’envie d’exister des personnes trans.
À plusieurs niveaux dans la fiction et dans les représentations, il y a donc une vraie amélioration. Sur les plateaux débats, c’est plutôt un retour en arrière.
La mainmise de Vincent Bolloré sur les médias audiovisuels et papier est inquiétante car il se sert d’eux pour promouvoir son projet politique. Or Bolloré est un conservateur qui voit d’un mauvais œil les existences qui dérogent à la norme hétéro-patriarcale hégémonique. Comment cela se matérialise-t-il ?
L’idée, c’est de toujours jouer le débat, qui en fait n’en est pas un, puisque le ressort c’est de jouer sur la polémique et le scandale. Il s’agit d’une mise en question de la démocratie via le débat où le public semble être pris à témoin. Les mouvements conservateurs ont perdu la bataille du mariage pour tous mais en attendant, ils ont forgé des expressions et des discours hyper violents que les médias n’auraient jamais dû tolérer à l’époque — car cela a autorisé tout le reste. La même chose s’est passée avec Trump : il a pu dire une phrase comme « attraper les femmes par la chatteFrédéric Joignot, « “Pussy” entre en politique », Le Monde, 12/01/2019, disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/12/pussy-entre-en-politique_5408212_3232.html » et pousuivre tranquillement sa route vers la Maison-Blanche en toute impunité. Il s’est passé quelque chose de similaire en France avec les débats autour du mariage pour tous (et toutes). Ce qui m’interpelle, c’est que l’on ne devrait pas avoir à débattre de ces sujets-là. On ne débat pas sur l’existence des gays et des lesbiennes, on ne débat pas sur le droit de faire famille, sur le fait d’aimer quelqu’un·e ou de vouloir des enfants — ce sont des droits fondamentaux. On peut trouver que c’est une mauvaise idée de se marier et d’avoir des enfants, mais ça c’est autre chose. [Rires.] Le problème, c’est donc qu’a été créée l’idée que l’on pouvait débattre sur ces questions. Depuis que cela s’est installé, cela n’a fait que se renforcer.
Sur le fond, Touche pas à mon poste ! et CNews ont repris ce que Christophe Dechavanne et Jean-Luc Delarue faisaient déjà avec Ça se discute et Ciel mon mardi !. La question trans y était abordée très régulièrement, avec moult caricatures et raccourcis, construisant une transidentité qui jouait sur le spectaculaire, le « donner à voir », mais avec des figures assez sages, pas vraiment subversives. Hanouna et CNews ont franchi un cap en orchestrant des mises en débat sur l’existence même de certaines choses, voire pire, de certaines personnes. Il n’est qu’à s’intéresser aux titres de leurs débats : « Faut-il / Est-ce que c’est bien ? » Est-ce que c’est bien qu’une personne trans se présente à Miss FranceÉmission « Miss France : une candidate transgenre se présente pour la première fois », Touche pas à mon poste !, C8, mai 2022. ? On met l’inacceptable en débat.
Avec ses chroniqueur·euses, Hanouna se lâche. D’un côté, on réduit par le rire, par la moquerie — c’est ainsi que peu à peu on déshumanise. De l’autre, on joue la carte de la fausse bienveillance. Il met un peu le feu, il met un coup d’extincteur, il rallume le feu. Quand Hanouna invite Nina, une personne trans, il la tutoie et joue la carte de l’amitié. D’abord, il y a une séquence problématique autour de la sécurité sociale et des personnes trans qui creuseraient le trou de la sécu — la première à avoir lancé cette idée-là, c’était Brigitte Bardot dans les années 1980. Et iels rigolent, Nina est vraiment sans filtre. Puis il lui demande de montrer les photos d’avant sa transitionÉmissions « Nina, femme trans et Jérémy, témoignent de leur amour dans TPMP ! », avril 2023 ; « Nina, femme transgenre, revient sur le documentaire polémique de Zone interdite ! », mai 2023, Touche pas à mon poste !, C8.. Or cela peut vraiment produire des effets très négatifs sur d’autres personnes trans — à l’inverse, un certain nombre de personnes ne voient pas d’inconvénients à cela. Personnellement, je pense qu’il ne faut tout simplement pas aller à ce genre d’émission. La transidentité est un sujet politique, ce n’est pas un ragot à aller donner en pâture à ces gens-là, ou un sujet de bricolage. D’autant plus que dès qu’iels savent que vous êtes trans, iels vous scannent comme une chose, avec complaisance, regardent votre visage, cherchent vos traits, écoutent votre voix, regardent vos mains, vos pieds.
Derrière une fausse bienveillance, on cherche en fait à « montrer » aux Français·es les dérives et le scandale comme on parlerait des immigré·es qui bénéficient d’une couverture santé. On pointe les atteintes faites à l’ordre, l’ordre de la société, des rapports hommes-femmes, l’ordre des genres. Ces discours de la spectacularisation la plus crade se font passer pour du divertissement qui se pose les bonnes questions (la dénonciation d’un certain « wokisme »)D’autres exemples d’émissions : « Le nouvel emoji “homme enceint” fait polémique ! », Touche pas à mon poste !, janvier 2022 ; « L’actrice transgenre Karla Sofia Gascon primée à Cannes porte plainte contre Marion Maréchal », mai 2024..
Pour orchestrer ces débats qui n’en sont pas, des expert·es sont invité·es sur les chaînes d’info et des chroniqueur·euses sont invité·es chez Cyril Hanouna. Chacun·e prétend à une expertise mais très souvent iels n’y connaissent rien et l’affirment. Iels ne connaissent rien au paradigme trans (histoire, culture, enjeux de santé et des expériences de vies trans, études trans) mais s’autorisent tous les raccourcis. Par exemple, dans une séquence consacrée à la victoire d’une athlète transgenre dans une compétion interlycées aux États-Unis (2024), Gilles Verdez (présenté comme le « woke » de l’équipe) est interrompu par Hanouna qui disqualifie tous les arguments par : « C’est n’importe quoi. […] Regarde la science. On dirait Tik Tok. » Et un autre renchérit : « Rien que le bon sens devrait t’amener à penser que si tu étais un homme, avec la musculature d’un homme, tu as un avantage certain. » La communauté scientifique débat de la question depuis plus d’une décennie et la tendance va dans le sens que les femmes transgenres ayant suivi un traitement de « suppression de testostérone ne profitent d’aucun avantage biologique net sur les femmes cisgenres dans le sport d’élite« Athlètes transgenres féminines et sport d’élite : examen scientifique », Centre canadien pour l’éthique dans le sport, rapport de 2021, disponible sur : https://cces.ca/fr/athletes-transgenres-feminines-et-sport-delite-examen-scientifique ». A-t-on déjà vu une femme transgenre truster des médailles aux Jeux olympiques ? Le plus souvent, à l’image de l’haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard aux JO de 2020, qui échoue et se retire du sport, les athlètes trans n’écrasent pas leur discipline, mais tout cas particulier, tel un fait divers, est bon à prendre si l’on souhaite faire du sensationnel. Une certaine idée de la télévision du divertissement autorise-t-elle de tels développements ?
Le problème, c’est qu’iels parlent à des heures de grande audience. On assiste à un phénomène de popularisation de la question trans — qui est différent de la vulgarisation. Or comme pour la visibilité, il y a une ambivalence : ça existe et c’est bien, mais à la fois cela existe trop et avec beaucoup de débordements. Au Canada, par exemple, quand une personne entreprend des recherches ou une thèse de doctorat sur les personnes trans, elle doit répondre à une charte d’éthique — parce qu’elle travaille sur des personnes humaines. Dans ces médias, clairement, ces critères éthiques n’existent pas. Il n’est pas question de « toucher au maître » comme l’écrit L’Humanité (2022) pour commenter la formule d’Hanouna face au député Louis Boyard (un ancien de l’émission) : « Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. » En mettant beaucoup de distance (vraiment beaucoup), on peut donc dire qu’il est un véritable professionnel des médias, qui adore son job, c’est indéniable, mais il est dépourvu de sens éthique et de responsabilité en tant que journaliste. Par exemple, il a « outé » des anonymes (un jeune gay piégé et mis à la rue par ses parents) comme des personnalités publiques (Angèle ou encore Matthieu Delormeau, un membre de son équipe). Le plus triste, c’est qu’il trouve des personnes pour rentrer dans son jeu. J’ai beaucoup de mal à penser qu’il puisse être différent dans une autre émission.
Enfin, il est important d’avoir en tête que dans une émission-débat ou sur un plateau de télévision, il y a une mise en scène qui est une construction : on vous met dans une position et on vous soumet à des questions bien précises, ce qui laisse peu de place à la spontanéité et à l’authenticité. Souvent, le débat est très dirigé et sortir du cadre est difficile. Si la retransmission n’est pas en direct, il ne faut pas oublier qu’il y a un travail de remontage derrière. Cette mise en scène ne colle pas nécessairement au réel, ou va donner lieu à des généralisations. Et quand on a l’impression que son dispositif est débordé, il en tire encore profit pour offrir du spectacle.
Ce fut le cas dans l’émission où a été invitée l’artiste trans Olivia Ciappa« Il est Elle », Touche pas à mon poste !, C8, septembre 2023.. Un gynécologue avait refusé de recevoir en consultation une personne trans ; iels en ont fait un débat : « Les gynécologues doivent-ils recevoir les personnes trans ? » Et la chroniqueuse Kelly Vedovelli de surenchérir : « Moi, je ne voudrais pas recevoir des hommes en barbe. » C’est du grand n’importe quoi. Là, évidemment, Olivia Ciappa est sortie de ses gonds. Mais même cette contestation, c’est du spectacle orchestré. Il y aurait vraiment un travail énorme à faire pour étudier comment cette spectacularisation passe par le montage des différentes séquences, le cadrage, etc. Moi, en tant que personne concernée, tout cela me violente. En tant que chercheuse, cela m’interpelle. Mais avant tout, c’est en tant qu’être humain que je trouve cela très choquant.
Est-ce que le succès d’audimat rencontré par les chaînes du groupe Bolloré influence les politiques vis-à-vis des représentations trans sur les autres chaînes de télévision, notamment celles du service public ?
Quand on prend l’exemple de l’émission d’Apolline de Malherbe sur RMC, on retrouve la même absence de contradiction, voire le même encouragement à la propagande, et surtout la même complaisance vis-à-vis de ce que les intervenant·es disent. Par exemple, à propos de la présence de personnes trans dans la HAS (Haute Autorité de santé) qui a rendu un rapport favorable pour les bloqueurs de puberté, Israël Nisand parle de transactivisme — un terme de l’extrême droite américaine — et d’« infiltration » — le mot est vraiment connoté« La transition de genre gratuite dès 16 ans ? », Le parti-pris, 13/12/2024, disponible sur : https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/le-parti-pris-la-transition-de-genre-gratuite-des-16-ans-13-12_EN-202412130276.html. Or les personnes qui travaillent à la HAS sont des clinicien·nes, des médecins, des professionnel·les de la santé — et ce sont des personnes trans. Donc ce qu’elles font, selon lui, n’est ni professionnel ni scientifique —ce qu’Apolline de Malherbe valide activement.
M6+, avec un peu plus de respectabilité, dans un registre un peu moins populaire, a proposé une rafale d’émissions — quatre sur une période de deux ans, c’est beaucoup« Fille ou garçon ? Le dilemme des transgenres » (2017) ; « Trans — uniques en leur genre » (2022) ; « En transition de genre » (2022) ; « Transgenres : enquête sur les nouveaux tabous » (2023), M6+.. Le terme « tabou » est beaucoup revenu depuis les années 1980. Ce qui a changé en revanche, c’est la disparition du terme « transsexuel », au profit de « transgenre », parce qu’iels savent bien que les associations vont monter au créneau. Malgré tout, ces plateaux demeurent un peu voyeuristes. Ypomoni, un collectif de parents « laïc et apolitique rassemblant des parents concernés par l’explosion des transitions médicales et chirurgicales rapides et irréversibles des enfants, adolescents et jeunes adultesVoir leur site : https://ypomoni.org/qui_sommes_nous/. Il faut préciser que cette structure est l’émanation de l’organisation internationale Genspect (https://genspect.org/), dont des audioleaks du directeur ont dévoilé des volontés de pratique de thérapies de conversion (https://healthliberationnow.com/2022/04/02/leaked-audio-confirms-genspect-director-as-anti-trans-conversion-therapist-targeting-youth/). », affilié à l’Observatoire la petite sirène« Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent, Centres d’études de ressources et d’information francophone. La transidentification des mineurs (ASP : Angoisse de Sexuation Pubertaire) est le premier sujet d’étude », voir leur site : https://www.observatoirepetitesirene.org. Les mamans étaient invitées à parler des dangers du transactivisme. Un débat a été organisé, selon un dispositif classique : des fauteuils se faisaient face, l’animateur était au milieu. Les personnes trans d’un côté, les autres en face. Les personnes trans étaient assises sur un fauteuil noir ; les expert·es, sur un fauteuil blanc. Il faudrait vraiment pouvoir interroger tous ces dispositifs. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu’ils sont tous signifiants. Mais cette mise en scène du face-à-face — des personnes trans face à des personnes neutres et/ou hostiles — montre que le casting n’est pas réalisé au hasard. Par ailleurs, iels sont très vigilant·es à ne pas se laisser infiltrer par des militant·es.
Mais sur le service public, l’exemple le plus flagrant que j’ai en tête est l’émission Quelle époque !, où Léa Salamé est poussée à bout lors d’une altercation entre Marie Cau et Dora Moutot, en octobre 2022. Léa Salamé a fait du Hanouna, car c’était impossible qu’elle ne sache pas que les deux intervenantes allaient s’en prendre l’une à l’autre. Le minimum, pour les personnes qui préparent ces émissions, c’est de se renseigner sur les positions des invité·es. Le seul point positif que je vois à cette affaire, c’est que cela a fait suffisamment de bruit pour que ça ne se reproduise pas.
Avec Bolloré qui détient Hachette, et donc, une grande partie de la production de manuels scolaires, pensez-vous qu’il y ait des risques d’une instrumentalisation transphobe ?
Je pense que oui, c’est indéniable, même si je ne peux faire que des hypothèses sur les types de discours que l’on pourrait retrouver. Ce que je retiens comme possibilité qui accélérerait cette instrumentalisation, c’est la dislocation : quand Bolloré arrive quelque part, il vire les personnes critiques ou qui l’ont critiqué, il les remplace. Il n’est qu’à regarder ce qui s’est passé avec Fayard. Un temps, Lise Boëll (alors directrice des Éditions Plon et éditrice de Zemmour) est pressentie pour remplacer Isabelle Saporta à la tête de Fayard (début 2024). Saporta sera licenciée au mois de mars 2024 et la nomination de Boëll donnera lieu à des spéculations avant son arrivée à la tête des éditions Fayard, deux mois plus tard. Bolloré fait du Trump finalement. C’est ainsi que paraissent les « Mémoires » du très vieux Jordan Bardella. La même chose se passe dans l’audiovisuel. Je pense notamment aux Guignols de l’info : Bolloré a fait le ménage à Canal+, c’est ce qu’il a fait à Valeurs actuelles, et il est en train de faire la même chose à Hachette. Je trouve cela particulièrement inquiétant de faire venir des gens qui ont des liens avec l’extrême droite ou avec des mouvements ultraconservateurs. Or le réseau qu’entretient Bolloré est impressionnant. Il ne se contente plus seulement de la France, il va jusqu’à s’étendre à l’étranger ou prendre les rênes de médias dans différents pays et continents (le groupe Vivendi est aussi présent en Europe de l’Est comme en Afrique). Il a vraiment l’envergure d’un magnat des médias comme Rupert MurdochMagnat des médias australo-américain, proche des Républicains et des ultraconservateurs, et dont les médias à travers le monde (The Sun, The Times, Talk TV, Sky News Australia, The Daily Telegraph, Fox News, parmi plus d’une centaine) portent des idées jugées ultraconservatrices..
D’abord, il ne faut pas baisser les bras ! Je trouve qu’il y a un déficit de résistance, que les médias baissent trop la culotte devant Bolloré. Il faut continuer à faire ce que l’on fait, même si c’est dur, même si on sait que l’on va en faire les frais plus tard. J’ai été parfois critique envers Quotidien, sur TMC, mais cependant je salue leur travail quand iels parodient les drama queens de CNews : iels savent rester critiques et percutant·es tout en étant capables de relever leurs propres contradictions.
Ensuite, il ne faut pas céder sur le lexique. Je reproche à beaucoup de médias d’avoir cédé, usant finalement d’une rhétorique anti-trans, reprenant le lexique de l’extrême droite américaine, comme « transactivisme », « transidentifier » ou encore « lobby trans » — sans même mettre de guillemets ! On le voit avec le terme « woke », qui a connu une dérive et une récupération très rapide. Désormais extrêmement péjoratif, son emploi vaut pour disqualification et injure. Mais les choses peuvent changer ! À force du travail vigilant et persévérant d’associations, les médias ont bien fini par abandonner la terminologie médicale pathologisante. Le service public est aujourd’hui irréprochable sur cette question. Il ne faut rien lâcher.
Il ne faut pas non plus céder à la menace, car c’est renoncer à soi-même. Or un média, c’est une identité culturelle. Cela m’a fait extrêmement mal quand j’ai découvert le portait de Caroline Eliacheff en une de la rubrique « Portraits » de LibérationÈve Szeftel, « Caroline Eliacheff, du genre tenace », Libération, 15/01/2023, disponible sur : https://www.liberation.fr/portraits/caroline-eliacheff-du-genre-tenace-20230116_PHDPNUMXOBFRPOQCVG2RFEMJ6A/ En contrepoint, lire aussi : Adrien Naselli, « Polémique/ Qui “annule” qui dans le débat sur la prise en charge des mineurs trans ? », Libération, 25 décembre 2022, disponible sur : https://www.liberation.fr/idees-et-debats/qui-annule-qui-dans-le-debat-sur-la-prise-en-charge-des-mineurs-trans-20221225_3LQTRPN4ARBNPAN4JFMDNOWWYU/, très glamourisant suivant beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux (une impression que je partage). Marianne ou Le Figaro j’aurais compris, mais Libération ! Je sais que cela a causé de gros débats en interne, et si le journal avait continué sur cette lancée, j’aurais vu cela comme un reniement. Bien sûr, cela n’avait rien à voir avec la une sur « Le délire transgenre » de Valeurs actuelles« Le délire transgenre. Comment les lobbies instrumentalisent le changement de sexe », Valeurs actuelles, 27/06/2021., mais cela me pose question. Quand des discours sont discriminants, violents, quand ils rabaissent et déshumanisent, jusqu’où, au nom de la liberté d’expression, doit-on les laisser s’exprimer ?
Sur la question des mineur·es, qui a été surexploitée (par les discours anti-trans, par l’extrême droite et par les médias Bolloré), je recommande la plateforme d’information et d’orientation Trajectoires jeunes trans : on y trouve un accompagnement, une écoute bienveillante et professionnelle, un encadrement avec des professionnel·les de la santé.
Du côté des livres, je recommande ceux d’Emmanuel Beaubatie, Transfuges de sexe. Passer les frontières du genre (éditions La Découverte, 2021), ceux de Pauline Clochec, Matérialisme trans, paru sous sa direction et celle de Noémie Grunenwald (éditions Hystériques & AssociéEs, 2021) et aussi Après l’identité. Transitude et féminisme (éditions Hystériques & AssociéEs, 2023) ou encore Le lobby transphobe de Maud Royer (éditions Textuel, 2024). Je me permets également de signaler le livre que nous avons publié avec Maud-Yeuse Thomas, Transidentité et transitude : se défaire des idées reçues (éditions Le Cavalier Bleu, 2022). Il a été écrit à destination d’un public non trans, désireux de s’intéresser à ces questions. Il a reçu un piètre accueil médiatique ; à ce moment-là, je me suis vraiment sentie blacklistée. À l’inverse, l’ouvrage de Claude Habib, La question trans (Gallimard, 2021) a très bonne presse, bien qu’il me semble moins intéressant que ceux que je viens de citer du point de vue critique. Désormais, pourtant, on la considère comme une spécialiste. Je voudrais également mentionner sur Mediapart le blog de Claire Vandendriessche, co-présidente du ReST (reseausantetrans.fr). Très sourcés, ses articles sont une véritable mine d’or d’informations !
Pour un statut d’éditeur indépendant
Texte issu d’une intervention aux IIe Assises de l’édition indépendante, sur le thème : « De la précarisation à la précarité : pourquoi ? comment ? », jeudi 21 février 2025.
En février 2023, à Aix-en-Provence, les premières Assises de l’édition indépendante étaient ouvertes par une rencontre rassemblant le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, le directeur général du CNL (Centre national du livre), le directeur de la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) et le président du SNE (Syndicat national de l’édition), c’est-à-dire les représentants des principales instances nationales du livre en France. Comme pour accomplir cette mise en scène du pouvoir, on trouvait, au bout de cette longue table, après le directeur de la Culture de la Région Sud, mais sur le côté, la représentante de la Fill (Fédération interrégionale du livre et de la lecture). Il s’agissait d’un échange sur « Les politiques de soutien à l’édition indépendante ».
En réponse à l’exposé des urgences pour l’édition indépendante donné par la représentante des structures régionales du livre — un exposé précis, clair et, dans ce contexte, quand on songe à l’état du rapport de forces, particulièrement courageux — qui proposait un plafond aux aides à l’édition en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’aides par maison, mais aussi, entre autres suggestions, aux dégâts écologiques, d’établir une taxe à la surproduction ; en réponse donc à ces propositions modestes et de bon sens, le directeur général du CNL a expliqué que, au nom de la « diversité de la création, notre mantra au ministère de la Culture », il n’imposerait jamais de plafonnement : « Nous n’avons pas vocation à exclure des maisons d’édition des soutiens du CNL. » Et de donner, en exemple, le soutien par le CNL, en 2022, d’« un formidable ouvrage, un dictionnaire du Moyen Âge », dont il signale, en se penchant en arrière pour s’adresser, dans un geste de connivence, à deux chaises de lui, au président du SNE : « Un ouvrage publié aux éditions du Seuil, que Vincent connaît bien. » (Il n’est pas sûr que Vincent Montagne connaisse bien cet éditeur, mais il est sûr en revanche qu’il l’a racheté avec le groupe La Martinière cinq ans plus tôt.) Le directeur général du CNL précise encore : « C’est un ouvrage extrêmement coûteux, qui a vocation à être un ouvrage de référence. Il réunit tous les plus grands spécialistes, et nous nous devions de le soutenir pour le rendre accessible au public. Nous n’avons pas vocation, quel que soit le chiffre d’affaires du Seuil, à l’exclure de nos soutiens. »
Si cette profession de foi ne souffre aucune ambiguïté — de fait, elle enterre les quelques pistes ouvertes par la représentante de la Fill —, on pourrait faire quelques remarques sur ses prérequis. Ne serait-ce que sur la compatibilité entre la mission de sauvegarde de la « diversité de la création », l’état de concentration qu’a atteint l’édition française et le rôle de l’État dans ce processus, notamment au travers des soutiens symboliques et financiers accordés à des groupes éditoriaux qui — du fait de leur croissance et de leurs liens avec de puissants intérêts industriels et financiers — ne sont plus seulement, désormais, en mesure d’acheter, comme depuis (presque) toujours, des maisons, mais d’autres groupes.
C’est l’une des rares vertus de Vincent Bolloré que d’avoir mis au jour avec éclat les dangers de la concentration éditoriale. Même si la cause de cette révélation — l’outrance de son programme de restauration des valeurs millénaires de l’Occident chrétien — a un peu tendance à aveugler son public. Après tout, le problème vient surtout du fait qu’autant de pouvoir puisse tomber entre les mains d’un seul individu. D’autant plus quand on sait que ce type de profil — les États-Unis, en ce domaine, servent de modèle — est aussi loin que possible d’un humaniste dévoué aux causes telles que la défense des libertés publiques, de l’égalité économique et devant la loi, de la fraternité entre les peuples, de l’urgence climatique, etc.
Le principal problème vient donc moins de l’arrivée d’un soutien actif des droites extrêmes à la tête du plus grand groupe éditorial français que du système qui l’a permise. Un constat qui ne semble pas être partagé par les médias dominants et les représentants de la politique culturelle de l’État français.
Sans remonter avant le début de ce siècle, on se souvient des louanges reçues par Jean-Marie Messier pour son montage du groupe médiatique transnational Vivendi Universal (2000). On se souvient aussi que l’effondrement, en moins de deux ans, de son château de cartes a permis au groupe Hachette de doubler (provisoirement) sa taille. On se souvient bien sûr qu’alors, au nom de l’« indépendance éditoriale », un quarteron de « grands indépendants », dont les groupes Gallimard, La Martinière et Le Seuil sont montés à l’assaut de Bruxelles pour tenter d’arracher au lion sa part. On se souvient enfin que la victoire de cette geste a donné naissance au groupe Editis (2004), sous la férule du patron des patrons d’alors, le baron Ernest-Antoine Seillière ; mais aussi, la même année, au rachat du Seuil par Hervé de La Martinière avec les fonds de la famille Wertheimer, propriétaire de Chanel, industrie du luxe qui passe pour l’une des marque les plus valorisées au monde.
Conçue par les éditions Agone & Le vent se lève, disponible en version papier (format 63 × 89 cm) sur : https://agone.org/livre/edition-francaise-qui-possede-quoi/, la carte « Édition française : qui possède quoi », est parue dans une version simplifiée, en avril 2025, dans Le Monde diplomatique.
La suite des années 2000 voit enfler les groupes Editis, Gallimard et Actes Sud par des acquisitions ponctuelles. Les années 2010 connaissent une accélération avec le rachat par le groupe Gallimard du groupe Flammarion — ce qui donne naissance au groupe Madrigall (2012–2013) avec des capitaux de LVMH (Bernard Arnault) ; puis le rachat en 2012 de Payot-Rivages par le groupe Actes Sud (Françoise Nyssen, première ministre de la Culture d’Emmanuel Macron) et du groupe La Martinière par le groupe Média-Participations (2017) ; enfin la naissance des groupes Humensis (2016) et Bourgois (2019). Ces derniers ont été respectivement rachetés par les groupes Gallimard et Albin Michel en 2024.
Cette situation peut-elle être favorable à la « diversité de la création » ? Beaucoup en doutent. Pour ceux-là, le « mantra du ministère de la Culture » ne peut être satisfait que par un développement de l’édition indépendante conjoint à une réduction, voire un arrêt de la concentration éditoriale.
Nous commercialisons en avril 2025 une carte « Édition française, qui possède quoi » — dont une version simplifiée est parue ce même mois dans Le Monde diplomatique. Prenant le contre-pied de la vision dominante, celle que donnent notamment les planisphères et classements de Livres Hebdo — le magazine officiel du Syndicat national de l’édition et du Cercle de la Librairie —, elle ne représente pas les seuls gros chiffres d’affaires, soit les groupes et une poignée d’indépendants : y est présent l’ensemble des éditeurs de littérature générale. En outre, la représentation des maisons ne suit pas les chiffres d’affaires mais leur date de création et leurs statuts : les groupes (avec leurs maisons dépendantes) et les indépendants sont ici au même niveau. Enfin, on a retiré les industriels du livre scientifique ou pratique (les groupes Relx et Lefebvre Sarrut) — trop loin du marché du livre généraliste et de la formation des opinions.
Cette carte représente l’ampleur de la concentration éditoriale — les 90 % du chiffre d’affaires de l’édition produits par une poignée de groupes dont les plus gros sont la propriété de grandes fortunes (les rangs dans les classements Challenges, en euros, et Bloomberg, en dollars, sont indiqués). Mais elle expose en même temps la véritable source de la diversité éditoriale : les maisons indépendantes. On comprend bien en effet que ces groupes de moins en moins nombreux et de plus en plus gros sont devenus ce qu’ils sont en se nourrissant du renouvellement régulier de maisons, dont ils absorbent, en les achetant, le chiffre d’affaires — et donc la capacité d’en acheter d’autres — mais aussi la créativité, indispensable pour contrebalancer la stérilisation qui touche les maisons dépendantes, soumises à une production standardisée par les impératifs de rentabilité.
Ce qu’on voit moins, mais que la plupart des éditeurs indépendants éprouvent au quotidien, c’est que, étant donné le niveau de concentration atteint par l’édition — 90 % du chiffre d’affaires produit par une poignée de groupe —, les conditions de précarité plus ou moins importantes dans lesquelles sont maintenues les indépendants ne sont rien d’autre que le maintien des conditions de leur rachat.
Parmi les innombrables avantages qu’auraient les maisons dépendantes sur les maisons indépendantes, on mentionne toujours l’économie d’échelle réalisée par les groupes, notamment sur les charges fixes — une réalité économique qui n’a rien de spécifique à l’édition. Ce n’est pas le seul avantage. Les plus importants sont certainement les moyens logistiques et financiers dont bénéficient les grands groupes : les quatre plus gros possédant, en outre, les plus grosses entreprises de diffusion-distribution, et deux étant propriétaires de médias, voire de chaînes de librairie. Ces moyens leur permettent d’élever la surproduction au rang de stratégie d’occupation : déverser sur les librairies et les médias une vague pour repousser celles de la concurrence. Une mécanique qu’illustre la rentrée littéraire, quand déboulent des centaines de romans, dont la plupart sont destinés à être pilonnés avant la fin de l’année, quelques-uns (déjà choisis) surfent plus ou moins bien et d’autres (déjà choisis) sont poussés vers les prix littéraires pour booster les ventes en supermarché et celles de Noël. Pour l’essentiel, cette « édition sans éditeurs » — pour reprendre la formule de l’éditeur franco-américain André SchiffrinAndré Schiffrin, L’édition sans éditeurs, Paris, La fabrique, 1999. — produit des livres vite faits, vendus en masse ou pilonnés en masse.
Sur la base de ce diagnostic sommaire — mais qui a largement déjà été développé ici et là au fil d’articles et d’ouvrages —, tentons quelques suggestions pour corriger quelques-uns des dysfonctionnements de ce système en suivant les conseils du ministère de la Culture et du CNL. Pas seulement pour protéger la sauvegarde de la diversité de création, mais aussi afin de répondre aux enjeux sociétaux et à la lutte contre la casse écologique dont ces institutions soulignent, à juste titre, l’importance.
Pour commencer, il faut donner un statut juridique à l’édition indépendante. Comme il en existe, par exemple, pour le secteur de la presse, protégée au nom de la liberté d’opinion. Un statut qui pourrait — comme l’évoquait, il y a deux ans, lors des premières Assises de l’édition indépendante, le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture — « être inscrit dans notre Constitution, parce qu’après tout, le livre, c’est aussi un moyen de communiquer, de former l’opinion » — et d’éduquer, devrait-on ajouter.
On pourrait partir de la définition élémentaire que le CNL donne d’un éditeur indépendant : ne pas être la propriété d’un groupe et ne pas dépasser le chiffre d’affaires annuel d’un demi-million d’eurosJulien Leford-Favreau, « Quel avenir pour le livre dans l’après-Covid », The Conversation, 03/06/2020, disponible sur : https://theconversation.com/quel-avenir-pour-le-livre-dans-lapres-covid-138470, consulté le 12/03/2025. — pour ne pas être accusé de misérabilisme, on peut multiplier ce chiffre par deux, dix, voire vingt sans changer grand-chose.
Sur la base de ce statut, l’édition indépendante bénéficierait des avantages fiscaux attribués à la presse indépendante ; mais aussi des tarifs postaux préférentiels — dans l’esprit du tarif Livres et Brochures pour l’exportation de la culture française que La Poste abandonne cette année dans l’indifférence générale.
Si ce statut d’éditeur indépendant contribuera à protéger la diversité de la création éditoriale, face à l’état de concentration éditoriale, il sera insuffisant : il faut aussi réguler. Une première mesure simple — déjà évoquée en février 2023 par la représentante de la Fill — serait d’établir, pour l’attribution des aides à l’édition, un plafond en termes de chiffre d’affaires (à définir) et de nombre d’aides par maison ou par groupe — en tenant compte, non pas des enseignes mais de leur propriétaire. À ces exigences répond la nécessité de réserver les aides aux maisons indépendantes. Ce serait en outre le meilleur moyen d’éviter que l’État, par les aides aux groupes, nourrisse la concentration éditoriale, principal facteur de stérilisation de la diversité de création.
Le directeur du CNL et le directeur du livre au ministère de la Culture ayant réaffirmé, voilà deux ans encore, leur souci de l’impact écologique du secteur du livre, s’impose l’établissement d’une taxe sur la surproduction. Ce qui serait aussi un premier pas pour répondre à la demande urgente, formulée par le SLF (Syndicat de la librairie française) en juin 2024, à quelques jours des Rencontres nationales de la librairie à Strasbourg, d’une « baisse drastique de la production de livresAntoine Oury, « Les libraires réclament une “baisse drastique de la production” de livres », ActuaLitté, 06/06/2014, disponible sur : https://actualitte.com/article/117539/librairie/les-libraires-reclament-une-baisse-drastique-de-la-production-de-livres, consulté le 12/03/2025. ». Pour que cette mesure ait un effet, il est de bon sens qu’elle s’adresse en priorité aux quelques-uns qui produisent 90 % du marché du livre plutôt qu’aux nombreux qui en produisent 10 %.
Dans la même logique de décroissance, qui croise en l’occurrence la protection de la diversité de création, ciblons deux acteurs majeurs de la consommation de biens répondant moins aux besoins sociaux et environnementaux qu’à des soucis mercantiles et aux exigences de l’accumulation : d’abord la publicité — qui fut longtemps interdite pour le livre (un interdit qu’il est temps de rétablir) ; ensuite la vente en supermarché, où s’écoule une production standardisée avec un gâchis incompatible même avec les plus bas critères environnementaux. Sans parler de la régulation des supermarchés en ligne, dont l’emblème est Amazon, et dont on connaît l’ampleur des impacts écologiques et (puisque nous sommes aussi soucieux des enjeux sociétaux) l’indignité des conditions de travail faites à leurs employés dans leurs entrepôts dantesques. En outre, ces mesures devraient recevoir le soutien des librairies, qui accueilleront une partie de cette clientèle égarée, à qui on est sûr qu’elles offriront autre chose à lire que la production promue par les chaînes en continu de Vincent Bolloré.
On le voit bien, ces mesures sont peu coûteuses et assez bénignes. Une fois acquises, il faudra s’attaquer à la racine. C’est-à-dire légiférer sur la possibilité pour un groupe éditorial de posséder médias, diffusion-distribution et chaînes de librairies. Il s’agit de réduire les concentrations horizontale et verticale dans l’édition française, désormais aux mains de quatre grandes fortunes. Produit des effets pervers de la concurrence par le jeu même des marchés, ce contexte d’oligopole débouche inévitablement sur des concentrations ; et les grands groupes issus de ce phénomène n’ont alors qu’une obsession : préserver leurs positions, quel qu’en soit le prix. C’est pourquoi l’ensemble des dangers qui pèsent sur la production et le commerce du livre, en tant qu’outil d’émancipation et partie prenante de tout projet de démocratisation de la culture, se résume à la concentration de l’édition.
On remarquera que ces quelques mesures suggérées pour corriger certains dysfonctionnements du marché éditorial sont indépendantes de tout critère intellectuel, artistique, politique, scientifique ou autre, pour ne s’en fixer qu’un seul : la taille. Limiter la taille d’un acteur économique, c’est limiter sa capacité de nuisance.
Il en va pour le champ éditorial comme il en va pour la politique, la société et l’environnement : nous avons dépassé le stade du sauvetage des acquis d’un monde qui n’existe plus. Il faut passer à l’offensive avec des analyses et des propositions claires. La Fédération des éditeurs indépendants est bien sûr le lieu où ouvrir ce chantier.
Trois propositions pour une pratique du démantèlement (de l’empire Bolloré) —
En juillet 2024, la campagne pour désarmer l’empire Bolloré a été lancée avec un sentiment d’urgence. Urgence à faire exister un front de lutte large et puissant face à la menace fasciste matérialisée par la montée de l’extrême droite et le RN aux portes du pouvoir. Quelques mois plus tard, force est de constater que l’urgence est devenue imminence.
De l’autre côté de l’Atlantique, la victoire de Trump, le salut nazi de Musk et les décrets par dizaines créent un état de sidération : purge de dizaines de milliers de fonctionnaires, déportations scénographiées à coups d’avions militaires, annonces d’invasions brutales du Canada, du Groenland ou du Panama, censure via intelligence artificielle de centaines de mots-clés allant de « femme » à « réchauffement climatique » en passant par « race » et « historiquement », des programmes de rechercheEmmanuel Clévenot, « “Femme”, “climat”… Trump interdit des mots dans les articles scientifiques », Reporterre, 12/02/2025, disponible sur : https://reporterre.net/Femme-climat-Trump-interdit-des-mots-dans-les-articles-scientifiques, création d’un bureau de la foi« Offensive obscurantiste aux USA : Trump crée un “bureau de la foi” et censure le monde universitaire », Contre Attaque, 14/02/2025, disponible sur : https://contre-attaque.net/2025/02/14/offensive-obscurantiste-aux-usa-trump-cree-un-bureau-de-la-foi-et-censure-le-monde-universitaire/ et fuite en avant dans le génocide du peuple palestinien.
En France, dans les sphères médiatique et politique, on ne compte plus les déclarations d’allégeance et les marques de fascination à ce techno-fascisme. L’interrègne dans lequel nous nous trouvons depuis les élections législatives de juin 2024 marque tous les jours un peu plus le trait d’union entre extrême droite macroniste et extrême droite traditionnelle : fin du droit du sol à MayotteLe Monde avec AFP, « Mayotte : l’Assemblée nationale vote une proposition de loi pour restreindre davantage le droit du sol », Le Monde, 06/02/2025, disponible sur : https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/02/06/l-assemblee-nationale-vote-une-proposition-de-loi-visant-a-restreindre-davantage-le-droit-du-sol-a-mayotte_6534839_3224.html, hommages des ministres à Le Pen père, apparition de Retailleau aux côtés du groupuscule identitaire Némésis, Bayrou parlant de « submersion migratoire », 109 milliards d’euros investis pour l’intelligence artificielle et le soutien du gouvernement — à peine voilé — au génocide du peuple palestinien. L’extrême droite est déjà au pouvoir. C’est d’ailleurs ce que déclarait un cadre du RN le 25 septembre 2024 sur France Info : « Bruno Retailleau a très bien appris notre programme, il le récite à la perfection et pratiquement à la virgule près, je ne vais pas dire que ça ne nous satisfait pas« Le RN est au pouvoir, et c’est le RN qui le dit », Contre Attaque, 26/09/2024, disponible sur : https://contre-attaque.net/2024/09/26/le-rn-est-au-pouvoir-et-cest-le-rn-qui-le-dit/. »
Ici comme outre-Atlantique, les grandes corporations capitalistes sont à la manœuvre, mettant leur puissance économique et financière au service de projets politiques et idéologiques fascistes. Depuis plusieurs années en France, le groupe Bolloré, via l’achat de Vivendi puis de Hachette, a méthodiquement façonné le paysage médiatique, tant éditorial qu’audiovisuel. L’intuition de la campagne « Désarmer Bolloré » est de s’attaquer directement aux fondements économique, médiatique et idéologique de l’extrême droite. C’est une façon de dire : « Détournons la focale des élections ; tout ne se situe pas là. » Le fascisme c’est une forme plus violente du capitalisme, plus ouvertement raciste, coloniale, masculiniste, mais qui s’abreuve aux mêmes structures d’oppression et de domination.
La proposition de la campagne contre Bolloré est d’ordre politique, tactique et organisationnel. Politiquement, nous disons : il est primordial de cibler le pouvoir de ceux qui possèdent les outils de production et de trouver comment le démanteler, l’exproprier, le reprendre. Tactiquement, nous augmentons notre surface d’attaque contre l’extrême droite et pointons des cibles plus concrètes et atteignables matériellement, car les succursales d’un groupe d’une telle envergure sont présentes à travers tout le territoire. L’une des ramifications de cet empire se trouve très sûrement près de chez vous. Du point de vue organisationnel, cette campagne permet de constituer un front large où les modalités d’actions — du désarmement à la soirée d’information et de la manifestation déterminée à l’armada de bateaux pirates — se renforcent mutuellement en formant une puissante caisse de résonance.
Le texte qui suit tente de répondre à la question : comment démanteler l’empire Bolloré ? Les ébauches de propositions esquissées ici ne prendront pas la forme d’un programme prêt à l’emploi mais de réflexions ouvertes que nous souhaitons mettre en discussion. Nous ne croyons pas à un démantèlement par le haut, les pouvoirs publics n’en ont ni les moyens, ni la volonté. Nous croyons en la coordination de résistances populaires.
La campagne ayant été lancée à l’appel d’une centaine d’organisations signataires« Appel à désarmer l’empire Bolloré ! », disponible sur : https://desarmerbollore.net/appel, nous écrivons depuis une de ces composantes : les Soulèvements de la terre. Notre affaire est donc : comment des dynamiques de luttes peuvent émerger, se coordonner, et ainsi se rendre capables d’atteindre des points de rupture sur des projets aussi importants que la construction de méga-bassines, d’autoroutes ou le monopole de milliardaires sur la quasi-totalité des médias ? Nos hypothèses sont inspirées de notre expérience dans les luttes territoriales depuis quatre ans et discutées âprement lors de débats entre camarades. Au cœur d’entre elles, il y a la perspective de démantèlement des industries nuisibles. Il s’agit d’envisager chaque projet toxique comme un maillon d’une filière. Par exemple, les méga-bassines sont une part de l’agro-industrieLes Soulèvements de la terre, Premières secousses, Paris, La fabrique, 2024. Cf. la partie 1 : « Désarmer le béton. », l’A69 de l’industrie du bitume, ou les sablières de Saint-Colomban de l’industrie du bétonLes Soulèvements de la terre, Premières secousses, op. cit. Cf. la partie 2 : « Démanteler le complexe agro-industriel. ». Lutter contre un projet s’inscrit alors dans une perspective plus vaste, ce qui permet, entre autres, d’élargir le champ de bataille en visant directement les infrastructures d’une filièreLa campagne d’actions décentralisées contre Lafarge en décembre 2023 et plus récemment l’action de blocage du port de La Rochelle (d’où sont exportées intensivement des céréales) lors de la mobilisation antibassines de juillet 2024 sont de bons exemples.. Mais cette stratégie du démantèlement est mise à l’épreuve par la campagne « Désarmer Bolloré ». Elle se situe hors du champ de l’écologie et s’appuie sur un objet plus difficilement saisissable qu’un projet précis comme la construction d’une autoroute ou d’un aéroport, car il s’agit de saper un empire qui finance l’extrême droite et la nourrit idéologiquement.
Lutter contre l’empire Bolloré avec en tête une stratégie de démantèlement, cela veut dire ne pas se restreindre à cibler les vecteurs de diffusion directe des idées réactionnaires que sont CNews, Europe 1, Praud, Morandini ou Hanouna. Il s’agit d’envisager l’empire dans son entièreté et dans toute sa complexité. Face au caractère tentaculaire de l’empire Bolloré, il nous faut adopter une stratégie et des tactiques multiformes, selon les secteurs. Cela nécessite d’identifier au sein de cet empire colossal les prises concrètes sur lesquelles nous pouvons agir directement ou indirectement. L’objectif est toujours de provoquer un effet domino, au sein d’une filière, puis de filière en filière. Le chemin vers le démantèlement de l’empire Bolloré est donc pavé d’expérimentations et de tentatives qui permettront de rassembler un front commun et de nous doter collectivement de nouvelles possibilités d’agir contre l’extrême droite, bien au-delà du cas particulier de Bolloré.
I. Comprendre et défaire les filières
La puissance du groupe Bolloré s’appuie sur le développement d’un empire économique et financier colossal, dont la dynamique d’extension et de diversification est multidirectionnelle. Il peut s’étendre horizontalement à travers des secteurs diversifiés (médias, culture, agriculture, industrie, énergie, etc.) mais parfois aussi verticalement par la maîtrise d’une grande partie de la chaîne de production.
Dans les années 1980, la reprise de l’entreprise de papier familiale, à Ergué-Gabéric, près de Quimper, permet à l’entrepreneur Vincent Bolloré d’expérimenter ce qui va ensuite devenir une marque de fabrique : rachat d’une entreprise, acquisitions dans le même secteur pour contrôler la production, la transformation et la distribution, diversification des activités, et souvent, revente. Suite à la reprise de la papeterie qui produisait notamment les papiers OCB, en 1985, le groupe se développe dans le tabac et les cigarettes en Afrique, jusqu’à arriver en situation de quasi-monopole en Afrique francophone. Il gère tout : production, fabrication, vente« Vincent Bolloré parie sur le tabac, son développement en Afrique et… la SEITA », Les Echos, 11/07/1994, disponible sur : https://www.lesechos.fr/1994/07/vincent-bollore-parie-sur-le-tabac-son-developpement-en-afrique-et-la-seita-885963. À partir de 1997, le groupe Bolloré choisit de renforcer son activité en Afrique. D’abord via la participation à la Socfin, « qui contrôle environ 390 000 ha de concessions de palmiers à huile et d’hévéas en Afrique et en AsieCf. l’appel à la campagne « Désarmer Bolloré » : « Il est le second actionnaire de la holding luxembourgeoise Socfin qui contrôle environ 390 000 ha de concessions de palmiers à huile et d’hévéas en Afrique et en Asie. Déforestation, spoliation des terres, mauvais traitement des populations riveraines, conditions de travail inhumaines, etc. », disponible sur : https://desarmerbollore.net/appel. » Mais également via le transport et la logistiqueEn 1998, Bolloré achète SAGA France et ses filiales DIAF, SCTT, Peschaud, opérateur international spécialisé en transport maritime, aérien et express, logistique, projet industriel et opérations en douane. : grâce aux plans de libéralisation de l’économie imposés par le FMI et la Banque mondiale et aux liens étroits qu’il entretient avec les chefs d’État africains, il met la main sur des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires à travers l’Afrique. Dans les années 2010, le groupe Bolloré Africa Logistics représentait plus de 80 % des bénéfices du groupe. La quasi-totalité des activités logistiques du groupe — en Afrique et en Europe — seront revendues début 2024Seulement Bolloré Energy est gardé, donc les dépôts pétroliers, de fioul domestique et le transport de ces marchandises.. Il reste un groupe industriel de premier ordre via la logistique pétrolière, mais également grâce à Blue et Blue Systems qui forment un ensemble d’entreprises allant du contrôle des fluxAutomatic Systems, Easier produisent des barrières de sécurité et des portiques, notamment pour les autoroutes et les aéroports. Smart City Platform, Indestat et Track & Trace sont des solutions logicielles pour les villes, les États et les acteurs industriels pour le traçage des marchandises et des populations. Blue produit des batteries au lithium et des véhicules électriques, notamment des bus. Nous en reparlons dans la suite du texte. aux batteries électriques. Parallèlement, à partir des années 2000, il acquiert des médias (Vivendi, Canal, etc.), des agences de publicité et de conseil en communication (Havas), un institut de sondage (CSA), puis des groupes d’édition (Editis puis Hachette) et des salles de spectacle (Olympia). C’est la face de l’empire la plus connue et la plus visible aujourd’hui, notamment en France. En revanche, on sait moins que, fidèle à ses fondements coloniaux, le groupe investit aussi massivement en Afrique dans l’industrie audiovisuelle et culturelle, construisant des studios, des salles de concerts, de cinéma et développant des chaînes de télévision (les chaînes des groupes Thema ou Multichoice ou simplement Canal+)Mathilde Boussion, « MultiChoice, joyau de l’audiovisuel africain, en passe d’intégrer la galaxie Bolloré », Le Monde, 09/06/2024, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/06/09/multichoice-joyau-de-l-audiovisuel-africain-en-passe-d-integrer-la-galaxie-bollore_6238109_3234.html ; Haby Niakaté, « Canal+ à l’assaut de l’Afrique francophone », Le Monde, 08/04/2018, disponible sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/08/canal-a-l-assaut-de-l-afrique-francophone_5282515_3234.html.
Ce rapide tour du propriétaire n’a pas pour but d’être exhaustif, mais de mettre le doigt sur le fonctionnement du groupe. Il agit par extension dans un secteur, acquérant de nombreux points de la chaîne et dupliquant les opérations dans plusieurs pays. Comprendre comment les activités du groupe Bolloré sont organisées au sein d’une même filière permet de dessiner des axes de lutte. La question du démantèlement peut se poser secteur par secteur et non plus d’un seul bloc, c’est-à-dire à l’échelle de l’empire Bolloré. Ce qui rend la tâche relativement plus facile à appréhender. Car une fois que sont identifiées les entreprises qu’il maîtrise dans un secteur donné, de nombreuses prises deviennent imaginables.
Dans cette perspective d’analyse sectorielle, l’exemple du monde de l’édition est paradigmatique, dans la mesure où le groupe Bolloré est aujourd’hui présent sur l’ensemble de la chaîne du livre. Depuis l’acquisition de Hachette en 2023, c’est connu, il possède de très nombreuses maisons d’éditionBolloré en possède plus de 200. Cf. la carte des maisons d’édition disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/carte-des-maisons-d-editions-et-medias-de-l-empire-bollore. À l’image d’i-Télé devenue CNews ou de Canal+, il a commencé les restructurations brutales. C’est le cas de la maison d’édition Fayard, à la tête de laquelle il a nommé Lise Boëll, éditrice d’Eric Zemmour et de Philippe de Villiers, qui a depuis publié en grande pompe le livre de Jordan Bardella. Le groupe Bolloré contrôle également la distribution des livres avec l’entité Hachette Livre Distribution et l’impression avec Lightning Source France. Via les boutiques Relay, appartenant à Vivendi, la commercialisation est, elle aussi, assurée dans les gares et les aéroports. L’influence du groupe sur les librairies s’exerce également de façon indirecte. Hachette, en tant que premier groupe éditorial français, s’assure que quasi aucune librairie, aussi indépendante soit-elle, ne puisse supprimer de ses rayons les livres édités par ses maisons d’édition.
Face à un tel monopole, par où commencer ? Comment s’y attaquer ? Depuis novembre 2024, la campagne « Désarmer Bolloré » a impulsé un mouvement pour défaire son emprise sur le monde de l’édition en visant en plusieurs endroits, parfois successivement, parfois simultanément.
Les premières à dégainer ont été les librairies indépendantes. Cet automne, plus de quatre-vingt d’entre elles ont appelé à « escamoter » Hachette. Conscientes des enjeux du milieu du livre et faute d’être en capacité financière de pouvoir réellement boycotter Bolloré, elles proposaient à leurs collègues de vendre moins de livres Hachette et plus d’éditions indépendantes. Leur tribune rappelle avec justesse qu’il faut voir plus loin que la seule littérature ouvertement d’extrême droite : « Plus que le livre de Bardella, c’est tout le système Bolloré qu’il faut pouvoir appréhender et faire chuter : un livre n’est pas qu’un texte imprimé, c’est toute une économie à laquelle il appartient. Tout autant que leur contenu, les modalités de fabrication et de circulation des textes ne sont pas neutres. Elles importent. Comme bien souvent, le pouvoir dans le livre est logistique« 100 librairies s’engagent à escamoter les livres Bolloré \| Tribune », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/les-librairies-s-engagent-a-escamoter-les-livres-Bollore. » Que cette première tribune vienne des librairies indépendantes n’est pas anodin, tout comme cet ouvrage, publié par un nombre inédit de maisons d’édition. Cela nous dit en creux qu’une des modalités du démantèlement d’un empire comme celui de Bolloré c’est de reprendre en main, de façon non capitaliste, la chaîne de production et de distribution du livre. Il y a là une piste qui doit se creuser entre les acteur·ices indépendant·es et les travailleur·euses d’un groupe comme Hachette.
Pour accompagner cette tribune, des centaines de milliers de marque-pages et de stickers invitant à ne plus acheter de produits Hachette et à privilégier les maisons d’édition indépendantes ont été imprimés. Ils ont été distribués dans tout l’Hexagone aux groupes locaux des organisations participant à la campagne. C’est une sorte de grand jeu, facile à prendre en main, qui est vite devenu viral. Les règles : aller voir des librairies indépendantes proches de chez soi et les inviter à rejoindre le mouvement, glisser les marque-pages de manière pirate dans les livres Hachette dans les grandes surfaces, les Fnac, etc., ou encore coller directement des stickers sur les livres d’extrême droite. Le but : faire chuter les ventes du groupe Hachette. De nombreux témoignages, photos et vidéos ont été envoyés. Ces gestes très rapides et très simples se sont répandus dans des centaines de points de vente. À tel point que la direction de Lagardère s’est fendue de plusieurs notes internes à destination des boutiques Relay. L’une d’entre elles, que nous avons publiée sur le site de la campagne« Les Relay submergés de marque-pages et stickers contre Bolloré — la note d’information de Lagardère », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/relay-la-note-d-info-de-lagardere, demande aux employé·es de retirer les marque-pages et les stickers et indique que « ces incidents touchent l’ensemble des enseignes et librairies qui vendent des livres Hachette ». Cette opération, toujours en cours, est un moyen pour tout un chacun de mettre un pied dans la campagne. Certains groupes locaux, à l’instar des comités franciliens des Soulèvements de la terre« Tuto | Comment bien zbeuler ton Relay », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/tuto-comment-zbeuler-ton-relay proposent d’en pimenter les modalités. Il est possible de répandre de la glue ou de la peinture sur les livres les plus ouvertement fascistes, ou plus magiquement, de les faire disparaître pour que plus personne ne puisse les lire. Ces actions effectuées souvent en petits groupes anonymes, en appellent d’autres, un peu plus visibles.
Lors de la première semaine d’actions décentralisées contre l’empire Bolloré qui a eu lieu du 29 janvier au 3 février 2025, au moins une quinzaine de boutiques Relay ont été prises pour cible« Les enseignes Relay/Bolloré ciblées à travers la France », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/les-enseignes-relay-ciblees-a-travers-la-france. Fanfares, batucadas et banderoles surgissent dans les gares. Les enseignes sont recouvertes de slogans. Des petits groupes se faufilent dans les boutiques pendant que d’autres distribuent des tracts ou entonnent des chants contre l’empire Bolloré. Certains Relay ont préféré fermer sur-le-champ plutôt que d’être affichés comme magasins de la haine — toute publicité n’est pas bonne à prendre. On peut aisément imaginer que ce type d’interventions s’intensifie dans les temps à venir. Ou que, lors de prochains mouvements sociaux, bloquer les gares visera aussi à mettre hors d’état de nuire ces points cruciaux de l’empire Bolloré.
Ces quelques actions montrent comment on peut partir à l’assaut d’un secteur précis du groupe Bolloré. Chacune offre un angle d’attaque différent, touche de nouvelles personnes, et révèle à tous·tes une nouvelle facette de l’empire. D’autres sont à imaginer. Comment initier une défection des auteur·ices et politiser un refus d’être publié·e chez Bolloré ? Comment co-organiser, avec les employé·es, des piquets devant les dépôts, et les centres logistiques de Hachette ? Comment perturber les agences de pub qui font la promotion des livres d’extrême droite ? Ces questions sont autant de champs d’action qui doivent être creusés pour qu’une acide intranquillité vienne ronger le monopole du groupe Bolloré sur l’édition. Une des prochaines batailles aura en ce sens lieu dans les établissements scolaires qui sont arrosés chaque année de manuels Hachette. Des personnels de l’Éducation nationale, syndicalistes et parents d’élèves ont d’ores et déjà lancé la dynamique dans une nouvelle tribune publiée à l’occasion des journées d’action : « Pour une école émancipatrice, solidaire et inclusive, boycottons les manuels scolaires édités par l’empire Bolloré« Tribune | Des personnels de l’éducation nationale, syndicalistes et parents d’élèves se mobilisent contre l’emprise de Bolloré dans nos écoles », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/ne-laissons-pas-Bollore-envahir-les-manuels-scolaires-et-les-cerveaux-de-nos-enfants. » Si ce mot d’ordre s’avère partagé largement au sein de l’Éducation nationale, qui sait jusqu’où ce refus peut aller ?
Bien sûr, ce n’est pas un marque-page dans un livre ou une tribune qui feront tomber le géant Hachette. Mais la multiplication des points de pression venant à la fois de lecteur·ices, auteur·ices, librairies, éditeur·ices, employé·es, profs, élèves et parents d’élèves, combinée avec des actions collectives et directes au niveau de nœuds stratégiques permet de toucher le groupe en plusieurs endroits, de l’extérieur comme de l’intérieur. Penser le démantèlement de l’empire Bolloré, secteur par secteur, c’est donc réussir à identifier comment une filière fonctionne pour l’attaquer jusqu’à trouver le point de rupture, le seuil de l’intolérable pour l’économie et l’image du groupe.
II. Trouver les points de bascule
Avant le lancement de la campagne « Désarmer Bolloré », nous étions très nombreux·ses à n’avoir qu’une vague idée de ses activités en dehors du versant médiatique. À mesure que nous nous renseignions, nous avons été forcé·es de constater l’ampleur et la cohérence du groupe. Derrière la diversité des secteurs qui ont été ou qui sont encore contrôlés, il y a une trame globale, néocoloniale et fascisante, qui va de l’esclavagisation des populations dans les champs de palmiers à huile au racisme décomplexé dans ses médias, du contrôle des infrastructures portuaires en Afrique au traçage et à la gestion de flux de populations, notamment aux frontières, via les entreprises IER, Automatic Systems et Easier présentes en EuropeCes activités moins connues sont représentatives d’une vision du monde où chaque déplacement, de marchandise comme de personne, serait à la fois contrôlé, maîtrisé et enregistré : IER est spécialisé dans l’optimisation de la chaîne logistique, l’entreprise produit des technologies déshumanisant les travailleur·euses et vend des solutions clé en main que le groupe promeut dans les salons de la police. Automatic Systems est le leader mondial du contrôle sécurisé des entrées tandis que Easier est le paradis du portique (anti-fraudeurs, biométriques, d’immigration, etc.)..
Mais au-delà de cette colonne vertébrale, y a-t-il une cohésion plus grande entre les activités du groupe qui pourrait nous intéresser dans la perspective du démantèlement ? L’intuition première est que le groupe Bolloré fabrique et soutient économiquement des médias réactionnaires pour faire gagner l’extrême droite : les revenus de ces activités sont en partie réinjectés pour la construction d’un arsenal de propagande. Mais plus on cherche, plus on se rend compte que cette idée peut être retournée : le groupe Bolloré pèse de tout son poids dans des élections pour s’ouvrir des parts de marché, déréguler et privatiser des pans entiers de l’économie. Ainsi, si son offensive médiatique en faveur de l’extrême droite semble inédite en France, il en est loin d’en être à son coup d’essai en termes de manipulation des scrutins électoraux. Des propres aveux de Vincent Bolloré, au Togo et en Guinée, le groupe a financé les campagnes des dictateurs Faure Gnassingbé et Alpha Condé. En Guinée, Havas a pris en charge les frais de communication de la campagne de M. Condé, ainsi qu’une partie de la publication d’un livre d’entretiens avec le futur président guinéen réalisé par le biographe officiel de la famille Bolloré« Complément d’enquête. La lune de miel entre Vincent Bolloré et le président guinéen Alpha Condé », France Info, 22/07/2016, disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/video-complement-d-enquete-la-lune-de-miel-entre-vincent-bollore-et-le-president-guineen-alpha-conde_1534047.html. Objectif atteint, moins de trois mois après l’arrivée au pouvoir d’Alpha Condé, celui-ci résilie la concession du port de Conakry et la confie sans appel d’offres à Bolloré Africa Logistics« La Cour de cassation valide la procédure visant Vincent Bolloré pour corruption au Togo », Jeune Afrique, 30/11/2023, disponible sur : https://www.jeuneafrique.com/1509799/politique/la-cour-de-cassation-valide-la-procedure-visant-vincent-bollore-pour-corruption-au-togo/ ; « Port de Conakry : l’affaire Bolloré déclarée “prescrite” par la justice française », Jeune Afrique, 19/07/2019, disponible sur : https://www.jeuneafrique.com/805638/economie-entreprises/port-de-conakry-laffaire-bollore-declaree-prescrite-par-la-justice-francaise/. Comment ne pas faire le parallèle avec la biographie de Jordan Bardella dont la promotion est assurée par les agences Havas ou avec la création d’émissions comme On marche sur la tête, entièrement dédiée à l’union des droites, dans l’entre-deux tours des dernières législatives ?
La question n’est certainement pas : est-ce que le groupe Bolloré veut influencer les élections en France, comme il l’a déjà fait en Afrique ? Mais : pourquoi ? Par conviction idéologique, certainement. Mais cette réponse, aussi vraie soit-elle, a tendance à réduire notre vision aux intentions d’un seul homme. Cela participe insidieusement d’une sorte de fascination pour les ennemis de classe. Nous avons également besoin de comprendre les intérêts matériels d’une méga machine économique comme le groupe Bolloré. Si pour le moment, nous sommes obligé·es de nous en tenir à des hypothèses, des promesses du RN comme celle de privatiser l’audiovisuel français serait pour le groupe Bolloré sans doute aussi intéressante que la concession d’un port.
Il y a donc non seulement une cohérence entre les différentes filières de l’empire Bolloré, liées au sein d’un projet raciste et néocolonial, mais également une fonction de vases communicants entre domination économique, influence politique et mainmise culturelle. Comprendre cette solidarité entre les différentes filières du groupe permet de penser l’effet ricochet de chacune des actions. Un peu comme dans un jeu de dominos, cibler une de ces entreprises, c’est aussi viser toute la structure. Tout d’abord, car cela permet une mise en lumière des différentes ramifications du groupe, mais aussi en venant montrer et attaquer cette solidarité politique tacite entre chaque filière.
Une des questions qui se pose alors porte sur le ou les dominos sur lesquels pousser en premier. Autrement dit : comment choisir des cibles ? Quel angle d’attaque est pertinent ? Pour répondre à ces questions, plusieurs outils ont été mis en place. Une carte publique et collaborative se trouve sur le site desarmerbollore.net« La carte de l’empire économique et médiatique du groupe Bolloré », disponible sur : https://desarmerbollore.net/la-carte. Elle est issue de recherches permettant d’identifier quelles sont les entreprises qui appartiennent au groupe Bolloré et où elles se situent.
Cette carte a plusieurs fonctions. D’abord, partager très largement une réalité matérielle. Elle dit : « Il est aussi près de chez vous. » Plus de cent soixante points y figurent en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, en Allemagne, et au Luxembourg. Elle permet en outre de faire apparaître visuellement comment se composent les différents secteurs du groupe Bolloré. Et bien sûr, cette carte est aussi une invitation à ce que chacun·e enquête de son côté, pour ajouter des points oubliés ou rendre visite à ceux déjà recensés, en allant faire un détour en voiture ou une balade entre ami·es et regarder à l’occasion quels sont les accès qui mènent à telle entreprise, comprendre le site et son fonctionnement, imaginer comment la bloquer, la perturber ou la désarmer. Puis, il s’agira de poursuivre l’enquête pour comprendre plus précisément le site et son fonctionnement : quels sont les horaires de travail ? De quels syndicats sont les délégué·es du personnel ? Quand est-ce que passe l’entreprise de gardiennage ?
Lors de la première vague de journées d’actions décentralisées, plus de soixante mobilisations ont eu lieu partout en France et en Belgique. C’est une preuve que la carte a été fortement réappropriée. Tous les secteurs de l’empire Bolloré ont été touchés. Par exemple, les technologies de contrôle et de traçage ont été ciblées en divers endroits, démontrant ainsi qu’elles sont elles-mêmes peu sécurisées : désarmement du site d’Easier qui se targue de « contrôler le monde depuis la ville de WavreValérie Druitte, « Made in Belgium : Automatic Systems contrôle le monde depuis Wavre », RTBF actus, 10/04/2013, disponible sur : https://www.rtbf.be/article/made-in-belgium-automatic-systems-controle-le-monde-depuis-wavre-7968569 » en Belgique, peinturlurage géant du site de IER à Nantes, intrusion dans le site de Automatic Systems suivi d’un rassemblement à Besançon. Ces journées d’actions décentralisées font ainsi office de premier round. Ensemble, elles forment une offensive globale sur le groupe, n’épargnant aucune de ses activités.
Bien sûr, il faudra plus de soixante mobilisations pour commencer à impacter réellement un empire comme celui de Bolloré. Mais d’ores et déjà, des points saillants apparaissent, certaines cibles peuvent constituer des angles d’attaque pertinents pour déstabiliser le reste de l’empire. Par exemple celui du lien entre le groupe Bolloré et la recherche publique. À Grenoble, des étudiant·es se sont introduit·es dans le laboratoire de l’UGA (Université Grenoble Alpes) qui fait de la recherche pour Blue SolutionsBlue Solutions, c’est l’entreprise du groupe Bolloré qui conçoit des batteries lithium pour les véhicules électriques.. Dans ce labo, les chercheur·euses du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) travaillent pour Bolloré sur le développement de batteries solides Lithium Métal Polymère. À Montpellier, des militant·es sont allé·es alerter les salarié·es du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) qui travaille à l’amélioration de variétés de palmiers à huile en partenariat avec la Socfin, holding détenue à 40 % par Bolloré qui gère des centaines de milliers d’hectares de plantations en Afrique et en Asie du Sud-Est et est connue pour ses exactions coloniales« PalmElit : semences de palmier à huile Cirad® », Cirad, disponible sur : https://www.cirad.fr/collaborer-avec-nous/solutions-cirad-innov/produits-et-services/palmelit et « Recherche et Développement » ; Socfin, disponible sur : https://socfin.com/recherche-et-developpement/. Plusieurs instituts de recherches collaborent avec le groupe Bolloré comme par exemple au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, à l’Université de Nantes, à la Sorbonne, au Collège de France — pour Blue Solutions —, mais aussi à Clermont-Ferrand ou à Gand en Belgique pour optimiser (et verdir) les activités de la Socfin. Ces partenariats sont, a minima, absurdes, voire suicidaires. Ils consistent à faire travailler des chercheur·euses sur les projets d’un groupe dont les médias soutiennent et appuient le démantèlement de l’université. À partir de ce constat, on peut imaginer qu’une rentrée pour sortir Bolloré des universités puisse prendre forme, créant des ponts entre les différentes actions au sein de la campagne et amplifiant ainsi leur écho : en parallèle de la tribune des professionnel·les de l’Éducation nationale appelant à boycotter les manuels Hachette, les activités de recherche de ces laboratoires pourraient être perturbées, par tous les moyens à la portée des étudiant·es, des chercheur·euses en rébellion et des militant·es.
Saisir la cohérence des activités du groupe Bolloré permet donc de trouver de nouvelles façons de lui faire face. Puisque que des interconnexions entre ses différentes activités se dessinent, puisqu’elles partagent des intérêts économiques, il est possible d’attaquer n’importe quel point de l’empire pour toucher le tout. La portée de ces actions, à l’instar des journées de janvier 2025, peut au premier abord paraître principalement symbolique mais c’est justement ce mouvement d’alternance entre enquête et action alimenté par les initiatives locales, qui permet d’identifier et de tester, en acte, des potentiels points de bascule. Ces actions permettent également de révéler des points de faiblesse au cœur de cet empire, des nœuds stratégiques où appuyer pour amorcer un processus de démantèlement.
III. Construire notre camp
Cibler le groupe Bolloré parmi tous les acteurs de l’extrême droite et parmi tous les milliardaires problématiques n’était pas une évidence, mais plutôt un choix stratégique en soi. Lancer une campagne autour d’un « super-ennemi », c’est un moyen de proposer une direction claire, un angle d’attaque précis aux forces et énergies qui se sont retrouvées éparpillées après les élections législatives. Le groupe Bolloré coche toutes les cases, parce que son rôle de propagandiste en chef est largement connu et documenté, parce que le caractère colonial, raciste et extractiviste de ses activités est paradigmatique. Mais cette stratégie de lutte ne fonctionne que si l’empire Bolloré ne devient pas l’arbre qui cache la forêt. Il suffit de regarder, outre-Atlantique, l’alignement des milliardaires de la tech devant Trump pour saisir l’ampleur de la situation.
Il faut comprendre le phénomène Bolloré comme un des symptômes du capitalisme en crise. Crise écologique, crise morale du patriarcat, crise de l’hégémonie devant l’apparition de nouvelles superpuissances impériales et de nouvelles guerres à caractère mondial, crise de création de la valeur et fuite en avant dans des systèmes spéculatifs. Et surtout crise de légitimité, rupture de la confiance. Ce dernier point ne veut certainement pas dire qu’il existe une force révolutionnaire organisée où même une idée largement partagée d’un au-delà du capitalisme. Seulement qu’il est aisé de constater qu’il y a quelque chose de cassé dans la confiance des populations envers les démocraties libérales. Faire ici la liste de tous les indicateurs d’une telle crise de la légitimité serait trop long. Mentionnons, à titre d’exemple et pour le seul cas de la France : les Gilets jaunes, les massifs mouvements contre la réforme des retraites, les révoltes contre le meurtre de Nahel, la gronde agricole de 2023, le nombre exponentiel de ministres sous enquête. On peut lire le tournant réactionnaire du capitalisme comme une réaction face à ces crises. Pour le dire avec Gramsci, l’hégémonie est en voie d’être remplacée par la domination« Si la classe dirigeante ne bénéficie plus d’un consensus en sa faveur, c’est-à-dire qu’elle n’est plus “dirigeante” mais “dominante”, exerçant uniquement la force de coercition, cela signifie précisément que les masses se sont détachées de leurs idéologies traditionnelles, et ne peuvent continuer à croire à ce en quoi elles croyaient jusque-là. », Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Paris, Gallimard, 2021.. Autrement formulé, dans la phase actuelle, le capitalisme assume — revendique — la guerre qu’il mène à une très large partie de la population. La tendance n’est plus à masquer la domination brutale sous le confort feutré de concepts réservés à une minorité de la population comme l’état de droit ou des élections dont on respecte le résultat.
Pour notre camp, il s’agit de se poser les questions : comment ne pas rester empêtré·es dans un mode défensif qui justifierait de sauver nos systèmes d’oppression actuels en craignant pire ? Comment faire émerger de possibles autres manières de vivre que le capitalisme, qu’il soit néolibéral ou fascistoïde ? Comment assumer la guerre qui nous est faite, et passer à l’offensive de façon large, populaire et déterminée ?
Face à toutes ces questions, nous concevons la campagne « Désarmer Bolloré » comme une invitation à se mettre en mouvement pour faire face à la résistible ascension des droites extrêmes. Les forces collectives qui se rassemblent dans cette campagne, les rencontres qui ont lieu, les modes d’action qui sont expérimentés et perfectionnés, les connaissances sur l’écosystème des grands groupes capitalistes qui sont engrangées sont autant de ressources mobilisables dans la lutte pour faire obstacle à la fascisation de la société. La proposition est bien, au-delà de Bolloré, de constituer un front commun. Comment cela fonctionne ? Dans un rapport dynamique entre des actions locales qui se coordonnent, se font écho, se renforcent les unes les autres, et une communication globale, soutenue par les organisations de la campagne, pour offrir aux mobilisations une caisse de résonance aussi grande que possible. Pour le dire autrement, ce mouvement peut sembler simple. Il se construit en réalité, petit à petit, à travers de nombreuses rencontres, réunions, temps d’élaboration, et de synchronisation pour la mise en exécution des différentes phases. Faire front, n’est pas un mot d’ordre unitaire crié à la va-vite, c’est un défi organisationnel et opérationnel.
Cela va de se mettre d’accord à plus de 150 organisations sur un même texte d’appel, jusqu’à construire au fil des mois des temps communs, telles que les journées d’actions décentralisées de janvier 2025, pour que chaque groupe local puisse frapper dans un même laps de temps. Cela passe aussi par partager et diffuser de l’information : des dizaines de soirées publiques ont été organisées un peu partout en seulement quelques mois. Ou encore par réussir à diffuser des centaines de milliers d’impressions en tout genre, marque-pages, stickers, affiches, flyers, etc. Cela peut encore vouloir dire, préparer des mobilisations d’ampleur, comme le grand assaut mené par une armada de bateaux, prévu le 24 mai 2025 sur l’île du Loc’h, que Bolloré a privatisé, au large de Concarneau, en Bretagne. Toutes ces tâches, aussi prosaïques soient-elles, demandent l’investissement de centaines, voire de milliers de personnes, qui au fil des actions partagent une culture de lutte commune. Ainsi un sabotage de nuit, réalisé grâce à la beauté de l’anonymat, comme ce fut le cas contre l’usine Easier à Wavre« La porte d’accès du bâtiment a été forcée en quelques minutes afin de saccager la machinerie lourde et les ordinateurs qui contribuent à façonner un monde verrouillé. Les vitres des bureaux ont été brisées, l’intérieur recouvert de peinture. Il n’est également plus possible de badger pour rentrer dans le bâtiment. », « Dimanche 26 janvier — Wavre, Belgique, Désarmement de l’entreprise Bolloré Easier », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/wavre-belgique-desarmement-de-l-entreprise-bollore-easier peut résonner avec un collage réalisé, par exemple, à Saint-Laurent du Maroni en Guyane« Collage contre Bolloré en Guyane », disponible sur : https://desarmerbollore.net/news/la-guyane-contre-bollore et avec bien d’autres actions encore.
Construire cette force de frappe commune est ce qui peut nous permettre d’enrayer la montée de l’extrême droite au-delà de l’empire Bolloré. Pierre-Edouard Stérin, PDG de Smartbox et du fonds d’investissement Otium, constitue une autre cible de choix. Il est un acteur clé d’une galaxie d’initiatives réactionnaires. Il a investi 150 millions d’euros dans le projet PériclèsAcronyme de patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. qui a pour but de porter le RN au pouvoir, en l’aidant, entre autres, à conquérir 300 mairies en 2026Thomas Lemahieu, « Pierre-Édouard Stérin, saint patron de l’extrême droite française #15. Avec Périclès, Pierre-Édouard Stérin entend faire basculer 1 000 mairies aux mains des droites extrêmes en 2026 », L’Humanité, 12/02/2025, disponible sur : https://www.humanite.fr/politique/droite/avec-pericles-pierre-edouard-sterin-entend-faire-basculer-1-000-mairies-aux-mains-des-droites-extremes ; « Pierre-Edouard Stérin, saint patron des réacs », Le Nouvel Obs, 12/02/2025, disponible sur : https://www.nouvelobs.com/dossiers/20250212.OBS100225/pierre-edouard-sterin-saint-patron-des-reacs.html. Il a également financé directement l’Institut de Formation Politique (IFP) qui alimente les chaînes d’info de Bolloré en sous-journalistes et politistes biberonnés aux éléments de langage des droites réactionnairesThomas Lemahieu, « Pierre-Édouard Stérin, saint patron de l’extrême droite française #14. Thibault de Montbrial, cheville ouvrière de Pierre-Édouard Stérin pour faire converger les droites extrêmes », L’Humanité, 12/02/2025, disponible sur : https://www.humanite.fr/politique/anti-avortement/thibault-de-montbrial-cheville-ouvriere-de-pierre-edouard-sterin-pour-faire-converger-les-droites-extremes ; Elodie Guéguen, « Pierre-Edouard Stérin, le milliardaire au service des droites extrêmes », France Inter, 22/02/2025, disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-fevrier-2025-3617308. Dans ces nombreuses initiatives, on trouve les Nuits du Bien Commun. Fondées en 2017, ce sont des soirées bon teint visant à financer un fonds de dotation lui aussi pour le « bien commun » dans lequel Stérin a déjà investi plus de 800 millions d’euros. Les projets qui gravitent autour de ces Nuits du Bien Commun sont, pour une part non négligeable, des associations anti-avortement, révisionnistes, identitaires, nationalistes ou encore catholiques intégristes. On y trouve des proches de Zemmour, de Marion Maréchal-Le Pen, des figures notoires de groupuscules néonazis, ou encore des membres du Journal du Dimanche (JDD) et de Valeurs actuelles (appartenant à Bolloré) étant passés par l’IFP. Les Nuits du Bien Commun remplissent allégrement les caisses d’une myriade d’initiatives d’extrême droite tout en défiscalisant en masseL’équipe de Stérin, qui a levé près de 1,4 millions d’euros à l’Olympia (propriété de Bolloré) début décembre 2024, l’a bien rappelé : « Ce soir, vous serez généreux, mais le plus généreux, ça restera… L’ÉTAT. », Youmni Kezzouf, « À l’Olympia, une soirée pour financer l’écosystème catho-tradi », Mediapart, 10/12/2024, disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/politique/101224/l-olympia-une-soiree-pour-financer-l-ecosysteme-catho-tradi. Elles servent aussi de rendez-vous de réseautage, structurant les bourgeoisies intégristes locales.
Une des particularités de ces Nuits est qu’elles ont lieu très régulièrement, dans de nombreuses villes. Avec plus de quinze lieux annoncés pour 2025, c’est une sorte de tournée permanente. Mais pour le moment, les Nuits du Bien Commun ont globalement réussi à passer sous les radars des organisations antifascistes ou féministes. Ils officient en grande pompe, dans des salles souvent publiques, sans presque être dérangés. Quand une manifestation contre une Nuit est organisée, comme ce fut le cas, avec beaucoup de succès, à Rennes, fin novembre 2024, celle-ci a un écho principalement local. Mais alors que nous finissons d’écrire ce texte, une campagne d’action contre ces Nuits du Bien Commun est sur le point d’être lancée par un collectif antifasciste. « Désarmer Bolloré » en sera l’un des acteurs et lui donnera autant d’écho que possible afin qu’aucune de ces Nuits ne puisse avoir lieu sans être perturbée ou bloquée. Pour que, de dates en dates, des coalitions toujours plus grandes, réunissant syndicats, AG antifascistes, collectifs féministes, organisations écologistes, fassent en sorte que la galaxie Stérin ne trouve plus aucune salle à louer. Il y a là un concours à lancer. Qui aura les plus belles banderoles ? Qui aura le cortège de tête le plus massif ? Qui réussira à encercler la salle où se tiennent ces Nuits ? Qui empêchera les participant·es d’y rentrer ?
L’empire Bolloré et la galaxie Stérin sont de ces structures économiques en campagne permanente pour imposer un monde ultra-libéral et ultra-conservateur. Depuis plusieurs années, elles organisent le renouveau de l’extrême droite, et ce bien au-delà du Rassemblement National. Elles l’alimentent financièrement et idéologiquement. Stérin et Bolloré représentent ce lien, toujours présent, entre économie et domination, ils sont la face brutalement prédatrice du capitalisme. Un des paris de la campagne « Désarmer Bolloré » est de cibler ce lien en constituant un large front de lutte doté de forts ancrages territoriaux. L’expérience des Soulèvements de la terre nous indique que c’est en mouvement, d’actions en actions qu’une telle dynamique se crée et se solidifie. Nous avons tenté d’expliquer, comment, au quotidien et de façon très terre-à-terre, un tel front se constitue. Nous allons continuer, dans les mois et les années qui viennent, à le faire grandir. Nous voulons apprendre, avec un nombre encore plus grand de collectifs, de groupes, d’organisations, qu’elles soient issues de l’écologie ou de l’antifascisme, du féminisme ou du syndicalisme, à combattre ensemble.
Attaquer en de multiples points un secteur ou une filière ; identifier des liens entre les filières afin de comprendre où des assauts précis peuvent déstabiliser l’ensemble ; construire, pied à pied, un front de lutte vaste et offensif. Telles sont les trois hypothèses que nous proposons pour penser le démantèlement d’un empire aussi vaste que celui de Bolloré. Elles sont exposées ici de façon embryonnaire, car la campagne « Désarmer Bolloré » n’en est qu’à ses débuts. Mais nous croyons fermement qu’elles valent plus que les programmes électoraux ou les promesses toujours repoussées du Grand Soir qui nous confinent dans une apathique attente. Si ce plan ne doit avoir qu’une vertu, c’est sûrement la suivante : nous avons commencé. Nous pensons, avec des milliers d’autres, qu’il n’y a plus à s’indigner de la montée de l’extrême droite. Comme si nous devions nous contenter d’être sur le banc de touche et de prendre acte des points que marque l’ennemi. Nous voulons briser la stupeur et l’effroi qui, trop souvent, nous paralysent : démanteler, non seulement l’empire Bolloré, mais toute l’impériale domination du capitalisme sur la surface de cette Terre.
Note sur la production du recueil
Depuis Offprint 2024, où l’idée du recueil est née et jusqu’à son départ en impression et la mise en ligne du site deborderbollore.fr, seulement quelques mois se sont écoulés. Une séquence courte mais intense. Il nous a fallu alors imaginer et déployer une architecture de travail qui soit opérationnelle, efficace et transparente vis-à-vis de l’ensemble des coéditeurices, tout en essayant d’incarner la variété et la multiplicité que représente le monde de l’édition indépendante.
Une vingtaine de personnes a alors œuvré à la production du recueil, du site web, et de leurs à-côtés ; communiqués de presse, supports de communication, etc. L’organisation du travail s’est faite en comités (édition, relecture, mise en forme, développement web, administration système, communication et presse) auxquels chacun·e s’est affilié·e en fonction de ses sensibilités, compétences, possibilités et préférences. À l’image de nos modes de travail, cette organisation a gardé souplesse et porosité, pour prêter main-forte là où le besoin se faisait sentir.
Nous nous sommes directement inspiré·es de La PastèqueLa Pastèque, nº 0, décembre 2024, disponible en version papier et en ligne téléchargeable sur : https://drive.google.com/file/d/1UYkmSIwDggeSlZdZ-bDlnwU4z_jGnOJf/view, un projet éditorial qui a vu le jour à l’automne 2024, dont l’objectif est d’ouvrir un espace aux voix palestiniennes sur les territoires francophones, dans lequel chacune des maisons d’édition engagées dépasse le cadre de travail de sa structure pour en former un nouveau.
Ce présent recueil fait partie des cinq formats de lecture déployés dans le cadre du projet. Parallèlement à sa sortie en librairie, le site internet, deborderbollore.fr, a été développé par une équipe de graphistes et développeureuses. Il permet de consulter facilement les contenus du projet Déborder Bolloré, de les télécharger et de les imprimer au format A4 (feuilles), A5 (livret) et EPUB. Les objectifs de cette plateforme de publication multiformat sont :
-
Faciliter le libre accès et la libre diffusion des contenus afin que ces textes soient disséminés le plus largement possible, quelles que soient les conditions matérielles, économiques et géographiques des lecteurices ;
-
Améliorer l’accessibilité des contenus en ne distribuant pas seulement des livres imprimés et des PDF mais aussi des contenus aux formats du web, permettant d’inclure les personnes empêchées de lire ;
-
Permettre la publication et la mise en circulation de contenus qui seraient considérés comme finis après le départ à l’impression du recueil, en laissant ainsi la porte ouverte à d’éventuels prolongements (traduction, écriture de nouvelles contributions, second recueil, etc.).
Un ensemble d’affiches imprimées en risographie circule parallèlement à la publication du recueil et la mise en ligne du site. Ces affiches, pour lesquelles des commandes d’illustrations ont été passées à Aurelio Gonzalez, Blandine Molin, Yiulia Panova, Margot Soulat, Justine Thévenin et Maya Mihindou sont des invitations à déferler sur Bolloré. Une police de caractères, la Aalter, a été spécifiquement dessinée par l’un·e des membres d’une des structures signataires pour unifier visuellement la multitude de ces formats.
Enfin, pour répondre aux contraintes imposées par une temporalité éditoriale extraordinairement restreinte, un convertisseur de fichiers a été développé pour que les textes à retrouver sur deborderbollore.fr soient directement générés depuis le fichier InDesign envoyé à l’imprimeur. Cela permet, entre autres, d’éviter les conversions « à la main » et les doubles reports de corrections.
Qu’il s’agisse d’un projet pour soutenir la cause palestinienne à l’instar de La Pastèque, ou de celui-ci, qui met en lumière les dynamiques de concentration par de grands groupes éditoriaux, ce qu’il faut lire en filigrane, c’est la nécessité d’imaginer de nouvelles formes d’organisation entre nos structures. Ces dernières passent par la mise en commun de nos compétences d’éditeurices, de relecteurices, de graphistes, typographes, traducteurices et développeureuses et la redéfinition de nos outils pour en renforcer la dimension collaborative. Tout cela, dans le but d’être plus opérant·es et rejoindre, depuis nos positions d’éditeurices, celles et ceux qui luttent contre le libéralisme autoritaire croissant.
Coédition
Une coédition de : *éditionsMagiCité., 16b éditions, Abrüpt, Acédie 58, Adverse, AFRIKADAAA, Agone, L’Amazone, Anacaona, Archives de la Zone Mondiale, Arnaud Bizalion Éditeur, Association Presse Offset, éditions de l’Atelier, L’atelier du poisson soluble, Atelier Téméraire, éditions b:t, bibliothèque fifi turin, Bluff books, La Boucherie Littéraire, Bouclard éditions, Les éditions du bout de la ville, Burn~Août, C&F éditions, Le Calicot, Le Carnet d’Or, Chemin des Crêtes, éditions du commun, Copie Gauche, Cosmic Studios, Courgette Editions, Courte échelle, éditions Daronnes, Dépaysage, Dépense Défensive, Le Détour, La Dispute, divergences, Écosociété, En 3000 éditions, Les Étaques, Evalou, éditions Excès, Fémixion, éditions fier·es, Les éditions FM, Fotocopias, FSB Press, Goater, les éditions du gospel, éditions du Grand Peut-Être, La Grange Batelière, HCKR, Hélice Hélas, Hématomes éditions, The Hoochie Coochie, Hors d’atteinte, Ici-Bas, Idoine, Îlot, katadorquie, La Lenteur, Lézard des Mots, éditions Libertaires, Libertalia, éditions des Lisières, Lorelei, M éditeur, Maison des éditions, maison trouble, Massot éditions, Matière Grasse, Même pas l’hiver, éditions Météores, éditions MF, Miam, milgrana, Les Monts Métallifères, Multimédi@, Le Muscadier, Nada, Ness Books, NONFICTION, OANI, L’Œil d’or, Oui’Dire éditions, pan, Paraguay, le passager clandestin, éditions petites singularités, Phenicusa Press, Les éditions du Portrait, Présence(s) éditions, primitive press, Les Prouesses, PVH éditions, Rackham, RAG, Les Règles de la nuit, Rotolux Press, Rue de l’échiquier, éditions de la rue de l’Ouest, éditions de la rue Dorion, Le Sabot, sahus sahus, les éditions sans escale, Selma & Salem, Shed Publishing, éditions silo, Les éditions sociales, solo ma non troppo, Strandflat, Super Loto éditions, Surfaces Utiles, Syllepse, Tache Papier, Terrasses, éditions terres de Feu., éditions des Trois Canards, trouble, Tusitala, éditions Véliplanchistes, Le Ver à soie, les vilains, La Volte, Winioux, YBY éditions, Yovana, zoème.
Ont travaillé à la production de ce présent recueil, les supports annexes et la mise en ligne de la plateforme de publication deborderbollore.fr :
Colophon
Relecture par Collectif.
Illustré par Bakonet Jackonet.
Développé par Camille de Noray, Quentin Juhel.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, mise en page avec InDesign et imprimée en Offset, rotative sur carton gris 1 jet 350 g/m², Holmen book extra 65 g/m² en 10 000 exemplaires lors du premier tirage par Floch, 778, avenue Gutenberg, 53100 Mayenne, reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en juin 2025 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-421-7.
Cette version a été composée par Collectif en Aalter (Alaric Garnier), Exécutif Moderne (Alaric Garnier) et en fourmis..
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.