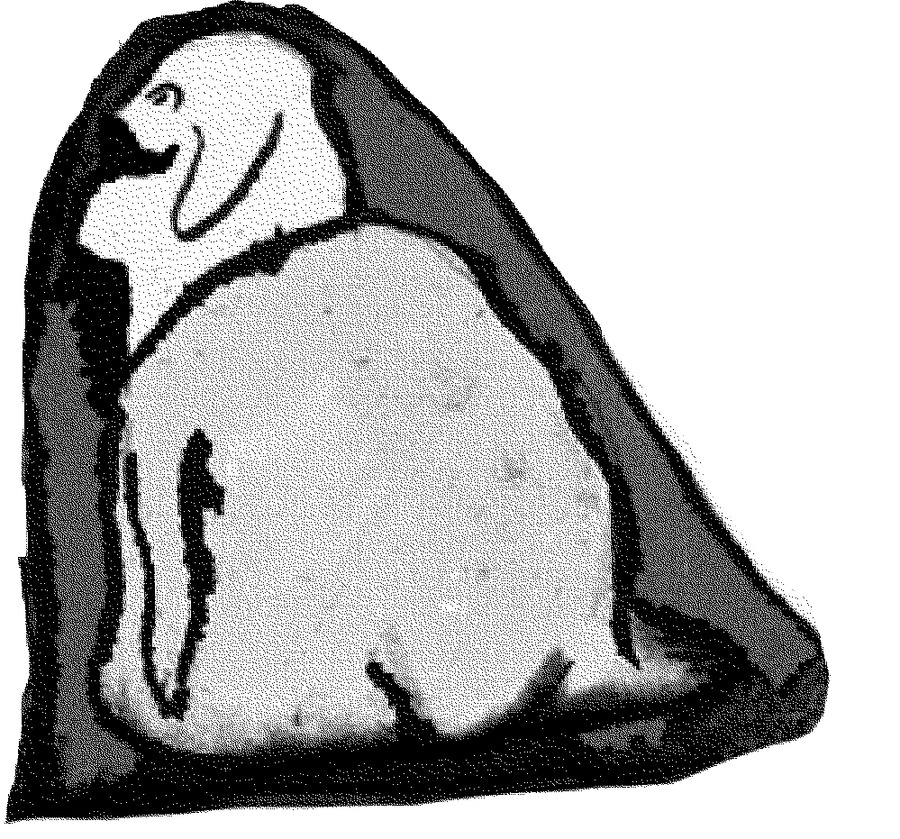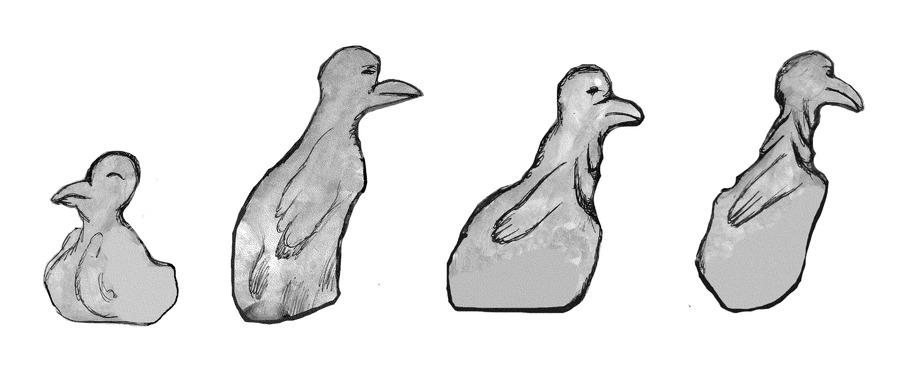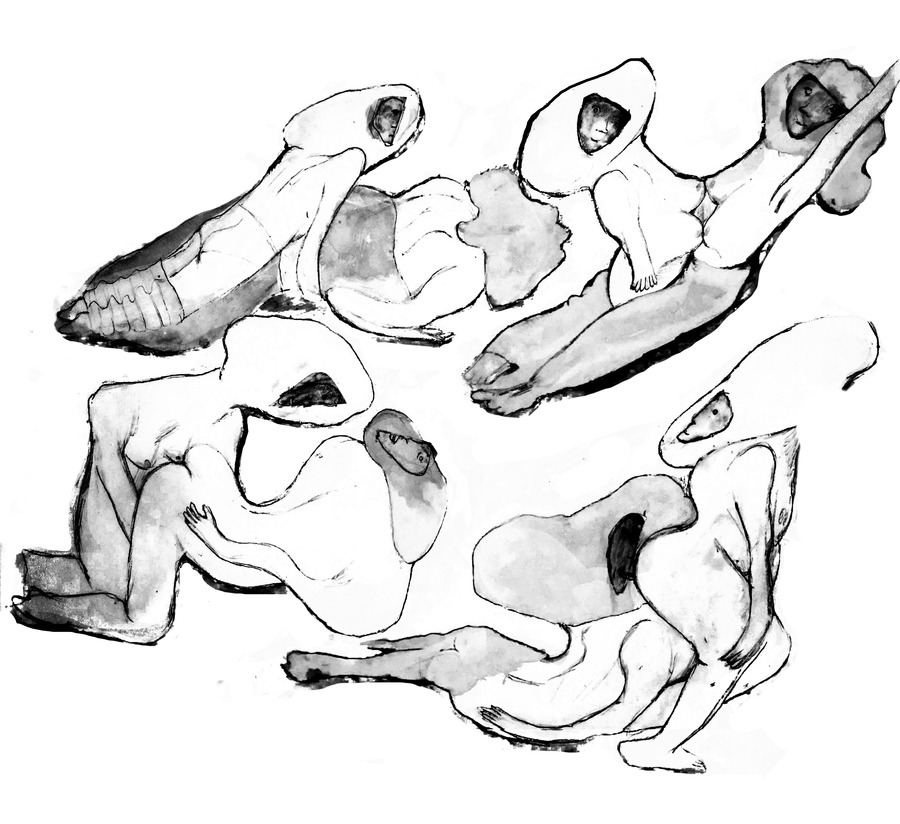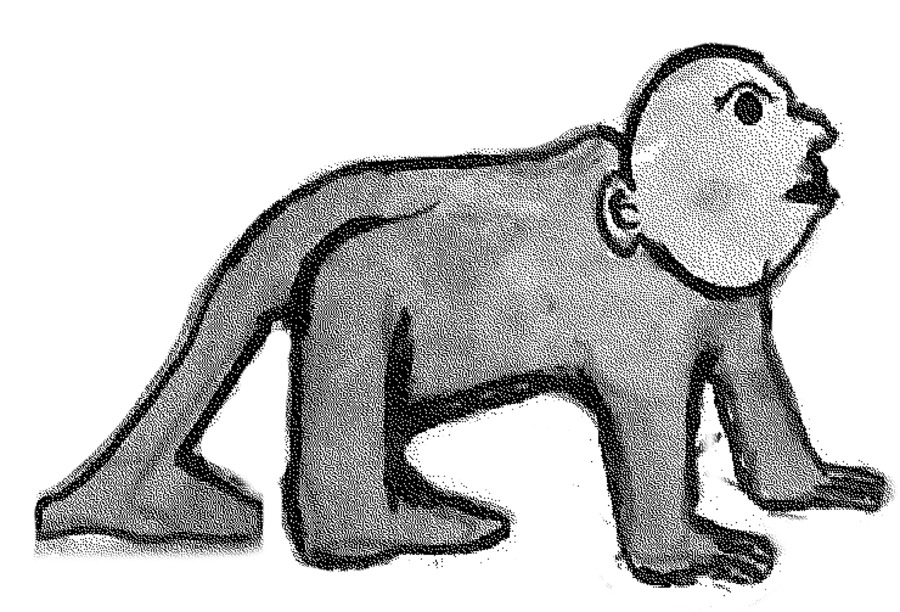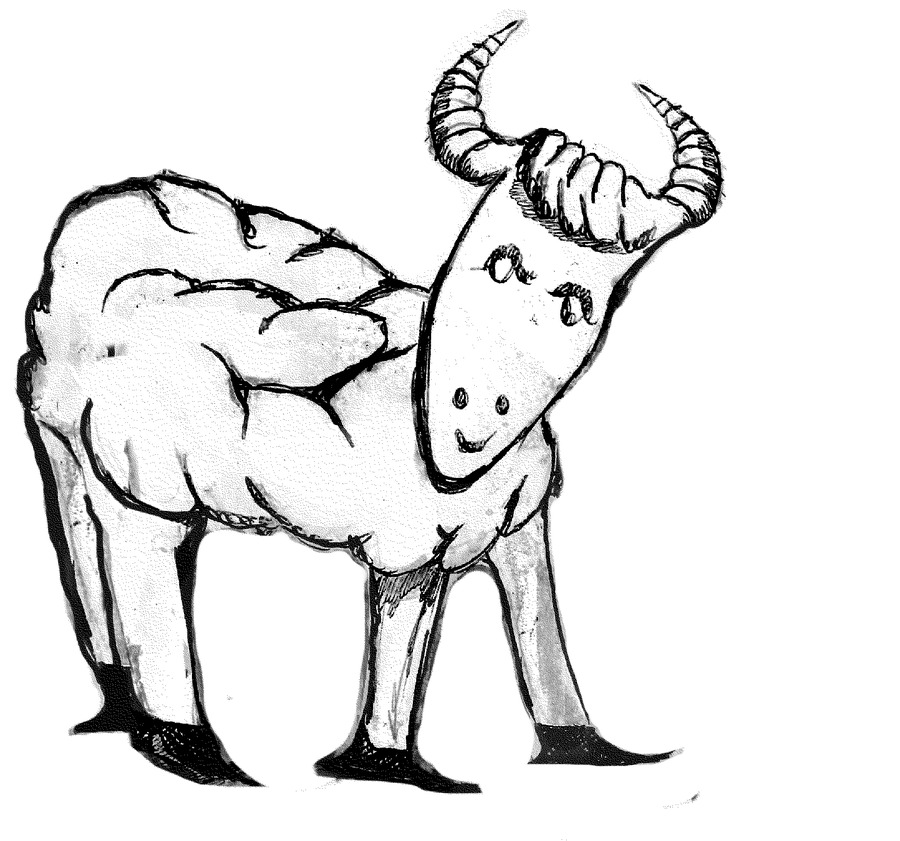Table des matières
C’est les vacances, n° 3
C’est les vacances regroupe des auteurices de plusieurs générations, explorant des littératures poétiques, dramaturgiques, théoriques. Ce premier numéro est articulé autour de la colère : le sentiment et les actes qu’elle motive. La dimension littéraire des textes s’enchevêtre à une dimension militante, notamment autour de manière de voir, de vivre et d’aimer. Les textes explorent le meurtre, l’art, la sexualité, le désir.
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 31/12/25 à 21 h 42.
- Avant-propos
- [05/12/2024 16:04:22] : ° les yeux endormis tombent dans les pommes ° —
- I just adore dykes (and I think you are a pretty dyke) —
- Aquatour —
- Promenons-nous —
- La poule au ventre —
- Taxi pour la gare, extrait de « Devenir Grace » —
- Hors hôpital : M A L A D E L A N D, un vrai coup de gueule —
- Domination, Fric et Persiennes —
- Avec des chansons pour les enfants —
- VENUS-1943-JOPLIN.JANIS, Canal Vénus —
- Quenotte, aux pensées magiques —
- Une batte pour les petits bourgeois —
- L’œil du cyclone —
- Entre l’épine et le clou —
- Formule 1 —
- Un medley, à minuit moins cinq, au parking du stade, après un combat corps à corps. —
- Note sur la graphie des genres

« C’est les vacances pourrait être un cadeau pour celles dont les yeux sont bordés de larmes, celles dont l’état de tristesse se trouve aggravé par les beaux jours. Quand toutes les autres semblent si détendues et passent leur journée au grand air, se baignent et rient dans l’air tiède du soir, pour celles qui n’éprouvent pas le moindre désir de sortir de leur chambre. »
Avant-propos
« Qui a le droit à l’auto-défense et quels sont les moyens de cette auto-défense ? Édifier un autel pour la vengeance. Ce qu’il aura fallu de douleur pour devenir aussi dure, quoi nous ramollirait ? Contre la guerre à outrance, la grève générale avec occupation générale. Le format de cette occupation, est un poème, est une litanie, est une chanson, est un cri, bien organisé, qui sonne, fan fiction violente, qui prolonge, amende, déforme les produits médiatiques. » Nous avons publié et diffusé cet appel à contribution l’été dernier, il a permis de rassembler les textes du présent numéro.
[05/12/2024 16:04:22] : ° les yeux endormis tombent dans les pommes ° —
J’ai des problèmes de vue, comme beaucoup de gens. Certainx même ne voient pas. La vue se dégrade. On s’en rend compte quand, soudain, une amie te demande si tu as vu le hérisson mort au loin, et que toi, tu pensais que c’était juste une flaque d’essence un peu visqueuse. La myopie c’est lorsque les rayons lumineux ne se rejoignent pas directement sur la rétine, c’est une altération entre la lumière extérieure et le corps en surface. L’onde sur la flaque encore plus floue. La pluie devient brouillard, les arbres des mousses poilues, les yeux des autres comme des miroirs opaques. Je ne portais ni lunettes ni lentilles : ne pas voir devenait ma parure transparente et soulageante, mon bijou d’invisibilité. Je croyais profondément que celleux qui m’entourent ne me verraient plus, parce que moi même je ne les voyais pas. J’y ai longtemps cru. Je disais que j’avais oublié mes lunettes et même avant un rendez-vous ou parfois un date, j’écrivais un message pour prévenir de venir vers moi, parce que je n’étais pas sûre de repérer la personne attendue. Rien voir c’était se penser invisible. Un sentiment plutôt apaisant. Un anonymat déguisé. Une cachette sensorielle dans l’espace public, au sein de la ville et des environnements bourdonnants. Mais une vue floue, c’était aussi ne pas pouvoir anticiper des rencontres désagréables ou qu’on aimerait mieux éviter. Cette année, je suis retournée consulter pour mes rétines. 2024, multiple de deux, multiple de langues pendues, suspendues, susurrantes. Ma langue sans toi. Mes yeux sont secs. Je devais pouvoir bifurquer, tourner le dos, changer de route. Je devais pouvoir partir. Discrètement. J’ai commandé des lentilles journalières. J’écarte mes paupières, j’approche la lentille et
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSssssSSSSssssssssssSSSSsssssssSSSSSSSSSSsssSssssSsssssssSssssSsssSsssssssssllllllup
elle s’absorbe à mon iris. J’ai les yeux bleus et j’aime bien les yeux noirs, ceux dont on ne voit pas la pupille. Moi c’est l’inverse, tout devient ultra visible. La dilatation est un carnaval dansant dans ces petits trous de visage. Mais voir impliquait de devenir visible. J’ai pu discerner les contours d’un rocher, d’une fenêtre, d’une rose, d’un escargot éclaté. Les délimitations des objets, des choses et des corps devenaient précises. C’est étrange, je m’habitue pas tout à fait. Les nuages, l’écume et ta salive, cependant, ne changent pas et m’offrent inlassablement des textures brumeuses et confuses dans lesquelles se lover. Mes yeux je les quitte tous les soirs : je décolle les prothèses de mes globes oculaires humides, et je les noie, et je les brûle. Je les verse dans les toilettes ou dans l’évier tout en rinçant quelques traces de dentifrice. Je les garde dans ma main, elles durcissent un peu, elles s’assèchent, et je les brûle une à une avec une bougie. Ça crépite et ça pue. Ça se consomme vite. Les yeux brûlés et la flamme affamée. Je la regarde, apaisée. Les eaux grasses, les eaux graissent mes globes. Je retourne aux lisières troubles, indécises. Tout est un peu plus duveteux et moelleux. Pourtant ma langue s’avale et se coince dans la gorge. Elle se retourne et m’étouffe calmement. Je ne peux pas enlever ma bouche mais je peux la garder fermée. Alors ça s’accumule entre les canines et la gencive. Et les larmes qui ne coulent pas ne partent pas en vacances, elles se préparent à la plus bleue et inconsolable des submersions. Du miel à la noisette et une allumette cachée dans mon sexe, ça me rassure pourtant. Je ne sais plus ce qui est visible de moi, alors je tente quelques techniques secrètes pour avaler mes yeux par le reste du corps. Je dessine des points bleus au bout de mes doigts, je déchire un tee-shirt au niveau de mes tétons, j’insère des écorces d’orange dans mon anus, je lèche mon coude en cas de doute, je ne porte pas de culottes, je glisse des mots dans mes chaussures. Je reste disponible, jusqu’à ce que je m’endorme. Le sommeil brutal, celui qui arrive quand le cœur est saturé et la tête retournée. L’anesthésie crue et fantastique, celle qui dit ÉCLIPSE, celle qui avale les corps, celle qui interrompt. Rupture narcoleptique. Enlever ses yeux, s’endormir lors d’émotions trop vives ou de conflits infinis, c’est comme tomber dans les pommes en cas d’extrême danger. Pourquoi mon corps s’abandonne ? Il s’agit de s’extraire. Mais comment revenir ? Je pensais aux déserteureuses, je me disais que j’étais un peu dans la même situation avec mon propre corps au milieu d’autres humainx. Les autres vivantx m’assouplissent et m’entraînent dans leurs creux et leurs sinuosités différentes, à écailles gélatineuses, écorces fragmentées, plumes emmêlées, orifices tentaculaires et autres épidermes mutants. Déserter, ce n’est pas devenir sèche et aride comme un désert. C’est partir d’une situation qu’on n’accepte plus. On ruse : on met des épouvantails, de bois, d’osier, de pierre, de chair, pour empêcher les oiseaux et les indésirables de piller ce qu’il reste de fruits, de graines, de ressources et d’intimité. On reste là mais plus plus tout à fait. On est presque là, et cela signifie qu’on oublie ou déplace quelque chose de soi quelque part. Pour se protéger tu crois ? Peut-être. A.W.O.L est une expression en anglais qui signifie Absent Without Official Leave. Je n’étais pas formellement partie mais il ne restait que ce qui pouvait se taire : être encore aimante et ma colère impossible car, par avance, réprimée. Les ondes électromagnétiques de certains regards me grésillaient. Ma salive se condensait. Je craignais que mon coeur devienne un abricot sec, un fruit sec, un truc sec. Votre langue est sèche, buvez de l’eau ! J’imaginais que tous mes liquides s’étaient évaporés malgré moi. Larmes verticales orientées ciel, paroles liquides au creux de tes mains. Quand j’écrivais ce texte, je t’envoyais quelques passages pour que tu me dises ce que tu en penses, t’as répondu : « Peut-être que je me demande pourquoi le texte est parfois érotique, ça pose cette question : est-ce que l’érotisme est aussi une forme de défense ? » Je t’ai fait un vocal. Je pense à des bouches muettes et saturées, des dents qui s’effritent. J’écris BOUCHE sur google. Je lis « la plupart des animaux ont un système digestif complet, avec une bouche à une extrémité et un anus à l’autre. Selon l’extrémité qui se forme en premier en embryologie, on peut classifier les animaux en deux catégories. Quelques animaux n’ont pas d’anus : ils excrètent leurs déchets par la bouche. » J’ai des problèmes digestifs. Mes organes se camouflent, c’est ce que disent les aiguilles. Mais, de ma bouche à mon cul, tout ce qui me déforme se dissout. Tout ce qui me perfore se fait vitrail. Parce qu’il reste cet endroit, sans aucun complice de la peur, où nous nous mêlons.
I just adore dykes (and I think you are a pretty dyke) —
Monde a creusé un ventre Corps Monde s’arque avec mien Monde murmure des secrets Monde ne veut rien de moi, si ce n’est embrasser ma peau Et le feu Soleil veut tout pareil Monde laisse les oiseaux me chanter bonne nuit, c’est pour que je m’endorme bien, mais moi je sais pas encore si j’ai sommeil Parce que je salive Les lesbiennes s’étaient installées dans le gros fauteuil vert olive, sous les arches de pierre : Tomorrow isn’t promised, sit on my face today moi, j’étais mes os, mes cheveux, ma peau, (de mon étoile, une lumière cachée sur ma langue, que je pourrais déposer sur la tienne) et mes mains sont miennes et ma bouche est mienne et moi je grimoire de salive je salive de grimoires et mes joues sont bien rouges et chaudes et passe ses doigts sur ma nuque bien dure Monde fait brisure alors que moi je voulais juste soigner mon sang Quand je vois la croûte je la gratte sans soin Pourtant je les pose bien les pansements sur les bobos des enfants de l’école, je les soigne gentiment et les embrasse sur le front, je mords pas la chair Ça sent le thym My love is not a waste My heart will always be huge with no shame Hier dans la nuit, j’ai pris mon ordinateur pour explorer ton profil j’ai dû prendre le chemin des câbles sous-marins en fibre optique, de métal, de verre, de cuivre et de silicium, ça transmet bien la lumière, I love that whenever I cross the blue light — it brings a gentle existential feeling all around my spine my chest shall be filled with wires and electronic pumps les tubes cathodiques me donnent plus à voir de toi les signaux de lune me montrent ton visage il est beau et moi je salive bien fort I filled a lever with dirty dishes Empty dishes mean people are fed And I should be fed with sweet treats Monde s’effrite doucement, comme un pain sec trempé dans le lait S’efface en miettes entre mes doigts, et moi, je ne sais pas si je veux la reconstruire, ou la goûter jusqu’au dernier grain Il pleut des rivières invisibles qui descendent sur mes jambes L’herbe colle à ma peau Mes orteils creusent la terre J’ai laissé une empreinte, une chaleur, un poids, Je dépose mes os dans le sol Dans le fauteuil vert olive j’ai laissé une odeur un mélange de peau tiède et de cuir vieilli et là je salive encore I just adore dykes And i think you are pretty A pretty dyke The prophetic bird came to me this morning And now there is a spiderweb full of raindrops If you had a garden, what would grow within it ? is literally all I crave
Aquatour —
Tout s’est éteint. Ça a commencé par des coupures de courant au quatrième étage. On a appris à survivre sans. On a construit un système bis. On a cherché de l’électricité sous la terre quand il y en avait encore. Maintenant tout est sec et à la tour, ça ruisselle. Quand l’électricité a été coupée à Paris et autour, nos systèmes B ont continué de fonctionner. La tour est devenue un refuge où l’électricité est rationnée — comme avant — mais ça suffit. Les artistes de la tour ont dû quitter leurs appartements que la crasse sèche de la ville a recouverts d’un coup. Ça s’est passé en une semaine ; comme un courant d’air sous une chaleur suffocante. Dehors, tout est brun, marron, sale. La couche de crasse qui recouvre tout a dû atteindre douze centimètres maintenant, calcule Dani. Ça commence à faire courber ce qu’il reste des arbres.
Brassière, T-shirt, sous-pull, pull, gilet, veste, manteau, elle assemble stratégiquement chaque couche de vêtement comme pour sceller son corps qui lui est encore frais et moite. Ce corps, elle fait ce qu’il faut pour le sortir de la tour de temps en temps. C’est risqué, personne n’aime qu’elle fasse ça. Pourtant personne ne sait ce qu’elle fait, ne serait-ce qu’elle revient toujours un peu plus sale encore. Cette saleté, c’est ce qui l’attire ou plutôt ce à quoi elle croit s’attaquer. C’est la possibilité de sa destruction qui l’appelle. Alors quand elle peut, quand elle sort, ses poches ruissellent. Les gouttes qui immergent le tissu et que la gravité dirige vers le sol forment de minuscules cercles de boue qui se résorbent presque immédiatement. C’est ce qui sauve Dani, l’eau est trop précieuse pour la transporter dans ses poches et la faire couler sur ses jambes nues jusqu’à la terre caillouteuse de gravats. Dani sent le froid se répandre sur ses cuisses puis ses mollets avant de disparaître pour s’écraser après ses pieds. Elle sait qu’elle doit accélérer. Elle cherche un endroit à l’abri, elle espère pouvoir retourner là où elle était la dernière fois, même si c’est dangereux. Ce danger l’excite mais c’est l’espoir de voir si son travail précédent a porté ses fruits qui la guide. Presque arrivée, elle fait demi-tour et choisit un autre spot, plus safe.
Accroupie sous un vestige d’arbre, Dani sort les mains des poches de son manteau au bout desquelles sont accrochées des guenilles mouillées. Doucement, son grand corps se met en mouvement, d’abord au ras du sol, elle attrape dans un geste de craquelure ce qui, sous l’épaisseur de poussière, semble être une feuille. Elle souffle, souffle encore, on croirait qu’elle mime un époussetage mais la poussière se fait plus fine. Enfin, ses grandes mains passent sur ce qui ressemble de plus en plus à une feuille et repassent jusqu’à ce que le vert refasse surface. C’est le vert d’un thé qui a trop infusé. Un vert utilisé un vert souillé. Dani ne peut pas risquer qu’on la voit utiliser de l’eau pour laver ce qu’on espère encore être des feuilles. Après deux ou trois feuilles, souvent elle part. Ça fait 17 jours qu’elle a commencé, sans savoir pourquoi, mais quand elle a vu l’eau couler à la tour, elle a voulu essayer. La nuit, elle dépose ses guenilles tout contre le mur, bien tassées dans la jonction entre le mur et le sol. Le matin, quand personne ne regarde, elle les récupère, les fourre dans ses poches et part. Elle sait que les artistes de la tour vont commencer à se rendre compte pour l’eau. Il n’y a plus beaucoup de murs ; presque seulement ceux qui délimitent l’intérieur de l’extérieur et ceux de la cage d’escalier. Tout ce qui n’était pas porteur a été cassé pour faire des espaces plus propices aux pratiques des ateliers. Les murs n’intéressent personne. Pour calfeutrer la tour de l’intérieur on a doublé les murs de bâches en plastique. La lumière qui transperce les fenêtres est depuis blanche et chaude : uniformisée, elle inonde les plateaux de sa puissance du dehors.
Dani regarde son café. Il est trop chaud. Elle ne déteste pas se brûler les doigts avec le café. Combien de personnes boivent encore du café en dehors de la tour ? Sans l’eau qui coule des parois et le système de filtration que Jo a réussi à fabriquer, il n’y a même pas d’eau. Le système de filtration de Jo semble efficace, mais le seul indicateur de son bon fonctionnement est notre plus ou moins bonne santé après avoir bu l’eau filtrée. Mais toute·s ceux·celles qui l’ont bu sans le filtre ont fini par ne plus sentir le poids de leurs os et leur corps ne les a plus soutenus. On entendait des bruits de chairs qui frappent le sol suivis de pas qui accourent, même plus de cris. Au bout d’un moment on savait que les membres s’écoulaient, mais que c’était seulement pour un moment. Les premier·es à tomber sont resté·es à terre plus longtemps. On ne savait pas quoi faire de leurs visages qui relâchaient le liquide des orifices — ça commençait toujours par les larmes, puis la bave, la morve. Tout se mélangeait dans une flaque brillante et un peu opaque. Pour les premier·es on a cru qu’il fallait conserver la flaque : on faisait des petits tubes. Les évanoui·es continuent de garder leurs petites fioles, au cas où. Pourtant iels ont fini par se relever, une faiblesse passagère, comme un court-circuit, tout le mécanisme reprenait du service peu de temps après la chute. Certain·es ont même raconté qu’on se réveille métamorphosé·e de cette extraction passagère de gravité. Plus fort·es. C’est vrai que celles·ceux qui sont tombé·es n’ont plus jamais senti cette déflagration des membres. Peut-être est-ce parce que Jo a mis au point le filtre entre-temps ? Ou le contact des corps débarrassés de quelques liquides, sur le sol froid de la tour a déclenché quelque chose. Tout coule ici les parois les orifices des évanoui·es et autour tout est sec.
À travers la bâche qui se gonfle de l’air chaud qui vient du dehors par les étroits interstices que l’usure des joints a créés, Dani fixe l’amas de poussière qui s’est accumulé sur le rebord de la fenêtre. Elle pense à cette poussière pareille à de la terre sèche. Elle la détestait, mais pas comme avant. Avant elle en avait peur. La terre la repoussait, la forçait à vivre en hauteur, à emprunter les seuls bien que nombreux chemins de béton. Cette peur lui dictait autrefois sa vie. Elle avait réussi à changer son rapport à cette terre mais aujourd’hui, comme dans un combat, elle sentait que la matière reprenait le dessus sur elle. Ça avait commencé par le besoin d’en nettoyer les quelques feuilles qu’elle avait pu atteindre lors de ses sorties secrètes. Et là, voyant ce petit tas de terre sèche qui s’étend du rebord de la fenêtre jusqu’à un horizon, elle est prise d’une panique qui lui coupe le souffle. Suspendue à sa respiration qui ne revient pas, elle se sent devenir rouge. Son air coincé dans ses poumons remplit peu à peu tout l’espace de sa cage thoracique mais au lieu de gonflée, elle la sent comme projetée vers l’intérieur. En l’espace d’une seconde, tout se calme, l’air se fraye un chemin à travers son thorax et jusqu’entre ses lèvres, elle se retourne, Jo est là derrière elle, iel vient d’arriver, doucement.
Dani seule dans son lit repense au vert qu’elle a fait éclore. Comme creuser en épaisseur de brun, couche par couche — modèle réduit de fouille archéologique —avec comme seuls outils les mains, les ongles même, et un peu de l’eau rescapée des guenilles. C’était la couleur qu’elle cherchait, peut-être même l’odeur. La matière elle n’y a pensé qu’après. Pourtant c’est la rencontre avec les nervures, leurs sillons humides à rebours du lisse qui lui a fait le plus d’effet. C’est ça qu’elle pense maintenant. Elle veut tout creuser, dépoussiérer, révéler toutes les aspérités étouffées, tout déballer et tout ouvrir. Elle sait qu’elle doit y aller doucement que c’est un travail qu’il ne faut pas gâcher mais qu’elle veut total ; du brun des feuilles au gris de cette tour.
Jo sentait que la vie c’était maintenant, tout avait l’air mou et mort autour mais c’était maintenant. Un maintenant brûlant qui perfore l’intérieur tant il s’agite. Iel pensait que maintenant ça serait quand ça tanguerait autour, mais autour tout est calme ; le poids des choses mortes ces dernières semaines est tombé — il s’est abattu, consommé, rendant sourde toute proximité. Pourtant ce maintenant, iel n’arrive pas à sentir ce que c’est. C’est moite presque poisseux — mais rien de plus. Iel navigue ses instincts en essayant de privilégier ce qui fait du sens mais tout a arrêté de faire du sens. Les palpitations dans sa poitrine poussent son cœur plus loin que ce qu’iel pense pouvoir voir, iel ne relâche pas l’air. Iel veut pouvoir s’en nourrir pour le goût du danger. Iel a peur que ça explose que ça en mette partout que la sueur s’accompagne d’autres liquides de l’intérieur, projetés vers le dehors. Iel ne contrôle plus rien — la respiration s’accélère pourtant iel se calme — ça sort — les fluides ont pris le relais — tout ce qu’iel retenait en dedans est sur le point de sortir — par où ? Ça sera partout, liquide. Iel est recouvert·e de sueur, ça coule, ça suinte. Soudainement, les robinets qui projetaient ses fluides au-dehors se stoppent d’un coup net. Ça la·e frappe comme un coup de poing en plein visage tellement iel s’était habitué·e au soulèvement de l’air dans ses poumons. Tout se résorbe — les pores de sa peau ravalent l’eau dispersée sur sa chair. Iel ne reconnaît plus le corps qui est le sien — iel n’a pas bougé. Jo regarde autour d’iel. Iel ne sait plus si iel les hait car iels lui rappellent qui iel est ? ou si leur présence près d’iel est devenue trop pesante. Iels n’ont rien vu, peut-être juste une lueur sur son front mais il fait chaud après tout, tout le monde sue. Iel continue d’éplucher les carottes que les artistes-maraîcher·es du sixième étage ont ramassées hier. Le tas de carottes pelées, doucement, se fait plus haut. Dani à côté d’iel finira par les découper pour les mettre dans la soupe. Presque depuis le début de la cohabitation, les tâches se sont organisées — divisées — chacun·e sait quelles tâches lui reviennent. Avant d’arriver à cet équilibre la hiérarchie initiale de la tour a dû être déconstruite.
Les deux mains contre la paroi chaude des fenêtres, Sax regarde l’horizon. C’est la première fois qu’il remarque le monochrome dont s’est recouvert Montreuil. Ça fait plusieurs jours que la couleur imprègne tout ce qui a constitué cette ville mais elle est maintenant devenue opaque. C’est une couleur indéfinie, entre le désert et la roche, certainement quelque chose qui laisserait un goût râpeux en bouche avec lequel on finirait par s’étouffer. C’est triste mais avec ce revêtement uniforme, la ville a comme aspiré ses disparités, tout est homogène. Il n’y a plus que les reliefs. Tous les détails ont été enfouis sous la poussière. Sax cligne lentement des yeux pour faire la mise au point, il a l’impression qu’un spot sur la carte se distingue. Ça lui donne une sensation de trou noir, d’un passage vers autre chose. Sax doit trouver. Des mains. La rambarde. Sa tête commence à lui tourner. Ce surgissement hors du brun lui a donné le vertige. Il se ressaisit et regarde de nouveau — plisse les yeux plus fort et arrive à percevoir des détails de cette anomalie du paysage. Ça ne lui semblait pas clair il y a quelques secondes encore mais cette tache dans le brun n’est pas noire. Sa texture semble mouvante, presque organique, comme si une force externe en testait la résistance. Sax se demande comment cette couleur qui a pu tout recouvrir de façon si opaque a pu oublier cette toute petite parcelle. En plissant les yeux plus encore, il pense voir des nervures se dessiner sur le vert surgissant. Il suit des yeux froncés ces lignes timides et en assemblant dans sa tête ces informations, commence à penser que ce petit bout de vert, c’est une résistance.
Promenons-nous —
Les pédés se promènent dans les bois Pendant que le loup n’y est pas Si le loup y était, il les mangerait Mais les pédés prennent le risque quand même Ils flairent les troncs morts Ils font craquer les branches Ils salivent sur les mousses Leurs paniers sont remplis de capotes et de honte C’est pour mieux se manger
Aussitôt que les truffes se trouvent Les pédés tirent sur les chevillettes de leurs slips qui choient en glissant sur leurs baskets Et les crocs se mettent à sortir Ils se repaissent entre eux et se lubrifient à coups de petits pots de beurre C’est pour mieux se manger Leurs lèvres se fendent et se rougissent du même rouge qui égratigne leurs genoux Leurs yeux sont au beurre noir C’est pour mieux se manger Les meutes de gars se trempent en même temps que leurs slips Ils jouissent en hurlant Ils se giclent dans les gueules Ils mettent des petites graines dans les ventres des lisières Car la forêt est une maternité cachée où naissent les enfants des pédés
Mais la corne résonne et les chasseurs débarquent Ils craquent leurs allumettes Ils fument les sous-bois jusqu’au filtre Ils jettent leurs mégots Et finissent d’achever de leurs fusils les bêtes déjà presque mortes
Seuls restent cachés sous les cendres les enfants des pédés En sursis dans leurs pouponnières calcinées Arrachés à leurs pères Sauvages
Les feux de forêts sont des holocaustes Ils façonnent des hectares et des hectares d’orphelins résineux
Alors les gosses apprennent tout seuls à faire des feuilles Ils se contentent de bouffer les poudres des canons Ils plantent les racines profond vers le centre de la terre La sève est brûlante Les braises dorment sous les lits de mousse Le charbon est acide Il peint sur les clairières désertes la couleur de la haine
La poule au ventre —
Je ne mange que des graines Je nourris une grosse poule à l’intérieur de moi Je mange des pavés Bjorg Gerlinéa Des Weetabix Des flocons d’avoine Des Special K Du muesli Du lin Du sésame Du pavot Du riz bio de chez Naturalia La viande je la recrache Les légumes je les vomis À ne manger que des graines Mon corps devient sec Je suis légère comme une plume Je ne pèse que le poids de la grosse poule dans mon ventre que je nourris
Taxi pour la gare, extrait de « Devenir Grace » —
La voiture des jeunes n’est pas là, je pense : sont-ce les vacances ? Ou elles ont autre chose à faire que vivre l’habitacle. Je demande à Stefan, il dit qu’il n’y a jamais fait attention. Je peste qu’il faut regarder les gens dans la rue, que sinon on meurt, et il lève les yeux au ciel. Nous montons dans le taxi qui nous amène à la gare, petit plaisir embourgeoisant que je nous ai autorisé, en ouverture de notre week-end de repos. Dans le rétroviseur, le chauffeur me lance des regards discrets, mais nombreux, et l’absence de musique, radio, pluie ou grêle n’apaise en rien l’angoisse paranoïaque qui croît dans mon ventre. Il finit par briser le silence : « Dites, c’est bien vous que j’ai vu à la télé la semaine dernière ! C’était vous, non ? À la quotidienne d’Attila Nelson, et vous aussi monsieur, c’est vous, le bad cop, le détective privé camé de la séquence scoop, non ? ». Stefan ne semble pas savoir de quoi on parle, ou il dort. Je suis perdue, je dis vous devez faire erreur. Il insiste : « Si ! Grace quelque chose, la réalisatrice-là, c’est vous ! J’ai adoré Icarus, après l’interview je suis allé voir tous vos films — enfin la plupart, sur Moubix, la plateforme de cinéma en ligne. D’habitude, je regarde des talk-show ou des séries, à la maison, le soir ou entre les courses, des petits bouts. Ça me distrait, ça fait passer le temps. Vous savez, madame la réalisatrice, j’ai passé ma vie à observer les autres, sur les trottoirs, les passages piétons ou dans le rétroviseur central, en essayant de savoir où est-ce qu’ils allaient, de comprendre leurs sourires renfrognés ou leurs pommettes saillantes, fières. Tiens, vous savez qu’une pommette ça bouge presque autant qu’un sourcil ? Excusez-moi, pardon, vous devez penser que je parle beaucoup ». Il se tait, deux secondes, le temps d’inspirer je pense, puis reprends :
« Je parle beaucoup, certes, mais vous avez la tête de quelqu’un qui sait écouter, et votre ami-là, il a pas l’air dans un meilleur état qu’à la télé, alors vous m’excuserez, mais j’ai des choses importantes à vous dire ». Je pense qu’on ne devrait jamais contredire quelqu’un qui conduit une voiture, et que de toute façon, n’eut-il pas été au volant et ma vie entre ses mains (n’oublions pas qu’une voiture, c’est un assemblement de métal, d’écrous, de boulons, de tout un tas de choses qui, propulsées par un carburant, lui-même dangereux sur tous les aspects, ne demandent qu’à s’écraser contre d’autres boîtes de conserve lancées à toute vitesse), j’aurais quand même eu envie de l’écouter. Je l’invite à continuer. Il conduit, a effectivement l’air de quelqu’un avec des choses importantes à dire, et je pense qu’un retour public, comme un micro-échantillonnage de ce qu’a inspiré mon apparition dans le talk-show de la semaine dernière, pourrait se révéler fort enrichissant.
« Voyez-vous, Grace, je peux vous appeler Grace ? j’ai toujours été un grand romantique. Au sens large : j’ai parcouru le continent du Nord au Sud et d’Est en Ouest, des années durant. J’ai travaillé comme assistant réalisateur, script, homme à lumière, on appelait ça comme ça avant, je gérais pas vraiment toutes les lumières comme les ingénieures lumières maintenant, mais simplement les objets-lumière qui apparaissaient à l’image (lampadaires, lunes, flashs, phares), bref, j’ai roulé ma bosse dans les films dans ma jeunesse, dans plusieurs pays, et toujours à la technique. On arrivait à se comprendre, miraculeusement, faut dire que c’était des équipes qui venaient de partout. À l’époque, on avait des financements de quatorze, quinze pays différents, ça vous donnait des enfers administratifs, madame, vous avez pas idée, mais quel bonheur sur les plateaux ! On parlait les signes, le gaffeur et le silence ça tourne. Tout le monde tombait amoureux, on faisait des fêtes sensationnelles, et à la fin de chaque tournage on priait pour que ça ne s’arrête pas, pour qu’on en tourne un autre, là tout de suite, sécouelle ou précouelle, sans attendre de retour, de critiques, de box-office, rien. On ne vivait que pour faire des films et épouser l’expérience du tournage comme une nouvelle vie à chaque fois, on s’en fichait presque du résultat final, c’est le moment qui nous emmenait. Y a des familles de sang, de sexe, de larmes, d’amitiés et d’entente ou de colères incroyables qui se sont formées comme ça. Moi j’avais trois compagnes et deux compagnons dispersés aux quatre coins du continent ! On m’appelait pour faire les guirlandes là-bas, j’en profitais pour en voir un, c’était l’amour fou puis je retraversais dans l’autre sens à peine un mois plus tard, pour aider aux lampes torches sur un film d’épouvante, c’était grandiose.
Et puis, le temps a passé, la télévision a commencé à produire ses propres fictions. Là, on a senti qu’on commençait à se faire niquer, excusez-moi du langage, mais c’est même pas vraiment à la hauteur de ce qui s’est passé. Les financements ont glissé peu à peu, des studios cinés aux studios télé, et en parallèle toute la génération a commencé à sortir de cet âge d’or romanesque, où demain n’existait pas. J’ai pigé que ça sentait vraiment le roussi quand, en une journée, mes trois compagnes m’ont appelé presque simultanément pour dire qu’elles allaient commencer à bosser pour la télé, qu’il fallait songer à devenir propriétaires à nos âges, que notre mode de vie n’était pas viable sur le long terme, qu’elles ne m’envisageaient pas comme un père stable, comme un modèle, et ça m’a fait des couteaux partout. Vous voyez, moi, je pensais que notre passion commune pour les histoires ça nous tiendrait, qu’on ferait front, qu’on continuerait à faire des films, mais les plateaux se sont désertés comme ça, à vue d’œil. La télé, c’était le futur : ça faisait travailler plus efficacement, avec des horaires respectables et des salaires fixes qui permettaient de se projeter.
Il me restait un compagnon, un amant de l’âge d’or, un seul. Pablo, un italien, mort du grand mal le jour de la fermeture de mes studios préférés. J’ai pris ça comme un signe. Si j’avais survécu aux deux épidémies, les histoires, c’était terminé. J’ai eu peur vous savez, quand tout s’écroule comme ça et que la mort rôde autour de votre lit. Imaginez un peu, vous la sentez partout ! Ramper, à se terrer, guetter, planer dans les toilettes de discothèques, derrière les buissons dans la nuit noire, imaginez je vous dis, vous pouvez la sentir attendre, presque la toucher, à vos côtés. Laissez-moi vous dire que ça fait quelque chose ; vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie, vous tergiversez pas. J’ai compris à ce moment-là, et je suis encore bien incapable aujourd’hui de discerner précisément la source de ce parallèle, qui m’est pourtant apparu d’un coup, comme une évidence fatale, j’ai compris-là que pour le reste, pour l’extérieur, raconter, développer, c’était tergiverser. Alors, comme les autres, celles et ceux encore en vie, je me suis rangé. J’ai mis toutes mes économies dans un vieux tacot, un bolide de bric et de broc qui roulait à peine, et j’ai sillonné les villes. On me disait, à Vienne, « mais pourquoi vous avez l’air d’un taxi parisien » ? Et à Madrid, « qu’est-ce qu’un taxi allemand fait ici » ? Je pratiquais mes propres tarifs et je dormais dans le taxi, j’avais deux costumes, que je portais en roulement. J’étais toujours impeccable, le taxi aussi, mais l’illusion ne prenait plus, l’équilibre était trop branlant, pour moi du moins. Je me suis regardé dépérir dans le miroir du pare-soleil, de jour en jour, de mois en mois puis d’années en années. Je regardais les gens passer, me surprenait à envier les couples avec enfants riants, nucléaires, qui gonflaient les trottoirs. Je suis tombé dans la religion, en ai essayé quelques unes, et là où je me suis rendu compte que la télé m’avait vraiment eu, c’est quand, sans jamais l’avoir vraiment regardé, j’ai ressenti ce besoin, venu de nulle part madame la réalisatrice ! c’est arrivé tout seul ! Je l’ai ressenti très fort, implacable, comme une tumeur tout à l’intérieur de mon ventre : le besoin de fonder une famille.
Je me suis installé ici, c’était il y a quinze ans de ça maintenant. J’ai vendu mon vieux taxi, si croulant qu’on ne pouvait même plus l’appeler décati, et avec toutes mes économies j’ai acheté un petit studio boulevard de la Lamproie. Ça me faisait encore sourire, d’imaginer une lamproie mutante dévorer le boulevard, ça me rappelait que j’étais au moins un peu vivant, que j’avais encore un peu le truc. J’ai fait un prêt à la banque, acheté une nouvelle voiture et travaillé dur. Je n’ai rencontré personne, alors quand elles sont apparues, j’ai craqué, et acheté une petite télé que j’ai encastré à l’avant, dans le tableau de bord. J’ai pris l’habitude de la regarder entre les courses, parfois pendant, et comme ça elle a remplacé mon habitude. J’ai perdu mon plaisir d’observer les gens, mais la faute est partagée, madame la réalisatrice, c’est les autres, c’est les passants, ils ont déteint. Avec les pluies et les années, ils ont déteint, perdu de leurs couleurs, de leur vie, de leur substance. Je les ai regardés mourir et j’ai choisi les spectres, les fantômes de l’écran, les histoires en carton. Je ne faisais même plus attention à qui je transportais, conduisant automatiquement, puis remontant inexorablement au trente-trois boulevard de la Lamproie, quatrième étage palier du milieu, m’écrouler sur mon lit, sans penser à rien. Le désir de famille est mort dans l’œuf, noyé par les apparitions. Dès que je m’allongeais, les yeux fermés, mon passé n’avait de cesse de me revenir, chantant toujours la même ritournelle moqueuse, fredonnant que la vraie famille, je l’avais déjà connu, et que plus rien ne serait jamais en mesure de combler ce vide.
Un jour, en plein hiver, j’ai senti l’habitacle se réchauffer d’un coup, quand une femme est rentrée. Son sourire m’éblouissait dans le rétroviseur, j’étais comme empêché de parler, conduisais, les yeux fixés sur la route, incapable de croiser son regard. Elle ne parlait pas mais je pouvais sentir son sourire et ses joues de feu dans le miroir . Le hasard de l’itinéraire a fait que l’on s’est retrouvés à passer devant chez moi, arrêtés au feu rouge, et là, devant le trente-trois boulevard de la Lamproie, elle m’a demandé : dites, ça vous arrive encore de regarder les gens vous ? Je me souviens encore de la rapidité avec laquelle mes yeux se sont inondés de larmes, et elle, dans le rétroviseur, pleurait aussi à chaudes larmes, et ça faisait comme deux fleuves tellement on pleurait, comme si l’on venait de crever une énorme bulle au dessus de nos têtes, une bulle en deux parties qu’on aurait chacun traîné de notre côté depuis si longtemps qu’on les aurait oubliées. Stéphanie, c’était son nom, a emménagé avec moi le soir même, et nous ne nous sommes plus quittés depuis. Elle est partie la semaine dernière, rattrapée par une vie de tabagisme et un goût prononcé pour l’aurore qui la poussait à rester debout toute les nuits, attendre les prémices, voir les toits blêmir, et saisir dans ses bras le soleil montant venu balayer le boulevard de la Lamproie.
Elle est partie et c’est ma plus belle histoire finalement, alors quand j’ai vu votre interview, j’ai compris de quel bois vous étiez faites, compris que si j’avais un jour la chance de vous croiser, il fallait que je vous parle, à tout prix, que je vous raconte à vous. À travers l’écran je vous ai senti, on vous a senti, avec Stéphanie, inarrêtable, prête à vous damner pour une belle histoire, qu’elle soit dans trois accords d’orgue, un montage saccadé ou des pommettes inhabituellement arquées. J’ai regardé vos films et j’ai pleuré, comme quand je l’ai rencontré. Aujourd’hui, elle vit encore, avec nous, ici, dans le taxi. J’ai fait tendre un tissu mélangé à ses cendres sur le plafond de la voiture, elle est avec moi partout, tout le temps, je peux l’entendre pleurer doucement devant les films que l’on regarde, rire des passants, des passagers, et parfois même me faire des confidences quand on roule seuls, la nuit. Là, tout de suite, elle vous chuchote, Grace, l’entendez-vous ? N’ayez pas peur ! N’ayez pas peur. Elle dit que ses propos vous parviendront d’une manière ou d’une autre, que s’ils n’arrivent jamais jusqu’à vous dans leur nature première, leur silhouette trouble vous poursuivra, affectueusement précise-t-elle, pour vous aiguiller.
Hors hôpital : M A L A D E L A N D, un vrai coup de gueule —
Ils traînent comme des bouches d’égouts, dans des espaces où baiser est une activité. Il existe des maladies de partout, certains disent la maladie d’aimer, c’est nul. La maladie de traîner dans les entrailles, les souterrains des espaces à baisers, la maladie de peau, les maladies rares. Je n’aime que les maladies rares qui contraignent, celles qui font que je veux être normal. Et pourtant, d’un même mouvement, c’est de la rareté et de la normalité dans leur spécificité
que je veux appartenir ;
et que je rejette.
alors le cul cerclé cuir,
je cherche des bouches, des trous qui respirent, de nos trous émanent nos odeurs des espaces vastes alors le cul cerclé cuir j’ai le cœur en cerne hyper ouvert.
Nous sommes 3 malades en dehors des hôpitaux, on est à MALADELAND, on est posé sous les pins parasols, à l’ombre, on a le feu au cul.
Moi, X, je veux qu’un doigt rentre dans ma chatte qui est trempée mais je ne sens que l’herbe qui chatouille,
On ne s’est pas échappéxs de l’hôpital, les docs ont affirmé « vous n’êtes pas guéris » sous entendu « vous ne le serez pas ». Oser dire : « Profitez de la vie à DEHORSLAND ! » Terreurland plutôt ! glaglaglaglagla, me pisse dessus, mode bb cadum, couche pleine de peur me l’étaler surles joues pour décompresser juste avant, les mots-docs en liste de course, « Avoir une malformation artérioveineuse cérébrale ; avoir une hémorragie cérébrale ; avoir une radionécrose ; avoir une hémiparésie au pied droit ; avoir une épilepsie ; avoir un lupus timidus » POSSESSION sans le sou, riche d’un capital invisible à l’oeil, vaporeux ça donne quoi au futur ? ça donne quoi à DEHORSLAND, ces micro-centimes fumeux ? Qui comprendra à Dehorsland la singularité de ce vocabulaire-patrimoine-fictif ?
Nous ça nous donne juste envie de cracher de la bave de la bouche sèche et de mettre le cerveau en off. dans ces moments-là, on a la rage alors face à la rage on pensait qu’il n’y avait que la rage on criait dans des champs face à personne et on tirait un coup de fusil sur rien.
ON est dans un autre monde où les tortues ont connu les dinosaures. On suce des bites énormes et on chevauche des fougères, les yeux fixent le ciel à nos ébats, nos organes flottent sans derme ; on est MOU.OLLES => on s’en fiche de tout, rien à cirer, on sent la honte qui pourrait exister d’avoir été torché adulte en même temps c’était pas si mal.
On a vécu à l’hôpital comme une deuxième maison, on reconnaît les odeurs de la bas, ici, c’est pas comme à DEHORSLAND prout prout, on sait que, quand on ne boit pas d’alcool, c’est parce qu’on a un traitement, et quand on boit, on sait le risque qu’on prends ; quand on est fatigué c’est, que la chimie nous contrôle ou notre œdème cérébral ; que le style vestimentaire, on ne le choisit pas toujours et que nos coupes de cheveux sont adaptées à cacher les stigmates : les gens de DEHORSLAND ont peur des trous dans les os et des aspects de bouts de peaux cousus sans poils.
NOUS ON SAIT que notre corps, allongé, a été exploré dans ses détails internes inconnus à soi, nos artères de l’aine au cerveau ont été visitées plusieurs fois comme des départementales. Nos veines ont été complètements perforées, pour vivre ; intérieurs dilatés — pupilles morphinées
NOUS ON SAIT QUE les docteurx peuvent avoir l’aspect de plastique épais avec des rayons gamma : les machines ont veillé sur nous, nous ont cramé des bouts. on a fait le deuil de la pleine autonomie ; on a marchandé avec la vie. Et pis malgré ça, on a des verrues, des mycoses et des ist. Et pis malgré ça, on a des peines d’amour-amicales. NOUS, on n’existe pas. on pointe sur l’autre l’arrogance d’être le plus malade ; — en cap. aucune cohésion sous ce vêtement marque-maladie les tuniques sont gratuites et distribuées à l’arrache pourquoi j’ai tendu la main ? Qui a distribué ? MALADELAND c’est dans la tête. et ça rends fou, DEHORSLAND épuise, c’est un monde sec avec des scarabées en pleine chair-cocktails en main, qui bougent leurs antennes d’innocence — ma jalousie. j’abandonne le mythe de la longévité cacher prise chevilles roc au plus et poignets mous au moins. je performe why not je dors plus je m’extrais des boulevards, pour aller dans l’ombre des ruelles ça fait comme la nuit je jouis à moitié
Et pis là, alors qu’on parlait ^de la pluie, du temps, de nos plats préférés,^ qu’on faisait du touche-pipi ^avé nos doigts et bites en silicones,^ en face de nous, d’un des pins parasols ciel bleu azur TOMBE un parapluie, il choque le sol et s’ouvre d’un coup, rayures jaunes et bleues ; de grands yeux aux grands cils style-BD dégringolent à l’ouverture, et nous regardent, nous, en train de nous toucher et blablater / on stop gênéxs ils s’approchent en faisant de petits bonds comme dans les dessins animés américains, et nous fixent de manière sympa, en clignant des grandes paupières l’air coquin De nos intimités de disloquéxs, de nos genoux, poussent des cornes, de nos poumons fleurent des coquelicots, on s’exclame OH AH, on laisse faire une camomille s’invite, c’est un bouquet avec des racines, il cercle l’organe-coeur et lui apporte des pulsations supplémentaires, des doigts des morts de la terre nous caressent les chevilles des orteils des buissons grimpent à nos aisselles, ça commencent à nous faire rire, on jacasse comme des porcs, notre langue spasme ; tellement on rit, la bouche ouverte, elle s’étire-tire, on rigole en énorme, notre corps se transforme en notre bouche de rire-chattx-anus, on convulsionne de manière saccadée si bien qu’on se soulève de la terre on se mets à voler on ressemble a des grands trous de nos bouches-chattes-anus-nous sort un épais brouillard gris nauséabond, épais, très humain, très artificiel ; c’est TROUBLELAND, de la brise, des filaments de salive se forment en toile d’araignées et se posent sur les arbres ON est dans le ciel, de loin, on ressemble à des corps-branches, des rameaux, on volète, on virevolte, voltige parmi les mouettes, les mouches, les cafards, les poules ricanant à s’en faire taper les dents ; et pis, de planètes en exo-planètes, naines en mini-grandes, la salive s’étire, on se projette des stalactites goût coca poussent sur les fils … des gouttelettes suintent sur les garrigues d’Occitanie.
Domination, Fric et Persiennes —
Il fait nuit sur le dortoir. Enfin il devrait faire nuit mais sans persiennes c’est presque plein jour et c’est comme un temps de grand soleil, alors personne ne dors. Personne ne dort même avec les yeux fermés et ça rends tout le monde fou. Tout le monde sue parce qu’il fait trop chaud et personne ne sait comment on éteint la lumière. En bref personne ne dort parce qu’il manque un putain de volet dans ce dortoir, c’est la nuit mais c’est aussi la sieste et tout le monde voudrait savoir alors les esprits se chauffent et chacun sue et se demande comment dormir sinon il va foutre le feu au dortoir.
Les draps se trempent dans les lits tout le monde a trop chaud alors les draps sont dans la poussière par terre mais tout le monde s’en fous parce que pas besoin de draps quand on sue. Toujours la lumière perce la fenêtre et tout ce qui reste froid dans la chambre c’est le métal du lit qui brille et qui brille et même sous les paupières fermées et la peau pleine de sueur on le sent le froid et c’est peut-être la seule chose qui réconforte les dormeurs. Dans les petits lits alignés les esprits s’échauffent et chacun se demande comment choper son voisin alors ils essayent de se donner la main. D’abord ils sentent les barreaux froids au-dessus de leur tête et puis juste à côté la main moite de leur voisin.
Ça fait de la buée sur les barreaux du lit puis des toutes petites gouttes qui tombent sur les fronts et maintenant les draps sont trempés deux fois de la sueur des fronts et de la sueur des mains. Alors avec leurs mains toutes glissantes ils prennent les barreaux dans la main et collent par deux les petits lits en métal vert et commencent à s’embrasser et bientôt ça fait des petites mares sous les lits.
Le Capitaine est sexy dans son uniforme blanc ça fait 20 ans que c’est lui le chef du dortoir alors sur sa poitrine il a beaucoup de médailles. Le Capitaine s’ennuie dans son appartement bien décoré, il a déjà bu un verre de whisky et c’est bientôt l’heure d’aller au lit. Mais maintenant il a entendu tous les lits traînés par terre alors il se dit que c’est quand même bizarre tout ce bruit. Pendant ce temps-là dans le dortoir tout le monde baise enfin son voisin en espérant que les hormones les feront dormir plus vite. Mais comme il n’y a toujours pas de volets ils baisent tous comme en plein jour alors les petites mares s’évaporent et ça fait de la vapeur comme c’est pas permis et personne n’y voit plus rien. Et comme plus personne n’y voit rien ils mettent des grandes claques en l’air pour aérer mais ça marche pas alors finalement les claques arrivent dans leurs bouches et sur leurs cuisses et peut-être qu’ensuite c’est la douleur qui les fera dormir. Pendant ce temps le capitaine met ses pantoufles et remonte le couloir, en se disant que c’est quand même bizarre tous ces bruits de bagarre. Finalement la vapeur se barre et alors tout le monde se découvre plein de bleus et de bave, ils sont tous trop fatigués et se disent que ça y est c’est le moment d’enfin dormir. Quand le Capitaine tourne la clé dans la porte il fait très chaud dans le dortoir alors il comprends pourquoi les draps sont par terre. Comme il fait presque jour il voit toutes les taches les bleus et les bosses mais il se dit que les garçons ont le sang chaud c’est pas grave sûrement une bagarre à cause des filles.
Ça y est tout le monde rêve dans le dortoir et tout le monde rêve presque de la même chose. Ils ont tous senti l’odeur du whisky donc cette fois les esprits s’échauffent dans des rêves où tout le monde a les mains pleines de fric dans un uniforme blanc. Tout le monde continue de suer dans ses rêves alors au final c’est comme si ils étaient réveillés et tout le monde continue de devenir fou. Ils deviennent fous dans leurs beaux rêves de fric alors tout le monde se réveille et jette des draps sur la fenêtres pour cacher la lumière. Mais la lumière qui rends fou reste là alors tout le monde a la haine et commence à jeter les oreillers puis les lits puis ses vêtements et malgré tout ça la lumière est toujours là. Alors la température monte encore et on se croirait en enfer ou dans une boîte de nuit.
Avec des chansons pour les enfants —
On entend un sifflement. Des blés partout. Le soleil se lève et inonde la plaine. Les arbres au loin en contre-jour, sont juste des silhouettes noires. La pente est très douce. Je ne vais pas très vite mais je n’ai même pas besoin de pédaler. Si j’avais à prendre une photo, je prendrai le ciel. Même s’il n’est pas très intéressant, il me plaît. Je rentre à la maison. Les fleurs dans le pot en bas des escaliers sont mortes depuis longtemps. Maintenant il y a des herbes sèches où on cache les clefs des fois. Il est très tôt et je suis très excité. Une sorte de frisson me parcourt et j’ai envie de rire. Pourtant il est très tôt, la maison est vide et il n’y a même pas eu de blague. Tout me rend heureux ce matin ; la façon dont j’enlève mes chaussures dans l’entrée comme tout le monde ; presque retenir ma respiration pour entendre le bruit de mes pas ; et surtout me recoucher comme s’il ne s’était rien passé hier. Le frisson est toujours dans le haut de mon dos comme si quelqu’un soufflait dessus. Je me recouche sur le côté. J’ai envie de me mordre. Le soleil chaud commence à taper un angle de ma chambre. Le papier peint est un peu sale et tout le monde dort. Je m’imagine déjà prendre le petit déjeuner et ne rien dire. Je n’arriverai sûrement pas à m’arrêter de sourire. Tout le monde saura qu’il se passe quelque chose. Mais je ne dirai rien. (Ça arrive des fois, de se réveiller dans cet état.) Sur la terrasse, les fauteuils en rotin encore frais de la nuit, craqueront sous les secousses de mes chevilles dans le vide. Peut-être qu’on me dira d’arrêter de bouger mon pied ? Alors je me lèverai, avec sur les cuisses les traces de la chaise, puis je partirai très vite au fond du jardin chaud avec tout ce qui peut voler dans les airs. Il y a une sorte de ruisseau qui passe au fond du jardin. Il est très petit, on ne le voit pas forcément et l’eau est un peu tiède. Mais du coup, tout ce qui peut vivre dans un jardin, nous l’avons. Je resterai là un moment, seul. Je relèverai la tête pour voir au-delà. Puis je remonterai lentement vers la maison, en laissant derrière moi la chose qui m’avait appelé. J’avais oublié ce que c’est, d’être ici. Maintenant que je suis parti, j’ai appris à être plus solide, moins perméable. Je ne garde que ce que je veux. Je filtre. Je sais que ce qui m’écrasait avant est toujours là, mais je décide de ne plus le voir. Le temps est compté. Je repars dimanche. Maman me regarde sourire sur le gros canapé en cuire qui ressemble à un sac poubelle. Je regarde dans le vide. Je ne m’en rends pas compte. Elle ne me dit rien. Elle ne sait pas par où commencer, et moi je triture les petites peaux sur mes doigts. Mes cuisses sont chaudes et j’ai envie de faire l’amour. (Avant, je croyais qu’on disait faire « la Moure ».) Quelque chose bout en moi et pourtant je ne réfléchis même pas. Il n’y a que ma respiration qui s’emballe à certains moments. Puis je me rappelle que ma mère me regarde alors je me ressaisis. Mon père et ma sœur ne sont pas là. Ils sont dans la maison mais je ne les vois pas. Il n’y a que ma mère devant moi. Je sens qu’elle a envie de me parler mais pas moi. Je suis très content de faire comme avant. Comme si j’étais jamais parti. Je suis parti longtemps, et je veux tout comme avant. (En mieux.) Être égoïste et léger, montrer aux autres qu’on peut vivre pour soi, chacun de son côté mais ensemble. J’ai pas envie qu’on me dise ce que je dois faire ce matin et j’ai de la chance. Désolé maman, on ne parlera toujours pas. « Ce midi j’irai pique-niquer tout seul ! » Je me vois déjà avec une tomate juteuse dans la main, un peu molle et fragile. Je regarderai les champs que j’ai traversé plus tôt. Je réfléchirai pas mais je posséderai tout. Je serai plus lucide que jamais. Avec un regard neuf sur tout ça, comme nouveau, comme sur-éveillé. Je vais regarder les choses comme si ma vie s’en arrêtait là, hyper-présent. Même si je sais que plus tard, quelque chose me rappellera à l’ordre. De mon enfance, je n’ai pas de grand souvenir, ni de bon sentiment. Mais aujourd’hui ça me plaît d’imaginer tout ce que j’ai oublié. En vrai, j’ai dû être content d’en manger des glaces, de jouer tout seul, ou de regarder la télé. Là maintenant, c’est ce qu’il me faut. Mais avec du sexe. Beaucoup de sexe. Je joue à être, comme une star de cinéma, ou comme les enfants avant qu’ils comprennent les conventions ou qu’ils se posent la question de l’autre. Plus rien n’est grave. Ce n’est plus ça ma vie. Et maintenant ici : c’est les vacances. La vieille usine d’à côté, le chemin avec les ronces, l’isolement…Toutes les choses que j’avais pas choisies de vivre, je les choisis maintenant. Car je sais que je peux les quitter. Cet après-midi, j’irai peut-être au lac, où je ferai semblant de ne pas regarder les adolescents insupportables. Il va faire très chaud, alors je chercherai un espace à l’ombre, où je pourrai mater sans être vu. Aujourd’hui, il n’y a pas de vent, ni de bruit, et le lac sent très fort. Normalement, y a toujours des jeunes à cette époque. Aujourd’hui je ne les connais plus, c’est sûr. Mais j’imagine bien les garçons bronzés avec des pommettes anguleuses et une voix douce, puis les cheveux mouillés des filles qui coulent le long de leurs dos. Ils seront tous simplement beaux, avec des gouttes d’eau comme des perles sur les hanches. Là, j’irai me baigner. (En contractant le ventre pour paraître plus maigre, au cas où il me regardent). J’irai trouver un coin un peu à part. (Peut-être celui où je me suis masturbé dans la vase quand j’étais au collège ? Mais je ne le referai pas. J’ai pas envie de jouir. J’ai envie de garder cette énergie superficielle qui me garde à fleur de peau. Par contre, l’eau traversera mon maillot et se glissera entre mes cuisses, entre mes fesses. Je vais me mordre et ce sera trop bien.) Sur la clôture qui entoure le lac et qui passe par les bois, les gens ont pris l’habitude d’accrocher les objets trouvés sur le chemin. Tout se ressemble ici, mais les vrais savent quand il faut tourner. Si on longe le grillage, on arrive sur une résidence dont les travaux ont été abandonnés presque à la fin. La maison est là. Morte-née. Les fenêtres ouvertes. Sans fantôme. Sur le sol, un mélange de ronces et de sable recouvre le lino, et sur le crépis il y a des tags et des prénoms. Au lycée, j’y étais allé avec un garçon après le lac. On avait mangé des chips. Je me souviens de la chair de poule, encore mouillé. J’ai vraiment cru qu’on allait s’embrasser. La clôture tourne à un moment mais le chemin continue. À cette heure-ci on est en plein cagnard.
VENUS-1943-JOPLIN.JANIS, Canal Vénus —
Je suis une vénus, une fausse rousse, une sans nacre. J’arpente le lit et la pharmacie à la recherche d’anxiolytiques, d’antidépresseurs, d’antipsychotiques et de lithium. Toute drogue de synthèse remboursée par la sécu. Coucou c’est moi le trou. Je perds mes cheveux, un peu, mes tétons coulent du lait. Effets secondaires des allers ↔ retours pharmacie ↔ lit. + 4 kilogrammes en quatre semaines. J’ai 30 ans et non 23. Simonetta le modèle de VENUS-1485-BOTTICELLI.SANDRO a 23 ans. Les lignes rousses contre la pâleur olivâtre. C’est pas grave, j’ai 27 ans. C’est rock. C’est Jimi, c’est Janis, c’est Amy, c’est Kurt, c’est Jim. Mon chien s’appelait Hendrix. Aussi rock que moi, sur le canapé les couilles à l’air, une dent en moins. Caca ↔ Pharmacie ↔ Lit ↔ Caca ↔ Gâteaux ↔ Pipi ↔ Chat ↔ Croquettes. À Noël on était à deux affalé·es sur le canapé. Je suçais du chocolat noir puis j’avalais du rouge. J’avalais puis je suçais. Son haleine de chacal me tenait chaud. Les larmes à l’œil, le signe grotesque de sa séduction pour un morceau de bouffe. Comme s’il allait crever de faim. Comme si j’allais le laisser crever. Lorsqu’il est mort, je n’étais pas là pour le serrer dans mes bras. Lui dire au revoir. Dire au revoir à mon meilleur ami. À la place j’avais des obligations professionnelles. J’étais présente à un vernissage. Formulaire rempli. ↓ Artiste émergente sans numéro, à gauche, file d’attente jaune cocu svp. Veuillez patienter jusqu’au prochain guichet intitulé « se faire repérer » #réseautage [.center] *** J’attends avec impatience mon propre vernissage. Là je crierai à la foule, l’histoire de l’huître-clown. J’ai trouvé la perle nacrée, le sérum irisé explosif des skin care machines. [.center] *** Applaudissement x 2 ♪♪ [.center] *** Je ferai la clown triste neuroleptisée, lithiumisée, dépressurisée, alcoolisée. Je porterai un nez de clown, une grosse perle. Je ferai la gueule comme les clowns. :( Je jouerai au double maléfique clownesque. J’effraierai les enfants comme les clowns. Je les mangerai et les baiserai comme les papas clowns. Je ferai de la politique comme les clowns. Je taxerai les pauvres et contrôlerai leurs aides sociales comme les clowns. Je dirais : l’art est accessible à toustes pour 10 balles seulement. Je me branlerai les jambes écartées dans le tromé. Touche pipi, frotte chatte dans les bus et les cars longs trajets. La perle sera grosse, si grosse. Tellement que j’en ferai mon masque. Un masque nacré de Pierrotta Simonetta, l’alcoolo dépressive. Une coquille Saint-Merde gravée avec ma gueule : idéal pour une tof Linkedin. Bac+5 s’il vous plaît. Clown liftée beaux-arts. Mon vernissage sera super. Il y aura des histoires de luttes de classes sous forme de transfuge ascendant, bien sûr. Pas descente dans une tenue strass et paillettes. Puis il y aura de la bière. Pas de meilleur ami, non. Puisqu’il est mort. Mon chien est mort et je suis allée à un vernissage. [.center] *** À 600 km de mon meilleur ami mort. Je suis en train de me professionnaliser. D’exercer mon charme pour établir un réseau. 80% du travail d’artiste = #réseauter Ça me plaît, je s(t)imule le contrôle de mon taux d’alcoolémie. C’est subversif de ne plus consommer. Dans la classe sociale sup’. Dans le taux de lithémie. Mon chien se raidit et moi avec mes anti-douleurs je me détends. La bière pression au comptoir du centre d’art est en libre service. Pas besoin d’aller choper les canettes du vendredi soir. On avait dit transfuge de classe, non ? L’alcoolisme n’est qu’un protocole social. [ J’ai pas envie d’écrire que c’est une maladie, l’alcoolisme. Parce que maintenant dans la vie réelle, si elle existe. Les reptilien·e·s sont partout à vrai dire. Ou les fachos, je ne sais plus. Dans la vie réelle, il est 16h51 et je me dis que j’aimerai bien boire un verre. ] L’alcoolisme n’est qu’un protocole social. Je sais être naturelle avec une 8.6. Capacités que l’on apprend minutieusement à coups d’échecs et de martinets. Personne ne sait que la Mamie après onze heures du matin il ne faut plus l’appeler. Pendant que le joli monde commente. Personne ne sait que mon meilleur ami mort prend trop de place en tant que mort. Il faut le plier en quatre comme les chemises. Jusque dans ta mort, il ne faut pas dépasser. Mais on te dira que ce n’est pas de l’élagage, c’est une once d’élégance, un réajustement des codes, des lignes d’héritages, des langues maternelles, des principes. Pour ne pas qu’il prenne trop de place dans son trou de clébard, il faut lui couper les pattes. [.center] *** Avant qu’il raidisse. Avant que j’irradie. [.center] *** Il faut plier le mort pour qu’il prenne moins de place. Il faut FERMER SA GUEULE pour moins de place. Le trou où on placera mon meilleur ami mort taille petit. Comme le vagin. Ta mort paie ta condition. Ta condition paie ta mort. 600 km me sépare du désastre. C’est la dissociation, madame. Vous avez toujours été séparée du désastre. She’s a very kinky girl♫♫♫ Et voilà que tu prends trop de place dans le jardin communal. Pas grave qu’on a dit. Mon meilleur pote, il n’avait pas de jardin de toute façon. Il n’était pas propriétaire. On l’a mis en boîte. Après l’avoir fumé comme un rôti. Il ne prendra pas trop de place sur les étagères vitrées. Il faudra juste l’astiquer de temps en temps comme tout le monde. Mon meilleur pote, c’était ma propriété. Quand il est mort, j’ai perdu un bout de moi. Un bout de mon âme. Un bout de mon investissement à long terme. Je ne serai jamais propriétaire d’un truc en brique. Alors j’ai pris un chien, sans penser qu’un jour ça finirait par crever cette chose-là. C’est pas comme un collier que l’on donne, une bague que l’on revend après le divorce pour payer l’avocate et les tequilas entre copaines. Ça coule chez moi. C’est lourd et c’est toujours vers le bas. Toujours pour atteindre la mer. Hendrix meurt le 1er décembre 2022. Il n’a pas le même nom de famille que moi. Avec le temps j’ai appris qu’il fallait s’en foutre des blasons. La bière pression n’empoisonne pas mon sang. Mes collègues de réseautage forment un joli zéro, un beau rond. Je suis au milieu. Il y a du monde à ce vernissage. Encerclée, j’ai chaud. Le cercle encercle. On pense qu’il est serein mais c’est une main qui vous cerne, vous serre et ne vous desserre plus. C’est la balle que l’on ne redonne pas aux chien·ne·s. C’est celle contre son camp. C’est Kurt. Le cercle est initié. Il est diplômé. Il est coiffé, maquillé, protégé. Il est instruit. Il a le vocabulaire. La plus belle arme. Les vrais sculpteurices déjà, ils n’ont jamais froid. Ça s’érige une sculpture. Ça se monte Ça pousse comme les arbres, ça bande comme les porcs. Ça demande de l’effort. Du capital. Sportif. Érotique. Cinématographique. C’est Pygmalion qui tombe amoureux des seins magnifiquement sculptés. Il éjacule dessus. La peau est déjà blanche, il s’en fiche. Il se branle avec zéro degré dehors et dans un atelier sale, il s’en fiche. Il est amoureux. Il est amoureux de l’art. Celleux qui continuent l’art ce sont les amoureux·ses, ce sont celleux qui sont vraiment passionné·es. Alors. Be yourself. Be a lover. Don’t be a looser. Continue ou crève salope. Chez toi, dans ta chambre avant de baiser, tu ne chauffes pas, non plus ? Pourquoi chauffer ton atelier ? C’est d’ailleurs pour ça que t’avales la bière gratuite pour payer moins cher à l’épicerie. Puis t’as compris que si tu t’élèves un peu, tu peux consommer tranquillement ton alcool et appeler cela en allumant une cigarette rougie par ton rouge à lèvres, un afterwork, un vernissage, des rendez-vous professionnels. La poudre dans le nez. Hendrix meurt, je ne lui dis pas au revoir. Je n’arrive pas à m’enivrer pourtant j’aurai quand même une gueule de bois demain. Je lui dis que je me vengerai. Comme la plupart des non-héroïnes, je ne sais pas vraiment bien me venger. Je n’ai pas d’idée de recettes de cakes végétariens pour mes copaines le vendredi soir alors une vengeance, ça sera compliqué. :( C’EST FAUX ! De la haine et du mépris c’est tout ce que j’ai. Je sue de la rancœur. Bien sûr que j’ai des idées pour buter LE MONDE. C’est ça le couac. C’est pour cette raison qu’iels m’ordonnent des régulateurs. Comment ma parole peut-elle être trouble-fête, si elle est dite dans les soirées qu’elle critique ?
Quenotte, aux pensées magiques —
La maîtresse m’a dit que c’était sûrement une engueulade de « brosse à dents ». Je lui ai demandé de préciser le fond de sa pensée. Elle s’est agenouillée à hauteur d’enfant et m’a saisi les poignets : « Tes parents, ils se sont sans doute disputés pour quelque chose d’insignifiant, c’est-à-dire qui n’a pas d’importance, comme une brosse à dents. Il ne faut pas pleurer pour ça ». J’ai séché mes larmes et nous sommes entrées dans la salle de classe. C’était la première et unique fois où j’ai craqué en public. J’ai vécu ma journée comme si rien ne s’était passé, comme si la Terre n’avait pas dévié de son axe. Je pense que je portais le pantalon rouge en velours côtelé que ma mère m’enfilait tous les matins de cette semaine-là. Je pense que j’avais cours de dessin le soir et que je pouvais parler à cette fille de CM2 que je trouvais trop cool car elle avait une mèche bleue décolorée. Mais, je n’ai pas parlé. Je n’ai pas dit ce qui se tramait chez moi, même l’écrire m’est actuellement insupportable. Je trouve des stratagèmes de menteuse pour dire la violence. Je me venge en racontant tout ce qui est en périphérie. Dans la périphérie du réacteur de ma famille nucléaire, il y avait les objets suivants : un bout de mur défoncé par un poing, une affiche de spectacle déchirée, de la vaisselle sale accumulée dans l’évier, des ordonnances chiffonnées, un tiroir à médicaments. Dans le cœur du réacteur, il y avait mon père, ma mère et moi.
Je suis rentrée de cette journée de pleurs, mon cartable appesanti par tous les livres empruntés à la bibliothèque de l’école. La littérature avait ce pouvoir mystique de me transporter dans un espace liminal — style hall d’aéroport où l’avion ne décolle jamais. Dans le salon, mes parents se font la gueule. J’ai peur du mot de trop, du regard mal interprété ou du geste trop brusque. Je me trouve ridicule à lire des histoires qui ne me concernent pas. Cela m’aide pourtant à entrevoir une porte de sortie aux cris du quotidien. Maintes fois, j’ai menacé avec un couteau à bout rond de m’ouvrir les veines devant mes parents, pour qu’ils arrêtent de hurler. Ça ne fonctionnait pas, c’était même un carburant pour leur ping-pong verbal « tu vois dans quel état tu la mets, la petite ? ».
J’ai décidé de percuter leurs angles morts de certitude. Ma mère me demande d’aller me brosser les dents. Je m’exécute. La mousse blanchâtre mentholée du dentifrice se répand dans ma bouche, aiguise mes canines de lait. Souvent, je tire dessus pour ressentir la douleur et les inciter à tomber. J’écarte le plus possible les commissures de mes lèvres pour examiner ma dentition. Je veux que toutes mes dents primaires tombent dans ma main, que le chapitre de l’enfance soit clos. Je passe méticuleusement le fil dentaire entre chaque interstice puis jette le résidu dans la petite poubelle sous l’évier. J’ai tout bien fait. Je quitte la salle de bains avec ma brosse à dents serrée contre mon torse. Ses poils sont un peu éclatés, ça fait longtemps que je l’ai. Je file sous la couette avec elle. Elle est mon gri-gri de ce soir, ma promesse dévastatrice d’évasion. Cette nuit-là ne ressemble à aucune autre, il me semble que mon pyjama est moins rêche et que je prends forme humaine. Que l’humanité ce n’est pas de vivre à genoux et que je suis décidée à ne plus être sur les rotules. Dans le lit, j’ai rassemblé quelques affaires, des livres, un paquet de biscuits, des vêtements, ma peluche préférée. Je vais m’en aller et je le sais, je sens que cette fois c’est la bonne. J’entame la prière magique, j’implore D.ieu ou n’importe quelle entité supérieure de ne pas m’abandonner, de me prendre avec Iel, de me téléporter loin de la maison. Mes phalanges enserrent la brosse à dents toute élimée. C’est par elle que tout a commencé et par elle que tout se finira. À mesure que je répète mes incantations, je sens les pieds du lit se décoller du sol, le matelas trembler sous mon corps. Je m’agrippe aux barreaux pour ne pas tomber. Le moteur gronde, ma chambre s’enfume des vapeurs d’essence. Mon lit-soucoupe s’élève et traverse la fenêtre. Un petit éclat de verre s’est logé sous ma paupière gauche. Je me retourne à temps pour observer les regards sidérés de mes parents depuis la fenêtre du salon. L’air de novembre est frais et plein d’espoir. Les silhouettes de mon père et de ma mère rapetissent peu à peu.
Une batte pour les petits bourgeois —
1. c’est une mesure d’hygiène pour nous les gens du bitume qui depuis l’âge des premières balades en bas des tours et des écharpes d’amiante dormons avec les cafards et les relances du trésor public câlinent plus que les chats sur l’oreiller d’ailleurs vraiment c’est une mesure d’hygiène d’entasser dans la cuisine vos gueules de bourges les unes après les autres matez toutes ces antennes adossées aux boîtes de conserve et le poste radio qui tousse à force de fumer matez toutes ces prises branchées sur vous dans la cuisine vos tronches toutes lisses vos tartines de petits bourgeois une mesure de santé publique scotcher vos lèvres car elles frétillent toujours toujours toujours pour ne rien dire des petites dorades qu’on vient de pêcher vos lèvres chaque fois un mot qui prend par l’épaule vous avez un lasso à la place de la langue l’aplomb mais tout ça ça va bientôt se terrer sous la table avec le chat et le bol de croquettes que j’ai posé pour les cafards en fait c’est le salut public et ça commence par une séquestration chez moi pas besoin d’attacher vos épaules fondent sous les ampoules des cuisines de prolos celles qui fument des clopes et qui posent des cocards sur les murs vos sales gueules qui dégoulinent j’aime ça ce soir il y a procès dans la cuisine on va tous se branler sur les costards de votre démocratie et quand la fumée sortira de ma bouche j’irai chercher la batte qui colle qui résonne contre les mâchoires et qui se trompe jamais au moment de punir le bourge
2. « L’appropriation culturelle, c’est lorsqu’un emprunt entre les cultures s’inscrit dans un contexte de domination » Eric Fassin des années à nous chier dessus nous les wesh les gosses de maçons vos lèvres de dorades brunes à force de vomir de la merde sur les survet’ qu’on agite comme des drapeaux au quartier sous les lampadaires et les LBD nos survet’ notre drapeau notre tenue de sport aussi pour tracer les flics que vos vos vos darons envoient chez nous faire râteaux à rebeu et aujourd’hui vous mandatez vos grands-mères en bas des tours pour les acheter nos fringues nos survet’ et les revendre faites du business sur le cul de nos courses poursuites avec les flics j’encule vos commerces underground et les moustaches brillantes de vos vendeurs au kilo mon survet’ il est ! mon survet au kilo ! c’est une tomate vraiment très chère mon survet’ ! et le bleu de travail de mon père ? au kilo ! et la blouse de ma mère ? au kilo ! et les grosses patates qu’on se prenait en GAV ? au kilo ! vous avez roulé nos vies de prolos en boule dans vos frip je vais vous fumer vous les petits bourges vous vous déguisiez déjà en noirs et en indiens maintenant en pauvres en wesh vous vous checkez comme des grands frères trop de palmiers trop noix de coco quand vous matez nos HLM mes cafards auraient jamais pensé devenir sexy un jour vous avez chié sur le survet’ racheté revendu inflationné nous avez étranglé avec la virgule du Nike alors c’est normal ma batte commence à durcir
3. vos stories ont les dents tranchantes vous dénoncez les gamins têtes d’obus les pommettes bleues des nanas les estomacs qui grognent à force de manger du vent vous dénoncez toutes les pluies de parpaings qui fracassent l’utopie regardez mes cafards applaudissent bravo ! vous bombez le torse les seins le cou roc au fascisme vous dites la résistance ! sortez votre langue de lasso vos mots qui passent la main autour de l’épaule vous vous savez quoi faire contre les fachos dans vos AG à quinze vous avalez vos tronches de gosses de prof’ vos références regardez mes cafards applaudissent bravo ! vous êtes des artistes des poètes les plumes vous disent merci de faire couler la justice au kilo bravo ! assez de place sur vos canap’ pour allonger toutes les larmes du monde bravo ! mes cafards applaudissent bravo ! bravo ! mes cafards vous demandent un autographe du coup mais personne vous a jamais vus dans la street tendre la main à ceux qui pleurent du ventre ni aux daronnes qui se font courser par des couteaux Lidl vos langues ont pris vos corps en queue de poisson et quand les fachos débarquent au bas des HLM où sont les poètes ? où sont les poétesses ? au marché de la poésie bien sûr à vendre leurs plumes qui disent merci à d’autres tronches frisées de petits bourges et eux poseront les bouquins de super héros sur la langue de leurs stories tranchantes vos langues ont pris vos corps en queue de poisson mes cafards applaudissent bravo !
4. tu te demandes pourquoi la bave qui coule des yeux j’ai des factures qui me courent derrière car tu rachètes les olives de l’épicier en bas le T1 de ma mère une bedaine remplie par ton chalet de vacances colonisés on est encore jusqu’aux greniers sous les toits et les espoirs que tu me laisses je les enroule dans la galette du kefta samouraï je suis le dernier Turc avant l’exode alors on s’entasse puisque tu rachètes tout on s’entasse avec nos doigts de weed et de peinture dans les cuisines de la faim on adopte les cafards pleurent à dix dans une boîte de conserve après t’avoir pété la gueule j’irai fumer ton père a toujours été mon proprio tu le sais bien petit jamais de bière entre nous jamais copains toi et moi on vit de chaque côté de la banque et sur mon ventre mate la main de ton daron qui gratte gratte mais sois tranquille je lui demanderai pas de raquer pour tes jolies dents après t’avoir pété la gueule j’irai fumer ton père je squatterai ton héritage avec mon cul tout froid et les chiens et les chiennes et les poussières de mes poches feront la teuf sur le rebord de tes fenêtres les miennes avant bien avant que tu recouvres ma piaule avec le fric de ton père je squatterai ton héritage avec mon crew petit on baisera sur le matelas de ta retraite jusqu’à y sculpter des nénuphars de foutre
5. en attendant petit c’est une mesure de salubrité publique tu vas être le premier à prendre mes cafards sont d’accord ton futal comme un zèbre à force de te pisser dessus dans ma cuisine je t’ai attaché à ma seule chaise retenu contre ta volonté dirait ta tante la flic moi je dis plutôt un animal à l’abattoir petit t’as le groin trop lisse à pas t’être pris assez de patates tout va changer jamais courbé la tronche devant la pierre plus blanche que blanche des tes lycées des grandes écoles des administrations en verre où les cravates se font la bise sur des chemises à trois smic ton temple je tag dessus avec ma bite et je ferai lécher le résultat promis en attendant tu vas prendre pour tous les léopold augustin hugo valère paul hortense eugénie agathe domitille léonie tu vas prendre pour tous les petits bourges et vos mots de lasso attention à vos corps si je lève l’orage dans ma bouche petit t’as la gueule trop lisse puceau de patates ta première fois contre ma batte je te promets pas de kiffer ma vie en bois 34 pouces de batailles 1 mètre de sang séché au bout de mes mains le visage qui tremble un papillon de nuit en plein jour pleure pas petit je suis à deux doigt de couper le volume et les gouttes qui s’écrasent de ton nez l’arête se taille en contresens
L’œil du cyclone —
Maux vagues De la nuit Secrets dévoilés Vus Par l’œil qui veille Dans les maux vagues […]Extrait Déwé Gorodé, Nuit taboues, dans _Revue poésie 1_, n° 116, mars-avril, 1984.
Le passé, lui aussi, est convoqué au tribunal du présent. Une chose est sûre : personne n’est surpris. Vivre au milieu de l’incompréhensible. Le renversement total et sidérant du réel. Une érosion lente. L’exil n’est pas toujours une rupture choisie. Ce qui est également détestable.
Imaginez les regrets croissants, le désir d’évasion, le dégoût impuissant, l’abdication, la haine. Les vents s’agitent, les souvenirs tourbillonnent, les fragments d’identité et les histoires se bousculent. Ce sont ces peurs mal résolues qui constituent le cyclone. Un archétype qui dénude, qui bouleverse et qui refaçonne.
Dans le cercle mouvant et implacable de chaque cyclone, il existe un centre. Un espace d’autodéfense où tout semble suspendu : l’œil. Là, dans cette quiétude apparente, où le tumulte semble retenu, se jouent les contrastes de ma propre existence. Le silence n’est qu’une promesse fugace. La transmission aussi. Je regarde aujourd’hui la Kanaky-Nouvelle-Calédonie avec un mélange de nostalgie et de douleur.
La quête d’un chez-soi. Insaisissable. L’apatridie psychologique. La vie liquide. Instants sans traces. Ni vraiment d’ici. Ni vraiment de là-bas. Il y a des souvenirs. Trempés de larmes. Celles et ceux qui ont été perdu·es. De la grotte d’Ouvéa à l’odeur de la poudre. De l’appareil d’État au pouvoir central. Louise Michel avait compris que ce n’était qu’une seule est même cause. De Paris à la Grande Terre. De 1989 à 2024. 35 ans. J’en ai 31 lorsque j’écris ce texte. 1 7495 km pour faire Nouméa-Paris. J’avais 7 ans lorsque nous sommes partis. Parce que mère en galère. Zéro repère. Santé mentale. Mais tout est normal. Je ne me souviens que de l’océan comme horizon. Des biscuits Arnott’s. La statue de Jean-Marie Tjibaou. Le centre culturel qui porte son nom. Des photographies sans légende.
Et puis, du « destin commun », écrit sur la partition unique d’un mensonge. Il ne reste aujourd’hui plus rien. Du « vivre ensemble », il ne reste aujourd’hui plus rien. Du processus décolonial, il ne reste aujourd’hui plus rien. Mais moi, depuis que je suis ici, j’ai le luxe de ne pas penser à eux. Alors qu’eux n’ont pas le luxe de ne pas penser à nous. L’ignorance est tellement épaisse. Mais je pense à eux. Tous les jours.
À l’école, ils croyaient que j’étais Tahitien. Incapables de situer mon pays sur une carte. Ils se demandaient si je parlais vraiment français. Aujourd’hui on me demande si je suis Kanak. Et je ne sais toujours pas quoi répondre. Mais j’aimerai bien avoir un passeport magique. Que c’est une histoire partagée et qu’on est tous·tes concerné·es. Le conflit est une respiration nécessaire. Un endroit pour naître à nouveau.
Pendant la journée d’appel à la défense, le militaire nous expliquait que des essais nucléaires avaient eu lieu sur notre île. En réalité, c’était sur les atolls de Mururoa et Fangataufa, en Polynésie française. 6 000 km de différence entre les deux. Ils ont eu la radioactivité en plus de la colonisation. Aujourd’hui les leucémies et les modifications génétiques transgénérationnelles. 193 essais nucléaires de 1966 à 1996. Les mêmes maladies pour tes enfants et tes petits-enfants.
Nous c’était la guerre civile de 1984 à 1988. Des morts. Des Kanaks. Et le 13 mai 2024. Des morts. Des Kanaks. Les mêmes traumatismes pour tes enfants et tes petits-enfants. Je ne peux plus dire qu’il s’est passé un processus décolonial incroyable et inédit dans l’histoire de notre pays. Entre la France et cette colonie. La métropole. Le bout du monde. Le traitement médiatique. Le racisme. L’ignorance est tellement épaisse. Les mêmes maladies pour tes enfants et tes petits-enfants.
Je ne fête plus Noël depuis quelques années. Santa Claus won’t make me happy with a toy on Christmas Day…Toute ma famille vit en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Depuis 1963 exactement. Étienne. Le grand-père mécano, résistant, amoureux d’une allemande. Et quatre enfants. Mais pas le Maroc pour l’aventure. Pas le Maroc parce que Guerre des Sables. Maroc contre lAlgérie. La France contre l’Algérie. L’indépendance. L’autonomie. Les pieds-noirs. Les traumatismes de tous les côtés. Pour eux. Pour nous. Donc boom du nickel parce que guerre du Vietnam.
L’aventure c’était la brousse en Calédonie avec 3 5000 autres personnes. Des Français·es parce que de Gaulle a certainement fait passer des réclames sur les ondes de l’ORTF : France du Pacifique ! Venez vivre sur l’île la proche du paradis !
Barrière de corail. Jeep et pick-up. Cocktail séduction tropicale. Fusils et chasse. Défisc, francs pacifiques et liste noire. Mais, Mais, MAIS, MAIS, MAIS Ça fait peur d’y aller aujourd’hui. Ouais, Ouais, OUAIS, OUAIS, OUAIS J’ai pas le fric. C’est trop abstrait de passer 3, 4 ou 5 fuseaux horaires en une journée. Paris–Los Angeles–Tahiti–Sydney–Nouméa. Paris–Tokyo–Nouméa. Paris–Singapour–Nouméa. Paris–Dubaï–Nouméa. et 3,54 tonnes d’empreinte carbone. et mon cœur en blessure et leurs blessures en mon cœur. L’œil du cyclone se referme.
Entre l’épine et le clou —
Sournoisement Vous déposez la mort aux pieds opportuns Déguisez mots en oiseaux quelconques Les mains en griffes et la présomption de tout prendre Vous arrivez en ville comme multinationale aux forêts Vous êtes là, fiévreux d’appartenance Troquez sujet en objet Désassemblez les morceaux Puis donnez le mode d’emploi Fière allure, dos courbé, vous redressez le monopole Au nom du bien, le vôtre Vous sortez les couteaux Aiguisez les foules Appelez aux armes Mais où est la dissemblance avec vos ancêtres ?
Fabulateurs d’araignées vous n’avez pas les fils Vous êtes à la ville ce qu’un chasseur est à la campagne Un nuisible À la mémoire courte La cataracte aux yeux Vous, Qui détestez tant nos étrangères silhouettes, Sachez que nous ne désirons pas vos formes Étrangleurs d’ombres, notre vie ne s’ôte pas Notre vie ne s’ôte pas Notre vie ne s’ôte pas
Nous avons Le coup dégagé La corde sous nos pieds Les pieds habitués Funambules nous l’avons toujours été Nous, Sommes nées Graines de trouble Troublé·es Choix radioactif Nucléaires Qui nous a plantés dans ce champ ? Labeur des mains Entre l’épine et le clou Nous assaillions l’interstice
Nous déposons la foi, le feu, la nourriture et le toit Nos mots résonnent au-delà d’une raison Conducteurs Nos corps gardent L’or Le cuivre Le zinc S’en souvenir Nous marchons solitaires, en dehors des groupes et de leurs arrangements Mais restons solidaires à la solitude de ceux qui marchent avec nous aussi Contemporains, De ceux qui ont nommé les choses déjà nommées De ceux qui vous ont donné naissance depuis le centre Qui ont poussé nos mères sur le côté, Écrasées nous autres contre le bord, Au bord du précipice, Vous, qui nous criez marginaux après nous avoir marginalisés Qui remplacez l’histoire avant de nous la rappeler Vous pensez tuer nos croyances en nous interdisant de croire ?
Eau de la Loire confluente Rue des jardins pour la prudence Léchouille de chienne à nos blessures Chêne d’automne pour nos racines Pollinisation des espaces colonisés Eau de la Loire confluente Rue des jardins pour la prudence Léchouille de chienne à nos blessures Chêne d’automne pour nos racines Pollinisation des espaces colonisés
Formule 1 —
quand on avait treize ou quatorze ou seize ans pendant que les appartements étaient des traquenards avec Windows 95 on cassait les barreaux et qu’on faisait naître des bouts de firmament par les fenêtres Skyblog et Caramail et que les filles étaient des chiennes ou des thons ou des cassos pendant que les rasoirs enfonçaient un petit pouvoir dans nos chairs tendres quand on disait que faire couler le sang nous retenait de mourir (et que ça marchait pas) à grands chahuts de gloss il fallait rutiler les cris strip-tease du cœur en continue sous effluve de paroxétine tout pour se faire remarquer celles-là Imane, Jenny et moi ensemble on était des traces vides mais il faut bien trouver du drama à la situation quand la jeunesse et des yeux qui tournent mal c’est tout ce que t’as pendant que pour les vieux on était des fleurs à couper et qu’on voulait du pognon pour changer de race on avait peur de rien à passer les niveaux comme des grosses bâtardes avec nos jolies fesses pendant que nos ventres fuyaient de partout mais qu’on habitait plus là-bas d’abord nos pieds avaient été tranchés depuis le début par les bouches des mères et par les mains des pères et par le reste combien contre les petits corps combien pour nous rentrer dedans par la fenêtre le vieux demandait à bouffer comme un con de tamagotchi pendant qu’on se disait on lui filera pour de faux quand il donnait rendez-vous au Formule 1 et que c’était pas dans des Ferrari qu’on faisait le voyage quand on s’allongeait dans les boîtes on voyait le ciel des néons et nos hanches se brisaient les unes contre les autres après au collège on était riche pendant qu’on ne disait pas comment la fois où on s’est pas couché et qu’on a pris l’argent quand avec un couteau de boucher contre sa gorge facile à comprendre que ta main prenne une forme identique autour d’un manche, d’un membre ou d’un mensonge pour la beauté du geste quand la course-poursuite dans la banlieue de Stras et que nos pieds ont repoussé à défaut de voler surtout ne pas laisser la nuit nous faire du sale à traîner sur la Terre nos carcasses de gosses les lampadaires me regardaient dans les yeux par la lunette arrière et la vitesse de nos rires pendant qu’on a tué le boss voilà c’était comme ça qu’on gagnait la partie et qu’on était plus mortes maintenant c’était lui
Un medley, à minuit moins cinq, au parking du stade, après un combat corps à corps. —
Un medley, à minuit moins cinq, au parking du stade, après un combat corps à corps Je te croise dans la rue, pour la première fois après drame et pluie diluvienne, je suis dans un état — D’épave La suite de l’incident Mes amies louves qui égorgent le présent vont venir jusqu’à mon matelas, me déposer de la viande fraîche Le silence va ramper, en découpant le paysage lourd de ma solitude Celle qui salive devant tout La maison n’aura presque plus de meubles Seul le luxe d’un abat-jour pour surveiller le sommeil L’invention fera le reste de nos envies Mon essence a la couleur du lever de soleil Pleine de bave C’est plutôt un aplatissement de mon propre ego, et un réel qui fonctionne comme un rasoir, surprenant (ma peau tremble) Épuisée, j’ai la flemme de rendre mon ciel visible, je résiste Non, plus maintenant Une histoire pour enfants, c’est à dire quelque chose pour apprendre à rien justifier aux autres Je me perds, toutes ces idées qui se mêlent Dans le salon, les ombres insistent Indélicates Et je poursuis quelque chose, personne ne peut la nommer Hermétique, la formation d’une idée n’a pas de pont, les arbres, oiseaux, le béton des bâtiments, égouts, trafic, aucune connexion Ma spiritualité glisse partout et sans un savoir fixe, je tiens la langue et je la crache Je me lève et la lumière à l’horizon a quelque chose de particulier Un nœud après l’orage, je prends feu Vapeur chaude, mon corps murmure une immensité de questions J’écris pour essayer de saisir quelque chose de l’indicible, cette rage Une prière pour expliquer mon souffle Peut-être plus libre qu’on le croit Brillante, mais rien d’extensif un reflet juste, comme un miroir Je veux arrêter toute cette symbolique, ces choix rapides, je veux t’impressionner Avec mon histoire, même avant ma naissance, ma mère et mon père étaient libres, s’en foutaient de séduire le ciel capitaliste de désirs erronés, leurs désirs étaient la paresse, le temps sans espoir, le présent ardent sans sol ni garantie, tout cramer, la pensée comme seul héritage Planer, comme un disque unique Tu réfléchis à mon cas, tu veux me donner un nom Fais pas l’idiot, mon corps dépasse tes envies, il déborde et il pleure, j’arrose le monde avec tous mes liquides Ceci est mon cœur, ouvre le-chéri C’est le temps des floraisons Je regarde ta chemise de travers, mon désir est vengeance, lèche mon sexe comme pour traduire mon importance, je t’embrasse, à en crever, sur le carrelage de la cuisine, après je te servirai un verre bien glacé, pour que tu puisses éteindre le feu, toute cette flamme, c’est moi qui déciderai quand est-ce que tout sera fini Calculatrice de tous les sentiments, parfois tendre, mes peines, je suis déplumée de partout Contre l’absolu qui tue, je te confie ma libido Errante Prends congé de moi je t’en prie, ne fais plus semblant, tu veux tout commander, Comment je vais m’y prendre avec mon art Suis pénombre, je vis dans un tunnel caché Entre sel et ongles, tu m’as gardée en toi J’ai pris d’assaut plusieurs couches de ta conscience Ose parler de mon amertume, tu ne sais rien encore de mes fonds Vidée de ma violence je choisirai toujours les souterrains Par le cadre rassurant de la fenêtre, je note que le dehors est irrégulier Accepte de m’aimer ainsi Un souffle, puis un autre La respiration inédite de nos corps je la sens, à toi d’y croire Un truc mortel ça serait que tu sois gentil avec moi, qu’on puisse manger toutes les choses ensemble sans jamais nous regarder faire Une confiance secrète, que personne ne peut voir Avec toi une vie qui tient la route comme dans une cour d’école, jouer des jeux sérieux, des pas légers aussi, des points qui évoquent une urgence, aucune ordonnance, je veux un miracle lumineux Laisser tomber les mythes Un bloc d’amour fou gardera en lui les carcasses de nos combats passés Et une pluie viendra tremper la beauté incohérente de nos jours Pourtant si ce souffle ne t’attend pas je continue Les personnes importantes sont gardées sous la paupière, en secret Une amie, une main, deux mains se collent, des pas s’accordent Do You Love Me Now? Elle met la chanson sur son portable Au soleil J’écris pour elle, pour moi aussi, pour nos douleurs sans solution un poème pour regarder le dehors — fais attention à ton désir fais attention à ta sexualité fais attention au monde observe le monde de près, de loin aussi fais attention à tes peurs à tes fantasmes regarde tout ça avec attention regarde les gestes que tu nourris pour rester soumise à un autre méfie-toi des ambitions qui suivent des lois externes à ton esprit respecte ton histoire et les apprentissages qui ont marqué ton corps une vie intéressante est plus importante qu’une vie heureuse tristesse avec pointe de joie Joie bleue reste Maintenant nos colères font de nos yeux des montagnes anciennes Celles qui ont vu des choses et qui disent le poids du monde Tragiques Une volupté tient lame dans l’œil du voyeur Après ce constat, une pause Mon cœur de louve se retourne
Note sur la graphie des genres
Le langage, parce qu’il est enchevêtré dans les constructions sociales, est le reflet des rapports de pouvoir qui nous entourent. Conscient·es de sa capacité à pouvoir dans un même temps les subir et les transformer, nous faisons le choix d’employer dans cette revue des formes de langues qui expérimentent d’autres façons d’écrire le genre. La pluralité des formes qui s’inventent nous paraît plus intéressante que l’homogénéisation, c’est pourquoi plusieurs types de graphie des genresExpression que nous reprenons à Emma Bigé (Mouvementements. Écopolitique de la danse, Paris, La Découverte, coll. Terrains philosophiques , 2023). sont employées par celles et ceux qui ont contribué à la revue.
Colophon
Paru dans la collection C’est les vacances.
Relecture par Louise Pachurka.
Publié sous licence CC BY-NC-SA.
Version imprimeur
Une version papier de C’est les vacances, n° 3, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Constellation Snow E07 Martellata 280 g/m², Holmen Book Extra Blanc 80 g/m² en 500 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en juin 2025 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-420-0.
Cette version a été composée par Aurélie Massa en Adelphe (Eugénie Bidaut), Amieamie (Mirat Masson et al.), Homoneta (Quentin Lamouroux), Playfair Display ( Claus Eggers Sørensen) et Basteleur (Keussel).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc avec OutDesign.