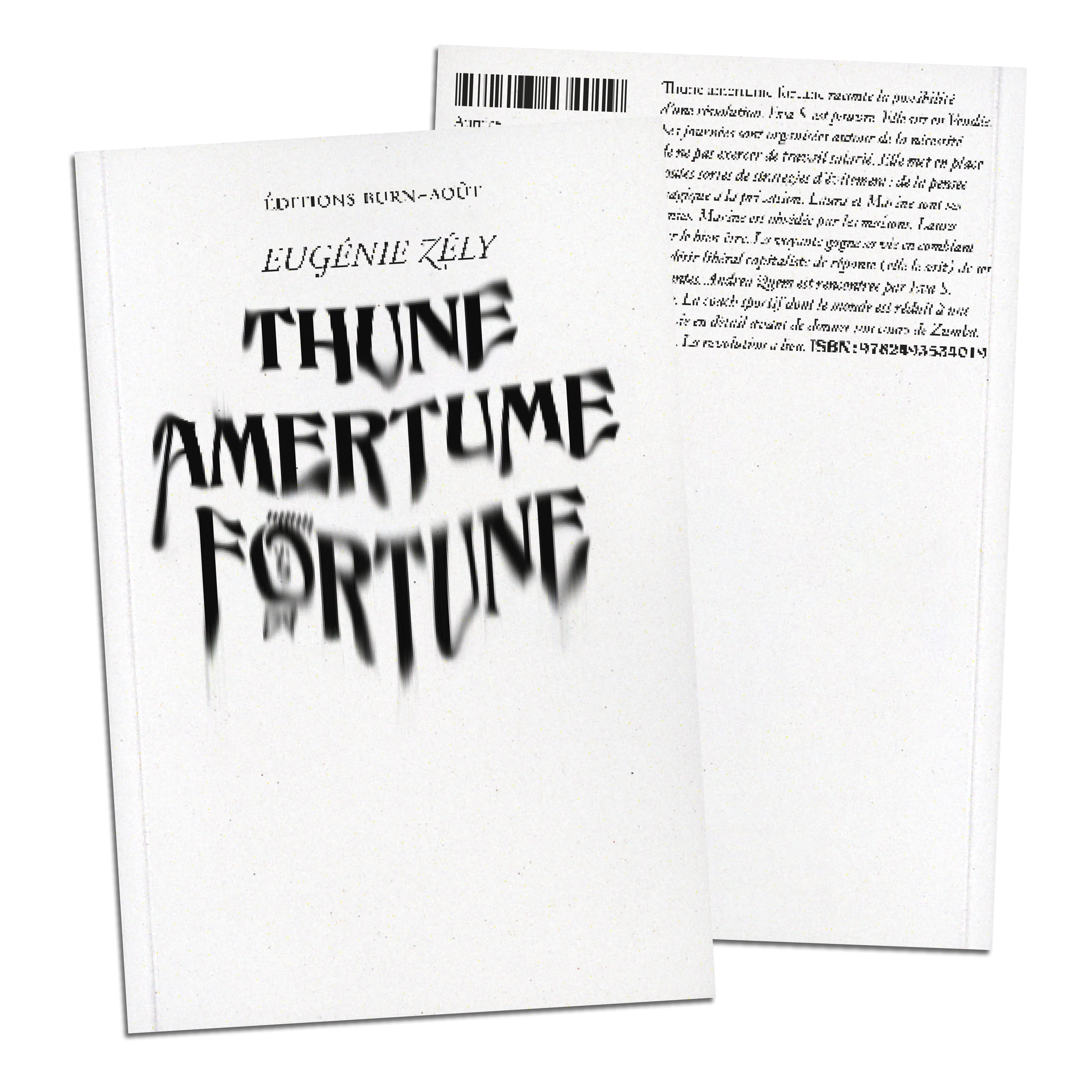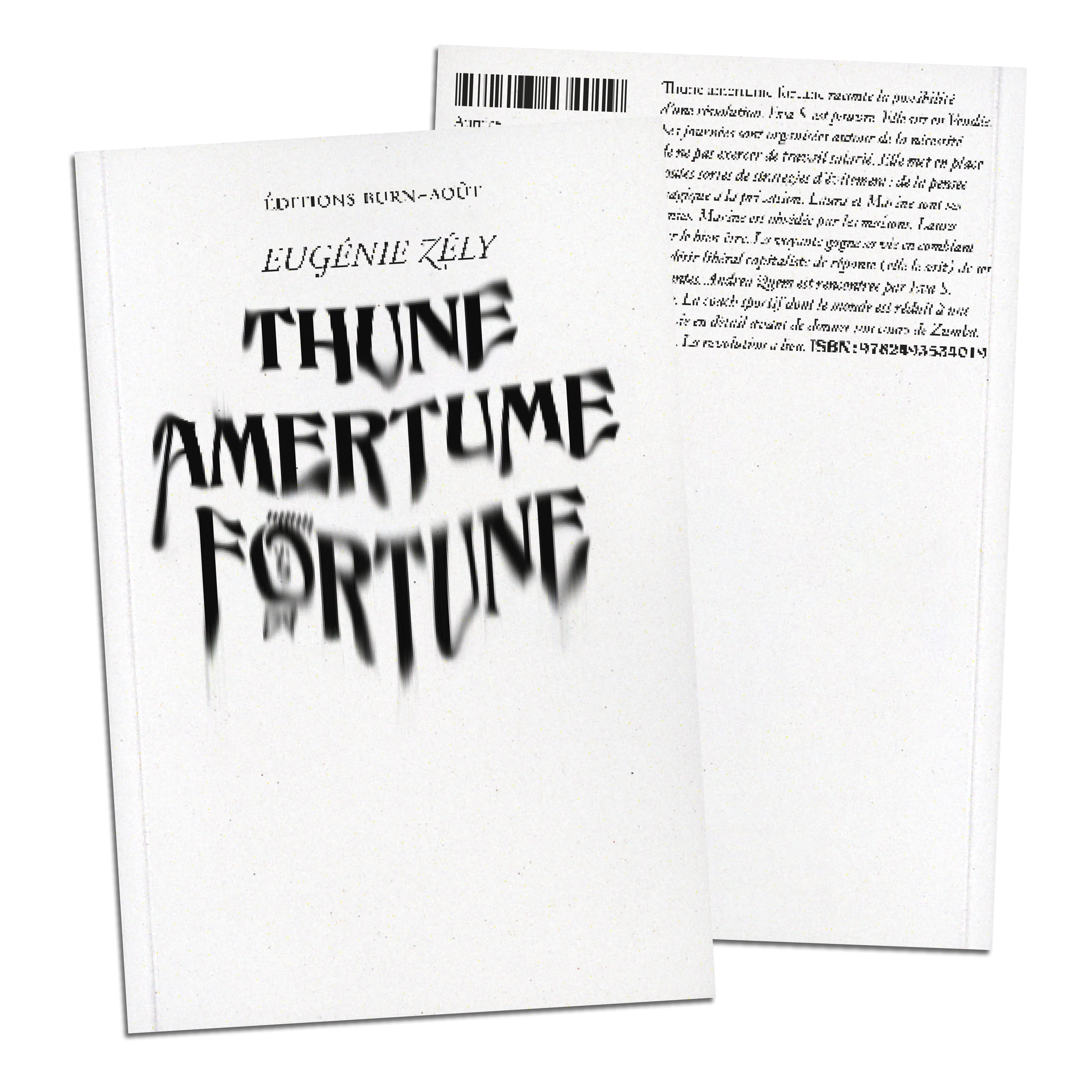
Table des matières
Thune amertume fortune
Thune amertume fortune est le premier roman de l’artiste-autrice Eugénie Zély, lauréate du prix Pierre Giquel de la critique d’art 2023. Elle y raconte la vie, la mort et le désir de révolution de son personnage principal Eva Sig, une femme pauvre de la classe moyenne. Eugénie Zély, informée par les théories féministes et queer radicales, développe dans son travail un savoir situé qui met en mouvement le monde autofictionnel qu’elle dépeint en actualisant une question primordiale : y a-t-il une place pour la littérature dans l’acte révolutionnaire ? Si oui, laquelle ?
Texte intégral
Ce PDF a été mis à jour le 06/10/24 à 18 h 33.
- Dédicace
- Eva S. boit un café en pensant à l’argent
- Le café entre copines
- Le rendez‑vous chez la voyante
- L’aperception des signes
- La rencontre d’Eva Sig et Andrea Quem chez NOZ
- Le cours de zumba dans une salle polyvalente d’une zone industrielle quelconque
- Le meurtre d’Eva Sig
- La révolution s’est produite
- Des agglomérations ( la dissolution d’eva sig)
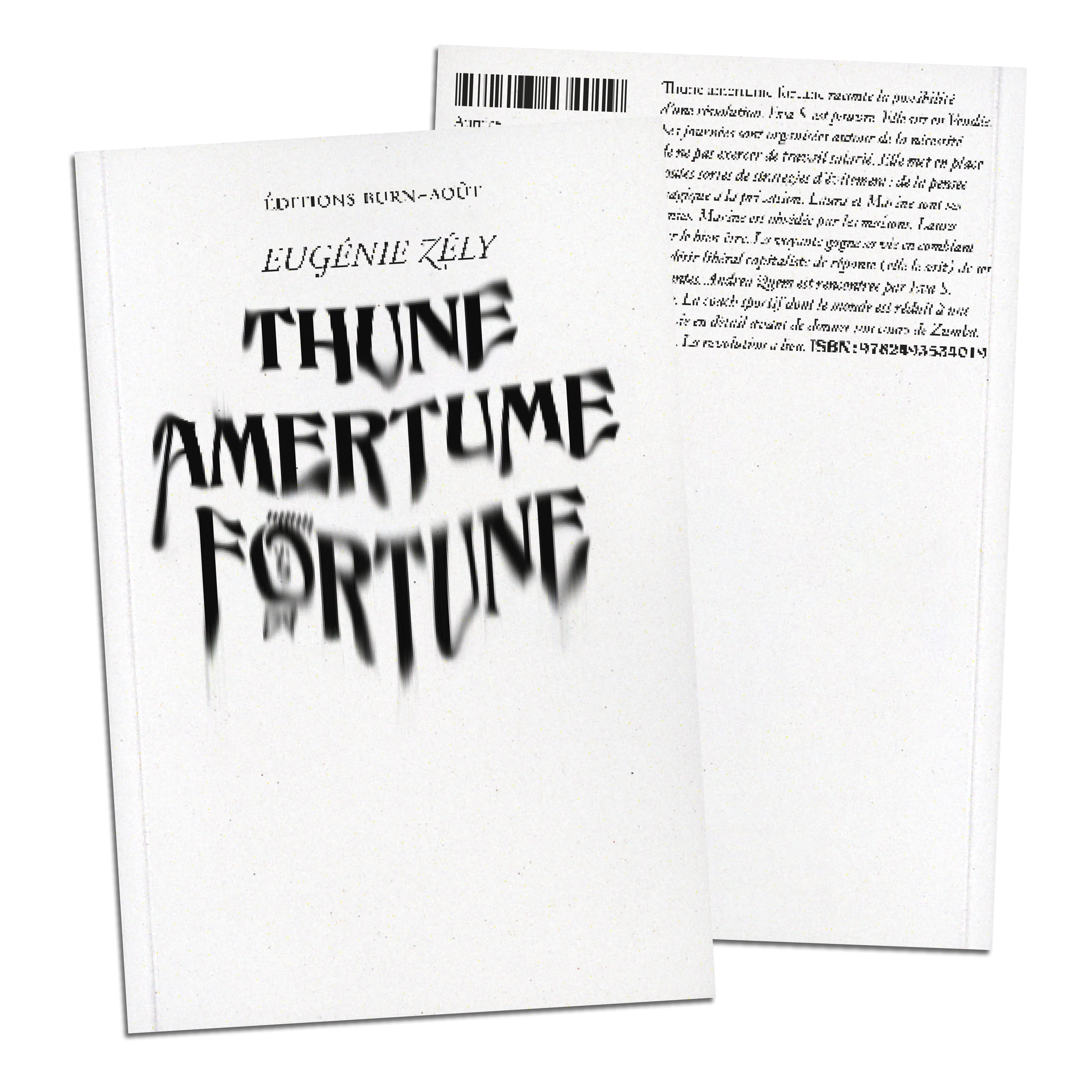
Eva S. boit un café en pensant à l’argent
Eva S. est dans la cuisine, elle fume une cigarette roulée. Cuisine chaleureuse, c’est le début de l’hiver. Il y a des bibelots partout. Deux grandes fleurs en plastique une rouge, une verte à paillettes, un flamant rose violet avec un jeu de miroirs faisant une profondeur violette infinie. Un poêle à pétrole chauffe la pièce. Le réfrigérateur fait du bruit. L’horloge aussi. Elle vit avec son mari qui ne peut pas supporter que cette horloge ne fonctionne pas. Elle n’a pas encore bien compris pourquoi il y tenait tant. Elle, ne tient pas à grand‑chose. Elle est triste et elle oublie (si quelque chose se casse). Pourtant, quand ça ne va pas (quand ses relations interpersonnelles deviennent si ennuyeuses et déprimantes — en fait manque de réciprocité —) elle achète des choses, on pourrait croire qu’elle achète des choses vaines mais non. Comme ils sont pauvres, elle achète des livres, des vêtements, des choses qu’elle a l’intention de garder longtemps. Ça (si elle les a gardés longtemps) on ne le saura que beaucoup plus tard, bien après la fin. Le dernier achat en date c’est un jogging jaune pâle acheté huit euros sur un site de vente de vêtements d’occasion. Ça fait quinze jours qu’elle attend que le colis arrive enfin. Elle l’avait acheté parce qu’une de ses amies avait autre chose à faire que la voir ce jour‑là. Maintenant ça paraît il y a une éternité. La cigarette finie, elle se lève pour aller aux toilettes, elle prend son café avec elle. Alors qu’elle fait pipi elle recalcule ce qui lui reste pour le mois. Ce qu’elle calcule c’est moins ce qui reste pour acheter à manger ou payer les mensualités diverses, que jusqu’où elle peut aller dans les achats inutiles : vêtements, cosmétiques, pâtes d’oléagineuses diverses, fruits exotiques, verres au bar, dîners au restaurant, ameublement, décoration, culottes de règles et comment choisir entre ces achats. La pauvreté ne permet pas l’épargne. La survie ne dépend pas de la quantité de nourriture. La survie, entendue comme continuation possible dans une situation de survivance alors même que la vie bonne est menacée, ne dépend pas non plus d’une capacité parfaite à payer traites et mensualités. Au contraire, elle consiste à identifier de quoi il est possible de se passer, quelles factures peuvent ne pas être payées sans que ça occasionne trop de conséquences et à partir de l’argent qui reste : définir ce qui est essentiel au bien‑être. Elle a choisi : pas de chauffage central, mais des chauffages d’appoint, un dans la pièce à vivre, un dans la chambre, un dans la salle de bain. Tous, éteints quand la maison est quittée. Facture d’eau, taxe d’habitation, impayés permanents. Les impôts finissent en saisie sur salaire et il est interdit de couper l’eau en France — si on cherche pourquoi, on trouvera un texte de Duras qui décrit la mort d’une famille française à laquelle l’eau avait été coupée dans les années soixante, la mort par insalubrité en un mois — la facture d’électricité il faut la réduire au minimum, bien en dessous des recommandations du fournisseur, même si la régularisation de juillet représente quasiment le loyer, au mois de juillet il fait beau, c’est les vacances. À partir du quinze du mois, les liquidités sont quasiment épuisées, c’est là qu’il faut commencer à faire des notes si possible, à réduire ses sorties. Le salaire du mari arrivant autour du vingt‑huit, ça donne une dizaine de jours de privation, mais les quinze précédents ont représenté juste assez de vie bonne, des amies ont été rejointes au bar, de la bonne nourriture a été mangée, et pour les dix jours suivants dans son cas ce qu’il reste à défaut d’argent c’est le temps qu’il fait, le temps qui passe, l’art, la littérature et les chat·tes. Voilà à quoi elle songe, ce cinq du mois — le jour des allocations — alors qu’elle pisse. Elle sort des toilettes en prenant soin de refermer l’abattant. Elle se sert un autre café, roule une autre cigarette et appelle une de ses amies.
quelque chose d’incroyable est arrivé. Laura m’a fait remarquer que je ne fermais jamais l’abattant des toilettes. D’ailleurs, elle l’a remarqué chez elle. Elle a dit : c’est pour ça que tu es pauvre. L’argent part dans le trou, ce trou‑là, c’est un puits à énergie et il n’y a rien à faire à part fermer l’abattant. Ça n’est pas tellement une question de croyance, je n’ai pas pensé que c’était possible, j’ai pensé que ça me coûtait moins de fermer l’abattant que de chercher du travail ou de cesser de sortir pour voir du monde. J’ai pensé, pourquoi pas. On pourrait réfléchir à pourquoi pas plutôt que la première idée de bêtise qui vient à l’esprit après avoir entendu ça. Toujours est‑il que pourquoi pas : je le ferme maintenant. J’ai commandé un jogging jaune la semaine dernière. Un jogging d’occasion. Il n’en finit pas d’arriver, je n’en finis pas de l’attendre. Pourquoi j’attends ça tellement ? Nécessairement, il y a mieux à désirer. Mais voilà j’attends. Je fais mes courses en ligne parce que je suis malade. Une sorte de bronchite. Sûrement parce que j’ai repris à fumer. La mère de Laura m’a dit que ce n’était pas grave, rien ne peut te faire du mal si tu le fais en pleine conscience. C’est‑à‑dire que fumer, me fait du bien. Pourquoi pas. Ça m’arrange. D’ailleurs cette façon de penser est tout à fait arrangeante avec tout, ce qu’elles disent, c’est qu’il y a réappropriation de leur santé, de leur vie. Ce qui me vient naturellement c’est qu’il y a déresponsabilisation politique. Aucun choix jamais plus n’est fait en fonction du bien commun, aucune réflexion à propos des actes, des mots employés n’est plus reliée qu’à la notion de bien‑être et le bien‑être, semble‑t‑il, se joue sur le territoire des pensées spontanées.
Le correspondant ne semble pas lui répondre. On pourrait croire qu’elle parle seule et tient son téléphone pour se faire croire qu’elle ne l’est pas. Comme les personnes qui entendent des voix, dans la rue, ils recourent à cette technique pour ne pas être remarqués par les neurotypiques. Dans ce long monologue, quelques doutes sont évoqués sur le ton de quelqu’une ayant intégré la violence qui lui est faite comme une conséquence de ses choix, choix qu’elle aurait fait tout à fait librement, en pleine responsabilité, sans qu’aucune contingence matérielle, sociale ou politique ne l’y ait invitée.
Je paie mes courses en ligne et plus tard mon mari les rapporte et les range. Il part au travail. Il est fonctionnaire territorial. C’est très mal payé mais d’aucuns diraient que c’est la sécurité de l’emploi. C’est l’heure du déjeuner, je suis seule, j’ouvre le réfrigérateur à la recherche d’un assemblage. Et là, je remarque deux paquets de jambon blanc. Ça m’agace parce que je pensais n’en avoir acheté qu’un seul, ça coûte très cher le jambon blanc bio sans : nitrites‑antibiotiques‑conservateurs‑colorants. Je décide de mettre du jambon dans la tarte aux courgettes, quitte à avoir payé deux fois autant ne pas le gâcher. En déjeunant, je relis ma facture et je me rends compte qu’il n’y a qu’un seul paquet indiqué. J’en ai gagné un, c’est fou parce que ça ne m’arrive jamais. Alors je pars m’acheter un Astro Poissons pour vérifier si ce ne seraient pas les toilettes fermées qui agiraient sur ce que je possède et là je gagne encore : quatre euros. Pourquoi ne pas fermer tes toilettes ?
Après ce coup de téléphone, elle s’endort dans le canapé. Le salon est baigné de soleil. Les chat·tes dorment aussi. Elle rêve : elle est avec des amies en voyage. Elle sait qu’elle est loin, mais ce loin est un arrêt de tram, même si ce dont elle rêve c’est du métro. L’air est jaune, chaud, poussiéreux. Elle a loué une chambre proche de là mais elle attend ses amies pour monter. Elle regarde en haut, monter veut dire que le tram prend comme un angle droit, on ne peut pas voir ce qu’il y a en haut. Elles sont là, elles montent dans le tram‑métro. Elles arrivent en haut et il fait beau, clair, lumineux. C’est le jardin anglais et la jungle et au milieu comme la Sagrada Familia qui se serait enchevêtrée à la Gare de l’Est. Et c’est beau. Pourquoi ne pas plutôt louer ici ? Elle est toujours en haut mais dans un appartement miteux, faux parquet en lino vert, murs humides. Une grande porte‑fenêtre donne sur la mer et sa plage de galets noirs faisant au moins cinquante centimètres. Deux des amies présentes partent se baigner. Elle reste avec Marine, regarde dehors et voit Laura enfiler une combinaison transparente remplie d’air. Elle demande pourquoi Laura a besoin de ça pour se baigner. Marine lui répond que c’est à cause de son allergie au sodium. Eva S. sort. Laura lui dit : c’est parce que j’ai peur de l’eau. Eva S. regarde la mer, il y a des vaches qui broutent là où les vagues s’écrasent. Ça lui rappelle un autre rêve de tempête. Elle se tourne vers Marine et Laura pour leur montrer mais le temps de se retourner vers la mer, les vaches sont mortes et leur sang se répand dans la mer qui devient rouge. Et les vagues immenses brassent les galets noirs, les vaches mortes et l’eau rouge.
Le café entre copines
C’est l’heure du café entre copines. Elle rejoint Laura et Marine chez Marine. Marine est mariée à un ingénieur, elle a un bébé, un pavillon, et une petite bouledogue française noire nommée Gaby. C’est un petit pavillon de plain-pied assorti d’un charmant jardin. Il y a toujours une fleur qui y pousse, un arbre qui bourgeonne, toujours quelque chose à regarder. Ils disposent d’environ quatre mille euros par mois. Elle travaille aussi. Eva Sig est venue pour les roses et l’enfant. Ça fait un moment déjà qu’elle sait qu’elle ne peut plus les aimer, ou plutôt ça fait déjà un moment qu’elle n’est plus aimée par elles. Elles croient qu’elles l’aiment car dans les yeux ça se voit, la fièvre dans les yeux ça se voit, mais elles ne savent pas qui elle est. À un moment, Eva S. a cessé de parler.
Elle venait toujours là, avec ces petites utopies domestiques, ces histoires d’apparentement promettre ce que la vie pourrait être pour nous parce que nous nous aimons. Elle essayait de le dire doucement, elle essayait de faire en sorte que quelque soit l’endroit où Laura et Marine se situaient tantôt trop proche de l’argent, tantôt trop proche de la famille (c’est la même chose, maintenant). Elles tentaient de les modifier à partir d’elles-même. C’était son désir de révolution. Elle voulait leur montrer la révolution, leur donner envie de la faire. Elle voulait leur faire entrevoir ce qu’elle avait vu, ce qu’elle avait par ailleurs commencé à construire avec d’autres. Elle voulait croire que c’était possible. Et c’est ça le pire, on a le sentiment que ça avance et soudainement, il y a un renversement démoniaque. Marine a commencé à dire : de quoi parlent tes histoires ? Je ne les comprends pas. C’est arrivé parce que Laura a trouvé un homme pour partager sa vie. Laura et Marine ont commencé à faire des dîners sans Eva Sig, avec leurs hommes, elles ont commencé à se tirer les cartes, à parler d’énergies, à consulter des voyantes.
Elles sont parties en vacances dans une station balnéaire de la Côte d’Azur et depuis ça, elle a perdu Marine. Laura était perdue à la seconde où cet homme-là s’est installé avec elle. Ensuite elle a vu le pavillon, la grossesse, le choix des couleurs pour les murs, le choix des vêtements de l’enfant. Quand l’enfant est né, Eva Sig l’aimait intensément, jusqu’à environ ses dix-huit mois ça ne posait pas problème. Mais un jour Laura a dit ça se voit que tu veux un enfant, c’est pour ça que tu t’occupes tellement d’Emma depuis Marine s’arrange pour qu’Eva Sig ne passe pas trop de temps avec la petite. Elle a peur qu’elle l’aime trop. Quelle peur bizarre.
Parmi toutes les connaissances de sa vie, celles de l’enfance sont les pires, elles vous déchirent. J’ai eu tort, je suis revenue. Je voulais voir la maison fleurie sous les roses. Mes très chéries, où êtes-vous donc aujourd’hui ?
Nous disions donc : on a le sentiment que l’histoire avance et d’un coup, il y a un renversement démoniaque. Avec cette commerciale qui aura inventé que la vérité est ce qui est répété le plus de fois par le plus de canaux. Ça c’est un moment noir de notre histoire. Voilà la maternité, la maison, là où Eva S. croyait en avoir fini avec la reproduction sociale et l’individu comme capital. Là où on pouvait faire une famille élective et des apparentements différents sans difficulté et Marine et Laura participaient.
Je n’ai qu’une envie c’est aller dehors, j’ai besoin d’air, besoin de marcher vers quelque part. Je n’arrive pas à marcher par plaisir, pour me sentir présente. Qu’est-ce que ça veut dire ? Je veux courir partout, dehors, pour de mauvaises raisons. Vivre pleinement mes mauvaises raisons. Adorer ma vie, adorer ces moments. La période n’est facile pour personne admettons. Mais qu’est-ce qu’elle a, qu’y a-t-il de difficile à avoir peu de choses, et donc à en devoir peu, à vivre pour soi-même. Qu’y a-t-il donc de difficile à marcher dans la forêt.
Au plus Marine se demande ce qu’elle aurait pu faire, ce qu’elle aurait voulu faire au plus des suv, des agrandissements, des horloges géantes apparaissent dans son esprit. Et l’école de la petite, et les vêtements de la petite, et le portable de la petite apparaissent à leur tour. Et la vie qu’elle a promis à son mari. Elle n’a jamais véritablement fait de promesse. Elle a cru d’ailleurs que c’était le monde qui avait changé. Elle a dit, la vente à un moment je trouvais ça trop en cheville avec le capital, trop indexé sur le développement individuel au détriment du bien commun,
_je voulais un travail avec du sens alors je me suis orientée vers le social mais finalement c’est pareil, les valeurs ne sont pas meilleures. Eva S. pense que je me trompe et me soutient. Quelque soit à quel point je me trompe je sais déjà que les pensées arrangeantes vont se loger dans des endroits que les autres ne peuvent pas atteindre. Les autres, je parle bien de la marge. Je parle bien de ce qui n’est pas contenu par la norme. Je ne parle pas de moi. La norme c’est un bien vilain mot qui a tendance à mener vers des raisonnements ridicules. Ce dont je parle c’est de ce qui s’imagine mais se met difficilement en pratique parce que peu de gens l’ont imaginé avant, parce qu’il n’y a pas de cadre légal à ces types de vies. Ce sont les bonnes. Je veux dire ce sont celles qui permettent toutes sortes de continuité. Qui donnent tout : la maison les enfants le travail les animaux mais qui les donnent autrement. Les animaux deviennent des compagnons, les enfants sont ceux de tout le monde, la maison devient l’artefact de ces relations. La conséquence accidentelle comme preuve sublime de vies vécues dans ses murs. Parce que les maisons qui abritent ces vies-là sont des maisons singulières je veux dire : spécifiques à l’usage qu’on fait d’elles. Ces maisons-là agissent déjà comme forme. Elles sont un noeud qui en contient des dizaines d’autres. Elles sont le noeud visible auquel on peut s’accrocher. Mais ces maisons sont détruites. Elles finissent démolies. Littéralement je veux dire. Un promoteur arrive et vous propose un million pour cette maison-là qui était la réification de ce qui avait été une idée folle, un petit geste d’imagination il y a longtemps. Et alors il dit un million et vous qui n’avez pas été très riche, qui avez longtemps combattu, vous vendez cette preuve pour un peu de calme et de sécurité. Ça vous rend seul et aigri, et idiot. La maison s’écroule. Entre temps vous en avez rachetée une autre. Sur un front de mer quelconque. Une grande maison sans tellement de cachet mais avec un terrain assez grand, très boisé, avec un point d’eau, si grand qu’on peut y construire un radeau. Et vous y mettez tout. Vous tentez dans le temps qui vous est imparti de remettre toutes ces années de construction, d’une pensée bien en marche, d’amour pour un certain nombre de personnes, vous comptez y remettre tout dans cette nouvelle maison. Mais vous êtes seul sur le radeau construit pour qui ? Puisque personne d’autre que vous n’a investi cette maison. Elle ne relève d’aucun noeud. Elle ne compte que pour vous, si tant est que vous ne rêviez pas la nuit de la maison démolie. Alors j’achète une cuisine de catalogue, grand plan de travail, la maison est parfaite, rien ne dépasse. Elle est terminée. Il faut choisir les rideaux. Gris beige bleu. Quoi d’autre. Le bébé est là à marcher à quatre pattes sur le parquet et tout est réglé. Je veux dire vraiment tout, même le chemin qu’il prendra dans quatorze ans pour aller au lycée. Pourquoi aller au lycée ailleurs qu’à côté de la maison après tout ? Il traversera le lotissement en passant devant chez Laura, puis devant chez ses grands-parents. Morts. Non ils ne seront pas morts. Maman peut-être. Elle est malade. Mais elle va bien, encore la semaine dernière elle a taillé les haies. Ce matin, j’ai fait les fenêtres. Il faut que je propose aux filles de venir prendre un café. Ah elles sont déjà là. Je me demande ce qu' Eva S. pensera des rideaux, elle ment assez souvent, si elle n’aime pas, je ne le saurais pas. Je ne sais pas pourquoi je la garde dans ma vie. Je l’aime bien, c’est une de mes seules copines. Je ne m’entends pas avec les filles habituellement. Il y a juste Laura et Eva S. mais elle veut toujours partir. Elle veut toujours autre chose et elle a toujours tellement de temps. Souvent, je me sens jugée par elle. Je la vois nous regarder et ça m’agresse. Son sourire composé pour ne pas nous vexer. À elle, il manque beaucoup de choses, je veux dire : elle n’achète pas de maison, ne fait pas d’enfant, n’a pas de travail. C’est débile. Oh Emma, qu’est-ce qu’elle est belle. Eva S. aime tellement Emma. Ça me gêne tout cet amour qu’elle lui porte. Comment elle la regarde. Je vois bien quand je parle maintenant qu’elle ne s’intéresse qu’à Emma. J’aime bien penser à ma fille. Même si elle n’est pas aussi facile que pourrait l’être un garçon. Je l’aime si intensément que ça m’étouffe. Et Eva S. est là à lui offrir un cadeau à chaque fois qu’elle vient. Comment elle trouve l’argent ? Elle n’a jamais de thune pour rien se payer. Des fois je suis mal à l’aise, j’ai presque peur qu’elle parte avec ; ou pire, qu’un jour Emma préfère la voir elle, lui parler à elle, plutôt qu’à moi. Elle n’a qu’à en faire une et me laisser la mienne.
Les cafés sont servis, Laura veut apaiser la situation. Bien que rien n’ait véritablement été dit, elles peinent à reprendre la conversation entamée avant l’arrivée d’Eva Sig.
Eva Sig reste seule avec Emma : tu me donnes tant d’amour tant de force que je ne peux pas me passer de toi. Elles jouent.
Le rendez‑vous chez la voyante
La lumière du jour brille dans un agencement secret. Rêver de la révolution, c’est tout ce que nous avons très fort et le goût des larmes. S’il faut le dire, le café entre copines s’est vécu difficilement. Elle se gare dans le parking des logements sociaux du village. J’ai aimé quelqu’une qui habitait là. Ce n’est pas le même bâtiment, celui de la voyante. C’est le même parking et les mêmes arbres sur lesquels elle avait défoncé l’arrière de sa voiture plusieurs fois. C’était la soeur d’un garçon avec qui elle couchait. C’était un moment très heureux. J’adorais me lever plus tôt que lui pour pouvoir être seule avec elle, elle avait toutes sortes d’histoires à raconter, la révolution qui approchait et moi je pensais « non je ne crois pas à la révolution, je crois aux gens qui la disent ». Elle était là dans sa cuisine presque jamais éclairée et toujours froide — l’hiver parce que le chauffage était au minimum, l’été parce que tous les volets étaient fermés pour garder le froid — un jour elle m’avait dit, comme ça, un lendemain d’élection ; elle était en colère contre moi parce que j’avais dit quelque chose comme « on est heureux, peu importe » ; mais tu sais l’injustice sociale elle est tellement grande dans le monde qu’un jour ou l’autre il va bien falloir la faire la révolution, encore. J’ai eu honte et je l’ai crue.
C’est au quatrième étage. La salle d’attente est un salon, canapé en cuir blanc abîmé confortable, recouvert de couvertures dans des variations de vert. Grande baie. Il fait beau.
La voyante entre dans la pièce, échange de salutations, déplacement vers le bureau. Le bureau est petit, il y a une table au centre. Il y a une bibliothèque sur le côté remplie de toutes sortes d’oracles. La table est gravée de signes.
Elle continue : je suis là parce que je dois gagner ma vie. Je ne comprends pas toujours ce que je dis, seulement je sais que c’est vrai. Il fallait bien manger et j’ai remarqué que je me trompais rarement. Ce que je fais, c’est la description des signes et de leurs agencements. Les gens pensent qu’il y a prédiction, mais ce qu’il y a, c’est que la plupart ne produisent pas l’effort que ça demande. Quelque chose comme la paresse, c’est de la bêtise. Souvenir de vacances. On me consulte rarement plus d’une fois et je m’applique à discerner ce qui est attendu et à le donner. Il n’y a plus que des réponses. Je comble alors ce désir‑là c’est un désir libéral capitaliste, s’il faut le dire. Je me laisse consommer parce que, et je dois être honnête à ce sujet, le point où une personne se met à penser à partir d’elle‑même et de l’agencement de ces signes n’est jamais atteint.
Eva Sig, sur l’air d’India song toi qui ne veux rien dire, me parle d’elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps : la haine, je brûle de colère. C’est tellement intense. Je veux voir morte l’humanité un nombre assez grand de fois dans une journée. En conduisant, souvent, j’imagine élaborer des bombes artisanales. J’aurais trouvé la recette sur internet, entre celle du banana bread et celle du savon maison. Les institutions exploseraient grâce à mon intervention miraculeuse. La misère sociale me dégoûte. Faire semblant que ça n’ait pas lieu, c’est pire. La colère me consume. Quand je pleure, c’est de la sueur qui s’écoule. Je suis si fatiguée. Si la mort est un mystère, la vie n’a rien de tendre. Toute cette haine que je ressens, je voudrais tuer des gens, lentement, qu’ils éprouvent une grande douleur. Si le ciel a un enfer, le ciel peut bien attendre. Je suis écoeurée. Je n’ai plus de force, jusqu’à la prochaine fois disons. C’est une veine. Moyenne fille polie. C’est éternel ça. Je ne sais pas si je mérite ce que je veux. Est‑ce que c’est vraiment la question ? Je suis le pistolet et la tempe. J’ai tellement envie de vivre que la seule chose qui me vient, c’est : j’ai envie de crever. On avancera comme ça, avec des guerres, des changements de régime et cette masse populaire, infinie dont tout le monde se fout. Jamais je ne m’en remettrai. Ma dernière pensée, ce sera celle‑là.
Eva S. choisit cinq cartes. Il faudrait les voir pour y croire. La mer et des filles qui s’y baignent, une maison sur la mer, un couteau en sang et au loin une rue, un visage déformé, un feu.
Qui sait ? J’aurais mis plus de temps à le devenir. Révolutionnaire. Là, c’est immédiat. C’est une conséquence immédiate de la vie vécue et non pas de la lecture ou d’une expérience culturelle ou idéologique. Ce n’est pas un état d’âme, c’est un état de fait. Personne n’est une révolutionnaire née. Chaque chose que je vois, que j’entends à son corollaire politique. C’est comme ça.
Je pourrais le supporter parce que je peux croire à la poésie. La poésie et la révolution c’est pareil. Ce sont des ramifications de la même branche. Il y a toute une littérature masculine très bavarde, percluse de culture, alourdie d’idées, truffées d’idéologie, de philosophie, d’essayisme larvé. Cette littérature des hommes, elle ressortit à l’orgueil, au patronat en général, sans spécificité, dans la plupart des cas, ils n’atteignent jamais la dimension de la poésie. Ils sont privés de ça. Les romans d’hommes ce ne sont jamais des poèmes et les romans ce sont des poèmes ou ce n’est rien du tout. C’est de la compilation. Vous savez la littérature masculine est tout de même l’exception. C’est une toute petite partie de la littérature. La littérature c’est un continent immense. C’est les chansons, c’est la pratique quotidienne de raconter des histoires, c’est la façon dont certaines racontent leur vie à des journalistes, la façon dont on raconte son histoire, la manière qu’ont certaines de faire leur travail. La littérature c’est dire comme on construirait une maison.
La voyante regarde les cartes sur la table, la révolution aura bien lieu. Eva S. va mourir. Elle rencontrera quelqu’une qui précipitera l’évènement. De ça, la voyante dit quelque chose comme : c’est un amour que je reconnais comme étant inconditionnel. Une fois logé, ça ne cesse jamais. Il n’y a rien à faire, c’est une calamité. Ça ne cesse jamais. Elle pourrait faire n’importe quoi, tuer dix personnes elle sera aimée toujours et toujours de la même façon. À ce moment‑là ça n’a pas une importance particulière pour Eva. Elle et la voyante vont continuer à discuter un moment. Il faudrait souligner que la voyante est troublée. Comme elle l’a décrit précédemment, elle gagne sa vie à donner des réponses. Ce qui la traverse, comme sentiment, n’est pas l’objet des moments passés avec la clientèle.
Je ne peux pas dire que c’est difficile. Il existe des vies faciles, des vies difficiles. Ce qui me dérange, c’est qu’une vie ne peut pas être que cela. Elle est difficile et autre chose. Comment sinon, d’après vous, entretiendrais‑je cette colère ? C’est pour ça que la critique est toujours mauvaise ou stérile, quel mot choisir, la critique ça ne sert à rien du tout si ce n’est à montrer qu’on a remarqué. Ça ne change rien aux vies menées. Les gens pensent que c’est le manque de sécurité qui empêche la vie bonne. Ils confondent. Alors je les vois comme des gens qui ne sont pas tout à fait des adultes. Sans mépris. Je suis tout à fait étonnée, chaque jour, de voir comment on peut supporter la vie que nous menons. C’est un étonnement dont je ne reviens pas. J’ai souffert comme tout le monde, je n’ai pas souffert de façon privilégiée. Seulement, un jour j’ai désiré la révolution. Il y a beaucoup de gens qui ne le désirent pas, mais il leur suffirait d’une lecture, d’une connaissance, quelques fois je pense même : d’un rêve voyez‑vous ? D’une conversation dans la rue… Pour que ces personnes changent complètement. C’est‑à‑dire qu’il y a beaucoup de gens qui ont manqué la chance d’un instant dans leur vie.
Il y a autre chose que je vois ; je ne peux pas définir celle que vous rencontrerez quant au passé puisqu’elle appartient à l’avenir. Est‑ce qu’il faut détruire absolument ? Oui je crois. On refera plus tard. On traînera d’abord dans un grand bain d’obscurité et d’ignorance. Les gens se réuniront pour parler et ils referont parce que le point de vue de la survivance du plus fort aura disparu. Ils commenceront à aimer autre chose.
Mais je crois que vous avez, de la révolution, une vue, je m’excuse de le dire : tout à fait innocente. Je veux bien ne pas avoir d’argent dans un monde où il n’y aurait pas d’argent. Mais je ne veux pas être privée d’argent dans un monde où il y est. Pour l’instant, il y est. La voyante dit : Courage, chance, ténacité. À titre prémonitoire on a entrevu ce que pouvait produire la révolution : l’entente commune à partir de la vie, tout simplement.
L’aperception des signes
Eva S. sur la route. Un gravillon percute le pare‑brise et le fissure. C’est l’apparition du soleil. Recouvremoi de lumière. L’angoisse dans une jolie forme. Combien ça coûte ? Est‑ce que ça compte si on ne le répare pas ? Répare et remplace. Elle vient de dilapider cinquante euros dans la voyance. Remplacer quoi ? Eva S. aime Laura et Marine. Elle aime la femme qu’elle vient de consulter. Ça n’est pas habituel de parler d’amour pour ces relation‑ci. Il est question de présence. L’apparition de la voyante s’est produite dans le vide laissé par Laura et Marine. Plutôt par l’absence de formes entre Eva S. Laura et Marine. C’est ce vide, quoique Eva en pense, qui l’a conduite à payer pour qu’on l’invite à prendre patience.
De réponses, je ne sais pas si j’en avais besoin. Je comprends tout cet argent dépensé pour se sentir pleine de gratitude. Loin de soi‑même, proche du bonheur, du bonheur des uns qui ne fait pas le bonheur de chacune. À peine convaincue pourtant. La qualité de la conversation et la qualité du sexe. Les personnes moyennes laissent des trous béants où peuvent se loger de drôles d’idées pour celles qui ne le supporteraient pas. Par exemple cette femme qui s’est taillée les joues au cutter pour accuser quelqu’un d’autre. Comme je la comprends. Je la vois d’ici, le sang coulant dans le café au lait chaud. La décision d’accusation.
Qu’importe le mensonge puisque la vérité c’est que cette lacération lui a été infligée, qu’elle ait porté le coup seule change : quoi ? Ce geste est plus compliqué que ça : s’entailler les joues, accuser quelqu’un d’avoir infligé la blessure, c’est une tentative de formalisation du contexte.
un jour, dans la fumée synthétique penser qu’un couteau, un pic à glace ou un rasoir pourrait transpercer sa peau et que le sang pourrait couler sur sa robe blanche. Quelques années plus tard, se décider, le lait comme la robe.
Je voulais une vie grandiose. Toujours ma torpeur, dont je ne sais pas parler. Je veux dire : vouloir ne sera jamais pouvoir. C’est‑à‑dire qu’affecter par un geste un déterminisme, est un privilège de. On sait. Un ennui enveloppant. Les yeux humides de fatigue. Il y a quelques temps j’ai regardé une image de moi en 2001. Dans mes souvenirs pour faire sortir l’oxygène des muscles (quelque chose du genre) je parle d’un bâillement. Je suis engourdie.
Cette fille très occupée, après un bâillement se lacère les joues au cutter. Ce qui paraît insensé dans la mesure où toutes les personnes heureuses, un jour, reçoivent un appel qui leur donne envie de mourir. Peut‑être que la lacération se situe bien après cet appel. Un appel dont elle n’aurait même jamais pu décrire le contenu, ni à elle‑même, ni aux autres. Un appel moyen. Un appel qui laisse un trou. Pendant assez longtemps, il y a assez longtemps, je me suis demandée comment construire un trou. Comment faire que le trou ne soit pas la conséquence mais la cause, le choix, ce qui se produit et où on se love.
Passage devant Rien sans Peine. Le nom de la maison à la sortie du bourg. Le monde est vide et tout à coup il y a un peuplement et le monde est bon. Tout le monde se tait devant moi. Tout le monde se met à me croire. Ça change. C’est bien. Je pleure. Je meurs. Je le sens bien que me croire c’est me tuer. (Le pressentiment de la suite.) Je pourrais me tromper sur pourquoi on me croit. Si je dis que ça ne va pas, il y en aura toujours une pour se réjouir. Tout ce qu’on attend de moi, je peux le devenir. Simplement je refuse d’être selon le goût des autres qui n’en ont pas. La thune panse tout. La moindre frustration un pull neuf te la soigne (surtout s’il fait froid). Le goût amer est le goût que je préfère. Est‑ce qu’avoir une double vie est d’abord un désir sexuel ? Après ce sont les faits divers qu’on connaît et les histoires sans drame, dont on entendra jamais parler mais qui se produisent toutes à la fois et partout. J’ai une double vie je crois (qui n’induit pas de famille). La double vie c’est toujours l’imagination d’un père de famille : père de deux familles, avec des frères et des soeurs qui s’ignorent. Quand je me masturbe, je suis quelqu’un d’autre. (Le peuplement, lover dans le trou, ça se comprend ?) Pensée suivante, La maison. ————
Je n’ai plus l’impression de marcher à l’intérieur d’elle comme je marcherais à l’intérieur de ma tête (de moi‑même, de mon corps) une histoire de poupées russes à mieux décrire. J’étais dans la maison et j’avais l’impression d’évoluer à l’intérieur de moi‑même, sans pour autant que ça change quoique ce soit à l’expérience de ma pensée. Ce qui donc était une impression sans intérêt. Mais très dense. Maintenant, j’ai conçu une maison mentale, Minette y vit. À défaut d’avoir survécu.
Amertume un goût, Un sentiment (mélange de rancoeur et de découragement) Un café, Un pamplemousse, Le sperme (le tien, qui est comme de la pierre liquide) D’autres choses, mais ce sont celles‑ci que je consomme. Demain il fera beau Le soleil éclaté sur le part‑brise, Il ne fait pas beau et ça fait des semaines Il pleut tellement souvent, c’est l’effet que ça me fait : la moyenneté du temps. Pulsion compulsion définition. Chaque moment de ciel bleu me semble être une chose dont je dois me souvenir, Avant que ça ne se produise plus. Le musée, le parc, les meubles. Est‑ce qu’il y a un rapport entre respirer et acheter ? À quel point j’attends que les choses se produisent, littéralement qu’elles m’arrivent. Aspirateur, drap : sommeil. J’ai un mauvais sommeil.
Cette femme qui a tué sa collègue malvoyante et en sous‑vêtements à coups de tessons de bouteille. C’est la fin de la journée et l’autre est là, assise à table et demande : pourquoi tu n’as pas voulu que je t’aide ?
Elle voulait juste aider (on l’appellera Martine). Martine voulait juste aider et l’autre (on l’appellera Véronique). Véronique refusait. Véronique ne méritait pas d’être tuée et découpée et plantée dans une jardinière (seulement sa tête) même si j’ai tendance à penser que c’est assez beau. Mais Martine avait une vie engourdissante. Martine voulait aider à classer les dossiers. Martine voulait passer du temps avec Véronique. Martine se sentait seule.
Sauf que : Véronique avait eu son lot. Véronique ne voulait pas perdre le privilège d’être la référence, la cheffe. Véronique n’avait pas besoin d’aide de toute façon. Martine, brisée, a attendu Véronique chez elle (toute sa vie on pourrait dire : ce moment du meurtre Martine l’a attendu comme une réparation. Elle a pensé faire justice, faire souffrir au niveau de sa douleur. Toutes les souffrances qu’on lui a infligées Martine les condense toutes et frappe Véronique). Véronique voit Martine attendre gentiment pour la découper en morceaux après l’avoir tuée. Véronique a peur. Véronique court en direction de la porte à moitié déshabillée, sort et hurle. Le voisin est là, il la regarde s’affoler.
Martine, au voisin : ne vous inquiétez pas je suis sa cousine, elle est folle, mais je m’en occupe. Véronique est trainée dans l’appartement par Martine. Véronique se demande comment Martine est entrée. Martine est pleine du désir de la mort de Véronique, elle est en train de la tuer et son désir de la tuer n’a jamais été aussi intense. Un bruit de verre brisé, Martine abat le tesson sur Véronique de tout son poids. Véronique meurt.
Martine découpe Véronique pour la faire loger dans une valise et un sac à dos. La valise est lourde alors elle la laisse dans un bosquet à trois cents mètres de l’appartement ; un cadeau pour le voisin, Martine croit se rappeler qu’il a un chien. Martine imagine l’horreur qui traversera le pauvre type quand il retrouvera Véronique. Elle garde la tête, qu’elle enterre avec douceur et gratitude dans la jardinière de son balconnet.
Eva S. rentre chez elle dans une succession d’images, de personnes et de personnages, elle se rappelle ou elle voit ou elle entend.
Des impayés, qu’elle consulte dans la cuisine. La relance pour l’eau est trempée des jours passés dans la boîte aux lettres et la tache a la forme d’une flamme. Elle jette le courrier.
Comment je la reconnaîtrais, comment je verrais un corps et autre chose. Ce sera un visage dans une image qui n’existe pas encore. Que je forme. Qui donc n’en sera peut‑être jamais : des images dont je me souviens. Elle doit être une image et un sujet à la fois. Elle devrait avoir un air monstrueux (n’importe quelle figure vue de près est celle d’une monstruosité, les sentiments pire encore). Non narrative. Elle serait pardonnée, toujours déjà
Quoiqu’il en soit, Eva S. tente de se constituer une journée à partir de ce qu’il reste de temps, de structurer ce temps. Manger, sortir. Développer : manger et sortir. Quoi déjeuner, du poisson. Du merlan, frit peut‑être. Avec des pommes de terre bouillies. Une compote. Un café Lancer une machine, programme éco vingt degrés Un coup de balai,
Le soleil traverse les rideaux verts‑beiges, éclaire le bouquet fané. Toutes tentatives de descriptions de cet espace ne donnent aucune impression de ce qu’il est véritablement.
Construire une maison est une activité pour laquelle il faut une spécifique attention. C’est voir et vivre, habiter. Comme voyager d’ailleurs. Savoir quoi déposer, où et comment, selon ses usages et ses sentiments ; selon les réactions de chaleur, d’humidité, d’empoussièrement de la maison. Ça prend des années de savoir la couleur des murs, l’emplacement de la table de la cuisine, s’il faut une étagère ou un petit meuble dans la salle de bain. Les personnes qui décorent ne savent rien des maisons.
Vivre quelque part c’est produire de la parure, parer avant de vivre c’est à peu près avouer que sa vie ne produit rien.
Les gestes quotidiens nécessitent des espaces non ornés, parce que ce sont des gestes opaques (impensés) tout ce qui leur reste ce sont leurs conséquences.
La rencontre d’Eva Sig et Andrea Quem chez NOZ
C’est le moment de la rencontre, Andrea Quem est attendue depuis le début, supposément c’est l’avenir. J’aimerais que ça le soit. Quelqu’une m’a dit, en octobre de l’année 2022 se produira la révolution des jeunes personnes. Mais c’est un peu trop tard (et nous ne voulons pas d’une révolution qui serait uniquement celle des jeunes personnes. Pourquoi ? Parce qu’un jour elles deviennent vieilles et propriétaires et de l’amour ne connaissent que celui qu’elles portent à leurs privilèges qu’elles ont renommé : travail, effort, argent, expérience). Trop tard pour Evasig, voyez‑vous son visage ? Une entourloupe avec personne (et personnage).
Le temps qu’Eva arrive finalement chez Noz, on aperçoit Andrea devant le bac.
Eva S., anxieuse, décide d’aller chez Noz. Ça prend du temps de regarder chaque objet minable. De chercher un trésor. De chercher les objets qui translatent des morceaux de la réalité. Trésor ne convient pas : richesse accumulée et cachée soigneusement. Elle aperçoit au loin un bac semblant comprendre une bouée en forme de flamme bleu transparente, un grand verre fissuré circulairement dans son centre (à peu près), un faux coquillage encadré, nommé (décrit). Et toutes sortes de ces choses. Andrea Quem se tient devant le bac. Ils ne devraient pas tous, les objets, être tellement pleins.
Eva Sig espère me rencontrer. C’est son caractère. Elle essaie de retrouver ce mot. Hier est la seule chose qu’on partage. Hier n’a pas encore eu lieu. Je suis une image. Pas l’image d’une chose. Pas sa représentation. Non une image, j’ai le souvenir d’après‑midi à ne rien faire, je bâille sur ces après‑midis. Je suis un type d’image qui s’adapte à son contexte, mon nom et ce que je suis varie. L' effet que je produis également. Ici, image moyenne. Je suis celle qu’attend Eva Sig. Je consiste en la prolongation de ce que l’on croyait terminé, par ajout d’un élément qui se trouvant ainsi déplacé, produit une translation de sens. Je suis perçue comme une possibilité du langage, la petite femme musculeuse sa colère et sa tristesse toute contenue quand elle enchaîne les pompes, un défaut essentiellement.
Je ne pense qu’à acheter (ça me donne des sueurs froides, de posséder, décider quoi ajouter et abattre ma décision sur la réalité. Ça a lieu. Imaginer comment cet objet va s’arranger avec les autres. Toutes les images qui se développent avec l’ajout de cet objet. Je paie et je vais mieux. C’est immédiat. Le rapport entre acheter et respirer c’est le pouvoir. Je respire mieux quand je peux changer le monde.
Les larmes de sueur — ce qu’elle a voulu dire c’est qu’un jour vous ne pouvez rien, vous perdez votre maison. C’est comme ça. Elle n’était pas à vous. Vous ne pouvez pas acheter de saumons sauvages ou de pommes Nashis. Le prix au kilo, pire si c’est bio. La révolution, les quatorze millions de pauvres qui se lèvent en même temps et les autres ( oui, les autres changent de camp, translation de la figuration ) — qui ne comprennent pas que le monde ait changé d’un seul coup, sans violence, les quatorze millions ne comprennent pas bien non plus. Ils ont fait le même geste au même moment, presque par hasard — entendre : sachant à peine pourquoi, et surtout l’immense variété des causes.
J’essaie de donner une marque à la révolution. Petit creux où loger le désir irrépressible d’acheter le monde révolutionnaire. En faire un lifestyle : lookbook, intérieur — pas très hygge, la révolution, plutôt chargé comme intérieur, pas épuré, des strates —, régime alimentaire, storytelling. La translation est un transfert, mais je voudrais ajouter que c’est un transfert qui laisse une trace, elle emporte des choses sur son passage, la chose translatée. Il faut se souvenir de la translation en géométrie (pour les enfants) pour bien saisir l’émotion de ce mot. Ce faisant : un renversement brutal du mode d’exposition et d’organisation de la pensée à partir du mode de saisie de la réalité se produit et c’est la révolution de chez Noz.
Andrea est interminable là où Eva se clôt. Je vais essayer de retrouver ce mot.
Andrea est une figure de style.
Il y a la définition d’hyperbate et il y a le rêve de ce mot.
Pour quelques personnes, très jeunes ces mots‑là, jamais entendus, découvrent des mondes et font des révolutions. J’étais une métaphore avant d’être un pronom. Surtout une hyperbate (rupture de la cohésion). Eva Sig n’écrit presque jamais. Elle écrit quand elle roule en voiture : got a fever. Pare‑brise, musique : c’est du cinéma. Je l’ai entendue tout à l’heure à la radio, quelle fatigue. J’ai écrit qu’une métaphore est une image qu’on ne voit pas.
J’avais écrit que la mer est une métonymie.
Les figures de style sont des poèmes. Rien que des mots. Des mots qu’on utilise pour lire, donc qu’on n’écrit pas ou qui ne se trouvent pas dans la littérature, ils sont là littéralement. Jamais prononcés. Comme Andrea. Pas prononcé : sans pronom. Mais là. Andrea n’est pas une métaphore c’est une hyperbate.
Le nom complet d’Andrea est Andrea Quem.
C’est son nom seulement parce qu’elle va rencontrer Eva, dont le nom est Eva Sig.
Andrea Quem est un anagramme.
De même qu’Eva Sig.
Pendant le rendez‑vous chez la voyante il a été question de ce qu’est la littérature, surtout de ce qui n’en n’est pas. C’est que c’est de la composition (comme les livres d’hommes, et cætera). Mais j’aime bien la composition. Là encore il y a une faute de mot. La composition c’est l’agencement et un agencement peut être de la littérature, désirer c’est construire un agencement (disait Gilles, comme mon amour ce nom déjà pronominé). Tout dépend de la manière. Hyperbate. I feel it coming.
Andrea Quem lui montre les objets, qui étaient un amas et sont un plateau organisé, chaque chose incarnant (comme un personnage) ou renvoyant (comme une astérisque).
Eva Sig est émue par Andrea Quem (la forme d’une nouvelle maison, d’une émotion, d’une rupture de sens à la fin d’une phrase qu’on pensait close).
Quand Eva aperçoit un des bacs au loin, le bac semble plein de tous les signes. Son sang se glace (elle est émerveillée de la beauté des objets) devant ce bac Andrea Quem prête à lui adresser la parole. S’en suit une discussion assez longue, détaillant les objets, tricotant une sorte d’histoire d’amour très intense et productive entre les deux personnages via les objets découverts. Elles sont émues. Elles décident de ne plus se quitter. Que pourrait être l’identité d’Andrea : une identité sans pronom (impossible à définir autrement que par elle‑même) une identité de l’agencement et du recyclage. Andrea n’étant rien de plus que ce qu’Andréa est : un désir, la construction d’un agencement, interminable, puisque semblant achevée suivi d’une conjonction ou d’une virgule.
Eva est reliée pathétiquement à son pronom : elle. J’y tiens comme à une chose conquise et fragile. Enfant, quand je n’étais fermement pas encore une femme, quand on m’a fait toute cette violence avec l’incorporation de mon genre.
Je pleurais en regardant mon corps que je détestais. Et puis, les femmes de ma vie, les histoires qu’elles ont faites et dites, et ce pronom est devenu l’incarnation d’une résistance sans laquelle je ne survivrais pas. Comme un choix. Fait de force.
Eva.
Eva Sig regarde Andrea Quem elle la regarde et lui parle Je me regarde dans la glace comme si j’allais y voir quelque chose d’autre que mon visage. Comme si ce visage allait s’animer sans moi, s’adresser à moi. Me tenir compagnie et… je regarde ce visage comme s’il méritait mieux que moi, que le reste de son corps. Ce visage que je trouve beau. Ça n’a pas toujours été le cas, mais quand ça n’était pas le cas, je ne pensais pas à mon visage, je pensais à mes seins et à mes hanches et à ma hauteur et à ma largeur. À un certain moment le visage s’est constitué en territoire dissident. Je ne me suis plus reconnue que dans mon visage.
Je ne vais pas vous raconter ce que ça me fait, de voir aller et venir certaines de mes occurrences. L’isolement dans lequel m’a plongée la pauvreté est parfois si insupportable que je préfèrerais me voir mourir. La pauvreté c’est s’ennuyer occupée en ayant un peu froid et un peu faim. Pire que ça, ce n’est plus du domaine de la pauvreté (il faudrait d’ailleurs s’en souvenir). Je suis pauvre devient tout ce que je suis par moments. La description la plus parfaite de l’enchaînement de gestes, de paroles et d’évènements qui constituent ma journée. Il n’y a qu’aux pauvres qu’on demande d’être républicaines. D’ailleurs, j’ai commencé à comprendre qu’il y a des vies qu’on peut vouloir ne plus vivre. C’est plus possible mais tu forces. Un rappeur riche dit Aujourd’hui j’aimerais mieux que le temps s’arrête, ce qui compte c’est pas l’arrivée c’est la quête. Je vois ce qu’il veut dire : ma bouche près du cou de mon amour, mais aucune quête n’en vaut la peine, et tous les petits gars des sagas des vingt dernières années le savent bien (eux, n’étaient même pas pauvres, celui que je préfère était même blanc, riche — comme tous ces petits gars qui devait sauver le monde, sans révolution surtout, c’était même leur mission d’éviter la révolution — puisque la révolution dans ces territoires‑là, c’est l’avènement d’une politique eugéniste autoritaire), mais aussi orphelin coincé avec sa tante et son oncle classe moyenne maltraitante. La vie c’est facile, il suff i t de faire mon travail. Tendresses.
Colophon
Relecture par Yann Trividic, Lou Ferrand.
Publié sous licence Édition équitable.
Version imprimeur
Une version papier de Thune amertume fortune, mise en page avec InDesign et imprimée en Numérique sur Lenza Top Recycling 300 g/m², Munken Print White 90 g/m2 en 300 exemplaires lors du premier tirage par Corlet Imprimeur (ZI, rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie), reliée en dos carré collé, et distribuée par Paon Serendip est parue en avril 2022 avec l’ISBN suivant : 978-2-49353-401-9.
Cette version a été composée par Elorah Connil en Adobe Garamond Pro (Robert Slimbach), Cristoforo (Thomas Phinney, Herman Ihlenburg), Easter Sunrise et Hoefler Text (Jonathan Hoefler).
Le PDF est à retrouver sur la version « desktop » de notre site.
Versions A4, A5 et A5 imposée
Design graphique en web-to-print par Amélie Dumont.
La famille de caractères utilisée pour composer ces différents PDF est la Full~Times. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la dessinatrice de caractères Amélie Dumont et les éditions Burn~Août.
Ces fichiers sont à télécharger depuis la version « desktop » de notre site. Ils ont été produits grâce à WeasyPrint à partir du contenu de notre site web, lui-même généré avec Pelican depuis une base de données en AsciiDoc. Le code source est entièrement disponible sur notre dépôt GitLab sous une licence libre. Les fichiers InDesign à l’origine de cette publication ont été convertis en AsciiDoc par Laura Amazo.